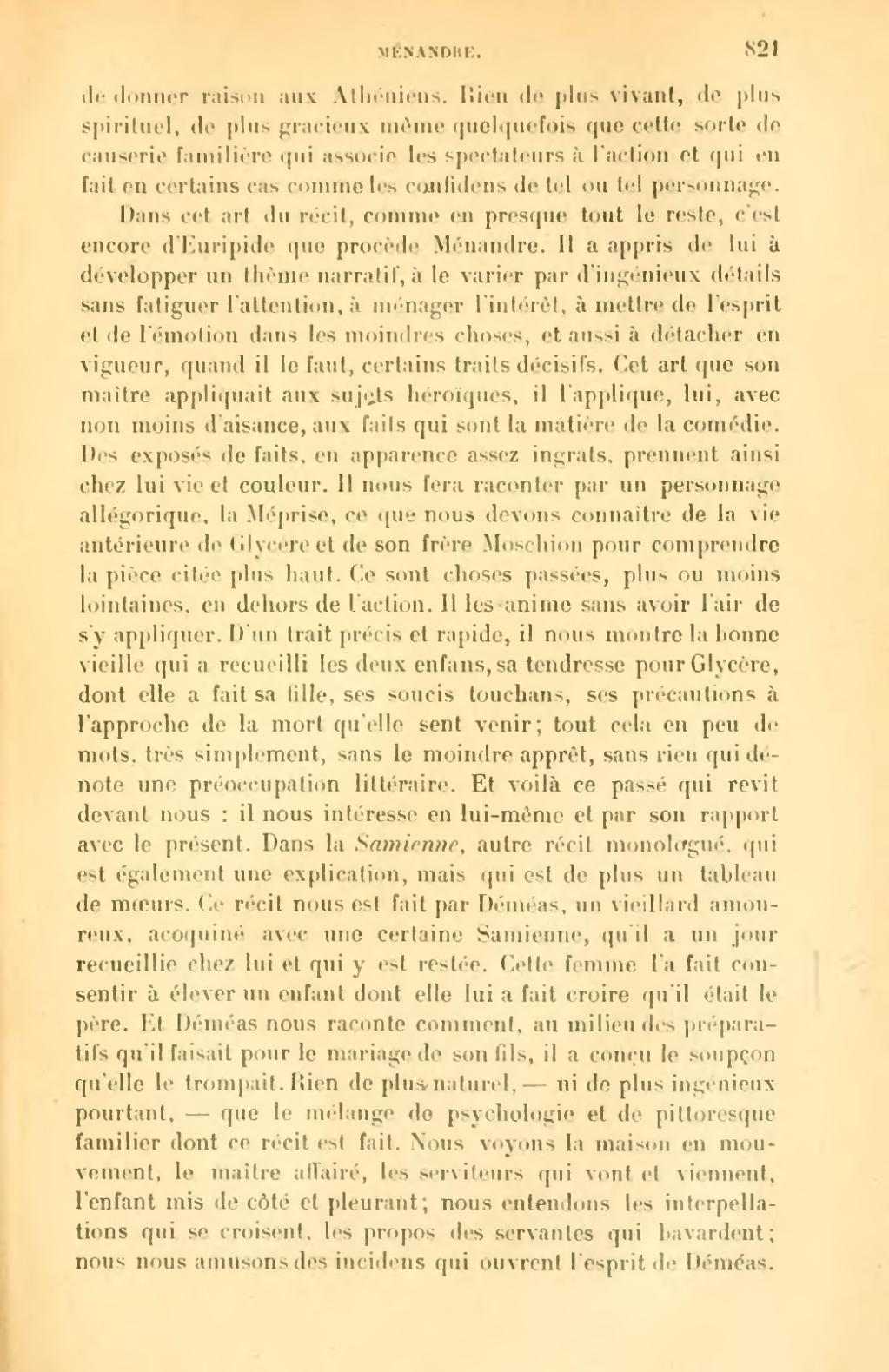de donner raison aux Athéniens, Rien de plus vivant, de plus spirituel, de plus gracieux même quelquefois que cette sorte de causerie familière qui associe les spectateurs à l’action et qui en fait en certains cas comme les confidens de tel ou tel personnage.
Dans cet art du récit, comme en presque tout le reste, c’est encore d’Euripide que procède Ménandre. Il a appris de lui à développer un thème narratif, à le varier par d’ingénieux détails sans fatiguer l’attention, à ménager l’intérêt, à mettre de l’esprit et de l’émotion dans les moindres choses, et aussi à détacher en vigueur, quand il le faut, certains traits décisifs. Cet art que son maître appliquait aux sujets héroïques, il l’applique, lui, avec non moins d’aisance, aux faits qui sont la matière de la comédie. Des exposés de faits, en apparence assez ingrats, prennent ainsi chez lui vie et couleur. Il nous fera raconter par un personnage allégorique, la Méprise, ce que nous devons connaître de la vie antérieure de Glycère et de son frère Moschion pour comprendre la pièce citée plus haut. Ce sont choses passées, plus ou moins lointaines, en dehors de l’action. Il les anime sans avoir l’air de s’y appliquer. D’un trait précis et rapide, il nous montre la bonne vieille qui a recueilli les deux enfans, sa tendresse pour Glycère, dont elle a fait sa fille, ses soucis touchans, ses précautions à l’approche de la mort qu’elle sent venir ; tout cela en peu de mots, très simplement, sans le moindre apprêt, sans rien qui dénote une préoccupation littéraire. Et voilà ce passé qui revit devant nous : il nous intéresse en lui-même et par son rapport avec le présent. Dans la Samienne, autre récit monologué, qui est également une explication, mais qui est de plus un tableau de mœurs. Ce récit nous est fait par Déméas, un vieillard amoureux, acoquiné avec une certaine Samienne, qu’il a un jour recueillie chez lui et qui y est restée. Cette femme l’a fait consentir à élever un enfant dont elle lui a fait croire qu’il était le père. Et Déméas nous raconte comment, au milieu des préparatifs qu’il faisait pour le mariage de son fils, il a conçu le soupçon qu’elle le trompait. Rien de plus naturel, — ni de plus ingénieux pourtant, — que le mélange de psychologie et de pittoresque familier dont ce récit est fait. Nous voyons la maison en mouvement, le maître affairé, les serviteurs qui vont et viennent, l’enfant mis de côté et pleurant ; nous entendons les interpellations qui se croisent, les propos des servantes qui bavardent ; nous nous amusons des incidens qui ouvrent l’esprit de Déméas.