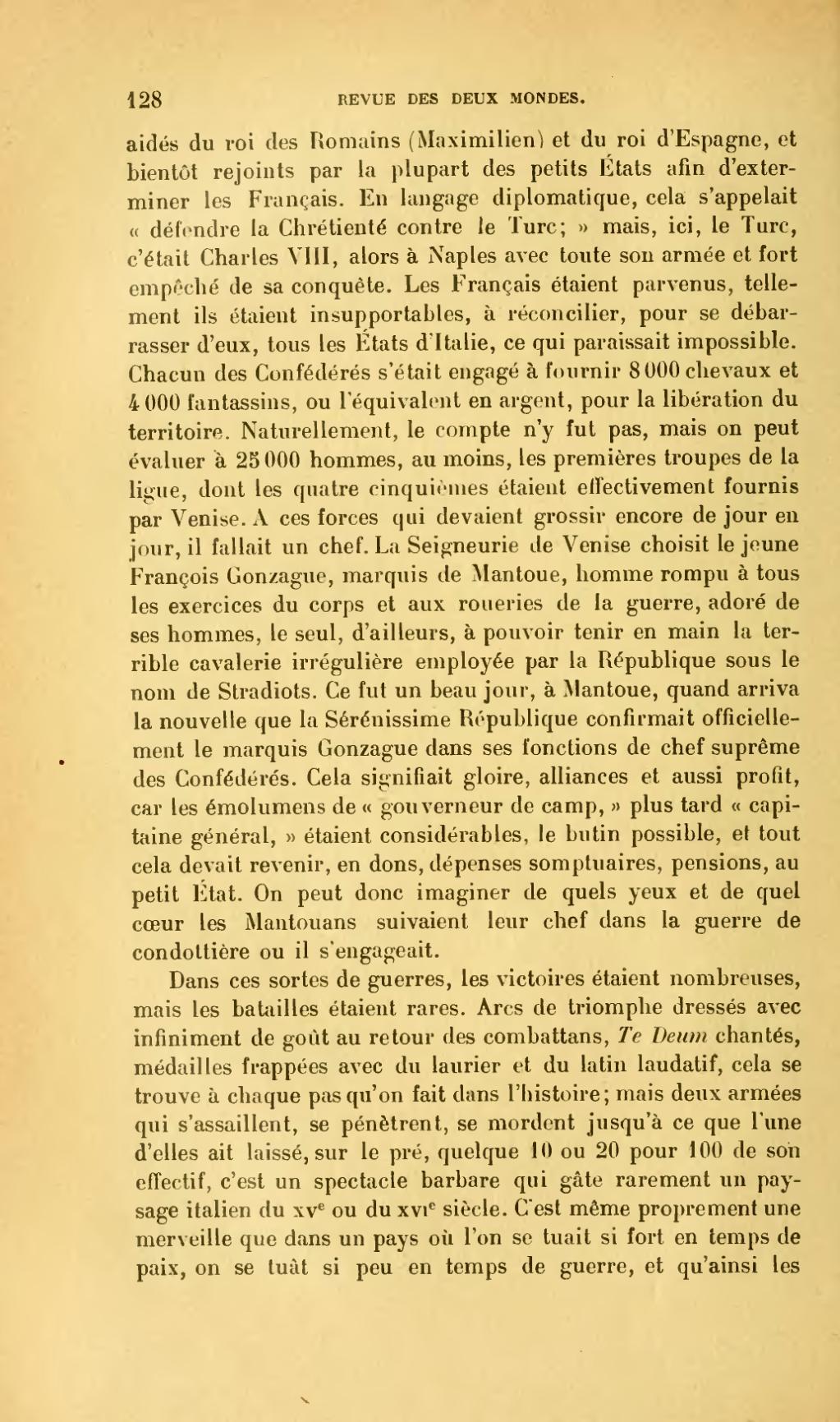aidés du roi des Romains (Maximilien) et du roi d’Espagne, et bientôt rejoints par la plupart des petits Etats afin d’exterminer les Français. En langage diplomatique, cela s’appelait « défendre la Chrétienté contre le Turc ; » mais, ici, le Turc, c’était Charles VIII, alors à Naples avec toute son armée et fort empêché de sa conquête. Les Français étaient parvenus, tellement ils étaient insupportables, à réconcilier, pour se débarrasser d’eux, tous les Etats d’Italie, ce qui paraissait impossible. Chacun des Confédérés s’était engagé à fournir 8 000 chevaux et 4 000 fantassins, ou l’équivalent en argent, pour la libération du territoire. Naturellement, le compte n’y fut pas, mais on peut évaluer à 25 000 hommes, au moins, les premières troupes de la ligue, dont les quatre cinquièmes étaient effectivement fournis par Venise. À ces forces qui devaient grossir encore de jour en jour, il fallait un chef. La Seigneurie de Venise choisit le jeune François Gonzague, marquis de Mantoue, homme rompu à tous les exercices du corps et aux roueries de la guerre, adoré de ses hommes, le seul, d’ailleurs, à pouvoir tenir en main la terrible cavalerie irrégulière employée par la République sous le nom de Stradiots. Ce fut un beau jour, à Mantoue, quand arriva la nouvelle que la Sérénissime République confirmait officiellement le marquis Gonzague dans ses fonctions de chef suprême des Confédérés. Cela signifiait gloire, alliances et aussi profit, car les émolumens de « gouverneur de camp, » plus tard « capitaine général, » étaient considérables, le butin possible, et tout cela devait revenir, en dons, dépenses somptuaires, pensions, au petit Etat. On peut donc imaginer de quels yeux et de quel cœur les Mantouans suivaient leur chef dans la guerre de condottiere ou il s’engageait.
Dans ces sortes de guerres, les victoires étaient nombreuses, mais les batailles étaient rares. Arcs de triomphe dressés avec infiniment de goût au retour des combattans, Te Deum chantés, médailles frappées avec du laurier et du latin laudatif, cela se trouve à chaque pas qu’on fait dans l’histoire ; mais deux armées qui s’assaillent, se pénètrent, se mordent jusqu’à ce que l’une d’elles ait laissé, sur le pré, quelque 10 ou 20 pour 100 de son effectif, c’est un spectacle barbare qui gâte rarement un paysage italien du XVe ou du XVIe siècle. C’est même proprement une merveille que dans un pays où l’on se tuait si fort en temps de paix, on se tuât si peu en temps de guerre, et qu’ainsi les