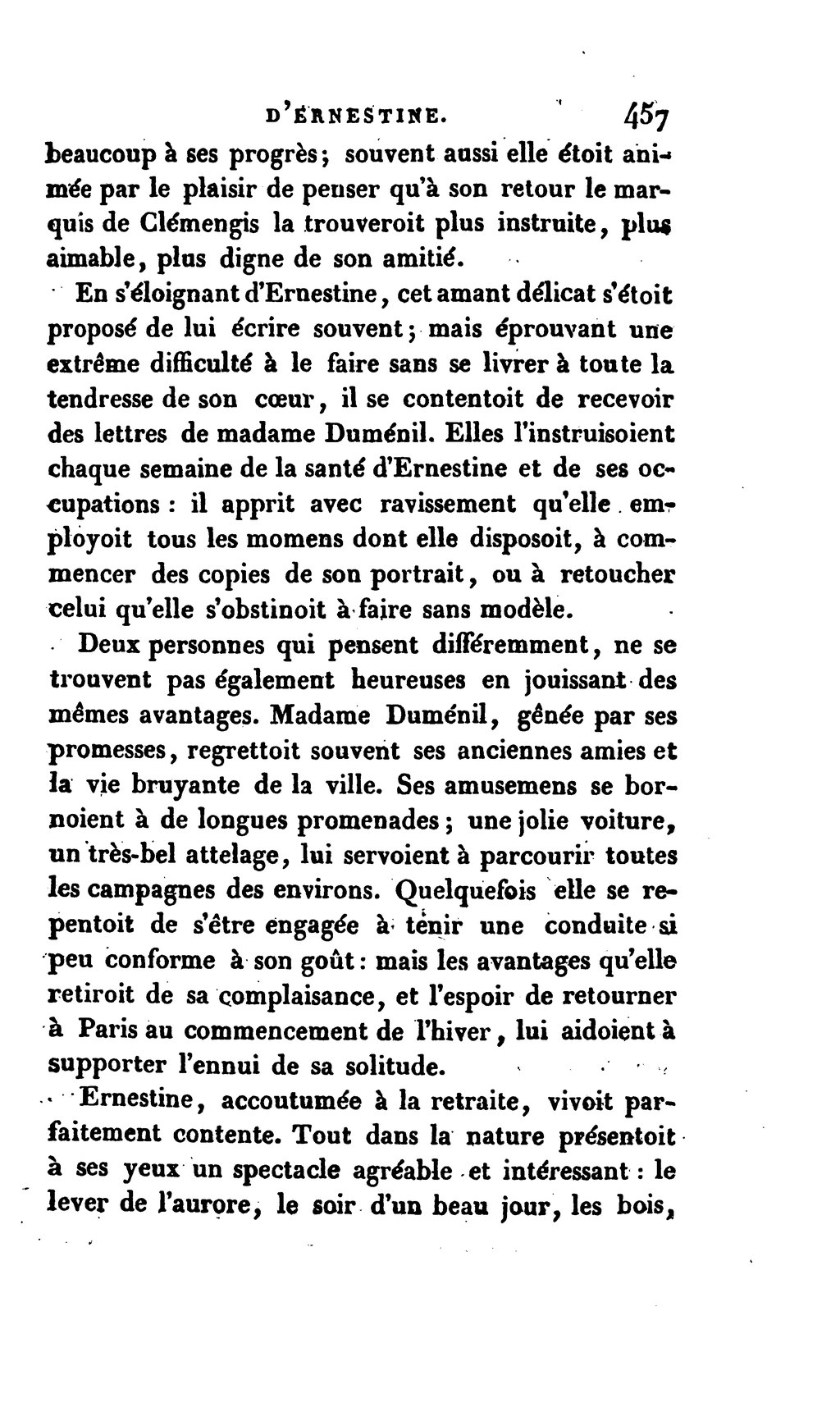beaucoup à ses progrès ; souvent aussi elle étoit animée par le plaisir de penser qu’à son retour le marquis de Clémengis la trouveroit plus instruite, plus aimable, plus digne de son amitié.
En s’éloignant d’Ernestine, cet amant délicat s’étoit proposé de lui écrire souvent ; mais éprouvant une extrême difficulté à le faire sans se livrer à toute la tendresse de son cœur, il se contentoit de recevoir des lettres de madame Duménil. Elles l’instruisoient chaque semaine de la santé d’Ernestine et de ses occupations : il apprit avec ravissement qu’elle employoit tous les momens dont elle disposoit, à commencer des copies de son portrait, ou à retoucher celui qu’elle s’obstinoit à faire sans modèle.
Deux personnes qui pensent différemment, ne se trouvent pas également heureuses en jouissant des mêmes avantages. Madame Duménil, gênée par ses promesses, regrettoit souvent ses anciennes amies et la vie bruyante de la ville. Ses amusemens se bornoient à de longues promenades ; une jolie voiture, un très bel attelage, lui servoient à parcourir toutes les campagnes des environs. Quelquefois elle se repentoit de s’être engagée à tenir une conduite si peu conforme à son goût : mais les avantages qu’elle retiroit de sa complaisance, et l’espoir de retourner à Paris au commencement de l’hiver, l’aidoient à supporter l’ennui de sa solitude.
Ernestine, accoutumée à la retraite, vivoit parfaitement contente. Tout dans la nature présentoit à ses yeux un spectacle agréable et intéressant : le lever de l’aurore, le soir d’un beau jour, les bois,