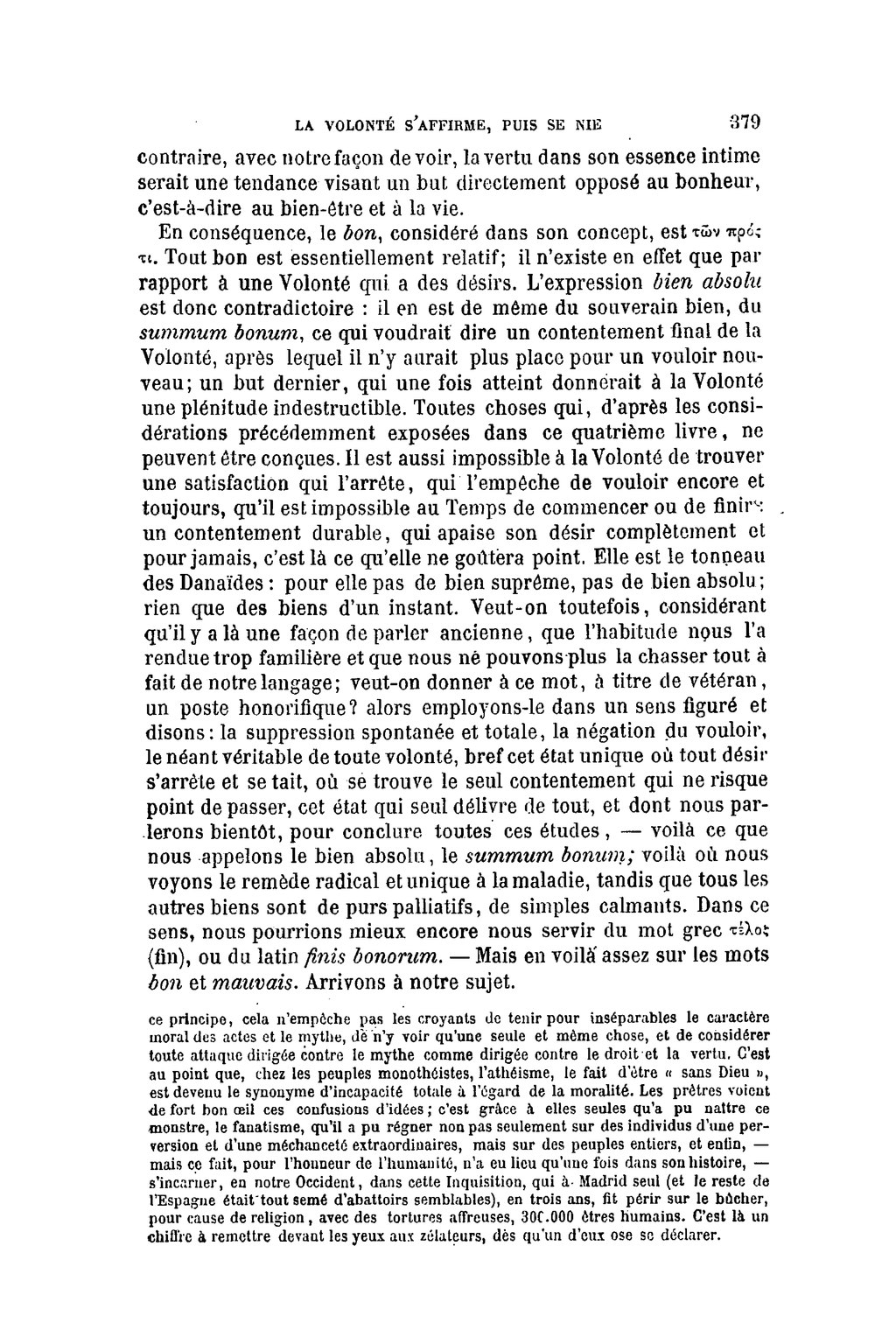contraire, avec notre façon de voir, la vertu dans son essence intime serait une tendance visant un but directement opposé au bonheur, c’est-à-dire au bien-être et à la vie.
En conséquence, le bon, considéré dans son concept, est των προς τι. Tout bon est essentiellement relatif ; il n’existe en effet que par rapport à une Volonté qui a des désirs. L’expression bien absolu est donc contradictoire : il en est de même du souverain bien, du summum bonum, ce qui voudrait dire un contentement final de la Volonté, après lequel il n’y aurait plus place pour un vouloir nouveau ; un but dernier, qui une fois atteint donnerait à la Volonté une plénitude indestructible. Toutes choses qui, d’après les considérations précédemment exposées dans ce quatrième livre, ne peuvent être conçues. Il est aussi impossible à la Volonté de trouver une satisfaction qui l’arrête, qui l’empêche de vouloir encore et toujours, qu’il est impossible au Temps de commencer ou de finir à un contentement durable, qui apaise son désir complètement et pour jamais, c’est là ce qu’elle ne goûtera point. Elle est le tonneau des Danaïdes : pour elle pas de bien suprême, pas de bien absolu ; rien que des biens d’un instant. Veut-on toutefois, considérant qu’il y a là une façon de parler ancienne, que l’habitude nous l’a rendue trop familière et que nous ne pouvons plus la chasser tout à fait de notre langage ; veut-on donner à ce mot, à titre de vétéran, un poste honorifique ? alors employons-le dans un sens figuré et disons : la suppression spontanée et totale, la négation du vouloir, le néant véritable de toute volonté, bref cet état unique où tout désir s’arrête et se tait, où se trouve le seul contentement qui ne risque point de passer, cet état qui seul délivre de tout, et dont nous parlerons bientôt, pour conclure toutes ces études, — voilà ce que nous appelons le bien absolu, le summum bonum ; voilà où nous voyons le remède radical et unique à la maladie, tandis que tous les autres biens sont de purs palliatifs, de simples calmants. Dans ce sens, nous pourrions mieux encore nous servir du mot grec τελος (fin), ou du latin finis bonorum. — Mais en voilà’assez sur les mots bon et mauvais. Arrivons à notre sujet.
ce principe, cela n’empêche pas les croyants de tenir pour inséparables le caractère moral des actes et le mythe, de n’y voir qu’une seule et même chose, et de considérer toute attaque dirigée contre le mythe comme dirigée contre le droit et la vertu. C’est au point que, chez les peuples monothéistes, l’athéisme, le fait d’être « sans Dieu », est devenu le synonyme d’incapacité totale à l’égard de la moralité. Les prêtres voient de fort bon œil ces confusions d’idées ; c’est grâce à elles seules qu’a pu naître ce monstre, le fanatisme, qu’il a pu régner non pas seulement sur des individus d’une perversion et d’une méchanceté extraordinaires, mais sur des peuples entiers, et enfin, — mais ce fait, pour l’honneur de l’humanité, n’a eu lieu qu’une fois dans son histoire, — s’incarner, en notre Occident, dans cette Inquisition, qui à Madrid seul (et le reste de l’Espagne était tout semé d’abattoirs semblables), en trois ans, fit périr sur le bûcher, pour cause de religion, avec des tortures affreuses, 300.000 êtres humains. C’est là un chiffre à remettre devant les yeux aux zélateurs, dès qu’un d’eux ose se déclarer.