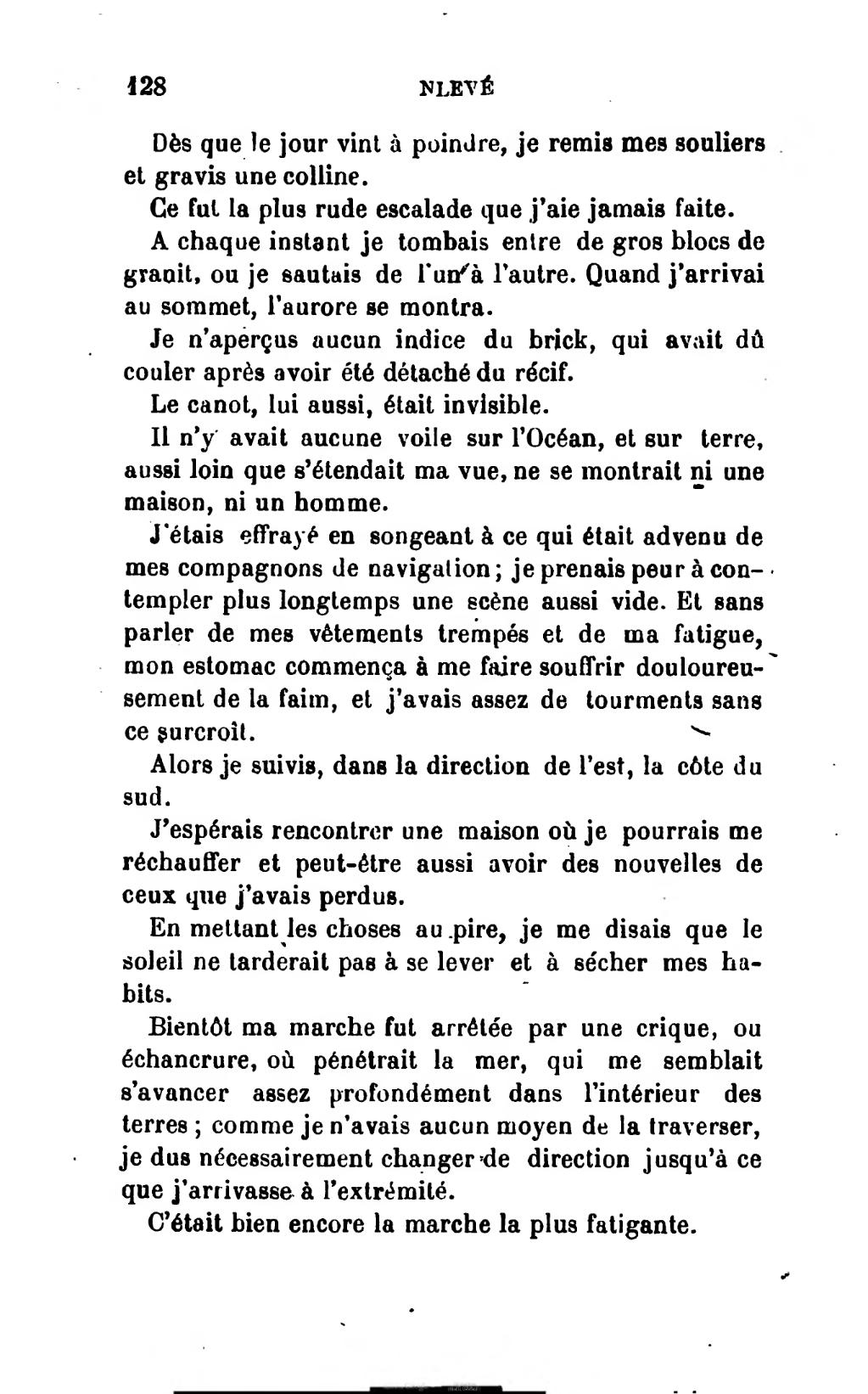Dès que le jour vint à poindre, je remis mes souliers et gravis une colline.
Ce fut la plus rude escalade que j’aie jamais faite.
À chaque instant je tombais entre de gros blocs de granit, ou je sautais de l’un à l’autre. Quand j’arrivai au sommet, l’aurore se montra.
Je n’aperçus aucun indice du brick, qui avait dû couler après avoir été détaché du récif.
Le canot, lui aussi, était invisible.
Il n’y avait aucune voile sur l’Océan, et sur terre, aussi loin que s’étendait ma vue, ne se montrait ni une maison, ni un homme.
J’étais effrayé en songeant à ce qui était advenu de mes compagnons de navigation ; je prenais peur à contempler plus longtemps une scène aussi vide. Et sans parler de mes vêtements trempés et de ma fatigue, mon estomac commença à me faire souffrir douloureusement de la faim, et j’avais assez de tourments sans ce surcroît.
Alors je suivis, dans la direction de l’est, la côte du sud.
J’espérais rencontrer une maison où je pourrais me réchauffer et peut-être aussi avoir des nouvelles de ceux que j’avais perdus.
En mettant les choses au pire, je me disais que le soleil ne tarderait pas à se lever et à sécher mes habits.
Bientôt ma marche fut arrêtée par une crique, ou échancrure, où pénétrait la mer, qui me semblait s’avancer assez profondément dans l’intérieur des terres ; comme je n’avais aucun moyen de la traverser, je dus nécessairement changer de direction jusqu’à ce que j’arrivasse à l’extrémité.
C’était bien encore la marche la plus fatigante.