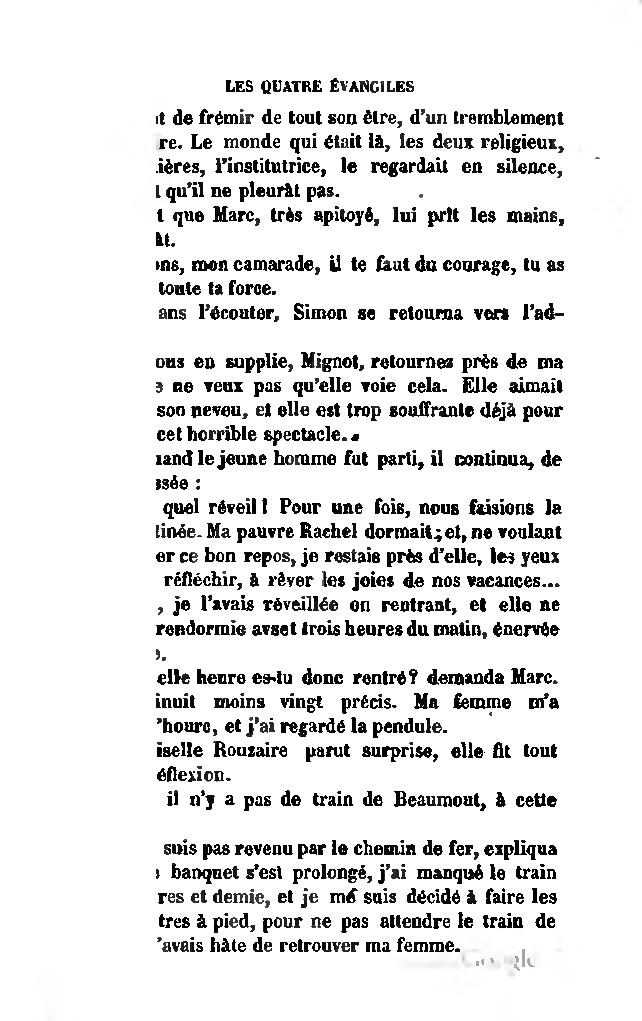de frémir de tout son être, d’un tremblement involontaire. Le monde qui était là, les deux religieux, les papetières, l’institutrice, le regardait en silence, s’étonnant qu’il ne pleurât pas.
Il fallut que Marc, très apitoyé, lui prît les mains, l’embrassât.
— Voyons, mon camarade, il te faut du courage, tu as besoin de toute ta force.
Mais, sans l’écouter, Simon se retourna vers l’adjoint.
— Je vous en supplie, Mignot, retournez auprès de ma femme. Je ne veux pas qu’elle voie cela. Elle aimait beaucoup son neveu, et elle est trop souffrante déjà pour supporter cet horrible spectacle.
Puis, quand le jeune homme fut parti, il continua, de sa voix cassée.
— Ah ! quel réveil ! Pour une fois, nous faisions la grasse matinée. Ma pauvre Rachel dormait ; et, ne voulant pas troubler ce bon repos, je restais près d’elle, les yeux ouverts, à réfléchir, à rêver les joies de nos vacances… Cette nuit, je l’avais réveillée en rentrant, et elle ne s’était pas rendormie avant trois heures du matin, énervée par l’orage.
— À quelle heure es-tu donc rentré ? demanda Marc.
— À minuit moins vingt précis. Ma femme m’a demandé l’heure, et j’ai regardé la pendule.
Mlle Rouzaire parut surprise, elle fit tout haut une réflexion.
— Mais il n’y a pas de train de Beaumont, à cette heure-là.
— Je ne suis pas revenu par le chemin de fer, expliqua Simon. Le banquet s’est prolongé, j’ai manqué le train de dix heures et demie, et je me suis décidé à faire les six kilomètres à pied, pour ne pas attendre le train de minuit… J’avais hâte de retrouver ma femme.