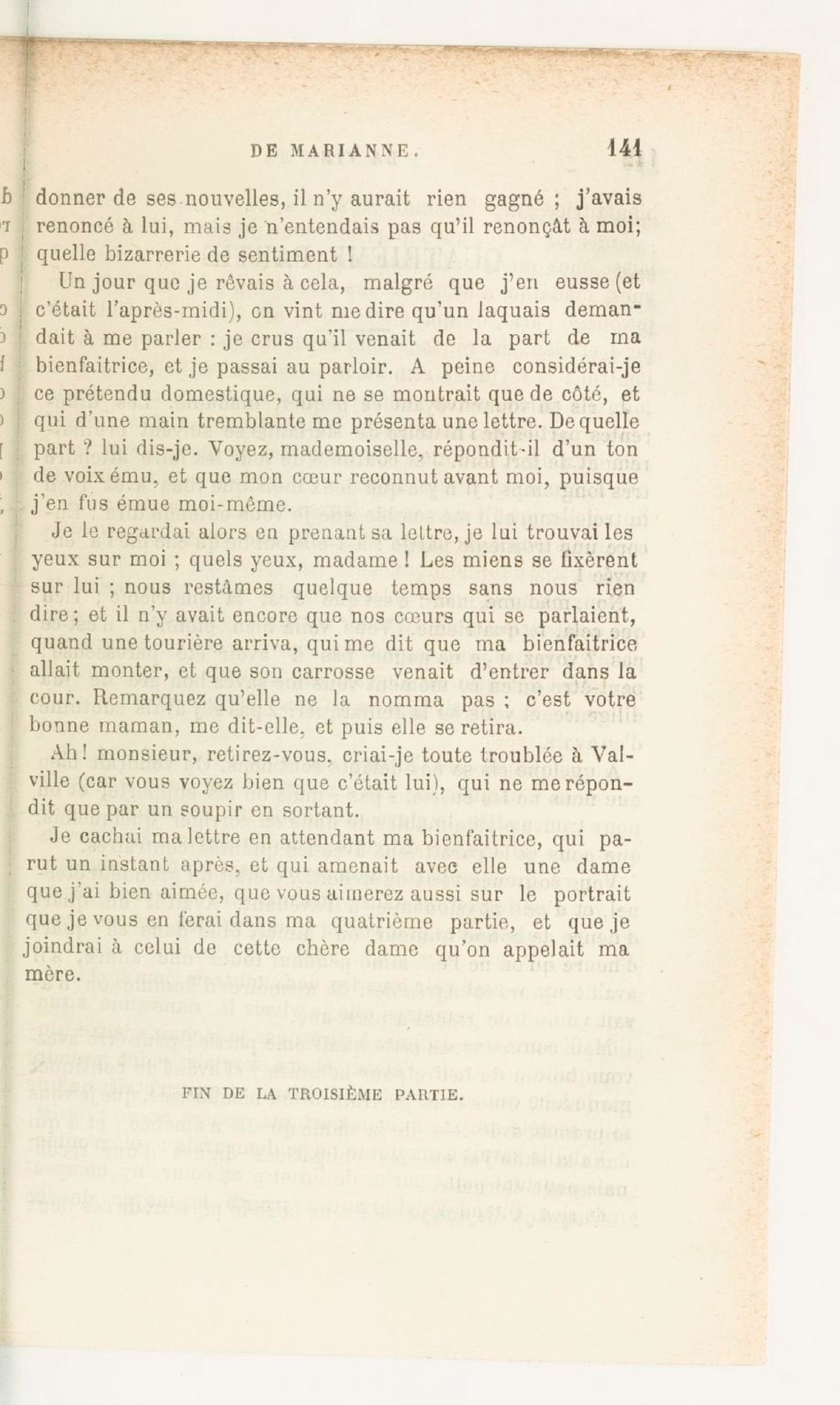donner de ses nouvelles, il n’y aurait rien gagné ; j’avais renoncé à lui, mais je n’entendais pas qu’il renonçât à moi ; quelle bizarrerie de sentiment !
Un jour que je rêvais à cela, malgré que j’en eusse (et c’était l’après-midi), on vint me dire qu’un laquais demandait à me parler : je crus qu’il venait de la part de ma bienfaitrice, et je passai au parloir. À peine considérai-je ce prétendu domestique, qui ne se montrait que de côté, et qui d’une main tremblante me présenta une lettre. De quelle part ? lui dis-je. Voyez, mademoiselle, répondit-il d’un ton de voix ému, et que mon cœur reconnut avant moi, puisque j’en fus émue moi-même.
Je le regardai alors en prenant sa lettre, je lui trouvai les yeux sur moi ; quels yeux, madame ! Les miens se fixèrent sur lui ; nous restâmes quelque temps sans nous rien dire ; et il n’y avait encore que nos cœurs qui se parlaient, quand une tourière arriva, qui me dit que ma bienfaitrice allait monter, et que son carrosse venait d’entrer dans la cour. Remarquez qu’elle ne la nomma pas ; c’est votre bonne maman, me dit-elle, et puis elle se retira.
Ah ! monsieur, retirez-vous, criai-je toute troublée à Valville (car vous voyez bien que c’était lui), qui ne me répondit que par un soupir en sortant.
Je cachai ma lettre en attendant ma bienfaitrice, qui parut un instant après, et qui amenait avec elle une dame que j’ai bien aimée, que vous aimerez aussi sur le portrait que je vous en ferai dans ma quatrième partie, et que je joindrai à celui de cette chère dame qu’on appelait ma mère.