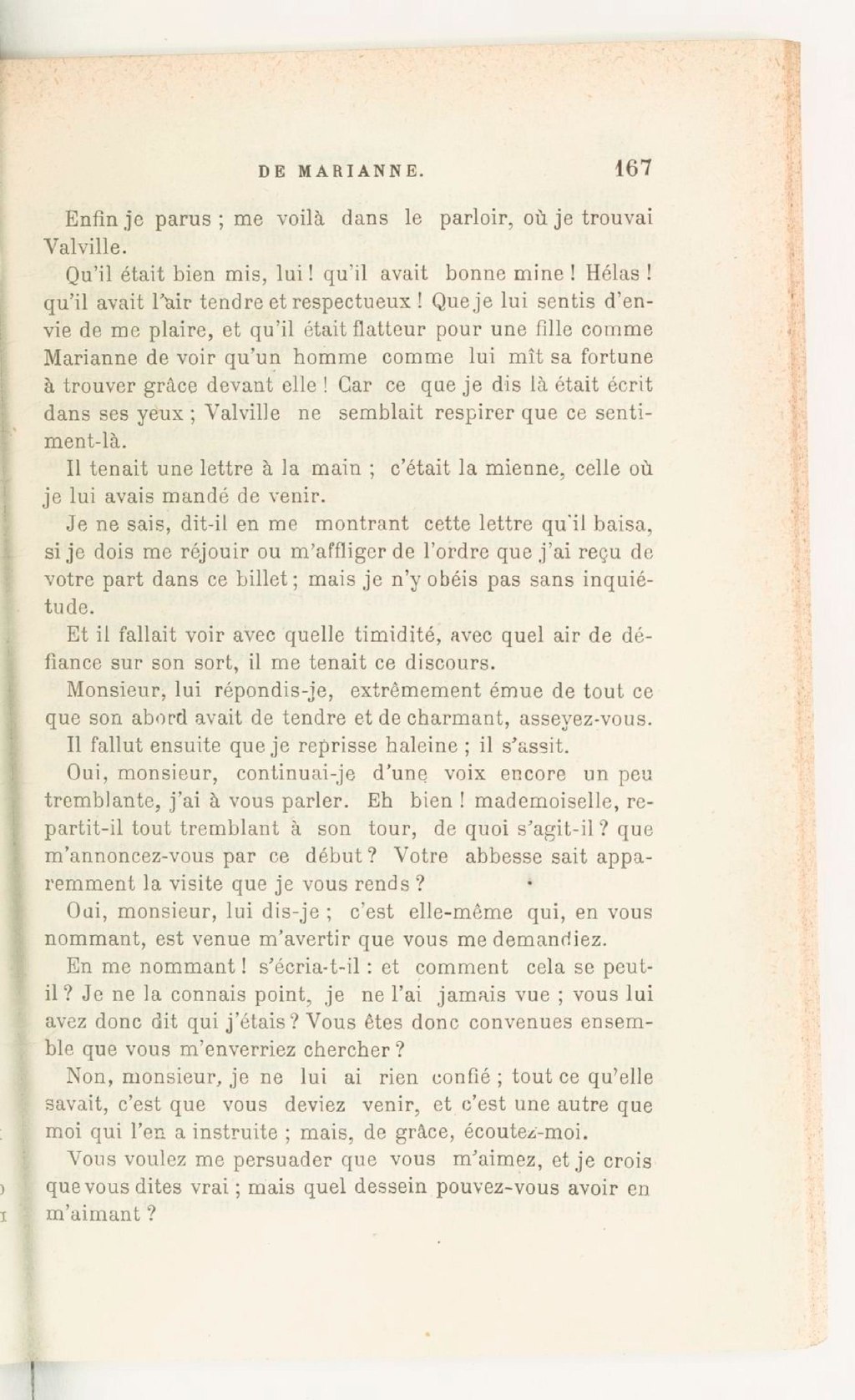Enfin je parus ; me voilà dans le parloir, où je trouvai Valville.
Qu’il était bien mis, lui ! qu’il avait bonne mine ! Hélas ! qu’il avait l’air tendre et respectueux ! Que je lui sentis d’envie de me plaire, et qu’il était flatteur pour une fille comme Marianne de voir qu’un homme comme lui mît sa fortune à trouver grâce devant elle ! Car ce que je dis là était écrit dans ses yeux ; Valville ne semblait respirer que ce sentiment-là.
Il tenait une lettre à la main ; c’était la mienne, celle où je lui avais mandé de venir.
Je ne sais, dit-il en me montrant cette lettre qu’il baisa, si je dois me réjouir ou m’affliger de l’ordre que j’ai reçu de votre part dans ce billet ; mais je n’y obéis pas sans inquiétude.
Et il fallait voir avec quelle timidité, avec quel air de défiance sur son sort, il me tenait ce discours.
Monsieur, lui répondis-je, extrêmement émue de tout ce que son abord avait de tendre et de charmant, asseyez-vous.
Il fallut ensuite que je reprisse baleine ; il s’assit.
Oui, monsieur, continuai-je d’une voix encore un peu tremblante, j’ai à vous parler. Eh bien ! mademoiselle, repartit-il tout tremblant à son tour, de quoi s’agit-il ? que m’annoncez-vous par ce début ? Votre abbesse sait apparemment la visite que je vous rends ?
Oui, monsieur, lui dis-je ; c’est elle-même qui, en vous nommant, est venue m’avertir que vous me demandiez.
En me nommant ! s’écria-t-il : et comment cela se peut-il ? Je ne la connais point, je ne l’ai jamais vue ; vous lui avez donc dit qui j’étais ? Vous êtes donc convenues ensemble que vous m’enverriez chercher ?
Non, monsieur, je ne lui ai rien confié ; tout ce qu’elle savait, c’est que vous deviez venir, et c’est une autre que moi qui l’en a instruite ; mais, de grâce, écoutez-moi.
Vous voulez me persuader que vous m’aimez, et je crois que vous dites vrai ; mais quel dessein pouvez-vous avoir en m’aimant ?