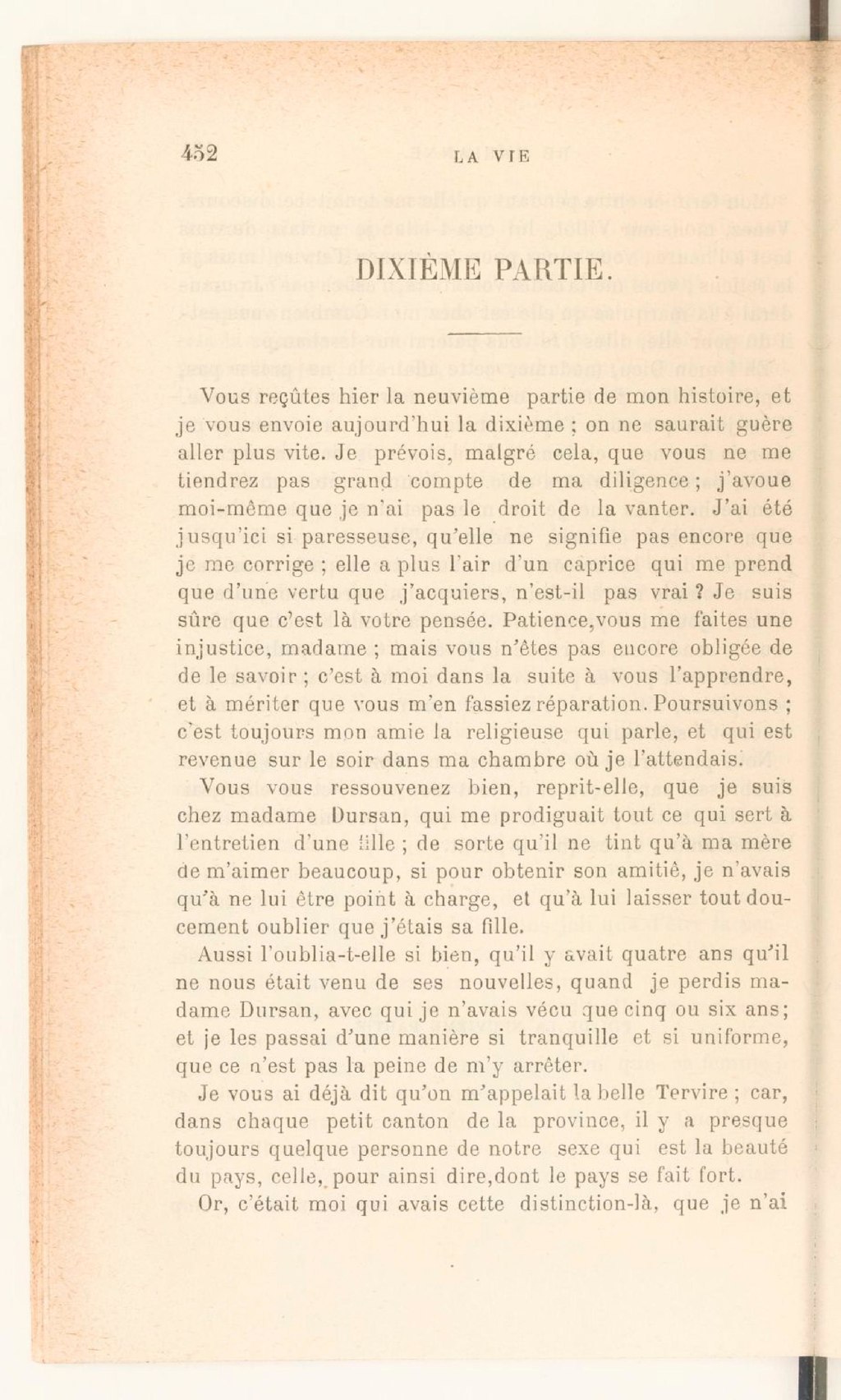DIXIÈME PARTIE.
Vous reçûtes hier la neuvième partie de mon histoire, et je vous envoie aujourd’hui la dixième ; on ne saurait guère aller plus vite. Je prévois, malgré cela, que vous ne me tiendrez pas grand compte de ma diligence ; j’avoue moi-même que je n’ai pas le droit de la vanter. J’ai été jusqu’ici si paresseuse, qu’elle ne signifie pas encore que je me corrige ; elle a plus l’air d’un caprice qui me prend que d’une vertu que j’acquiers, n’est-il pas vrai ? Je suis sûre que c’est là votre pensée. Patience, vous me faites une injustice, madame ; mais vous n’êtes pas encore obligée de le savoir ; c’est à moi dans la suite à vous l’apprendre, et à mériter que vous m’en fassiez réparation. Poursuivons ; c’est toujours mon amie la religieuse qui parle, et qui est revenue sur le soir dans ma chambre où je l’attendais.
Vous vous ressouvenez bien, reprit-elle, que je suis chez madame Dursan, qui me prodiguait tout ce qui sert à l’entretien d’une fille ; de sorte qu’il ne tint qu’à ma mère de m’aimer beaucoup, si pour obtenir son amitié, je n’avais qu’à ne lui être point à charge, et qu’à lui laisser tout doucement oublier que j’étais sa fille.
Aussi l’oublia-t-elle si bien, qu’il y avait quatre ans qu’il ne nous était venu de ses nouvelles, quand je perdis madame Dursan, avec qui je n’avais vécu que cinq ou six ans ; et je les passai d’une manière si tranquille et si uniforme, que ce n’est pas la peine de m’y arrêter.
Je vous ai déjà dit qu’on m’appelait la belle Tervire ; car, dans chaque petit canton de la province, il y a presque toujours quelque personne de notre sexe qui est la beauté du pays, celle, pour ainsi dire, dont le pays se fait fort.
Or, c’était moi qui avais cette distinction-là, que je n’ai