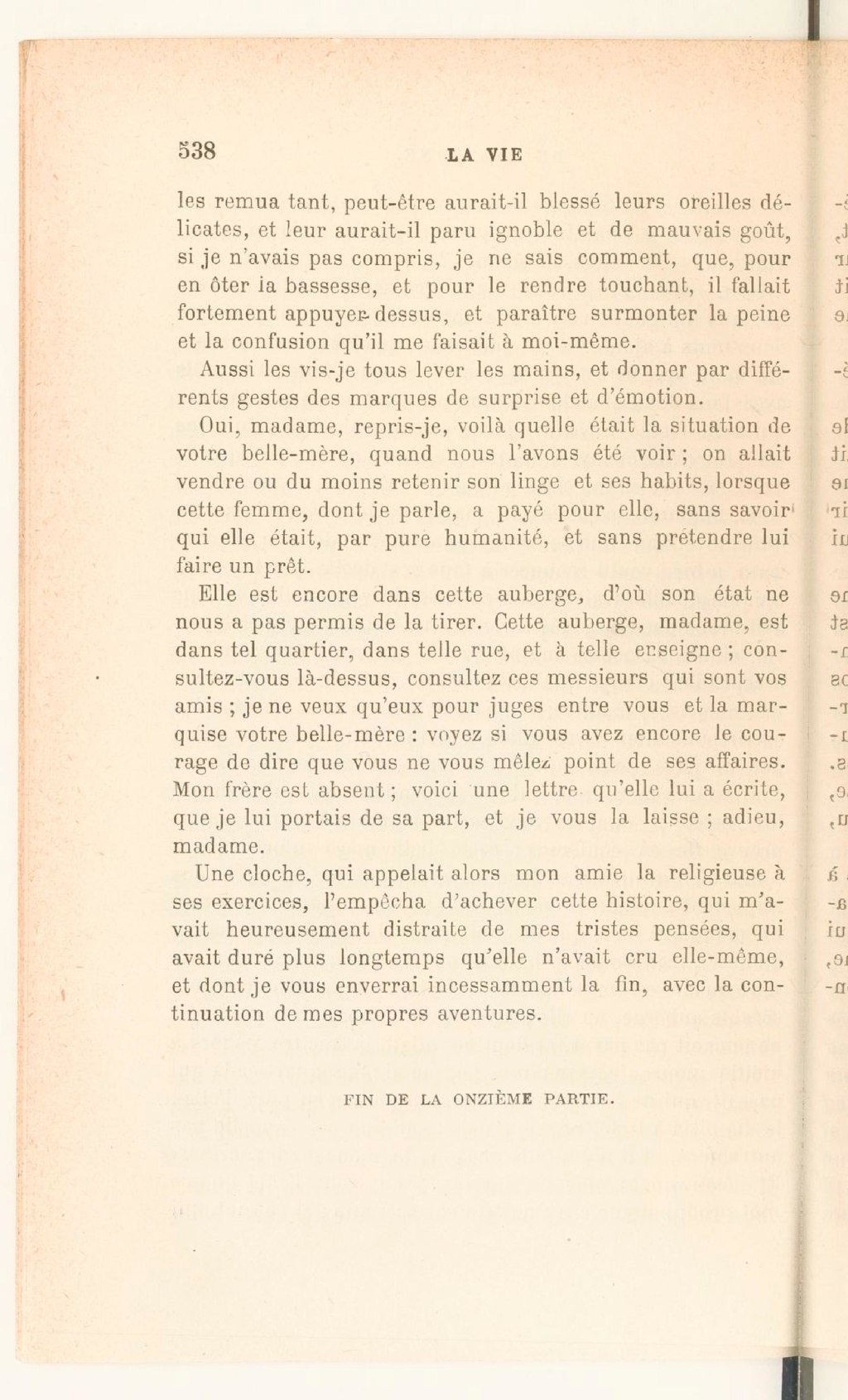les remua tant, peut-être aurait-il blessé leurs oreilles délicates, et leur aurait-il paru ignoble et de mauvais goût, si je n’avais pas compris, je ne sais comment, que, pour en ôter la bassesse, et pour le rendre touchant, il fallait fortement appuyer dessus, et paraître surmonter la peine et la confusion qu’il me faisait à moi-même.
Aussi les vis-je tous lever les mains, et donner par différents gestes des marques de surprise et d’émotion.
Oui, madame, repris-je, voilà quelle était la situation de votre belle-mère, quand nous l’avons été voir ; on allait vendre ou du moins retenir son linge et ses habits, lorsque cette femme, dont je parle, a payé pour elle, sans savoir qui elle était, par pure humanité, et sans prétendre lui faire un prêt.
Elle est encore dans cette auberge, d’où son état ne nous a pas permis de la tirer. Cette auberge, madame, est dans tel quartier, dans telle rue, et à telle enseigne ; consultez-vous là-dessus, consultez ces messieurs qui sont vos amis ; je ne veux qu’eux pour juges entre vous et la marquise votre belle-mère : voyez si vous avez encore le courage de dire que vous ne vous mêlez, point de ses affaires. Mon frère est absent ; voici une lettre qu’elle lui a écrite, que je lui portais de sa part, et je vous la laisse ; adieu, madame.
Une cloche, qui appelait alors mon amie la religieuse à ses exercices, l’empêcha d’achever cette histoire, qui m’avait heureusement distraite de mes tristes pensées, qui avait duré plus longtemps qu’elle n’avait cru elle-même, et dont je vous enverrai incessamment la fin, avec la continuation de mes propres aventures.