Le Livre des mille nuits et une nuit/Tome 10/Texte entier
LE LIVRE DES MILLE NUITS ET UNE NUIT
strictement réservés.
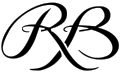
MÉDECIN DES HÔPITAUX, — QUI EST LA RÉALISATION MÊME DU SAVANT SELON NOTRE CŒUR, — CET HOMMAGE DE SON AMI
LES AVENTURES DE HASSÂN AL-BASSRI
Et Schahrazade dit au roi Schahriar :
Sache, ô Roi fortuné, que l’histoire merveilleuse que je vais te raconter a une origine extraordinaire qu’il faut que je te révèle, avant de commencer ; sinon il ne serait point aisé de comprendre comment elle est parvenue jusqu’à moi.
Il y avait, en effet, dans les années et les âges d’il y a bien longtemps, un roi d’entre les rois de la Perse et du Khorassân, qui avait sous sa domination les pays de l’Inde, du Sindh et de la Chine, ainsi que les peuples qui habitent au delà de l’Oxus dans les terres barbares. Il s’appelait le roi Kendamir. Et c’était un héros au courage indomptable et un cavalier de grande vaillance, sachant manier la lance, et passionné de tournois, de chasses et de chevauchées guerrières ; mais il préférait, et de beaucoup, à toutes choses la causerie avec les gens délicieux et les personnes de choix, et donnait près de lui, dans les festins, la place d’honneur aux poètes et aux conteurs. Bien plus ! quand un étranger, après avoir accepté son hospitalité, et éprouvé les effets de ses largesses et de sa générosité, lui narrait quelque conte encore inconnu ou quelque belle histoire, le roi Kendamir le comblait de faveurs et de bienfaits, et ne le renvoyait dans son pays qu’une fois satisfaits ses moindres désirs, et il le faisait accompagner durant tout le voyage par un cortège splendide de cavaliers et d’esclaves à ses ordres. Quant à ses conteurs habituels et à ses poètes, il les traitait avec les mêmes égards que ses vizirs et ses émirs. Et, de cette façon, le palais était devenu la demeure chérie de tous ceux qui savaient construire des vers, ordonner des odes ou faire revivre par la parole les passés abolis et les choses mortes.
Aussi, il ne faut point s’étonner que le roi Kendamir, au bout d’un certain temps, eût entendu tous les contes connus des Arabes, des Persans et des Indiens, et les eût conservés dans sa mémoire avec les passages les plus beaux des poètes et les enseignements des annalistes versés dans l’étude des peuples anciens. Si bien, qu’après avoir récapitulé tout ce qu’il savait, il ne lui resta plus rien à apprendre et plus rien à écouter.
Quand il se vit dans cet état, il fut pris d’une tristesse extrême et plongé dans une grande perplexité ! Alors, ne sachant plus comment occuper ses loisirs habituels, il se tourna vers son chef eunuque et lui dit : « Va vite me chercher Abou-Ali ! » Or, Abou-Ali était le conteur favori du roi Kendamir ; et il était si éloquent et si bien doué qu’il pouvait faire durer un conte pendant une année entière, sans discontinuer et sans, une seule nuit, lasser l’attention de ses auditeurs. Mais déjà il avait, lui, comme tous ses compagnons, épuisé son savoir et ses ressources d’éloquence, et depuis longtemps il se trouvait dans une pénurie d’histoires nouvelles.
L’eunuque se hâta donc d’aller le chercher et de l’introduire auprès du roi. Et le roi lui dit : « Voici, ô père de l’éloquence, que tu as épuisé ton savoir et que tu te trouves dans une pénurie d’histoires nouvelles ! Or, moi, je t’ai fait venir parce qu’il faut absolument qu’en dépit de tout tu me trouves un conte extraordinaire et de moi inconnu, et tel que jamais je n’aie entendu le pareil ! Car plus que jamais j’aime les histoires et le récit des aventures. Si donc tu réussis à me charmer par les belles paroles que tu me feras entendre, moi, en retour, je te ferai cadeau d’immenses terres dont tu seras le maître, et de châteaux-forts et de palais, avec un firman qui te libère de toutes taxes et redevances ; et je te nommerai aussi mon grand-vizir et te ferai asseoir à ma droite ; et tu gouverneras comme tu l’entendras, avec autorité pleine et entière, au milieu de mes vassaux et des sujets de mes royaumes. Et même, si tu le souhaites, je te léguerai le trône après ma mort, et, de mon vivant, tout ce qui m’appartient t’appartiendra ! Mais si ton destin est assez néfaste pour que tu ne puisses pas satisfaire au désir que je t’exprime, et qui me tient à l’âme bien plus que de posséder la terre entière, tu peux, dès à présent, aller faire tes adieux à tes parents et leur dire que le pal t’attend ! »
À ces paroles du roi Kendamir, le conteur Abou-Ali comprit qu’il était perdu sans recours, et répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il baissa la tête, bien jaune de teint, en proie au désespoir sans remède. Mais au bout d’un certain temps il releva la tête et dit : « Ô roi du temps, ton esclave l’ignorant demande une grâce de ta générosité, avant de mourir ! » Et le roi demanda : « Et quelle est-elle ? » Il dit : « C’est de lui accorder seulement un délai d’un an pour lui permettre de trouver ce que tu lui demandes. Mais si, ce délai passé, le conte en question n’est pas trouvé, et si, trouvé, il n’est pas le plus beau, le plus merveilleux et le plus extraordinaire qui soit parvenu à l’oreille des hommes, je subirai, sans amertume en mon âme, le supplice du pal ! »
À ces paroles, le roi Kendamir se dit : « Ce délai est bien long ! Et nul homme ne sait s’il doit vivre encore le lendemain ! » Puis il ajouta : « Pourtant, mon désir est si grand d’entendre encore une histoire, que je t’accorde ce délai d’un an ; mais c’est à condition que tu ne bouges pas de ta maison, durant ce laps de temps ! » Et le conteur Abou-Ali baisa la terre entre les mains du roi, et se hâta de s’en retourner à sa maison.
Là, après avoir longtemps réfléchi, il appela cinq de ses jeunes mamalik, qui savaient lire et écrire, et qui, en outre, étaient les plus sagaces, les plus dévoués et les plus distingués d’entre tous ses serviteurs, et leur remit à chacun cinq mille dinars d’or. Puis il leur dit : « Moi, je ne vous ai élevés et soignés et nourris dans ma maison que pour un jour comme celui-ci ! À vous donc de me porter secours et de m’aider à me tirer d’entre les mains du roi ! » Ils répondirent : « Ordonne, ô notre maître ! Nos âmes t’appartiennent, et nous sommes ta rançon ! » Il dit : « Voici ! Que chacun de vous parte pour les pays étrangers, sur les voies différentes d’Allah ! Parcourez tous les royaumes et toutes les contrées de la terre à la recherche des savants, des sages, des poètes et des conteurs les plus célèbres ! Et demandez-leur, afin de me la rapporter, s’ils ne connaissent pas l’Histoire des Aventures de Hassân Al-Bassri ! Et si, par une faveur du Très-Haut, l’un d’eux la connaît, priez-le de vous la raconter ou de vous l’écrire, à quelque prix que ce soit ! Car ce n’est que grâce à cette histoire-là que vous pouvez sauver votre maître du pal qui l’attend ! » Puis il se tourna vers chacun d’eux en particulier, et dit au premier mamelouk : « Toi, tu t’en iras vers les pays des Indes et du Sindh, et les contrées et provinces qui en dépendent ! » Et il dit au second : « Toi, tu t’en iras vers la Perse et la Chine et les pays limitrophes ! » Et il dit au troisième : « Toi, tu parcourras le Khorassân et ses dépendances ! » Et il dit au quatrième : « Toi, tu exploreras tout le Maghreb, de l’orient à l’occident ! » Et il dit au cinquième : « Quant à toi, ô Mobarak, tu visiteras le pays d’Égypte et la Syrie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
»… Quant à toi, ô Mobarak, tu visiteras le pays d’Égypte et la Syrie ! »
Ainsi parla, à ses cinq mamalik dévoués, le conteur Abou-Ali. Et il leur choisit, pour le départ, un jour de bénédiction, et leur dit : « Partez en ce jour béni ! Et revenez-moi avec l’histoire dont dépendra ma rédemption ! » Et ils prirent congé de lui, et se dispersèrent en cinq différentes directions.
Or, les quatre premiers, au bout d’onze mois, revinrent l’un après l’autre, le nez bien long, et dirent à leur maître que le destin, malgré les recherches les plus exactes dans les pays lointains qu’ils venaient de parcourir, ne les avait point mis sur la piste du conteur ou du savant qu’ils souhaitaient, et qu’ils n’avaient rencontré partout, dans les villes et sous les tentes, que des conteurs et des poètes ordinaires, dont les histoires étaient universellement connues ; mais que, quant aux aventures de Hassân Al-Bassri, nul ne les connaissait !
À ces paroles, la poitrine du vieux conteur Abou-Ali se rétrécit à la limite du rétrécissement, et le monde noircit sur son visage. Et il s’écria : « Il n’y a de recours et de force qu’en Allah l’Omnipotent ! Je vois bien à présent qu’il est écrit dans le livre de l’Ange que ma destinée m’attend sur le pal ! » Et il fit ses préparatifs et son testament avant d’aller mourir de cette mort de goudron ! Et voilà pour lui !
Mais pour ce qui est du cinquième mamelouk, qui s’appelait Mobarak, il avait déjà parcouru tout le pays d’Égypte et une partie notable de la Syrie, sans trouver trace de ce qu’il cherchait. Et même les conteurs fameux du Caire n’avaient pu le renseigner à ce sujet, bien que leur savoir dépasse l’entendement. Bien plus ! Ils n’avaient même jamais entendu parler, par leurs pères ou leurs grands-pères, conteurs comme eux, de l’existence de cette histoire-là ! Aussi le jeune mamelouk avait-il pris le chemin de Damas, sans toutefois espérer réussir désormais dans cette entreprise.
Or, dès son arrivée à Damas, il fut tout de suite sous le charme de son climat, de ses jardins, de ses eaux et de sa magnificence. Et son enchantement aurait été aux limites extrêmes s’il n’avait eu l’esprit si préoccupé par sa mission sans aboutissant. Et, comme c’était le soir, il parcourait les rues de la ville à la recherche de quelque khân où passer la nuit, quand il vit, en tournant dans les souks, une foule de portefaix, de balayeurs, d’âniers, de terrassiers, de marchands et de porteurs d’eau, ainsi qu’une quantité d’autres personnes, qui se hâtaient de courir dans une même direction, de toute leur vitesse. Et il se dit : « Qui sait où vont ces gens-là ? » Et comme il se disposait à courir avec eux, il fut violemment heurté par un jeune homme qui venait de trébucher en se prenant le pied dans les pans de sa robe, à cause de son ardeur à se hâter dans sa marche. Et il l’aida à se relever et, après lui avoir essuyé le dos, il lui demanda : « Pour où, comme ça ? Je te vois fort préoccupé et plein d’impatience, et je ne sais que penser en voyant aussi les autres faire comme toi ! » Le jeune homme répondit : « Je vois bien que tu es un étranger, pour ignorer ainsi le but de notre course. Sache donc que, pour ma part, je veux arriver un des premiers là-bas, dans la salle voûtée où se tient le cheikh Ishak Al-Monabbi, le conteur sublime de notre ville, celui qui raconte les histoires les plus merveilleuses du monde. Et comme il y a toujours, au dehors et au dedans, une grande foule d’auditeurs, et que les derniers arrivés ne peuvent pas jouir comme il faut de l’histoire contée, je te prie d’excuser maintenant ma hâte de te quitter ! » Mais le jeune mamelouk s’attacha aux vêtements de l’habitant de Damas, et lui dit : « Ô fils des gens de bien, je te supplie de m’emmener avec toi, afin que je puisse trouver une bonne place près du cheikh Ishak. Car je souhaite, moi aussi, vivement l’entendre, et c’est pour lui précisément que je viens de mon pays, du profond lointain ! » Et l’adolescent répondit : « Suis-moi donc, et courons ! » Et tous deux, bousculant à droite et à gauche les gens paisibles qui rentraient dans leurs demeures, se ruèrent vers la salle où tenait ses séances le cheikh Ishak Al-Monabbi.
Or, en entrant dans cette salle au plafond voûté d’où descendait une fraîcheur douce, Mobarak aperçut, assis sur un siège au milieu du cercle silencieux des portefaix, des marchands, des notables, des porteurs d’eau et des autres, un vénérable cheikh au visage marqué par la bénédiction, au front auréolé de splendeur, qui parlait d’une voix grave, en continuant l’histoire qu’il avait commencée depuis plus d’un mois devant ses auditeurs fidèles. Mais la voix du cheikh ne tarda pas à s’animer, en racontant les exploits inégalables de son guerrier. Et, soudain, il se leva de son siège, ne pouvant plus maîtriser sa véhémence, et se mit à courir, entre ses auditeurs, d’un bout de la salle à l’autre bout, en faisant tournoyer le glaive du guerrier arracheur de têtes, et en taillant en mille pièces les ennemis ! Ainsi donc ! Qu’ils meurent les traîtres ! Et qu’ils soient maudits et brûlés dans les feux de la géhenne ! Et qu’Allah préserve le guerrier ! Il est préservé ! Mais non ! Où sont nos sabres, où sont nos gourdins pour voler à son secours ? Le voici ! Il sort triomphant de la mêlée, écrasant ses ennemis terrassés avec l’aide d’Allah ! Alors, gloire au Tout-Puissant, maître de la vaillance ! Et que le guerrier maintenant aille sous la tente où l’attend l’amoureuse, et que les beautés diverses de l’adolescente lui fassent oublier les périls courus pour elle ! Et louanges à Allah qui a créé la femme pour mettre le baume dans le cœur du guerrier et le feu dans ses entrailles !
Comme sur ces mots le cheikh Ishak terminait la séance ce soir-là, les auditeurs, à la limite de l’extase, se levèrent et, tout en répétant les dernières paroles du conteur, sortirent de la salle. Et le mamelouk Mobarak, émerveillé d’un art si admirable, s’approcha du cheikh Ishak et, après lui avoir baisé la main, lui dit : « Ô mon maître, je suis un étranger, et je désire te demander une chose…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-DIX-HUITlÈME NUIT
Elle dit :
« … Ô mon maître, je suis un étranger, et je désire te demander une chose ! » Et le cheikh lui rendit son salam et répondit : « Parle ! L’étranger ne nous est point étranger. Que te faut-il ? » Il répondit : « Je viens de bien loin pour t’offrir de la part de mon maître, le conteur Abou-Ali du Khorassân, un cadeau de mille dinars d’or ! Car il te considère comme le maître de tous les conteurs de ce temps, et veut par là te prouver son admiration ! » Le cheikh Ishak répondit : « Certes ! la renommée de l’illustre Abou-Ali du Khorassân, nul ne saurait l’ignorer. J’accepte donc de tout cœur amical le cadeau de ton maître, et je voudrais en retour lui envoyer quelque chose par ton intermédiaire. Dis-moi donc ce qu’il aime le mieux, afin que mon cadeau lui agrée davantage ! » À ces paroles si longtemps attendues, le mamelouk Mobarak se dit : « Me voici au but ! Et c’est ma dernière ressource ! » Et il répondit : « Qu’Allah, ô mon maître, le comble de ses bénédictions. Mais les biens de ce monde sont nombreux sur la tête d’Abou-Ali, et il ne souhaite qu’une chose, c’est d’orner son esprit de ce qu’il ne connaît pas ! Aussi m’a-t-il dépêché vers toi, pour te demander, comme une faveur, de lui apprendre quelque conte nouveau dont il pourrait dulcifier les oreilles de notre roi ! Ainsi, par exemple, rien ne saurait le toucher davantage que d’apprendre de toi, si toutefois tu la connais, l’histoire qu’on nomme les « Aventures de Hassân Al-Bassri ! » Le cheikh répondit : « Sur ma tête et sur mes yeux ! ton souhait sera satisfait, et au delà, car cette histoire m’est connue, et je suis d’ailleurs le seul conteur à la connaître, sur la face de la terre ! Et il a bien raison de la chercher, ton maître Abou-Ali, car c’est certainement l’une des plus extraordinaires histoires qui soient, et elle m’a été racontée autrefois par un saint derviche, mort maintenant, qui la tenait d’un autre derviche, mort également. Et moi, pour reconnaître la générosité de ton maître, non seulement je vais te la raconter, mais te la dicter dans tous ses détails, depuis le commencement jusqu’à la fin. Seulement, à cette donation de ma part, je mets une condition expresse que tu t’engageras, par serment, à remplir, si tu veux avoir cette copie ! » Le mamelouk répondit : « Je suis prêt à accepter toutes les conditions, même en exposant au péril mon âme ! » Il dit : « Eh bien ! comme cette histoire est de celles qu’on ne raconte pas devant n’importe qui, et qu’elle n’est point faite pour tout le monde, mais seulement pour les personnes de choix, tu vas me jurer, en ton nom et au nom de ton maître, de ne jamais en dire un mot à cinq sortes de personnes : les ignorants, car ils ne sauraient l’estimer avec leur esprit grossier ; les hypocrites, qui en seraient offusqués ; les maîtres d’école, qui, impuissants et épais, ne la comprendraient pas ; les idiots, car ils sont comme les maîtres d’école ; et les mécréants, qui n’en pourraient tirer un enseignement profitable ! » Et le mamelouk s’écria : « Je le jure devant la face d’Allah et devant toi, ô mon maître ! » Puis il déroula sa ceinture et en tira un sac qui contenait mille dinars d’or, et le remit au cheikh Ishak. Et le cheikh, à son tour, lui présenta un encrier et un calam, et lui dit : « Écris ! » Et il se mit à lui dicter, mot par mot, toute l’histoire des Aventures de Hassân Al-Bassri, telle qu’elle lui avait été transmise par le derviche. Et cette dictée dura sept jours et sept nuits, sans discontinuer. Après quoi, le mamelouk relut ce qu’il avait écrit devant le cheikh, qui rectifia divers passages et en corrigea les fautes d’écriture. Et le mamelouk Mobarak, à la limite de la joie, baisa la main du cheikh et, après lui avoir fait ses adieux, se hâta de prendre le chemin du Khorassân. Et comme le bonheur le rendait léger, il ne mit, pour y arriver, que la moitié du temps qu’il fallait d’ordinaire aux caravanes.
Or, il ne restait plus que dix jours pour que l’année fixée comme délai par le roi expirât, et pour que le pal fût dressé, pour le supplice d’Abou-Ali, devant la porte du Palais. Et l’espérance s’était tout à fait évanouie de l’âme de l’infortuné conteur, et il avait fait assembler tous ses parents et ses amis pour qu’ils l’aidassent à supporter, avec moins de terreur, l’heure effroyable qui l’attendait. Et voici qu’au milieu des lamentations, le mamelouk Mobarak, brandissant le manuscrit, fit son entrée et alla vers son maître et, après lui avoir baisé la main, lui remit les feuillets précieux dont le premier portait, en grandes lettres, le titre : « Histoire des Aventures de Hassân Al-Bassri. »
À cette vue, le conteur Abou-Ali se leva et embrassa son mamelouk et le fit asseoir à sa droite et se dévêtit de ses propres habits pour l’en vêtir et le combla de marques d’honneur et de bienfaits ; puis, après l’avoir libéré, il lui donna, en cadeau, dix chevaux de noble race, cinq juments, dix chameaux, dix mulets, trois nègres et deux jeunes garçons. Après quoi il prit le manuscrit qui lui sauvait la vie, et le transcrivit lui-même, à nouveau, sur du magnifique papier, en lettres d’or, de sa plus belle calligraphie, en mettant de larges espaces entre les mots, de façon que la lecture en devînt agréable et aisée. Et il employa à ce travail neuf jours entiers, en prenant à peine le temps de fermer l’œil ou de manger une datte. Et le dixième jour, à l’heure marquée pour son empalement, il mit le manuscrit dans une cassette d’or et monta chez le roi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME NUIT
… Et le dixième jour, à l’heure marquée pour son empalement, il mit le manuscrit dans une cassette d’or et monta chez le roi.
Aussitôt, le roi Kendamir réunit ses vizirs, ses émirs et ses chambellans, ainsi que les poètes et les savants, et dit à Abou-Ali : « La parole des rois doit courir ! Lis-nous donc cette histoire promise ! Et, à mon tour, je n’oublierai pas ce qui a été convenu entre nous dans le commencement ! » Et Abou-Ali tira le merveilleux manuscrit de la cassette d’or, et en déroula la première feuille et commença sa lecture. Et il déroula la seconde feuille, et la troisième feuille et beaucoup d’autres feuilles, et continua à lire, au milieu de l’admiration et de l’émerveillement de toute l’assemblée. Et l’effet en fut si extraordinaire sur le roi qu’il ne voulut point lever la séance ce jour-là ! Et l’on mangea et l’on but, et l’on recommença ; et ainsi de suite jusqu’à la fin.
Alors le roi Kendamir, ravi à la limite du ravissement, et sûr désormais de n’avoir jamais plus un instant d’ennui puisqu’il possédait une histoire pareille sous sa main, se leva en l’honneur d’Abou-Ali, et le nomma sur-le-champ son grand-vizir, destituant l’ancien de sa charge, et, après l’avoir revêtu de son propre manteau royal, lui fit don, comme propriété héréditaire, d’une province entière de son royaume avec ses villes, villages et châteaux-forts ; et il le garda auprès de lui pour compagnon intime et confident. Puis il fit serrer la cassette avec le manuscrit précieux dans l’armoire des papiers, pour l’en tirer ensuite et faire lire l’histoire toutes les fois que l’ennui se présenterait aux portes de son âme.
— Et c’est justement, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, cette histoire merveilleuse que je vais pouvoir te conter, grâce à une copie exacte qui en est parvenue jusqu’à moi.
On raconte — mais Allah est plus savant et plus sage et plus bienfaisant ! — qu’il y avait — en ce qui se présenta et s’écoula des années d’il y a très longtemps —, dans la ville de Bassra, un adolescent qui était le plus gracieux, le plus beau et le plus délicat d’entre tous les jeunes garçons de son temps. Il s’appelait Hassân, et vraiment jamais nom n’avait si parfaitement convenu à un fils des hommes[1]. Et le père et la mère de Hassân l’aimaient d’un grand amour, car ils ne l’avaient eu que dans les jours de leur extrême sénilité, et cela grâce au conseil d’un savant lecteur de grimoires qui leur avait fait manger les morceaux situés entre la tête et la queue d’un serpent de la qualité des grands serpents, selon la prescription de notre seigneur Soleïman (sur Lui la paix et la prière !) Or donc, au terme fixé, Allah le Tout-Entendeur, le Tout-Voyant, décréta l’admission du marchand, père de Hassân, dans le sein de Sa miséricorde ; et le marchand trépassa dans la paix de son Seigneur (qu’Allah l’ait toujours en Sa pitié !) Et, de la sorte, le jeune Hassân se trouva être l’unique héritier des biens de son père. Mais, comme il avait été très mal élevé par ses parents, qui le chérissaient, il se hâta de fréquenter les adolescents de son âge et en leur compagnie, ne tarda pas à manger en festins et en dissipations les économies de son père. Et il ne lui resta plus rien entre les mains. Alors sa mère, dont le cœur était compatissant, ne put souffrir de le voir attristé, et, avec sa propre part d’héritage, lui ouvrit une boutique d’orfèvre dans le souk.
Or, la beauté de Hassân attira bientôt vers la boutique, avec l’assentiment d’Allah, les yeux de tous les passants ; et nul ne traversait le souk sans s’arrêter devant la porte pour contempler l’œuvre du Créateur, et s’en émerveiller. Et, de la sorte, la boutique de Hassân devint le centre d’un attroupement continu de marchands, de femmes et d’enfants, qui se réunissaient là, pour lui voir manier le marteau d’orfèvre et l’admirer tout à leur aise.
Or, un jour d’entre les jours, comme Hassân était assis à l’intérieur de sa boutique, et qu’au dehors l’attroupement habituel commençait à s’épaissir, vint à passer par là un Persan avec une grande barbe blanche et un grand turban de mousseline blanche. Son maintien et sa démarche indiquaient assez que c’était un notable et un homme d’importance. Et il tenait à la main un vieux livre. Et il s’arrêta devant la boutique et se mit à regarder Hassân avec une attention soutenue. Puis il s’avança plus près de lui et dit, de façon à en être entendu : « Par Allah ! quel excellent orfèvre ! » Et il se mit à branler la tête avec les signes les plus évidents d’une admiration sans bornes. Et il resta là, sans bouger, jusqu’à ce que les passants se fussent dispersés pour la prière de l’après-midi. Alors, il entra dans la boutique et il salua Hassân qui lui rendit le salam et l’invita courtoisement à s’asseoir. Et le Persan s’assit en lui souriant avec une grande tendresse, et lui dit :
« Mon enfant, tu es, en vérité, un jeune homme bien avenant ! Et moi, comme je n’ai point de fils, je voudrais t’adopter afin de t’enseigner les secrets de mon art, unique dans le monde et que des milliers et des milliers de personnes m’ont inutilement supplié de leur enseigner. Et, maintenant, mon âme et l’amitié qui est née en mon âme pour toi me poussent à te révéler ce que j’ai jusqu’aujourd’hui soigneusement caché, pour que tu sois, après ma mort, le dépositaire de ma science. Et, de la sorte, je mettrai entre toi et la pauvreté un obstacle infranchissable, et je t’épargnerai ce travail fatigant du marteau et ce métier peu lucratif, indigne de ta personne charmante, ô mon fils, et que tu exerces au milieu de la poussière, du charbon et de la flamme ! » Et Hassân répondit : « Par Allah ! ô mon vénérable oncle, je ne souhaite que d’être ton fils et l’héritier de ta science ! Quand donc veux-tu commencer à m’initier ? » Il répondit : « Demain ! » Et, se levant aussitôt, il prit la tête de Hassân dans ses deux mains et l’embrassa. Puis il sortit sans ajouter un mot de plus…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
… il prit la tête de Hassân dans ses deux mains et l’embrassa. Puis il sortit sans ajouter un mot de plus.
Alors, Hassân, extrêmement troublé de tout cela, se hâta de fermer sa boutique, et courut à la maison raconter à sa mère ce qui venait de se passer. Et la mère de Hassân, fort émue, répondit : « Que me racontes-tu là, ya Hassân ? Et comment peux-tu croire aux paroles d’un Persan hérétique ? » Il dit : « Ce vénérable savant n’est point un hérétique, car son turban était en mousseline blanche comme celui des vrais Croyants ! » Elle répondit : « Ah ! mon fils, détrompe-toi ! Ces Persans sont des fourbes, des séducteurs ! Et leur science c’est l’alchimie ! Et Allah seul sait les complots qu’ils trament dans la noirceur de leur âme, et le nombre des tours qu’ils font pour dépouiller les gens ! » Mais Hassân se mit à rire et dit : « Ô ma mère, nous sommes de pauvres gens, et nous n’avons, en vérité, rien qui puisse tenter la cupidité d’autrui ! Quant à ce Persan, il n’y a pas dans toute la ville de Bassra quelqu’un qui ait un visage et un maintien plus avenants ! Et j’ai vu en lui les signes les plus évidents de la bonté et de la vertu ! Remercions plutôt Allah qui a fait compatir son cœur à ma condition ! » À ces paroles, la mère ne répondit plus rien. Et Hassân ne put fermer l’œil cette nuit-là, tant il était perplexe et impatient.
Le lendemain, il se rendit de bonne heure au souk avec ses clefs, et ouvrit sa boutique avant tous les autres marchands. Et, aussitôt, il vit entrer le Persan ; et il se leva vivement en son honneur et voulut lui baiser la main ; mais il s’y refusa, et le serra dans ses bras et lui demanda : « Es-tu marié, ô Hassân ? » Il répondit : « Non, par Allah ! je suis célibataire, bien que ma mère ne cesse de me pousser du côté du mariage ! » Le Persan dit : « Alors, c’est excellent ! Car si tu avais été marié, tu n’aurais jamais pu entrer dans l’intimité de mes connaissances ! » Puis il ajouta : « Mon fils, as-tu du cuivre dans ta boutique ? » Il dit : « J’ai là un vieux plateau tout ébréché, en cuivre jaune ! » Il dit : « C’est cela même qu’il me faut ! Commence donc par allumer ton fourneau, mets ton creuset sur le feu et fais marcher tes soufflets ! Puis, prends ce vieux plateau de cuivre et coupe-le en petites pièces avec tes ciseaux ! » Et Hassân se hâta d’exécuter l’ordre. Et le Persan lui dit : « Mets à présent ces morceaux de cuivre dans le creuset, et active le feu jusqu’à ce que tout ce métal devienne liquide ! » Et Hassân jeta les morceaux de cuivre dans le creuset, activa le feu et se mit à souffler avec le roseau à air sur le métal, jusqu’à liquéfaction. Alors, le Persan se leva et s’approcha du creuset et ouvrit son livre et lut sur le liquide bouillant des formules en une langue inconnue ; puis, élevant la voix, il cria : « Hakh ! makh ! bakh ! Ô vil métal, que le soleil te pénètre de ses vertus ! Hakh ! makh ! bakh ! Ô vil métal, que la vertu de l’or chasse tes impuretés ! Hakh ! makh ! bakh ! ô cuivre, transmue-toi en or ! » Et, en prononçant ces paroles, le Persan leva la main vers son turban, et tira d’entre les plis de la mousseline un petit paquet de papier plié qu’il ouvrit ; et il y prit une pincée d’une poudre jaune comme le safran qu’il se hâta de jeter au milieu du cuivre liquide, dans le creuset ! Et, à l’instant, le liquide se solidifia et se transmua en une galette d’or, de l’or le plus pur !
À cette vue, Hassân fut stupéfait à la limite de la stupéfaction ; et, sur un signe du Persan, il prit sa lime d’essai et en frotta, sur un coin, la galette brillante ; et il constata que c’était bien de l’or de la qualité la plus fine et la plus estimée. Alors, ravi d’admiration, il voulut prendre la main du Persan et la baiser ; mais celui-ci ne voulut pas le permettre et lui dit : « Ô Hassân, va vite au souk vendre, cette galette d’or ! Et touches-en le prix, et retourne à ta maison serrer l’argent, sans dire un mot de ce que tu sais ! » Et Hassân alla au souk, et remit la galette au crieur public qui, après l’avoir contrôlée comme poids et qualité, la cria et en obtint d’abord mille dinars d’or, puis deux mille à la seconde criée. Et la galette fut adjugée à un marchand à ce prix-là, et Hassân prit les deux mille dinars et alla les porter à sa mère, en volant de joie. Et la mère de Hassân, à la vue de tout cet or, ne put d’abord prononcer une parole, tant elle était remplie d’étonnement ; puis, comme Hassân, en riant, lui racontait que cela lui venait de la science du Persan, elle leva les mains et s’écria, terrifiée : « Il n’y a d’autre dieu qu’Allah, et il n’y a de force et de puissance qu’en Allah ! Qu’as-tu fait, ô mon fils, avec ce Persan versé dans l’alchimie ? » Mais Hassân répondit : « Justement, ô mère, ce vénérable savant est en train de m’instruire dans l’alchimie ! Et il a commencé par me faire voir comment on change un vil métal en l’or le plus pur ! » Et, sans plus faire attention aux objurgations de sa mère, Hassân prit, dans la cuisine, le grand mortier en cuivre où sa mère pilait l’ail et l’ognon et confectionnait les boulettes de blé concassé, et courut à sa boutique retrouver le Persan qui l’y attendait. Et il posa par terre le mortier en cuivre, et se mit à activer le feu. Et le Persan lui demanda : « Que veux-tu donc faire, ya Hassân ? » Il répondit : « Je voudrais transmuer en or le mortier de ma mère ! » Et le Persan éclata de rire et dit : « Tu es un insensé, Hassân, de vouloir te montrer deux fois dans la même journée au souk, avec des lingots d’or, pour éveiller de la sorte les soupçons des marchands, qui devineront que nous nous occupons d’alchimie, et attirer sur notre tête une bien fâcheuse affaire ! » Hassân répondit : « Tu as raison ! mais je voudrais tellement apprendre de toi le secret de la science ! » Et la Persan se mit à rire encore plus fort que la première fois, et dit : « Tu es un insensé, Hassân, de croire que la science et les secrets de la science s’apprennent comme ça, en pleine rue ou sur les places publiques, et qu’on peut faire son apprentissage au milieu du souk, sous l’œil de la police ! Mais, si vraiment, ya Hassân, tu as le ferme désir de t’instruire sérieusement, tu n’as qu’à ramasser tous tes outils et à me suivre à ma demeure ! » Et Hassân, sans hésiter, répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et, se levant, il ramassa ses outils, ferma sa boutique, et suivit le Persan.
Or, en chemin, Hassân se rappela les paroles de sa mère au sujet des Persans, et, mille pensées venant envahir son esprit, il s’arrêta de marcher, sans savoir au juste ce qu’il faisait, et, la tête baissée, il se mit à réfléchir profondément. Et le Persan, s’étant retourné, le vit dans cet état et se prit à rire ; puis il lui dit : « Tu es un insensé, Hassân ! Car si tu avais autant de raison que tu as de gentillesse, tu ne t’arrêterais pas devant la belle destinée qui t’attend ! Comment ! je veux ton bonheur et tu hésites ! » Puis il ajouta : « Pourtant, mon fils, afin que tu n’aies point le plus léger doute sur mes intentions, je préfère te révéler les secrets de ma science dans ta propre maison ! » Et Hassân répondit : « Oui ! par Allah, cela tranquilliserait la mère ! » Et le Persan dit : « Précède-moi donc pour me montrer le chemin ! » Et Hassân se mit à marcher devant, et le Persan derrière ; et ils arrivèrent de la sorte chez la mère…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-UNIÈME NUIT
… et ils arrivèrent de la sorte chez la mère. Et Hassân pria le Persan d’attendre dans le vestibule, et, courant comme un jeune étalon qui bondit au printemps dans les prairies, il alla prévenir sa mère que le Persan était leur hôte. Et il ajouta : « Du moment qu’il va manger de notre nourriture, dans notre maison, il y aura entre nous le lien du pain et du sel, et tu ne pourras plus de la sorte avoir désormais l’esprit préoccupé à mon sujet. » Mais la mère répondit : « Qu’Allah nous protège, mon fils ! Le lien du pain et du sel est sacré chez nous ; mais ces Persans abominables, qui sont des adorateurs du feu, des pervertis, des parjures, ne le respectent guère ! Ah ! mon fils, quelle calamité nous poursuit ! » Il dit : « Lorsque tu auras vu ce vénérable savant, tu ne voudras plus le laisser partir de notre maison ! » Elle dit : « Non ! par la tombe de ton père, je ne resterai pas ici pendant le séjour de cet hérétique ! Et, lorsqu’il sera parti, je laverai les dalles de la chambre, et je brûlerai de l’encens, et je ne te toucherai pas toi-même pendant un mois entier, de peur de me souiller à ton contact ! » Puis elle ajouta : « Pourtant, comme il est déjà dans notre maison, et que nous avons de l’or qu’il nous a envoyé, je vais vous apprêter à tous deux de quoi manger, puis je me hâterai de m’en aller chez les voisins ! » Et, pendant que Hassân allait retrouver le Persan, elle tendit la nappe, et, après avoir fait de larges emplettes, elle leur mit sur les plateaux des poulets rôtis et des concombres et dix sortes de pâtisseries et de confitures, et se hâta d’aller se réfugier chez les voisins.
Alors, Hassân introduisit son ami le Persan dans la salle du repas, et l’invita à prendre place, en lui disant : « Il faut qu’il y ait entre nous le lien du pain et du sel ! » Et le Persan répondit : « Certes ! ce lien-là est une chose inviolable ! » Et il s’assit à côté de Hassân, et se mit à manger avec lui, tout en causant. Et il lui disait : « Ô mon fils Hassân, par le lien sacré du pain et du sel, qui est maintenant entre nous, si je ne t’aimais d’un si vif amour, je ne t’apprendrais pas les choses secrètes pour lesquelles nous sommes ici ! » Et, ce disant, il tirait de son turban le petit paquet de poudre jaune et, le lui montrant, ajoutait : « Tu vois cette poudre-ci ! Eh bien ! sache qu’au moyen d’une seule pincée, tu peux changer en or dix okes de cuivre. Car cette poudre n’est autre que l’elixir quintessencié, solidifié et pulvérisé que j’ai retiré de la substance de mille simples et de mille ingrédients plus compliqués les uns que les autres. Et je ne suis arrivé à cette découverte qu’à la suite de travaux et de fatigues que tu connaîtras un jour ! » Et il remit le petit paquet à Hassân, qui se mit à le regarder avec une telle attention, qu’il ne vit point le Persan retirer vivement de son turban un morceau de bang crétois et le mélanger à une pâtisserie. Et le Persan offrit la pâtisserie à Hassân qui, tout en continuant à regarder la poudre, l’avala pour rouler aussitôt à la renverse, sans connaissance, sa tête précédant ses pieds !
Aussitôt, le Persan, poussant un cri de triomphe, sauta sur ses deux pieds, disant : « Ah ! charmant Hassân, que d’années déjà je te cherche sans te trouver ! Mais te voici maintenant entre mes mains, et tu n’échapperas point à mon vouloir ! » Et il releva ses manches, se serra la taille et, s’approchant de Hassân, il le courba en deux, la tête près des genoux, et lui attacha dans cette position les bras avec les jambes, et les mains avec les pieds. Puis il prit un coffre à vêtements, le vida, et mit Hassân dedans, avec tout l’or qui était le produit de son opération d’alchimie. Puis il sortit appeler un portefaix, lui chargea le coffre sur le dos, et le lui fit porter sur le bord de la mer, où se trouvait un navire prêt à mettre à la voile. Et le capitaine, qui n’attendait plus que l’arrivée du Persan, leva l’ancre. Et le navire, poussé par la brise de terre, s’éloigna du rivage à pleines voiles ! Et voilà pour le Persan, ravisseur de Hassân et du coffre où était renfermé Hassân !
Mais pour ce qui est de la mère de Hassân, voici ! Lorsqu’elle se fut aperçu que son fils avait disparu avec le coffre et l’or, et que les vêtements étaient épars à travers la chambre, et que la porte de la maison était restée ouverte, elle comprit que Hassân était désormais perdu pour elle et que l’arrêt du destin était exécuté ! Alors elle s’abandonna au désespoir, et se donna de grands coups au visage, et déchira ses vêtements, et se mit à gémir, à sangloter, à pousser des cris douloureux, et à verser des pleurs, en disant : « Hélas ! ô mon enfant, ah ! Hélas, le fruit vital de mon cœur, ah ! » Et elle passa toute la nuit à courir, affolée, chez tous les voisins pour s’informer de son fils, mais sans résultat. Et les voisines cherchèrent à la consoler, mais elle était inconsolable. Et elle se mit, depuis lors, à passer ses jours et ses nuits dans les larmes et le deuil, auprès du tombeau qu’elle fit élever au milieu de sa maison et sur lequel elle écrivit le nom de son fils Hassân et la date du jour où il avait été enlevé à son affection. Et elle fit également graver ces deux vers sur le marbre du tombeau, afin de se les réciter sans cesse et de pleurer :
Une forme trompeuse se présente la nuit pendant que je m’assoupis, et, triste, vient errer autour de ma couche et de ma solitude.
Je veux presser dans mes bras la forme aimée de mon enfant, et je m’éveille, hélas ! au milieu de la maison déserte, quand l’heure de la visite est déjà passée !
Et c’est ainsi que vivait la pauvre mère avec sa douleur.
Quant au Persan, parti sur le navire avec le coffre…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Quant au Persan, parti sur le navire avec le coffre, c’était réellement un magicien fort redoutable ; et il s’appelait Bahram le Guèbre, de son métier alchimiste. Et, chaque année, il choisissait parmi les fils des musulmans un adolescent bien fait, pour l’enlever et faire avec lui ce que le poussait à faire sa mécréantise, sa perversion et sa race maudite ; car, comme a dit le Maître des proverbes, c’était « un chien, fils de chien, petit-fils de chien ; et tous ses ancêtres étaient des chiens ! Comment alors aurait-il été autre chose qu’un chien, ou fait autre chose que les actions d’un chien ? » Or donc, pendant tout le temps que dura le voyage par mer, il descendait une fois par jour au fond du navire, là où se trouvait le coffre, soulevait le couvercle et donnait à manger et à boire à Hassân, en lui mettant lui-même les aliments à la bouche, tout en le laissant toujours dans un état de somnolence. Et, lorsque le navire fut arrivé au but du voyage, il fit débarquer le coffre et descendit lui-même à terre, tandis que le navire regagnait le large.
Alors le magicien Bahram ouvrit le coffre, défit les liens de Hassân et détruisit l’effet du bang en lui faisant respirer du vinaigre et en lui jetant dans les narines de la poudre d’anti-bang. Et Hassân recouvra aussitôt l’usage de ses sens, et regarda à droite et à gauche ; et il se vit étendu sur un rivage marin dont les galets et le sable étaient colorés en rouge, en vert, en blanc, en bleu, en jaune et en noir ; et il reconnut par là que ce n’était point le rivage de sa mer natale. Alors, bien étonné de se voir en ce lieu qu’il ne connaissait pas, il se leva et vit, assis derrière lui sur un rocher, le Persan qui le regardait avec un œil ouvert et un œil fermé. Et, rien qu’à cette vue, il eut le pressentiment qu’il avait été sa dupe, et qu’il était désormais en sa puissance. Et il se souvint des malheurs que lui avait prédits sa mère, et il se résigna aux décrets du destin, en se disant : « Je mets ma confiance en Allah ! » Puis il s’approcha du Persan, qui le laissait avancer sans bouger, et lui demanda d’une voix bien émue : « Que veut dire cela, mon père ? Et n’y a-t-il donc jamais eu entre nous le lien du pain et du sel ? » Et Bahram le Guèbre éclata de rire et s’écria : « Par le Feu et la Lumière ! Que me parles-tu de pain et de sel, à moi Bahram l’adorateur de la Flamme et de l’Étincelle, du Soleil et de la Lumière ? Et ne sais-tu que j’ai déjà eu, de cette façon, en ma puissance, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf jeunes musulmans, que j’ai ravis, et que tu es le millième ? Mais toi, par le Feu et la Lumière ! tu es certes le plus beau d’entre tous ceux-là ! Et je ne croyais pas, ô Hassân, que tu tomberais si facilement dans mon filet ! Mais, gloire au Soleil ! te voici entre mes mains et tu verras bientôt combien je t’aime ! » Puis il ajouta : « Tu vas d’abord commencer par abjurer ta religion, et adorer ce que j’adore ! » À ces paroles, la surprise de Hassân se changea en une indignation sans limites, et il cria au magicien : « Ô cheikh de malédiction, qu’oses-tu me proposer là ? Et quelle abomination veux-tu me faire commettre ? » Lorsque le Persan vit Hassân dans une telle colère, comme il avait d’autres projets à son sujet, il ne voulut pas insister davantage ce jour-là, et il lui dit : « Ô Hassân, ce que je te proposais, en te demandant d’abjurer ta religion, n’était qu’une feinte de ma part pour mettre ta foi à l’épreuve, et t’en faire un grand mérite devant le Rétributeur ! » Puis il ajouta : « Mon seul but, en t’amenant ici, est de t’initier, dans la solitude, aux mystères de la science ! Regarde cette haute montagne à pic qui domine la mer ! C’est la Montagne-des-Nuages ! Et c’est là que se trouvent les éléments nécessaires à l’élixir des transmutations. Et si tu veux te laisser conduire sur son sommet, je te jure par le Feu et la Lumière que tu n’auras point à t’en repentir ! Car si j’avais voulu t’y conduire malgré toi, je l’eusse fait pendant ton sommeil ! Or, une fois que nous serons arrivés sur le sommet, nous recueillerons les tiges des plantes qui croissent dans cette région située au-dessus des nuages. Et je t’indiquerai alors ce qu’il faudra faire ! » Et Hassân, qui se sentait dominé malgré lui par les paroles du magicien, n’osa point refuser et dit : « J’écoute et j’obéis ! » Puis, se rappelant avec douleur sa mère et sa patrie, il se mit à pleurer amèrement.
Alors Bahram lui dit : « Ne pleure pas, Hassân ! Tu verras bientôt ce que tu gagneras à suivre mes conseils ! » Et Hassân demanda : « Mais comment pourrons-nous faire l’ascension de cette montagne à pic comme une muraille ? » Le magicien répondit : « Que cette difficulté ne t’arrête point ! Nous y arriverons avec plus d’aisance que l’oiseau ! »
Ayant dit ces paroles, le Persan tira de sa robe un petit tambour de cuivre sur lequel était étendue une peau de coq, et où étaient gravés des caractères talismaniques. Et, avec ses doigts, il se mit à battre sur ce petit tambour. Et aussitôt s’éleva un nuage de poussière du sein duquel se fit entendre un long hennissement ; et, en un clin d’œil, apparut devant eux un grand cheval noir ailé qui se mit à battre le sol de son sabot, en lançant la flamme de ses narines. Et le Persan l’enfourcha aussitôt, et aida Hassân à grimper derrière lui. Et, à l’instant, le cheval battit des ailes et s’envola ; et en moins de temps qu’il n’en faut pour ouvrir une paupière et fermer l’autre, il les déposa sur le sommet de la Montagne-des-Nuages. Puis il disparut.
Alors le Persan regarda Hassân avec le même mauvais œil que sur le rivage, et, lançant un grand éclat de rire, il s’écria…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et se tut discrètement.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors le Persan regarda Hassân avec le même mauvais œil que sur le rivage, et, lançant un grand éclat de rire, il s’écria : « Maintenant, Hassân, tu es définitivement en ma puissance ; et nulle créature ne saurait te porter secours ! Prépare-toi donc à satisfaire à tous mes caprices d’un cœur soumis, et commence d’abord par abjurer ta religion et reconnaître comme seule puissance le Feu, père de la Lumière ! »
En entendant ces paroles, Hassân recula en s’écriant : « Il n’y a d’autre dieu qu’Allah ! Et Môhammad est l’Envoyé d’Allah ! Quant à toi, ô vil Persan, tu n’es qu’un impie et un mécréant ! Et le Maître de la Toute-Puissance va te châtier par mon entremise ! » Et Hassân, rapide comme l’éclair, sauta sur le magicien et lui arracha le tambour des mains ; puis il le poussa vers le rebord de la montagne à pic, et, de ses deux bras, tendus avec force, il le précipita dans l’abîme. Et le magicien parjure et impie, tournoyant sur lui-même, alla se fracasser sur les rochers de la mer, et expira son âme dans la mécréantise. Et Éblis recueillit son souffle pour en attiser le feu de la Géhenne. Et voilà de quelle mort mourut Bahram le Guèbre, magicien trompeur et alchimiste.
Quant à Hassân, délivré de cette façon de l’homme qui voulait lui faire commettre toutes les abominations, il commença d’abord par examiner sur toutes ses faces le tambour magique sur lequel était tendue la peau de coq. Mais il préféra, ne sachant de quelle manière s’en servir, s’abstenir de le manier ; et il le suspendit à sa ceinture. Après quoi, il tourna les yeux tout autour de lui, et vit qu’en effet le sommet où il se trouvait était si haut qu’il dominait les nuages accumulés à sa base. Et une plaine immense s’étendait sur ce plateau élevé et formait, entre le ciel et la terre, comme une mer sans eau. Et tout au loin brûlait une grande flamme étincelante. Et Hassân pensa : « Là où se trouve le feu, se trouve un être humain ! » Et il se mit à marcher dans cette direction, en s’enfonçant au milieu de cette plaine où il n’y avait, pour toute présence, que la présence d’Allah ! Et, en s’approchant du but, il finit par distinguer que la flamme étincelante n’était que l’éclat, sous le soleil, d’un palais d’or au dôme d’or supporté par quatre hautes colonnes d’or.
À cette vue, Hassân se demanda : « Quel roi ou quel genni peut bien habiter dans de tels lieux ? » Et, comme il était bien fatigué de toutes les émotions qu’il venait d’avoir et de la longue marche qu’il venait de faire, il se dit : « Je vais, à la grâce d’Allah, entrer dans ce palais et demander au portier de me donner un peu d’eau et quelque nourriture, pour ne pas mourir de faim. Et, si c’est un homme de bien, il me logera peut-être pour une nuit dans un coin ! » Et, se liant à la destinée, il arriva devant la grande porte, qui était taillée dans un bloc d’émeraude, et, franchissant le seuil, il pénétra dans la cour d’entrée.
Or, à peine Hassân avait-il fait quelques pas dans cette première cour, qu’il aperçut, assises sur un banc de marbre, deux jeunes filles, éblouissantes de beauté, qui jouaient aux échecs. Et, comme elles étaient très attentives à leur jeu, elles ne remarquèrent pas d’abord l’entrée de Hassân. Mais la plus jeune, entendant le bruit des pas, releva la tête et vit le beau Hassân qui s’était également arrêté, en les apercevant. Et elle se leva vivement et dit à sa sœur : « Regarde, ma sœur, le beau jeune homme ! Ce doit être certainement l’infortuné que le magicien Bahram amène chaque année sur la Montagne-des-Nuages ! Mais comment a-t-il pu faire pour échapper d’entre les mains de ce démon ? » À ces paroles, Hassân, qui n’osait d’abord bouger de sa place, s’avança vers les jeunes filles, et, se jetant aux pieds de la plus jeune, s’écria : « Oui, ô ma maîtresse, je suis cet infortuné-là ! » Et la jeune fille, de voir à ses pieds cet adolescent si beau qui avait des gouttes de larmes sur le bord de ses yeux noirs, fut émue jusque dans ses entrailles ; et elle se leva, avec un visage compatissant, et dit à sa sœur, en lui montrant le jeune Hassân : « Sois témoin, ma sœur, que dès cet instant je jure, devant Allah et devant toi, que j’adopte ce jeune homme pour mon frère, et que je veux partager avec lui les plaisirs et les joies des beaux jours et les peines et les afflictions des jours moins heureux ! » Et elle prit la main de Hassân et l’aida à se relever et l’embrassa comme une sœur aimante embrasse son frère chéri. Puis, le tenant toujours par la main, elle le conduisit dans l’intérieur du palais où, avant toute chose, elle commença par lui donner, au hammam, un bain qui le rafraîchit parfaitement ; ensuite, elle le revêtit d’habits magnifiques, en jetant ses vieux effets salis par le voyage, et, aidée de sa sœur qui était venue les rejoindre au hammam, elle le conduisit dans sa propre chambre, en le soutenant sous un bras, tandis que sa sœur le soutenait sous l’autre. Et les deux jeunes filles invitèrent leur jeune hôte à s’asseoir entre elles deux pour prendre quelque nourriture. Après quoi, la plus jeune lui dit : « Ô mon frère bien-aimé, ô le chéri, toi dont la venue fait danser de joie les pierres de la demeure…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ô mon frère bien-aimé, ô le chéri, toi dont la venue fait danser de joie les pierres de la demeure, veux-tu nous dire le nom charmant dont tu t’appelles, et le motif qui t’a conduit à la porte de notre demeure ? » Il répondit : « Sache, ô sœur qui m’interroges et toi aussi, notre grande, que je m’appelle Hassân. Mais, pour ce qui est du motif qui m’a conduit dans ce palais, c’est mon heureuse destinée ! Il est vrai toutefois que, si je suis ici, ce n’est qu’après avoir éprouvé de bien grandes tribulations ! » Et il raconta ce qui lui était arrivé avec le magicien Bahram le Guèbre, depuis le commencement jusqu’à la fin. Mais il n’y a point d’utilité à le répéter. Et les deux sœurs, indignées de la conduite du Persan, s’exclamèrent à la fois : « Ô le chien maudit ! Que sa mort est méritée, et que tu as bien fait, ô notre frère, de l’empêcher pour toujours de respirer l’air de la vie ! »
Après quoi, la plus âgée se tourna vers la plus jeune et lui dit : « Ô Bouton-de-Rose, à ton tour maintenant de raconter à notre frère, afin qu’il la retienne en sa mémoire, notre histoire ! » Et la charmante Bouton-de-Rose dit :
« Sache, ô frère mien, ô le plus beau, que nous sommes des princesses ! Moi, je m’appelle Bouton-de-Rose, et ma sœur que voici s’appelle Grain-de-Myrte, mais j’ai également cinq autres sœurs, encore plus belles que nous, qui sont en ce moment à la chasse, et qui ne vont pas tarder à rentrer. L’aînée de nous toutes s’appelle Étoile-du-Matin, la seconde s’appelle Étoile-du-Soir, la troisième Cornaline, la quatrième Émeraude, et la cinquième Anémone. Mais c’est moi qui suis la plus jeune des sept. Et nous sommes les filles du même père, mais non de la même mère ; et moi et Grain-de-Myrte nous sommes les filles de la même mère. Or, notre père, qui est un des puissants rois des genn et des mareds, est un tyran si orgueilleux que, ne jugeant personne digne de devenir l’époux d’une de ses filles, il jura de ne jamais nous marier. Et, pour avoir la certitude que sa volonté ne serait jamais trahie, il fit venir ses vizirs et leur demanda : « Ne connaîtriez-vous point un lieu qui ne fût fréquenté ni par les hommes ni par les genn, et pût servir d’habitation à mes sept filles ? » Les vizirs répondirent : « Et pourquoi donc, ô notre roi ? » Il dit : « Pour mettre mes sept filles à l’abri des hommes et des genn, de l’espèce mâle ! » Ils dirent : « Ô notre roi, nous pensions que les femmes et les jeunes filles n’étaient créées par le Bienfaiteur que pour s’unir aux hommes par les organes délicats ! Et, d’ailleurs, le Prophète (sur Lui la prière et la paix !) a dit : « Aucune femme ne vieillira vierge dans l’Islam ! » Ce serait donc une grande honte sur la tête du roi, si ses filles vieillissaient avec leur virginité ! Et puis, par Allah ! quel dommage pour leur jeunesse ! » Mais notre père répondit : » J’aime mieux les voir mourir que de les marier ! » Et il ajouta : « Si tout de suite vous ne m’indiquez l’endroit que je vous demande, votre tête sautera de votre cou ! » Alors les vizirs répondirent : « En ce cas, ô roi, sache qu’il y a un endroit tout trouvé pour mettre tes filles à l’abri : c’est la Montagne-des-Nuages, qui, dans les temps anciens, était habitée par les éfrits rebelles aux ordres de Soleïmân. Là s’élève un palais d’or, bâti autrefois par les éfrits rebelles, pour leur servir de refuge, mais qui depuis lors fut abandonné et reste désert. Et la région où il est situé est favorisée d’un climat admirable et abondante en arbres, en fruits et en eaux délicieuses plus fraîches que la glace et plus douces que le miel ! » À ces paroles, notre père se hâta de nous envoyer ici avec une escorte formidable de genn et de mareds qui, une fois qu’ils nous eurent mises en sûreté, s’en retournèrent au royaume de notre père.
« Or, nous, dès notre arrivée, nous vîmes qu’en effet cette contrée, isolée de toutes les créatures d’Allah, était une contrée fleurie, riche en forêts, en pâturages luisants, en vergers et en sources d’eaux vives qui y coulaient avec abondance, semblables à des colliers de perles et à des lingots d’argent ; que les ruisseaux se poussaient les uns les autres pour regarder et pour mirer les fleurs qui leur souriaient ; que l’air était charmé de gazouillis et de parfums ; que les pigeons à collier et les tourterelles psalmodiaient sur les rameaux du printemps et chantaient les louanges du Créateur ; que les cygnes nageaient glorieusement sur les lacs, et que les paons, dans leurs splendides vêtements incrustés de corail et de pierreries aux couleurs par milliers, étaient semblables aux nouvelles mariées ; que la terre était une terre pure et camphrée, belle de toutes les beautés du Paradis ; et qu’enfin c’était un pays élu par les bénédictions !
« Aussi, ô frère mien, nous ne nous sentîmes guère malheureuses de vivre dans un tel pays, au milieu de ce palais d’or ; et, tout en remerciant le Rétributeur de ses faveurs, nous ne regrettions qu’une chose et c’est de n’avoir, pour nous tenir compagnie, aucun homme dont le visage fût agréable à voir à notre réveil du matin, et dont le cœur fût aimant et bien intentionné. C’est pourquoi, ô Hassân, tu nous vois maintenant si joyeuses de ta venue ! »
Et, après avoir ainsi parlé, la charmante Bouton-de-Rose combla Hassân de prévenances et de cadeaux, comme on se fait entre frères et entre amis, et continua à causer avec lui affectueusement.
Sur ses entrefaites, arrivèrent les cinq autres princesses, sœurs de Bouton-de-Rose et de Grain-de-Myrte ; et, charmées et ravies de voir un si bel adolescent et un frère si délicieux, elles lui firent le plus gracieux et le plus cordial accueil. Et, après les salams et les premières formules et paroles, elles lui firent jurer de rester avec elles durant un long espace de temps. Et Hassân, qui n’y voyait aucun
inconvénient…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Et Hassân, qui n’y voyait aucun inconvénient, le leur jura d’un cœur amical. Et il demeura auprès d’elles, dans ce palais plein de merveilles, et, dès cet instant, devint leur compagnon dans toutes leurs parties de chasse et dans leurs promenades. Et il se réjouissait et se félicitait d’avoir des sœurs si charmantes et si délicieuses ; et elles s’émerveillaient d’avoir un frère si beau et si miraculeux. Et ils passaient leurs journées à folâtrer ensemble dans les jardins et le long des ruisseaux ; et, le soir, ils s’instruisaient mutuellement, Hassân en leur racontant les usages de son pays natal, et les jeunes filles en lui racontant l’histoire des genn, des mareds et des éfrits. Et cette vie agréable le rendait plus beau de jour en jour, et donnait à son visage l’aspect de la lune, tout à fait. Et son amitié fraternelle avec les sept sœurs, surtout avec la jeune Bouton-de-Rose, se consolida à l’égal de la fraternité des enfants nés du même père et de la même mère.
Or, un jour qu’ils étaient tous assis à chanter dans un bosquet, ils aperçurent un grand tourbillon de poussière qui emplissait le ciel et couvrait la face du soleil ; et il arrivait rapidement de leur côté, avec un bruit de tonnerre. Et les sept princesses, remplies d’effroi, dirent à Hassân : « Oh ! cours vite te cacher dans le pavillon du jardin ! » Et Bouton-de-Rose le prit par la main et alla le cacher dans le pavillon. Et voici que la poussière se dissipa et d’en dessous apparut un corps entier de genn et de mareds ! Or, c’était une escorte qu’envoyait à ses filles le roi du Gennistân, pour les amener chez lui assister à de grandes fêtes qu’il avait l’intention de donner en l’honneur de l’un des rois ses voisins. Et, à cette nouvelle, Bouton-de-Rose courut retrouver Hassân en cachette ; et elle l’embrassa, les larmes aux yeux et la poitrine secouée de hoquets douloureux, et lui apprit son départ et celui de ses sœurs et lui dit : « Mais, ô mon frère bien-aimé, toi tu attendras notre retour dans ce palais, dont tu es le maître absolu ! Et voici les clefs de toutes les chambres ! » Et elle lui remit les clefs, en ajoutant : « Je te supplie seulement, ya Hassân, et te conjure par ton âme chérie, de ne point ouvrir la chambre dont la clef porte comme signe cette turquoise incrustée ! » Et elle lui montra la clef en question. Et Hassân, bien chagriné de son départ et de celui de ses sœurs, l’embrassa en pleurant et lui promit qu’il attendrait, sans bouger, leur retour, et qu’il n’ouvrirait pas la porte dont la clef portait comme signe la turquoise incrustée. Et la jeune fille et ses six sœurs, qui étaient venues en cachette la rejoindre, pour revoir leur frère avant le départ, firent à Hassân des adieux pleins de tendresse, et l’embrassèrent toutes, l’une après l’autre, puis s’en allèrent, au milieu de leur escorte, se mettre immédiatement en route pour le pays de leur père.
Quant à Hassân, lorsqu’il se vit seul dans le palais, il fut pris d’une grande mélancolie ; et, de se sentir dans la solitude après avoir été dans la charmante compagnie de ses sept sœurs, il devint fort rétréci quant à sa poitrine ; et, pour chercher à distraire et à calmer ses regrets, il se mit à visiter, l’une après l’autre, les chambres des jeunes filles. Et, en revoyant la place qu’elles occupaient et les beaux objets qui leur appartenaient, il s’exaltait l’âme et sentait son cœur palpiter d’émoi. Et il arriva de la sorte devant la porte qui s’ouvrait avec la clef qui portait comme signe la turquoise incrustée. Mais il ne voulut point s’en servir, et revint sur ses pas. Puis il pensa : « Qui sait pourquoi ma sœur Bouton-de-Rose m’a tellement recommandé de ne point ouvrir cette porte-là ? Et qu’est-ce qu’il peut bien y avoir, là-dedans, de si mystérieux pour qu’une telle défense m’ait été imposée ? Mais, puisque telle est la volonté de ma sœur, je n’ai qu’à répondre par l’ouïe et l’obéissance ! » Et il se retira, et, comme la nuit tombait et que la solitude lui pesait, il alla se coucher pour endormir son chagrin. Mais il ne put fermer les yeux, tant l’obsédait cette porte défendue ; et cette pensée le torturait si intensément qu’il se dit : « Si j’allais l’ouvrir tout de même ? » Mais il pensa : « Il vaut mieux attendre le matin ! » Puis, n’en pouvant plus d’attendre sans dormir, il se leva, en se disant : « Je préfère aller tout de suite ouvrir cette porte et voir ce que renferme l’appartement dont elle est l’entrée, dussé-je y trouver la mort ! »
Et, se levant, il alluma un flambeau et se dirigea vers la porte défendue. Et il fit entrer la clef dans la serrure, qui céda sans difficulté ; et la porte s’ouvrit sans bruit, comme d’elle-même ; et Hassân pénétra dans la chambre où elle donnait accès.
Or, il eut beau regarder de tous côtés, il ne vit d’abord rien du tout : aucun meuble, aucune natte, aucun tapis. Mais, en faisant le tour de la chambre, il vit dans un coin, adossé au mur, une échelle en bois noir dont le haut sortait par un grand trou ménagé dans le plafond. Et Hassân, sans hésiter, déposa à terre son flambeau, et, grimpant sur l’échelle, il monta jusqu’au plafond et de là s’engagea dans le trou. Et, une fois sa tête hors du trou, il se vit en plein air, à ras d’une terrasse qui donnait de plain-pied sur le plafond de la chambre.
Alors, Hassân monta sur la terrasse, qui était couverte de plantes et d’arbustes comme un jardin, et là, sous la clarté miraculeuse de la lune, il vit se dérouler, au milieu du silence de la terre, le plus beau paysage qui ait jamais enchanté les yeux humains…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIXÈME NUIT
Elle dit :
… Alors, Hassân monta sur la terrasse, qui était couverte de plantes et d’arbustes comme un jardin, et là, sous la clarté miraculeuse de la lune, il vit se dérouler, au milieu du silence de la terre, le plus beau paysage qui ait jamais enchanté les yeux humains. À ses pieds, endormi dans la sérénité, un grand lac s’étendait, où toute la beauté du ciel se regardait, où la rive, avec les rides heureuses de l’eau, souriait par les feuillages balancés des lauriers, par les myrtes on fleurs, par les amandiers couronnés de leur neige, par les guirlandes des glycines, et chantait l’hymne de la nuit de tous les gosiers de ses oiseaux. Et la nappe de soie, resserrée entre des futaies, allait plus loin baigner le pied d’un palais, aux étranges architectures, aux dômes diaphanes, surgi dans la transparence et le cristal des cieux. Et de ce palais s’avançait jusque dans l’eau, par un escalier de marbre et de mosaïque, une estrade royale bâtie avec des rangs alternés de pierres de rubis, de pierres d’émeraude, de pierres d’argent et de pierres d’or. Et sur cette estrade s’étendait, soutenu par quatre légers piliers d’albâtre rose, un grand voile de soie verte qui protégeait de la douceur de son ombre un trône de bois d’aloès et d’or, d’un travail exquis, le long duquel grimpait une vigne aux lourdes grappes, dont les grains étaient des perles grosses comme des œufs de pigeon. Et le tout était entouré d’un treillage en lamelles d’or rouge et d’argent. Et une telle harmonie et une telle beauté vivaient sur ces choses pures, que nul homme, fût-il Khosroès ou Kaïssar, n’eût pu deviner ou réaliser de pareilles splendeurs.
Aussi, Hassân, ébloui, n’osait bouger de peur de troubler la paix délicieuse de ces lieux, quand, tout à coup, il vit se détacher sur le ciel et se rapprocher visiblement du lac un vol de grands oiseaux. Et voici qu’ils vinrent s’abattre sur le bord de l’eau ; et ils étaient au nombre de dix ; et leurs belles plumes blanches et touffues traînaient sur l’herbe, tandis qu’en marchant ils se balançaient avec nonchalance. Et ils semblaient obéir, en tous leurs mouvements, à un oiseau plus grand et plus beau qu’eux tous qui lentement s’était dirigé vers l’estrade et était monté sur le trône. Et, soudain, tous les dix ensemble, d’un gracieux mouvement, se dépouillèrent de leurs plumes. Et, ce manteau rejeté, il en sortit dix lunes de pure beauté, sous la forme de dix jeunes filles toutes nues. Et, rieuses, elles sautèrent dans l’eau qui les reçut avec un éclaboussement de pierreries. Et elles se baignèrent avec délices, en folâtrant entre elles ; et la plus belle les poursuivait, les attrapait et s’enlaçait à elles avec mille caresses, et les chatouillait et les mordait avec quels rires et quelles câlineries !
Lorsque leur bain fut terminé, elles sortirent du lac ; et la plus belle remonta sur l’estrade et alla s’asseoir sur le trône, n’ayant pour tout vêtement que sa chevelure. Et Hassân, en contemplant ses charmes, sentit sa raison s’envoler, et il pensa : « Ah ! je sais bien maintenant pourquoi ma sœur Bouton-de-Rose m’a défendu d’ouvrir cette porte ! Voici que mon repos est à jamais perdu ! » Et il continua à détailler les diverses beautés de l’adolescente nue. Quelles merveilles ! ah ! que ne vit-il pas ! En vérité, c’était, à n’en pas douter, la plus parfaite chose sortie des doigts du Créateur. Ô sa splendide nudité ! Elle surpassait les gazelles par la beauté de sa nuque et l’éclat de ses yeux noirs, et l’araka par la sveltesse de sa taille. Sa chevelure de ténèbres était une nuit d’hiver, épaisse et noire. Sa bouche imitant la rose était le sceau de Soleïman. Ses dents de jeune ivoire étaient un collier de perles, ou des grêlons d’égale grosseur ; son cou était un lingot d’argent ; son ventre avait des coins et des recoins, et sa croupe des fossettes et des étages ; son nombril était assez vaste pour contenir une once de musc noir ; ses cuisses étaient lourdes et à la fois fermes et élastiques comme des coussins bourrés de plumes d’autruche, et, à leur sommet, dans son nid chaud et charmant, semblable à un lapin sans oreilles, une histoire pleine de gloire, avec sa terrasse et son territoire, et ses vallons en entonnoir, où se laisser choir pour oublier les chagrins noirs. Et l’on pouvait également la prendre pour une coupole de cristal, ronde de tous les côtés et assise sur une base solide, ou pour une tasse d’argent reposant renversée. Et c’est à une telle adolescente que peuvent s’appliquer ces vers du poète :
Elle vint à moi, la jeune fille, vêtue de sa beauté comme le rosier de ses roses, et les seins en avant, ô grenades ! Et je m’écriai : « Voici la rose et les grenades ! »
Je me trompais ! Comparer tes joues aux roses, ô jeune fille, et tes seins aux grenades, quelle erreur ! Car ni les roses des rosiers, ni les grenades des jardins ne méritent la comparaison.
Car les roses, on peut les respirer, et les grenades on peut les cueillir, mais toi, ô virginale, qui peut se flatter de te sentir ou toucher ?
Et telle était l’adolescente qui était montée s’asseoir, royale et nue, sur le trône, au bord du lac…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Et telle était l’adolescente qui était montée s’asseoir, royale et nue, sur le trône au bord du lac. Lorsqu’elle se fut reposée de son bain, elle dit à ses compagnes, couchées près d’elle sur l’estrade : « Donnez-moi mes vêtements de dessous ! » Et les jeunes filles s’approchèrent et lui mirent, pour tout vêtement, une écharpe d’or sur les épaules, une gaze verte sur les cheveux et une ceinture en brocart autour de la taille. Et ainsi elle fut parée ! Et elle était comme une nouvelle épousée, et plus merveilleuse qu’aucune merveille. Et Hassân la regardait, caché derrière les arbres de la terrasse, et, malgré tout le désir qui le poussait à s’avancer, il ne parvenait point à faire un mouvement, tant il était immobilisé par l’admiration et anéanti par l’émotion. Et l’adolescente dit : « Ô princesses, voici le matin qui se lève, et il est temps que nous songions au départ, car notre pays est loin, et nous nous sommes assez reposées ! » Alors elles la vêtirent de sa robe de plumes, se vêtirent également de la même manière, et toutes ensemble s’envolèrent, mettant de la clarté dans le ciel du matin.
Tout cela ! Et Hassân, stupéfait, les suivait des yeux et, bien longtemps après qu’elles eurent disparu, il continua à fixer l’horizon lointain, en proie à la violence d’une passion que n’avait jamais allumé en son âme la vue de n’importe quelle fille de la terre. Et des larmes de désir et d’amour coulèrent le long de ses joues, et il s’écria : « Ah ! Hassân, infortuné Hassân ! Voici ton cœur désormais entre les mains des filles des genn, toi que nulle beauté ne sut fixer dans ta patrie ! » Et, plongé dans une profonde rêverie, et la joue sur la main, il improvisa :
« Quel matin t’accueille, ô disparue, sous sa rosée ? De lumière vêtue et de beauté tu m’apparus pour torturer mon cœur et t’en aller.
Ils ont osé prétendre que l’amour est rempli de douceur ? Ah ! si ce martyre est doux, quelle serait donc l’amertume de la myrrhe ? »
Et il continua à soupirer de la sorte, sans fermer l’œil, jusqu’au lever du soleil. Puis il descendit sur le bord du lac, et se mit à errer de ci de là, respirant dans l’air frais les effluves qu’elles avaient laissés. Et il continua à se consumer tout le jour dans l’attente de la nuit, pour remonter alors sur la terrasse, espérant le retour des oiseaux. Mais rien ne vint cette nuit-là ni les autres nuits. Et Hassân, désespéré, ne voulut plus ni manger, ni boire, ni dormir, et ne fit que s’enivrer de plus en plus de sa passion pour l’inconnue. Et, de cette façon, il dépérit et jaunit ; et ses forces peu à peu l’abandonnèrent, et il se laissa tomber sur le sol, se disant : « La mort est encore préférable à cette vie de souffrance ! »
Sur ces entrefaites, les sept princesses, filles du roi du Gennistân, revinrent des fêtes où elles avaient été conviées par leur père. Et la plus jeune courut, avant même de changer ses vêtements de voyage, à la recherche de Hassân. Et elle le trouva dans sa chambre, étendu sur son lit, bien pâle et bien changé ; et il avait les paupières fermées, et des larmes coulaient lentement le long de ses joues. Et la jeune fille, à cette vue, poussa un cri douloureux et se jeta sur lui et l’entoura de ses bras, comme la sœur le fait pour son frère, et le baisa sur le front et sur les yeux, lui disant : « Ô mon frère bien-aimé, par Allah ! mon cœur se fend de te voir en cet état ! Ah ! dis-moi de quel mal tu souffres, pour que j’en trouve le remède ! » Et Hassân, la poitrine soulevée de sanglots, fit de la tête et de la main un signe qui signifiait : « Non ! » et ne prononça pas une parole. Et la jeune fille, tout en larmes, et avec des caresses infinies dans la voix, lui dit : « De grâce, mon frère Hassân, âme de mon âme, délices de mes paupières, de voir tes yeux enfoncés de maigreur dans leurs orbites, et effacées les roses de tes joues chéries, la vie m’est devenue étroite et sans charme ! Je te conjure, par l’affection sacrée qui nous lie, de ne point cacher tes peines et ton mal à une sœur qui voudrait racheter ta vie au prix de mille siennes ! » Et, éperdue, elle le couvrait de baisers et lui tenait les deux mains appuyées contre sa poitrine, et le suppliait ainsi à genoux près de sa couche. Et Hassân, au bout d’un certain temps, poussa plusieurs soupirs déchirants et, d’une voix éteinte, improvisa ces vers :
« Si tu regardais attentivement, tu trouverais, sans explication, la cause de mes souffrances. Mais à quoi bon connaître une maladie qui n’a point de remède ?…
Mon cœur a changé de place, et mes yeux ne savent plus dormir ! Et ce qui a été changé par l’amour, ne peut être restauré que par l’amour ! »
Puis les larmes de Hassân coulèrent en abondance ; et il ajouta : « Ah ! ma sœur, quel secours peux-tu apporter à quelqu’un qui souffre de sa faute ? Et puis j’ai bien peur que tu ne puisses que me laisser mourir de mon chagrin et de mon infortune ! » Mais la jeune fille s’écria : « Le nom d’Allah sur toi et autour de toi, ô Hassân ! Que dis-tu là ? Dût mon âme quitter mon corps, je ne saurais faire autrement que de te venir en aide ! » Alors Hassân, avec des sanglots dans la voix, dit : « Sache donc, ô ma sœur Bouton-de-Rose, qu’il y a dix jours que je n’ai pris de nourriture et cela à cause de telles et telles choses qui me sont arrivées ! » Et il lui raconta toute son aventure, sans en omettre un détail !
Lorsque Bouton-de-Rose eut entendu le récit de Hassân, loin de s’en montrer formalisée, comme elle aurait pu l’être, elle compatit grandement à sa peine, et se mit à pleurer avec lui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… elle compatit grandement à sa peine, et se mit à pleurer avec lui. Puis elle lui dit : « Ô mon frère, calme ton âme chérie, rafraîchis tes yeux et sèche tes larmes ! Car, moi, je te jure que je suis prête à risquer ma chère vie et mon âme précieuse pour remédier à ce qui t’arrive et réaliser ton désir en te faisant posséder l’inconnue que tu aimes, inschallah ! Mais je te recommande, ô mon frère, de tenir la chose secrète et de ne pas en dire un mot à mes sœurs, sans quoi tu risques de te perdre et de me perdre avec toi. Et, si elles te parlent de la porte défendue et t’interrogent à ce sujet, dis-leur : « Je ne connais pas cette porte-là ! » Et si, désolées de te voir si languissant, elles te font des questions, tu leur diras : « Si je suis languissant, c’est d’avoir trop longtemps, dans cette solitude, souffert de votre absence ! Et mon cœur a beaucoup travaillé à votre sujet ! » Et Hassân répondit : « Certes ! c’est ainsi que je parlerai ! car ton idée est excellente ! » Et il embrassa Bouton-de-Rose, et sentit son âme se tranquilliser et sa poitrine se dilater d’être ainsi soulagé de la grande crainte qu’il avait de voir sa sœur se fâcher contre lui à cause de la porte défendue ! Et, désormais rassuré, il respira à son aise et demanda à manger. Et Bouton-de-Rose l’embrassa encore une fois et se hâta d’aller, les larmes aux yeux, rejoindre ses sœurs auxquelles elle dit : « Hélas ! mes sœurs, mon pauvre frère Hassân est bien malade ! Depuis dix jours pas un aliment n’est descendu dans son estomac, fermé à cause de notre absence et du désespoir où il est plongé ! Nous l’avons laissé seul ici, le pauvre bien-aimé, sans personne pour lui tenir compagnie ; et alors il s’est rappelé sa mère et sa patrie, et ces souvenirs l’ont saturé d’amertume. Oh ! que son sort est pitoyable, mes sœurs ! »
À ce discours de Bouton-de-Rose, les princesses, qui étaient douées d’une âme charmante et facile à émouvoir, s’empressèrent de courir porter à manger et à boire à leur frère ; et elles s’efforcèrent de le consoler et de le ranimer par leur présence et leurs paroles ; et, pour le distraire, elles lui racontèrent toutes les fêtes et les merveilles qu’elles avaient vues au palais de leur père, dans le Gennistân. Et, pendant un mois entier, elles ne cessèrent de lui prodiguer les soins les plus attentifs et les plus tendres, sans parvenir toutefois à le guérir tout à fait.
Au bout de ce temps, les princesses, à l’exception de Bouton-de-Rose qui demanda à rester au palais pour ne point laisser Hassân seul, sortirent pour aller à la chasse, selon leur habitude ; et elles surent bon gré à leur jeune sœur de son attention pour leur hôte. Or, dès qu’elles furent parties, la jeune fille aida Hassân à se lever, le prit dans ses bras, et le conduisit sur la terrasse qui dominait le lac. Et, là, le prenant dans son sein, et lui faisant reposer la tête contre son épaule, elle lui dit : « Dis-moi maintenant, mon agneau, dans lequel de ces pavillons échelonnés sur le bord du lac tu as aperçu celle qui te cause tant d’alarmes. » Et Hassân répondit : « Ce n’est point dans un de ces pavillons que je l’ai vue, mais c’est d’abord dans l’eau du lac et ensuite sur le trône de cette estrade ! » À ces paroles, la jeune fille devint fort pâle de teint et s’écria : « Ô notre malheur ! Mais alors, ô Hassân, c’est la fille même du roi des genn, qui règne sur le vaste empire dont mon père n’est qu’un des lieutenants ! Et le pays où notre roi réside est à une distance infranchissable et environné d’une mer que les hommes ni les genn ne peuvent traverser. Et il a sept filles, dont celle que tu as vue est la plus jeune. Et il a une garde composée uniquement d’adolescentes guerrières d’une naissance illustre, qui commandent chacune à un corps de cinq mille amazones. Or, c’est précisément celle que tu as vue qui est la plus belle et la plus aguerrie de toutes les adolescentes royales ; et elle surpasse toutes les autres en courage et en adresse. Elle s’appelle Splendeur ! Elle vient ici se promener à chaque nouvelle lune, en compagnie des filles des chambellans de son père. Quant à leurs manteaux de plumes, qui les portent dans les airs comme des oiseaux, ils appartiennent à la garde-robe des génies ! Et c’est grâce à ces manteaux que nous allons pouvoir atteindre notre but. Sache, en effet, ô Hassân, que le seul moyen que tu aies de te rendre maître de sa personne, c’est de t’emparer de ce vêtement enchanté. Pour cela, tu n’as qu’à attendre ici son retour, en te cachant ; et tu profiteras du moment où elle sera descendue se baigner dans le lac, pour enlever le manteau et n’enlever rien que cela ! Et, du coup, tu la possèdes elle-même ! Et alors prends bien garde de céder à ses supplications, et de lui rendre son manteau, sinon tu es perdu sans recours, et nous serons toutes également les victimes de sa vengeance, et notre père avec nous ! Saisis-la plutôt par les cheveux, et entraîne-la avec toi ; et elle se soumettra à toi et t’obéira ! Et il arrivera ce qui arrivera…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et il arrivera ce qui arrivera. »
À ce discours de Bouton-de-Rose, Hassân fut transporté de joie et sentit une vie nouvelle entrer en lui et lui rendre la plénitude de ses forces. Et il se leva debout sur ses pieds et prit dans ses mains la tête de sa sœur et l’embrassa tendrement, en la remerciant de son amitié. Et tous deux descendirent dans le palais et passèrent le reste du temps à s’entretenir doucement de choses et d’autres, en compagnie des autres jeunes filles.
Or, le lendemain, qui était précisément le jour de la nouvelle lune, Hassân attendit la nuit pour aller se cacher derrière l’estrade du bord du lac. Et il était à peine là depuis quelques instants, qu’un bruit d’ailes se fit entendre dans le silence nocturne et, à la clarté de la lune, les oiseaux, si impatiemment désirés, arrivèrent et descendirent dans le lac, après avoir ôté leurs manteaux de plumes et leurs soieries de dessous. Et la merveilleuse Splendeur, fille du roi-des-rois des genn, plongea, elle aussi, dans l’eau sa chair de gloire nue. Et elle était plus belle et plus désirable que la première fois. Et Hassân, malgré l’admiration et l’émoi où il se trouvait, put tout de même se glisser, sans être vu, jusqu’à l’endroit où étaient posés les vêtements, enlever le manteau de plumes de l’adolescente royale, et s’esquiver en toute hâte derrière l’estrade.
Lorsque la belle Splendeur fut sortie du bain, d’un coup d’œil elle s’aperçut, au désordre des vêtements épars sur le gazon, qu’une main étrangère avait profané leurs effets. Et elle s’approcha et constata que son manteau à elle avait disparu. Et elle poussa un grand cri de terreur et de désespoir, et se frappa le visage et la poitrine. Ô ! qu’elle était belle ainsi, sous la lune, la désespérée ! Mais ses compagnes, au cri entendu, se précipitèrent pour voir quelle était l’affaire, et, comprenant ce qui venait de se passer, elles prirent en hâte chacune son manteau et, sans songer à sécher leur nudité mouillée et à se vêtir de leurs soieries de dessous, elles s’enveloppèrent de leurs plumes volantes et, rapides comme des gazelles effarées ou des colombes poursuivies par un faucon, elles s’enfuirent éperdument à travers les airs. Et elles disparurent en un clin d’œil, laissant seule, au bord du lac, l’éplorée, la douloureuse, l’indignée Splendeur, fille de leur roi.
Alors, Hassân, bien que tremblant d’émotion, s’élança de sa cachette sur l’adolescente nue qui s’enfuit. Et il la poursuivit autour du lac, l’appelant par les noms les plus tendres, et l’assurant qu’il ne lui voulait aucun mal. Mais elle, telle une biche aux abois, courait, les bras en avant, haletante, les cheveux au vent, affolée d’être ainsi surprise dans sa chair intime de vierge. Mais Hassân, bondissant, finit par l’atteindre : et il la saisit par sa chevelure qu’il enroula autour de son poignet, et la contraignit de le suivre. Alors elle ferma les yeux et, résignée à son sort, se laissa mener sans opposer de résistance. Et Hassân la conduisit dans sa chambre où, sans se laisser toucher par ses supplications et ses pleurs, il l’enferma pour courir sans retard prévenir sa sœur et lui annoncer la bonne nouvelle de son succès.
Aussitôt, Bouton-de-Rose se rendit à la chambre de Hassân et trouva l’éplorée Splendeur qui se mordait les mains de désespoir, et qui pleurait toutes les larmes de ses yeux. Et Bouton-de-Rose se jeta à ses pieds pour lui rendre hommage et, après avoir embrassé la terre, lui dit : « Ô ma souveraine, la paix sur toi et la grâce d’Allah et ses bénédictions ! Tu éclaires la demeure et la parfumes de ta venue ! » Et Splendeur répondit : « Comment ! c’est toi, Bouton-de-Rose ! c’est donc ainsi que tu permets que les enfants des hommes traitent la fille de ton roi ! Tu connais la puissance de mon père ; tu sais que les rois des genn lui sont soumis, et qu’il commande à des légions d’éfrits et de mareds, innombrables comme les grains du sable marin ; et tu as osé recevoir un homme dans ta demeure, pour qu’il puisse me surprendre, et tu as trahi la fille de ton souverain ! Sinon, comment cet homme aurait-il trouvé le chemin du lac où je me baignais ? »
À ces paroles, la sœur de Hassân répondit : « Ô princesse, fille de notre souverain, ô la plus belle et la plus admirée des filles des genn et des humains ! Sache que celui qui t’a surprise dans ton bain, ô lustrale, est un adolescent à nul autre pareil. Et il est, en vérité, doué de manières trop charmantes pour avoir eu la moindre intention de te désobliger. Mais quand une chose a été fixée par la destinée, elle doit courir ! Et, justement, la destinée du beau jeune homme qui t’a surprise l’a rendu passionnément amoureux de ta beauté ; et les amoureux sont excusables ! Et de t’aimer comme il t’aime il ne peut être coupable à tes yeux ! Et, d’ailleurs, Allah n’a-t-il point créé les femmes pour les hommes ? Et celui-là n’est-il pas le plus charmant adolescent qui soit sur terre ? Si tu savais, ô ma maîtresse, comme il a été malade depuis le jour où pour la première fois il t’a vue ! Il a failli en perdre son âme ! Ainsi ! » Et elle continua à raconter à la princesse toute la violence de la passion allumée dans le cœur de Hassân, et termina, en disant : « Et n’oublie pas, ô ma maîtresse, qu’il t’a choisie au milieu de tes dix compagnes, comme la plus belle et la plus merveilleuse ! Et, pourtant, comme toi elles étaient nues, et comme toi faciles à surprendre dans leur bain ! »
En entendant ce discours de la sœur de Hassân, la belle Splendeur vit bien qu’elle devait renoncer à tout plan d’évasion, et se contenta de pousser un grand soupir de résignation. Et Bouton-de-Rose courut aussitôt lui apporter une magnifique robe dont elle la vêtit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et Bouton-de-Rose courut aussitôt lui apporter une magnifique robe dont elle la vêtit. Ensuite elle lui servit à manger, et fit tous ses efforts pour bannir son chagrin. Et la belle Splendeur finit par se consoler un peu et dit : « Je vois bien qu’il était écrit dans ma destinée que je devais être séparée de mon père, de ma famille et des demeures de la patrie ! Et il faut que je me soumette aux arrêts du destin ! » Et la sœur de Hassân ne manqua pas de la maintenir dans cette résolution, et fit si bien que les larmes de la princesse s’arrêtèrent tout à fait et qu’elle se résigna à son sort. Alors, la sœur de Hassân s’absenta un moment pour courir auprès de son frère et lui dire : « Hâte-toi de te rendre à l’instant vers ta bien-aimée, car le moment est propice. Une fois que tu auras pénétré dans la chambre, commence par lui baiser les pieds, puis les mains, puis la tête. Et alors seulement adresse-lui la parole, et cela de la façon la plus éloquente et la plus gentille ! » Et Hassân, tremblant d’émotion, se rendit auprès de la princesse qui, l’ayant reconnu, le regarda attentivement et fut, malgré son dépit, touchée à l’extrême par sa beauté. Mais elle baissa les yeux, et Hassân lui embrassa les pieds et les mains et la baisa ensuite sur le front, entre les deux yeux, en lui disant : « Ô souveraine des plus belles, vie des âmes, joie des regards, jardin de l’esprit, ô reine, ô ma souveraine ! de grâce, tranquillise ton cœur, et rafraîchis tes yeux, car ton sort est plein de bonheur ! Moi, je n’ai pour tout dessein à ton sujet que d’être uniquement ton esclave fidèle, comme déjà ma sœur est ta servante. Et mon intention n’est point de te violenter, mais de t’épouser d’après la loi d’Allah et de son Envoyé ! Et alors je te conduirai à Baghdad, ma patrie, où je t’achèterai des esclaves des deux sexes, et une demeure digne de toi par sa magnificence. Ah ! si tu savais quel pays admirable que celui où s’élève Baghdad, la ville de paix, et comme ses habitants sont aimables, polis et accueillants, et comme leur abord est délicieux et de bon augure ! Et puis, j’ai une mère qui est la meilleure des femmes et qui t’aimera comme sa fille, et qui te fera des plats merveilleux, car c’est certainement elle qui sait le mieux faire la cuisine dans tout le pays d’Irak ! »
Ainsi parla Hassân à l’adolescente Splendeur, fille du roi du Gennistân ! Et la princesse ne lui répondait ni par un mot, ni par une lettre, ni par un signe ! Et, soudain, on entendit frapper à la porte du palais. Et Hassân, qui était chargé d’ouvrir et de fermer les portes, dit : « Excuse-moi, ô ma maîtresse ! Je vais m’absenter un moment ! » Et il courut ouvrir la porte. Or, c’étaient ses sœurs qui revenaient de la chasse, et qui, le voyant de nouveau revenu à la santé et les joues éclairées, se réjouirent et furent ravies à la limite du ravissement. Et Hassân se garda bien de leur parler de la princesse Splendeur, et les aida à porter le produit de leur chasse, qui consistait en gazelles, en renards, en lièvres, en buffles, et en bêtes fauves de toutes les espèces. Et il fut avec elles d’une amabilité excessive, les embrassant l’une après l’autre sur le front, et les cajolant, et leur témoignant de l’amitié avec une effusion à laquelle elles n’étaient pas habituées de sa part, vu qu’il réservait toutes ses caresses à leur plus jeune sœur, Bouton-de-Rose ! Aussi furent-elles agréablement surprises de ce changement ; et même l’aînée des jeunes filles finit par soupçonner qu’il devait y avoir un motif qui occasionnait de tels transports ; et elle le regarda avec un sourire malicieux, et cligna de l’œil, et lui dit : « En vérité, ô Hassân, cette démonstration excessive nous étonne de ta part, toi qui jusqu’aujourd’hui acceptais nos caresses sans vouloir jamais nous les rendre ! Nous trouves-tu donc plus belles dans nos habits de chasse, ou bien nous aimes-tu mieux maintenant, ou bien sont-ce les deux motifs à la fois ? » Mais Hassân baissa les yeux, et poussa un soupir capable de fendre le cœur le plus endurci ! Et les princesses, étonnées, lui demandèrent : « Pourquoi donc soupires-tu de la sorte, ô notre frère ? Et qui peut troubler ta quiétude ? Veux-tu retourner auprès de ta mère, dans ta patrie ? Parle, Hassân, ouvre ton cœur à tes sœurs ! » Mais Hassân se tourna vers sa sœur Bouton-de-Rose, qui précisément venait d’arriver, et lui dit, en rougissant à l’extrême : « Parle plutôt, toi ! Car moi j’ai bien honte de leur dire la cause qui me trouble ! » Et Bouton-de-Rose dit : « Mes sœurs, ce n’est rien du tout ! Notre frère a simplement attrapé un bel oiseau de l’air, et désire, de vous autres, que vous l’aidiez à l’apprivoiser ! » Et toutes s’écrièrent : « Certes ! cela n’est rien du tout ! Mais pourquoi Hassân rougit-il tellement de cette chose-là ? » Elle répondit : « Voilà ! C’est que Hassân aime d’amour, et de quel amour ! cet oiseau-là. » Elles dirent : « Par Allah ! et comment feras-tu, ô Hassân, pour montrer ton amour à un oiseau de l’air ? » Et Bouton-de-Rose dit, alors que Hassân baissait la tête et rougissait encore bien plus : « Avec la parole, avec le geste et avec tout ce qui s’ensuit ! » Elles dirent : « Mais, alors, c’est qu’il est bien grand, l’oiseau de notre frère ! » Bouton-de-Rose dit : « Il est de notre taille ! Écoutez-moi plutôt ! » Et elle ajouta : « Sachez, ô mes sœurs, que l’esprit des fils d’Adam est très borné ! C’est pourquoi, lorsque nous eûmes laissé ici tout seul notre pauvre Hassân, comme il se sentait la poitrine fort rétrécie, il se mit à errer à travers le palais pour se distraire. Mais il avait l’esprit si troublé, qu’il confondit les clefs des chambres, et ouvrit, par mégarde, la porte de l’appartement défendu, où se trouve la terrasse ! Et il lui arriva telle et telle chose ! » Et elle raconta, mais en atténuant la faute de Hassân, toute l’histoire, en ajoutant : « En tout cas, notre frère est excusable, car l’adolescente est belle ! Ah ! si vous saviez, mes sœurs, comme elle est belle ! »
À ce discours de Bouton-de-Rose, ses sœurs lui dirent : « Si elle est aussi belle que tu le dis, commence, avant de nous la montrer, par nous la dépeindra à peu près ! » Bouton-de-Rose dit : « Vous la dépeindre, ya Allah ! qui le pourrait ! Des poils me pousseraient plutôt sur la langue, avant que je puisse vous dire ses charmes, même approximativement. Je veux bien pourtant essayer, ne fût-ce que pour vous empêcher, en la voyant, de tomber sur le dos !
« Bismillah, ô mes sœurs ! gloire à Celui qui a revêtu de splendeur sa nudité de jasmin ! Elle surpasse les gazelles par la beauté de sa nuque et par l’éclat de ses yeux noirs, et l’araka par la sveltesse de sa taille ! Sa chevelure est une nuit d’hiver, épaisse et noire ; sa bouche, imitant la rose, est le sceau même de Soleïmân ; ses dents de jeune ivoire sont un collier de perles, ou des grêlons d’égale grosseur ; son cou est un lingot d’argent ; son ventre a des coins et des recoins, et sa croupe des fossettes et des étages ; son nombril est assez vaste pour contenir une once de musc noir ; ses cuisses sont lourdes et à la fois fermes et élastiques comme des coussins bourrés de plumes d’autruche, et, à leur sommet, dans son nid chaud et charmant, semblable à un lapin sans oreilles, une histoire pleine de gloire, avec sa terrasse et son territoire, et ses vallons en entonnoir, où se laisser choir pour oublier les chagrins noirs. Et ne vous y trompez point, ô mes sœurs ! Car vous pourriez, en la voyant, la prendre également pour une coupole de cristal, ronde de tous les côtés et assise sur une base solide, ou pour une tasse d’argent reposant renversée. Et c’est à une telle adolescente que s’appliquent judicieusement ces vers du poète :
« Elle vint à moi, la jeune fille, vêtue de sa beauté comme le rosier de ses roses, et les seins en avant, ô grenades ! Et je m’écriai : « Voici la rose et les grenades ! »
Je me trompais ! comparer tes joues aux roses, ô jeune fille, et tes seins aux grenades, quelle erreur ! Car ni les roses des rosiers ni les grenades des jardins ne méritent la comparaison.
Car les roses, on peut les respirer, et les grenades on peut les cueillir, mais toi, ô virginale, qui peut se flatter de te sentir ou toucher ?
« Et voilà, ô mes sœurs, ce que, d’un coup d’œil, j’ai pu voir de la princesse Splendeur, fille du roi-des-rois du Gennistân…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et voilà ce que j’ai pu voir de la princesse Splendeur, fille du roi-des-rois du Gennistân ! »
Lorsque les jeunes filles eurent entendu ces paroles de leur sœur, elles s’écrièrent, émerveillées : « Que tu as raison, ô Hassân, d’être épris de cette adolescente splendide ! Mais, par Allah ! hâte-toi de nous conduire auprès d’elle, pour que nous la voyions de nos yeux ! » Et Hassân, rassuré du côté de ses sœurs, les conduisit au pavillon où se trouvait la belle Splendeur. Et elles, voyant sa beauté sans pareille, baisèrent la terre entre ses mains, et, après les salams de bienvenue, lui dirent : « Ô fille de notre roi, certes ! ton aventure avec l’adolescent, notre frère, est prodigieuse. Mais, nous toutes ici debout entre tes mains, nous te prédisons le bonheur dans le futur, et nous t’assurons que, durant toute ta vie, tu n’auras qu’à te louer grandement de cet adolescent, notre frère, et de sa délicatesse de manières et de son adresse en tout, et de son affection ! Songe en outre qu’au lieu de se servir d’un intermédiaire il t’a lui-même déclaré sa passion, et ne t’a rien demandé d’illicite ! Et nous, si nous n’étions pas certaines que les jeunes filles ne peuvent se passer d’hommes, nous ne ferions pas auprès de toi, la fille de notre roi, une démarche aussi hardie ! Laisse-nous donc te marier avec notre frère, et tu seras contente de lui, nous le te certifions sur notre cou ! » Et, ayant dit ces paroles, elles attendirent la réponse. Mais, comme la belle Splendeur ne disait ni oui ni non, Bouton-de-Rose s’avança et lui prit la main dans ses mains et lui dit : « Avec ta permission ! ô notre maîtresse ! » et elle se tourna vers Hassân et lui dit : « Avance ta main, toi ! » Et Hassân avança la main, et Bouton-de-Rose la prit et l’unit dans les siennes à celle de la princesse Splendeur, en leur disant à tous deux : « Avec l’assentiment d’Allah et par la loi de son Envoyé, je vous marie ! » Et Hassân, à la limite du bonheur, improvisa ces vers :
« Ô mélange admirable réuni en toi, houria ! En voyant ton glorieux visage baigné dans l’eau de la beauté, qui pourrait en oublier la rayonnante splendeur !
Mes yeux te voient composée précieusement de rubis, pour toute la moitié de ton corps charmant, de perles pour le tiers, de musc noir pour le cinquième et d’ambre pour le sixième, ô toute dorée !
Parmi les vierges nées de l’Ève première, et parmi les beautés qui habitent les multiples jardins des cieux, il n’en est aucune qu’on puisse te comparer !
Veux-tu me donner la mort ? Ne me pardonne pas ! L’amour a fait bien d’autres victimes ! Veux-tu me rappeler à la vie, abaisse tes yeux vers moi, ô ornement du monde ! »
Et les jeunes filles, en entendant ces vers, s’écrièrent toutes ensemble, en se tournant vers Splendeur : « Ô princesse, nous blâmeras-tu maintenant de t’avoir amené un jouvenceau qui s’exprime d’une si belle façon, et en vers si beaux ? » Et Splendeur demanda : « Est-il donc poète ? » Elles dirent : « Mais certainement ! Il improvise et compose avec une facilité merveilleuse des poèmes et des odes de milliers de vers, où règne toujours un très vif sentiment ! » Ces paroles, qui montraient si clairement le nouveau mérite de Hassân, achevèrent enfin de gagner le cœur de la nouvelle épousée. Et elle regarda Hassân en souriant sous ses grands cils. Et Hassân, qui n’attendait qu’un signe de ses yeux, la prit dans ses bras et l’emporta dans sa chambre. Et là, avec sa permission, il ouvrit en elle ce qu’il y avait à ouvrir, et brisa ce qu’il y avait à briser, et décacheta ce qu’il y avait de scellé ! Et il se dulcifia de tout cela à la limite de la dulcification ; et elle également. Et ils éprouvèrent, tous deux, la somme de toutes les joies du monde en peu de temps. Et l’amour s’incrusta dans le cœur de Hassân pour la jouvencelle, au delà de toutes les passions. Et il chanta longuement de tous ses oiseaux ! Or, gloire à Allah qui unit ses Croyants dans les délices et ne leur calcule pas ses dons bienheureux ! C’est toi, Seigneur, que nous adorons, c’est toi dont nous implorons le secours ! Dirige-nous dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui sont dans l’égarement !
Or, Hassân et Splendeur passèrent de la sorte ensemble quarante jours au sein de toutes les jouissances que procure l’amour. Et les sept princesses, surtout Bouton-de-Rose, s’efforcèrent de varier chaque jour les plaisirs des deux époux, et de leur rendre le séjour du palais le plus agréable qu’il leur fut possible. Mais, au bout du quarantième jour, Hassân vit en songe sa mère, qui lui reprochait de l’avoir oubliée, tandis qu’elle passait les jours et les nuits à pleurer sur le tombeau qu’elle lui avait fait élever dans la maison. Et il se réveilla les larmes aux yeux, et poussant des soupirs à fendre l’âme ! Et les sept princesses, ses sœurs, accoururent en l’entendant pleurer ; et Bouton-de-Rose, éplorée plus que toutes les autres, demanda à la fille du roi des genn ce qui était arrivé à son époux ! Et Splendeur répondit : « Je ne sais pas ! » Et Bouton-de-Rose dit : « Je vais alors moi-même m’informer du sujet de son trouble ! » Et elle demanda à Hassân : « Qu’as-tu, mon agneau ? » Et les larmes de Hassân ne firent que couler avec plus de violence ; et il finit par raconter son rêve, en se lamentant beaucoup…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… et il finit par raconter son rêve, en se lamentant beaucoup. Alors, ce fut au tour de Bouton-de-Rose de pleurer et de gémir, tandis que ses sœurs disaient à Hassân : « En ce cas, ô Hassân, nous ne pouvons te retenir davantage ici ni t’empêcher de retourner dans ton pays revoir ta mère chérie. Seulement, nous te supplions de ne point nous oublier et de nous promettre de revenir nous faire une visite, une fois tous les ans ! » Et sa petite sœur Bouton-de-Rose se jeta à son cou en sanglotant, et finit par tomber évanouie de douleur. Et, lorsqu’elle reprit connaissance, elle récita tristement des vers d’adieu, et enfonça sa tête dans ses genoux, refusant toute consolation. Et Hassân se mit à l’embrasser et à la cajoler ; et il lui promit par serment de revenir la voir une fois tous les ans. Et pendant ce temps, sur la prière de Hassân, ses autres sœurs se mirent à faire les préparatifs du voyage. Et quand tout fut prêt, elles lui demandèrent : « De quelle manière veux-tu retourner à Bassra ? » Il dit : « Je ne sais pas ! » Puis soudain il se rappela le tambour magique qu’il avait enlevé au magicien Bahram, et sur lequel était tendue la peau de coq. Et il s’écria : « Par Allah ! voilà l’affaire. Mais je ne sais point m’en servir ! » Alors Bouton-de-Rose, qui pleurait, sécha un moment ses larmes et, se levant, dit à Hassân : « Ô mon frère bien-aimé, moi je vais t’enseigner le moyen de te servir de ce tambour ! » Et elle prit le tambour, et, l’appuyant sur son flanc, elle fit le simulacre de battre des doigts sur la peau de coq. Puis elle dit à Hassân : « C’est comme ça qu’il faut faire ! » Et Hassân dit : « J’ai compris, ma sœur ! » Et il prit à son tour le tambour des mains de la jeune fille, et le battit de la même manière qu’il avait vu faire à Bouton-de-Rose, mais avec beaucoup de force. Et, aussitôt, de tous les points de l’horizon surgirent de grands chameaux, des dromadaires de course, des mulets et des chevaux. Et tout le troupeau accourut au galop se ranger tumultueusement, sur une longue file, d’abord les chameaux, puis les dromadaires de course, puis les mulets et les chevaux.
Alors, les sept princesses choisirent les meilleures bêtes et congédièrent le reste. Et elles chargèrent sur celles qu’elles avaient choisies les ballots précieux, les cadeaux, les effets et les provisions de bouche. Et elles mirent sur le dos d’un grand dromadaire de course un magnifique palanquin à deux places pour les deux époux. Et alors commencèrent les adieux. Oh ! qu’ils furent douloureux ! Pauvre Bouton-de-Rose ! Tu fus triste, et tu pleurais ! Comme ton cœur fraternel se fendait en embrassant Hassân qui partait avec la fille du roi ! Et tu gémissais comme une tourterelle violemment séparée d’avec son tourtereau ! Ah ! tu ne savais pas encore, ô tendre Bouton-de-Rose, combien d’amertume renferme la coupe de la séparation ! Et tu ne te doutais pas que ton bien-aimé Hassân, dont tu préparais le bonheur, ô pleine de pitié, devait être si tôt enlevé à ton affection ! Mais tu le reverras, sois en certaine ! Tranquillise donc ton âme chérie, et rafraîchis tes yeux ! À force de pleurer, tes joues sont devenues, de roses qu’elles étaient, semblables aux fleurs du grenadier ! cesse tes pleurs, Bouton-de-Rose tranquillise ton âme chérie et rafraîchis tes yeux ! Tu reverras Hassân, car ainsi le veut la destinée !
Or donc, la caravane se mit en marche, au milieu des cris déchirants des adieux, et disparut au loin, tandis que Bouton-de-Rose retombait évanouie. Et, avec la rapidité de l’oiseau, elle traversa les montagnes et les vallées, les plaines et les déserts, et, avec l’assentiment d’Allah qui lui écrivit la sécurité, elle arriva sans encombre à Bassra.
Lorsqu’ils furent à la porte de la maison, Hassân entendit sa mère gémir et déplorer douloureusement l’absence de son fils ; et ses yeux se remplirent de larmes, et il frappa à la porte. Et, du dedans, la voix cassée de la pauvre vieille demanda : « Qui est à la porte ? » Et Hassân dit : « Ouvre-nous ! » Et elle vint, en tremblant sur ses pauvres jambes, ouvrir la porte et, malgré sa vue affaiblie par les larmes, elle reconnut son fils Hassân. Alors elle poussa un grand soupir et tomba évanouie ! Et Hassân lui prodigua ses soins, aidé de son épouse, et la fit revenir à elle. Alors il se jeta à son cou, et ils s’embrassèrent tendrement, en pleurant de joie. Et, après les premiers transports, Hassân dit à son mère : « Ô mère, voici ta fille, mon épouse, que je t’amène pour te servir ! » Et la vieille regarda Splendeur, et, en la voyant si belle, elle fut éblouie et faillit voir s’envoler sa raison. Et elle lui dit : « Qui que tu sois, ma fille, sois la bienvenue dans la maison que tu illumines ! » Et elle demanda à Hassân : « Mon fils, comment s’appelle ton épouse ? » Il répondit : « Splendeur, ô ma mère ! » Elle dit : « Ô convenance du nom ! Qu’il fut bien inspiré celui qui t’a trouvé ce nom, ô fille de bénédiction ! » Et elle la prit par la main et s’assit à côté d’elle sur le vieux tapis de la maison. Et Hassân alors se mit à raconter à sa mère toute son histoire, depuis sa disparition soudaine jusqu’à son retour à Bassra, sans oublier un seul détail. Et sa mère fut émerveillée de ce qu’elle entendait, à la limite de l’émerveillement, et ne sut plus comment faire pour honorer, selon son rang, la fille du roi-des-rois du Gennistân.
Or, pour commencer, elle se hâta d’aller au souk acheter toutes sortes de provisions de première qualité ; et elle alla ensuite au souk des soieries, et acheta dix robes splendides, ce qu’il y avait de plus cher chez les grands marchands ; et elle les apporta à l’épouse de Hassân, et l’en vêtit, en les lui mettant toutes les dix à la fois, l’une au-dessus de l’autre, pour lui marquer de la sorte que rien n’était de trop pour son rang et son mérite. Et elle l’embrassa comme si c’eût été sa propre fille. Et elle se mit ensuite à lui cuisiner des mets extraordinaires et des pâtisseries à nulles autres pareilles. Et elle n’épargna rien pour la contenter, la comblant de soins et de délicates attentions. Après quoi, elle se tourna vers son fils et lui dit : « Je ne sais pas, Hassân, mais je crois bien que la ville de Bassra n’est pas digne du rang de ton épouse ; et il vaut mieux pour nous, sous tous les rapports, que nous allions vivre à Baghdad, la Cité de Paix, sous l’aile protectrice du khalifat Haroun Al-Rachid. Et puis, mon fils, nous voici devenus soudainement très riches, et je crains fort qu’en restant à Bassra, où nous sommes connus pour être pauvres, nous n’attirions l’attention d’une façon soupçonneuse, et soyons accusés, à cause de nos richesses, de pratiquer l’alchimie ! Le mieux, à mon avis, est de nous en aller au plus tôt à Baghdad, où, dès le commencement, nous serons connus pour être des princes ou des émirs du loin ! » Et Hassân répondit à sa mère : « L’idée est excellente ! » Et il se leva à l’heure et à l’instant, et vendit les meubles et la maison. Après quoi, il prit le tambour magique et fit résonner la peau de coq…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
… Après quoi, il prit le tambour magique et fit résonner la peau de coq. Et, aussitôt, surgirent du fond des airs les grands dromadaires, qui vinrent se ranger en file le long de la maison. Et Hassân et la mère de Hassân et l’épouse de Hassân prirent ce qu’ils avaient gardé de mieux en fait de choses précieuses et légères de poids, et, montant en palanquin, mirent les dromadaires au pas de course. Et, en moins de temps qu’il n’en faut pour reconnaître la main droite de la main gauche, ils arrivèrent sur les bords du Tigre, aux portes de Baghdad. Et Hassân prit les devants, et alla quérir un courtier qui lui fit faire l’acquisition, au prix de cent mille dinars, d’un magnifique palais, propriété d’un vizir d’entre les vizirs. Et il se hâta d’y conduire sa mère et son épouse. Et il meubla le palais avec un luxe fastueux, et acheta des esclaves des deux sexes, et des jeunes garçons et des eunuques. Et il n’épargna rien pour que son train de maison fût le plus remarquable de toute la ville de Baghdad.
Ainsi installé, Hassân mena dès lors, dans la Cité de Paix, une vie délicieuse avec son épouse Splendeur, entourés tous deux des soins minutieux de la vénérable vieille mère qui s’ingéniait tous les jours à confectionner un mets nouveau et à exécuter les recettes de cuisine qu’elle apprenait de ses voisines, et qui différaient beaucoup des recettes de Bassra ; car, à Baghdad, il y avait beaucoup de plats qu’on ne pouvait réussir nulle part ailleurs sur la face de la terre. Aussi, au bout de neuf mois de cette vie charmante et de cette nourriture soignée, l’épouse de Hassân accoucha heureusement de deux enfants mâles et jumeaux, comme des lunes. Et on appela l’un Nasser, et l’autre Manssour.
Or, au bout d’un an, le souvenir des sept princesses s’offrit à la mémoire de Hassân avec le rappel du serment qu’il leur avait fait. Et il éprouva le plus vif désir de revoir surtout sa sœur Bouton-de-Rose. Il fit donc les préparatifs nécessaires pour ce voyage, acheta les plus belles étoffes et les plus belles choses, dignes d’être offertes en cadeaux, qu’il put trouver à Baghdad et dans tout l’Irak, et fit part à sa mère du projet qu’il avait formé, en ajoutant : « Je veux seulement te recommander une chose, pendant mon absence, à la limite de la recommandation : c’est de garder bien soigneusement le manteau de plumes de mon épouse Splendeur, que j’ai caché dans le lieu le plus secret de la maison. Car, ô ma mère, sache bien que si mon épouse chérie avait l’occasion, pour notre plus grand malheur, de revoir ce manteau, elle se rappellerait à l’instant son instinct originel, qui est le vol des oiseaux, et ne pourrait s’empêcher de s’envoler d’ici, même à son cœur défendant ! Prends donc bien garde, ma mère, de lui montrer ce manteau-là ! Car, si ce malheur arrivait, moi, certainement, ou je mourrais de chagrin ou je me tuerais ! Je te recommande, en outre, de bien la soigner, vu qu’elle est délicate et habituée au dorlotement, et de ne point craindre de la servir toi-même de préférence aux servantes qui ne savent pas, comme toi, ce qui sied et ce qui ne sied pas, ce qui convient et ce qui ne convient pas, ce qui est raffiné et ce qui est grossier. Et surtout, ma mère, ne la laisse pas mettre un pied hors de la maison, ni faire sortir sa tête d’une fenêtre ni même monter sur la terrasse du palais ; car je crains beaucoup le grand air pour elle, et que l’espace ne la tente de quelque manière ou par quelque endroit. Ainsi donc, voilà mes recommandations ! Et si tu veux ma mort, tu n’as qu’à les négliger ! » Et la mère de Hassân répondit : « Qu’Allah me garde de te désobéir, ô mon enfant ! Prions sur le Prophète ! Est-ce que je serais devenue folle pour avoir besoin de tant de recommandations, ou pour enfreindre le moindre de tes ordres ! Pars donc tranquille, ô Hassân, et calme ton esprit ! Et, à ton retour, avec la grâce d’Allah, tu n’auras qu’à demander à Splendeur si tout a marché comme tu le voulais ! Mais, moi, à mon tour, je veux te demander une chose, ô mon enfant, et c’est de ne pas prolonger loin de nous ton absence plus que le temps nécessaire pour aller et revenir, après un court séjour auprès des sept princesses ! »
Ainsi se parlèrent l’un à l’autre Hassân et la mère de Hassân. Et ils ne savaient pas ce que leur réservait l’inconnu dans le livre de la destinée, alors que la belle Splendeur entendait toutes les paroles qu’ils se disaient et les fixait dans sa mémoire.
Or donc, Hassân promit à sa mère qu’il ne s’absenterait que juste le temps nécessaire, et lui fit ses adieux, et alla embrasser son épouse Splendeur, et ses deux fils Nasser et Manssour qui tétaient le sein de leur mère. Après quoi, il battit la peau de coq du tambour…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
… Après quoi, il battit la peau de coq du tambour, et enfourcha le dromadaire de course qui se présenta ; et, après avoir réitéré une seconde fois à sa mère toutes ses recommandations, il lui baisa la main. Puis il parla au dromadaire accroupi, qui se releva aussitôt sur ses quatre jambes et fila dans les airs, plutôt que sur terre, livrant ses membres au vent, et anéantissant, sous ses pas, la distance. Et il ne fut plus qu’un point au loin dans l’espace.
Or, il est, en vérité, sans utilité de dire l’intensité de joie qui accueillit Hassân à son arrivée chez les sept princesses, et surtout le bonheur de Bouton-de-Rose, et comment elles ornèrent le palais de guirlandes de fleurs et l’illuminèrent. Laissons-le plutôt raconter à ses sœurs tout ce qu’il a à leur raconter, surtout la naissance de ses deux fils jumeaux Nasser et Manssour ; laissons-le, en outre, se livrer avec elles à la chasse et aux amusements ; et faites-moi la grâce ô mes honorables et généreux auditeurs qui m’entourez, de revenir avec moi au palais de Hassân, à Baghdad, où nous avons laissé la vieille mère de Hassân et son épouse Splendeur. Accordez-moi cette faveur, ô mes seigneurs à la main ouverte, et vous verrez et vous entendrez ce que vos oreilles honorables et vos yeux admirables n’ont de leur vie jamais ouï, entendu ou soupçonné ! Et que sur vous descendent les bénédictions du Distributeur et les mieux choisies de ses faveurs. Écoutez-moi bien seigneurs !
Donc, ô très illustres, lorsque Hassân fut parti, son épouse Splendeur ne bougea pas et ne quitta pas un instant la mère de Hassân, et cela pendant deux jours. Mais, au matin du troisième jour, elle baisa la main de la vieille dame en lui souhaitant le bonjour, et lui dit : « Ô ma mère, je voudrais bien aller au hammam, depuis le temps que je ne prends plus de bains, à cause de l’allaitement de Nasser et de Manssour ! » Et la vieille dame dit : « Ya Allah ! ô les paroles inconsidérées, ma fille ! Aller au hammam, ô notre calamité ! Ne sais-tu que moi et toi nous sommes des étrangères qui ne connaissons pas du tout les hammams de cette ville-ci ! Et comment pourrais-tu y aller sans y être conduite par ton époux, qui t’y précéderait d’abord pour te retenir d’avance une salle, et s’assurer que tout est propre là-dedans et que les cancrelats, les blattes et les cafards ne tombent pas de la voûte ! Or, ton époux est absent, et moi je ne connais personne qui puisse le remplacer dans une si grave occasion ; et je ne puis moi-même t’accompagner, à cause de mon grand âge et de ma faiblesse ! Mais, si tu veux, ma fille, je vais te faire chauffer de l’eau ici-même, et je te laverai la tête et te donnerai un bain délicieux dans le hammam de notre maison ! J’ai précisément tout ce qu’il faut pour cela, et j’ai même reçu avant-hier une boite de terre parfumée d’Alep, et de l’ambre, et de la pâte épilatoire, et du henné ! Ainsi donc, ma fille, tu peux être tranquille à ce sujet. Ce sera excellent ! » Mais Splendeur répondit : « Ô ma maîtresse, depuis quand refuse-t-on aux femmes la permission du hammam ? Par Allah ! si tu avais dit ces choses-là même à une esclave, elle ne les aurait pas supportées, et plutôt que de continuer à rester dans votre maison, elle t’aurait demandé à être vendue au souk, à la criée ! Mais, ô ma maîtresse, que les hommes sont insensés qui s’imaginent que toutes les femmes se ressemblent, et qu’il faut prendre contre elles mille précautions plus tyranniques les unes que les autres, pour les empêcher de faire les choses illicites ! Mais, toi, tu dois bien savoir pourtant que lorsqu’une femme a fermement résolu de faire une chose, elle trouve toujours moyen, en dépit de tous les empêchements, d’en venir à bout, et que rien ne peut l’arrêter dans ses desseins, fussent-ils irréalisables ou pleins de désastres ! Ah ! hélas sur ma jeunesse ! on me soupçonne, et on n’a plus aucune foi en ma chasteté ! Et il ne me reste plus qu’à mourir ! » Et, ayant dit ces paroles, elle se mit à verser des larmes, à sangloter et à appeler sur sa tête les plus noires calamités !
Alors, la mère de Hassân finit par se laisser toucher par ses pleurs et ses gémissements, en comprenant, d’ailleurs, qu’il n’y avait plus moyen désormais de la détourner de son dessein. Elle se leva donc, malgré son grand âge et la défense expresse de son fils, et prépara tout ce qu’il fallait pour le bain, en fait de linge propre et de parfums. Puis elle dit à Splendeur : « Allons ! ma fille, viens et ne t’attriste plus ! Mais qu’Allah nous sauvegarde de la colère de ton époux ! » Et elle sortit avec elle du palais, et l’accompagna au hammam le plus renommé de la ville.
Ah ! comme elle aurait mieux fait, la mère de Hassân, de ne point se laisser toucher par les plaintes de Splendeur, et de ne pas franchir le seuil de ce hammam ! Mais qui peut lire dans le livre des destinées, en dehors du Seul Voyant ? Et qui peut dire d’avance ce qu’il compte faire entre deux pas de chemin ? Mais nous, qui sommes des musulmans, nous croyons et nous nous fions à la Volonté Suprême ! Et nous disons : « Il n’y a de Dieu qu’Allah, et Môhammad est l’Envoyé d’Allah ! » Priez sur le Prophète, ô Croyants, mes illustres auditeurs !
Lorsque la belle Splendeur, précédée par la mère de Hassân qui portait le paquet de linge propre, eut pénétré dans le hammam, les femmes qui étaient étendues dans la grande salle centrale d’entrée poussèrent toutes ensemble un cri d’admiration, tant elles furent ravies par sa beauté…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsque la belle Splendeur, précédée par la mère de Hassân qui portait le paquet de linge propre, eut pénétré dans le hammam, les femmes qui étaient étendues dans la grande salle centrale d’entrée poussèrent toutes ensemble un cri d’admiration, tant elles furent ravies par sa beauté. Et elles ne la quittèrent plus des yeux ! Or, tel fut leur éblouissement quand l’adolescente était encore enveloppée de ses voiles ! Mais quel ne fut point leur délire quand, s’étant dévêtue, elle eut achevé d’être nue ! Ô harpe de Daoud le Roi, qui enchantais le lion Saül ; et toi, fille du désert, amante d’Antara le guerrier crépu, ô vierge Abla aux belles hanches, qui soulevas de large en long, les faisant s’entre-choquer, toutes les tribus de l’Arabie ; et toi, Sett Boudour, fille du roi Ghaïour, maître d’El-Bouhour et d’El-Koussour, toi dont les yeux d’incendie troublèrent à l’extrême les genn et les éfrits ; et toi, musique des sources, et toi, chant printanier des oiseaux, que devîntes-vous devant la nudité de cette gazelle ? Louanges à Allah qui te créas, ô Splendeur, et mélangea en ton corps de gloire les rubis et le musc, l’ambre pur et les perles, ô toute d’or !
Ainsi donc, les femmes du hammam, pour la mieux considérer, quittèrent leur bain et leur nonchaloir, et la suivirent pas à pas. Et le bruit de ses charmes se répandit bientôt du hammam dans tout le voisinage, et, en un instant, les salles furent envahies, à ne pouvoir y circuler, de femmes attirées par la curiosité de voir cette merveille de beauté. Et, parmi ces femmes inconnues, se trouvait précisément une des esclaves de Sett Zobéida, épouse du khalifat Haroun Al-Rachid. Et cette jeune esclave, qui s’appelait Tohfa, fut encore plus stupéfaite que les autres de la beauté parfaite de cette lune magique ; et, les yeux grands ouverts, elle s’immobilisa au premier rang à la regarder se baigner dans le bassin. Et, lorsque Splendeur eut terminé son bain et se fut habillée, la petite esclave ne put faire autrement que de la suivre hors du hammam, attirée par elle comme par une pierre d’aimant, et se mit à marcher derrière elle dans la rue jusqu’à ce que Splendeur et la mère de Hassân fussent arrivées à leur demeure. Alors la jeune esclave Tohfa, ne pouvant entrer dans le palais, se contenta de porter ses doigts à ses lèvres et de lancer à Splendeur, en même temps qu’une rose, un baiser retentissant. Mais, malheureusement pour elle, l’eunuque de la porte vit la rose et le baiser, et, formalisé à l’extrême, se mit à lui dire d’épouvantables injures, en faisant des yeux blancs : ce qui la décida, mais en soupirant, à revenir sur ses pas. Et elle rentra au palais du khalifat, où elle se hâta de se rendre auprès de sa maîtresse, Sett Zobéida.
Or, Sett Zobéida vit que son esclave préférée était toute pâle et bien émue ; et elle lui demanda : « Où donc as-tu été, ô gentille, pour me revenir dans cet état de pâleur et d’émotion ? » Elle dit : « Au hammam, ô ma maîtresse ! » Elle demanda : « Et qu’as-tu donc vu au hammam, ma Tohfa, pour me revenir sens dessus dessous, et avec des yeux si languissants ? » Elle répondit : « Et comment, ô ma maîtresse, mes yeux et mon âme ne languiraient-ils pas, et la mélancolie n’envahirait-elle pas mon cœur au sujet de celle qui m’a ravi la raison ? » Sett Zobéida se mit à rire et dit : « Que me racontes-tu là, ô Tohfa, et de qui me parles-tu ? » Elle dit : « Quel adolescent délicat ou quelle jouvencelle, quel faon ou quelle gazelle, ô ma maîtresse, égaleront jamais ses charmes et sa beauté ? » Sett Zobéida dit : « Ô folle Tohfa, veux-tu enfin te décider à me dire son nom ? » Elle dit : « Je ne le sais pas, ô ma maîtresse ! Mais, ô ma maîtresse, je te le jure par les mérites de tes bienfaits sur ma tête ! nulle créature sur la face de la terre, dans le passé, dans le présent ou dans le futur, ne lui est comparable ! Tout ce que je sais d’elle, c’est qu’elle habite ce palais situé sur les bords du Tigre, et qui a une grande porte du côté de la ville et une autre porte du côté du fleuve. Et, de plus, on m’a dit au hammam qu’elle était l’épouse d’un riche marchand appelé Hassân Al-Bassri ! Ah ! ma maîtresse, si tu me vois toute tremblante entre tes mains, ce n’est point seulement de l’émoi suscité par sa beauté, mais de la crainte extrême qui m’envahit en songeant aux conséquences funestes qui résulteraient si, par malheur, notre maître le khalifat venait à en entendre parler. Sûrement, il ferait tuer le mari et, au mépris de toutes les lois de l’équité, il épouserait cette miraculeuse adolescente ! Et il vendrait de la sorte les biens inestimables de son âme immortelle pour la possession temporaire d’une créature belle mais périssable ! »
À ces paroles de sa petite esclave Tohfa, Sett Zobéida, qui savait combien elle était d’ordinaire sage et mesurée en ses discours, fut stupéfaite grandement, et lui dit : « Mais, ô Tohfa, es-tu au moins bien sûre que tu n’as pas vu en songe seulement une telle merveille de beauté ? » Elle répondit : « Je le jure sur ma tête et sur le poids de l’obligation que je dois à tes bontés pour moi, ô ma maîtresse, je viens, l’ayant vue, de jeter une rose et un baiser à cette adolescente dont nulle terre et nul climat, pas plus chez les Arabes que chez les Turcs ou les Persans, n’a vu naître la pareille ! » Et Sett Zobéida alors s’écria : « Par la vie de mes ancêtres les Purs ! il faut que moi aussi je contemple cette unique pierrerie, et que je la voie avec mes deux yeux ! »
Aussitôt, elle fit appeler le porte-glaive Massrour et lui dit, après qu’il eut embrassé la terre entre ses mains…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
… Aussitôt elle fit appeler le porte-glaive Massrour et lui dit, après qu’il eut embrassé la terre entre ses mains : « Ô Massrour, rends-toi en toute hâte au palais qui a deux portes, l’une donnant sur le fleuve et l’autre regardant du côté de la ville ! Et là tu demanderas l’adolescente qui l’habite, et tu me l’amèneras, au risque de ta tête ! » Et Massrour répondit : « Ouïr, c’est obéir ! » Et il sortit, la tête avant les pieds, et courut au palais en question, qui était, en effet, celui de Hassân. Et il franchit la grande porte devant l’eunuque, qui le reconnut et s’inclina devant lui jusqu’à terre. Et il arriva à la porte d’entrée à laquelle il frappa.
Aussitôt la vieille, mère de Hassân, vint elle-même ouvrir. Et Massrour entra dans le vestibule et souhaita la paix à la vieille dame. Et la mère de Hassân lui rendit son salam et lui demanda : « Que désires-tu ? » Il dit : « Je suis Massrour, le porte-glaive ! Je suis envoyé ici par El-Saïéda Zobéida, fille d’El-Kassem, épouse d’Al-Émir Al-Moumenîn Haroun Al-Rachid, le sixième des descendants d’Al-Abbas, oncle du Prophète (sur Lui la paix d’Allah et ses bénédictions !) Et je viens pour emmener avec moi au palais, auprès de ma maîtresse, la belle adolescente qui habite dans cette demeure ! » À ces paroles, la terrifiée et tremblante mère de Hassân s’écria : « Ô Massrour, nous sommes étrangères ici, et mon fils, l’époux de l’adolescente en question, est absent, en voyage ! Et, avant de partir, il m’a expressément défendu de la laisser sortir de la maison, pas plus avec moi qu’avec toute autre personne, et sous aucun prétexte ! Et j’ai bien peur qu’en la laissant sortir quelque accident ne survienne, à cause de sa beauté, qui obligera mon fils, à son retour, de se donner la mort ! Nous te supplions donc, ô bienfaisant Massrour, d’avoir pitié de notre détresse, et de ne point nous demander quelque chose qu’il est au-dessus de notre volonté et de nos moyens de t’accorder ! » Massrour répondit : « Ne crains donc rien, ma bonne dame ! Sois sûre qu’aucun accident regrettable n’arrivera à la jouvencelle ! Il s’agit simplement que ma maîtresse Sett Zobéida voie cette jeune beauté, pour s’assurer par ses propres yeux si la renommée n’exagère point la portée de ses charmes et de sa splendeur. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que je suis chargé d’un pareil message ; et je puis t’assurer que vous n’aurez, ni l’une ni l’autre, sujet de regretter votre soumission à un tel désir, bien au contraire ! Et, en outre, de même que je vais vous conduire en toute sécurité entre les mains de Sett Zobéida, de même je m’engage à vous reconduire saines et sauves à votre maison ! »
Lorsque la mère de Hassân vit de la sorte que toute résistance devenait inutile et même nuisible, elle laissa Massrour dans le vestibule, et entra habiller Splendeur et la parer, et habiller également les deux petits, Nasser et Manssour. Et elle prit les deux petits chacun sur un bras, et dit à Splendeur : « Puisqu’il nous faut céder devant le désir de Sett Zobéida, allons-nous-en ensemble ! » Et elle la précéda dans le vestibule et dit à Massrour : « Nous sommes prêtes ! » Et Massrour sortit et ouvrit la marche, suivi par la mère de Hassân qui portait les deux petits, suivie elle-même par Splendeur, complètement enveloppée de ses voiles. Et Massrour les conduisit de la sorte dans le palais du khalifat, jusque devant le large trône bas où était majestueusement assise, au repos, El-Saïéda Zobéida, entourée de la foule nombreuse de ses esclaves femmes et de ses favorites, au premier rang desquelles se tenait la petite Tohfa.
Alors, la mère de Hassân, remettant les deux petits enfants à Splendeur, qui était toujours entièrement enveloppée de ses voiles, embrassa la terre entre les mains de Sett Zobéida et, après le salam, lui fit son compliment. Et Sett Zobéida lui rendit son salam, lui tendit la main, qu’elle porta à ses lèvres, et la pria de se relever. Puis elle se tourna vers l’épouse de Hassân et lui dit : « Pourquoi, ô bienvenue, ne te débarrasses-tu pas de tes voiles ? Il n’y a point d’hommes ici ! » Et elle fit signe à Tohfa, qui s’approcha aussitôt, en rougissant, de Splendeur, et commença par toucher le pan de son voile, pour porter ensuite à ses lèvres et à son front ses doigts qui avaient frôlé l’étoffe. Puis elle l’aida à rejeter son grand voile, et lui releva elle-même son petit voile de visage.
Ô Splendeur ! Ni la lune qui sort dans son plein de dessous un nuage, ni le soleil dans tout son éclat, ni le tendre balancement du rameau dans la tiédeur du printemps, ni les brises du crépuscule, ni l’eau riante, ni rien de ce qui charme les humains par la vue, par l’ouïe et par l’entendement, n’aurait pu ravir, comme tu le fis, la raison de celles qui te regardaient ! Du rayonnement de ta beauté, tout le palais s’illumina et resplendit ! Dans la joie de ta présence, les cœurs bondissaient comme les agneaux et dansaient dans les poitrines ! Et la folie soufflait sur toutes les têtes ! Et les esclaves te contemplaient avec admiration, en chuchotant : « Ô Splendeur ! » Mais nous, ô mes auditeurs, nous disons : « Louanges à Celui qui forma le corps de la femme comme le lis de la vallée, et le donna à ses Croyants comme un signe du Paradis…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Mais nous, ô mes auditeurs, nous disons : « Louanges à Celui qui forma le corps de la femme comme le lis de la vallée, et le donna à ses Croyants comme un signe du Paradis ! »
Lorsque Sett Zobéida fut revenue de l’éblouissement où elle se trouvait, elle se leva de son trône et s’approcha de Splendeur qu’elle entoura de ses bras et serra contre son sein en lui baisant les yeux. Puis elle la fit asseoir à ses côtés sur le large trône, et enleva, pour le lui passer au cou, un collier de dix rangs de grosses perles qu’elle portait elle-même depuis son mariage avec Al-Rachid. Puis elle lui dit : « Ô souveraine des enchantements, en vérité, elle s’est trompée, mon esclave Tohfa, qui m’a parlé de ta beauté ! Car ta beauté est au-dessus de toutes paroles ! Mais, dis-moi, ô accomplie, sais-tu le chant, la danse, ou la musique ? Car, lorsqu’on est comme toi, on excelle en toutes choses ! » Splendeur répondit : « En vérité, ô ma maîtresse, je ne sais point chanter, ni danser, ni jouer du luth et des guitares ; et je n’excelle dans aucun des arts que d’ordinaire connaissent les jeunes femmes ! Toutefois, je dois te le dire, je possède un seul talent, qui va peut-être te paraître merveilleux : c’est de voler dans les airs comme les oiseaux ! »
À ces paroles de Splendeur, toutes les femmes s’écrièrent : « Ô enchantement ! Ô prodige ! » Et Sett Zobéida dit : « Comment, bien qu’étonnée à l’extrême, ô charmante, hésiter à te croire douée d’un tel talent ? N’es-tu point déjà plus harmonieuse que le cygne et plus légère à notre vue que les oiseaux ? Mais si tu voulais entraîner notre âme derrière toi, tu consentirais à faire, devant nos yeux, l’essai d’un envolement sans ailes ! » Elle dit : « Justement, ô ma maîtresse, je possède des ailes ; mais elles ne sont point sur moi ! Je puis pourtant les avoir, si telle est ta volonté ! Tu n’aurais pour cela qu’à demander à la mère de mon époux de m’apporter mon manteau de plumes ! »
Aussitôt, Sett Zobéida se tourna vers la mère de Hassân et lui dit : « Ô vénérable dame, notre mère, veux-tu aller nous chercher ce manteau de plumes, pour que j’en voie l’usage qu’en fait ta charmante fille ? » Et la pauvre femme pensa : « Nous voici tous perdus sans recours ! La vue de son manteau va lui remettre en mémoire son instinct originel, et Allah seul sait ce qui va arriver ! » Et elle répondit d’une voix tremblante : « Ô ma maîtresse, ma fille Splendeur est troublée par ta majesté, et ne sait plus ce qu’elle dit ! A-t-on jamais porté des habits de plumes, alors que cette sorte de vêtement ne convient qu’aux oiseaux ! » Mais Splendeur intervint et dit à Sett Zobéida : « Par ta vie, ô ma maîtresse, je te jure que mon manteau de plumes est enfermé dans un coffre caché dans notre maison ! » Alors Sett Zobéida enleva de son bras un bracelet précieux, qui valait tous les trésors de Khosroès et de Kaïssar, et le tendit à la mère de Hassân en lui disant : « Ô notre mère, par ma vie chez toi ! je te conjure d’aller à la maison nous chercher ce manteau de plumes, simplement pour le voir une fois ! Et tu le reprendras ensuite comme il est. » Mais la mère de Hassân jura qu’elle n’avait jamais vu ce manteau de plumes ni rien de semblable. Alors Sett Zobéida cria : « Ya Massrour ! » Et aussitôt le porte-glaive du khalifat se présenta entre les mains de sa souveraine, qui lui dit : « Massrour, cours vite à la maison de ces dames, et cherche partout un manteau de plumes qui est enfermé dans un coffre caché ! » Et Massrour obligea la mère de Hassân à lui remettre les clefs de la maison, et courut faire partout des recherches jusqu’à ce qu’il eût fini par trouver le manteau de plumes dans un coffre caché sous terre. Et il le rapporta à Sett Zobéida, qui, après l’avoir longuement admiré et s’être émerveillée de l’art avec lequel il était façonné, le remit à la belle Splendeur.
Alors, Splendeur commença par l’examiner plume par plume, et constata qu’il était aussi intact que le jour où Hassân le lui avait enlevé. Et elle le déploya et entra dedans, en ramenant sur elle les deux pans, et en les ajustant. Et elle devint semblable à un grand oiseau blanc ! Et, ô émerveillement des assistants ! elle ébaucha d’abord un long glissement, revint sur ses pas, sans toucher le sol, et s’éleva en se balançant jusqu’au plafond ! Puis, elle redescendit légère et aérienne, et prit ses deux enfants, à califourchon, chacun sur une épaule, en disant à Sett Zobéida et aux dames : « Je vois que mes voltiges vous font plaisir. Je vais donc vous mieux satisfaire. Et elle prit son élan, et s’élança jusqu’à la fenêtre du haut, sur le rebord de laquelle elle se posa. Et, de là, elle s’écria : « Écoutez-moi ! car je vous quitte ! » Et Sett Zobéida, émue à l’extrême, lui dit : « Comment, ô Splendeur, tu nous quittes déjà, en nous frustrant pour toujours de ta beauté, ô souveraine des souveraines ! » Splendeur répondit : « Hélas ! oui, ô ma maîtresse. Qui part ne revient pas ! » Puis elle se tourna vers la pauvre mère de Hassân, l’éplorée, la sanglotante, l’affaissée sur les tapis, et lui dit : « Ô mère de Hassân, certes ! de partir ainsi je m’afflige beaucoup, et je m’attriste à cause de toi et de ton fils Hassân, mon époux, car les jours de la séparation déchireront son cœur, et noirciront votre vie ; mais, hélas ! je n’y puis rien ! Je sens l’ivresse de l’air envahir mon âme, et il faut que je m’envole dans l’espace. Mais si ton fils veut jamais me retrouver, il n’aura qu’à venir me chercher dans les îles Wak-Wak. Adieu donc, ô mère de mon époux ! » Et, ayant dit ces paroles, Splendeur s’éleva dans les airs et alla se poser un instant sur le dôme du palais pour lisser ses plumes. Puis elle reprit son vol, et disparut dans les nuages avec ses deux enfants…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Et, ayant dit ces paroles, Splendeur s’éleva dans les airs et alla se poser un instant sur le dôme du palais, pour lisser ses plumes. Puis elle reprit son vol, et disparut dans les nuages avec ses deux enfants.
Quant à la pauvre mère de Hassân, elle fut sur le point d’expirer de douleur, et resta affaissée sur le sol sans mouvement. Et Sett Zobéida se pencha sur elle, et lui prodigua elle-même les soins nécessaires ; et, l’ayant un peu ranimée, lui dit : « Ah ! ma mère, que ne m’as-tu plutôt prévenue, au lieu de tout nier, que Splendeur pouvait faire un semblable usage de cette robe enchantée, de ce manteau fatal ! Je me serais alors bien gardée de le mettre en son pouvoir ! Mais comment pouvais-je deviner que l’épouse de ton fils était de la race des genn aériens ? Je te prie donc, ma bonne mère, de me pardonner mon ignorance et de ne point trop blâmer un acte que je ne calculai point ! » Et la pauvre vieille dit : « Ô ma maîtresse, je suis la seule coupable ! Et l’esclave n’a point à pardonner à sa souveraine ! Chacun porte sa destinée attachée à son cou ! La mienne et celle de mon fils, c’est de mourir de douleur ! » Et, sur ces paroles, elle sortit du palais au milieu des pleurs de toutes les femmes, et se traîna jusqu’à sa maison. Et là elle chercha les petits enfants, et ne les trouva pas ; et elle chercha l’épouse de son fils, et elle ne la trouva pas ! Alors elle fondit en larmes et en sanglots, plus près de la mort que de la vie. Et elle fit élever dans la maison trois tombeaux, un grand et deux petits, auprès desquels elle passait les jours et les nuits à gémir et à pleurer. Et elle récitait ces vers et bien d’autres encore :
« Ô mes pauvres petits enfants ! comme la pluie sur les vieux rameaux des arbres, mes pleurs coulent sur mes joues ridées.
L’adieu de votre départ, c’est l’adieu à notre vie ! Votre perte est la perte de notre âme, ô mes petits enfants, et c’est moi, hélas ! qui reste.
Vous étiez mon âme ! Comment, mon âme m’ayant quittée, puis-je vivre encore, ô mes pauvres petits ! Et c’est moi qui reste ! »
Et voilà pour elle ! Mais pour ce qui est de Hassân, lorsqu’il eut passé trois mois avec les sept princesses, il songea à partir, pour ne point jeter dans l’inquiétude sa mère et son épouse. Et il battit la peau de coq du tambour ; et les dromadaires se présentèrent. Et ses sœurs en choisirent dix et renvoyèrent les autres. Et elles chargèrent cinq dromadaires de lingots d’or et d’argent, et cinq de pierreries. Et elles lui firent promettre de revenir les voir au bout d’un an. Puis elles l’embrassèrent toutes, l’une après l’autre, en se mettant sur un rang ; et chacune à son tour lui adressa une ou deux strophes fort tendres, où elles lui exprimaient combien les affligeait son départ. Et elles se balançaient rythmiquement sur leurs hanches, en marquant la mesure des vers. Et Hassân leur répondit par ce poème improvisé :
« Mes larmes sont des perles dont je vous offre un collier, mes sœurs ! Voici qu’au jour du départ, affermi dans les étriers, je ne puis détourner les rênes !
Ô mes sœurs, comment m’arracher de vos bras aimants ? mon corps s’éloigne, mais mon âme vous reste. Hélas ! hélas ! comment détourner les rênes, le pied déjà dans l’étrier ? »
Puis Hassân s’éloigna sur son dromadaire, à la tête du convoi, et arriva heureusement à Baghdad, la Cité de Paix.
Or, en entrant dans sa maison, Hassân eut peine à reconnaître sa mère, tant les larmes, le jeûne et les veilles l’avaient changée, l’infortunée. Et, comme il ne voyait point accourir son épouse avec les enfants, il demanda à sa mère : « Où est la femme ? Et où sont les enfants ? » Et sa mère ne put répondre que par ses sanglots. Et Hassân se mit à courir comme un fou à travers les pièces, et il vit, dans la salle de réunion, ouvert et vide, le coffre où il avait enfermé le manteau enchanté. Et il se retourna et vit, au milieu de la pièce, les trois tombeaux ! Alors il s’écroula tout de son long, le front sur la pierre, sans connaissance. Et, malgré les soins de sa mère qui avait volé à son secours, il resta dans cet état depuis le matin jusqu’à la nuit. Mais il finit par revenir à lui, et déchira ses vêtements et couvrit sa tête de cendres et de poussière. Puis soudain il se précipita sur son épée, et voulut s’en transpercer. Mais sa mère se jeta entre lui et son épée, en étendant les bras. Et elle lui prit la tête contre sa poitrine, et le fit s’asseoir, bien que, de désespoir, il se roulât par terre comme un serpent. Et elle se mit à lui raconter, peu à peu, tout ce qui s’était passé pendant son absence, et conclut en lui disant : « Tu vois, mon fils, que, malgré l’immensité de notre malheur, le désespoir ne doit pas encore entrer dans ton cœur, puisque tu peux retrouver ton épouse dans les îles Wak-Wak…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Tu vois, mon fils, que, malgré l’immensité de notre malheur, le désespoir ne doit pas encore entrer dans ton cœur, puisque tu peux retrouver ton épouse dans les îles Wak-Wak. »
À ces paroles de sa mère, Hassân sentit un espoir soudain rafraîchir les éventails de son âme, et, se levant à l’instant, il dit à sa mère : « Je pars pour les îles Wak-Wak ! » Puis il pensa : « Où peuvent-elles bien être situées, ces îles dont le nom ressemble à un cri d’oiseau de proie ? Sont-elles dans les mers de l’Inde, ou du Sindh, ou de la Perse ou de la Chine ? » Et, pour éclairer son esprit à ce sujet, il sortit de la maison, bien que tout parût noir et sans aboutissant à ses yeux, et alla trouver les savants et les lettrés de la cour du khalifat, et leur demanda, à tour de rôle, s’ils connaissaient les mers ou étaient situées les îles Wak-Wak. Et tous répondirent : « Nous ne le savons pas ! Et de notre vie nous n’avons entendu parler de l’existence de ces îles-là ! » Alors Hassân recommença à se désespérer, et retourna à la maison, la poitrine oppressée par le vent de la mort. Et il dit à sa mère, en se laissant tomber à terre : « Ô mère, ce n’est point aux îles Wak-Wak qu’il me faut aller, mais plutôt aux lieux où la Mère-des-Vautours [la Mort] a déposé son bagage ! » Et il fondit en larmes, la tête dans les tapis. Mais soudain il se releva, et dit à sa mère : « Allah m’envoie la pensée de retourner auprès des sept princesses qui m’appellent leur frère, pour leur demander le chemin des îles Wak-Wak ! » Et, sans plus tarder, il fit ses adieux à la pauvre mère, en mêlant ses larmes aux siennes, et remonta sur le dromadaire qu’il n’avait pas encore congédié depuis son retour. Et il arriva heureusement au palais des sept sœurs, dans la Montagne-des-Nuages.
Lorsque ses sœurs le virent arriver, elles le reçurent avec les transports de la félicité la plus vive. Et elles l’embrassèrent en poussant des cris de joie et lui souhaitant la bienvenue. Et lorsque vint le tour de Bouton-de-Rose d’embrasser son frère, elle vit, avec les yeux de son cœur aimant, le changement opéré dans les traits de Hassân et le trouble de son âme. Et, sans lui faire la moindre question, elle fondit en larmes sur son épaule. Et Hassân pleura avec elle, et lui dit : « Ah ! Bouton-de-Rose, ma sœur, je souffre cruellement, et je viens près de toi chercher le seul remède qui puisse alléger mes maux ! Ô parfums de Splendeur ! le vent ne vous apportera plus pour rafraîchir mon âme ! » Et Hassân, en prononçant ces mots, poussa un grand cri et tomba privé de sentiment.
À cette vue, les princesses effrayées s’empressèrent autour de lui en pleurant, et Bouton-de-Rose lui aspergea le visage d’eau de roses et l’arrosa de ses larmes. Et Hassân sept fois essaya de se relever, et sept fois il retomba par terre. Enfin, il put rouvrir les yeux après un évanouissement encore plus long que les autres, et il raconta à ses sœurs toute la triste histoire depuis le commencement jusqu’à la fin. Puis il ajouta : « Et maintenant, ô secourables sœurs, je viens vous demander le chemin qui conduit aux îles Wak-Wak ! Car mon épouse Splendeur, en partant, a dit à ma pauvre mère : « Si ton fils veut jamais me retrouver, il n’aura qu’à venir me chercher dans les îles Wak-Wak ! »
Lorsque les sœurs de Hassân eurent entendu ces dernières paroles, elles baissèrent la tête, en proie à une stupeur sans bornes, et se regardèrent longtemps sans parler. Enfin elles rompirent le silence et s’écrièrent toutes à la fois : « Lève ta main vers la voûte du ciel, ô Hassân, et tâche de l’atteindre ou de la toucher. Cela te serait encore plus aisé que de parvenir à ces îles Wak-Wak, où se trouve ta femme avec tes enfants ! » À ces mots, les larmes de Hassân coulèrent comme un torrent, et inondèrent ses vêtements. Et les sept princesses, de plus en plus émues de sa douleur, s’efforcèrent de le consoler. Et Bouton-de-Rose lui entoura tendrement le cou de ses bras, et lui dit, en l’embrassant : « Ô frère mien, calme ton âme et rafraîchis tes yeux, puis prends patience avec la destinée contraire, car le Maître des Proverbes a dit : « La patience est la clef de la consolation, et la consolation fait parvenir au but ! » Et tu sais, ô mon frère, que toute destinée doit s’accomplir, mais jamais celui qui doit vivre dix ans ne meurt dans sa neuvième année ! Prends donc courage, et essuie tes larmes : et moi je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour tâcher de te faciliter les moyens de parvenir auprès de ta femme et de tes enfants, si telle est la volonté d’Allah (qu’il soit exalté !) Ah ! ce maudit manteau de plumes ! Que de fois n’ai-je pas eu l’idée de te dire de le brûler et chaque fois je m’arrêtais de peur de te contrarier. Enfin ! Ce qui est écrit, est écrit ! Nous allons tâcher de remédier, entre tous tes maux, à celui qui est le plus remédiable ! » Et elle se tourna vers ses sœurs, et se jeta à leurs pieds, et les conjura de se joindre à elle pour découvrir par quel moyen son frère pourrait trouver le chemin des îles Wak-Wak. Et ses sœurs le lui promirent de tout cœur amical.
Or, les sept princesses avaient un oncle, frère de leur père, qui chérissait d’une manière toute particulière l’aînée des sœurs ; et il venait la voir régulièrement une fois tous les ans. Et cet oncle s’appelait Abd Al-Kaddous…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENTIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, les sept princesses avaient un oncle, frère de leur père, qui chérissait d’une manière toute particulière l’aînée des sœurs ; et il venait la voir régulièrement une fois tous les ans. Et cet oncle s’appelait Abd Al-Kaddous. Et lors de sa dernière visite il avait donné à sa préférée, l’aînée des princesses, un petit sac rempli d’aromates, en lui disant qu’elle n’avait qu’à brûler un peu de ces aromates, s’il se présentait jamais quelque circonstance où elle crût avoir besoin de son secours. Aussi, lorsque Bouton-de-Rose l’eut tellement suppliée d’intervenir, l’aînée des princesses pensa que son oncle pourrait peut-être tirer le pauvre Hassân de son embarras. Et elle dit à Bouton-de-Rose : « Va vite me chercher le sac de parfums et la cassolette d’or ! » Et Bouton-de-Rose courut chercher les deux choses, et les remit à sa sœur, qui ouvrit le sac, y prit une pincée de parfum et la jeta dans la cassolette, au milieu de la braise, en pensant mentalement à son oncle Abd Al-Kaddous, et en l’appelant.
Or, dès que les fumées se dégagèrent de la cassolette, voici que s’éleva un tourbillon de poussière qui se rapprocha, et d’en dessous apparut, monté sur un éléphant blanc, le cheikh Abd Al-Kaddous. Et il descendit de son éléphant, et dit à l’aînée des sœurs et aux princesses, filles de son frère : « Me voici ! Pourquoi ai-je senti l’odeur du parfum ? Et en quoi puis-je t’être utile, à toi, ma fille ? » Et la jeune fille se jeta à son cou et lui baisa la main, et répondit : « Ô notre oncle chéri, voilà déjà plus d’un an que tu n’étais venu nous voir, et ton absence nous inquiétait et nous tourmentait. C’est pourquoi j’ai brûlé du parfum, pour te voir et être tranquillisée ! » Il dit : « Tu es la plus charmante des filles de mon frère, ô ma préférée. Mais ne crois point, parce que j’ai retardé cette année mon arrivée, que je t’aie oubliée. Justement je voulais venir te voir demain ! Mais ne me cache rien, car tu dois certainement avoir quelque chose à me demander ! » Elle répondit : « Qu’Allah te garde et prolonge tes jours, ô mon oncle ! Du moment que tu me le permets, je voudrais, en effet, te demander quelque chose ! » Il dit : « Parle ! Je te l’accorde d’avance ! » Alors l’adolescente lui raconta toute l’histoire de Hassân, et ajouta : « Et maintenant je te demande, pour toute faveur, de dire à notre frère Hassân comment il faut qu’il fasse pour arriver à ces îles Wak-Wak ! »
À ces paroles, le cheikh Abd Al-Kaddous baissa la tête, et mit un doigt dans sa bouche en réfléchissant profondément pendant une heure de temps. Puis il tira son doigt de sa bouche, releva la tête et, sans dire un mot, se mit à tracer plusieurs figures sur le sable. Enfin il rompit le silence et dit aux princesses, en hochant la tête : « Mes filles, dites à votre frère qu’il se tourmente inutilement ! Il est impossible qu’il puisse aller aux îles Wak-Wak ! » Alors les jeunes filles, avec des larmes dans les yeux, se tournèrent vers Hassân, et dirent : « Hélas ! ô notre frère ! » Mais Bouton-de-Rose le prit par la main, le fit approcher, et dit au cheikh Abd Al-Kaddous : « Mon bon oncle, fais-lui la preuve de ce que tu viens de nous dire, et donne-lui de sages conseils qu’il écoutera d’un cœur soumis ! » Et le vieillard donna sa main à baiser à Hassân et lui dit : « Sache, mon fils, que tu te tourmentes inutilement ! Il est impossible que tu puisses aller aux îles Wak-Wak, quand même toute la cavalerie volante des genn, les comètes vagabondes et les planètes tournoyantes viendraient à ton secours ! En effet, ces îles Wak-Wak, mon fils, sont des îles habitées par des amazones vierges, et où règne précisément le roi-des-rois du Gennistân, père de ton épouse Splendeur. Et tu es, ici, séparé de ces îles-là, où personne n’est jamais allé et d’où personne n’est revenu, par sept vastes mers, sept vallées sans fond et sept montagnes sans sommet. Et elles sont situées aux confins extrêmes de la terre, au delà desquels il n’y a plus rien de connu ! Aussi je ne crois pas que tu puisses arriver, par n’importe quel moyen, à franchir les obstacles divers qui t’en séparent. Et je pense que pour toi le plus sage parti à prendre est encore de t’en retourner chez toi, ou de rester ici avec tes sœurs, qui sont charmantes ! Mais quant aux îles Wak-Wak, n’y pense plus ! »
À ces paroles du cheikh Abd Al-Kaddous, Hassân devint jaune comme le safran, poussa un grand cri et tomba évanoui. Et les princesses ne purent retenir leurs sanglots ; et la plus jeune déchira ses vêtements et se meurtrit le visage ; et toutes ensemble se mirent à gémir et à se lamenter autour de Hassân. Et, une fois qu’il eut repris connaissance, il ne sut que pleurer, la tête dans les genoux de Bouton-de-Rose. Et le vieillard finit par être ému de ce spectacle, et, compatissant à toute cette douleur, il se tourna vers les princesses qui ululaient lamentablement, et leur dit d’un ton bourru : « Taisez-vous ! » Et les princesses arrêtèrent soudain dans leur gosier les cris qui en sortaient, et attendirent avec anxiété ce qu’allait dire leur oncle. Et le cheikh Abd Al-Kaddous appuya sa main sur l’épaule de Hassân et lui dit : « Cesse tes gémissements, mon fils, et reprends courage ! Car, avec l’aide d’Allah, je donnerai un meilleur tour à ton affaire. Lève-toi donc et suis-moi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le cheikh Abd Al-Kaddous appuya sa main sur l’épaule de Hassân et lui dit : « Cesse tes gémissements, mon fils, et reprends courage ! Car, avec l’aide d’Allah, je donnerai un meilleur tour à ton affaire. Lève-toi donc et suis-moi ! » Et Hassân, à qui ces paroles avaient soudain rendu la vie, se leva sur ses pieds, fit rapidement ses adieux à ses sœurs, embrassa plusieurs fois Bouton-de-Rose, et dit au vieillard : « Je suis ton esclave ! »
Alors, le cheikh Abd Al-Kaddous fit monter Hassân derrière lui, sur l’éléphant blanc, et parla à la bête immense qui se mouvementa. Et, rapide comme la grêle qui tombe, la foudre qui frappe et l’éclair qui brille, le grand éléphant livra ses membres au vent et s’envola et s’enfonça dans les plaines de l’espace, anéantissant sous ses pas la distance !
Or, en trois jours et trois nuits de cette rapidité, ils parcoururent un chemin de sept années. Et ils arrivèrent auprès d’une montagne bleue, dont tous les alentours étaient bleus, et au milieu de laquelle se trouvait une caverne dont l’entrée était fermée par une porte d’acier bleu. Et le cheikh Abd Al-Kaddous frappa à cette porte, et il en sortit un nègre bleu, qui tenait d’une main un sabre bleu, et de l’autre un bouclier de métal bleu. Et le cheikh, avec une promptitude incroyable, arracha ces armes des mains du nègre, qui aussitôt s’effaça pour le laissa passer ; et il entra, suivi de Hassân, dans la caverne dont le nègre bleu referma la porte derrière eux.
Alors ils marchèrent, environ l’espace d’un mille, dans une large galerie voûtée où la lumière était bleue et les roches transparentes et bleues, et au bout de laquelle ils se trouvèrent en face de deux énormes portes d’or. Et le cheikh Abd Al-Kaddous ouvrit l’une de ces portes, et dit à Hassân de l’attendre jusqu’à ce qu’il fût de retour. Et il disparut à l’intérieur. Mais, au bout d’une heure, il revint en tenant par la bride un cheval bleu, tout scellé et harnaché en couleurs bleues, sur lequel il fit monter Hassân. Et il ouvrit alors la seconde porte d’or, et devant eux se déploya soudain le grand espace bleu, et, à leurs pieds, une immense prairie sans horizon. Et le cheikh dit à Hassân : « Mon fils, es-tu toujours déterminé à partir et à affronter les dangers sans nombre qui t’attendent ? Ou bien n’aimerais-tu pas mieux, comme je te le conseille, revenir sur tes pas et retourner auprès des sept princesses, mes nièces, qui sauraient bien te consoler de la perte de ton épouse Splendeur ? » Hassân répondit : « Je préfère mille fois braver les dangers de la mort, que de souffrir plus longtemps les tourments de l’absence ! » Le cheikh reprit : « Mon fils Hassân, n’as-tu point une mère pour laquelle ton absence sera une source inépuisable de larmes ? Et n’aimerais-tu pas mieux retourner auprès d’elle pour la consoler ? » Il répondit : « Je ne retournerai point auprès de ma mère sans mon épouse et mes enfants ! » Alors le cheikh Abd Al-Kaddous lui dit : « Eh bien donc, Hassân, pars sous la protection d’Allah ! » Et il lui remit une lettre où était écrite à l’encre bleue l’adresse suivante : « Au très illustre et très glorieux cheikh-des-cheikhs, notre maître, le vénérable Père-des-Plumes ! » Puis il lui dit : « Prends cette lettre, mon fils, et va où te conduira ton cheval. Il arrivera à une montagne noire, dont tous les alentours sont noirs, devant une caverne noire. Alors mets pied à terre et, après avoir attaché la bride à la selle, laisse entrer le cheval tout seul dans la caverne. Et tu attendras à la porte, et tu verras sortir un vieillard noir, habillé de noir, et noir partout, à l’exception d’une longue barbe blanche qui lui descend jusqu’aux genoux. Alors tu lui baiseras la main, tu placeras sur ta tête le pan de sa robe, et lui remettras cette lettre que je te donne pour te servir d’introduction auprès de lui. Car c’est lui le cheikh Père-des-Plumes ! Et il est mon maître et la couronne sur ma tête ! Et lui seul, sur la terre, peut t’aider dans ta téméraire entreprise ! Tu tâcheras donc de te le rendre favorable, et tu feras tout ce qu’il te dira de faire. Ouassalam ! »
Alors Hassân prit congé du cheikh Abd Al-Kaddous, et serra les flancs de son cheval bleu qui hennit et partit comme la flèche ! Et le cheikh Abd Al-Kaddous rentra dans la grotte bleue.
Or, pendant dix jours Hassân laissa aller le cheval à son gré, à une allure telle qu’il ne pouvait être devancé ni par le vol de l’oiseau ni par les tourbillons des tempêtes. Et il franchit de la sorte un espace de dix années en ligne droite ! Et il arriva enfin au pied d’une chaîne de montagnes noires, au sommet invisible, qui s’étendaient de l’orient à l’occident. Et, en approchant de ces montagnes, son cheval se mit à hennir, en ralentissant son allure…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et, en approchant de ces montagnes, son cheval se mit à hennir, en ralentissant son allure. Et aussitôt, de tous les points à la fois, accoururent, plus innombrables que les gouttes de pluie, des chevaux noirs qui vinrent flairer le cheval bleu de Hassân et se frotter à lui. Et Hassân fut effrayé de leur nombre, et eut peur qu’ils ne voulussent lui défendre le chemin ; mais il poursuivit sa route et arriva à l’entrée de la caverne noire, au milieu des roches plus noires que l’aile de la nuit. Et c’était précisément la caverne dont lui avait parlé le cheikh Abd Al-Kaddous. Il descendit donc, et, après avoir attaché la bride au pommeau de la selle, il laissa son cheval entrer seul dans la caverne ; et il s’assit à l’entrée, ainsi que le lui avait ordonné le cheikh.
Or, Hassân n’était pas là depuis une heure lorsqu’il vit sortir de la grotte un vénérable vieillard, vêtu de noir, et noir lui-même depuis les pieds jusqu’à la tête, à l’exception de la longue barbe blanche qui lui arrivait jusqu’à la ceinture. C’était le cheikh-des-cheikhs, le très glorieux Ali Père-des-Plumes, fils de la reine Balkis, épouse de Soleïmân (sur eux tous la paix d’Allah et ses bénédictions !) Et Hassân, à sa vue, se jeta à ses genoux, et lui baisa les mains et les pieds, et se plaça sur la tête le pan de sa robe, se mettant ainsi sous sa protection. Puis il lui présenta la lettre d’Abd Al-Kaddous. Et le cheikh Père-des-Plumes prit la lettre et, sans dire un seul mot, rentra dans la grotte. Et Hassân, ne le revoyant plus, commençait déjà à se désespérer, quand il parut, mais cette fois entièrement vêtu de blanc. Et il fit signe à Hassân de le suivre, et marcha devant lui dans la grotte. Et Hassân le suivit, et arriva derrière lui dans une immense salle carrée, pavée de pierreries, dont les quatre angles étaient occupés chacun par un vieillard vêtu de noir et assis sur un tapis, au milieu d’un nombre infini de manuscrits, avec une cassolette d’or où brûlaient des parfums devant lui ; et chacun de ces quatre sages était entouré par sept autres savants, ses disciples, qui transcrivaient les manuscrits et lisaient ou réfléchissaient. Mais lorsque le cheikh Ali Père-des-Plumes fut entré, tous ces vénérables personnages se levèrent en son honneur ; et les quatre savants principaux quittèrent leurs angles et vinrent s’asseoir auprès de lui, au milieu de la salle. Et lorsque tout le monde eut pris sa place, Cheikh Ali se tourna vers Hassân et lui dit de raconter son histoire devant cette assemblée de sages.
Alors Hassân, bien ému, commença d’abord par verser des larmes en torrents ; puis, ayant pu les sécher, il se mit à raconter, d’une voix entrecoupée de sanglots, toute son histoire depuis son enlèvement par Bahram le Guèbre, jusqu’à sa rencontre avec le cheikh Abd Al-Kaddous, disciple du cheikh Père-des-Plumes et oncle des sept princesses. Et, pendant tout ce récit, les sages ne l’interrompirent point ; mais lorsqu’il eut fini, ils s’écrièrent tous à la fois, en se tournant vers leur maître : « Ô vénérable maître, ô fils de la reine Balkis, le sort de ce jeune homme est digne de pitié, car il souffre et comme époux et comme père. Et peut-être pouvons-nous contribuer à lui rendre cette jouvencelle si belle et ces deux enfants si beaux ! » Et le cheikh Ali répondit : « Mes vénérables frères, c’est là une grande affaire. Et vous savez comme moi combien il est difficile d’arriver aux îles Wak-Wak, et combien il est plus difficile encore d’en revenir. Et vous savez toute la difficulté qu’il y a, une fois que l’on est dans ces îles après tous les obstacles franchis, à approcher des amazones vierges, gardiennes du roi-des-rois des genn et de ses filles. Dans ces conditions, comment voulez-vous que Hassân parvienne jusqu’à la princesse Splendeur, fille de leur puissant roi ? » Les cheikhs répondirent : « Vénérable père, tu as raison, qui peut le nier ? Mais ce jeune homme t’a été particulièrement recommandé par notre frère, l’honorable et illustre cheikh Abd Al-Kaddous, et tu ne peux ne point accueillir favorablement ses intentions ! »
Et Hassân, de son côté, en entendant ces paroles, se jeta aux pieds du cheikh, se couvrit la tête du pan de son manteau et, lui entourant les genoux de ses bras, le conjura de lui rendre son épouse et ses enfants. Et il baisa également les mains de tous les cheikhs, qui joignirent leurs prières aux siennes en suppliant leur maître à tous, le cheikh Père-des-Plumes, d’avoir pitié de l’infortuné jeune homme ! Et le cheikh Ali répondit : « Par Allah ! moi, de ma vie, je n’ai vu quelqu’un mépriser l’existence aussi résolument que ce jeune Hassân ! Il ne sait ce qu’il désire ni ce qui l’attend, ce téméraire ! Mais enfin, je veux bien faire pour lui tout ce qui dépendra de moi ! »
Ayant ainsi parlé, le cheikh Ali Père-des-Plumes réfléchit une heure de temps, au milieu de ses vieux disciples respectueux ; puis il releva la tête et dit à Hassân : « Avant tout, je vais te donner quelque chose qui te sauvegardera en cas de danger ! » Et il s’arracha de la barbe une touffe de poils, à l’endroit où ils étaient le plus longs, et les remit à Hassân en lui disant…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il s’arracha de la barbe une touffe de poils, à l’endroit où ils étaient le plus longs, et les remit à Hassân en lui disant : « Voilà ce que je fais pour toi ! Si tu te trouves jamais au milieu d’un grand danger, tu n’as qu’à brûler un des poils de cette touffe, et je viendrai à l’instant à ton secours ! » Puis il leva la tête vers la voûte de la salle, et frappa ses mains l’une contre l’autre, comme pour appeler quelqu’un. Et aussitôt se présenta entre ses mains, descendu de la voûte, un éfrit d’entre les éfrits ailés. Et le cheikh lui demanda : « Comment t’appelles-tu, ô éfrit ? » Il dit : « Ton esclave Dahnasch ben-Forktasch, ô cheikh Ali Père-des-Plumes ! » Et le cheikh lui dit : « Approche-toi ! » Et l’éfrit Dahnasch s’approcha du cheikh Ali qui appliqua sa bouche contre son oreille et lui dit quelque chose à voix basse. Et l’éfrit répondit par un signe de tête, qui signifiait : « Oui ! » Et le cheikh se tourna vers Hassân et lui dit : « Monte, mon fils, monte sur le dos de cet éfrit. Il te transportera dans la région des nuages, et de là te descendra sur une terre qui est de camphre blanc. Et c’est là, ô Hassân, que l’éfrit te laissera, car il ne peut aller plus loin. Et tu devras alors te diriger tout seul à travers cette terre de camphre blanc. Et une fois que tu en seras sorti, tu arriveras en face des îles Wak-Wak. Et, là, Allah pourvoira ! »
Alors Hassân baisa de nouveau les mains du cheikh Père-des-Plumes, fit ses adieux aux autres sages en les remerciant de leurs bontés, et monta à califourchon sur les épaules de Dahnasch qui s’éleva avec lui dans les airs. Et l’éfrit le porta dans la région des nuages, et de là descendit avec lui sur la terre de camphre blanc, où il le laissa, puis il disparut.
Ainsi, ô Hassân, ô natif de Bassra, toi que jadis on admirait dans les souks de ta ville natale, et qui faisais s’envoler tous les cœurs et se pâmer de ta beauté ceux qui te regardaient, toi qui vécus si longtemps heureux au milieu des princesses, et qui suscitas dans leurs âmes tant de tendresse et tant de douleur, voici que, poussé par ton amour pour Splendeur, tu abordes, sur les ailes de l’éfrit, à cette terre de camphre blanc, ou tu vas éprouver ce que nul avant toi et nul après toi n’aura jamais éprouvé !
En effet, lorsque l’éfrit l’eut déposé sur cette terre, Hassân se mit à marcher droit devant lui, sur un sol brillant et parfumé. Et il marcha ainsi longtemps, et finit par distinguer au loin, au milieu d’une prairie, quelque chose qui ressemblait à une tente. Et il se dirigea de ce côté-là, et finit par arriver tout près de cette tente. Mais comme à ce moment il marchait dans un gazon très épais, il heurta du pied quelque chose qui y était caché ; et il regarda et vit que c’était un corps blanc comme une masse d’argent et grand comme une des colonnes de la cité d’Iram. Or c’était un géant, et la tente que Hassân voyait n’était autre chose que son oreille, laquelle lui servait de tente-abri contre le soleil. Et le géant, réveillé ainsi de son sommeil, se leva en mugissant, et se mit dans une telle colère qu’il se gonfla le ventre de son haleine, avec des efforts de cul si considérables que son fondement en gémit à travers : ce qui produisit, sous forme de tonnerre, une suite de pets extraordinaires, dont Hassân fut projeté la face contre terre, puis lancé en l’air avec, de terreur, les yeux à l’envers ! Et, avant qu’il fût retombé sur le sol, le géant l’attrapa au vol par le col, à l’endroit où la peau est le plus molle, et le tint, par la force de son bras, suspendu en l’air comme le moineau dans la serre du faucon. Et il se disposa, le faisant tournoyer à tour de bras, à l’aplatir contre terre en lui broyant les os et faisant ainsi entrer sa longueur dans sa largeur.
Lorsque Hassân vit ce qui allait lui arriver, il se débattit de toutes ses forces et s’écria : « Ah ! qui me sauvera ? Ah ! qui me délivrera ? Ô géant, aie pitié de moi ! » En entendant ces cris de Hassân, le géant se dit : « Par Allah ! Il ne chante pas mal, ce petit oiseau-là ! Et son gazouillement me plaît. Aussi vais-je de ce pas le porter à notre roi ! » Et il le tint délicatement par un pied, de peur de l’abîmer, et pénétra dans une épaisse forêt où, au milieu d’une clairière, assis sur un rocher qui lui tenait lieu de trône, se tenait le roi des géants de la terre de camphre blanc. Et il était environné de ses gardes, qui étaient cinquante géants hauts chacun de cinquante coudées. Et celui qui tenait Hassân s’approcha du roi, et lui dit : « Ô notre roi, voici un petit oiseau que j’ai attrapé par le pied, et que je t’apporte à cause de sa belle voix ! Car il gazouille agréablement ! » Et il donna de petits coups sur le nez de Hassân, en lui disant : « Chante un peu devant le roi ! » Et Hassân, qui ne comprenait pas le langage du géant, crut que sa dernière heure était arrivée, et se mit à se débattre, en s’écriant : « Ah ! qui me sauvera ? Ah ! qui me délivrera ? » Et le roi, en entendant cette voix, se convulsa et se trémoussa de joie, et dit au géant : « Par Allah ! il est charmant ! Et il faudra le porter sur-le-champ à ma fille qu’il enchantera ! » Et il ajouta, en se tournant vers le géant : « Oui ! hâte-toi de le mettre dans une cage, et d’aller le suspendre dans la chambre de ma fille, près de son lit, afin qu’il puisse la distraire par ses chants et son gazouillement…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Oui ! hâte-toi de le mettre dans une cage, et d’aller le suspendre dans la chambre de ma fille, près de son lit, afin qu’il puisse la distraire par ses chants et son gazouillement ! »
Alors, le géant se hâta de mettre Hassân dans une cage, avec deux grandes tasses, une pour la nourriture, et une pour l’eau. Et il lui mit également deux perchoirs, afin qu’il pût sauter et chanter à son aise ; et il le porta dans la chambre de la fille du roi, et le suspendit à son chevet.
Lorsque la fille du roi vit Hassân, elle fut charmée de sa figure et de ses formes jolies, et se mit à lui faire mille caresses et à le gâter de toutes les façons. Et elle lui parlait d’une voix très douce, pour l’apprivoiser, bien que Hassân ne comprît rien à son langage. Mais comme il voyait qu’elle ne lui voulait pas de mal, il essaya de l’attendrir sur sa destinée, en pleurant et en gémissant. Et la princesse prenait chaque fois ses gémissements et ses soupirs pour des chants harmonieux ; et elle en éprouvait un plaisir extrême. Et elle finit par éprouver pour lui une inclination extraordinaire ; et elle ne pouvait plus le quitter à aucune heure du jour ou de la nuit. Et elle sentait, en l’approchant, que tout son être travaillait à son sujet. Et elle ne comprenait pas ce que l’on pouvait bien faire avec un si petit oiseau, en fait de manifestations. Et souvent elle lui faisait des signes, et lui parlait par gestes ; mais, lui non plus, ne la comprenait pas, et il était loin de deviner tout le parti que l’on pouvait tirer d’une adolescente, géante, à la vérité, mais si avenante.
Or, un jour, la fille du roi tira Hassân de la cage pour le nettoyer et le changer d’habits. Et lorsqu’elle l’eut déshabillé, elle vit, ô prodigieuse découverte ! qu’il n’était pas du tout dépourvu de ce qu’avaient les géants de son père, bien que tout cela fût, en proportion, extrêmement menu. Et elle pensa : « Par Allah ! c’est la première fois que je vois un oiseau avec des choses comme ça ! » Et elle se mit à manipuler Hassân et à le tourner et retourner dans tous les sens, en s’émerveillant de ce qu’elle découvrait en lui à chaque instant. Et Hassân était dans ses mains exactement comme un moineau entre les mains du chasseur. Et la jeune géante, voyant que sous ses doigts le concombre se changeait en courge, se mit à rire tellement qu’elle se renversa sur le côté. Et elle s’écria : « Quel oiseau étonnant ! Il chante comme les oiseaux, et se comporte avec les femmes aussi poliment que les hommes géants ! » Et comme elle voulait lui rendre égard pour égard, elle le prit tout contre elle, et se mit à le caresser partout comme s’il était un homme, lui faisant mille propositions, non en paroles, car un oiseau n’aurait pu les entendre, mais en gestes et en actions, si bien qu’il se comporta avec elle tout à fait comme un moineau avec sa moinelle. Et de ce moment Hassân devint l’oiseau de la fille du roi !
Or, Hassân, bien que cajolé et gâté et dorloté comme un oiseau, et en dépit de ce qu’il éprouvait au milieu des somptuosités de la géante, fille du roi, et de ce qu’il lui faisait d’ailleurs sentir, à son tour, et malgré tout le bien-être où il vivait dans sa cage, où la princesse l’enfermait chaque fois qu’elle avait fini sa chose avec lui, était loin d’oublier son épouse Splendeur, fille du roi-des-rois du Gennistân, et les îles Wak-Wak, but de son voyage, dont il savait n’être plus très éloigné ! Et, pour se tirer d’embarras, il aurait volontiers fait usage du tambour magique et de la touffe de poils ; mais, en le changeant d’habits, la fille du roi des géants, lui avait enlevé les objets précieux ; et il avait beau les réclamer par signes et par tous les gestes qu’on fait en arabe, elle ne comprenait point ce qu’il lui demandait, et croyait chaque fois qu’il demandait la copulation. Ce qui faisait que chaque fois qu’il demandait le tambour, c’était une copulation qui lui répondait, et chaque fois qu’il réclamait la touffe de poils, c’était une copulation qu’il lui fallait exécuter, tant et tant, en vérité, qu’il fut, au bout de quelques jours, dans un état à nul autre pareil, et qu’il n’osait plus faire un geste ni le moindre signe, de peur de voir la réponse en action de la terrible géante.
Tout cela ! Et la situation de Hassân ne changeait pas ; et il dépérissait et jaunissait dans sa cage, ne sachant plus à quel parti se résoudre, quand un jour la géante, après des caresses multipliées plus qu’à l’ordinaire, s’assoupit pendant qu’elle le tenait contre elle, et le laissa s’échapper. Et Hassân se précipita aussitôt vers le coffre où se trouvaient ses vieux effets, et il prit la touffe de barbe dont il brûla un des poils, en appelant, dans sa pensée, le cheikh Ali Père-des-Plumes. Et voici que…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et discrète, se tut.
LA SIX CENT CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Et Hassân se précipita aussitôt vers le coffre où se trouvaient ses vieux effets, et il prit la touffe de barbe dont il brûla un des poils, en appelant dans sa pensée, le cheikh Ali Père-des-Plumes. Et voici que le palais trembla, et le cheikh vêtu de noir sortit de terre devant Hassân, qui se jeta à ses genoux. Et le cheikh lui demanda : « Que veux-tu, Hassân ? » Et le jeune homme lui dit : « De grâce ! ne fais pas de bruit, ou celle-ci va se réveiller ! Et alors je serai sans recours entre ses mains pour faire l’oiseau ! » Et il lui montra du doigt la géante endormie. Alors le cheikh le prit par la main et, par la vertu de sa puissance cachée, le conduisit hors du palais. Puis il lui dit : « Raconte-moi ce qui t’est arrivé. » Et Hassân lui raconta tout ce qu’il avait fait depuis son arrivée dans la terre de camphre blanc, et il ajouta : « Et maintenant, par Allah ! si j’étais resté un jour de plus auprès de cette géante, mon âme serait sortie de mon nez ! » Et le cheikh dit : « Je t’avais pourtant prévenu de ce que tu allais éprouver ! Mais tout cela n’est que le commencement ! Et, de plus, je dois te dire, ô mon enfant, pour te décider une dernière fois à revenir sur tes pas, que dans les îles Wak-Wak la vertu de mes poils n’aura plus d’effet, et que tu seras abandonné à tes propres moyens ! » Et Hassân dit : « Il faut que j’aille tout de même retrouver mon épouse ! Et il me reste encore ce tambour magique qui pourra me servir en cas de danger pour me tirer d’embarras ! » Et le cheikh Ali regarda le tambour et dit : « Oh ! je le reconnais ! C’est celui qui appartenait à Bahram le Guèbre, un de mes anciens disciples, le seul qui ait cessé de marcher dans la voie d’Allah ! Mais, ô Hassân, sache que ce tambour-là, non plus, ne pourra guère te servir dans les îles Wak-Wak, où se défont tous les enchantements, et où les genn, habitants de l’île, n’obéissent qu’à leur seul roi ! » Et Hassân dit : « Celui qui doit vivre dix ans ne mourra pas dans sa neuvième année ! Si donc ma destinée est de mourir dans ces îles-là, il n’y a pas d’inconvénient ! Je te supplie donc, ô vénérable cheikh des cheikhs, de me dire le chemin que je dois suivre pour y aller ! » Et le cheikh Ali alors, pour toute réponse, le prit par la main, et lui dit : « Ferme les yeux et ouvre-les ! » Et Hassân ferma les yeux ; puis, l’instant d’après, il les ouvrit. Et tout avait disparu, aussi bien le cheikh Père-des-Plumes, que le palais de la fille du roi et que la terre de camphre blanc. Et il se vit sur le rivage d’une île dont les galets étaient des pierreries de couleurs différentes. Et il ne savait point s’il était enfin arrivé aux îles tant désirées.
Or, Hassân avait à peine eu le temps de tourner un œil à droite et un œil à gauche, qu’aussitôt fondirent sur lui, sortis des galets marins et de l’écume des vagues, des bandes de grands oiseaux blancs, qui couvrirent le ciel d’un nuage dense et bas. Et le vol ennemi s’avança contre lui en tourbillon, avec un vacarme de becs menaçants et d’ailes agitées ; et tous les gosiers aériens poussèrent en même temps un cri rauque, mille fois répété, dans lequel Hassân reconnut enfin les syllabes Wak-Wak du nom des îles ! Alors il comprit qu’il était arrivé sur ces terres interdites, et que ces oiseaux le considéraient comme un intrus et cherchaient à le repousser vers la mer. Et Hassân courut se réfugier dans une cabane qui s’élevait non loin de là, et se mit à réfléchir sur l’affaire.
Soudain, il entendit gronder la terre et la sentit trembler sous ses pieds ; et il prêta l’oreille, en retenant sa respiration, et vit au loin grossir un autre nuage, d’où peu à peu surgirent au soleil des pointes de lances et de casques, et brillèrent des armures. Les amazones ! Où fuir ? Et le galop furieux, rapide comme la grêle qui tombe, comme l’éclair qui brille, se rapprocha en un clin d’œil. Et devant lui apparurent, massées en un carré mouvant et formidable, des guerrières montées sur des cavales fauves comme l’or pur, à la queue longue, au jarret vigoureux, portant les rênes hautes et libres, plus promptes que le vent du nord lorsqu’il souffle avec violence de la mer tempétueuse. Et ces guerrières, armées pour le combat, portaient chacune un sabre pesant au côté, une longue lance dans une main et dans l’autre une masse d’armes qui épouvantait la pensée ; et elles tenaient, serrées sous leurs cuisses, quatre javelines qui montraient leurs têtes épouvantables.
Or, dès que ces guerrières eurent aperçu l’insolite Hassân debout sur le seuil de la cabane, elles arrêtèrent net leurs cavales bondissantes. Et toute la masse des sabots fit, en s’abattant, voler dans le ciel les galets du rivage, et s’enfonça dans le sable, profondément. Et les naseaux large ouverts des bêtes palpitantes frémissaient en même temps que les narines des guerrières adolescentes ; et les figures nues sous les casques aux visières hautes étaient belles comme des lunes ; et les croupes arrondies et pesantes se continuaient et se confondaient avec les croupes fauves des cavales. Et les longues chevelures, brunes, blondes, fauves et noires, se mêlaient, en ondoyant, aux grands crins des queues et des crinières. Et les têtes de métal et les cuirasses d’émeraude éclataient au soleil comme d’immenses joyaux, et flambaient sans se consumer.
Mais alors, du milieu de ce carré de lumière, s’avança une amazone plus haute que toutes les autres…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Mais alors, du milieu de ce carré de lumière, s’avança une amazone plus haute que toutes les autres, dont le visage était non point nu sous le casque, mais complètement recouvert de la visière baissée, et dont la poitrine, aux seins rebondissants, reluisait sous la protection d’une cotte de mailles d’or plus serrées que les ailes des sauterelles. Et elle arrêta sa cavale brusquement à quelques pas de Hassân. Et Hassân, ne sachant si elle lui était hostile ou hospitalière, commença par se jeter devant elle, le front dans la poussière, puis releva la tête et lui dit : « Ô ma souveraine, je suis un étranger que la destinée a conduit dans cette terre, et je me mets sous la protection d’Allah et sous ta sauvegarde ! Ne me repousse pas ! Ô ma souveraine, aie pitié du malheureux qui est à la recherche de son épouse et de ses enfants ! »
À ces paroles de Hassân, la cavalière sauta à bas de son cheval et, se tournant vers ses guerrières, d’un geste les congédia. Et elle s’approcha de Hassân, qui aussitôt lui baisa les pieds et les mains et porta à son front le bord de son manteau. Et elle l’examina avec attention ; puis, relevant sa visière, elle se montra à lui à découvert. Et Hassân, en la voyant, poussa un grand cri et recula épouvanté ; car au lieu d’une jeune femme pour le moins aussi belle que les guerrières adolescentes qu’il avait vues, il avait devant lui une vieille à l’aspect bien laid, qui possédait un nez gros comme une aubergine, des sourcils de travers, des joues ridées et tombantes, des yeux qui s’injuriaient l’un l’autre, et, dans chacun des neuf angles de sa figure, une calamité ! Ce qui faisait qu’elle ressemblait tout à fait à un cochon !
Aussi Hassân, pour n’être point obligé de regarder plus longtemps ce visage, se couvrit les yeux avec le pan de son vêtement. Et la vieille prit ce geste pour un grand signe de respect, se persuadant que Hassân ne le faisait que pour ne point paraître insolent en la regardant face à face ; et elle fut touchée à l’extrême de cette marque de respect et lui dit : « Ô étranger, calme ton inquiétude. Dès ce moment tu es sous ma protection ! Et je te promets mon assistance dans tout ce dont tu auras besoin ! » Puis elle ajouta : « Mais, avant toute chose, il faut que personne ne te voie dans cette île ! Et, dans ce but, et bien que je sois impatiente de connaître ton histoire, je vais courir t’apporter les objets nécessaires pour te déguiser en amazone, afin que tu ne puisses plus désormais être différencié d’avec les jeunes vierges guerrières, gardiennes du roi et des filles du roi ! » Et elle s’en alla, pour revenir au bout de quelques instants avec une cuirasse, un sabre, une lance, un casque et d’autres armes en tous points semblables à celles que portaient les amazones. Et elle les donna à Hassân qui s’en couvrit. Alors elle le prit par la main et le conduisit sur un rocher qui s’élevait au bord de la mer, et, s’y étant assise avec lui, lui dit : « Maintenant, ô étranger, hâte-toi de me raconter la cause qui t’a poussé jusque vers ces îles où nul adamite avant toi n’a osé aborder ! » Et Hassân répondit, après l’avoir remercié pour ses bontés : « Ô ma maîtresse, mon histoire est celle d’un malheureux qui a perdu le seul bien qu’il possédât, et qui parcourt la terre dans l’espoir de le retrouver ! » Et il lui raconta ses aventures sans omettre un détail. Et la vieille amazone lui demanda : « Et comment s’appelle l’adolescente, ton épouse, et comment s’appellent tes enfants ? » Il dit : « Dans mon pays mes enfants s’appelaient Nasser et Manssour, et mon épouse s’appelait Splendeur ! Mais j’ignore quel nom ils portent dans le pays des genn ! » Et Hassân, ayant fini de parler, se mit à pleurer d’abondantes larmes.
Lorsque la vieille eut entendu cette histoire de Hassân et vu sa douleur, elle fut tout à fait gagnée par la compassion, et lui dit : « Je te fais le serment, ô Hassân, qu’une mère ne s’intéresse pas à son enfant plus que je ne veux m’intéresser à ton sort. Et puisque tu dis que ton épouse se trouve peut-être au milieu de mes amazones, je vais, dès demain, te les faire voir toutes nues dans la mer. Et je les ferai ensuite défiler devant toi une à une, pour que tu me dises si tu reconnais ton épouse parmi elles ! »
Ainsi parla la vieille Mère-des-Lances à Hassân Al-Bassri. Et elle le tranquillisa, en lui affirmant qu’ils ne manqueraient pas, par ce stratagème, de découvrir l’adolescente Splendeur ! Et elle passa cette journée-là avec lui, et le promena à travers l’île, en lui en faisant admirer toutes les merveilles. Et elle finit par l’aimer d’un grand amour, et elle lui disait : « Calme-toi, mon enfant ! Je t’ai mis dans mes yeux ! Et si même tu me demandais, pour ton plaisir, toutes mes guerrières, qui sont des jeunes filles vierges, je te les donnerais de tout cœur amical ! » Et Hassân lui répondait : « Ô ma maîtresse, moi, par Allah ! je ne te quitterai que lorsque mon âme me quittera ! »
Or, le lendemain, selon sa promesse, la vieille Mère-des-Lances, vint à la tête de ses guerrières, au son des tambours. Et Hassân, déguisé en amazone, était assis sur le rocher qui dominait la mer. Et, de la sorte, il ressemblait à quelque fille d’entre les filles des rois…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, le lendemain, selon sa promesse, la vieille Mère-des-Lances vint à la tête de ses guerrières, au son des tambours. Et Hassân, déguisé en amazone, était assis sur le rocher qui dominait la mer. Et, de la sorte, il ressemblait à quelque fille d’entre les filles des rois !
Cependant les guerrières adolescentes, descendues de leurs cavales à un signe de la vieille Mère-des-Lances qui les commandait en chef, se débarrassèrent de leurs armes et de leurs cuirasses. Et, fuselées et brillantes elles en sortirent, ô délire des lis et des roses ! comme les lis de leurs feuilles et les roses de leurs épines. Et, blanches et légères, elles descendirent dans la mer. Et l’écume se mêla à leurs chevelures libres et roulées, ou coiffées et hautes comme des tours. Et le gonflement des vagues continua le gonflement de leurs croupes vierges. Et elles étaient comme des corolles effeuillées sur les eaux.
Mais parmi tant de visages de lune et de tailles flexibles, d’yeux noirs et de dents blanches, de cheveux de couleurs différentes et de croupes de bénédiction, Hassân eut beau regarder, il ne reconnut point l’incomparable beauté de sa bien-aimée Splendeur. Et il dit à la vieille : « Ô ma bonne mère, Splendeur n’est point parmi elles ! » Et la vieille cavalière répondit : « Qui sait, mon fils ? peut-être que l’éloignement ne te permet pas de bien juger ! » Et elle frappa dans ses mains, et toutes les adolescentes sortirent de l’eau et vinrent se ranger sur le sable, humides encore de pierreries. Et, l’une après l’autre, flexibles et balancées, elles passèrent devant la roche ou se tenait Hassân avec la Mère-des-Lances, n’ayant sur elles, pour toutes armures, que leurs cheveux épars dans le dos, et lourdes seulement des joyaux de leur chair nue.
C’est alors, ô Hassân, que tu vis ce que tu vis ! Ô lapins de toutes les couleurs et de toutes les variétés entre les cuisses des adolescentes filles de rois ! Vous étiez gras, vous étiez ronds, vous étiez dodus, vous étiez blancs, vous étiez comme des dômes, vous étiez gros, vous étiez voûtés, vous étiez hauts, vous étiez unis, vous étiez bombés, vous étiez fermés, vous étiez intacts, vous étiez comme des trônes, vous étiez comme des mulets, vous étiez lourds, vous étiez lippus, vous étiez muets, vous étiez comme des nids, vous étiez sans oreilles, vous étiez chauds, vous étiez comme des tentes, vous étiez sans poils, vous aviez des museaux, vous étiez sourds, vous étiez blottis, vous étiez petits, vous étiez fendus, vous étiez sensibles, vous étiez des gouffres, vous étiez secs, vous étiez excellents, mais, certes ! vous n’étiez point comparables à l’histoire de Splendeur.
Aussi Hassân laissa-t-il passer toutes les adolescentes, et dit à la vieille Mère-des-Lances : « Ô ma maîtresse, par ta vie sur moi ! il n’y a pas une seule parmi toutes ces jeunes filles qui, de près ou de loin, ressemble à Splendeur ! » Et la vieille guerrière, étonnée, lui dit : « Alors, ô Hassân, il ne reste plus, après toutes celles que tu as vues, que les sept filles de notre roi ! Veuille donc m’apprendre à quelles marques je puis, à l’occasion, reconnaître ton épouse, et me la dépeins dans ce qu’elle a de particulier ! Et moi je garderai tout cela dans ma mémoire ! Et je te promets que, renseignée de la sorte, je ne manquerai pas de retrouver celle que tu désires ! » Et Hassân répondit : « Te la dépeindre, ô ma maîtresse, c’est mourir d’impuissance ; car nulle langue ne saurait en exprimer toutes les perfections. Mais je veux bien t’en donner la ressemblance approximativement. Elle a, ô ma maîtresse, un visage aussi blanc qu’un jour de bénédiction ; une taille si fine que le soleil n’en saurait allonger l’ombre sur le sol ; une chevelure noire et longue sur le dos comme la nuit sur le jour ; des seins qui trouent les étoffes les plus dures ; une langue comme celle des abeilles ; une salive comme l’eau de la fontaine Salsabil ; des yeux comme la source de Kausar ; une souplesse de rameau de jasmin ; des dents comme des grêlons ; un grain de beauté sur la joue droite et une envie sous le nombril ; une bouche comme une cornaline, qui dispense de la coupe et de l’aiguière ; des joues comme les anémones de Némân ; un ventre élastique et éblouissant, aussi vaste et aussi blanc qu’une cuve de marbre ; une croupe plus solide et mieux bâtie que la coupole du temple d’Iram ; des cuisses fondues dans le moule de la perfection, aussi douces que les jours de la réunion après l’absence amère, entre lesquelles est assis le trône du khalifat, sanctuaire du repos et de l’ivresse, et dont le logogriphe a été ainsi décrit par le poète :
» Mon nom, objet de tant d’émois, est composé de deux lettres fameuses ! Multipliez quatre par cinq et six par dix, et vous l’obtenez ! »[2]
Et, ayant dit ces paroles, Hassân ne put retenir ses larmes plus longtemps, et se mit à pleurer. Puis il s’écria : « Mon tourment, ô Splendeur, est aussi amer que le tourment du derviche qui a perdu son écuelle, ou la souffrance du pèlerin qui a une blessure au talon, ou la douleur de l’amputé qui a perdu ses jambes et ses bras ! »
Lorsque la vieille amazone eut entendu tout cela, elle baissa la tête un moment, plongée dans une profonde réflexion, puis elle dit à Hassân : « Quelle calamité, ô Hassân ! Tu te perds sans recours et tu me perds avec toi ! Car l’adolescente que tu viens de me dépeindre est certainement l’une des sept filles de notre puissant roi ! Quel leurre est le tien, et que ton audace est insensée ! Entre toi et elle, il y a la distance qu’il y a entre la terre et le ciel ! et si tu persistes dans ton vouloir, c’est à ta perte que tu te précipites ! Écoute-moi donc, Hassân ! Renonce à ce projet téméraire, et n’expose pas ton âme à la perdition…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Écoute-moi donc, Hassân ! Renonce à ce projet téméraire, et n’expose pas ton âme à la perdition ! » À ces mots de la vieille, Hassân fut tellement bouleversé qu’il tomba évanoui ; et, lorsqu’il revint à lui, il pleura si amèrement, que ses vêtements furent inondés de ses larmes, et, à la limite du désespoir, il s’écria : « Ainsi donc, ô ma secourable tante, il faut que je m’en retourne désespéré, après être venu si loin, et au moment où je suis prêt à atteindre le but ! Comment, après l’assurance que tu m’en avais donnée, aurais-je pu douter du succès de mon entreprise et de la portée de ta puissance ? N’est-ce point toi-même qui commandes en chef aux troupes des Sept Îles, et à qui aucune entreprise de ce genre n’est impossible ? » Elle répondit : « Certes, mon fils, je puis beaucoup sur mes troupes et sur chacune en particulier des amazones qui les composent ! Aussi je veux, pour te détourner de ton projet insensé, que tu choisisses, parmi toutes ces adolescentes guerrières, celle qui te plaît le mieux ; et moi je te la donnerai à la place de ton épouse ! Et ensuite tu retourneras avec elle dans ton pays, et tu seras à l’abri de la vengeance de notre roi ! Sinon ma perte et la tienne sont inévitables ! » Mais Hassân ne répondit à ce conseil de la vieille que par de nouvelles larmes et de nouveaux sanglots. Et la vieille, émue de l’excès de sa douleur, lui dit : « Par Allah sur toi, ô Hassân, que veux-tu donc que je fasse pour toi ? Si déjà l’on vient à découvrir que je t’ai laissé aborder dans nos îles, ma tête n’appartiendra plus à mes épaules. Et si jamais on vient à savoir que je t’ai fait voir dans le bain, toutes nues, mes guerrières adolescentes, des jeunes filles vierges que nul regard de mâle n’a effleurées et que nul doigt d’homme n’a touchées, mon âme ne m’appartiendra plus ! » Et Hassân s’écria : « Par Allah ! ô ma maîtresse, je t’assure que je n’ai point regardé d’une façon inconvenante ces jeunes filles, et je n’ai point prêté grande attention à leur nudité ! » Et la vieille dit : « Tu as eu tort justement, ô Hassân, car de ta vie entière tu n’auras encore pareil spectacle ! En tout cas, si aucune de ces vierges ne te tente, pour te décider à retourner dans ton pays et à sauvegarder ainsi ton âme, je te chargerai des richesses et des produits précieux de nos îles, et te comblerai de biens qui te rendront riche et heureux pour le restant de tes jours ! » Mais Hassân se précipita aux pieds de la vieille, lui embrassa les genoux et lui dit en pleurant : « Ô ma bienfaitrice, ô prunelle de mes yeux, ô ma souveraine, comment puis-je retourner dans mon pays après avoir souffert tant de fatigues et bravé tant de dangers ? Comment pourrais-je quitter cette île sans avoir vu la bien-aimée dont l’amour m’y a conduit ? Ah ! songe, ô ma maîtresse, que peut-être la volonté de la destinée est que je retrouve mon épouse après toutes les souffrances que j’ai endurées ! » Et, ayant dit ces paroles, Hassân ne put retenir l’élan de son âme, et il improvisa ces strophes :
« Ô reine de la beauté, aie pitié du prisonnier de deux paupières qui ont subjugué les royaumes des Khosroès.
Ni les roses, ni les nards, ni les essences aromatiques ne peuvent se passer, pour leurs vertus, de ton haleine.
La brise des plaines du paradis s’arrête dans tes cheveux pour embaumer les heureux qui la respirent.
Les pléiades qui brillent le soir prennent de tes yeux leur clarté, et les astres des nuits sont seuls dignes de servir de collier à ta gorge, ô blanche jeune femme ! »
Lorsque la vieille amazone eut entendu ces vers de Hassân, elle vit qu’il serait vraiment cruel de lui enlever pour toujours l’espoir de revoir son épouse, et elle compatit à sa douleur et lui dit : « Mon fils, éloigne de ta pensée l’affliction et le désespoir. Car maintenant je suis bien décidée à tout tenter pour te rendre ton épouse ! » Puis elle ajouta : « Je vais à l’instant commencer à m’occuper avec mon âme de ton affaire, ô pauvre ! Car je vois bien que l’amoureux n’a ni ouïe ni entendement ! Je te quitte donc pour aller au palais de la reine de cette île où nous sommes, qui est l’une des sept îles Wak-Wak. Car il faut que tu saches que chacune de ces sept îles est habitée et gouvernée par l’une des sept filles de notre roi, qui sont des sœurs du même père et non de la même mère. Et celle qui nous gouverne ici est l’aînée des sœurs, et s’appelle la princesse Nour Al-Houda. Et moi je vais aller la trouver pour lui parler en ta faveur. Calme donc ton âme, rafraîchis tes yeux, et attends mon retour d’un cœur tranquille ! » Et elle prit congé de lui et se dirigea vers le palais de la princesse Nour Al-Houda.
Une fois arrivée en présence de la princesse, la vieille amazone, qui était respectée et aimée par les filles du roi et par le roi lui-même, à cause de sa sagesse et de l’éducation et des soins qu’elle avait donnés aux jeunes princesses, s’inclina et embrassa la terre entre les mains de Nour Al-Houda. Et la princesse se leva aussitôt en son honneur, et l’embrassa et la fit asseoir à côté d’elle, et lui dit : « Inschallah ! Puissent les nouvelles, que tu m’apportes être de bon présage ! Et si tu as une demande à me faire, ou une faveur à me réclamer, parle ! Me voici attentive à t’écouter…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT NEUVlÈME NUIT
Elle dit :
« … parle ! Me voici attentive à t’écouter ! » La vieille Mère-des-Lances répondit : « Ô reine du siècle et du temps, ô ma fille, je viens chez toi pour t’annoncer un événement extraordinaire qui, je l’espère, te sera une distraction et un amusement. Sache, en effet, que j’ai trouvé, échoué sur le rivage de notre île, un jeune homme d’une beauté merveilleuse qui pleurait avec amertume. Et comme je l’interrogeais sur son état, il me répondit que sa destinée l’avait jeté sur nos côtes, alors qu’il était à la recherche de son épouse ! Et comme je le priais de me dire qui était son épouse, il me fit d’elle une description qui m’a jetée dans un grand émoi à ton sujet et au sujet des autres princesses, tes sœurs ! Et je dois également te révéler, ô ma reine, pour dire toute la vérité, que jamais mes yeux n’ont vu, chez les genn et les éfrits, un adolescent aussi beau que celui-là ! »
Lorsque la princesse Nour Al-Houda eut entendu ces paroles de la vieille, elle entra dans une colère terrible et cria à la vieille amazone : « Ô vieille de malédiction, ô fille des mille cornards de l’infamie, comment as-tu fait pour introduire un mâle au milieu de nos vierges, dans nos domaines ? Ah ! race d’impudicité, qui me servira à boire une gorgée de ton sang, ou à manger une bouchée de ta chair ? » Et la vieille guerrière se mit à trembler comme un roseau au milieu de la tempête, et tomba aux genoux de la princesse, qui lui cria : « Ne crains-tu donc pas la punition que t’attirent ma vengeance et mon courroux ? Par la tête de mon père, le grand roi des genn ! je ne sais ce qui me retient en ce moment de te faire couper en morceaux, afin que tu serves d’exemple dans l’avenir aux guides d’infamie qui voudront introduire les voyageurs dans nos îles ! » Puis elle ajouta : « Mais, avant tout, hâte-toi d’aller me chercher cet adamite téméraire qui a osé violer nos frontières ! » Et la vieille se releva, ne sachant plus, dans sa terreur, distinguer sa main droite de sa main gauche, et sortit pour aller trouver Hassân. Et elle pensait : « Cette affreuse calamité, qu’Allah m’envoie par l’entremise de la reine, m’est tout entière suscitée par ce jeune Hassân ! Que ne l’ai-je plutôt obligé à quitter cette île, et à nous faire voir la largeur de son dos ! » Et elle arriva de la sorte à l’endroit où se trouvait Hassân et lui dit, dès qu’elle l’eut aperçu : « Lève-toi, ô celui dont le terme final est proche ! Et viens chez la reine qui a à te parler ! » Et Hassân suivit la vieille, en disant : « Ya salam ! Dans quel abîme vais-je être précipité ! » Et il arriva de la sorte dans le palais, entre les mains de la princesse. Et elle le reçut, assise sur son trône et le visage entièrement couvert de son voile. Et Hassân ne trouva rien de mieux à faire, dans cette pénible circonstance, que de commencer par embrasser la terre devant le trône et, après le salam, d’adresser un compliment en vers à la princesse. Alors elle se tourna vers la vieille et lui fit un signe qui signifiait : « Interroge-le ! » Et la vieille dit à Hassân : « Notre puissante reine te rend le salam et te demande, afin que tu lui répondes : « Quel est ton nom, quel est ton pays d’origine, quel est le nom de ton épouse et quel est le nom de tes enfants ? » Et Hassân, aidé par la destinée, répondit, en se tournant vers la princesse : « Reine de l’univers, souveraine du siècle et du temps, ô l’unique de l’époque et des âges, pour ce qui est de mon misérable nom, je m’appelle Hassân le rempli de tribulations, le natif de la ville de Bassra, dans l’Irak. Mais pour ce qui est de mon épouse, je ne connais pas son nom ! Quant à mes enfants, l’un s’appelle Nasser et l’autre Manssour ! » La reine lui demanda, par l’entremise de la vieille : « Et pourquoi ton épouse t’a-t-elle quitté ? » Il dit : « Par Allah, je ne le sais pas ! Mais ce doit être malgré elle ! » Elle lui demanda : « D’où est-elle partie ? Et par quel moyen ? » Il dit : « Elle est partie de Baghdad, du palais même du khalifat Haroun Al-Rachid, émir des Croyants ! Et elle n’a eu, pour cela, qu’à se vêtir de son manteau de plumes et à s’élever dans les airs ! » Elle demanda : « Et n’a-t-elle rien dit, en partant ? » Il répondit : « Elle a dit à ma mère : « Si ton fils, torturé par la douleur de mon absence, veut jamais me retrouver, il n’aura qu’à venir me chercher dans les îles Wak-Wak ! Et maintenant adieu, ô mère de Hassân ! Certes ! de partir ainsi je m’afflige beaucoup, et je m’attriste en mon âme, car les jours de la séparation déchireront son cœur, et noirciront votre vie ; mais, hélas ! je n’y puis rien ! Je sens l’ivresse de l’air envahir mon âme, et il faut que je m’envole dans l’espace ! » Ainsi parla mon épouse ! Et elle s’envola ! Et depuis lors le monde est noir devant mes yeux, et ma poitrine est habitée par la désolation ! » La princesse Nour Al-Houda répondit, en hochant la tête : « Par Allah ! il est certain que si ton épouse ne voulait plus te revoir, elle n’aurait pas révélé à ta mère l’endroit où elle allait ! Mais, d’un autre côté, si elle t’aimait véritablement, elle ne t’aurait pas ainsi abandonné ! » Hassân jura alors, par les plus grands serments, que son épouse l’aimait véritablement, qu’elle lui avait donné mille preuves de son affection et de son dévouement, mais qu’elle n’avait pu résister à l’appel de l’air et à celui de son instinct originel, qui est le vol des oiseaux ! Et il ajouta : « Ô reine, je t’ai raconté ma triste histoire ! Et me voici devant toi, suppliant ta clémence de me pardonner ma démarche audacieuse, et de m’aider à retrouver mon épouse et mes enfants ! Par Allah sur toi, ô ma souveraine, ne me repousse pas ! »
Lorsque la princesse Nour Al-Houda eut entendu ces paroles de Hassân, elle réfléchit pendant une heure de temps ; puis elle releva la tête et dit à Hassân : « J’ai beau réfléchir sur le genre de supplice que tu as mérité, je n’en trouve pas un qui soit suffisant pour punir ta témérité ! » Alors la vieille, bien que terrifiée, se jeta aux pieds de sa maîtresse, et prit le pan de sa robe dont elle se couvrit la tête, et lui dit : « Ô grande reine…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors la vieille, bien que terrifiée, se jeta aux pieds de sa maîtresse, et prit le pan de sa robe dont elle se couvrit la tête, et lui dit : « Ô grande reine, par mes titres de nourrice qui t’a élevée, ne te hâte point de le châtier, d’autant que tu sais maintenant que c’est un pauvre étranger, qui a affronté bien des périls et éprouvé bien des tribulations ! Et ce n’est que grâce à la longue vie que lui a octroyée le destin, qu’il a pu résister aux tourmentes traversées. Et il est plus grand et plus digne de ta noblesse, ô reine, de lui pardonner, et de ne point violer à ses dépens les droits de l’hospitalité ! De plus, considère que c’est l’amour seul qui l’a jeté dans cette entreprise fatale, et que l’on doit beaucoup pardonner aux amoureux. Enfin, ô ma reine et la couronne sur notre tête, sache que si j’ai osé venir te parler de cet adolescent si beau, c’est que nul comme lui, parmi les fils des hommes, ne sait construire les vers et improviser des odes. Et, pour contrôler mon dire, tu n’auras qu’à lui montrer ton visage à découvert, et tu verras comme il saura célébrer ta beauté ! » À ces paroles de la vieille, la reine sourit et dit : « En vérité, il ne manquait plus que cela pour que la mesure soit comble ! » Mais, en secret, la princesse Nour, malgré la sévérité de son attitude, avait été remuée dans ses entrailles par la beauté de Hassân, et elle ne demandait pas mieux que d’expérimenter son savoir, aussi bien en vers qu’en ce qui s’en suit toujours. Donc elle feignit de se laisser convaincre par les paroles de sa nourrice et, levant son voile, elle montra son visage à découvert.
À cette vue, Hassân jeta un si grand cri, que le palais en fut ébranlé ; et il tomba sans connaissance. Et la vieille lui prodigua les soins nécessaires et le rappela à lui ; puis elle lui demanda : « Qu’as-tu donc, mon fils ? Et qu’as-tu vu pour être si troublé ! » Et Hassân répondit : « Ah ! qu’ai-je vu, ya Allah ! La reine elle-même est mon épouse, ou, du moins, elle ressemble à mon épouse comme la moitié d’une fève divisée ressemble à sa sœur ! » Et la reine, en entendant ces paroles, se mit à rire tellement qu’elle se renversa sur le côté, et dit : « Ce jeune homme est fou ! Il dit que je suis son épouse ! Par Allah, et depuis quand les vierges sont-elles fécondées sans le secours du mâle, et ont-elles des enfants de l’air du temps ? » Puis elle se tourna vers Hassân et lui dit en riant : « Ô mon chéri, veux-tu au moins me dire, afin que je l’apprenne, en quoi je ressemble à ton épouse, et en quoi je ne lui ressemble pas ? Car je vois que tout de même tu es dans une grande perplexité à mon sujet ! » Il répondit : « Ô souveraine des rois, asile des grands et des petits, c’est ta beauté qui m’a rendu fou ! Car tu ressembles à mon épouse par les yeux plus lumineux que des étoiles, par la fraîcheur de ton teint, par l’incarnat de tes joues, par la forme droite de tes beaux seins, par la douceur de ta voix, par la légèreté et l’élégance de ta taille et par bien d’autres appas que je ne dirai pas, par respect pour ce qui est voilé ! Mais, à bien regarder tes charmes, je trouve entre toi et elle une différence, visible pour mes seuls yeux d’amoureux, et que je ne puis t’exprimer par la parole ! »
Lorsque la princesse Nour Al-Houda entendit ces paroles de Hassân, elle comprit que son cœur ne s’attacherait jamais à elle ; et elle en conçut un violent dépit, et jura de découvrir quelle était celle des princesses, ses sœurs, dont Hassân était devenu l’époux sans l’assentiment du roi, leur père ! Et elle se dit : « Je me vengerai de la sorte et sur Hassân et sur son épouse, en assouvissant sur eux deux mon juste ressentiment ! » Mais elle cacha ces pensées au fond de son âme et, se tournant vers la vieille, dit : « Ô nourrice, va vite trouver mes six sœurs, chacune en particulier dans l’île qu’elle habite, et dis-leur que leur absence me pèse à l’extrême depuis déjà plus de deux ans qu’elles ne m’ont visitée. Et invite-les de ma part à venir me voir, et amène-les-moi avec toi ! Mais surtout prends bien garde de leur dire un mot de ce qui est arrivé, ou de leur annoncer la venue parmi nous d’un jeune étranger qui est à la recherche de son épouse ! Va, et ne tarde pas ! »
Aussitôt la vieille, qui ne pouvait soupçonner les intentions de la princesse, sortit du palais et vola, rapide comme l’éclair, vers les îles où se trouvaient les six princesses, sœurs de Nour Al-Houda. Et elle réussit, sans difficulté, à décider les cinq premières à la suivre. Mais lorsqu’elle fut arrivée à la septième île, où la plus jeune princesse habitait avec son père, le roi-des-rois des genn, elle éprouva bien de la peine à faire accepter le désir de Nour Al-Houda. En effet, lorsque la plus jeune princesse, sur l’avis de la vieille, fut allée demander au roi son père la permission d’aller avec la Mère-des-Lances visiter sa sœur aînée, le roi, ému de cette demande à la limite de l’émotion, s’écria : « Ah ! ma fille bien-aimée, la préférée de mon cœur, j’ai dans mon âme quelque chose qui me dit que je ne te reverrai plus, si tu viens à t’éloigner désormais de ce palais. Et d’ailleurs j’ai fait cette nuit un songe terrifiant que je vais te conter. Sache donc, ma fille, ô prunelle de mes yeux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT ONZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Sache donc, ma fille, ô prunelle de mes yeux, que cette nuit un songe pesa sur mon sommeil et oppressa ma poitrine. Je me promenais, en effet, dans mon rêve, au milieu d’un trésor caché à tous les regards, mais dont les richesses étaient étalées à mes seuls yeux. Et j’admirais tout ce que je voyais, mais mes regards ne s’arrêtaient que sur sept pierres précieuses qui brillaient au milieu de tout le reste, d’un éclat splendide. Mais c’était la plus petite qui était la plus belle et la plus attirante. Aussi, pour la mieux admirer et la mettre à l’abri des regards, je la pris dans ma main, la serrai contre mon cœur, et, l’ayant emportée, je sortis du trésor. Et comme je la tenais devant mes yeux, sous les rayons du soleil, soudain un oiseau d’une espèce extraordinaire, et comme on n’en voit jamais dans nos îles, fondit sur moi, m’arracha la pierre précieuse et s’envola. Et moi je restai plongé dans la stupeur et dans la plus vive douleur. Et, à mon réveil, après toute une nuit de tourments, je fis venir les interprètes des songes et leur demandai l’explication de ce que j’avais vu dans mon sommeil. Et ils me répondirent : « Ô notre roi, les sept pierres précieuses sont tes sept filles, et la pierre la plus petite, enlevée par l’oiseau d’entre tes mains, c’est ta fille la plus petite qui doit être ravie par la force à ton affection ! » Or moi, ma fille, j’ai bien peur maintenant de te laisser t’éloigner avec tes sœurs et la Mère-des-Lances pour aller chez ta grande sœur Nour Al-Houda ; car je ne sais point ce qui peut t’arriver de fâcheux en voyage, soit à l’aller soit au retour ! » Et Splendeur (car c’était elle-même, l’épouse de Hassân) répondit : « Ô mon souverain et père, ô grand roi, tu n’ignores pas que ma sœur la grande, Nour Al-Houda, a préparé pour moi une fête, et m’attend avec la plus vive impatience. Et voilà déjà plus de deux ans que je pense toujours à aller la voir, sans que la chose me soit permise ; et maintenant elle doit avoir toutes sortes de motifs d’être peu satisfaite de ma conduite. Mais ne crains rien, ô père mien ! Et n’oublie pas qu’il y a quelque temps, lorsque j’avais fait un voyage au loin avec mes compagnes, tu m’avais cru perdue pour toujours, et tu avais pris mon deuil. Et pourtant je te suis revenue sans encombre et en bonne santé ! De même cette fois, je m’absenterai tout au plus un mois, au bout duquel je te reviendrai, si Allah veut ! D’ailleurs, si c’était pour m’éloigner de notre royaume, je comprendrais ton émoi ; mais ici, dans nos îles, quel ennemi pourrais-je redouter ? Qui pourrait arriver jusqu’aux îles Wak-Wak, après avoir traversé la Montagne-des-Nuages, les Montagnes Bleues, les Montagnes Noires, les Sept Vallées, les Sept Mers et la Terre de Camphre blanc, sans perdre mille fois son âme en route ? Chasse donc toute inquiétude de ton esprit, ô mon père, rafraîchis tes yeux et rassure ton cœur ! »
Lorsque le roi des genn entendit ces paroles de sa fille, il voulut bien consentir à la laisser partir, mais bien à regret, et en lui faisant promettre de ne rester que quelques jours auprès de sa sœur. Et il lui donna une escorte de mille amazones, et l’embrassa avec tendresse. Et Splendeur prit congé de lui, et, après être allée embrasser, dans l’endroit où ils étaient en sûreté, ses deux enfants dont personne ne soupçonnait l’existence, vu que, dès son arrivée, elle les avait confiés à deux de ses esclaves dévouées, elle suivit la vieille et ses sœurs dans l’île où régnait Nour Al-Houda.
Or, pour recevoir ses sœurs, Nour Al-Houda s’était habillée d’une robe de soie rouge ornementée d’oiseaux d’or dont les yeux, le bec, et les ongles étaient des rubis et des émeraudes ; et, lourde de parures et de pierreries, elle était assise sur le trône, dans la salle des audiences. Et devant elle se tenait Hassân debout ; et à sa droite étaient rangées des jeunes filles avec les épées nues ; et à sa gauche d’autres jeunes filles tenaient les longues lances pointues.
Ce fut à ce moment qu’arriva la Mère-des-Lances avec les six princesses. Et elle demanda l’audience, et, sur l’ordre de la reine, elle introduisit d’abord la plus âgée qui s’appelait Noblesse-de-la-Race. Elle était vêtue d’une robe de soie bleue, et elle était encore plus belle que Nour Al-Houda. Et elle s’avança jusqu’au trône, et baisa la main de sa sœur qui se leva en son honneur et l’embrassa et la fit asseoir à côté d’elle. Puis elle se tourna vers Hassân et lui dit : « Dis-moi, ô adamite, est-ce celle-ci ton épouse ? » Et Hassân répondit : « Par Allah, ô ma maîtresse, celle-ci est merveilleuse et belle comme la lune à son lever ; elle a une chevelure de charbon, des joues délicates, une bouche souriante, des seins debout, des jointures fines et des extrémités exquises ; et, pour la célébrer en vers, je dirai :
« Elle s’avance vêtue de bleu, et telle qu’on la croirait un morceau détaché de l’azur des cieux.
Sur ses lèvres elle porte une ruche de miel, sur ses joues un parterre de roses, et sur son corps des corolles de jasmin.
À voir sa taille droite et fine et sa croupe monumentale, on la prendrait pour un roseau enfoncé dans un monticule de sable mouvant !
« Ainsi je la vois, ô ma maîtresse ! Mais il y a entre elle et mon épouse une différence que ma langue se refuse à exprimer ! »
Alors Nour Al-Houda fit signe à la vieille nourrice d’introduire sa seconde sœur. Et l’adolescente entra, vêtue d’une robe de soie couleur d’abricot. Et elle était encore plus belle que la première ; et elle s’appelait Fortune-de-la-Maison. Et sa sœur, après l’avoir embrassée, la fit asseoir à côté de la précédente, et demanda à Hassân s’il reconnaissait en elle son épouse. Et Hassân répondit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… et demanda à Hassân s’il reconnaissait en elle son épouse. Et Hassân répondit : « Ô ma souveraine, celle-ci ravit la raison de ceux qui la regardent, et enchaîne les cœurs de ceux qui l’approchent ; et voici les vers qu’elle m’inspire :
« La lune d’été au milieu d’une nuit d’hiver n’est point plus belle que ta venue, ô jeune fille !
Les nattes noires de tes cheveux, allongées jusqu’à tes chevilles, et les bandeaux ténébreux qui te ceignent le front, me font te dire :
« Tu assombris l’aurore avec l’aile de la nuit ! » Mais tu me réponds : « Non pas ! non pas ! simplement un nuage qui cache la lune ! »
« Ainsi je la vois, ô ma souveraine ! Mais il y a entre elle et mon épouse une différence que ma langue est impuissante à te dépeindre ! » Alors Nour Al-Houda fit signe à la Mère-des-Lances, qui se hâta d’introduire la troisième sœur. Et l’adolescente entra vêtue d’une robe de soie grenat ; et elle était encore plus belle que les deux premières, et s’appelait Lueur-Nocturne. Et sa sœur, après l’avoir embrassée, la fit asseoir à côté de la précédente, et demanda à Hassân s’il reconnaissait en elle son épouse. Et Hassân répondit : « Ô ma reine et la couronne sur ma tête, certes ! celle-ci fait s’envoler la raison des plus sages, et mon émerveillement à son sujet me fait improviser ces vers :
« Tu te balances, ô pleine de grâce, légère comme la gazelle, et tes paupières, à chaque mouvement, lancent les flèches mortelles.
Ô soleil de beauté ! ton apparition remplit de gloire les cieux et les terres, et ta disparition étend les ténèbres sur la face de l’univers.
« Ainsi je la vois, ô reine du temps ! Mais tout de même mon âme se refuse à reconnaître en elle mon épouse, malgré la ressemblance extrême des traits et de la démarche ! » Alors la vieille amazone, sur un signe de Nour Al-Houda, introduisit la quatrième sœur, qui s’appelait Pureté-du-Ciel. Et l’adolescente était vêtue d’une robe de soie jaune, avec des dessins en large et en long. Et elle embrassa sa sœur, qui la fit asseoir à côté des autres. Et Hassân, en la voyant, improvisa ces vers :
« Elle apparaît comme la pleine lune dans une nuit heureuse, et ses regards magiques éclairent notre chemin.
Si je m’approche d’elle pour me réchauffer sous le feu de ses yeux, je suis aussitôt repoussé par les sentinelles qui la défendent, ses deux seins tendus et durs comme la pierre de granit.
« Et je ne la dépeins pas tout entière, ce qui demanderait une ode de longue haleine. Pourtant, ô ma maîtresse, je dois te dire qu’elle n’est pas mon épouse, bien que la ressemblance soit frappante en bien des choses ! » Alors Nour Al-Houda fit entrer sa cinquième sœur, qui s’appelait Blanche-Aurore, et qui s’avança en mouvant ses hanches ; et elle était aussi souple qu’un rameau de bân et aussi légère qu’un jeune faon. Et, après avoir embrassé sa grande sœur, elle s’assit à la place qui lui fut assignée, à côté des autres, et arrangea les plis de sa robe de soie verte ouvragée d’or. Et Hassân, en la voyant, improvisa ces vers :
« La fleur rouge de la grenade n’est pas mieux voilée de ses feuilles vertes, ô jeune fille, que tu n’es vêtue de cette chemise charmante.
Et si je te demande : « Quel est ce vêtement qui va si bien à tes joues solaires ? » Tu me réponds : « Il n’a point de nom, car c’est ma chemise ! »
Et moi je m’écrie : « Ô sa merveilleuse chemise, cause de tant de blessures mortelles, je t’appellerai : la chemise crève-cœur !
N’es-tu pas toi-même plus merveilleuse encore, ô jouvencelle ? Si tu te lèves dans ta beauté pour éblouir les yeux humains, tes hanches te disent : « Reste ! reste ! Ce qui nous suit est trop lourd pour nos forces ! »
Et si je m’avance alors, en t’implorant ardemment, ta beauté me dit ; « Fais-le ! fais-le ! » Mais, comme je m’apprête, ta pudeur me dit : « Non pas ! non pas ! »
Lorsque Hassân eut récité ces vers, toute l’assistance fut émerveillée de son talent ; et la reine elle-même, malgré son ressentiment, ne put s’empêcher de lui marquer son admiration. Aussi la vieille amazone, protectrice de Hassân, profita-t-elle de la bonne tournure que prenait l’affaire pour essayer de remettre Hassân dans les bonnes grâces de la vindicative princesse, et lui dit : « Ô ma souveraine, t’avais-je trompée en te parlant de l’art admirable de ce jeune homme dans la construction des vers ? Et n’est-il point délicat et discret dans ses improvisations ? Je te prie donc de tout à fait oublier l’audace de son entreprise, et de l’attacher désormais à ta personne comme poète, en utilisant son talent pour les fêtes et les occasions solennelles ! » Mais la reine répondit : « Oui ! mais je voudrais d’abord en finir
avec l’épreuve ! Fais vite entrer ma plus jeune sœur…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT TREIZIÉME NUIT
Elle dit :
« … Oui ! mais je voudrais d’abord en finir avec l’épreuve ! Fais vite entrer ma plus jeune sœur ! » Et la vieille sortit, et, un instant après, rentra, tenant par la main l’adolescente la plus jeune, celle que l’on nommait Ornement-du-Monde, et qui n’était autre que Splendeur !
Ainsi tu entras, ô Splendeur, et tu étais vêtue de ta seule beauté, dédaigneuse des parures et des voiles menteurs ! Mais quelle destinée pleine de calamités accompagnait tes pas ! Tu l’ignorais, ne sachant encore tout ce qui avait été écrit à ton sujet dans le livre du sort !
Lorsque Hassân, qui était debout au milieu de la salle, vit arriver Splendeur, il poussa un grand cri et tomba par terre, privé de sentiment. Et Splendeur, en entendant ce cri, se retourna et reconnut Hassân. Et, saisie de voir son époux qu’elle croyait si loin, elle s’affaissa tout de son long, en répondant par un autre cri, et perdit connaissance.
À cette vue, la reine Nour Al-Houda ne douta pas un instant que ce ne fût cette sœur-là qui était devenue l’épouse de Hassân, et ne put dissimuler plus longtemps sa jalousie et sa fureur. Et elle cria à ses amazones : « Ramassez cet adamite, et allez le jeter hors de la ville ! » Et les gardes exécutèrent l’ordre, et emportèrent Hassân et allèrent le jeter sur le rivage, hors de la ville. Puis la reine se tourna vers sa sœur, qu’on avait fait revenir de son évanouissement, et lui cria : « Ô débauchée ! comment as-tu fait pour connaître cet adamite ? Et quelle conduite criminelle tu as eue, de toutes les manières ! Tu t’es non seulement mariée sans le consentement de ton père et de ta famille, mais tu as encore abandonné ton époux et quitté ta maison ! Et tu as de la sorte avili ta race et la noblesse de ta race ! Or, cette ignominie ne peut se laver que dans ton sang ! » Et elle cria à ses femmes : « Apportez une échelle, et attachez-y cette criminelle par ses longs cheveux, et frappez-la de verges jusqu’au sang ! » Puis elle sortit avec ses sœurs de la salle des audiences, et alla dans sa chambre écrire au roi son père une lettre, dans laquelle elle lui apprenait, dans tous ses détails connus, l’histoire de Hassân avec sa sœur, et lui apprenait, en même temps que la honte qui rejaillissait sur toute la race des genn, le châtiment qu’elle avait cru devoir infliger à la coupable. Et elle termina sa lettre en demandant à son père de lui répondre au plus tôt pour lui dire son avis sur la punition définitive à infliger à la fille criminelle. Et elle confia la lettre à une rapide messagère, qui se hâta d’aller la porter au roi.
Lorsque le roi lut la lettre de Nour Al-Houda, il vit le monde noircir devant ses yeux et, indigné à la limite de l’indignation de la conduite de sa plus jeune fille, il répondit à sa fille aînée que toute punition serait légère en comparaison du forfait, et qu’il fallait mettre à mort la coupable, mais qu’il abandonnait tout de même le soin d’exécuter cet ordre à sa sagesse et à sa justice.
Or, pendant que Splendeur, livrée de la sorte entre les mains de sa sœur, gémissait attachée par les cheveux sur l’échelle, et attendait le supplice, Hassân, qui avait été jeté sur la plage, finit par revenir de son évanouissement, mais ce fut pour penser à la gravité de son malheur, dont il ne soupçonnait point d’ailleurs toute l’étendue. Que pouvait-il encore espérer ? Maintenant que nulle puissance ne pouvait le secourir, que pouvait-il tenter, et comment essaierait-il de sortir de cette île maudite ? Et il se leva, en proie au désespoir, et se mit à errer le long de la mer, espérant encore trouver quelque remède à ses maux. Et c’est alors que lui vinrent à la mémoire ces vers du poète :
Quand tu n’étais qu’une germe dans le sein de ta mère, j’ai formé ta destinée dans le sens de Ma Justice et l’ai dirigée dans le sens de Ma Vision.
Laisse donc, ô créature, les événements suivre leur cours : tu ne peux t’y opposer.
Et si l’adversité fond sur la tête, laisse à ton destin le soin de l’en détourner.
Ce précepte de sagesse ranima quelque peu le courage de Hassân, qui continua à errer à l’aventure sur la plage, essayant de deviner ce qui avait pu arriver pendant son évanouissement, et pourquoi il avait été ainsi abandonné sur la grève. Et pendant qu’il réfléchissait de la sorte, il rencontra deux petites amazones d’une dizaine d’années, qui se battaient sur le sable à grands coups de poing. Et il vit, non loin d’elles, jeté par terre, un bonnet de cuir sur lequel étaient tracées des figures et des écritures. Et il s’approcha de ces petites filles, essaya de les séparer, et leur demanda la cause de leur querelle. Et elles lui dirent qu’elles se disputaient la possession de ce bonnet-là ! Alors Hassân leur demanda si elles voulaient le choisir pour arbitre et s’en rapporter à lui pour les mettre d’accord sur la possession de ce bonnet. Et, les petites filles ayant accepté, Hassân ramassa le bonnet et leur dit : « Eh bien ! je vais jeter une pierre en l’air, et celle d’entre vous deux qui me la rapportera aura le bonnet…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Eh bien ! je vais jeter une pierre en l’air, et celle d’entre vous deux qui me la rapportera aura le bonnet ! » Et les petites amazones dirent : « L’idée est excellente ! » Alors Hassân ramassa un galet de la grève et le lança au loin de toutes ses forces. Et, pendant que les fillettes couraient pour attraper le caillou, Hassân mit le bonnet sur sa tête, pour l’essayer, et l’y laissa. Or, au bout de quelques instants les petites filles revinrent, et, celle qui avait attrapé le caillou, criait : « Où es-tu, ô homme ? C’est moi qui ai gagné ! » Et elle arriva jusqu’à l’endroit où se tenait Hassân, et se mit à regarder de tous les côtés, sans voir Hassân. Et sa sœur également regardait autour d’elle dans toutes les directions, mais ne voyait pas Hassân. Et Hassân se demandait : « Elles ne sont pourtant pas aveugles, ces petites amazones ! Comment se fait-il alors qu’elles ne me voient pas ? » Et il leur cria : « Je suis là ! Arrivez donc ! » Et les petites filles regardèrent dans la direction d’où partait la voix, mais elles ne virent pas Hassân ; et elles eurent peur, et se mirent à pleurer. Et Hassân s’approcha d’elles et les toucha à l’épaule et leur dit : « Me voici ! Pourquoi pleurez-vous, mes petites ? » Et les fillettes levèrent la tête, mais ne virent pas Hassân. Et elles furent alors si terrifiées, qu’elles se mirent à courir de toutes leurs forces, en jetant de grands cris, comme si elles étaient poursuivies par quelque genni de la mauvaise espèce. Et Hassân alors se dit : « Il n’y a plus de doute ! Ce bonnet est enchanté ! Et son enchantement consiste à rendre invisible celui qui le porte sur la tête ! » Et il se mit à danser de joie, en se disant : « C’est Allah qui me l’envoie ! Car je vais pouvoir, ce bonnet sur la tête, courir revoir mon épouse, sans être vu par personne ! » Et il retourna aussitôt à la ville, et, pour mieux expérimenter les vertus de ce bonnet, il voulut en essayer l’effet devant la vieille amazone. Et il la chercha partout, et finit par la trouver dans une des chambres du palais, enchaînée, par ordre de la princesse, à un anneau enfoncé dans le mur. Alors, pour s’assurer si réellement il était invisible, il s’approcha d’une étagère sur laquelle étaient rangés des vases de porcelaine, et il fit tomber par terre le plus gros vase qui alla se briser aux pieds de la vieille. Et elle poussa alors un cri d’épouvante, croyant à quelque tour que lui jouait un des mauvais éfrits dévoués aux ordres de Nour Al-Houda. Et elle se mit en devoir de prononcer les formules conjuratoires, et dit : « Ô éfrit, je t’ordonne, par le nom gravé sur le sceau de Soleïmân, de me dire ton nom ! » Et Hassân répondit : « Je ne suis point un éfrit, mais ton protégé Hassân Al-Bassri ! Et je viens te délivrer ! » Et en disant ces mots, il ôta son bonnet magique et se fit voir et reconnaître ! Et la vieille s’écria : « Ah ! malheur à toi, infortuné Hassân ! ne sais-tu donc que la reine a déjà regretté de ne t’avoir pas fait donner la mort sous ses yeux, et qu’elle a envoyé ses esclaves de toutes parts à ta poursuite, en promettant un quintal d’or comme récompense à celui qui te rapporterait à elle, mort ou vivant ! Ne perds donc pas un instant, et sauve ta tête par la fuite ! » Puis elle mit Hassân au courant des supplices terribles que la reine préparait pour faire mourir sa sœur, avec l’assentiment du roi des genn. Mais Hassân répondit : « Allah la sauvera et nous sauvera tous d’entre les mains de cette cruelle princesse ! Regarde ce bonnet ! Il est enchanté ! Et c’est grâce à lui que je puis partout marcher invisible ! » Et la vieille s’écria : « Louanges à Allah, ô Hassân, qui ranime les ossements des morts, et qui t’a envoyé ce bonnet pour notre salut ! Hâte-toi de me délivrer, afin que je te montre le cachot où est enfermée ton épouse ! » Et Hassân coupa les liens de la vieille, et la prit par la main, et se couvrit la tête du bonnet enchanté. El aussitôt ils devinrent tous deux invisibles. Et la vieille le conduisit dans le cachot où gisait son épouse Splendeur attachée par les cheveux à une échelle, et attendant à chaque instant la mort dans les supplices. Et il l’entendit qui récitait à mi-voix ces vers :
« La nuit est obscure, et triste est ma solitude. Ô mes yeux, laissez couler la source de mes larmes. Mon bien-aimé est loin de moi ! D’où pourrait me venir l’espérance, alors que mon cœur et l’espérance sont partis avec lui.
Coulez, ô mes larmes, coulez de mes yeux ; mais, hélas ! réussirez-vous jamais à éteindre le feu qui dévore mes entrailles ?… Ô fugitif amant, ton image est ensevelie dans mon cœur, et les vers de la tombe eux-mêmes ne pourront l’effacer ! »
Et Hassân, bien qu’il eût souhaité ne point brusquer la reconnaissance afin d’éviter une émotion trop grande à son épouse, ne put, en entendant et en voyant sa bien-aimée Splendeur, résister plus longtemps aux tourments qui l’agitaient, et il enleva son bonnet et se précipita vers elle en l’entourant de ses bras. Et elle le reconnut, et s’évanouit contre sa poitrine. Et Hassân, aidé de la vieille, coupa ses liens, et la fit tout doucement revenir à elle, et la prit sur ses genoux en lui faisant de l’air avec la main. Et elle ouvrit les yeux, et, des larmes sur les joues, elle lui demanda : « Es-tu descendu du ciel, ou sorti du sein de la terre ? Ô mon époux, hélas ! hélas ! que pouvons-nous contre le destin ? Ce qui est écrit doit courir ! Hâte-toi donc, avant d’être découvert, de laisser ma destinée suivre sa voie, et retourne-t’en par où tu es venu, pour ne point me causer la douleur de te voir, toi aussi, victime de la cruauté de ma sœur ! « Mais Hassân répondit : « Ô bien-aimée, ô lumière de mes yeux, je suis venu pour te délivrer et t’emmener avec moi à Baghdad, loin de ce pays cruel ! » Mais elle s’écria : « Ah ! Hassân, quelle imprudence encore vas-tu commettre ? De grâce ! retire-toi, et n’ajoute pas encore à mes souffrances par les tiennes ! » Mais Hassân répondit : « Ô Splendeur, mon âme, sache que je ne sortirai de ce palais qu’avec toi et avec notre protectrice, la bonne tante que voici. Et si tu me demandes quel moyen je compte employer, je te montrerai ce bonnet…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
« … El si tu me demandes quel moyen je compte employer, je te montrerai ce bonnet ! » Et Hassân lui fit voir le bonnet enchanté, l’essaya devant elle, en disparaissant soudain dès qu’il l’eut mis sur la tête, puis lui raconta comment Allah l’avait jeté sur son chemin pour être la cause de leur délivrance ! Et Splendeur, les joues couvertes de larmes de joie et de repentir, dit à Hassân : « Ah ! tous les maux dont nous avons souffert viennent de ma faute à moi qui ai quitté notre demeure de Baghdad sans ta permission. Ô mon maître bien-aimé, épargne-moi, de grâce ! les reproches que je mérite, car je vois bien maintenant qu’une femme doit apprendre le prix de son époux ! Et pardonne-moi ma faute, dont j’implore la rémission devant Allah et devant toi ! Et excuse-moi un peu, vu que mon âme n’a pas su résister à l’émoi qui l’a remplie en revoyant le manteau de plumes ! » Et Hassân répondit : « Par Allah, ô Splendeur, c’est moi seul le coupable, moi qui t’avais laissée seule à Baghdad. J’aurais dû t’emmener avec moi chaque fois ! Mais à l’avenir il en sera ainsi, tu peux être tranquille ! » Et, ayant dit ces mois, il la prit sur son dos, prit également la main de la vieille, et se couvrit la tête du bonnet. Et ils devinrent invisibles tous les trois. Et ils sortirent du palais, et se dirigèrent en toute hâte vers la septième île, où étaient cachés leurs deux petits enfants, Nasser et Manssour.
Alors Hassân, bien qu’il fût à la limite de l’émotion de revoir ses deux enfants sains et saufs, ne voulut point perdre le temps en effusions de tendresse ; et il confia les deux petits à la vieille, qui les mit à califourchon chacun sur une épaule. Puis, sans être vue de personne, Splendeur réussit à prendre trois manteaux de plumes, tout neufs ; et ils s’en vêtirent. Puis ils se tinrent tous trois par la main et, quittant sans regret les îles Wak-Wak, ils s’envolèrent vers Baghdad.
Or, Allah leur écrivit la sécurité et, après un voyage par petites étapes, ils arrivèrent un matin dans la Ville de Paix. Et ils atterrirent sur la terrasse de leur demeure, et descendirent l’escalier et pénétrèrent dans la salle où se tenait la pauvre mère de Hassân, que les chagrins et les inquiétudes avaient depuis longtemps rendue infirme et presque aveugle. Et Hassân écouta un instant à la porte, et entendit à l’intérieur la pauvre femme qui gémissait et se désespérait. Alors il frappa, et la voix de la vieille demanda : « Qui est à la porte ? » Hassân répondit : « Ô ma mère, c’est le destin qui veut réparer ses rigueurs ! »
À ces mots, la mère de Hassân, ne sachant encore si c’était une illusion ou la réalité, courut sur ses pauvres jambes ouvrir la porte. Et elle vit son fils Hassân avec son épouse et ses enfants, et la vieille amazone qui restait derrière eux, discrètement. Et, l’émotion étant trop forte pour elle, elle tomba évanouie dans leurs bras. Et Hassân la fit revenir en la baignant de ses larmes, et la pressa tendrement sur son sein. Et Splendeur s’avança aussi vers elle et la combla de mille caresses, en lui demandant pardon de s’être laissé vaincre par son instinct originel. Puis ils firent avancer la Mère-des-Lances et la lui présentèrent comme leur protectrice et la cause de leur délivrance. Et alors Hassân raconta à sa mère toutes les aventures merveilleuses qui lui étaient arrivées, et qu’il est inutile de répéter. Et ils glorifièrent ensemble le Très-Haut qui avait permis leur réunion.
Et depuis lors ils vécurent tous ensemble dans la vie la plus délicieuse et la plus pleine de bonheur. Et chaque année ils ne manquèrent pas d’aller tous, en caravane, grâce au tambour magique, visiter les sept princesses, sœurs de Hassân, dans le palais au dôme vert, sur la Montagne-des-Nuages.
Et c’est ainsi, qu’après de très nombreuses années, vint les visiter la Destructrice inexorable des joies et des plaisirs ! Mais louanges et gloire à Celui qui domine l’empire du visible et de l’invisible, le Vivant, l’Éternel, qui ne connaît pas la mort !
— Lorsque Schahrazade eut raconté de la sorte cette histoire extraordinaire, la petite Doniazade sauta à son cou, et l’embrassa sur la bouche, et lui dit : « Ô ma sœur, que cette histoire est merveilleuse et pleine de goût, et qu’elle est charmante et délectable ! Ah ! combien j’aime Bouton-de-Rose, et comme je regrette que Hassân ne l’ait point prise comme épouse en même temps que Splendeur ! » Et le roi Schahriar dit : « Schahrazade, cette histoire est étonnante ! Et elle a failli me faire oublier bien des choses que je veux, dès demain, mettre à exécution ! » Et Schahrazade dit : « Oui, ô Roi, mais elle n’est rien, comparée à celle que je veux le raconter encore sur le Pet historique ! Et le roi Schahriar s’écria : « Que dis-tu, Schahrazade ? El quel est ce pet historique que je ne connais pas ? » Schahrazade dit : « C’est celui que je vais soumettre demain au Roi, si je suis encore en vie ! » Et le roi Schahriar se dit : « Certes ! je ne la tuerai que lorsqu’elle m’aura instruit au sujet de ce qu’elle dit ! » Et Schahrazade, à ce moment, vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA SIX CENT SEIZIÈME NUIT
Elle dit : « Cette anecdote nous est transmise, ô Roi Fortuné, par le diwan des gens hilares et incongrus. Et je ne veux point différer davantage de te la raconter ! » Et Schahrazade dit :
- ↑ Hassân : Beau.
- ↑ Le mot arabe Koss (le « Kussos » des Grecs) est composé de deux lettres dont la première, le Kaf, est représentée par 20, et la seconde, le Sin, par 60.
LE DIWAN DES GENS HILARES ET INCONGRUS
Il est raconté — mais Allah est plus savant — qu’il y avait dans la ville de Kaukabân, dans le Yamân, un Bédouin de la tribu des Fazli, appelé Aboul-Hossein, qui, depuis déjà de longues années, avait abandonné la vie des Bédouins, et était devenu un citadin distingué et un marchand d’entre les marchands les plus opulents. Et il s’était une première fois marié au temps de sa jeunesse, mais Allah avait appelé l’épouse dans Sa miséricorde, au bout d’un an de mariage. Aussi les amis d’Aboul-Hossein ne cessaient-ils de le presser au sujet d’un nouveau mariage, en lui répétant les paroles du poète :
Lève-toi, compagnon, et ne laisse pas s’écouler en vain la saison du printemps.
La jouvencelle est là ! Marie-toi ! Ne sais-tu qu’une femme dans la maison est un almanach excellent pour toute l’année ?
Et Aboul-Hossein à la fin, ne pouvant plus résister à toutes les sollicitations de ses amis, se décida à engager des pourparlers avec les vieilles femmes négociatrices des mariages ; et il finit par se marier avec une jouvencelle aussi belle que la lune quand elle brille sur la mer. Et, pour ses noces, il donna de grands festins auxquels il invita tous ses amis et connaissances, ainsi que les ulémas, les fakirs, les derviches, et les santons. Et il ouvrit toutes grandes les portes de sa maison, et il fit servir à ses invités des mets de toutes les espèces, et, entre autres choses, du riz de sept couleurs différentes, et des sorbets, et des agneaux farcis de noisettes, d’amandes, de pistaches et de raisins secs, et un jeune chameau rôti en entier et servi d’une seule pièce. Et tout le monde mangea et but et entra en joie, en allégresse et en contentement. Et l’épousée fut promenée et montrée en parade sept fois de suite, habillée chaque fois d’une robe différente plus belle que la précédente. Et on la promena même une huitième fois au milieu de l’assistance pour la satisfaction, des invités qui n’avaient pu suffisamment s’en rassasier les yeux. Après quoi les vieilles dames l’introduisirent dans la chambre nuptiale et la couchèrent sur un lit haut comme un trône, et la préparèrent de toutes les manières pour l’entrée de l’époux.
Alors, Aboul-Hossein, au milieu du cortège, pénétra chez l’épousée, lentement et avec dignité. Et il s’assit un instant sur le divan, pour se bien prouver à lui-même et montrer à son épouse et aux dames du cortège combien il était plein de tact et de mesure. Puis il se leva avec pondération, pour recevoir les vœux des dames et leur donner congé avant de s’approcher du lit où l’attendait modestement la jouvencelle, lorsque, voici ! il lâcha, ô calamité ! de son ventre qui était plein de viandes lourdes et de boissons, un pet bruyant à la limite du bruit, terrible et grand ! Éloigné soit le Malin !
À ce bruit, chaque dame se tourna vers sa voisine, en parlant à haute voix et faisant semblant de n’avoir rien entendu, et la jouvencelle également, au lieu de rire ou de se moquer, se mit à faire résonner ses bracelets. Mais Aboul-Hossein, confus à la limite de la confusion, prétexta un pressant besoin et, la honte dans le cœur, descendit dans la cour, sella sa jument, sauta sur son dos et, désertant sa maison et la noce et l’épousée, il s’enfuit à travers les ténèbres de la nuit. Et il sortit de la ville, et s’enfonça dans le désert. Et il arriva de la sorte au bord de la mer, où il vit un navire en partance pour l’Inde. Et il s’y embarqua et arriva sur la côte de Malabar.
Là, il fit la connaissance de plusieurs personnes originaires du Yamân, qui le recommandèrent au roi du pays. Et le roi lui donna une charge de confiance et le nomma capitaine de sa garde. Et il demeura en ce pays dix années, honoré et respecté, et dans la tranquillité d’une vie délicieuse. Et chaque fois que le souvenir du pet se présentait à sa mémoire, il le chassait comme on chasse les mauvaises odeurs.
Mais au bout de ces dix années, il fut pris de la tristesse du mal du pays natal ; et peu à peu il fut atteint de langueur ; et il soupirait sans cesse en pensant à sa maison et à sa ville ; et il faillit mourir de ce désir rentré. Mais un jour, ne pouvant plus résister aux sollicitations de son âme, il ne prit même pas le temps de demander congé au roi, et il s’évada et regagna le pays de Hadramont, dans le Yamân. Là, il se déguisa en derviche et gagna à pied la ville de Kaukabân ; et il arriva de la sorte, en taisant son nom et son cas, sur la colline qui dominait la ville. Et il vit, avec des yeux pleins de larmes, la terrasse de sa vieille maison et les terrasses avoisinantes, et il se dit : « Pourvu que personne ne me reconnaisse ! Fasse Allah qu’ils aient tous oublié mon histoire ! » Et, pensant ainsi, il descendit de la colline et prit des chemins détournés pour arriver à sa maison. Et, en route, il vit, assise sur le seuil de sa porte, une vieille femme qui enlevait les poux de la tête d’une petite fille de dix ans ; et la petite fille disait à la vieille : « Ô ma mère, je voudrais bien savoir mon âge, car une de mes compagnes veut tirer mon horoscope. Veux-tu donc me dire en quelle année je suis née ! » Et la vieille réfléchit un moment et répondit : « Tu es née, ô ma fille, exactement la nuit de l’année où Aboul-Hossein lâcha le pet ! »
Lorsque le malheureux Aboul-Hossein entendit ces paroles, il rebroussa chemin et se mit à courir, livrant ses jambes au vent. Et il se disait : « Voilà que ton pet est devenu une date dans les annales ! Et il se transmettra à travers les âges aussi longtemps que les fleurs naîtront sur les palmiers ! » Et il ne cessa de courir et de voyager qu’en arrivant dans le pays de l’Inde. Et il vécut avec amertume dans l’exil jusqu’à sa mort. Que sur lui soient la miséricorde d’Allah et sa pitié !
— Puis Schahrazade, cette nuit-là, dit encore :
Il m’est revenu également, ô Roi fortuné, qu’il y avait autrefois dans la ville de Damas, en Syrie, un homme réputé pour ses bons tours, ses drôleries et ses indélicatesses, et un autre au Caire, non moins fameux pour les mêmes qualités. Or le farceur de Damas, qui avait souvent entendu parler de son semblable du Caire, souhaitait fort le connaître, d’autant plus que ses clients habituels lui disaient sans cesse : « Il n’y a pas de doute ! l’Égyptien est certainement bien plus malin, plus intelligent, mieux doué et plus drôle que toi ! Et sa société est bien plus amusante que la tienne ! D’ailleurs, si tu ne veux pas nous croire, tu n’as qu’à aller le voir à l’œuvre, au Caire, et tu constateras sa supériorité ! » Et ils firent si bien que l’homme se dit : « Par Allah ! je vois qu’il ne me reste plus qu’à aller au Caire voir de mon œil ce que l’on dit à son sujet ! » Et il fit ses paquets et quitta Damas, sa ville, et partit pour le Caire où il arriva, avec l’assentiment d’Allah, en bonne santé. Et il s’informa, sans tarder, de la demeure de son rival, et alla lui rendre visite. Et il fut reçu avec tous les égards d’une large hospitalité, et honoré et hébergé, après les souhaits de bienvenue les plus cordiaux. Puis tous deux se mirent à se raconter mutuellement les affaires importantes du monde, et passèrent la nuit à s’entretenir agréablement.
Or, le lendemain, l’homme de Damas dit à l’homme du Caire : « Par Allah, ô compagnon, moi, je ne suis venu de Damas au Caire que pour juger avec mon œil des bons tours et des farces que tu joues sans cesse par la ville ! Et je voudrais ne retourner dans mon pays qu’enrichi d’instruction ! Voudrais-tu donc me rendre témoin de ce que je souhaite si ardemment voir ? « L’autre dit : « Par Allah ! ô compagnon, ceux qui l’ont parlé de moi t’ont sans doute trompé ! Moi, c’est à peine si je sais différencier ma main gauche d’avec ma main droite ! Comment donc saurais-je instruire dans la délicatesse et l’esprit un noble Damasquin comme toi ? Mais puisqu’il est de mon devoir d’hôte de te faire voir les belles choses de notre ville, sortons nous promener ! »
Il sortit donc avec lui et l’emmena, avant tout, voir la mosquée d’Al-Azhar, afin qu’il pût raconter aux habitants de Damas les merveilles de l’instruction et de la science. Et, en route, passant près des marchands de fleurs, il se composa un bouquet de fleurs, d’herbes aromatiques, d’œillets, de roses, de basilics, de jasmins, de branches de menthe et de marjolaine. Et ils arrivèrent ainsi tous deux à la mosquée, et pénétrèrent dans la cour. Or, en y entrant, ils aperçurent en face de la fontaine aux ablutions, accroupis dans les cabinets, des gens qui satisfaisaient de pressants besoins. Et l’homme du Caire dit à celui de Damas : « Eh bien, compagnon, toi, si tu avais à faire quelque plaisanterie à ces gens accroupis en file, comment t’y prendrais-tu…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Eh bien, compagnon, toi, si tu avais à faire quelque plaisanterie à ces gens accroupis en file, comment t’y prendrais-tu ? » L’autre répondit : « La chose est tout indiquée. J’irais derrière eux avec un balai d’épines, et, comme par inadvertance, tout en balayant, je leur piquerais le derrière ! » L’homme du Caire dit : « Le procédé, compagnon, est quelque peu lourd et grossier. Et c’est vraiment indélicat de faire de telles plaisanteries ! Voici ce que, moi, je ferais ! » Et, ayant ainsi parlé, il s’approcha d’un air aimable et engageant des gens accroupis dans les cabinets, et, à l’un après l’autre, il offrit une gerbe de fleurs, disant : « Avec ta permission, ô mon maître ! » Et chacun lui répondait, à la limite de la confusion et de la fureur : « Qu’Allah ruine ta maison, ô fils d’entremetteur ! Sommes-nous donc ici à un festin ? » Et tous les assistants assemblés dans la cour de la mosquée, en voyant la mine indignée des gens en question, riaient extrêmement.
Aussi, lorsque l’homme de Damas eut vu cela de ses propres yeux, il se tourna vers l’homme du Caire, et lui dit : « Par Allah, tu m’as vaincu, ô cheikh des farceurs ! Et le proverbe a raison qui dit : Fin comme l’Égyptien qui passe dans le trou de l’aiguille ! »
Puis Schahrazade, cette nuit-là, dit encore :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, que, dans une ville d’entre les villes, une jeune femme de haut rang, dont le mari s’absentait souvent en voyages proches et lointains, finit par ne plus résister aux sollicitations de son tourment et se choisit, comme baume cal- mant, un jouvenceau qui n’avait pas son pareil parmi les jouvenceaux du temps. Et tous deux s’aimèrent d’un amour extraordinaire ; et ils se satisfaisaient mutuellement en toute joie et toute tranquillité, se levant pour manger, mangeant pour se coucher, et se couchant pour copuler. Et ils vécurent en cet état un long espace de temps.
Or, un jour, le jouvenceau fut sollicité de travers par un cheikh à barbe blanche, un perfide dédoublé, semblable au couteau du vendeur de colocases. Mais il ne voulut point se prêter à ce que l’autre lui demandait, et, se prenant de querelle avec lui, il lui donna de grands coups sur la figure et lui arracha sa barbe de confusion. Et le cheikh alla se plaindre au wali de la ville du mauvais traitement qu’il venait de subir ; et le wali fit saisir et jeter en prison le jouvenceau.
Sur ces entrefaites, la jeune femme apprit ce qui venait d’arriver à son amoureux, et, de le savoir en prison, elle conçut un très violent chagrin. Aussi elle ne tarda pas à arrêter son plan pour délivrer son ami, et, s’ornant de ses plus beaux atours, elle alla au palais du wali, sollicita l’audience et fut introduite dans la salle des requêtes. Or, par Allah ! rien qu’en se montrant ainsi dans sa souplesse, elle pouvait d’avance obtenir le gain de toutes les requêtes de la terre en large et en long. En effet, après les salams, elle dit au wali : « Ô notre seigneur le wali, le jouvenceau Tel, que tu as fait mettre en prison, est mon propre frère, et le seul soutien de ma maison. Et il a été calomnié par les témoins du cheikh et par le cheikh lui-même qui est un perfide, un débauché. Je viens donc solliciter de ta justice son élargissement, sans quoi ma maison va tomber en ruines ; et moi je mourrai de faim ! » Or, dès que le wali eut vu l’adolescente, son cœur travailla beaucoup à son sujet ; et il en tomba amoureux ; et il lui dit : « Certes ! je suis disposé à élargir ton frère ! Mais, auparavant, entre dans le harem de ma maison, et je viendrai te retrouver à la fin des audiences, pour causer avec toi de la chose ! » Mais elle, comprenant ce qu’il lui voulait, se dit : « Par Allah ! ô barbe de poix, tu ne me toucheras qu’au temps des abricots ! » Et elle répondit : « Ô notre seigneur le wali, il est préférable que tu viennes toi-même dans ma maison, où nous aurons tout loisir de causer de la chose avec plus de tranquillité qu’ici, où je ne suis qu’une étrangère ! » Et le wali, à la limite de la joie, lui demanda : « Et où se trouve ta maison ? » Elle dit : « Dans tel endroit ! El je t’y attendrai ce soir au coucher du soleil » Et elle sortit de chez le wali, qu’elle laissa plongé dans une mer agitée, et alla trouver le kâdi de la ville.
Elle entra donc chez le kâdi, qui était un homme d’âge, et lui dit : « Ô notre maître le kâdi ! » Il dit : « Oui ! » Elle continua : « Je te supplie de jeter tes regards sur mon cas, et Allah t’en saura gré ! » Il demanda : « Qui t’a opprimée ? » Elle répondit : « Un cheikh perfide qui, grâce à ses faux témoins, a réussi à faire emprisonner mon frère, le seul soutien de ma maison. Et je viens te prier d’intercéder auprès du wali, pour qu’il fasse relâcher mon frère ! » Or, lorsque le kâdi vit et entendit l’adolescente, il en tomba éperdument amoureux, et lui dit : « Certes ! je veux bien m’occuper de ton frère. Mais commence par entrer dans le harem, pour attendre mon arrivée. Et alors nous causerons de la chose. Et tout arrivera selon ton désir ! » Et l’adolescente se dit : « Ah ! fils de l’entremetteur, tu m’auras au temps des abricots ! » Et elle répondit : « Ô notre maître, il vaut mieux que j’aille t’attendre dans ma maison, où nul ne nous dérangera ! » Il demanda : « Et où se trouve ta maison ? » Elle dit : « Dans tel endroit ! Et je t’y attends pour ce soir même, après le coucher du soleil ! » Et elle sortit de chez le kâdi et alla trouver le vizir du roi.
Lorsqu’elle fut devant le vizir, elle lui raconta l’emprisonnement du jouvenceau, qu’elle disait être son frère, et le supplia de donner l’ordre de le faire élargir. Et le vizir lui dit : « Il n’y a pas d’inconvénient ! Mais, en attendant, entre dans le harem où j’irai te rejoindre, pour causer de l’affaire ! » Elle dit : « Par la vie de ta tête, ô notre maître, je suis fort timide, et je ne saurais même pas me diriger dans le harem de ta seigneurie. Mais ma maison convient mieux aux causeries de cette nature, et je t’y attendrai ce soir même, une heure après le coucher du soleil ! » Et elle lui indiqua l’endroit où était située sa maison, et sortit de chez lui pour aller au palais trouver le roi de la ville.
Or, lorsqu’elle fut entrée dans la salle du trône, le roi, émerveillé de sa beauté, se dit : « Par Allah ! quel morceau à s’appliquer tout chaud à jeun ! » Et il lui demanda : « Qui t’a opprimée ? » Elle dit : « Je ne suis point opprimée, puisqu’il y a la justice du roi ! » Il dit : « Allah est le seul juste ! Mais que puis-je faire pour toi ? » Elle dit : « Donner l’ordre de faire élargir mon frère emprisonné injustement ! » Il dit : « La chose est aisée ! Va, ma fille, m’attendre dans le harem ! Et il n’arrivera que ce qui peut te convenir ! » Elle dit : « Dans ce cas, ô roi, j’irai plutôt t’attendre dans ma maison. Car notre roi sait que pour ces sortes de choses-là, une grande préparation est nécessaire, en fait de bain, de propreté et autres choses semblables. Et tout cela je ne puis le bien faire que dans ma propre maison, qui, d’être foulée par les pas de notre roi, sera à jamais honorée et bénie ! » Le roi dit : « Qu’il en soit donc ainsi ! » Et tous deux tombèrent d’accord sur l’heure et le lieu de la rencontre. Et l’adolescente sortit du palais et alla trouver un menuisier…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
… Et l’adolescente sortit du palais et alla trouver un menuisier auquel elle dit : « Tu vas m’envoyer ce soir à la maison une grande armoire à quatre étages superposés, et dont chaque étage aura une porte indépendante fermant solidement avec un cadenas ! » Le menuisier répondit : « Par Allah ! ô ma maîtresse, la chose n’est pas faisable d’ici ce soir ! » Elle dit : « Je te paierai tout ce que tu voudras ! » Il dit : « Dans ce cas, elle sera prête. Mais, comme prix, je ne demande de toi ni or ni argent, ô ma maîtresse, mais seulement ce que tu sais ! Entre donc dans la pièce du fond, afin que je puisse causer avec toi ! » À ces paroles du menuisier l’adolescente répondit : « Ô menuisier de bénédiction, quel homme sans tact tu es ! Par Allah ! est-ce que cette misérable pièce du fond de ta boutique peut convenir à une causerie du genre de celle que tu voudrais causer ? Viens plutôt ce soir dans ma maison, une fois que tu auras envoyé l’armoire, et tu me verras prête à causer avec toi jusqu’au matin ! » Et le menuisier répondit : « De tout cœur amical et comme hommages dus ! » Et l’adolescente continua : « Oui ! mais ce n’est plus une armoire à quatre étages qu’il te faudra faire, mais une à cinq ! Car c’est bien à cinq étages qu’il me la faut, pour y serrer tout ce que j’ai à serrer ! » Et, après lui avoir donné son adresse, elle le quitta et rentra chez elle.
Là, elle sortit d’un coffre cinq robes de formes et de couleurs différentes, les rangea soigneusement, et fit apprêter les mets et les boissons, et ranger les fleurs et brûler les parfums. Et elle attendit de la sorte l’arrivée de ses invités.
Or, vers le soir, les portefaix du menuisier apportèrent l’armoire en question ; et l’adolescente la fit placer dans la salle de réunion. Puis elle congédia les portefaix, et, avant qu’elle eût le temps d’essayer les cadenas de l’armoire, on frappa à la porte. Et, bientôt après, le premier des invités entra, qui était le wali de la ville. Et elle se leva en son honneur, et embrassa la terre entre ses mains et le fit asseoir, et lui présenta les rafraîchissements. Puis elle se mit à couler de son côté des yeux longs d’un empan, et à lui lancer des regards brûlants, si bien que le wali se leva sur son séant, et, avec force gestes et tremblements, voulut la posséder à l’instant. Mais l’adolescente, se désenlaçant, lui dit : « Ô mon maître, que tu manques de raffinement ! Commence d’abord par te déshabiller pour être libre de tes mouvements ! » Et le wali dit : « Il n’y a pas d’inconvénient ! » Et il enleva ses vêtements. Et elle lui présenta, comme on fait d’ordinaire dans les festins des libertins, à la place de ses habits de couleur sombre, une robe de soie jaune et de forme extraordinaire, et un bonnet de la même couleur. Et le wali s’affubla de la robe jaune et du bonnet jaune, et s’apprêta à s’amuser. Mais, au même moment, on frappa à la porte, avec violence. Et le wali demanda, fort désappointé : « Attends-tu quelque voisine ou quelque pourvoyeuse ? » Elle répondit, terrifiée : « Non, par Allah ! mais j’avais oublié que mon époux revenait ce soir même de voyage ! Et c’est lui-même qui frappe à la porte en ce moment ! » Il demanda : « Et alors, moi, que vais-je devenir ? El que me faut-il faire ? » Elle dit : « Il n’y a pour toi qu’un moyen de salut, c’est d’entrer dans cette armoire ! » Et elle ouvrit la porte du premier étage de l’armoire, et dit au wali : « Entre là-dedans ! » Il dit : « Et comment m’y prendrais-je ? » Elle dit : « En t’y accroupissant ! » Et le wali, ployé en deux, entra dans l’armoire, et s’y accroupit. Et l’adolescente ferma la porte à clef, et alla ouvrir à celui qui frappait.
Or c’était le kâdi. Et elle le reçut comme elle avait reçu le wali, et, au moment qu’il fallait, l’affubla d’une robe rouge de forme extraordinaire, et d’un bonnet de la même couleur ; et, comme il voulait foncer sur elle, elle lui dit : « Non, par Allah ! pas avant que tu m’aies écrit un billet pour ordonner l’élargissement de mon frère ! » Et le kâdi lui écrivit le billet en question, et le lui remit au moment même où l’on entendit frapper à la porte. Et l’adolescente, d’un air terrifié, cria : « C’est mon époux qui revient de voyage ! » et fit grimper le kâdi dans le second étage de l’armoire, et alla ouvrir à celui qui frappait à la porte de la maison.
Et c’était précisément le vizir. Et il lui arriva ce qui était arrivé aux deux autres ; et, affublé d’une robe verte et d’un bonnet vert, il fut poussé dans le troisième étage de l’armoire, au moment où arrivait à son tour le roi de la ville. Et le roi, de la même façon, fut affublé d’une robe bleue et d’un bonnet bleu, et, au moment où il voulait faire ce pour quoi il était venu, la porte résonna, et, devant la terreur de l’adolescente, il fut bien obligé de grimper dans le quatrième étage de l’armoire, où il s’accroupit dans une position fort pénible, vu qu’il était bien dodu.
Alors entra le menuisier, avec des yeux dévorateurs et, pour prix de l’armoire, il voulut immédiatement foncer sur l’adolescente. Mais elle lui dit : « Ô menuisier, pourquoi as-tu fait si petit le cinquième étage de l’armoire ! c’est à peine si on peut y enfermer le contenu d’un petit coffre ! » Il dit : « Par Allah ! cet étage-là peut me contenir et quatre autres encore plus gros que moi ! » Elle dit : « Essaie, pour voir, d’y entrer ! « Et le menuisier, grimpant sur des tabourets superposés, pénétra dans le cinquième étage, où aussitôt il fut enfermé à clef.
Aussitôt l’adolescente, prenant le billet que lui avait donné le kâdi, s’en fut trouver les gardiens de la prison, qui, sur le vu du cachet apposé au bas de l’écriture, relâchèrent le jouvenceau. Alors elle et lui regagnèrent la maison en grande hâte et, dans la joie de fêter leur réunion, ils copulèrent ferme et longtemps, avec beaucoup de bruit et de halètements. Et, au dedans de l’armoire, les cinq enfermés entendaient tout cela, mais n’osaient et ne pouvaient bouger. Et, accroupis les uns au-dessus des autres dans les étages, ils ne savaient quand ils allaient pouvoir être délivrés.
Or, lorsque l’adolescente et le jouvenceau eurent fini leurs ébats, ils ramassèrent dans la maison tout ce qu’ils purent ramasser en fait de choses précieuses, enfermèrent cela dans des coffres, vendirent tout le reste, et quittèrent cette ville-là pour une autre ville et un autre royaume. Et voilà pour eux !
Mais pour ce qui est des cinq, voici ! Au bout de deux jours qu’ils étaient là, ils furent pris tous les cinq d’un pressant besoin de pisser. Et le premier qui pissa fut le menuisier. Et, pissant ainsi, l’urine tomba sur la tête du roi. Et le roi, au même moment, pissa sur la tête de son vizir, qui pissa sur la tête du kâdi, lequel pissa sur la tête du wali. Alors tous élevèrent la voix, excepté le roi et le menuisier, en criant : « Ô souillure ! » Et le kâdi reconnut la voix du vizir, lequel reconnut la voix du kâdi. Et ils se dirent les uns les autres : « Nous voici tombés dans le piège ! Heureusement que le roi a été épargné ! » Mais, à ce moment, le roi, qui s’était tu par dignité, leur cria : » Taisez-vous donc ! Je suis là ! Et je ne sais pas quel est celui qui a pissé sur ma tête ! » Alors le menuisier s’écria : « Qu’Allah hausse la dignité du roi ! Je crois bien que c’est moi ! Car je suis au cinquième étage ! » Puis il ajouta : « Par Allah ! c’est moi qui suis la cause de tout cela, car l’armoire est mon ouvrage ! »
Sur ces entrefaites, l’époux de l’adolescente revint de voyage ; et les voisins, qui ne s’étaient pas aperçus du départ de l’adolescente, le virent arriver et frapper à sa porte inutilement. Et il leur demanda pourquoi personne ne lui répondait de l’intérieur. Et ils ne surent le renseigner à ce sujet. Alors tous ensemble, à bout d’attente, enfoncèrent la porte et pénétrèrent à l’intérieur ; mais ils virent la maison vide, et n’ayant pour tout meuble que l’armoire en question. Et ils entendirent à l’intérieur de l’armoire des voix d’hommes. Et ils ne doutèrent pas que l’armoire ne fût habitée par les genn…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ils entendirent à l’intérieur des voix d’hommes. Et ils ne doutèrent pas que l’armoire ne fût habitée par les genn. Et ils proposèrent, à haute voix, de mettre le feu à l’armoire et de la brûler avec ceux qu’elle pouvait contenir. Et, comme ils allaient mettre leur projet à exécution, la voix du kâdi se fit entendre du fond de l’armoire, criant : « Arrêtez, ô bonnes gens ! Nous ne sommes ni des genn ni des voleurs. Mais nous sommes Tel et Tel ! » Et, en quelques mots, il les mit au courant de la ruse dont ils avaient été tous victimes. Alors les voisins, avec l’époux en tête, brisèrent les cadenas et délivrèrent les cinq enfermés, qu’ils trouvèrent affublés des habits étranges que leur avait fait endosser l’adolescente. Et, à cette vue, nul ne put s’empêcher de rire de l’aventure. Et le roi, pour consoler l’époux du départ de sa femme, lui dit : « Je te nomme mon second vizir ! » Et telle est cette histoire. Mais Allah est plus savant !
Et Schahrazade, ayant ainsi parlé, dit au roi Schahriar : « Mais ne crois point, ô Roi, que tout cela soit comparable à l’histoire du Dormeur éveillé ! » Et, comme le roi Schahriar rapprochait ses sourcils à ce titre qui lui était inconnu, Schahrazade, sans tarder davantage, dit :
HISTOIRE DU DORMEUR ÉVEILLÉ
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait autrefois à Baghdad, au temps du khalifat Haroun Al-Rachid, un jeune homme célibataire, appelé Aboul-Hassân, qui menait une vie bien étrange et bien extraordinaire. En effet, ses voisins ne le voyaient jamais fréquenter deux jours de suite la même personne ni inviter chez lui un habitant de Baghdad ; car tous ceux qui venaient chez lui étaient des étrangers. Aussi les gens de son quartier, ne comprenant point ce qu’il pouvait bien faire, l’avaient-ils surnommé Aboul-Hassân le Débauché.
Tous les soirs il avait coutume d’aller se poster au bout du pont de Baghdad, et là il attendait qu’un étranger vînt à passer ; et dès qu’il en apercevait un, fût-il riche ou pauvre, jeune ou vieux, il s’avançait vers lui, souriant et plein d’urbanité, et, après les salam et les souhaits de bienvenue, il l’invitait à accepter l’hospitalité de sa maison pour sa première nuit de séjour à Baghdad. Et il l’emmenait chez lui, et l’hébergeait le mieux qu’il pouvait ; et comme il était fort jovial et de caractère plaisant, il lui tenait compagnie toute la nuit et n’épargnait rien pour lui donner la meilleure idée de sa générosité. Mais le lendemain il lui disait : « Ô mon hôte, sache que si je t’ai invité chez moi, alors que dans cette ville Allah seul te connaissait, c’est que j’avais des raisons qui me poussaient à agir de la sorte. Mais j’ai fait le serment de ne jamais fréquenter deux jours de suite le même étranger, fût-il le plus charmant et le plus délicieux d’entre les fils des hommes. Ainsi donc me voici obligé de me séparer de toi ; et même je te prie, si jamais tu me rencontres dans les rues de Baghdad, de faire semblant de ne pas me reconnaître, pour ne point m’obliger à me détourner de toi ! » Et, ayant ainsi parlé, Aboul-Hassân conduisait son hôte à quelque khân de la ville, lui donnait tous les renseignements dont il pouvait avoir besoin, prenait congé de lui et ne le revoyait plus. Et si, par hasard, il lui arrivait plus tard de rencontrer dans les souks un des étrangers qu’il avait reçus chez lui, il feignait de ne pas le reconnaître, ou même il tournait la tête d’un autre côté, pour n’être point obligé de l’aborder ou de le saluer. Et il continua à agir de la sorte, sans jamais manquer un seul soir d’amener à sa maison un nouvel étranger.
Or, un soir, vers le coucher du soleil, comme il était assis, selon son habitude, au bout du pont de Baghdad, à attendre l’arrivée de quelque étranger, il vit s’avancer de son côté un riche marchand vêtu à la manière des marchands de Mossoul, et suivi d’un esclave de haute taille et d’aspect imposant. Or c’était le khalifat Haroun Al-Rachid lui-même, déguisé, comme il avait l’habitude de faire tous les mois, afin de voir et d’examiner avec ses propres yeux ce qui se passait dans Baghdad. Et Aboul-Hassân, en le voyant, fut loin de deviner qui il était ; et il se leva de l’endroit où il était assis et s’avança vers lui et, après le salam le plus gracieux et le souhait de bienvenue, il lui dit : « Ô mon maître, bénie soit ton arrivée parmi nous ! Fais-moi la grâce d’accepter pour cette nuit mon hospitalité, au lieu d’aller dormir au khân. Et demain matin il sera temps pour toi de chercher à ton aise un logement ! » Et, pour le décider à accepter son offre, il lui raconta, en quelques mots, qu’il avait depuis longtemps l’habitude de donner l’hospitalité pour une nuit seulement au premier étranger qu’il voyait passer sur le pont. Puis il ajouta : « Allah est généreux, ô mon maître ! Dans ma maison tu trouveras large hospitalité, pain chaud et vin clarifié ! »
Lorsque le khalifat eut entendu les paroles d’Aboul-Hassân, il trouva l’aventure si étrange et Aboul-Hassân si singulier, qu’il n’hésita pas un instant à satisfaire son envie de le connaître. Aussi, après s’être laissé prier un moment, pour la forme seulement et pour n’avoir pas l’air d’être un homme mal élevé, il accepta l’offre en disant : « Sur ma tête et sur mon œil ! qu’Allah augmente ses bienfaits sur toi, ô mon maître. Me voici prêt à te suivre ! » Et Aboul-Hassân montra le chemin à son hôte et l’emmena à sa maison, tout en causant avec lui fort agréablement.
Or, la mère de Hassân, ce soir-là, avait préparé une cuisine excellente. Elle leur servit d’abord des galettes grillées au beurre et farcies de viande hachée et de pépins de pin, puis un chapon bien gras, cantonné au milieu de quatre gros poulets, puis une oie farcie de raisins secs et de pistaches, et enfin un ragoût de pigeons. Et tout cela, en vérité, était exquis au goût et agréable à la vue…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Et tout cela, en vérité, était exquis au goût et agréable à la vue. Aussi tous deux, s’étant assis devant les plateaux, mangèrent de grand appétit ; et Aboul-Hassân choisissait, pour les donner à son hôte, les morceaux les plus délicats. Puis, quand ils eurent achevé de manger, l’esclave leur présenta l’aiguière et le bassin ; et ils se lavèrent les mains, tandis que la mère de Hassân enlevait les plateaux des mets pour servir les plateaux des fruits, remplis de raisins, de dattes et de poires, ainsi que d’autres plateaux où étaient les pots remplis de confitures, de pâtes d’amandes et de toutes sortes de choses délicieuses. Et ils mangèrent jusqu’à satiété, pour ensuite commencer à boire.
Alors Aboul-Hassân remplit de vin la coupe du festin et, la tenant en main, se tourna vers son hôte et lui dit : « Ô mon hôte, tu sais que le coq ne boit jamais avant qu’il ait, par de petits cris, appelé les poules pour venir boire avec lui. Or, moi, si je devais porter cette coupe à mes lèvres pour boire tout seul, la boisson s’arrêterait dans mon gosier, et sûrement je mourrais. Je te prie donc, pour cette nuit, de laisser la sobriété aux gens d’humeur chagrine, et de chercher avec moi la joie au fond de la coupe. Car, moi, en vérité, ô mon hôte, ma félicité est à sa limite extrême d’avoir dans ma maison un aussi honorable personnage que toi ! » Et le khalifat, qui ne voulait point le désobliger, et qui désirait en outre le faire parler, ne refusa point la coupe et se mit à boire avec lui. Et lorsque le vin eut commencé à alléger leurs âmes, le khalifat dit à Aboul-Hassân : « Ô mon maître, maintenant qu’entre nous il y a eu le pain et le sel, voudrais-tu me dire la cause qui te fait ainsi agir avec les étrangers que tu ne connais pas, et me raconter, afin que je l’entende, ton histoire qui doit être étonnante ? » Et Aboul-Hassân répondit : « Sache, ô mon hôte, que mon histoire n’est point étonnante, mais instructive seulement. Je m’appelle Aboul-Hassân, et suis le fils d’un marchand qui, à sa mort, me laissa de quoi vivre en toute aisance à Baghdad, notre ville. Or, moi, comme j’avais été tenu très sévèrement du vivant de mon père, je me hâtai de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour, en peu de temps, regagner le temps perdu pour ma jeunesse. Mais, comme de ma nature j’étais doué de réflexion, je pris la précaution de partager mon héritage en deux parts, une que je réalisai en or, et une que je conservai en fonds. Et je pris l’or réalisé avec la première part, et me mis à le dépenser, la paume ouverte, dans la société des adolescents de mon âge que je régalais et entretenais pour mon plaisir avec une largesse et une générosité d’émir. Et je n’épargnai rien pour que notre vie fût pleine de délices et d’agrément. Or, en agissant de la sorte, je trouvai qu’au bout d’une année il ne me restait plus un seul dinar au fond de la cassette, et je me tournai vers mes amis, mais ils avaient disparu. Alors je me mis à leur recherche, et leur demandai à mon tour de m’aider dans la situation pénible où je me voyais. Mais tous, l’un après l’autre, me donnèrent un prétexte qui les empêchait de me venir en aide, et nul d’entre eux ne consentit à m’offrir de quoi vivre, ne fût-ce qu’un seul jour. Alors moi je rentrai en moi-même, et compris combien mon défunt père avait eu raison de m’élever dans la sévérité. Et je revins à ma maison, et me mis à réfléchir sur ce qu’il me restait à faire. Et c’est alors que je m’arrêtai à une résolution que depuis lors je tins sans faiblir. Je jurai, en effet, devant Allah de ne jamais plus fréquenter les gens de mon pays, et de n’hospitaliser dans ma maison que les étrangers ; mais, en outre, l’expérience m’apprit que l’amitié courte et chaude était de beaucoup préférable à l’amitié longue et qui finit mal, et je fis le serment de ne jamais fréquenter deux jours de suite le même étranger invité dans ma maison, fût-il le plus charmant et le plus délicieux d’entre les fils des hommes ! Car j’avais bien senti combien étaient cruels les liens de l’attachement, et combien ils empêchaient de goûter dans leur plénitude les joies de l’amitié. Ainsi donc, ô mon hôte, ne sois point étonné demain matin, après cette nuit où l’amitié se fait voir à nous sous l’aspect le plus engageant, si je suis obligé de te faire mes adieux. Et même si, plus tard, tu me rencontres dans les rues de Baghdad, ne trouve pas mauvais que je ne te reconnaisse plus ! »
Lorsque le khalifat eut entendu ces paroles d’Aboul-Hassân, il lui dit : « Par Allah ! ta conduite est une conduite merveilleuse, et de ma vie je n’ai vu un débauché se conduire avec autant de sagesse que toi ! Aussi mon admiration pour toi est à ses limites extrêmes : tu as su, avec le fonds que tu as gardé de la seconde part de ton héritage, mener une vie intelligente qui te permet d’avoir chaque nuit la société d’un homme nouveau avec qui tu peux toujours varier tes plaisirs et tes causeries, et dont tu ne saurais ni te lasser ni éprouver du désagrément ! » Puis il ajouta : « Mais, ô mon maître, ce que tu m’as dit au sujet de notre séparation pour demain me cause une peine extrême. Car j’eusse bien voulu reconnaître par quelque endroit ton bienfait sur moi et l’hospitalité de cette nuit. Je te prie donc dès maintenant de m’exprimer un désir, et, je te le jure sur la Kâaba sainte, je m’engage à le satisfaire. Parle-moi donc en toute sincérité, et ne crains point de grossir ta demande, car les biens d’Allah sont nombreux sur le marchand que je suis, et rien ne me sera difficile à réaliser, avec l’aide d’Allah…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … et rien ne me sera difficile à réaliser, avec l’aide d’Allah ! »
À ces paroles du khalifat déguisé en marchand, Aboul-Hassân, sans se troubler ou manifester le moindre étonnement, répondit : « Par Allah ! ô mon hôte, mon œil est déjà rassasié grâce à ta vue, et tes bienfaits seraient un supplément. Je te remercie donc de ton vouloir à mon égard, mais comme je n’ai aucun désir à satisfaire ni aucune ambition à réaliser, je suis fort perplexe pour répondre à tes avances ! Car mon sort me suffit, et je ne souhaite plus rien que de vivre comme je vis, sans avoir jamais besoin de personne ! » Mais le khalifat reprit : « Par Allah sur toi, ô mon maître, ne repousse pas mon offre, et laisse ton âme exprimer un désir, afin que je le satisfasse ! Sinon je partirais d’ici le cœur bien torturé et bien humilié ! Car un bienfait que l’on a éprouvé est plus lourd à porter qu’un méfait, et l’homme bien né doit toujours rendre le bien en mesure double ! Ainsi donc parle et ne crains point de me rebuter ! »
Alors Aboul-Hassân, voyant qu’il ne pouvait faire autrement, baissa la tête et se mit à réfléchir profondément sur la demande qu’il se voyait obligé de faire ; puis soudain il releva la tête, et s’écria : « Eh bien, j’ai trouvé ! Mais c’est la demande d’un fou, sans aucun doute. Et je crois bien que je ne vais pas te la dire, pour ne point me séparer d’avec toi sur une si mauvaise idée de toi sur moi ! » Le khalifat dit : « Par la vie de ma tête ! et quel est celui qui peut dire d’avance si une idée est folle ou raisonnable ! Moi, à la vérité, je ne suis qu’un marchand, mais je puis tout de même faire bien plus que mon métier ne donne à penser sur ma puissance ! Hâte-toi donc de parler ! » Aboul-Hassân répondit : « Je parlerai, ô mon maître, mais je te jure par les mérites de notre Prophète (sur Lui la paix et la prière !) qu’il n’y a que le khalifat qui puisse réaliser ce que je désire ! Ou encore il faudrait que je devinsse, fût-ce pour un seul jour, khalifat à la place de notre maître l’émir des Croyants, Haroun Al-Rachid ! » Le khalifat demanda : « Mais enfin, ya Aboul-Hassân, que ferais-tu si tu étais le khalifat pour un jour seulement ? » Il répondit : « Voici ! » Et Aboul-Hassân s’arrêta un moment ; puis il dit :
« Sache, ô mon maître, que la ville de Baghdad est divisée en quartiers, et que chaque quartier a à sa tête un cheikh qu’on appelle cheikh-al-balad. Or, pour le malheur de ce quartier-ci que j’habite, le cheikh-al-balad est un homme si laid et si plein d’horreur qu’il a dû naître, sans aucun doute, de la copulation d’une hyène avec un cochon. Son approche est pestilentielle, car sa bouche n’est point une bouche ordinaire, mais un cul malpropre comparable à une bouche de latrine ; ses yeux, couleur de poisson, dévient des deux côtés et risquent de tomber à ses pieds ; ses lèvres tuméfiées ont l’air d’une plaie de mauvaise nature, et lancent, quand il parle, des jets de salive ; ses oreilles sont des oreilles de porc ; ses joues flasques et fardées ressemblent au derrière d’un vieux singe ; ses mâchoires sont édentées à force d’avoir mâché les ordures ; son corps est atteint de toutes les maladies ; quant à son fondement il n’existe plus : à force d’avoir servi de fosse aux outils des âniers, des vidangeurs et des balayeurs, il est tombé en pourriture et se trouve maintenant remplacé par des tampons de laine qui empêchent ses tripes de tomber.
« Or, c’est précisément cette ignoble crapule qui, avec l’aide des deux autres crapules que je vais te dépeindre, se permet de jeter le trouble dans tout le quartier. En effet, il n’y a point de vilenie qu’il ne commette et de calomnie qu’il ne répande, et, comme il a une âme excrémenteuse, c’est sur les gens honnêtes, tranquilles et propres, qu’il exerce sa méchanceté de vieille femme. Mais comme il ne peut se trouver partout pour infecter le quartier de sa pestilence, il a à son service deux aides tout aussi infâmes que lui.
« Le premier de ces infâmes est un esclave au visage glabre comme les eunuques, aux yeux jaunes et à la voix aussi désagréable que le son qui sort du derrière des ânes. Et cet esclave, fils de putain et de chien, se fait passer pour un noble Arabe alors qu’il n’est qu’un Roumi de la plus ville et de la plus basse extraction. Son métier consiste à aller tenir compagnie aux cuisiniers, aux domestiques et aux eunuques, chez les vizirs et les grands du royaume, pour surprendre les secrets des maîtres et les rapporter à son chef, le cheikh-al-balad, et les colporter à travers les cabarets et les lieux mal famés. Nulle besogne ne lui répugne, et il lèche les culs quand sur les culs léchés il peut trouver un dinar d’or.
« Quant au second infâme, c’est une sorte de gros bouffon aux gros yeux, qui s’exerce à dire des facéties et des calembours à travers les souks, où il est connu pour son crâne chauve comme une pelure d’oignon et son bégaiement si pénible que l’on croirait, à chaque parole, qu’il va vomir ses boyaux. D’ailleurs, aucun des marchands ne l’invite à venir s’asseoir dans sa boutique, vu qu’il est si lourd et si massif que, lorsqu’il s’assied sur une chaise, la chaise aussitôt vole en éclats sous son poids ! Or celui-ci n’est pas aussi crapuleux que le premier, mais il est bien plus sot !
« Si donc, ô mon maître, je devenais pour un jour seulement émir des Croyants, je ne chercherais ni à m’enrichir ni à enrichir mes parents, mais je me hâterais de débarrasser notre quartier de ces trois horribles canailles, et je les balaierais dans la fosse aux ordures, une fois que je les aurais punis chacun suivant le degré de son ignominie. Et je rendrais de la sorte la tranquillité aux habitants de notre quartier. Et c’est là tout ce que je désire…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et je rendrais de la sorte la tranquillité aux habitants de notre quartier. Et c’est là tout ce que je désire ! »
Lorsque le khalifat eut entendu ces paroles d’Aboul-Hassân, il lui dit : « En vérité, ya Aboul-Hassân, ton souhait est le souhait d’un homme qui est dans la voie droite et d’un cœur qui est un cœur excellent, car il n’y a que les hommes droits et les cœurs excellents qui ne peuvent souffrir que l’impunité soit l’apanage des méchants. Mais ne crois point que ton souhait soit aussi difficile à réaliser que tu me le donnais à croire ; car je suis bien persuadé que si l’émir des Croyants en était informé, lui qui n’aime rien tant que les aventures singulières, il se hâterait de remettre son pouvoir entre tes mains pour un jour et pour une nuit ! » Mais Aboul-Hassân se mit à rire et répondit : « Par Allah ! je vois bien maintenant que tout ce que nous disons là n’est qu’une plaisanterie ! Et je suis persuadé, à mon tour, que si le khalifat était informé de mon extravagance, il me ferait enfermer dans la maison des fous ! Ainsi donc, je te prie, si par hasard tes relations te mettaient en présence de quelque personnage du palais, de ne jamais parler de ce que nous venons de dire sous l’influence de la boisson ! » Et le khalifat, pour ne point désobliger son hôte, lui dit : « Je jure que je ne parlerai de la chose à personne ! » Mais, à part lui, il se promit de ne point laisser passer cette occasion de se divertir comme jamais il ne l’avait fait depuis le temps qu’il parcourait sa ville, déguisé sous toutes sortes de déguisements. Et il dit à Aboul-Hassân : « Ô mon hôte, il faut maintenant qu’à mon tour je te verse à boire ; car jusqu’à présent c’est toi-même qui prenais la peine de me servir ! » Et il prit la bouteille et la coupe, versa du vin dans la coupe, en y glissant adroitement une pincée de bang crétois de qualité pure, et offrit la coupe à Aboul-Hassân, en lui disant : « Que cela te soit sain et délicieux ! » Et Aboul-Hassân répondit : « Peut-on refuser la boisson que nous offre la main de l’invité ! Mais, par Allah sur toi, ô mon maître, comme je ne pourrai demain matin me lever pour t’accompagner hors de ma maison, je te prie de ne pas oublier, en sortant, de bien fermer la porte derrière toi ! » Et le khalifat le lui promit également. Aboul-Hassân, tranquille de ce côté-là, prit la coupe et la vida d’un seul trait. Mais aussitôt le bang fit son effet, et Aboul-Hassân roula à terre, la tête avant les pieds, d’une façon si rapide que le khalifat se mit à rire. Après quoi il appela l’esclave qui était resté à ses ordres, et lui dit : « Charge cet homme sur ton dos, et suis-moi ! » Et l’esclave obéit et, chargeant Aboul-Hassân sur son dos, il suivit le khalifat qui lui dit : « Rappelle-toi bien l’emplacement de cette maison, afin que tu puisses y retourner quand je te l’ordonnerai ! » Et ils sortirent dans la rue, en oubliant toutefois de refermer la porte, malgré la recommandation.
Lorsqu’ils furent arrivés au palais, ils y entrèrent par la porte secrète, et pénétrèrent dans l’appartement particulier où était située la chambre à coucher. Et le khalifat dit à son esclave : « Enlève les vêtements de cet homme, habille-le de mes habits de nuit, et étends-le sur mon propre lit ! » Et lorsque l’esclave eut exécuté l’ordre, le khalifat l’envoya chercher tous les dignitaires du palais, les vizirs, les chambellans et les eunuques, ainsi que toutes les dames du harem ; et lorsqu’ils furent tous présents entre ses mains, il leur dit : « Il faut que demain matin vous soyez tous dans cette chambre, et que chacun de vous soit empressé aux ordres de cet homme qui est là étendu sur mon lit et revêtu de mes habits. Et ne manquez point de lui rendre les mêmes égards qu’à moi-même, et de vous comporter vis-à-vis de lui, en toutes choses, exactement comme s’il était moi-même. Et vous lui donnerez, en répondant à ses questions, le titre d’émir des Croyants ; et vous prendrez bien soin de ne le contrarier dans aucun de ses désirs. Car si l’un de vous, fût-il mon propre fils, s’avisait de se méprendre sur les intentions que je vous indique, il serait pendu à l’heure et à l’instant à la grande porte du palais ! »
À ces paroles du khalifat, tous les assistants répondirent : « Ouïr, c’est obéir ! » et, sur un signe du vizir, ils se retirèrent en silence, comprenant que le khalifat, en leur donnant ces instructions, avait l’intention de se divertir d’une façon extraordinaire.
Lorsqu’ils furent partis, Al-Rachid se tourna vers Giafar et vers le porte-glaive Massrour, qui étaient restés dans la chambre, et leur dit : « Vous avez entendu mes paroles. Eh bien ! demain il faudra que vous soyez les premiers levés et arrivés dans cette chambre, pour être aux ordres de mon remplaçant que voici ! Et ne soyez étonnés d’aucune des choses qu’il vous dira ; et faites semblant de le prendre pour moi-même, quoi qu’il puisse vous dire pour vous tirer de votre erreur simulée. Et faites des libéralités à tous ceux qu’il vous indiquera, dussiez-vous épuiser tous les trésors du royaume ; et récompensez, et punissez, et pendez, et tuez, et nommez, et destituez, exactement selon ce qu’il vous dira de faire. Et vous n’avez point besoin, pour cela, de venir auparavant me consulter. D’ailleurs, je serai moi-même caché à proximité, et je verrai et j’entendrai tout ce qui va se passer ! Et, surtout, faites en sorte qu’il ne puisse point se douter un moment que tout ce qui lui arrive n’est qu’un divertissement combiné par mes ordres ! C’est tout ! Et qu’il en soit ainsi ! » Puis il ajouta : « Ne manquez pas toutefois, une fois que vous serez réveillés, de venir me tirer moi aussi de mon sommeil, à l’heure de la prière du matin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ne manquez pas toutefois, une fois que vous serez réveillés, de venir me tirer moi aussi de mon sommeil, à l’heure de la prière du matin ! »
Or, le lendemain, à l’heure dite, Giafar et Massrour ne manquèrent pas de venir éveiller le khalifat qui aussitôt courut se placer derrière un rideau, dans la chambre même où était endormi Aboul-Hassân. Et de là il pouvait entendre et voir tout ce qui allait se passer, sans être exposé à être remarqué pas plus par Aboul-Hassân que par les assistants.
Alors entrèrent Giafar et Massrour, ainsi que tous les dignitaires, les dames et les esclaves ; et chacun se plaça, suivant son rang, à la place habituelle. Et une gravité et un silence régnèrent dans la chambre tout comme s’il s’agissait du lever de l’émir des Croyants. Et lorsque tous furent ainsi rangés en bon ordre, l’esclave qui avait été d’avance désigné s’approcha d’Aboul-Hassân, toujours endormi, et plaça sous son nez un tampon trempé dans du vinaigre. Et aussitôt Aboul-Hassân éternua une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, en jetant par le nez de longs filaments produits par l’effet du bang. Et l’esclave recueillit cette pituite dans un plateau d’or, pour qu’elle ne tombât pas sur le lit ou sur le tapis ; puis il essuya le nez et le visage d’Aboul-Hassân et l’aspergea d’eau de roses. Et Aboul-Hassân finit par sortir de son assoupissement et, s’éveillant, il ouvrit les yeux,
Et il se vit d’abord dans un lit magnifique dont la couverture était recouverte d’un brocart d’or rouge constellé de perles et pierreries ! Et il leva les yeux et se vit dans une grande salle aux murs et au plafond recouverts de satin, avec des portières de soie, et, dans les angles, des vases d’or et de cristal ! Et il jeta les yeux autour de lui et se vit entouré de jeunes femmes et de jeunes esclaves inclinés, d’une beauté ravissante ; et, derrière eux, il aperçut la foule des vizirs, des émirs, des chambellans, des eunuques noirs et des joueuses d’instruments prêtes à toucher les cordes harmonieuses et à accompagner les chanteuses disposées en cercle sur une estrade. Et, tout près de lui, sur tabouret, il reconnut, à leur couleur, les habits, le manteau et le turban de l’émir des Croyants.
Lorsque Aboul-Hassân eut vu tout cela, il referma les yeux pour se rendormir, tant il fut persuadé qu’il se trouvait sous l’effet d’un rêve. Mais, au même moment, le grand-vizir Giafar s’approcha de lui et, après avoir embrassé la terre trois fois, lui dit d’un ton respectueux : « Ô émir des Croyants, permets à ton esclave de t’éveiller, car c’est l’heure de la prière du matin ! »
À ces paroles de Giafar, Aboul-Hassân se frotta les yeux à diverses reprises, puis se pinça le bras si cruellement qu’il poussa un cri de douleur, et se dit : « Non, par Allah ! je ne rêve pas ! Me voici devenu khalifat ! » Mais il hésita encore ; et dit à haute voix : « Par Allah ! tout cela est le fait de ma raison égarée par toute la boisson que j’ai bue hier avec le marchand de Mossoul, et aussi l’effet de ma folle conversation avec lui ! » Et il se tourna du côté du mur pour se rendormir. Et, comme il ne bougeait plus, Giafar s’approcha encore de lui et lui dit : « Ô émir des Croyants, permets à ton esclave de s’étonner de voir son seigneur manquer à son habitude de se lever pour la prière ! » Et, au même moment, sur un signe de Giafar, les joueuses d’instruments firent entendre un concert de harpes, de luths et de guitares, et les voix des chanteuses retentirent harmonieusement. Et Aboul-Hassân se retourna du côté des chanteuses, en se disant à haute voix : « Et depuis quand, ya Aboul-Hassân, les dormeurs entendent-ils ce que tu entends et voient-ils ce que tu vois ? » Et il se leva sur son séant, à la limite de la stupéfaction et de l’enchantement, mais doutant toujours de la réalité de tout cela. Et il se mit les mains devant les yeux pour mieux distinguer et se mieux prouver ses impressions, et en se disant : « Ouallah ! N’est-ce pas étrange ? N’est-ce pas stupéfiant ! Où es-tu donc, Aboul-Hassân, ô fils de ta mère ? Rêves-tu ou ne rêves-tu pas ? Depuis quand es-tu le khalifat ? Depuis quand ce palais, ce lit, ces dignitaires, ces eunuques, ces femmes charmantes, ces joueuses d’instruments, ces chanteuses enchanteresses, et tout ceci, et tout cela ? » Mais, à ce moment, le concert cessa, et Massrour, le porte-glaive, s’approcha du lit, baisa la terre à trois reprises différentes, et, se levant, dit à Aboul-Hassân : « Ô émir des Croyants, permets au dernier de tes esclaves de te dire que l’heure de la prière est déjà passée, et qu’il est temps de venir au diwân pour les affaires du royaume ! » Et Aboul-Hassân, de plus en plus stupéfait, et ne sachant plus, dans sa perplexité, à quel parti se résoudre, finit par regarder Massrour entre les deux yeux, et lui dit avec colère : « Qui es-tu, toi ? Et qui suis-je, moi ? » Massrour répondit, d’un ton respectueux : « Tu es notre maître l’émir des Croyants, le khalifat Haroun Al-Rachid, le cinquième des Bani-Abbas, le descendant de l’oncle du Prophète (sur lui la prière et la paix !) Et l’esclave qui te parle, est le pauvre, le méprisable, le rien du tout Massrour, l’honoré par la charge auguste de porter le glaive de la volonté de notre seigneur…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT TRENTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et l’esclave qui te parle est le pauvre, le méprisable, le rien du tout Massrour, l’honoré par la charge auguste de porter le glaive de la volonté de notre seigneur ! » En entendant ces paroles de Massrour, Aboul-Hassân lui cria : « Tu mens, fils de mille cornards ! » Mais Massrour, sans se troubler, répondit : « Ô mon seigneur, certes ! un autre que moi, en entendant ainsi parler le khalifat, mourrait de douleur ! Mais moi, ton vieil esclave, qui suis depuis de si longues années à ton service et qui vis à l’ombre de tes bienfaits et de ta bonté, je sais que le vicaire du Prophète ne me parle ainsi que pour éprouver ma fidélité ! De grâce donc, ô mon maître, je te supplie de ne point me mettre plus longtemps à l’épreuve ! Ou bien, si cette nuit un mauvais songe a fatigué ton sommeil, chasse-le et rassure ton esclave tremblant ! »
À ce discours de Massrour, Aboul-Hassân ne put se retenir plus longtemps, et, poussant un immense éclat de rire, il se renversa sur son lit, et se mit à tourner sur lui-même en s’entortillant dans les couvertures et en lançant ses jambes par-dessus sa tête. Et, derrière le rideau, Haroun Al-Rachid qui entendait et voyait tout cela, se gonflait les joues pour étouffer le rire qui le secouait.
Lorsque Aboul-Hassân eut ri dans cette posture pendant une heure de temps, il finit par se calmer un peu, et, se levant sur son séant, il fit signe de s’approcher à un petit esclave noir, et lui dit : « Dis-moi, toi ! me reconnais-tu ? et peux-tu me dire qui je suis ? » Le petit noir baissa les yeux avec respect et modestie, et répondit : « Tu es notre maître l’émir des Croyants, Haroun Al-Rachid, le khalifat du Prophète (qu’Il soit béni !) et le vicaire sur la terre du Souverain de la Terre et du Ciel. » Mais Aboul-Hassân lui cria : « Tu mens, ô visage de poix, ô fils de mille entremetteurs ! »
Il se tourna alors vers une des jeunes esclaves qui étaient présentes, et, lui faisant signe d’approcher, lui tendit un doigt en lui disant : « Mords ce doigt ! Je verrai bien si je dors ou si je suis éveillé ! » Et l’adolescente, qui savait que le khalifat voyait et entendait tout ce qui se passait, se dit en elle-même : « Voilà pour moi l’occasion de montrer à l’émir des Croyants ce que je sais faire pour le divertir ! » Et, serrant les dents de toutes ses forces, elle mordit le doigt jusqu’à l’os. Et Aboul-Hassân, poussant un cri de douleur, s’écria : « Aïe ! Ah ! je vois bien que je ne dors pas ! Certes ! je ne dors pas ! » Et il demanda à la même jeune fille : « Peux-tu, toi, me dire si tu me reconnais, et si vraiment je suis celui qu’on a dit ? » Et l’esclave répondit, en étendant les bras : « Le nom d’Allah sur le khalifat et autour de lui ! Tu es, ô mon seigneur, l’émir des Croyants, Haroun Al-Rachid, le vicaire d’Allah ! »
À ces paroles, Aboul-Hassân s’écria : « Te voilà devenu en une nuit le vicaire d’Allah, ô Aboul-Hassân, ô fils de ta mère ! » Puis, se ravisant, il cria à la jeune fille : « Tu mens, ô chiffon ! Est-ce que je ne sais pas bien, moi, qui je suis ? »
Mais, à ce moment, le chef eunuque s’approcha du lit et, après avoir embrassé trois fois la terre, se releva et, courbé en deux, s’adressa à Aboul-Hassân et lui dit : « Que notre maître me pardonne ! Mais c’est l’heure habituelle où notre maître va satisfaire ses besoins au cabinet ! » Et il passa le bras sous son aisselle, et l’aida à sortir du lit. Et, dès qu’il fut debout sur ses pieds, la salle et le palais retentirent du cri par lequel le saluaient tous les assistants : « Qu’Allah rende victorieux le khalifat ! » Et Aboul-Hassân pensait : « Par Allah ! n’est-ce pas une chose merveilleuse ? Hier j’étais Aboul-Hassân ! Et aujourd’hui je suis Haroun Al-Rachid ? « Puis il se dit : « Du moment que c’est l’heure d’aller pisser, allons pisser ! Mais je ne suis pas bien sûr maintenant si c’est bien l’heure aussi où je satisfais l’autre besoin, également ! » Mais il fut tiré de ces réflexions par le chef eunuque qui lui tendit une paire de chaussures découvertes brodées d’or et de perles, et qui, hautes de talon, étaient spécialement réservées pour être chaussées au cabinet. Mais Aboul-Hassân, qui, de sa vie, n’avait vu pareille chose, prit les chaussures et, croyant que c’était quelque objet précieux dont on lui faisait cadeau, les mit dans l’une des larges manches de sa robe !
À cette vue, les assistants, qui jusque-là avaient réussi à retenir leurs rires, ne purent plus longtemps comprimer leur hilarité. Et les uns tournèrent la tête, tandis que les autres, faisant semblant d’embrasser la terre devant la majesté du khalifat, tombèrent sur les tapis, convulsés. Et, derrière le rideau, le khalifat était pris d’un tel rire silencieux, qu’il était sur le flanc, étendu sur le sol.
Pendant ce temps, le chef eunuque, soutenant Aboul-Hassân par-dessous l’épaule, le conduisit à un cabinet pavé de marbre blanc, alors que toutes les autres pièces du palais étaient couvertes de riches tapis. Après quoi, il le ramena dans la chambre à coucher, au milieu des dignitaires et des dames, tous rangés sur deux files. Et aussitôt d’autres esclaves s’avancèrent, qui étaient spécialement chargés de l’habillement et qui lui enlevèrent ses effets de nuit et lui présentèrent le bassin d’or, rempli d’eau de roses, pour ses ablutions. Et lorsqu’il se fut lavé, en reniflant avec délices l’eau parfumée, ils le vêtirent des habits royaux, le coiffèrent du diadème, et lui remirent en mains le sceptre d’or.
À cette vue, Aboul-Hassân pensa : « Voyons ! Suis-je ou ne suis-je pas Aboul-Hassân ? » Et il réfléchit un instant et, d’un ton résolu, il cria à haute voix, de façon à être entendu de toute l’assistance : « Je ne suis pas Aboul-Hassân ! Que l’on empale celui qui dit que je suis Aboul-Hassân ! Je suis Haroun Al-Rachid en personne ! »
Et, ayant prononcé ces paroles, Aboul-Hassân, d’un ton de commandement aussi assuré que s’il fût né sur le trône, ordonna : « Marchez ! » Et aussitôt le cortège se forma ; et Aboul-Hassân, se plaçant le dernier, suivit le cortège qui le conduisit dans la salle du trône. Et Massrour l’aida à monter sur le trône, où il s’assit aux acclamations de tous les assistants. Et il posa le sceptre sur ses genoux, et regarda autour de lui. Et il vit tout le monde rangé en bon ordre dans la salle aux quarante portes ; et il vit les gardes aux glaives brillants, et les vizirs, et les émirs, et les notables, et les représentants de tous les peuples de l’empire, et d’autres encore, en foule innombrable. Et il reconnut, dans la masse silencieuse, des figures qu’il connaissait bien : Giafar le vizir, Abou-Nowas, Al-Ijli, Al-Rakashi, Ibdân, Al-Farazadk, Al-Lauz, Al-Sakar, Omar Al-Tartis, Abou-Ishak, Al-Khalia et Jadim.
Or, pendant qu’il promenait ainsi ses regards sur chaque figure, Giafar s’avança, suivi des principaux dignitaires, tous vêtus d’habits splendides ; et, arrivés devant le trône, ils se prosternèrent la face contre terre, et restèrent dans cette posture jusqu’à ce qu’il leur eût ordonné de se relever. Alors Giafar tirade dessous son manteau un grand paquet qu’il déplia et dont il tira une liasse de papiers qu’il se mit à lire l’un après l’autre, et qui étaient les requêtes ordinaires. Et Aboul-Hassân, bien qu’il ne se fût jamais trouvé à même d’entendre de pareilles affaires, ne fut pas un instant embarrassé ; et il se prononça sur chacune des affaires qui lui étaient soumises avec tant de tact et de justice, que le khalifat, qui était venu se cacher derrière un rideau dans la salle du trône, fut tout à fait émerveillé.
Lorsque Giafar eut fini son rapport, Aboul-Hassân lui demanda : « Où est le chef de la police ? » Et Giafar lui désigna du doigt Ahmad-la-Teigne, chef de la police, et lui dit : « C’est celui-ci, ô émir des Croyants ! » Et le chef de la police, se voyant désigné, sortit aussitôt de la place qu’il occupait, et s’approcha gravement du trône, au pied duquel il se prosterna la face contre terre. Et Aboul-Hassân, après lui avoir permis de se relever, lui dit : « Ô chef de la police, prends avec toi dix gardes, et va à l’instant dans tel quartier, telle rue, telle maison ! Là tu trouveras un horrible cochon qui est le cheikh-al-balad du quartier, et tu te trouveras assis entre ses deux compères, deux canailles non moins ignobles que lui. Saisis-toi de leurs personnes, et commence, pour les habituer à ce qu’ils vont subir, par leur donner à chacun quatre cents coups de bâton sur la plante des pieds…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT TRENTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Saisis-toi de leurs personnes, et commence, pour les habituer à ce qu’ils vont subir, par leur donner à chacun quatre cents coups de bâton sur la plante des pieds. Après quoi, tu les hisseras sur un chameau galeux, vêtus de haillons et la face tournée vers la queue du chameau, et tu les promèneras par tous les quartiers de la ville, en faisant crier par le crieur public : « Voilà le commencement de la punition des calomniateurs, des salisseurs de femmes, de ceux qui troublent leurs voisins et bavent sur les honnêtes gens ! » Cela fait, tu feras empaler par la bouche le cheikh-al-balad, vu que c’est par là qu’il a péché et vu qu’il n’a plus de fondement ; et tu jetteras son corps pourri en pâture aux chiens. Tu prendras ensuite l’homme glabre, aux yeux jaunes, le plus infâme des deux compères qui aidaient dans sa vile besogne le cheikh-al-balad, et tu le feras noyer dans la fosse des excréments de la maison de Aboul-Hassân, son voisin. Puis ce sera le tour du second compère ! Celui-ci, qui est un bouffon et un sot ridicule, tu ne lui feras pas subir d’autre punition que la suivante : tu feras construire par un menuisier habile une chaise faite d’une façon telle qu’elle puisse voler en éclats chaque fois que l’homme en question viendra s’y asseoir, et tu le condamneras à s’asseoir toute sa vie sur cette chaise-là ! Va ! Et exécute mes ordres ! »
En entendant ces paroles, le chef de la police Ahmad-la-Teigne, qui avait reçu de Giafar l’ordre d’exécuter tous les commandements qu’il recevrait d’Aboul-Hassân, mit la main sur sa tête, pour bien indiquer par là qu’il était prêt à perdre lui-même la tête, s’il n’exécutait pas ponctuellement les ordres reçus. Puis il embrassa la terre une seconde fois entre les mains d’Aboul-Hassân et sortit de la salle du trône.
Tout cela ! Et le khalifat, en voyant Aboul-Hassân s’acquitter avec tant de gravité des prérogatives de la royauté, éprouva un plaisir extrême. Et Aboul-Hassân continua à juger, à nommer, à destituer, et à terminer les affaires pendantes, jusqu’à ce que le chef de la police fût de retour au pied du trône. Et il lui demanda : « As-tu exécuté mes ordres ? » Et le chef de la police, après s’être prosterné comme à l’ordinaire, tira un papier de son sein et le présenta à Aboul-Hassân qui le déplia et le lut en entier. Or c’était précisément le procès-verbal de l’exécution des trois compères, signé par les témoins légaux et par des personnes bien connues dans le quartier. Et Aboul-Hassân dit : « C’est bien ! Je suis satisfait ! Ainsi soient à jamais punis les calomniateurs, les salisseurs de femmes et tous ceux qui se mêlent des affaires d’autrui ! »
Après quoi, Aboul-Hassân fit signe au chef trésorier de s’approcher, et lui dit : « Prends à l’instant dans le trésor un sac de mille dinars d’or, va au quartier même où j’ai envoyé le chef de la police, demande où se trouve la maison d’Aboul-Hassân, celui qu’on appelle le débauché. Et comme cet Aboul-Hassân, bien loin d’être un débauché, est plutôt un homme excellent et de bonne compagnie, et qu’il est bien connu dans son quartier, tout le monde s’empressera de t’indiquer sa maison. Alors tu entreras et tu demanderas à parler à sa vénérable mère ; et, après les salams et les égards dus à cette excellente vieille, tu lui diras : « Ô mère d’Aboul-Hassân, voici un sac de mille dinars d’or que t’envoie notre maître le khalifat. Et ce cadeau n’est rien au regard de tes mérites. Mais le trésor en ce moment est vide, et le khalifat regrette de ne pouvoir aujourd’hui mieux faire pour toi ! » Et, sans plus attendre, tu lui remettras le sac et tu reviendras me rendre compte de ta mission ! » Et le chef trésorier répondit par l’ouïe et l’obéissance, et se hâta d’aller exécuter l’ordre.
Cela fait, Aboul-Hassân marqua, par un signe, au grand-vizir Giafar qu’il fallait lever le diwân. Et Giafar transmit le signe aux vizirs, aux émirs, aux chambellans et aux autres assistants, et tous, après s’être prosternés au pied du trône, sortirent dans le même ordre que lorsqu’ils étaient entrés. Et seuls restèrent, auprès d’Aboul-Hassân, le grand-vizir Giafar et le porte-glaive Massrour, qui s’approchèrent de lui et l’aidèrent à se lever, en le prenant l’un par par-dessous le bras droit, et l’autre par-dessous le bras gauche. Et ils le conduisirent jusqu’à la porte de l’appartement intérieur des femmes, où était servi le festin du jour. Et les dames de service vinrent aussitôt remplacer auprès de lui Giafar et Massrour, et l’introduisirent dans la salle du festin.
Aussitôt se fit entendre un concert de luths, de théorbes, de guitares, de flûtes, de hautbois et de clarinettes qui accompagnaient des voix fraîches d’adolescentes, avec tant de charme, de mélodie et de justesse, qu’Aboul-Hassân, ravi à l’extrême limite du ravissement, ne savait plus à quoi se résoudre. Et il finit par se dire : « Maintenant je ne puis plus douter ! Je suis bien réellement l’émir des Croyants Haroun Al-Rachid. Car tout cela ne peut être un songe ! Sinon, pourrais-je voir, entendre, sentir et marcher comme je le fais ? Ce papier du procès-verbal de l’exécution des trois compères, je le tiens en main ; ces chants, ces voix, je les entends ; et tout le reste, et ces honneurs, et ces égards, c’est pour moi ! Je suis le khalifat…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT TRENTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Je suis le khalifat ! » Et il regarda à sa droite et il regarda à sa gauche ; et ce qu’il vit le consolida encore davantage dans l’idée de sa royauté. Il était au milieu d’une salle splendide où l’or brillait sur toutes les parois, où les couleurs les plus agréables se dessinaient d’une façon variée sur les tentures et les tapis, et où, suspendus au plafond d’azur, sept lustres d’or à sept branches, mettaient un éclat incomparable. Et au milieu de la salle, sur des tabourets bas, étaient sept grands plateaux d’or massif, couverts de mets admirables dont l’odeur embaumait l’air d’ambre et d’épiceries. Et autour de ces plateaux étaient debout, attendant un signe, sept adolescentes, d’une beauté incomparable, vêtues de robes de couleurs et de formes différentes. Et elles tenaient chacune à la main un éventail, prêtes à en rafraîchir l’air autour d’Aboul-Hassân.
Alors Aboul-Hassân, qui depuis la veille n’avait encore rien mangé, s’assit devant les plateaux ; et aussitôt les sept adolescentes se mirent à agiter toutes ensemble leurs éventails, pour faire de l’air autour de lui. Mais, comme il n’était point habitué à recevoir tant d’air en mangeant, il regarda les adolescentes l’une après l’autre, avec un sourire gracieux, et leur dit : « Par Allah, ô jouvencelles, je crois bien qu’une seule personne suffit pour me donner de l’air. Venez donc toutes vous asseoir autour de moi, pour me tenir compagnie. Et dites à cette négresse, qui est là, de venir nous faire de l’air ! » Et il les obligea à venir se placer à sa droite, à sa gauche et devant lui, de façon à ce que, de quelque côté qu’il se tournât, il eût devant les yeux un spectacle agréable.
Alors il commença à manger ; mais, au bout de quelques instants, il s’aperçut que les adolescentes n’osaient point toucher à la nourriture, par égard pour lui ; et il les invita à plusieurs reprises à se servir sans contrainte, et il leur offrit même de sa propre main des morceaux choisis. Puis il les interrogea, chacune à son tour, sur leurs noms ; et elles lui répondirent : « Nous nous appelons Grain-de-Musc, Cou-d’Albâtre, Feuille-de-Rose, Cœur-de-Grenade, Bouche-de-Corail, Noix-Muscade, et Canne-à-Sucre ! » Et, en entendant des noms si gracieux, il s’écria : « Par Allah ! ces noms vous conviennent, ô jeunes filles ! Car ni le musc, ni l’albâtre, ni la rose, ni la grenade, ni le corail, ni la noix muscade, ni la canne à sucre ne perdent leurs qualités à travers votre grâce ! » Et il continua, durant le repas, à leur dire des paroles si exquises, que le khalifat, caché derrière un rideau, et qui l’observait avec une grande attention, se félicita de plus en plus d’avoir organisé un tel divertissement.
Lorsque le repas fut terminé, les adolescentes avertirent les eunuques, qui aussitôt apportèrent de quoi se laver les mains. Et les adolescentes s’empressèrent de prendre des mains des eunuques le bassin d’or, l’aiguière et les serviettes parfumées et, se mettant à genoux devant Aboul-Hassân, elles firent couler l’eau sur ses mains. Puis elles l’aidèrent à se lever ; et, les eunuques ayant tiré une grande portière, une seconde salle apparut où étaient rangés les fruits sur les plateaux d’or. Et les adolescentes l’accompagnèrent jusqu’à la porte de cette salle, et se retirèrent.
Alors Aboul-Hassân, soutenu par deux eunuques, marcha jusqu’au milieu de cette salle qui était plus belle et mieux décorée que la précédente. Et dès qu’il se fut assis, un nouveau concert, donné par une autre troupe de musiciennes et de chanteuses, fit entendre des accords admirables. Et Aboul-Hassân, fort ravi, aperçut sur les plateaux dix rangées alternées des fruits les plus rares et les plus exquis ; et il y en avait sept plateaux ; et chaque plateau était sous un lustre suspendu au plafond ; et devant chaque plateau se tenait une adolescente, plus belle et mieux ornée que les précédentes ; et elle tenait également un éventail. Et Aboul-Hassân les examina l’une après l’autre et fut enchanté de leur beauté. Et il les invita à s’asseoir autour de lui ; et pour les encourager à manger, il ne manqua pas de les servir lui-même au lieu de les laisser le servir. Et il s’informa de leurs noms, et sut dire à chacune d’elles un compliment approprié, en leur présentant soit une figue, soit une grappe de raisin, soit une tranche de pastèque, soit une banane. Et le khalifat, qui l’entendit, se divertissait à l’extrême et était de plus en plus satisfait de mieux voir chaque fois la mesure qu’il pouvait donner.
Lorsque Aboul-Hassân eut goûté de tous les fruits qui étaient sur les plateaux, et qu’il en eut fait goûter aux adolescentes, il se leva, aidé par les eunuques qui l’introduisirent dans une troisième salle, certainement plus belle que les deux premières…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT TRENTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… il se leva, aidé par les eunuques qui l’introduisirent dans une troisième salle, certainement plus belle que les deux premières. Or, c’était la salle des confitures. Il y avait, en effet, sept grands plateaux, chacun sous un lustre, et devant chaque plateau une adolescente debout ; et sur ces plateaux, dans des bocaux de cristal et des bassins de vermeil, étaient contenues les confitures excellentes. Et il y en avait de toutes les couleurs et de toutes les espèces. Il y avait des confitures liquides et des confitures sèches, et des gâteaux feuilletés, et tout ! Et Aboul-Hassân, au milieu d’un nouveau concert de voix et d’instruments, goûta un peu de toutes les douceurs parfumées, et en fit goûter aux adolescentes qu’il invita, de la même manière, à lui tenir compagnie. Et à chacune d’elles il sut dire un mot agréable en réponse au nom qu’il demandait.
Après quoi, il fut introduit dans la quatrième salle qui était la salle des boissons, et qui était de beaucoup la plus surprenante et la plus merveilleuse. Sous les sept lustres d’or du plafond étaient sept plateaux, où des flacons de toutes formes et de toutes grandeurs étaient rangés en lignes symétriques ; et des musiciennes et des chanteuses se faisaient entendre, qui étaient invisibles à l’œil du spectateur ; et devant les plateaux étaient debout sept adolescentes, non point vêtues de lourdes robes comme leurs sœurs des autres salles, mais simplement enveloppées d’une chemise de soie ; et elles étaient de couleurs différentes et d’aspect différent : la première était brune, la seconde noire, la troisième blanche, la quatrième blonde, la cinquième grasse, la sixième maigre, et la septième rousse. Et Aboul-Hassân les examina avec d’autant plus de plaisir et d’attention qu’il pouvait aisément juger de leurs formes et de leurs appas, sous la transparence de l’étoffe légère. Et ce fut avec un plaisir extrême qu’il les invita à s’asseoir autour de lui et à lui verser à boire. Et il se mit à demander son nom à chaque adolescente à son tour, à mesure qu’elle lui présentait la coupe. Et chaque fois qu’il vidait une coupe, il prenait de l’adolescente soit un baiser, soit une morsure, soit un pincement de fesse. Et il continua à jouer de la sorte avec elles, jusqu’à ce que l’enfant héritier se fût mis à crier. Alors, pour l’apaiser, il demanda aux sept adolescentes : « Par ma vie ! qui de vous veut se charger de cet enfant encombrant ! » Et les sept adolescentes, à cette demande, pour toute réponse, se jetèrent toutes à la fois sur le nourrisson, et voulurent lui donner à téter. Et chacune le tirait à elle de côté et d’autre, en riant et en poussant des cris, si bien que le père de l’enfant ne sachant plus qui entendre ni qui exaucer, le rentra dans son sein, en disant : « Il s’est rendormi ! »
Tout cela !
Et le khalifat, qui suivait partout Aboul-Hassân et se dissimulait derrière les rideaux, jubilait en silence de ce qu’il voyait et entendait, et bénissait la destinée qui l’avait mis sur le chemin d’un homme tel que celui-ci. Mais, sur ces entrefaites, l’une des adolescentes, qui avait reçu de Giafar les instructions nécessaires, prit une coupe et y jeta adroitement une pincée de la poudre soporifique que le khalifat avait employée la nuit précédente pour endormir Aboul-Hassân. Puis elle tendit en riant la coupe à Aboul-Hassân, et lui dit : « Ô émir des Croyants, je te supplie de boire encore cette coupe qui peut-être réveillera le cher enfant ! » Et Aboul-Hassân, éclatant de rire, répondit : « Hé, ouallah ! » et il prit la coupe que lui tendait l’adolescente, et la but d’un seul coup. Puis il se tourna pour parler à celle qui lui avait servi à boire, mais il ne put qu’ouvrir la bouche en bégayant, et roula sur lui-même, la tête avant les pieds.
Alors le khalifat, qui s’était diverti de tout cela à la limite du divertissement, et qui n’attendait plus que ce sommeil d’Aboul-Hassân, sortit de derrière le rideau, ne pouvant plus se tenir debout à force d’avoir ri. Et il se tourna vers les esclaves accourus et leur ordonna de dépouiller Aboul-Hassân des habits royaux dont ils l’avaient revêtu le matin, et de le vêtir de ses habits ordinaires. Et lorsque cet ordre fut exécuté, il fit appeler l’esclave qui avait enlevé Aboul-Hassân, et lui ordonna de le recharger sur ses épaules, de le transporter à sa maison, et de le coucher sur son lit. Car le khalifat se dit en lui-même : « Si cela dure davantage, ou bien je vais mourir de rire, ou bien il deviendra fou ! » Et l’esclave, ayant chargé Aboul-Hassân sur son dos, l’emporta hors du palais en sortant par la porte secrète, et courut le déposer sur son lit, dans sa maison, dont cette fois il prit soin de fermer la porte en se retirant.
Quant à Aboul-Hassân…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT TRENTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Quant à Aboul-Hassân, il resta endormi dans un profond sommeil jusqu’au lendemain à midi, et il ne s’éveilla que lorsque l’effet du bang sur son cerveau se fut complètement dissipé. Et, avant que de pouvoir ouvrir les yeux, il pensa : « Celle que je préfère, réflexion faite, entre toutes les adolescentes, c’est certainement la jeune Canne-à-Sucre, et ensuite Bouche-de-Corail, et en troisième lieu seulement Bouquet-de-Perles, la blonde, celle qui m’a servi la dernière coupe, hier ! » Et il appela à haute voix : « Allons ! venez, ô jeunes filles ! Canne-à-Sucre, Bouche-de-Corail, Bouquet-de-Perles, Aube-du-Jour, Étoile-du-Matin, Grain-de-Musc, Cou-d’Albâtre, Face-de-Lune, Cœur-de-Grenade, Fleur-de-Pommier, Feuille-de-Rose ! Allons ! Accourez ! Hier j’étais un peu fatigué ! Mais aujourd’hui l’enfant se porte bien ! »
Et il attendit un moment. Mais comme personne ne répondait ni n’accourait à sa voix, il fut courroucé et, ouvrant les yeux, il se mit sur son séant. Et il se vit alors dans sa chambre, plus du tout dans le palais somptueux qu’il avait habité la veille, et où il avait commandé en maître à toute la terre. Et il s’imagina qu’il était sous l’effet d’un rêve, et, pour le dissiper, il se mit à crier de toutes ses forces : « Eh bien, Giafar, ô fils de chien, et toi, Massrour, l’entremetteur, où êtes-vous ? »
À ses cris, la vieille mère accourut, et lui dit : « Qu’as-tu, mon fils ? Le nom d’Allah sur toi et autour de toi ! Quel rêve fais-tu, ô mon fils, ô Aboul-Hassân ? » Et Aboul-Hassân, indigné de voir la vieille à son chevet, lui cria : « Qui es-tu, vieille femme ? Et qui ça, Aboul-Hassân ? » Elle dit : « Allah ! Je suis ta mère ! Et tu es mon fils, tu es Aboul-Hassân, ô mon enfant ! Quelles paroles étranges n’ai-je pas entendues de ta bouche ? Tu as l’air de ne pas me reconnaître ! » Mais Aboul-Hassân lui cria : « Arrière, ô maudite vieille ! Tu parles à l’émir des Croyants, le khalifat Haroun Al-Rachid ! Va-t’en de devant la face du vicaire d’Allah sur la terre ! » À ces paroles, la pauvre vieille se mit à se donner de grands coups sur la figure, en s’écriant : « Le nom d’Allah sur toi, ô mon enfant ! De grâce, n’élève pas la voix pour dire de pareilles folies ! Les voisins vont l’entendre, et nous serons perdus sans recours ! Puisse la sécurité et le calme descendre sur ta raison ! » Aboul-Hassân s’écria : « Je te dis de sortir à l’instant, ô vieille exécrable ! Tu es folle de me confondre avec ton fils ! Je suis Haroun Al-Rachid, émir des Croyants, maître de l’Orient et de l’Occident ! » Elle se donna des coups au visage, et dit, en se lamentant : « Qu’Allah confonde le Malin ! Et que la miséricorde du Très-Haut te délivre de la possession, ô mon enfant ! Comment une chose aussi insensée peut-elle entrer dans ton esprit ? Ne vois-tu pas que cette chambre où tu es est loin d’être le palais du khalifat, et que depuis ta naissance tu y as toujours vécu, et que jamais tu n’as habité ailleurs qu’ici, jamais avec d’autres personnes que ta vieille mère qui t’aime, mon fils, ya Aboul-Hassân ! Écoute-moi, chasse de ta pensée ces rêves vains et dangereux qui t’ont hanté cette nuit, et bois, pour te calmer, un peu de l’eau de cette gargoulette ! »
Alors, Aboul-Hassân prit la gargoulette des mains de sa mère, but une gorgée d’eau, et dit, un peu calmé : « Il se peut bien, en effet, que je sois Aboul-Hassân ! » Et il baissa la tête et, la main appuyée sur la joue, il réfléchit pendant une heure de temps, et, sans lever la tête, il dit, se parlant à lui-même comme quelqu’un qui sort d’un profond sommeil : « Oui, par Allah ! il se peut bien que je sois Aboul-Hassân ! Je suis Aboul-Hassân, sans aucun doute ! Cette chambre est ma chambre, ouallahi ! Je la reconnais maintenant ! Et toi, tu es ma mère, et je suis ton fils ! Oui, je suis Aboul-Hassân ! » Et il ajouta : « Mais par quel sortilège ai-je donc pu avoir ma raison envahie par de telles folies ? »
En entendant ces paroles, la pauvre vieille pleura de joie, ne doutant plus que son fils ne se fût tout à fait calmé. Et, après avoir séché ses larmes, elle s’apprêtait à lui apporter à manger et à l’interroger sur les détails du rêve étrange qu’il venait de faire, quand Aboul-Hassân qui, depuis un moment, regardait fixement devant lui, bondit soudain comme un fou et, saisissant la pauvre femme par ses vêtements, se mit à la secouer en lui criant : « Ah ! infâme vieille, si tu ne veux pas que je t’étrangle, tu vas me dire à l’instant quels sont les ennemis qui m’ont détrôné, et quel est celui qui m’a enfermé dans cette prison, et qui tu es toi-même qui me gardes dans ce misérable taudis ! Ah ! crains les effets de ma colère, quand je reviendrai sur le trône ! Redoute la vengeance de ton auguste souverain, le khalifat que je reste, moi, Haroun Al-Rachid ! » Et, la secouant, il finit par la lâcher de ses mains. Et elle alla s’effondrer sur la natte, en sanglotant et en se lamentant. Et Aboul-Hassân, à la limite de la rage, se rejeta dans son lit, et se tint la tête dans les mains, en proie au tumulte de sa pensée.
Mais, au bout d’un certain temps, la vieille se releva et, comme son cœur était tendre pour son fils, elle n’hésita pas à lui apporter, bien qu’en tremblant, un peu de sirop à l’eau de roses, et le décida à en prendre une gorgée, et lui dit, pour le faire changer d’idée : « Écoute, mon fils, ce que j’ai à te raconter ! C’est une chose qui, j’en suis persuadée, va te faire un bien grand plaisir. Sache, en effet, que le chef de la police est venu hier, de la part du khalifat, arrêter le cheikh-al-balad et ses deux compères ; et qu’après leur avoir fait donner à chacun quatre cents coups de bâton sur la plante des pieds, il les a fait promener, à rebours sur un chameau galeux, à travers les quartiers de la ville, sous les huées et les crachats des femmes et des enfants. Après quoi il a fait empaler par la bouche le cheikh-al-balad, puis jeter le premier compère dans la fosse aux excréments de notre maison, et condamner le troisième à un supplice extrêmement compliqué qui consiste à le faire asseoir toute sa vie sur une chaise qui s’effondre sous lui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et discrète, se tut :
LA SIX CENT TRENTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … un supplice extrêmement compliqué qui consiste à le faire asseoir toute sa vie sur une chaise qui s’effondre sous lui ! »
Lorsque Aboul-Hassân eut entendu ce discours qui, selon ce que pensait la bonne vieille, devait contribuer à chasser le trouble dont son âme était obscurcie, il fut plus persuadé que jamais de sa royauté et de sa dignité héréditaire d’émir des Croyants. Et il dit à sa mère : « Ô vieille de malheur, tes paroles, loin de me dissuader, ne font que me confirmer dans l’idée, que d’ailleurs je n’avais jamais abandonnée, que je suis Haroun Al-Rachid. Et, pour te prouver la chose à toi, sache que c’est moi-même qui ai donné l’ordre à mon chef de police, Ahmad-la-Teigne, de châtier les trois canailles de ce quartier ! Cesse donc de me dire que je rêve ou que je suis possédé du souffle du Cheitân. Prosterne-toi donc devant ma gloire, embrasse la terre entre mes mains, et demande-moi pardon des paroles inconsidérées et du doute que tu as émis à mon sujet ! »
À ces paroles de son fils, la mère n’eut plus aucun doute au sujet de la folie d’Aboul-Hassân, et elle lui dit : « Qu’Allah le miséricordieux fasse descendre la rosée de sa bénédiction sur ta tête, ô Aboul-Hassân, et qu’il te pardonne et te fasse la grâce de redevenir un homme doué de raison et de bon sens ! Mais, je t’en supplie, ô mon fils, cesse de prononcer le nom du khalifat et de te l’appliquer, car les voisins peuvent t’entendre et rapporter tes paroles au wali qui te fera alors arrêter et pendre à la porte du palais ! » Puis, ne pouvant plus résister à son émotion, elle se mit à se lamenter et à se frapper la poitrine de désespoir.
Or, cette vue, au lieu d’apaiser Aboul-Hassân, ne fit que l’exciter davantage ; et il se leva debout sur ses deux pieds, se saisit d’un bâton et se précipitant sur sa mère, dans l’égarement de sa fureur, il lui cria d’une voix terrifiante : « Je te défends, ô maudite, de m’appeler encore Aboul-Hassân ! Je suis Haroun Al-Rachid en personne, et, si tu en doutes encore, je te ferai entrer cette croyance dans la tête à coups de bâton ! » El la vieille, à ces paroles, bien que toute tremblante de frayeur et d’émotion, n’oublia pas qu’Aboul-Hassân était son fils, et, le regardant comme une mère regarde son enfant, lui dit d’une voix douce : « Ô mon fils, je ne crois pas que la loi d’Allah et de Son Prophète se soit retirée de ton esprit au point que tu puisses oublier le respect qu’un fils doit à sa mère qui l’a porté neuf mois dans son sein et l’a nourri de son lait et de sa tendresse ! Laisse-moi plutôt te dire, une dernière fois, que tu as tort de laisser ta raison s’enfoncer dans cette étrange songerie, et de t’arroger ce titre auguste de khalifat qui n’appartient qu’à notre maître et souverain l’émir des Croyants, Haroun Al-Rachid. Et, surtout, tu te rends coupable d’une bien grande ingratitude envers le khalifat, juste au lendemain du jour où il nous a comblés de ses bienfaits. Sache, en effet, que le chef trésorier du palais est venu hier dans notre maison, envoyé par l’émir des Croyants lui-même, et m’a remis de par son ordre un sac de mille dinars d’or, en l’accompagnant d’excuses pour la modicité de la somme, et en me promettant que ce ne serait pas le dernier cadeau de sa générosité ! »
En entendant ces paroles de sa mère, Aboul-Hassân perdit les derniers scrupules qu’il pouvait encore garder concernant son ancien état, et fut convaincu qu’il avait toujours été le khalifat, puisque c’était lui-même qui avait envoyé le sac de mille dinars à la mère d’Aboul-Hassân. Il regarda donc la pauvre femme avec de gros yeux menaçants et lui cria : « Prétends-tu, pour ton malheur, ô vieille calamiteuse, que ce n’est point moi qui t’ai envoyé le sac de l’or, et que ce n’est point par mon ordre que mon chef trésorier est venu te le remettre hier ? Et oseras-tu encore, après cela, m’appeler ton fils et me dire que je suis Aboul-Hassân le Débauché ? » Et, comme sa mère se bouchait les oreilles pour ne point entendre ces paroles qui la bouleversaient, Aboul-Hassân, excité à la limite de la frénésie, ne put plus se retenir et se jeta sur elle, le bâton à la main, et se mit à la rouer de coups.
Alors la pauvre vieille, ne pouvant taire sa douleur et son indignation de ce traitement, se mit à hurler, appelant les voisins au secours, en criant : « Ô ma calamité ! Accourez, ô musulmans ! » Et Aboul-Hassân, que ces cris ne faisaient que davantage exciter, continua à faire tomber les coups de bâton sur la vieille, en lui criant de temps à autre : « Suis-je ou ne suis-je pas l’émir des Croyants ? » Et la mère répondait, malgré les coups : « Tu es mon fils ! Tu es Aboul-Hassân le Débauché ! » Sur ces entrefaites, les voisins, accourus aux cris et au vacarme…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUARANTIÈME NUIT
Elle dit :
… Sur ces entrefaites, les voisins, accourus aux cris et au vacarme, pénétrèrent dans la chambre, et s’interposèrent aussitôt entre la mère et le fils pour les séparer, et arrachèrent le bâton des mains d’Aboul-Hassân et, indignés de la conduite d’un tel fils, ils l’empoignèrent pour l’empêcher de bouger et lui demandèrent : « Es-tu donc devenu fou, Aboul-Hassân, pour ainsi lever la main sur ta mère, cette pauvre vieille ? Et as-tu complètement oublié les préceptes du Livre Saint ? » Mais Aboul-Hassân, les yeux brillants de fureur leur cria : « Qui ça, Aboul-Hassân ? Qui appelez-vous de ce nom ? » Et les voisins, à cette question, furent extrêmement perplexes, et finirent par lui demander : « Comment ? N’es-tu pas Aboul-Hassân le Débauché ? Et cette bonne vieille n’est-elle pas ta mère, celle qui t’a élevé et nourri de son lait et de sa tendresse ? » Il répondit : « Ah ! fils de chiens, sortez de ma présence ! Je suis votre maître le khalifat Haroun Al-Rachid, émir des Croyants ! »
En entendant ces paroles d’Aboul-Hassân, les voisins furent tout à fait persuadés de sa folie ; et, ne voulant plus laisser libre de ses mouvements cet homme qu’ils avaient vu dans l’aveuglement de la fureur, ils lui lièrent les mains et les pieds, et envoyèrent l’un d’entre eux quérir le portier de l’hôpital des fous. Et, au bout d’une heure, le porteur de l’hôpital des fous, suivi de deux solides gardiens, arriva avec tout un attirail de chaînes et de menottes, et tenant à la main une cravache en nerf de bœuf. Et comme Aboul-Hassân, à cette vue, faisait de grands efforts pour se débarrasser de ses liens et lançait des injures aux assistants, le portier commença par lui appliquer sur l’épaule deux ou trois coups de son nerf de bœuf. Après quoi, sans plus tenir compte de ses protestations et des titres qu’il se donnait, ils le chargèrent de chaînes de fer et le transportèrent à l’hôpital des fous, au milieu du grand rassemblement des passants qui lui donnaient les uns un coup de poing et les autres un coup de pied, en le traitant de fou.
Lorsqu’il fut arrivé à l’hôpital des fous, il fut enfermé dans une cage de fer, comme une bête féroce, et régalé d’une râclée de cinquante coups de nerf de bœuf, comme premier traitement. Et, depuis ce jour, il subit, une fois le matin et une fois le soir, une râclée de cinquante coups de nerf de bœuf, si bien qu’au bout de dix jours de ce traitement, il changea de peau comme un serpent. Alors il fit un retour sur lui-même et pensa : « Voilà en quel état je suis réduit maintenant ! Il faut bien que ce soit moi qui aie tort, puisque tout le monde me traite de fou ! Pourtant il n’est pas possible que tout ce qui m’est arrivé au palais ne soit que l’effet d’un rêve ! Enfin ! Je veux refuser d’approfondir davantage cette question ou d’essayer encore de la comprendre, sinon je deviendrai réellement fou. D’ailleurs, ce n’est point là la seule chose que la raison de l’homme ne peut arriver à comprendre, et je m’en remets à Allah pour la solution ! »
Or, pendant qu’il était plongé dans ces nouvelles pensées, sa mère arriva, toute en larmes, voir en quel état il se trouvait et s’il était revenu à des sentiments plus raisonnables. Et elle le vit si amaigri et si exténué qu’elle éclata en sanglots ; mais elle parvint à surmonter sa douleur et finit par pouvoir le saluer tendrement ; et Aboul-Hassân lui rendit le salam d’une voix tranquille, comme un homme sensé, en lui répondant : « Sur toi le salut et la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions, ô mère mienne ! » Et la mère eut une grande joie de s’entendre appeler ainsi du nom de mère, et lui dit : « Le nom d’Allah sur toi, ô mon enfant ! Béni soit Allah qui t’a rendu la raison, et qui a remis à sa place ordinaire ta cervelle renversée ! » Et Aboul-Hassân, d’un ton fort contrit, répondit : « Je demande mon pardon d’Allah et de toi, ô ma mère ! En vérité, je ne comprends pas comment j’ai pu dire toutes les folies que j’ai dites, et me porter aux excès qu’un insensé seul est capable de faire ! C’est sans doute le Cheitân qui m’a possédé et m’a poussé à ces emportements ! Et il n’y a pas de doute qu’un autre que moi ne fût porté à des extravagances plus grandes encore ! Mais tout cela est bien fini, et me voici revenu de mon égarement ! » Et la mère sentit, à ces paroles, ses larmes de douleur se changer en larmes de bonheur, et s’écria : « Mon cœur est aussi joyeux, ô mon enfant, que si je venais de te mettre au monde une seconde fois. Béni soit Allah à jamais ! » Puis elle ajouta…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et se tut discrètement.
LA SIX CENT QUARANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … Béni soit Allah à jamais ! » Puis elle ajouta : « Certes ! tu n’as aucune faute à te reprocher, ô mon enfant, car tout le mal qui nous est arrivé est dû à ce marchand étranger que tu as invité la dernière nuit à manger et boire avec toi, et qui est parti au matin sans prendre la peine de fermer la porte derrière lui. Or tu dois savoir que chaque fois que la porte d’une maison est restée ouverte avant le lever du soleil, le Cheitân entre dans la maison et prend possession de l’esprit de ses habitants ! Et il arrive alors ce qui arrive ! Remercions donc Allah qui n’a pas permis de pires malheurs sur notre tête ! » Et Aboul-Hassân répondit : « Tu as raison, ô mère ! C’est l’œuvre de la possession du Cheitân ! Quant à moi, j’avais bien averti le marchand de Mossoul de ne point oublier de fermer la porte derrière lui, pour éviter l’entrée du Cheitân dans notre maison ; mais il a omis de le faire, et nous a causé de la sorte tous ces désagréments ! » Puis il ajouta : « Maintenant que je sens bien que ma cervelle n’est plus renversée et que les extravagances sont finies, je te prie, ô tendre mère, de parler au portier de l’hôpital des fous pour que je sois délivré de cette cage et des supplices que j’endure ici tous les jours ! » Et la mère d’Aboul-Hassân courut, sans différer davantage, avertir le portier que son fils avait recouvré la raison. Et le portier vint avec elle examiner Aboul-Hassân et l’interroger. Et comme les réponses étaient sensées, et qu’il reconnaissait être Aboul-Hassân et non plus Haroun Al-Rachid, le portier le tira de la cage et le délivra de ses chaînes. Et Aboul-Hassân, pouvant à peine se tenir sur ses jambes, regagna lentement sa maison, aidé par sa mère, et y resta couché plusieurs jours, jusqu’à ce que les forces lui fussent revenues, et que les effets des coups reçus se fussent un peu amendés.
Alors, comme il commençait à s’ennuyer de sa solitude, il se décida à reprendre sa vie d’autrefois, et à aller, vers le coucher du soleil, s’asseoir au bout du pont pour attendre l’arrivée de l’hôte étranger que pouvait lui envoyer la destinée.
Or, précisément, ce soir-là était le premier du mois ; et le khalifat Haroun Al-Rachid, qui, selon son habitude se déguisait en marchand au commencement de chaque mois, était sorti en secret de son palais, à la recherche de quelque aventure, et aussi pour voir par lui-même si le bon ordre régnait dans la ville comme il le souhaitait. Et il arriva de la sorte sur le pont, à l’extrémité duquel était assis Aboul-Hassân. Et Aboul-Hassân, qui guettait l’apparition des étrangers, ne fut pas long à apercevoir le marchand de Mossoul, qu’il avait déjà hébergé, et qui s’avançait de son côté, suivi, comme la première fois d’un grand esclave.
À cette vue, Aboul-Hassân, soit parce qu’il considérait le marchand de Mossoul comme la cause première de ses malheurs, soit parce qu’il avait pour habitude de ne jamais faire semblant de reconnaître les personnes qu’il avait invitées chez lui, se hâta de tourner la tête dans la direction du fleuve, pour n’être point obligé de saluer son ancien hôte. Mais le khalifat, qui, par ses espions, avait appris tout ce qui était arrivé à Aboul-Hassân depuis son absence, et le traitement qu’il avait subi à l’hôpital des fous, ne voulut point laisser passer cette occasion de se divertir encore davantage aux dépens d’un homme si singulier. Et, d’ailleurs, le khalifat, qui avait un cœur généreux et magnanime, avait également résolu de réparer un jour, autant qu’il serait en son pouvoir de le faire, le dommage subi par Aboul-Hassân, et de lui rendre d’une manière ou d’une autre, en bienfaits, le plaisir qu’il avait éprouvé en sa compagnie. Aussi, dès qu’il eut aperçu Aboul-Hassân, il s’approcha de lui, et pencha la tête par-dessus son épaule, vu qu’Aboul-Hassân tenait obstinément le visage tourné du côté du fleuve, et, le regardant dans les yeux, lui dit : « Le salam sur toi, ô mon ami Aboul-Hassân ! Mon âme désire t’embrasser ! » Mais Aboul-Hassân, sans le regarder et sans bouger, lui répondit : « Il n’y a pas de salam de moi à toi ! Marche ! Je ne te connais pas ! « Et le khalifat s’écria : « Comment, Aboul-Hassân ? Tu ne reconnais pas l’hôte que tu as hébergé toute une nuit chez toi ? » Il répondit : « Non, par Allah ! je ne te reconnais pas ! Va en ta voie ! » Mais Al-Rachid insista auprès de lui, et dit : « Pourtant, moi je te reconnais bien, et ne puis croire que tu m’aies si complètement oublié, alors qu’il y a à peine un mois d’écoulé depuis notre dernière entrevue et la soirée agréable que j’ai passée seul à seul avec toi, dans ta maison ! » Et, comme Aboul-Hassân continuait à ne pas répondre, en lui faisant signe de s’en aller, le khalifat lui jeta les bras autour du cou et se mit à l’embrasser, et lui dit : « Ô mon frère Aboul-Hassân, comme c’est mal à toi de me faire une telle plaisanterie ! Quant à moi, je suis bien décidé à ne pas te quitter avant que tu m’aies conduit une seconde fois dans ta maison et que tu m’aies raconté la cause de ton ressentiment contre moi. Car je vois bien que tu as quelque chose à me reprocher, à la manière dont tu me repousses ! » Aboul-Hassân, d’un ton indigné, s’écria : « Moi, te conduire une seconde fois à ma maison, ô visage de mauvais augure, après tout le mal dont ta venue chez moi a été la cause ? Allons ! tourne le dos et fais-moi voir la largeur de tes épaules ! » Mais le khalifat l’embrassa une seconde fois et lui dit : « Ah ! mon ami Aboul-Hassân, comme tu me traites durement ! S’il est vrai que ma présence chez toi t’a été une cause de malheur, sois bien persuadé que me voici prêt à réparer tout le dommage qu’involontairement je t’ai causé ! Raconte-moi donc ce qui s’est passé et le mal dont tu as pu souffrir, afin que je puisse y apporter un remède ! » Et, malgré les protestations d’Aboul-Hassân, il s’accroupit à côté de lui, sur le pont, et lui entoura le cou de son bras, comme un frère fait à son frère, et attendit la réponse.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUARANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Et, malgré les protestations d’Aboul-Hassân, il s’accroupit à côté de lui sur le pont, et lui entoura le cou de son bras, comme un frère fait à son frère, et attendit la réponse.
Alors Aboul-Hassân, gagné par les caresses, finit par dire : « Je veux bien te raconter les choses étranges qui me sont arrivées depuis notre soirée, et les malheurs qui s’en suivirent. Et tout cela à cause de cette porte que tu as omis de fermer derrière toi, et par où est entrée la Possession ! » Et il raconta tout ce qu’il avait cru voir en réalité et qu’il supposait être, sans aucun doute, une illusion suscitée par le Cheitân, et tous les malheurs et les mauvais traitements qu’il avait endurés dans la maison des fous, et le scandale causé dans le quartier par toute cette affaire, et la mauvaise réputation qu’il avait définitivement acquise auprès de tous les voisins ! Et il n’omit aucun détail, et apporta dans son récit une telle véhémence, et narra avec tant de crédulité l’histoire de sa prétendue Possession, que le khalifat ne put s’empêcher de pousser un grand éclat de rire ! Et Aboul-Hassân ne sut exactement à quoi attribuer ce rire, et lui demanda : « N’as-tu donc pas pitié du malheur qui s’est abattu sur ma tête, pour te moquer ainsi de moi ? Ou bien t’imagines-tu que c’est moi qui me moques de toi en te racontant une histoire imaginaire ? S’il en est ainsi, je vais lever tes doutes, et te donner les preuves de ce que j’avance ! » Et, ce disant, il retira les manches de sa robe et mit à nu ses épaules, son dos et son derrière, et montra de la sorte au khalifat les cicatrices et les colorations de sa peau meurtrie par les coups de nerf de bœuf.
À cette vue, le khalifat ne put s’empêcher de compatir réellement au sort du malheureux Aboul-Hassân. Il cessa dès lors d’avoir à son sujet nulle intention de raillerie, et l’embrassa cette fois avec beaucoup de véritable affection, et lui dit : « Par Allah sur toi, mon frère Aboul-Hassân, je te supplie de m’emmener à ta maison pour cette nuit encore, car je souhaite me réjouir l’âme de ton hospitalité. Et tu verras que demain Allah te rendra au centuple ton bienfait ! » Et il continua à lui dire de si bonnes paroles et à l’embrasser si affectueusement qu’il le décida, malgré sa résolution de ne jamais recevoir deux fois la même personne, à l’emmener à sa maison. Mais, en chemin, il lui dit : « Je cède à tes importunités, mais bien à regret. Et en retour je ne veux te demander qu’une seule chose, c’est de ne pas oublier cette fois de fermer la porte, en sortant demain matin de ma maison ! » Et le khalifat, étouffant en son intérieur le rire qui le secouait à cette croyance qu’avait toujours Aboul-Hassân de l’entrée chez lui du Cheitân par la porte ouverte, lui promit par serment qu’il prendrait soin de la fermer. Et ils arrivèrent de la sorte à la maison.
Lorsqu’ils furent entrés, et qu’ils se furent un peu reposés, l’esclave les servit et, après le repas, leur apporta les boissons. Et, la coupe à la main, ils se mirent à s’entretenir agréablement de choses et d’autres, jusqu’à ce que la boisson eût fermenté dans leur raison. Alors le khalifat mit adroitement la causerie sur les choses de l’amour, et demanda à son hôte s’il lui était arrivé de s’éprendre violemment des femmes, ou s’il s’était déjà marié, ou s’il était toujours resté célibataire. Et Aboul-Hassân répondit : « Je dois te dire, ô mon maître, que jusqu’aujourd’hui je n’ai aimé véritablement que les gais compagnons, les mets délicats, les boissons et les parfums ; et je n’ai rien trouvé de supérieur dans la vie à la causerie, la coupe à la main, avec les amis. Mais cela ne signifie point que je ne sache pas à l’occasion reconnaître les mérites d’une femme, surtout si elle est semblable à l’une de ces merveilleuses adolescentes que le Cheitân m’avait laissé voir dans ces songes fantastiques qui m’avaient rendu fou ; une de ces adolescentes toujours de belle humeur, qui savent chanter, jouer des instruments, danser et calmer l’enfant dont nous sommes les héritiers ; qui consacrent leur vie à notre plaisir et s’étudient à nous plaire et à nous divertir. Certes ! si jamais je rencontrais une telle adolescente, je me hâterais de l’acheter à son père et de me marier avec elle et d’avoir pour elle un profond attachement. Mais cette espèce-là n’existe que chez l’émir des Croyants et tout au plus chez le grand-vizir Giafar ! C’est pourquoi, ô mon maître, au lieu de tomber sur une femme qui risquerait de me gâter la vie par sa mauvaise humeur et ses imperfections, je préfère de beaucoup la société des amis de passage et des vieilles bouteilles que voici. De cette façon, ma vie est tranquille, et, si je deviens pauvre, je mangerai seul le pain noir de la misère ! »
Et, disant ces paroles, Aboul-Hassân vida d’un trait la coupe que lui tendait le khalifat, et roula aussitôt sur le tapis, la tête avant les pieds. Car le khalifat avait pris soin, cette fois encore, de mélanger au vin un peu de poudre de bang crétois. Et aussitôt l’esclave, sur un signe de son maître, chargea Aboul-Hassân sur son dos et sortit de la maison, suivi par le khalifat qui, cette fois, n’ayant plus l’intention de renvoyer Aboul-Hassân à sa maison, ne manqua pas de fermer soigneusement la porte derrière lui. Et ils arrivèrent au palais et, sans bruit, glissèrent à l’intérieur par la porte secrète, et pénétrèrent dans les appartements réservés…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vît apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUARANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ils arrivèrent au palais et, sans bruit, glissèrent à l’intérieur par la porte secrète, et pénétrèrent dans les appartements réservés.
Alors, le khalifat fit étendre Aboul-Hassân sur son propre lit, comme la première fois, et le fit vêtir de la même manière. Et il donna les mêmes ordres que précédemment, et recommanda à Massrour de venir le réveiller de bon matin, avant l’heure de la prière. Et il alla se coucher dans une pièce voisine.
Or, le lendemain matin, à l’heure dite, le khalifat, éveillé par Massrour, se rendit à la chambre où était encore assoupi Aboul-Hassân, et fit venir en sa présence toutes les adolescentes qui, la première fois, s’étaient trouvées dans les différentes salles traversées par Aboul-Hassân, ainsi que toutes les musiciennes et les chanteuses. Et il les fit ranger en bon ordre, et leur donna ses instructions. Puis, après avoir fait respirer un peu de vinaigre à Aboul-Hassân, qui aussitôt rendit par le nez un peu de pituite en éternuant, il se cacha derrière le rideau, et donna le signal convenu.
Aussitôt les chanteuses mêlèrent en chœur leurs voix délicieuses au son des harpes, des flûtes et des hautbois, et firent entendre un concert semblable au concert des anges dans le paradis. Et Aboul-Hassân, à ce moment, sortit de son assoupissement, et, avant que d’ouvrir les yeux, il entendit cette musique pleine d’harmonie qui acheva de l’éveiller. Et il ouvrit alors les yeux et se vit environné par les vingt-huit adolescentes qu’il avait rencontrées dans les quatre salles, sept par sept ; et il les reconnut en un clin d’œil, ainsi que le lit, la chambre, les tentures et les ornements. Et il reconnut également les mêmes voix qui l’avaient charmé les premières fois. Et alors il se leva, les yeux écarquillés, sur son séant, et passa à plusieurs reprises la main sur son visage, pour bien s’assurer de son état de veille.
À ce moment, ainsi qu’il avait été d’avance convenu, le concert cessa et un grand silence régna dans la chambre. Et toutes les dames baissèrent modestement les yeux devant les yeux augustes qui les regardaient. Alors Aboul-Hassân, à la limite de la stupéfaction, se mordit les doigts et s’écria, au milieu du silence : « Malheur à toi, ya Aboul-Hassân, ô fils de ta mère ! Maintenant, c’est l’illusion ; mais demain le nerf de bœuf, les chaînes, l’hôpital des fous et la cage de fer ! » Puis il cria encore : « Ah ! infâme marchand de Mossoul, puisses-tu étouffer dans les bras du Cheitân, ton maître, au fond de l’enfer. C’est encore toi qui, sans doute, n’ayant pas fermé la porte, a laissé le Cheitân entrer dans ma maison et me posséder. Et maintenant le Malin me renverse la cervelle et me fait voir des choses extravagantes. Qu’Allah te confonde, ô Cheitân, toi, ainsi que tes suppôts et tous les marchands de Mossoul ! » Et puisse la ville de Mossoul en entier s’écrouler sur ses habitants, et les étouffer sous ses décombres ! Puis il ferma les yeux, et les ouvrit, et les referma encore et les rouvrit, et cela à plusieurs reprises, et il s’écria : « Ô pauvre Aboul-Hassân, ce que tu as de mieux à faire, c’est de te rendormir tranquille, et de ne te réveiller que lorsque tu auras bien senti que le Malin est sorti de ton corps et que ta cervelle s’est rétablie à sa place ordinaire ! Sinon gare, demain, ce que tu sais ! » Et, disant ces paroles, il se rejeta dans son lit, ramena la couverture par-dessus sa tête, et, pour se donner à lui-même l’illusion de dormir, se mit à ronfler comme un chameau en rut ou comme un troupeau de buffles dans l’eau.
Or, le khalifat, derrière le rideau, fut, de voir et d’entendre cela, secoué d’un rire tel qu’il faillit étouffer.
Quant à Aboul-Hassân, il ne put réussir à dormir, car la jeune Canne-à-Sucre, sa préférée, s’approcha, suivant les instructions qu’elle avait reçues, du lit où il ronflait sans dormir, et s’assit sur le bord du lit, et, d’une voix gentille, dit à Aboul-Hassân : « Ô émir des Croyants, je préviens Ta Hautesse que c’est le moment de se réveiller pour la prière du matin ! » Mais Aboul-Hassân, d’une voix sourde, cria de dessous la couverture : « Confondu soit le Malin ! Retire-toi, ô Cheitân ! » Canne-à-Sucre, sans se déconcerter, reprit : « Sans doute l’émir des Croyants est sous l’effet d’un mauvais rêve ! Ce n’est pas le Cheitân qui te parle, ô mon seigneur, c’est la petite Canne-à-Sucre ! Éloigné soit le Malin ! Je suis la petite Canne-à-Sucre, ô émir des Croyants…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUARANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … Je suis la petite Canne-à-Sucre, ô émir des Croyants ! »
À ces paroles, Aboul-Hassân rejeta la couverture et, ouvrant les yeux, il vit en effet, assise sur le bord du lit, la petite Canne-à-Sucre, sa préférée, et, debout devant lui, sur trois rangs, les autres adolescentes qu’il reconnut une à une, Feuille-de-Rose, Cou-d’Albâtre, Bouquet-de-Perles, Étoile-du-Matin, Aube-du-Jour, Grain-de-Musc, Cœur-de-Grenade, Bouche-de-Corail, Noix-Muscade, Force-des-Cœurs, et les autres ! Et, à cette vue, il se frotta les yeux à se les enfoncer dans le crâne, et s’écria : « Qui êtes-vous ? et qui suis-je ? » Et toutes répondirent en chœur sur des tonalités différentes : « Gloire à notre maître le khalifat Haroun Al-Rachid, émir des Croyants, roi du monde ! » Et Aboul-Hassân, à la limite de la stupéfaction, demanda : « Ne suis-je donc pas Aboul-Hassân le Débauché ? » Elles répondirent en chœur, sur des tonalités différentes : « Éloigné soit le Malin ! Tu n’es pas Aboul-Hassân, mais Aboul-Hossn[1] ! Tu es notre souverain et la couronne sur notre tête ! » Et Aboul-Hassân se dit : « Cette fois, je vais bien voir si je dors ou si je veille ! » Et se tournant vers Canne-à-Sucre, il lui dit : « La petite, viens-t’en par ici ! » Et Canne-à-Sucre avança la tête, et Aboul-Hassân lui dit : « Mords-moi l’oreille ! » Et Canne-à-Sucre enfonça ses petites dents dans le lobe de l’oreille d’Aboul-Hassân, mais si cruellement qu’il se mit à hurler de travers, d’une façon épouvantable. Puis il s’écria : « Certes ! je suis l’émir des Croyants, Haroun Al-Rachid en personne ! »
Aussitôt les instruments de musique se mirent à jouer en même temps, sur un mode entraînant, un pas de danse, et les chanteuses entonnèrent une vive chanson, en chœur. Et toutes les adolescentes, se prenant la main, formèrent un grand cercle dans la chambre et, levant leurs pieds avec légèreté, se mirent à danser autour du lit, en répondant au chant principal par le refrain, et cela avec un tel entrain et une telle folie, qu’Aboul-Hassân, exalté soudain et pris d’enthousiasme, rejeta couvertures et coussins, lança son bonnet de nuit en l’air, sauta du lit, se déshabilla complètement en s’arrachant les vêtements, et, le zebb en avant, et le cul nu, il se jeta entre les adolescentes et se mit à danser avec elles, en faisant mille contorsions, et secouant son ventre, son zebb et son derrière, au milieu des éclats de rire et du tumulte grandissant. Et il fit tant de bouffonneries, et exécuta de tels mouvements divertissants, que le khalifat, derrière le rideau, ne put plus contenir l’explosion de son hilarité, et se mit à lancer une suite d’éclats de rire si forts qu’ils dominèrent le vacarme de la danse et le chant et le bruit des tambours de basque, des instruments à cordes et des instruments à vent ! Et il fut prit de hoquet, et tomba sur le derrière, et faillit perdre connaissance. Mais il parvint à se relever et, écartant le rideau, il avança la tête et cria : « Aboul-Hassân, ya Aboul-Hassân, as-tu donc juré de me faire mourir étouffé de rire ? »
À la vue du khalifat et au son de sa voix, la danse cessa tout d’un coup, les adolescentes se figèrent immobiles à la place où elles se trouvaient respectivement, et le bruit cessa si complètement que l’on eût entendu résonner la chute d’une aiguille sur le sol. Et Aboul-Hassân, stupéfait, s’arrêta comme les autres et tourna la tête dans la direction de la voix. Et il aperçut le khalifat, et, du même coup d’œil, reconnut en lui le marchand de Mossoul. Alors, rapide comme l’éclair qui brille, la compréhension de la cause de tout ce qui lui était arrivé lui traversa l’esprit. Et du coup il devina toute la plaisanterie. Aussi, loin de se déconcerter ou de se troubler, il fit semblant de ne point reconnaître la personne du khalifat ; et, voulant à son tour se divertir, il s’avança vers le khalifat et lui cria : « Ha ! ha ! te voilà donc, ô marchand de mon cul ! Attends ! tu vas voir comment je vais t’apprendre à laisser ouvertes les portes des honnêtes gens ! » Et le khalifat se mit à rire de tout son gosier, et répondit : « Par les mérites de mes saints aïeux, ô Aboul-Hassân, mon frère, je fais le serment, pour te dédommager de toutes les tribulations que nous t’avons causées, de t’accorder tout ce que peut souhaiter ton âme ! Et tu seras désormais, dans mon palais, traité comme mon frère ! » Et il l’embrassa avec effusion, en le tenant serré contre sa poitrine,
Après quoi, il se tourna vers les adolescentes et leur ordonna de revêtir son frère Aboul-Hassân d’habits tirés de son armoire particulière, en lui choisissant ce qu’il y avait de plus riche et de plus somptueux. Et les adolescentes se hâtèrent d’exécuter l’ordre. Et quand Aboul-Hassân fut complètement habillé, le khalifat lui dit : « Maintenant, Aboul-Hassân, parle ! Tout ce que tu me demanderas te sera accordé à l’instant ! » Et Aboul-Hassân embrassa la terre entre les mains du khalifat, et répondit : « Je ne veux demander qu’une chose à notre généreux maître, c’est de m’accorder la faveur de vivre toute ma vie à son ombre ! » Et le khalifat, extrêmement touché de la délicatesse des sentiments d’Aboul-Hassân, lui dit : « J’apprécie beaucoup ton désintéressement, ya Aboul-Hassân ! Aussi, non seulement je te choisis dès cet instant comme mon compagnon de coupe et comme mon frère, mais je t’accorde l’entrée libre et la sortie libre, à toute heure du jour et de la nuit, sans demande d’audience et sans demande d’absence. Bien plus ! Je veux que même l’appartement de Sett Zobéida, la fille de mon oncle, ne te soit point interdit comme aux autres. Et lorsque j’y entrerai, tu seras avec moi, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit ! »
En même temps, le khalifat assigna à Aboul-Hassân un splendide logement dans le palais, et commença par lui donner, comme premiers émoluments, dix mille dinars d’or. Et il lui promit qu’il veillerait lui-même à ne jamais le laisser manquer de rien. Après quoi, il le quitta pour aller au diwân régler les affaires du royaume…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUARANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Après quoi, il le quitta pour aller au diwân régler les affaires du royaume.
Alors, Aboul-Hassân ne voulut pas différer davantage d’aller informer sa mère de tout ce qui venait de lui arriver. Et il courut la trouver et lui raconta, par le détail, les faits étranges qui s’étaient produits, depuis le commencement jusqu’à la fin. Mais il n’y a pas d’utilité à les répéter. Et il ne manqua pas de lui expliquer, vu que son esprit à elle n’aurait pu tout seul arriver à cette compréhension, que c’était le khalifat lui-même qui lui avait joué tous ces tours, simplement pour se divertir. Et il ajouta : « Mais puisque tout a fini par tourner à mon avantage, qu’Allah le Bienfaiteur soit glorifié ! » Puis il se hâta de la quitter, en lui promettant qu’il reviendrait la voir tous les jours, et reprit le chemin du palais, tandis que le bruit de son aventure avec le khalifat et de sa situation nouvelle se répandait dans tout le quartier, et de là à travers tout Baghdad, pour ensuite gagner les provinces proches et reculées.
Quant à Aboul-Hassân, la faveur dont il jouissait auprès du khalifat, au lieu de le rendre arrogant ou désagréable, ne fit qu’exalter sa bonne humeur, son caractère jovial et sa gaieté. Et il ne se passait pas de jour où il ne divertit le khalifat et toutes les personnes du palais, les grands et les petits, par ses saillies pleines d’esprit et ses plaisanteries. Et le khalifat, qui ne pouvait plus se passer de sa société, le menait partout avec lui, même dans les appartements réservés, et chez son épouse, Sett Zobéida : ce qui était une faveur que jamais il n’avait accordée, même à son grand-vizir Giafar.
Or Sett Zobéida ne tarda pas à remarquer qu’Aboul-Hassân, chaque fois qu’il se trouvait avec le khalifat dans l’appartement des femmes, s’obstinait à fixer les yeux sur une de ses suivantes, celle précisément qui s’appelait Canne-à-Sucre, et que la petite, sous les regards d’Aboul-Hassân, devenait toute rouge de plaisir. C’est pourquoi elle dit un jour à son époux : « Ô émir des Croyants, sans doute que tu as remarqué, comme moi, les signes péremptoires d’amour qu’échangent Aboul-Hassân et la petite Canne-à-Sucre. Que penses-tu donc d’un mariage entre eux ? » Il répondit : « Cela se peut. Et je n’y vois pas d’inconvénient. J’aurais dû d’ailleurs y penser moi-même depuis longtemps. Mais les affaires du règne m’ont fait oublier ce soin-là. Et j’en suis fort contrarié, car j’avais promis à Aboul-Hassân, lors de la seconde soirée dans sa maison, de lui trouver une épouse de choix. Or je vois que Canne-à-Sucre fera bien l’affaire. Et nous n’avons plus qu’à les interroger tous deux pour voir si le mariage est à leur goût. »
Aussitôt ils firent venir Aboul-Hassân et Canne-à-Sucre, et leur demandèrent s’ils consentaient à se marier ensemble. Et Canne-à-Sucre, pour toute réponse, se contenta de rougir à l’extrême, et se jeta aux pieds de Sett Zobéida, en lui baisant le pan de sa robe, en signe de remercîment. Mais Aboul-Hassân répondit : « Certes, ô émir des Croyants, ton esclave Aboul-Hassân est le noyé de ta générosité. Mais avant de prendre chez lui, comme épouse, cette charmante jouvencelle dont le nom seul peint déjà les exquises qualités, je voudrais, avec ta permission, que notre maîtresse Sett Zobéida lui posât une question… » Et Sett Zobéida sourit et dit : « Et quelle est cette question, ô Aboul-Hassân ? » Il répondit : « Ô ma maîtresse, je voudrais savoir si mon épouse aime ce que j’aime. Or, moi, je dois te l’avouer, ô ma maîtresse, les seules choses que j’estime, sont la gaieté par le vin, le plaisir par les mets et la joie par le chant et les beaux vers ! Si donc Canne-à-Sucre aime ces choses-là, et que, en outre, elle soit sensible et ne dise jamais non à ce que tu sais, ô ma maîtresse, je consens à l’aimer d’un grand amour. Sinon, par Allah ! je reste célibataire ! » Et Sett-Zobéida, à ces paroles, se tourna en riant vers Canne-à-Sucre, et lui demanda : « Tu as entendu… Qu’as-tu à répondre ? » Et Canne-à-Sucre répondit en faisant avec la tête un signe qui signifiait oui.
Alors, le khalifat fit venir, sans tarder, le kâdi et les témoins qui écrivirent le contrat de mariage. Et, à cette occasion, on donna au palais de grands festins et de grandes réjouissances, pendant trente jours et trente nuits, au bout desquels les deux époux purent jouir l’un de l’autre, en toute tranquillité. Et ils passaient leur vie à manger, à boire et à rire aux éclats, en dépensant sans compter ! Et les plateaux des mets, des fruits, des pâtisseries et des boissons n’étaient jamais vides dans leur maison, et la joie et les délices marquaient tous leurs instants. Aussi, au bout d’un certain temps, à force de dépenser leur argent en festins et en divertissements, il ne leur resta plus rien entre les mains. Et, comme le khalifat, à cause du souci des affaires, avait oublié de fixer des émoluments réguliers à Aboul-Hassân, ils se réveillèrent un matin dénués de tout argent, et ne purent, ce jour-là, régler les traiteurs qui leur faisaient toutes les avances. Et ils se trouvèrent bien malheureux, et n’osèrent, par discrétion, alla demander quoique ce fût au khalifat ou à Sett Zobéida. Alors ils baissèrent la tête et se mirent à réfléchir sur la situation. Mais, le premier, Aboul-Hassân releva la tête et dit : « Certes, nous avons été bien prodigues ! Et je ne veux pas m’exposer à la honte d’aller demander de l’or, comme un mendiant. Et je ne veux pas davantage que tu ailles toi-même en demander à Sett Zobéida ! Aussi j’ai réfléchi à ce qu’il nous reste à faire, ô Canne-à-Sucre ! » Et Canne-à-Sucre répondit, en soupirant : « Parle ! Je suis prête à t’aider dans tes projets, car nous ne pouvons aller quémander, et, d’un autre côté, nous ne pouvons changer notre train de vie et diminuer nos dépenses, au risque de voir les autres nous regarder avec moins de considération ! » Et Aboul-Hassân dit : « Je savais bien, ô Canne-à-Sucre, que tu ne refuserais jamais de m’aider dans les diverses circonstances où nous nous trouverions de par les arrêts du destin ! Eh bien, sache qu’il n’y a plus pour nous qu’un seul moyen de nous tirer d’embarras, ô Canne-à-Sucre ! » Elle répondit : « Dis-le vite ! » Il dit : « C’est de nous laisser mourir…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUARANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … C’est de nous laisser mourir ! »
À ces paroles, la jeune Canne-à-Sucre, épouvantée, s’écria : « Non, par Allah ! moi je ne veux pas mourir ! Et tu peux employer pour toi seul ce moyen-là ! » Aboul-Hassân, sans s’émouvoir ni se fâcher, répondit : « Ah ! fille de la femme, je savais bien, quand j’étais célibataire, que rien ne valait la solitude ! Et la faiblesse de ton jugement me le montre plus que jamais ! Si, au lieu de me répondre avec cette promptitude, tu avais pris la peine de me demander des explications, tu te serais réjouie à l’extrême de cette mort que je te proposais et que je te propose encore ! Ne comprends-tu donc pas qu’il s’agit pour nous, afin d’avoir de l’or pour tout le restant de notre vie, de mourir d’une mort feinte et non point d’une mort véritable ? » À ces paroles, Canne-à-Sucre se mit à rire et demanda : « Et comment cela ? » Il dit : « Écoute donc ! Et n’oublie rien de ce que je vais t’enseigner. Voici ! Une fois que je serai mort, ou plutôt une fois que j’aurai feint d’être mort, car c’est moi qui mourrai le premier, tu prendras un linceul et tu m’y enseveliras. Cela fait, tu me mettras au milieu de cette chambre où nous sommes, dans la position prescrite, le turban posé sur le visage, et le visage et les pieds tournés dans la direction de la Kaaba sainte, vers la Mecque. Puis tu te mettras à pousser des cris perçants, à hurler de travers, à verser les larmes ordinaires et extraordinaires, à déchirer tes vêtements, et à faire semblant de t’arracher les cheveux ! Et, quand tu te seras bien mise dans cet état-là, tu iras, tout en pleurs et les cheveux défaits, te présenter à ta maîtresse Sett Zobéida, et, par des paroles entrecoupées de sanglots et d’évanouissements divers, tu lui raconteras ma mort en des termes attendrissants, puis tu t’affaleras sur le sol où tu resteras une heure de temps, pour ne reprendre tes sens qu’une fois noyée sous l’eau de roses dont on ne manquera pas de t’arroser. Et alors tu verras, ô Canne-à-Sucre, comment l’or entrera dans notre maison ! »
À ces paroles, Canne-à-Sucre répondit : « Certes ! cette mort-là est possible. Et je consens à t’aider à l’accomplir ! » Puis elle ajouta : « Mais, moi, quand et de quelle façon me faudra-t-il mourir ? » Il dit : « Commence d’abord par faire ce que je viens de te dire. Et ensuite Allah pourvoira ! » Et il ajouta : « Voici ! Je suis mort. » Et il s’étendit au milieu de la pièce, et fit le mort.
Alors, Canne-à-Sucre le déshabilla, l’ensevelit dans un linceul, lui tourna les pieds dans la direction de la Mecque, et lui posa le turban sur le visage. Après quoi, elle se mit à exécuter tout ce qu’Aboul-Hassân lui avait dit de faire en fait de cris perçants, de hurlements de travers, de larmes ordinaires et extraordinaires, de déchirement d’habits, d’arrachement de cheveux et de griffage de joues. Et, lorsqu’elle se fut mise dans l’état prescrit, elle alla, le visage jaune comme le safran et les cheveux épars, se présenter à Sett Zobéida, et commença par se laisser tomber tout de son long aux pieds de sa maîtresse, en poussant un gémissement capable de fendre le cœur de la roche.
À cette vue, Sett Zobéida, qui avait déjà entendu de son appartement les cris perçants et les hurlements de deuil qu’avait poussés Canne-à-Sucre dans le loin, ne douta plus, en voyant sa favorite Canne-à-Sucre dans cet état, que la mort n’eût fait son œuvre sur son époux Aboul-Hassân. Aussi, affligée à la limite de l’affliction, elle lui prodigua elle-même tous les soins que comportait son état, et la prit sur ses genoux, et réussit à la rappeler à la vie. Mais Canne-à-Sucre, éplorée et les yeux baignés de larmes, continua à gémir et à se griffer et à se tirer les cheveux et à se frapper les joues et la poitrine, en soupirant, à travers ses sanglots, le nom d’Aboul-Hassân. Et elle finit par raconter, en mots entrecoupés, qu’il était mort, pendant la nuit, d’une indigestion. Et elle ajouta, en se donnant un dernier coup sur la poitrine : « Il ne me reste plus qu’à mourir à mon tour. Mais qu’Allah prolonge d’autant la vie de notre maîtresse ! » Et elle se laissa encore une fois tomber aux pieds de Sett Zobéida ; et elle s’évanouit de douleur.
À cette vue, toutes les femmes se mirent à se lamenter autour d’elle, et à regretter la mort de cet Aboul-Hassân qui les avait tant diverties de son vivant par ses plaisanteries et sa bonne humeur. Et, par leurs pleurs et leurs soupirs, elles témoignèrent à Canne-à-Sucre, revenue de son évanouissement à force d’avoir été aspergée d’eau de roses, la part qu’elles prenaient à son deuil et à sa douleur.
Quant à Sett Zobéida, qui pleurait elle aussi, avec ses suivantes, la mort d’Aboul-Hassân, elle finit, après toutes les formules de condoléance que l’on dit en pareille circonstance, par appeler sa trésorière, et elle lui dit : « Va vite prendre, sur ma cassette particulière, un sac de dix mille dinars d’or, et apporte-le à cette pauvre, cette éplorée Canne-à-Sucre, afin qu’elle puisse faire célébrer dignement les funérailles de son époux Aboul-Hassân ! » Et la trésorière s’empressa d’exécuter l’ordre et fit charger le sac d’or sur le dos d’un eunuque qui alla le déposer à la porte de l’appartement d’Aboul-Hassân.
Ensuite Sett Zobéida embrassa sa suivante et lui dit encore de bien douces paroles, pour la consoler, et l’accompagna jusqu’à la sortie, en lui disant : « Qu’Allah te fasse oublier ton affliction, ô Canne-à-Sucre, et guérisse tes blessures, et prolonge ta vie de toutes les années qu’a perdues le défunt…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUARANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Qu’Allah te fasse oublier ton affliction, ô Canne-à-Sucre, et guérisse tes blessures, et prolonge ta vie de toutes les années qu’a perdues le défunt ! » Et l’éplorée Canne-à-Sucre baisa la main de sa maîtresse, en pleurant, et revint toute seule à son appartement.
Elle entra donc dans la pièce où Aboul-Hassân l’attendait, étendu toujours comme mort et enveloppé du linceul, et referma la porte en entrant, et commença par faire un éclat de rire de bon augure. Et elle dit à Aboul-Hassân : « Lève-toi donc d’entre les morts, ô père de la finesse, et viens traîner avec moi ce sac d’or, fruit de ta fourberie ! Par Allah, ce n’est pas encore aujourd’hui que nous mourrons de faim ! » Et Aboul-Hassân se hâta, aidé par sa femme, de se débarrasser du linceul, et, sautant sur ses deux pieds, il courut au sac de l’or et le traîna au milieu de la pièce, et se mit à danser autour, sur un seul pied.
Après quoi il se tourna vers son épouse et la félicita de la réussite de l’affaire et lui dit : « Mais ce n’est pas tout, ô femme ! À ton tour maintenant de mourir comme je l’ai fait, et à mon tour de gagner le sac ! El nous verrons de la sorte si je serai aussi habile auprès du khalifat que tu l’as été auprès de Sett Zobéida. Car il faut bien que le khalifat, qui s’est tellement diverti à mes dépens autrefois, sache bien qu’il n’est pas le seul à réussir dans ses plaisanteries ! Mais il est inutile de perdre le temps en vains propos ! Allons ! tu es morte ! »
Et Aboul-Hassân accommoda sa femme dans le linceul où elle l’avait elle-même enseveli, la plaça au milieu de la pièce, là même où il avait été étendu, lui tourna les pieds dans la direction de la Mecque et lui recommanda de ne plus donner signe de vie, quoi qu’il arrivât ! Cela fait, il s’accommoda lui-même tout à rebours de sa mise ordinaire, défit à moitié son turban, se frotta les yeux d’oignon pour se faire pleurer à grandes larmes, et, se déchirant les habits et s’arrachant la barbe et se frappant la poitrine à grands coups de poing, il courut trouver le khalifat qui, à ce moment, était entouré de son grand-vizir Giafar, de Massrour et de plusieurs chambellans, au milieu du diwân. Et le khalifat, de voir en cet état d’affliction et d’égarement le même Aboul-Hassân qu’il savait d’ordinaire si jovial et si insouciant, fut à la limite de l’étonnement et de l’affliction et, interrompant la séance du diwân, il se leva de sa place et courut à Aboul-Hassân qu’il pressa de lui raconter la cause de sa douleur. Mais Aboul-Hassân, un mouchoir sur les yeux, ne répondit que par un redoublement de pleurs et de sanglots, pour enfin laisser échapper de ses lèvres, entre mille soupirs et mille feintes d’évanouissement, le nom de Canne-à-Sucre, disant : « Hélas ! ô pauvre Canne-à-Sucre ! hélas, ô modique de chance ! Que vais-je devenir sans toi ? »
À ces paroles et à ces soupirs, le khalifat compris qu’Aboul-Hassân venait lui annoncer la mort de Canne-à-Sucre, son épouse, et il en fut extrêmement affecté. Et les larmes lui vinrent aux yeux, et il dit à Aboul-Hassân, en lui posant le bras sur l’épaule : « Qu’Allah l’ait en sa miséricode ! Et qu’il prolonge tes jours de tous ceux qui ont été enlevés à cette douce et charmante esclave ! Nous te l’avions donnée pour qu’elle fût pour toi un sujet de joie, et voici maintenant qu’elle te devient une cause de deuil ! La pauvre ! » Et le khalifat ne put s’empêcher de pleurer à chaudes larmes. Et il s’essuya les yeux avec son mouchoir. Et Giafar et les autres vizirs et les assistants pleurèrent également à chaudes larmes, et s’essuyèrent les yeux comme l’avait fait le khalifat.
Puis le khalifat eut la même idée que Sett Zobéida ; et il fit venir le trésorier, et lui dit : « Compte à l’instant dix mille dinars à Aboul-Hassân, pour les frais des funérailles de sa défunte épouse ! Et fais-les-lui porter à la porte de son appartement ! » Et le trésorier répondit par l’ouïe et l’obéissance, et se hâta d’aller exécuter l’ordre ! Et Aboul-Hassân, plus éploré que jamais, baisa la main du khalifat et se retira en sanglotant.
Lorsqu’il fut arrivé dans la pièce où l’attendait Canne-à-Sucre, toujours enveloppée du linceul, il s’écria : « Eh bien ! crois-tu être la seule à gagner autant de pièces d’or que tu as versé de larmes ? Tiens ! Regarde mon sac ! » Et il traîna le sac au milieu de la pièce ; et, après avoir aidé Canne-à-Sucre à sortir du linceul, il lui dit : « Oui ! mais ce n’est pas tout, ô femme ! Il s’agit maintenant de faire en sorte que, lorsque notre fourberie sera connue, nous ne puissions pas attirer sur nous le courroux du khalifat et de Sett Zobéida ! Voici donc ce que nous allons faire… » Et il s’apprêta à instruire Canne-à-Sucre de ses intentions à ce sujet. Et voilà pour eux deux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT QUARANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Et voilà pour eux deux !
Quant au khalifat ! Lorsqu’il eut terminé la séance du diwân, que d’ailleurs il abrégea ce jour-là, il se hâta d’emmener Massrour et d’aller au palais de Sett Zobéida lui faire ses condoléances au sujet de la mort de son esclave favorite. Et il entr’ouvrit la porte de l’appartement de son épouse, et la vit, étendue sur son lit et entourée de ses suivantes qui lui séchaient les yeux et la consolaient. Et il s’approcha d’elle et lui dit : « Ô fille de l’oncle, puisses-tu vivre les années perdues par ta pauvre favorite Canne-à-Sucre ! » À ce compliment de condoléance, Sett Zobéida, qui attendait l’arrivée du khalifat pour lui dire elle-même ses compliments de condoléance au sujet de la mort d’Aboul-Hassân, fut extrêmement surprise, et, croyant que le khalifat avait été mal informé, s’exclama : « Préservée soit la vie de ma favorite Canne-à-Sucre, ô émir des Croyants ! C’est à moi plutôt à prendre part à ton deuil ! Puisses-tu vivre, et longtemps survivre à ton compagnon, le défunt Aboul-Hassân ! Si tu me vois, en effet, si affligée, ce n’est qu’à cause de la mort de ton ami, et non point de celle de Canne-à-Sucre qui est, béni soit Allah ! en bonne santé ! »
À ces paroles, le khalifat, qui avait toutes les raisons les meilleures pour croire qu’il avait été bien informé de la vérité, ne put s’empêcher de sourire ; et, se tournant vers Massrour, il lui dit : « Par Allah ! ô Massrour, que penses-tu de ces paroles de ta maîtresse ? Elle, si sensée et si sage d’ordinaire, voici qu’elle a des absences d’esprit, tout comme les autres femmes ! Tant il est vrai qu’elles sont toutes les mêmes, en somme ! Je viens la consoler, et elle essaie de me faire de la peine et de me tromper en m’annonçant une nouvelle qu’elle sait être fausse ! Enfin, parle-lui, toi-même ! Et dis-lui ce que tu as vu et entendu comme moi ! Peut-être qu’alors elle changera de discours, et n’essaiera plus de vouloir nous donner le change ! » Et Massrour, pour obéir au khalifat, dit à la princesse : « Ô ma maîtresse, notre maître l’émir des Croyants a raison ! Aboul-Hassân est en bonne santé et en forces excellentes, mais il pleure et se lamente sur la perte de son épouse Canne-à-Sucre, ta favorite, morte cette nuit d’une indigestion ! Sache, en effet, qu’Aboul-Hassân vient de sortir à l’instant du diwân, où il était venu nous annoncer lui-même la mort de son épouse. Et il est retourné chez lui, bien désolé, et gratifié, grâce à la générosité de notre maître, d’un sac de dix mille dinars d’or, pour les frais des funérailles ! »
Ces paroles de Massrour, loin de persuader Sett Zobéida, ne firent que la confirmer dans la croyance que le khalifat voulait plaisanter, et elle s’écria : « Par Allah, ô émir des Croyants, ce n’est point aujourd’hui l’occasion de faire, selon ta coutume, des plaisanteries ! Je sais bien ce que je dis ; et ma trésorière te dira ce que les funérailles d’Aboul-Hassân me coûtent. Nous devrions plutôt prendre davantage part au deuil de notre esclave, et ne point rire, comme nous le faisons, sans tact et sans mesure ! » Et le khalifat, à ces paroles, sentit la colère l’envahir et s’écria : « Que dis-tu, ô fille de l’oncle ? Par Allah, serais-tu donc devenue folle, pour dire de pareilles choses ? Je te dis que c’est Canne-à-Sucre qui est morte ! Et d’ailleurs il est bien inutile que nous disputions plus longtemps à ce sujet ! Je vais te donner la preuve de ce que j’avance ! » Et il s’assit sur le diwân et se tourna vers Massrour et lui dit : « Hâte-toi de te rendre à l’appartement d’Aboul-Hassân pour voir, bien que je n’aie point besoin d’autre preuve que celle qui m’est connue, quel est des deux époux celui qui est mort ! Et reviens vite nous dire ce qu’il en est ! » Et, pendant que Massrour se hâtait d’aller exécuter l’ordre, le khalifat se tourna vers Sett Zobéida et lui dit : « Ô fille de l’oncle, nous allons bien voir maintenant qui de nous deux a raison ! Mais, du moment que tu insistes tellement sur une chose si claire, je veux gager contre toi tout ce que tu voudras gager ! » Elle répondit : « J’accepte la gageure ! Et je veux gager ce que j’ai de plus cher au monde, à savoir mon pavillon des peintures, contre ce que tu veux me proposer, de quelque peu de valeur que cela puisse être ! » Il dit : « Je propose, contre ta gageure, ce que moi j’ai de plus cher au monde, à savoir mon palais des délices ! Je pense, de cette façon, que je n’abuse pas ! Car mon palais des délices est de beaucoup supérieur en valeur et en beauté à ton pavillon des peintures ! » Sett Zobéida, extrêmement offusquée, répondit : « Il ne s’agit pas de savoir maintenant, pour nous diviser davantage, si ton palais est supérieur à mon pavillon ! Là-dessus tu n’auras qu’à écouter ce que l’on dit derrière toi ! Mais plutôt il s’agit de donner une sanction à notre gageure. Que la Fatiha soit donc entre nous ! » Et le khalifat dit : « Oui, que la Fatiha du Korân soit entre nous ! » Et ils récitèrent ensemble le chapitre liminaire du livre saint, pour sceller leur gageure…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT CINQUANTIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ils récitèrent ensemble le chapitre liminaire du livre saint, pour sceller leur gageure. Et ils attendirent dans un silence ennemi le retour du porte-glaive Massrour. Et voilà pour eux !
Quant à Aboul-Hassân, qui était aux aguets pour surveiller tout ce qui pouvait arriver, il vit de loin s’avancer Massrour et comprit le dessein pour lequel il venait le trouver. Et il dit à Canne-à-Sucre : « Ô Canne-à-Sucre voici que Massrour vient droit à notre maison ! Et il doit, sans aucun doute, être expédié chez nous à cause du démêlé qui a certainement surgi, au sujet de notre mort, entre le khalifat et Sett Zobéida. Il nous faudra donc commencer par donner raison au khalifat contre Sett Zobéida. Hâte-toi de faire la morte encore une fois, afin que je t’ensevelisse sans tarder ! » Et Canne-à-Sucre fit aussitôt la morte ; et Aboul-Hassân l’ensevelit dans le linceul et la disposa comme la première fois, pour aussitôt s’asseoir à côté d’elle, le turban défait, le visage allongé et le mouchoir sur les yeux.
Or au même moment entra Massrour. Et, à la vue de Canne-à-Sucre ensevelie au milieu de la pièce et d’Aboul-Hassân plongé dans le désespoir, il ne put s’empêcher de s’émouvoir et il prononça : « Il n’y a d’autre dieu qu’Allah ! Mon affliction sur toi est bien grande, ô pauvre Canne-à-Sucre, notre sœur, ô toi jadis si gentille et si douce ! Comme ta destinée est douloureuse pour nous tous ! Et qu’il a été rapide pour toi l’ordre du retour vers Celui qui t’a créée ! Puisses-tu du moins être prise en compassion et en bonnes grâces par le Rétributeur ! » Puis il embrassa Aboul-Hassân et, bien triste, se hâta de prendre congé de lui pour aller rendre compte au khalifat de ce qu’il avait contrôlé. Et il n’était point fâché de faire voir de la sorte à Sett Zobéida combien elle avait été opiniâtre et fautive en contredisant le khalifat.
Il entra donc chez Sett Zobéida et, après avoir embrassé la terre, dit : « Qu’Allah prolonge la vie de notre maîtresse ! La défunte est ensevelie au milieu de la chambre, et son corps est déjà gonflé sous le linceul, et elle sent mauvais ! Quant au pauvre Aboul-Hassân, je crois bien qu’il ne survivra pas à son épouse ! »
À ces paroles de Massrour, le khalifat se dilata d’aise et exulta de contentement ; puis, se tournant vers Sett Zobéida, devenue bien jaune de teint, il lui dit : « Ô fille de l’oncle, qu’attends-tu pour faire appeler le scribe qui doit écrire en mon nom le pavillon des peintures ? » Mais Sett Zobéida se mit à injurier Massrour, et, à la limite de l’indignation, dit au khalifat : « Comment peux-tu avoir confiance dans les paroles de cet eunuque, menteur et fils de menteur ? N’ai-je point vu moi-même, et mes esclaves n’ont-elles pas vu avec moi, ici, il y a une heure, ma favorite Canne-à-Sucre, éplorée et pleurant la mort d’Aboul-Hassân ? » Et, s’excitant à ses propres paroles, elle lança sa babouche à la tête de Massrour et lui cria : « Sors d’ici, ô fils de chien ! » Et Massrour, plus stupéfait encore que le khalifat, ne voulut point davantage irriter sa maîtresse, et, se courbant en deux, se hâta de déguerpir, en hochant la tête.
Alors Sett Zobéida, pleine de colère, se tourna vers le khalifat et lui dit : « Ô émir des Croyants, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour tu serais d’intelligence avec cet eunuque pour me faire un si grand chagrin et me donner à croire ce qui n’est pas ! Car je ne puis plus douter que ce rapport de Massrour n’ait été d’avance concerté pour me faire de la peine. En tout cas, je veux, pour te bien prouver que c’est moi qui ai raison, envoyer à mon tour quelqu’un voir quel est de nous deux celui qui a perdu la gageure. Et si c’est toi qui dis la vérité, c’est que je suis une insensée et que toutes nos suivantes sont insensées comme leur maîtresse ! Si au contraire c’est moi qui ai raison, je veux que tu m’accordes, outre le gain de la gageure, la tête de l’impertinent eunuque de poix ! » Et le khalifat, qui savait, par expérience, combien sa cousine était irritable, donna immédiatement son consentement à tout ce qu’elle lui demandait. Et Sett Zobéida fit aussitôt venir la vieille nourrice qui l’avait élevée, et en laquelle elle avait toute confiance, et lui dit : « Ô nourrice, rends-toi, sans tarder, à la maison d’Aboul-Hassân, le compagnon de notre maître le khalifat, et vois simplement qui est mort dans cette maison, si c’est Aboul-Hassân ou si c’est son épouse Canne-à-Sucre. Et reviens vite me rapporter ce que tu auras vu et appris ! » Et la nourrice répondit par l’ouïe et l’obéissance et, malgré ses vieilles jambes, se mit à presser le pas dans la direction de la maison d’Aboul-Hassân.
Or, Aboul-Hassân qui surveillait d’un œil attentif les allées et venues devant sa maison, aperçut au loin la vieille nourrice qui s’avançait péniblement ; et il comprit le motif de son envoi, et il se tourna vers son épouse et s’écria, en riant : « Ô Canne-à-Sucre, je suis mort…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT CINQUANTE UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ô Canne-à-Sucre, je suis mort ! » Et, comme il n’y avait pas de temps à perdre, il s’ensevelit lui-même dans le linceul, il s’étendit par terre, les pieds dans la direction de la Mecque. Et Canne-à-Sucre lui posa le turban sur le visage ; et, la chevelure défaite, elle se mit à se frapper les joues et la poitrine en poussant les cris de deuil. Et, à ce moment, entra la vieille nourrice. Et elle vit ce qu’elle vit ! Et, fort triste, elle s’approcha de l’éplorée Canne-à-Sucre et lui dit : « Qu’Allah reporte sur ta tête les années perdues par le défunt ! Hélas, ma fille Canne-à-Sucre, te voilà seule, dans le veuvage au milieu de ton adolescence ! Que vas-tu devenir sans Aboul-Hassân, ô Canne-à-Sucre ? » Et elle se mit à pleurer avec elle un certain temps. Puis elle lui dit : « Hélas, ma fille, il faut que je te quitte, bien qu’il m’en coûte beaucoup. Mais je dois retourner en toute hâte auprès de ma maîtresse Sett Zobéida pour la délivrer de l’affligeante inquiétude où l’a plongée ce menteur effronté, l’eunuque Massrour, qui lui a affirmé que la mort t’avait frappée, toi, à la place de ton époux Aboul-Hassân ! » Et Canne-à-Sucre dit, en gémissant : « Plût à Allah, ô ma mère, que cet eunuque eût dit vrai ! Je ne serais plus là pour le pleurer comme je le fais ! Mais d’ailleurs cela ne va plus tarder beaucoup ! Demain matin, au plus tard, on m’enterrera, morte de douleur. » Et, disant ces paroles, elle redoubla ses pleurs, ses soupirs et ses lamentations. Et la nourrice, plus attendrie que jamais, l’embrassa encore une fois et sortit lentement, pour ne point la troubler, et referma la porte derrière elle. Et elle alla rendre compte à sa maîtresse de ce qu’elle avait vu et entendu. Et, lorsqu’elle eut fini de parler, elle s’assit hors d’haleine d’en avoir tant fait pour son grand âge.
Lorsque Sett Zobéida eut entendu le rapport de sa nourrice, elle se tourna avec hauteur vers le khalifat et lui dit : « Avant tout, il faut pendre ton esclave Massrour, cet eunuque impertinent ! » Et le khalifat, à la limite de la perplexité, fit aussitôt venir Massrour en sa présence, et le regarda avec colère et voulut lui reprocher son mensonge. Mais Sett Zobéida ne lui on laissa pas le temps. Excitée par la présence de Massrour, elle se tourna vers sa nourrice et lui dit : « Répète, ô nourrice, devant ce fils de chien, ce que tu viens de nous dire ! » Et la nourrice, qui n’avait pu encore retrouver sa respiration, fut obligée de répéter son rapport devant Massrour. Et Massrour, irrité de ses paroles, ne put s’empêcher, malgré la présence du khalifat et de Sett Zobéida, de lui crier : « Ah ! vieille édentée, comment oses-tu mentir si impudemment, et avilir tes cheveux blancs ? Vas-tu me faire croire que je n’ai point vu de mes yeux Canne-à-Sucre morte et ensevelie ? » Et la nourrice, suffoquée, avança la tête avec fureur et lui cria : « Il n’y a de menteur que toi seul, ô nègre noir ! Ce n’est point par la pendaison qu’il faudrait te mettre à mort, mais en te coupant par morceaux et en te faisant manger ta propre chair ! » Et Massrour répliqua : « Tais-toi, vieille radoteuse ! Va raconter tes histoires aux filles du harem ! » Mais Sett Zobéida, outrée de l’insolence de Massrour, se mit soudain à éclater en sanglots, en lui jetant à la tête les coussins, les vases, les aiguières et les tabourets, et lui cracha à la figure, et finit par se jeter elle-même, anéantie, sur son lit, en pleurant.
Lorsque le khalifat eut vu et entendu tout cela, il fut à la limite de la perplexité, et frappa ses mains l’une dans l’autre, et dit : « Par Allah ! Massrour n’est pas le seul menteur ! Moi aussi je suis un menteur, et la nourrice aussi est une menteuse, et toi aussi tu es une menteuse, ô fille de l’oncle ! » Puis il baissa la tête et ne dit plus rien. Mais, au bout d’une heure de temps, il releva la tête et dit : « Par Allah ! il nous faut de suite savoir la vérité. Il ne nous reste donc qu’à aller à la maison d’Aboul-Hassân voir par nous-mêmes quel est de nous tous le menteur et quel est le véridique ! » Et il se leva et pria Sett Zobéida de l’accompagner ; et, suivi de Massrour, de la nourrice et de la foule des femmes, il se dirigea vers l’appartement d’Aboul-Hassân. Or, en voyant s’avancer ce cortège, Canne-à-Sucre ne put s’empêcher, bien qu’Aboul-Hassân l’eût d’avance prévenue que la chose pouvait bien arriver, de se montrer fort inquiète et agitée, et elle s’écria : « Par Allah ! ce n’est point chaque fois qu’on la jette que reste intacte la gargoulette ! » Mais Aboul-Hassân se mit à rire et dit : « Mourons tous deux, ô Canne-à-Sucre ! » Et il étendit sa femme par terre, l’ensevelit dans le linceul, s’accommoda lui-même dans une pièce de soie qu’il prit dans un coffre, et s’étendit à côté d’elle, en n’oubliant point de se poser son turban sur le visage, selon le rite. Et il avait à peine terminé ses préparatifs que la compagnie entra dans la salle.
Lorsque le khalifat et Sett Zobéida eurent vu le spectacle funèbre qui se présentait à leurs yeux, ils restèrent immobiles et muets. Puis soudain Sett Zobéida, que tant d’émotions en si peu de temps avaient complètement bouleversée, devint bien pâle, changea de visage et tomba évanouie dans les bras de ses femmes. Et lorsqu’elle fut revenue de son évanouissement, elle répandit un torrent de larmes et s’écria : « Hélas sur toi, ô Canne-à-Sucre ! tu n’as pu survivre à ton époux, et tu es morte de douleur ! » Mais le khalifat, qui ne voulait point l’entendre ainsi, et qui d’ailleurs pleurait également la mort de son ami Aboul-Hassân, se tourna vers Sett Zobéida et lui dit : « Non, par Allah ! ce n’est point Canne-à-Sucre qui est morte de douleur, mais c’est le pauvre Aboul-Hassân qui n’a pu survivre à son épouse ! Cela est certain…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT CINQUANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… le khalifat qui ne voulait point l’entendre ainsi, et qui d’ailleurs pleurait également la mort de son ami Aboul-Hassân, se tourna vers Sett Zobéida et lui dit : « Non, par Allah ! ce n’est point Canne-à-Sucre qui est morte de douleur, mais c’est le pauvre Aboul-Hassân qui n’a pu survivre à son épouse ! Cela est certain ! » Et il ajouta : « Oui ! mais tu pleures et tu t’évanouis, et de la sorte tu penses avoir raison ! » Et Sett Zobéida répondit : « Et toi tu penses avoir raison contre moi parce que ce maudit esclave t’a menti ! » Et elle ajouta : « Oui ! mais où sont les serviteurs d’Aboul-Hassân ? Qu’on aille vite me les chercher ! Et ils sauront bien nous dire, puisque ce sont eux qui ont enseveli leurs maîtres, quel est d’entre les deux époux celui qui est mort le premier, et quel est celui qui est mort de douleur ! » Et le khalifat dit : « Tu as raison, ô fille de l’oncle ! Et moi, par Allah ! je promets dix mille dinars d’or à celui qui m’annoncera cette nouvelle ! »
Or, à peine le khalifat avait-il prononcé ces paroles, qu’une voix se fit entendre de dessous le linceul de droite, qui disait : « Que l’on me compte les dix mille dinars ! J’annonce à notre maître le khalifat que c’est moi, Aboul-Hassân, qui suis mort le second, de douleur certainement ! »
À cette voix, Sett Zobéida et les femmes, saisies d’épouvante, poussèrent un grand cri en se précipitant vers la porte, tandis que, au contraire, le khalifat, qui avait de suite compris le tour joué par Aboul-Hassân, était pris d’un tel rire qu’il se renversait sur le derrière, au milieu de la salle, et s’écriait : « Par Allah, ya Aboul-Hassân, c’est moi maintenant qui vais mourir, à force de rire ! »
Puis, lorsque le khalifat eut fini de rire et que Sett Zobéida fut revenue de sa terreur, Aboul-Hassân et Canne-à-Sucre sortirent de leur linceul et, au milieu de l’hilarité générale, se décidèrent à raconter le motif qui les avait poussés à faire cette plaisanterie. Et Aboul-Hassân se jeta aux pieds du khalifat ; et Canne-à-Sucre embrassa les pieds de sa maîtresse ; et tous deux, d’un air fort contrit, demandèrent leur pardon. Et Aboul-Hassân ajouta : « Tant que j’étais célibataire, ô émir des Croyants, je n’avais que du mépris pour l’argent ! Mais cette Canne-à-Sucre, que je dois à ta générosité, a un tel appétit qu’elle mange les sacs avec leur contenu, et, par Allah ! elle est capable de dévorer tout le trésor du khalifat avec le trésorier ! » Et le khalifat et Sett Zobéida se mirent de nouveau à rire aux éclats. Et ils leur accordèrent à tous deux le pardon et leur firent, en outre, compter, séance tenante, les dix mille dinars gagnés par la réponse d’Aboul-Hassân, et, en plus, dix autres mille, pour leur délivrance de la mort.
Après quoi, le khalifat, que cette petite tromperie avait éclairé au sujet des dépenses et des besoins d’Aboul-Hassân, ne voulut point que son ami manquât désormais de paie régulière. Et il donna l’ordre à son trésorier de lui verser mensuellement des émoluments égaux à ceux de son grand-vizir. Et il voulut, bien plus que par le passé, qu’Aboul-Hassân restât son ami intime et son compagnon de coupe. Et ils vécurent tous dans la vie la plus délicieuse jusqu’à l’arrivée de la Séparatrice des amis, la Destructrice des palais et la Constructrice des tombeaux, l’Inexorable, l’Inévitable !
Et Schahrazade, cette nuit-là, ayant ainsi fini de raconter cette histoire, dit au roi Schahriar : « C’est là tout ce que je sais, ô Roi, au sujet du Dormeur Éveillé. Mais, si tu me le permets, je veux te raconter une autre histoire qui surpasse de beaucoup, et de toutes les manières, celle que tu viens d’entendre ! » Et le roi Schahriar dit : « Je veux d’abord, avant de te le permettre, que tu me dises le titre de cette histoire-là, Schahrazade ! » Elle dit : « C’est l’histoire des Amours de Zein Al-Mawassif ! » Il dit : « Et quelle est cette histoire que je ne connais pas ? » Schahrazade sourit et dit :
- ↑ Le Père de la Beauté.
LES AMOURS DE ZEIN AL-MAWASSIF
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait, dans les âges et les années d’il y a très longtemps, un tout à fait bel adolescent qui s’appelait Anis, et qui, certainement, était le plus riche, le plus généreux, le plus délicat, le plus excellent et le plus délicieux adolescent de son temps. Et comme, en outre, il aimait tout ce qui est aimable sur la terre, les femmes, les amis, la bonne chère, la poésie, la musique, les parfums, la verdure, les belles eaux, les promenades et tous les plaisirs, il vivait dans l’épanouissement de la vie bienheureuse.
Or, une après-midi, le bel Anis faisait une agréable sieste, selon son habitude, couché sous un caroubier de son jardin. Et il eut un rêve où il se voyait jouer et se plaire avec quatre beaux oiseaux et une colombe d’une blancheur éblouissante. Et son plaisir devenait intense de les caresser, de lisser leur plumage et de les embrasser, quand soudain un vilain gros corbeau bondit, le bec menaçant, sur la colombe et l’enleva, en dispersant les quatre gentils oiseaux, ses camarades. Et Anis se réveilla bien affecté, et se leva et sortit à la recherche de quelqu’un qui pût lui expliquer ce songe. Mais il erra longtemps sans trouver personne. Et déjà il songeait à s’en retourner chez lui, quand il vint à passer près d’une demeure de fort belle apparence, d’où il entendit, à son approche, s’élever une voix de femme, charmante et mélancolique, qui chantait ces vers :
La douce odeur du matin frais émeut le cœur des amoureux. Mais mon cœur captif est-il le cœur libre des amoureux ?
Ô fraîcheur des matins, as-tu jamais calmé un amour égal à celui de mon cœur pour un jeune faon plus délicat que le flexible rameau du bân ?
Et Anis se sentit l’âme pénétrée des accents de cette voix ; et, sollicité par le désir de connaître celle qui la possédait, il s’approcha de la porte qui se trouvait à moitié ouverte, et regarda à l’intérieur. Et il vit un jardin magnifique où, aussi loin que s’étendait le regard, il n’y avait que parterres harmonieux, berceaux fleuris et bosquets de roses, de jasmins, de violettes, de narcisses et de mille autres fleurs, où vivait, sous le ciel d’Allah, tout un peuple chanteur.
Aussi, attiré par la pureté de ces lieux, Anis n’hésita point à franchir la porte et à s’avancer dans le jardin. Et il aperçut, tout au fond de la verdure, au bout d’une allée coupée par trois arceaux, un groupe
blanc de jouvencelles en liberté…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT CINQUANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il aperçut, tout au fond de la verdure, au bout d’une allée coupée par trois grands arceaux, un groupe blanc de jouvencelles en liberté. Et il se dirigea de leur côté, et arriva sous le premier arceau où se lisait cette inscription gravée en caractères couleur de vermillon :
Ô maison, puisse la tristesse ne jamais franchir ton seuil, et jamais le temps s’appesantir sur la tête de tes habitants !
Puisses-tu, ô maison, durer éternellement pour ouvrir tes portes à l’hospitalité, et ne te jamais trouver trop étroite aux amis !
Et il arriva au second arceau, et put y lire cette inscription gravée en lettres d’or :
Ô maison de bonheur, puisses-tu durer aussi longtemps que tes bosquets se réjouiront de l’harmonie de tes oiseaux !
Que les parfums de l’amitié t’embaument aussi longtemps que tes fleurs languiront de se savoir si belles !
Et que tes possesseurs vivent dans la sérénité aussi longtemps que tes arbres verront mûrir leurs fruits, et que dans la voûte des cieux luiront de nouvelles étoiles !
Il arriva de la sorte au-dessous du troisième arceau, où il put lire ces vers gravés en caractères d’azur ultra-marin :
Ô maison du luxe et de la gloire, puisses-tu t’éterniser dans ta beauté, sous la chaude lumière et sous les ténèbres douces, malgré le temps et les mobilités !
Or, ayant franchi ce troisième arceau, il arriva au bout de l’allée ; et, devant lui, au pied des degrés de marbre lavé qui conduisaient à la demeure, il vit une jouvencelle qui devait être âgée de plus de quatorze ans, mais qui, sans aucun doute, n’avait pas atteint la quinzième année. Et elle était étendue sur un tapis de velours et appuyée sur des coussins. Et quatre autres jouvencelles l’entouraient et étaient à ses ordres. Et elle était belle et blanche comme la lune, avec des sourcils déliés aussi délicats qu’un arc formé de musc précieux, des yeux grands et noirs chargés de massacres et d’assassinats, une bouche de corail aussi petite qu’une noix muscade, et un menton qui disait à la perfection : « Me voici ! » Et certes elle eût embrasé d’amour, par tant de charmes, les cœurs les plus froids et les plus endurcis.
Aussi, le bel Anis s’avança vers la belle jouvencelle, s’inclina jusqu’à terre, porta sa main à son cœur, à ses lèvres et à son front, et dit : « Le salam sur toi, ô souveraine des pures ! » Mais elle lui répondit : « Comment as-tu osé, ô jeune impertinent, entrer dans un endroit défendu et qui ne t’appartient pas ! » Il répondit : « Ô ma maîtresse, la faute n’est point à moi, mais à toi et à ce jardin ! Par la porte à moitié ouverte j’ai vu ce jardin avec ses parterres de fleurs, ses jasmins, ses myrtes et ses violettes, et j’ai vu tout le jardin avec ses parterres et ses fleurs s’incliner devant la lune de beauté assise ici même où tu te trouves ! Et mon âme n’a pu résister au désir qui la poussait à venir s’incliner et rendre hommage avec les fleurs et les oiseaux ! » Et la jouvencelle se mit à rire et lui dit : « Comment t’appelles-tu ? » Il dit : « Ton esclave Anis, ô ma maîtresse ! » Elle dit : « Tu me plais infiniment, ya Anis ! Viens t’asseoir à côté de moi ! »
Elle le fit donc s’asseoir à côté d’elle et lui dit : « Ya Anis, j’ai bien envie de me distraire un peu ! Sais-tu jouer aux échecs ? » Il dit : « Oui, certes ! » Et elle fit signe à l’une des jeunes filles, qui aussitôt leur apporta un échiquier d’ébène et d’ivoire, aux coins d’or, dont les pions étaient rouges et blancs, les pions rouges taillés dans le rubis et les pions blancs taillés dans le cristal de roche. Et elle lui demanda : « Veux-tu les rouges ou les blancs ? » Il répondit : « Par Allah, ô ma maîtresse, je prendrai les blancs, car les rouges sont de la couleur des gazelles et, sous ce rapport et bien d’autres encore, ils te conviennent parfaitement ! » Elle dit : « Cela peut être ! » Et elle se mit à ranger les pions. Et le jeu commença.
Mais Anis, qui faisait bien plus attention aux charmes de sa partenaire qu’aux pions de l’échiquier, était ravi à l’extase de la beauté de ses mains qu’il trouvait semblables à de la pâte d’amandes, et de l’élégance et de la finesse de ses doigts semblables à du camphre blanc. Et il finit par s’écrier : « Comment pourrais-je, ô ma maîtresse, jouer sans danger contre de pareils doigts ? » Mais elle, tout à son jeu, lui répondit : « Échec au roi ! Échec au roi, ya Anis ! Tu as perdu ! » Puis, comme elle voyait qu’Anis ne prêtait point son attention au jeu, elle lui dit : « Anis, pour te rendre plus attentif au jeu, nous allons mettre, pour chaque partie, une gageure de cent dinars ! » Il répondit : « Certainement ! » Et il rangea les pions. Et, de son côté, la jouvencelle, qui de son nom s’appelait Zein Al-Mawassif, enleva à ce moment le voile de soie qui lui couvrait les cheveux et apparut comme une éclatante colonne de lumière. Et Anis, qui ne pouvait réussir à arracher ses regards de sa partenaire, continuait à ne point savoir ce qu’il faisait : tantôt il prenait les pions rouges au lieu des pions blancs, et tantôt il les faisait marcher tout de travers, si bien qu’il perdit cinq parties de suite, de cent dinars chacune. Et Zein Al-Mawassif lui dit : « Je vois que tu n’es pas plus attentif qu’auparavant. Faisons une gageure plus forte ! Mille dinars la partie ! » Mais Anis, malgré la somme en jeu, ne se comporta pas mieux, et perdit la partie. Alors elle lui dit : « Jouons tout ton or contre tout le mien ! » Il accepta, et perdit. Alors il joua ses boutiques, ses maisons, ses jardins et ses esclaves, et il les perdit les uns après les autres. Et il ne lui resta plus rien entre les mains.
Alors, Zein Al-Mawassif se tourna vers lui et dit : « Anis, tu es un insensé. Et je ne veux point que tu aies à te repentir d’être entré dans mon jardin et d’avoir fait ma connaissance. Je te rends donc tout ce que tu as perdu ! Lève-toi, Anis, et retourne en paix par où tu es venu ! » Mais Anis répondit : « Non, par Allah, ô ma souveraine, je n’ai aucun regret de ce que j’ai perdu ! Et si tu me demandes ma vie, elle t’appartiendra à l’instant. Mais, de grâce ! ne m’oblige point à te quitter ! » Elle dit : « Du moment que tu ne veux point reprendre ce que tu as perdu, va du moins trouver le kâdi et les témoins, et amène-les ici pour qu’ils dressent une donation en règle de ces biens que j’ai gagnés ! » Et Anis alla aussitôt chercher le kâdi et les témoins. Et le kâdi, bien que le calam eût failli lui tomber des doigts à la vue de la beauté de Zein Al-Mawassif, dressa l’acte de donation et y fit apposer leur sceau aux deux témoins. Puis il s’en alla…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT CINQUANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le kâdi, bien que le calam eût failli lui tomber des doigts à la vue de la beauté de Zein Al-Mawassif, dressa l’acte de donation et y fit apposer leur sceau aux deux témoins. Puis il s’en alla.
Alors, Zein Al-Mawassif se tourna vers Anis et lui dit, en riant : « Maintenant, Anis, tu peux t’en aller. Nous ne nous connaissons pas ! » Il dit : « Ô ma souveraine, me laisseras-tu donc partir sans la satisfaction du désir ? » Elle dit : « Je veux bien, Anis, satisfaire ce que tu dis, mais il me reste encore quelque chose à te demander ! Il te faudra m’apporter encore quatre vessies de musc pur, quatre onces d’ambre gris, quatre mille pièces de brocart d’or de la plus belle qualité, et quatre mules harnachées ! » Il dit : « Sur ma tête, ô ma maîtresse ! » Elle demanda : « Comment feras-tu pour me les avoir ? Tu ne possèdes plus rien. » Il dit : « Allah pourvoira ! J’ai des amis qui me prêteront tout l’argent qu’il me faut. » Elle dit : « Alors, hâte-toi de m’apporter ce que je t’ai demandé. » Et Anis, ne doutant point que ses amis ne lui vinssent en aide, sortit pour aller les trouver.
Alors Zein Al-Mawassif dit à l’une de ses suivantes, qui s’appelait Houboub : « Sors derrière lui, ô Houboub, et épie ses démarches. Et lorsque tu auras vu que tous les amis dont il parle auront refusé de lui venir en aide et, sous un prétexte ou sous un autre, l’auront éconduit, tu t’approcheras de lui et tu lui diras : « Ô mon maître Anis, ma maîtresse Zein Al-Mawassif m’envoie vers toi pour te dire qu’elle veut te voir à l’instant ! » Et tu l’emmèneras avec toi, et tu l’introduiras dans la salle de réception. Et alors il arrivera ce qu’il arrivera ! » Et Houboub répondit par l’ouïe et l’obéissance, et se hâta de sortir derrière Anis et de suivre ses démarches.
Quant à Zein Al-Mawassif, elle entra dans sa maison et commença par aller au hammam prendre un bain. Et ses suivantes lui donnèrent, après le bain, tous les soins nécessaires à une toilette extraordinaire ; puis elles épilèrent ce qu’elles avaient à épiler, frottèrent ce qu’elles avaient à frotter, parfumèrent ce qu’elles avaient à parfumer, allongèrent ce qu’elles avaient à allonger, et rétrécirent ce qu’elles avaient à rétrécir. Puis elles la vêtirent d’une robe brodée d’or fin, et placèrent sur sa tête une lame d’argent pour soutenir un riche diadème de perles, qui formait par derrière un nœud dont les deux bouts, ornés chacun d’un rubis de la grosseur d’un œuf de pigeon, retombaient sur ses épaules éblouissantes comme le vierge argent. Puis elles achevèrent de natter ses beaux cheveux noirs, parfumés de musc et d’ambre, en vingt-cinq nattes qui lui traînaient jusqu’aux talons. Et lorsqu’elles eurent fini de l’orner, et qu’elle devint semblable à une nouvelle épousée, elles se jetèrent à ses pieds et lui dirent, d’une voix tremblante d’admiration : « Qu’Allah te conserve dans ta splendeur, ô notre maîtresse Zein Al-Mawassif, et éloigne de toi à jamais le regard de l’envieux, et te préserve du mauvais œil ! » Et, pendant qu’elle s’essayait à faire de jolis pas à travers la pièce, elles ne cessèrent de lui adresser, du fond de leur âme, mille et mille compliments.
Sur ces entrefaites, la jeune Houboub revint avec le bel Anis qu’elle avait entraîné, une fois que ses amis l’eurent éconduit en refusant de lui venir en aide. Et elle l’introduisit dans la salle où se trouvait sa maîtresse Zein Al-Mawassif.
Lorsque le bel Anis eut aperçu Zein Al-Mawassif dans tout l’éclat de sa beauté, il s’arrêta ébloui et se demanda : « Est-ce bien elle ou bien l’une des nouvelles mariées qu’on ne voit qu’au paradis ? » Mais Zein Al-Mawassif, satisfaite de l’effet produit sur Anis, vint à lui en souriant, lui prit la main et le conduisit jusqu’au divan large et bas où elle s’asseyait, et le fit s’asseoir à côté d’elle. Puis elle fit signe à ses suivantes qui, aussitôt, apportèrent une grande table basse, faite d’un seul morceau d’argent et sur laquelle étaient gravés ces vers gastronomiques :
Enfonce-toi, avec les cuillers, dans les grandes saucières, et réjouis tes yeux et réjouis ton cœur de toutes ces espèces admirables et variées :
Les ragoûts et les fricassées, les rôtis et les bouillis, les confitures et les gelées, les fritures et les compotes à l’air libre ou à l’étuvée.
Ô cailles, ô poulets, ô chapons, ô attendrissants, je vous adore !
Et vous, agneaux, si longtemps nourris de pistaches, et maintenant farcis de raisins sur ce plateau, ô excellences !
Moi, bien que vous n’ayez point d’ailes comme les cailles et les poulets et les chapons, je vous aime bien !
Quant à toi, ô kabab grillé, qu’Allah te bénisse ! Jamais ta dorure ne me verra lui dire non !
Et toi, salade de pourpier, qui bois dans cette écuelle l’âme même des oliviers, mon esprit t’appartient, ô mon amie !
Frémis de plaisir dans ma poitrine, ô mon cœur, à la vue de cette couple de poissons, assis sur la menthe fraîche, au fond du plat.
Et toi, ma bouche bienheureuse, tais-toi et songe à manger ces délices qu’à jamais rediront les annales !
Alors, les suivantes leur servirent les mets parfumés. Et ils mangèrent ensemble jusqu’à satiété et se dulcifièrent. Et on leur apporta les flacons de vin, et ils burent dans la même coupe. Et Zein Al-Mawassif se pencha vers Anis et lui dit : « Voici que nous avons mangé ensemble le pain et le sel, et tu es ainsi devenu mon hôte ! Ne crois donc pas que je puisse maintenant garder la plus petite chose de ce qui t’a appartenu. Aussi, que tu le veuilles ou non, je te rends tout ce que je t’ai gagné ! » Et Anis fut bien obligé d’accepter, en don, les biens qui lui avaient appartenu. Et il se jeta aux pieds de la jouvencelle, et la remercia beaucoup. Mais elle le releva et lui dit : « Si vraiment, Anis, tu veux me remercier de ce don, tu n’as qu’à me suivre dans mon lit. Et là tu me prouveras, sérieusement cette fois, si tu es un excellent joueur d’échecs…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT CINQUANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Tu n’as qu’à me suivre dans mon lit. Et là tu me prouveras, sérieusement cette fois, si tu es un excellent joueur d’échecs ! » Et Anis, sautant sur ses deux pieds, répondit : « Par Allah, ô ma maîtresse, tu verras dans le lit que le roi blanc surpassera tous les cavaliers ! » Et, disant ces paroles, il l’emporta dans ses bras et, chargé de cette lune, courut dans la chambre à coucher dont la suivante Houboub lui ouvrit la porte. Et là il joua avec la jouvencelle une partie d’échecs, suivant toutes les règles d’un art consommé, et la fit suivre d’une seconde partie et d’une troisième partie, et ainsi de suite jusqu’à la quinzième partie, en faisant se comporter le roi, à tous les assauts, si vaillamment, que la jouvencelle, émerveillée à la fois et hors d’haleine, s’avoua vaincue et s’écria : « Tu as excellé, ô père des lances et des cavaliers ! » Puis elle ajouta : « Par Allah sur toi, ô mon maître, dis au roi de se reposer ! » Et, riant, elle se leva et mit fin, pour ce soir-là, aux parties d’échecs.
Alors, l’âme et le corps nageant dans l’océan des délices, ils se reposèrent un moment dans les bras l’un de l’autre. Et Zein Al-Mawassif dit à Anis : « C’est l’heure des repos bien gagnés, ô invincible Anis ! Mais je veux, pour mieux encore juger de ta valeur, savoir de toi si tu es aussi excellent dans l’art des vers que dans le jeu d’échecs ! Pourrais-tu donc disposer rythmiquement les divers épisodes de notre rencontre et de notre jeu, de façon à nous les bien fixer dans la mémoire ? » Et Anis répondit : « La chose m’est aisée, ô ma maîtresse ! » Et il s’assit sur la couche parfumée, et, pendant que Zein Al-Mawassif avait le bras autour de son cou et le caressait gentiment, il improvisa cette ode sublime :
« Levez-vous pour écouter l’histoire d’une jouvencelle de quatorze ans et quart, que je rencontrai dans un paradis, plus belle que toutes les lunes dans le ciel d’Allah !
Elle se balançait, gazelle, dans le jardin, et les rameaux flexibles des arbres s’inclinaient vers elle, et les oiseaux la chantaient.
Et j’apparus et je lui dis : « Le salam sur toi, ô soyeuse de joues, ô souveraine ! Dis-moi, que je le sache, le nom de celle dont les regards causent ma folie ! »
D’un accent plus doux que le bruit des perles dans la coupe, elle me dit : « Ne pourrais-tu tout seul trouver mon nom ? Sont-elles donc si cachées mes qualités, que mon visage ne puisse les refléter à tes yeux ? »
Je répondis : « Non, certes ! Non, certes ! Tu t’appelles, sans aucun doute, Ornement des Qualités ! Fais-moi l’aumône, ô Ornement des Qualités[1].
Et en retour, ô jouvencelle, voici du musc, voici de l’ambre, voici des perles, voici de l’or et des bijoux et toutes les gemmes et les soieries ! »
Alors l’éclair de son sourire brilla sur ses jeunes dents, et elle me dit : « Me voici donc ! Me voici, mon œil chéri ! »
Extases de mon âme, ô sa ceinture dénouée, ô sa chemise apparue, ô sa chair mise à nu, ô diamants ! Assouvissement de mes désirs ! Émanations d’elle lors du baiser, parfums ! Odeur de peau suprême, chaleur de creux, ô fraîcheur, mille baisers !
Mais vous, censeurs, qui me blâmez, ah ! si vous la connaissiez ! Voici ! Je vous dirai toute mon ivresse, et peut-être comprendrez-vous !
Son immense chevelure, couleur de nuit, triomphale s’éploie sur la blancheur de son dos jusqu’à terre. Mais les roses, sur ses joues incendiaires, allumeraient l’enfer.
Ses sourcils déliés sont un arc précieux ; ses paupières, chargées de flèches, tuent ; et chacun de ses regards est un glaive.
Sa bouche est un flacon de vin vieux ; sa salive est une eau de fontaine ; ses dents sont un collier de perles fraîchement cueillies de la mer.
Son cou, comme le cou de l’antilope, est élégant et admirablement taillé ; sa poitrine est une table de marbre sur laquelle reposent deux coupes renversées.
Son ventre a un creux embaumant les parfums les plus riches ; et en dessous, frontière de mon attente, gras et dodu, haut comme un trône de roi, assis entre deux colonnes de gloire, celui-là qui est la folie des plus sages.
Tantôt lisse, tantôt barbu, il est si sensible qu’il s’effarouche, comme un mulet, quand on le touche.
Son œil est rouge, ses lèvres sont charnues et douces, son museau est frais et charmant.
Si tu t’en approches avec vaillance, tu le trouves chaud, solide, résolu et somptueux, ne redoutant ni les fatigues, ni les assauts, ni les batailles.
Ainsi tu es, ô Zein Al-Mawassif, complète en charmes et en courtoisie. Et c’est pourquoi je n’oublierai ni les délices de nos nuits, ni la beauté de nos amours ! »
En entendant cette ode improvisée en son honneur, Zein Al-Mawassif fut transportée de plaisir et s’épanouit à la limite de l’épanouissement…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète se tut.
LA SIX CENT CINQUANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… En entendant cette ode improvisée en son honneur, Zein Al-Mawassif fut transportée de plaisir et s’épanouit à la limite de l’épanouissement. Et elle dit à Anis, en l’embrassant : « Ô Anis, quelle excellence ! Par Allah, je ne veux plus vivre qu’avec toi ! » Et ils passèrent ensemble le reste de la nuit, en ébats divers, caresses, copulations et autres choses semblables jusqu’au matin. Et ils passèrent la journée l’un près de l’autre, tantôt se reposant et tantôt mangeant et buvant et s’amusant jusqu’au soir. Et ils continuèrent à vivre de la sorte un mois durant, dans les transports de la joie et de la volupté.
Or, au bout du mois, la jeune Zein Al-Mawassif, qui était une femme mariée, reçut une lettre de son époux, où il lui annonçait son prochain retour. Et l’ayant lue, elle s’écria : « Puisse-t-il se casser les jambes ! Éloignée soit la laideur ! Voilà que notre vie délicieuse de maintenant va être troublée par l’arrivée de ce visage de mauvais augure ! » Et elle montra la lettre à son ami, et lui dit : « Quel parti allons-nous prendre, ô Anis ? » Il répondit : « Je m’en rapporte entièrement à toi, ô Zein ! Car, en fait de ruses et de finesses, les femmes ont toujours surpassé les hommes ! » Elle dit : « Oui ! Mais mon mari est un homme bien violent, et sa jalousie n’a point de limites ! Et ce nous sera bien difficile de ne point éveiller ses soupçons ! » Et elle réfléchit une heure de temps, et dit : « Je ne vois pas d’autre moyen de t’introduire dans la maison, après son arrivée maudite, que de te faire passer pour un marchand de parfums et d’épices ! Réfléchis donc sur ce métier, et surtout garde-toi bien, dans les marchandages, de le contrarier en quoi que ce soit ! » Et ils tombèrent tous deux d’accord sur les moyens à employer pour tromper le mari.
Sur ces entrefaites, le mari revint de voyage, et il fut à la limite de la surprise en voyant sa femme toute jaune, depuis les pieds jusqu’à la tête. Or, la coquine s’était mise elle-même dans cet état, en se frottant avec du safran. Et son mari lui demanda, bien effrayé, quelle maladie elle avait ; et elle répondit : « Si tu me vois si jaune, hélas ! c’est, non pas à cause d’une maladie, mais à cause de la tristesse et de l’inquiétude où j’ai été durant ton absence ! De grâce, ne voyage plus désormais sans prendre avec toi un compagnon, qui puisse te défendre ou te soigner ! Et de la sorte je serai plus tranquille à ton sujet ! » Il répondit : « De tout cœur, je le ferai ! Par ma vie, ton idée est sensée ! Tranquillise donc ton âme, et tâche de revenir à ton teint brillant d’autrefois ! » Puis il l’embrassa et se rendit à sa boutique, car c’était un grand marchand, juif de religion. Et son épouse également, la jouvencelle, était juive comme lui.
Or, Anis, qui avait pris toutes les informations au sujet du nouveau métier qu’il devait exercer, attendait le mari à la porte de sa boutique. Et, pour lier tout de suite connaissance, il lui offrit des parfums et des épices, à un prix bien au-dessous du cours. Et le mari de Zein Al-Mawassif, qui avait l’âme endurcie des juifs, fut tellement satisfait de cette affaire et des procédés d’Anis et de ses bonnes manières qu’il devint son client habituel. Et il finit, au bout de quelques jours, par lui proposer de s’associer avec lui, s’il pouvait apporter un capital suffisant. Et Anis ne manqua pas d’accepter une offre qui devait le rapprocher, sans aucun doute, de sa bien-aimée Zein Al-Mawassif ; et il répondit qu’il avait ce même désir et qu’il souhaitait fort être l’associé d’un marchand aussi estimable. Et ils dressèrent, sans tarder, leur contrat d’association, et y apposèrent leurs sceaux, devant deux témoins d’entre les notables du souk.
Or, le soir même, l’époux de Zein Al-Mawassif, pour fêter son contrat d’association, invita son nouvel associé à venir dans sa maison partager son repas. Et il l’emmena ; et, comme il était juif, et que les juifs n’ont pas de honte et ne gardent pas leurs femmes cachées aux regards des étrangers, il voulut lui faire connaître son épouse. Et il alla la prévenir de l’arrivée de son associé Anis, et lui dit : « C’est un jeune homme riche et de bonnes manières. Et je désire que tu viennes le voir ! » Et Zein Al-Mawassif, transportée de joie à cette nouvelle, ne voulut point tout de même laisser voir ses sentiments, et, feignant d’être extrêmement indignée, s’écria : « Par Allah ! comment oses-tu, ô père de la barbe, introduire les étrangers dans l’intimité de ta maison ! Et de quel œil prétends-tu m’imposer la dure nécessité de me montrer à eux, le visage découvert ou voilé ! Le nom d’Allah sur moi et autour de moi ! Dois-je oublier la modestie qui convient aux jeunes femmes, parce que tu as trouvé un associé ? Je me ferais plutôt couper en morceaux ! » Mais il répondit : « Quelles paroles inconsidérées tu dis là, ô femme ! Et depuis quand avons-nous résolu de faire comme les musulmans, dont c’est la loi de cacher leurs femmes ? Et quelle honte déplacée, et quelle modestie hors de saison ! Nous sommes des moïsites, et ta délicatesse à ce sujet est bien excessive pour une moïsite ! » Et il lui parla ainsi. Mais, en son âme, il pensait : « Quelle bénédiction d’Allah sur ma maison, d’avoir une épouse si chaste, si modeste, si sage et si pleine de retenue ! » Puis il se mit à lui parler avec tant d’éloquence qu’il finit par la persuader de venir rendre elle-même les devoirs de l’hospitalité à son nouvel associé.
Or, Anis et Zein Al-Mawassif se gardèrent bien, en se voyant, de laisser paraître qu’ils se connaissaient. Et Anis, durant tout le repas, tint les yeux baissés fort honnêtement ; et il feignait une grande discrétion, et ne regardait que le mari. Et le juif, en lui-même, pensait : « Quel jeune homme excellent ! » Aussi, le repas terminé, il ne manqua pas d’inviter Anis à venir le lendemain lui tenir également compagnie à table. Et Anis revint le lendemain, et le jour suivant ; et chaque fois il se comportait, en tout, avec un tact et une discrétion admirables.
Mais déjà le juif avait été assez frappé d’une chose étrange qui se passait chaque fois qu’Anis se trouvait à la maison. Il y avait, en effet, dans la maison, un oiseau apprivoisé…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et se tut discrètement.
LA SIX CENT SOIXANTIÈME NUIT
Elle dit :
… Il y avait, en effet, dans la maison, un oiseau apprivoisé qui avait été élevé par le juif et qui reconnaissait et chérissait beaucoup son maître. Mais, pendant l’absence du juif, cet oiseau avait reporté son affection sur Anis et avait pris l’habitude de venir se poser sur sa tête et sur ses épaules et de lui faire mille caresses, si bien que, lorsque son maître, le juif, fut de retour de voyage, il ne voulut plus le reconnaître, le considérant comme un étranger. Et il n’avait plus de cris de joie, de battements d’ailes et de caresses que pour le jeune Anis, l’associé de son maître. Et le juif pensait en lui-même : « Par Moussa et Aâroun ! cet oiseau m’a oublié ! Et sa conduite à mon égard me rend encore bien plus précieux les sentiments de mon épouse qui, elle, est tombée malade de la douleur de mon absence ! » Ainsi il pensait ! Mais une autre chose étrange ne tarda pas à le frapper et à lui donner mille idées torturantes.
En effet, il remarqua que son épouse, si réservée et si modeste en présence d’Anis, avait, dès qu’elle était endormie, des rêves bien extraordinaires. Elle tendait les bras, haletait, soupirait et faisait mille contorsions en prononçant le nom d’Anis et en lui parlant comme parlent les amoureuses les plus passionnées. Et le juif fut extrêmement étonné de constater cette chose-là plusieurs nuits de suite, et pensa : « Par le Pentateuque ! cela est pour me démontrer que les femmes sont toutes les mêmes, et que lorsque l’une d’elles est vertueuse et chaste et continente comme mon épouse, il faut que, d’une façon ou d’une autre, elle satisfasse ses mauvais désirs, ne fût-ce qu’en rêvant ! Éloigné de nous soit le Malin ! Quelle calamité que ces créatures formées avec la flamme de l’enfer ! » Puis il se dit : « Il me faut mettre mon épouse à l’épreuve ! Si elle repousse la tentation et si elle reste chaste et réservée, c’est que le fait de l’oiseau et le fait des rêves ne sont qu’une coïncidence d’entre les coïncidences sans conséquence ! »
Or, quand vint l’heure du repas habituel, le juif annonça à son épouse et à son associé qu’il était invité à aller chez le wali pour une grande commande de marchandises ; et il les pria d’attendre son retour pour commencer le repas. Puis il les quitta et sortit dans le jardin. Mais, au lieu d’aller chez le wali, il se hâta de revenir sur ses pas et de monter à l’étage supérieur de la maison ; là, d’une chambre dont la fenêtre donnait sur la salle de réunion, il pouvait surveiller ce qui allait se passer.
Or, il ne fut pas long à attendre le résultat, qui se manifesta de leur part sous forme de baisers et de caresses d’une intensité et d’une passion incroyables. Et, comme il ne voulait ni trahir sa présence ni leur laisser deviner qu’il n’était pas allé chez le wali, il fut obligé d’assister, pendant une heure de temps, aux manifestations forcenées des deux amants. Mais, après cette attente douloureuse, il descendit les retrouver et entra dans la salle, avec un visage souriant, tout comme s’il ne savait rien. Et, durant tout le repas, il se garda bien de leur laisser deviner ses sentiments, et eut beaucoup plus d’égards et d’attentions pour le jeune Anis, qui, d’ailleurs, se montra encore plus réservé et plus discret que d’habitude.
Mais lorsque le repas fut terminé et que le jeune Anis fut parti, le juif se dit : « Par les cornes de notre seigneur Moussa ! je vais brûler leur cœur par la séparation ! » Et il tira de son sein une lettre qu’il ouvrit et lut ; puis s’écria : « Voici que je vais être encore obligé de partir pour un long voyage. Car cette lettre m’arrive de mes correspondants de l’étranger, et il faut que j’aille les voir pour arranger avec eux une grosse affaire commerciale ! » Et Zein Al-Mawassif sut dissimuler parfaitement la joie que lui causait cette nouvelle, et dit : « Ô mon époux bien-aimé, tu vas donc me laisser mourir pendant ton absence ! Dis-moi au moins pendant combien de temps tu vas rester loin de moi ! » Il dit : « Pendant trois ans ou peut-être quatre ans, mais pas moins ni plus ! » Et elle s’écria : « Ah ! pauvre Zein Al-Mawassif ! quel sort est le tien de ne jamais jouir de là présence de ton époux ! Ô désespoir de mon âme ! » Mais il lui dit : « Que cela ne te désespère plus ! Car, cette fois, pour ne point te laisser seule et t’exposer à la maladie et à la tristesse, je veux que tu viennes avec moi ! Lève-toi donc et fais-toi aider par tes suivantes Houboub, Khoutoub, Soukoub et Roukoub pour faire tes paquets et tes ballots pour le départ ! »
À ces paroles, l’effondrée Zein Al-Mawassif devint bien jaune de teint, et ses yeux se mouillèrent de larmes, et elle ne put prononcer une seule parole. Et son mari, qui, en son intérieur, se dilatait de contentement, lui demanda d’un ton bien affectueux : « Qu’as-tu, Zein ? » Elle répondit : « Rien, par Allah ! Je suis seulement un peu émue de cette agréable nouvelle, en sachant que je ne vais plus être séparée de toi ! »
Puis elle se leva et se mit à faire les préparatifs du départ, aidée de ses suivantes, sous l’œil du juif, son époux. Et elle ne savait pas comment faire savoir la triste nouvelle à Anis. Enfin elle put profiter d’un moment pour tracer sur la porte d’entrée ces vers d’adieu à son ami :
À toi mes regrets, Anis ! Te voici demeuré seul, le cœur saignant de vives blessures.
La jalousie plus que la nécessité cause notre éloignement. Et la joie est entrée dans l’âme des envieux, à la vue de ma douleur et de mon désespoir.
Mais, j’en jure par Allah ! nul autre que toi, Anis, ne me possédera, vînt-il à moi accompagné de mille intercesseurs !
Après quoi, elle monta sur le chameau, qui avait été préparé pour elle, et, sachant qu’elle ne devait plus revoir Anis, elle s’enfonça dans sa litière en adressant des vers d’adieu à la maison et au jardin. Et toute la caravane se mit en marche, le juif en tête, Zein Al-Mawassif au milieu et les suivantes à la queue. Et voilà pour Zein et le juif, son époux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade, vit apparaître le matin, et se tut discrètement.
LA SIX CENT SOIXANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et voilà pour Zein et le juif, son époux.
Mais pour ce qui est du jeune Anis, voici ! Lorsque, le lendemain, il ne vit point venir au souk, selon son habitude, le marchand juif, son associé, il fut extrêmement surpris et attendit son arrivée jusqu’au soir. Mais ce fut en vain. Alors il se décida à aller voir par lui-même la cause d’une pareille absence. Et il arriva de la sorte devant la porte d’entrée, et lut l’inscription que Zein Al-Mawassif y avait elle-même gravée. Et il en comprit le sens et, bouleversé, il se laissa tomber à terre, en proie au désespoir. Et lorsqu’il fut revenu un peu de l’émotion que lui causait ce départ de sa bien-aimée, il s’informa d’elle auprès des voisins. Et il apprit ainsi que le juif, son époux, l’avait emmenée avec ses suivantes et un grand nombre de paquets et de ballots, sur dix chameaux, avec des provisions pour un très long voyage.
À cette nouvelle, Anis se mit à rôder comme un insensé à travers les solitudes du jardin ; et il improvisa ces vers :
« Arrêtons-nous pour pleurer au souvenir de la bien-aimée, ici, où se limitent les arbres de son jardin, où s’élève sa chère maison, où ses traces, comme dans mon cœur, ne peuvent être effacées ni par les vents du nord ni par les vents du sud.
Elle est partie ! mais mon cœur est avec elle, attaché à l’aiguillon qui presse la marche des chameaux.
Ah ! viens, ô nuit, viens refroidir mes joues brûlantes et calmer les feux qui consument mon cœur.
Ô brise du désert ! toi dont le souffle est parfumé de son haleine, ne t’a-t-elle ordonné aucun collyre pour sécher mes larmes, aucun remède pour ranimer mon corps glacé ?
Hélas ! hélas ! le conducteur de la caravane a donné le signal du départ pendant les ténèbres de la nuit, avant que le souffle du zéphyr matinal fût venu vivifier les vallons.
Les chameaux se sont agenouillés ; on a formé les ballots ; elle s’est placée dans la litière ; elle est partie.
Hélas ! elle est partie et m’a laissé égaré sur ses traces ! Je la suis de loin, en arrosant la poussière de mes larmes. »
Puis, comme il se laissait ainsi aller à ses réflexions et à ses souvenirs, il entendit croasser un corbeau qui avait son nid sur un des palmiers du jardin. Et il improvisa cette strophe :
« Ô corbeau ! que restes-tu faire dans le jardin de ma bien-aimée ? Viens-tu gémir, avec ta voix lugubre, sur les tourments de mon amour ! Hélas ! hélas ! cries-tu à mes oreilles ; et l’infatigable écho répète sans cesse : Hélas ! hélas ! »
Puis, Anis ne put plus résister à tant de peines et de tourments, et il s’étendit sur le sol et fut gagné par le sommeil. Et voici que sa bien-aimée lui apparut en songe ; et il se trouvait heureux avec elle ; et il la pressait dans ses bras, et elle, également. Mais soudain il se réveilla et l’illusion se dissipa. Et il ne put qu’improviser ces vers pour se consoler :
« Salut, image de la bien-aimée ! Tu m’apparais au milieu des ténèbres de la nuit, et tu viens un instant calmer la violence de mon amour.
Ah ! les songes sont le seul bonheur qui reste aux infortunés ! Mais combien plus amers les pleurs du réveil, quand s’évanouit la douce illusion !
Elle me parle, elle me sourit, elle me fait mille tendres caresses ; je tiens toute la félicité de la terre dans mes mains et je me réveille dans les larmes. »
Ainsi se lamentait le jeune Anis. Et il continua à vivre à l’ombre de la maison abandonnée, ne s’éloignant que pour prendre quelque nourriture dans son logis. Et voilà pour lui.
Quant à la caravane, lorsqu’elle fut arrivée à un mois de distance de la ville en question, elle fit halte. Et le juif fit dresser les tentes non loin d’une ville située sur la mer. Là, il dépouilla son épouse de ses riches habits, prit une longue baguette flexible, et lui dit : « Ah ! vile débauchée, ta peau salie ne pourra être nettoyée qu’avec ceci ! Qu’il vienne maintenant te délivrer d’entre mes mains, le jeune enculé Anis ! » Et, malgré ses cris et ses protestations, il la fustigea douloureusement, à tour de bras. Puis il jeta sur elle un vieux manteau en crin piquant, et alla à la ville chercher un maréchal, et dit au maréchal…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… et alla à la ville chercher un maréchal. Et il dit au maréchal : « Tu vas ferrer solidement les pieds de cette esclave ; après quoi tu lui ferreras les mains. Et elle me servira de monture ! » Et le maréchal, stupéfait, regarda le vieux et lui dit : « Par Allah ! c’est la première fois que je suis appelé pour ferrer des êtres humains ! Qu’a-t-elle donc fait, cette jeune esclave, pour mériter ce châtiment ? » Le vieux dit : « Par le Pentateuque ! c’est là le châtiment dont, nous autres juifs, nous punissons nos esclaves, quand nous avons à nous plaindre de leur conduite. » Mais le maréchal, ébloui par la beauté de Zein Al-Mawassif et impressionné à l’extrême par ses charmes, regarda le juif avec mépris et indignation, et lui cracha à la figure ; et, au lieu de toucher à la jouvencelle, il improvisa cette strophe :
« Puisses-tu, ô mulet, être ferré sur toute ta peau, avant que soient torturés ses pieds délicats ! Si tu étais sensé, ce serait avec des anneaux d’or que tu ornerais ses pieds charmants ! Car sois bien sûr qu’une si belle créature, en comparaissant devant le Souverain Juge, sera déclarée innocente et pure ! »
Puis le maréchal courut trouver le wali de la ville et lui raconta ce qu’il avait vu, en lui dépeignant la beauté merveilleuse de Zein Al-Mawassif et le traitement cruel que voulait lui faire éprouver le juif, son époux. Et le wali ordonna aux gardes d’aller immédiatement aux tentes et d’amener devant lui la belle esclave, le juif, et les autres femmes de la caravane. Et les gardes se hâtèrent d’exécuter l’ordre. Et, au bout d’une heure, ils revinrent, et introduisirent dans la salle des audiences, devant le wali, le juif, Zein Al-Mawassif et les quatre suivantes, Houboub, Khoutoub, Soukoub et Roukoub. Et le wali, ébloui de la beauté de Zein Al-Mawassif, lui demanda : « Comment t’appelles-tu, ma fille ? » Elle dit, en secouant ses hanches : « Ton esclave Zein Al-Mawassif, ô notre maître ! » Et il lui demanda : « Et cet homme, si laid, qui est-il ? » Elle répondit : « C’est un juif, ô mon maître, qui m’a enlevée à mon père et à ma mère, et m’a violentée, et a voulu, par toutes sortes de mauvais traitements, me forcer à abjurer la sainte foi des musulmans, mes pères ! Et, tous les jours, il me fait subir la torture, et essaie, par ce moyen, de vaincre ma résistance ! » Et, comme preuves de ce que j’avance, ô notre maître, voici les traces des coups dont il ne cesse de m’accabler ! » Et elle découvrit, avec beaucoup de pudeur, le haut de ses bras, et montra les raies qui les marquaient. Puis elle ajouta : « Et d’ailleurs, ô notre maître, l’honorable maréchal témoignera du traitement barbare que ce juif voulait me faire subir ! Et mes suivantes confirmeront mes paroles ! Quant à moi, je suis une musulmane, une Croyante, et je témoigne qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Môhammad est l’Envoyé d’Allah ! »
À ces paroles, le wali se tourna vers les suivantes, Houboub, Khoutoub, Soukoub et Roukoub, et leur demanda : « Est-ce vrai, ce que dit votre maîtresse ? » Elles répondirent : « C’est vrai ! » Alors le wali se tourna vers le juif et, avec des yeux étincelants, lui cria : « Malheur à toi, ennemi d’Allah ! Pourquoi as-tu arraché cette adolescente à son père et à sa mère, à sa maison et à sa patrie, et l’as-tu torturée, et as-tu essayé de lui faire renier notre sainte religion et de la précipiter dans les horribles erreurs de ta croyance maudite ? » Le juif répondit : « Ô notre maître, par la vie de la tête d’Yâcoub, de Moussa et d’Aâroun ! je te jure que cette adolescente est mon épouse légale ! » Alors le wali s’écria : « Qu’on lui donne la bastonnade ! » Et les gardes le jetèrent par terre et lui appliquèrent sur la plante des pieds cent coups de bâton, et sur le dos cent coups de bâton, et sur les fesses cent coups de bâton. Et, comme il continuait à crier et à vociférer, en protestant et en affirmant que Zein Al-Mawassif lui appartenait légalement, le wali dit : « Du moment qu’il ne veut pas avouer, qu’on lui coupe les mains et les pieds, et qu’on le fustige ! »
En entendant cette terrible sentence, le juif s’écria : « Par les cornes sacrées de Moussa ! s’il ne faut que cela pour me sauver, eh bien ! j’avoue que cette femme n’est pas mon épouse et que je l’ai enlevée à sa famille ! » Alors le wali prononça : « Du moment qu’il avoue, qu’on le jette en prison ! Et qu’il y reste toute sa vie ! Ainsi soient punis les juifs mécréants ! » Et les gardes aussitôt exécutèrent l’ordre. Et ils traînèrent le juif en prison. Et c’est là qu’il mourra, certainement, dans sa mécréantise et sa laideur. Qu’Allah ne l’ait jamais en compassion ! Et qu’il précipite son âme juive dans les feux du dernier étage de l’enfer ! Mais nous, nous sommes des Croyants ! Et nous reconnaissons qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Môhammad est l’Envoyé d’Allah !
Quant à Zein Al-Mawassif, elle baisa la main du wali et, accompagnée de ses quatre suivantes, Houboub, Khoutoub, Soukoub et Roukoub, elle regagna les tentes et ordonna aux chameliers de lever le campement et de se mettre en route pour le pays de son bien-aimé Anis.
Or, la caravane voyagea sans encombre, et, vers le soir du troisième jour, elle arriva à un monastère chrétien qui était habité par quarante moines et par leur patriarche. Et ce patriarche, qui s’appelait Danis, était justement assis devant la porte du monastère, pour respirer le frais, lorsque la belle jouvencelle vint à passer sur son chameau, la tête hors de la litière. Et le patriarche, à la vue de ce visage de lune, sentit se rajeunir sa vieille chair morte ; et il frémit dans ses pieds, dans son dos, dans son cœur et dans sa tête. Et il se leva de son siège et fit signe à la caravane de s’arrêter, et, s’inclinant jusqu’à terre devant la litière de Zein Al-Mawassif, invita l’adolescente à descendre se reposer avec toute sa troupe. Et il l’engagea vivement à passer la nuit au monastère, en lui assurant que les chemins étaient infestés, la nuit, de brigands coupeurs de routes. Et Zein Al-Mawassif ne voulut point refuser l’offre de cette hospitalité, même de la part de chrétiens et de moines, descendit de sa litière, et entra au monastère suivie de ses quatre compagnes.
Or, le patriarche Danis, embrasé d’amour par la beauté et les charmes de Zein Al-Mawassif…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Or le patriarche Danis, embrasé d’amour par la beauté et les charmes de Zein Al-Mawassif, ne savait comment s’y prendre pour lui déclarer sa passion. Et la chose était, en effet, bien ardue. Enfin il crut trouver le bon moyen, qui fut d’envoyer à l’adolescente le moine le plus éloquent d’entre les quarante moines du monastère. Et ce moine arriva auprès de l’adolescente, dans l’intention de parler en faveur de son patriarche. Mais, à la vue de cette lune de beauté, il sentit sa langue se lier de mille nœuds dans sa bouche, et, au contraire, son doigt du ventre parler éloquemment sous sa robe, en se soulevant comme une trompe d’éléphant. Et, à cette vue, Zein Al-Mawassif se mit à rire de tout son gosier avec Houboub, Khoutoub, Soukoub et Roukoub. Puis, voyant que le moine, sans parler, restait avec son outil en l’air, elle fit signe à ses suivantes, qui aussitôt se levèrent et le poussèrent hors de la chambre.
Alors le patriarche Danis, voyant que le moine revenait d’un air bien piteux, se dit : « Sans doute, il n’a pas su la persuader ! » Et il dépêcha vers elle un second moine. Et le second moine alla auprès de Zein Al-Mawassif ; mais il lui arriva exactement ce qui était arrivé au premier. Et il fut chassé, et revint tête basse auprès du patriarche, qui alors envoya un troisième, puis un quatrième et un cinquième, et ainsi de suite, jusqu’au quarantième. Et, chaque fois, le moine envoyé en pourparlers, revenait sans résultat, n’ayant pu exposer la mission de son patriarche, et n’ayant manifesté sa présence que par le soulèvement de l’héritage paternel.
Lorsque le patriarche vit tout cela, il se ressouvint du proverbe qui dit : « Il n’est que de se gratter avec ses propres ongles et de marcher sur ses propres pieds ! » Et il résolut d’agir par lui-même.
Alors il se leva et entra d’un pas grave et mesuré dans la chambre où se tenait Zein Al-Mawassif. Et voici ! Exactement, comme à ses moines, il lui arriva tout ce qui leur était arrivé en fait de langue nouée en mille nœuds et d’éloquence d’outil. Et, devant le rire et les railleries de la jouvencelle et de ses compagnes, il sortit de la chambre, le nez allongé jusqu’à ses pieds.
Or, dès qu’il fut sorti, Zein Al-Mawassif se leva et dit à ses compagnes : « Par Allah ! il nous faut déguerpir de ce monastère au plus vite, car j’ai bien peur que ces moines terribles et leur patriarche puant ne viennent nous violenter cette nuit, et nous salir de leur contact avilissant ! » Et, à la faveur des ténèbres, elles se glissèrent toutes les cinq hors du monastère, et, remontant sur leurs chameaux, continuèrent leur route pour leur pays. Et voilà pour elles.
Quant au patriarche et aux quarante moines, lorsqu’ils se furent réveillés le matin, et qu’ils se furent aperçus de la disparition de Zein Al-Mawassif, ils sentirent leurs boyaux se tordre de désespoir. Et ils se réunirent dans leur église, pour chanter comme des ânes, selon leur habitude. Mais, au lieu de chanter leurs antiennes et de réciter leurs prières ordinaires, voici ce qu’ils improvisèrent ! Le premier moine chanta :
« Rassemblez-vous, mes frères, avant que mon âme vous abandonne, car mon heure dernière est venue !
Le feu de l’amour consume mes os, la passion dévore mon cœur, et je brûle pour une beauté qui est venue dans cette région nous frapper tous des flèches mortelles lancées par les cils de ses paupières. »
Et le second moine répondit par ce chant :
« Ô toi qui voyages loin de moi, pourquoi, ayant ravi mon pauvre cœur, ne m’as-tu emmené avec toi ?
Tu es partie, en emportant mon repos ! Ah ! puisses-tu bientôt revenir pour me voir expirer dans tes bras ! »
Le troisième moine chanta :
« Ô toi dont l’image brille à mes yeux, remplit mon âme et habite mon cœur.
Ton souvenir est plus doux à mon esprit que le miel n’est doux aux lèvres de l’enfant : et tes dents qui sourient à mes rêves sont plus brillantes que le glaive d’Azraël.
Comme une ombre tu as passé, en versant dans mes entrailles une flamme dévorante !
Si jamais en songe tu t’approchais de mon lit, tu le trouverais baigné de mes pleurs. »
Le quatrième moine répondit :
« Retenons nos langues, mes frères, et ne laissons plus échapper des paroles superflues qui affligeraient nos cœurs souffrants.
Ô pleine lune de la beauté ! ton amour a répandu ses brillants rayons sur ma tête obscure, et tu m’as incendié d’une passion infinie. »
Le cinquième moine, en sanglotant, chanta :
« Mon seul désir, c’est ma bien-aimée ! Sa beauté efface l’éclat de la lune ; sa salive est plus douce que l’eau précieuse des raisins ; l’ampleur de ses hanches loue leur Créateur.
Voici que mon cœur est consumé par la flamme de l’amour qu’elle m’a inspiré, et que mes larmes coulent de mes yeux comme des gouttes d’onyx. »
Le sixième moine, alors, poursuivit :
« Ô rameaux chargés de roses, ô étoiles des cieux, où est celle qui apparut sur notre horizon, et dont l’influence mortelle fait périr les hommes sans l’aide des armes, par son seul regard ? »
Ensuite le septième moine entonna ce chant :
« Mes yeux, qui l’ont perdue, se remplissent de larmes ; l’amour s’accroît et la patience diminue.
Ô douce enchanteresse apparue sur nos chemins ; l’amour s’accroît et la patience diminue. »
Et, ainsi de suite, tous les autres moines entonnèrent, chacun à son tour, un chant improvisé, jusqu’à ce que vint le tour de leur patriarche qui alors, d’une voix sanglotante, chanta :
« Mon âme est pleine de trouble, et l’espoir m’a abandonné.
Une beauté ravissante a passé dans notre ciel, et m’a enlevé le repos.
Maintenant le sommeil fuit mes paupières et la tristesse les consume.
Seigneur, je me plains à Toi de mes souffrances ! Seigneur, fais que, mon âme partie, mon corps s’évanouisse comme une ombre ! »
Lorsqu’ils eurent terminé leurs chants, les moines se jetèrent la face contre les dalles de leur église, et pleurèrent longtemps. Après quoi ils résolurent de dessiner, de mémoire, le portrait de la fugitive, et de le placer sur l’autel de leur mécréantise. Mais ils ne purent accomplir leur projet, car la mort les surprit et mit un terme à leurs tourments, après qu’ils eurent creusé eux-mêmes leurs tombeaux, dans le monastère.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-SlXÈME NUIT
Elle dit :
… car la mort les surprit et mit un terme à leurs tourments, après qu’ils eurent creusé eux-mêmes leurs tombeaux, dans le monastère. Et voilà pour les quarante moines et pour leur patriarche !
Quant à la caravane, la vigilance d’Allah lui écrivit la sécurité et, après un voyage sans désagrément, elle arriva, en bonne santé, au pays natal. Et Zein Al-Mawassif, aidée de ses compagnes, descendit de sa litière et mit pied à terre dans son jardin. Et elle entra dans la demeure, et fit aussitôt tout préparer, et parfumer le lit à l’ambre précieux, avant d’envoyer Houboub prévenir de son retour son bien-aimé Anis.
Or, à ce moment, Anis, qui continuait à passer ses jours et ses nuits dans les larmes, était étendu, somnolent, sur sa couche, et faisait un rêve où il voyait distinctement sa bien-aimée de retour. Et, comme il avait foi dans les songes, il se leva bien ému et se dirigea aussitôt vers la maison de Zein Al-Mawassif pour s’assurer si le songe était véritable. Et il franchit la porte du jardin. Et aussitôt il sentit dans l’air le parfum de l’ambre et du musc de sa bien-aimée. Et il vola vers la demeure et entra dans la chambre où, déjà prête, Zein Al-Mawassif attendait son arrivée. Et ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre, et restèrent longtemps enlacés, en se prodiguant les marques passionnées de leur amour. Et, pour ne point s’évanouir de joie et d’émotion, ils burent à une gargoulette pleine d’une boisson rafraîchissante au sucre, aux limons et à l’eau des fleurs. Après quoi ils s’épanchèrent mutuellement, en se racontant tout ce qui leur était arrivé pendant l’absence ; et ils ne s’interrompaient que pour se caresser et s’embrasser tendrement. Et Allah seul sait le nombre et l’intensité des preuves d’amour de cette nuit-là. Et, le lendemain, ils envoyèrent la jeune Houboub chercher le kâdi et les témoins, qui, séance tenante, écrivirent leur contrat de mariage. Et tous deux vécurent dans la vie bienheureuse, jusqu’à l’arrivée de la Faucheuse des adolescents et des jouvencelles ! Mais gloire et louange à Celui qui distribue, dans Sa justice, la beauté et les plaisirs ! Et la prière et la paix sur le Seigneur des Envoyés, Môhammad, qui a réservé à ses Croyants le paradis !
Lorsque Schahrazade eut ainsi raconté cette histoire, la petite Doniazade s’écria : « Ô ma sœur, quelle saveur, quelles délices, quelle pureté et quelle excellence dans tes paroles ! » Et Schahrazade dit : « Mais qu’est tout cela comparé à ce que je veux encore raconter, si toutefois veut me le permettre le Roi, au sujet du Jeune Homme Mou ? » Et le roi Schahriar dit : « Certes ! Schahrazade, je veux te le permettre encore cette nuit, car les paroles m’ont satisfait, et je ne connais pas l’Histoire du Jeune Homme Mou ! » Et Schahrazade dit :
- ↑ Zein Al-Mawassif, signifie Ornement des Qualités.
HISTOIRE DU JEUNE HOMME MOU
Il est raconté — entre beaucoup d’autres choses
— qu’un jour, comme le khalifat Haroun Al-Rachid
était assis sur son trône, un jeune eunuque entra,
qui tenait entre ses mains une couronne d’or rouge
incrustée de perles, de rubis et de toutes les espèces
les plus inestimables de gemmes et de pierreries. Et
cet eunuque enfant embrassa la terre entre les
mains du khalifat et dit : « Ô émir des Croyants,
notre maîtresse Sett Zobéida m’envoie te transmettre
ses salams et ses hommages et, en même temps, te
dire que cette merveilleuse couronne que voici, et
que tu connais bien, manque encore à son sommet
d’une grosse gemme, et qu’on n’a jamais pu en
trouver une assez belle pour cette place vide. Et
elle a fait faire partout des recherches chez les
marchands, et elle a fouillé dans ses propres trésors,
mais jusqu’à présent elle n’a pu encore trouver la
pierre digne de surmonter cette couronne ! C’est
pourquoi elle souhaite que tu fasses faire toi-même
des recherches à ce sujet, pour satisfaire son
désir. »
Alors, le khalifat se tourna vers ses vizirs, ses émirs, ses chambellans et ses lieutenants et leur dit : « Cherchez tous cette gemme, aussi grande et aussi belle que le souhaite Zobéida ! »
Or, ils cherchèrent tous cette gemme-là, parmi les pierreries de leurs épouses ; mais ils ne trouvèrent rien selon le souhait de Sett Zobéida. Et ils rendirent compte au khalifat de l’inutilité de leurs recherches. Et le khalifat se rétrécit fort de la poitrine, à cette nouvelle, et leur dit : « Comment se fait-il que je sois le khalifat et le roi des rois de la terre, et qu’il me soit impossible d’avoir une chose aussi misérable qu’une pierre ? Malheur à vos têtes ! Allez faire des recherches chez les marchands ! » Et ils firent des recherches chez tous les marchands, qui répondirent unanimement : « Ne cherchez pas davantage ! Notre seigneur le khalifat ne pourra trouver cette gemme que chez un jeune homme de Bassra, qui s’appelle Abou-Môhammad-les-Os-Mous ! » Et ils allèrent rendre compte au khalifat de ce qu’ils avaient fait et appris, en lui disant : « Notre seigneur le khalifat ne pourra trouver cette gemme que chez un jeune homme de Bassra, qui s’appelle Abou-Môhammad-les-Os-Mous ! »
Alors le khalifat ordonna à Giafar, son vizir, d’envoyer aviser l’émir de Bassra qu’il eût immédiatement à chercher cet Abou-Môhammad-les-Os-Mous, pour le faire conduire en toute diligence à Baghdad, entre ses mains…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… chercher cet Abou-Môhammad-les-Os-Mous pour le faire conduire en toute diligence à Baghdad, entre ses mains. Et Giafar écrivit aussitôt une missive à ce sujet, et chargea le porte-glaive Massrour d’aller en toute hâte la porter lui-même à Bassra, à l’émir El-Zobéidi, gouverneur de la ville. Et Massrour partit, sans tarder, remplir sa mission.
Lorsque le gouverneur de Bassra, l’émir El-Zobéidi, reçut la missive du khalifat, il répondit par l’ouïe et l’obéissance ; et, après avoir rendu à l’envoyé du khalifat tous les honneurs et les égards dus, il lui donna des gardes pour le conduire chez Abou-Môhammad-les-Os-Mous. Et Massrour arriva bientôt au palais habité par ce jeune homme ; et il fut reçu à la porte par une troupe d’esclaves richement vêtus, auxquels il dit : « Avisez votre maître que l’émir des Croyants le réclame à Baghdad ! » Et les esclaves entrèrent aviser de la chose leur maître.
Quelques instants après, le jeune Abou-Môhammad parut lui-même sur le seuil de sa demeure et vit l’envoyé du khalifat avec les gardes de l’émir de Bassra ; et il s’inclina jusqu’à terre devant lui et dit : « L’obéissance aux ordres de l’émir des Croyants ! » Puis il ajouta : « Mais je vous supplie, ô très honorables, d’entrer un instant honorer ma maison ! » Massrour répondit : « Nous ne pouvons pas trop nous attarder par ici, à cause des ordres pressés de l’émir des Croyants qui n’attend que ton arrivée à Baghdad ! » Il dit : « Il faut tout de même me donner le temps nécessaire pour faire mes préparatifs de voyage. Entrez donc vous reposer ! » Massrour et ses compagnons firent encore quelques difficultés, pour la forme, mais finirent par suivre le jeune homme.
Et ils virent, dès le vestibule, de magnifiques rideaux de velours bleu tissé d’or fin, et des marbres précieux, et des bois ouvragés, et toutes sortes de merveilles, et partout, aussi bien sur les tapisseries que sur les meubles, les murs ou les plafonds, des métaux précieux et des scintillements de pierreries. Et l’hôte les fit conduire à une salle de bain, éblouissante de propreté et parfumée comme un cœur de rosier, si splendide que le palais du khalifat ne possédait point la pareille. Et, après le bain, les esclaves les revêtirent tous de somptueuses robes de brocart vert, semées de motifs en perles, en or délié et en pierreries de toutes les couleurs. Et, en leur faisant leurs souhaits d’après le bain, les esclaves leur offrirent, sur des plateaux de porcelaine dorée, les coupes de sorbets et les rafraîchissements. Après quoi, entrèrent cinq jeunes garçons, beaux comme l’ange Harout, qui leur présentèrent à chacun, de la part du maître, après le souhait du bain, une bourse de cinq mille dinars, en cadeau. Et alors entrèrent les premiers esclaves qui les avaient menés au hammam ; et ils les prièrent de les suivre, et les conduisirent dans la salle de réunion où les attendait Abou-Môhammad, assis sur un divan de soie, et les bras appuyés sur des coussins ourlés de perles. Et il se leva en leur honneur et les fit asseoir à côté de lui, et mangea et but avec eux toutes sortes de mets admirables, et des boissons comme il n’y en a que dans les palais des Kaïssars.
Alors, le jeune homme se leva et dit : « Je suis l’esclave de l’émir des Croyants ! Les préparatifs sont faits, et nous pouvons partir pour Baghdad ! » Et il sortit avec eux et, pendant qu’ils remontaient sur leurs chevaux, les esclaves, empressés à ses ordres, l’aidèrent à mettre le pied dans l’étrier et à enfourcher une mule blanche comme le vierge argent, dont la selle et les harnachements scintillaient de tous les feux des ors et des pierreries qui les agrémentaient. Et Massrour et le jeune Abou-Môhammad se mirent à la tête de l’escorte et sortirent de Bassra pour prendre la route de Baghdad. Et, après un heureux voyage, ils arrivèrent dans la Cité de Paix, et entrèrent dans le palais de l’émir des Croyants.
Lorsqu’il fut introduit en présence du khalifat, il embrassa par trois fois la terre entre ses mains et prit une attitude pleine de modestie et de déférence. Et le khalifat l’invita à s’asseoir. Et il s’assit respectueusement sur le bord du siège, et, avec un langage fort distingué, il dit : « Ô émir des Croyants, ton esclave soumis a appris, sans qu’on le lui dît, le motif pour lequel il est appelé devant son souverain. C’est pourquoi, au lieu d’une seule gemme, il a cru de son devoir d’humble sujet d’apporter à l’émir des Croyants ce que le sort lui a fixé ! » Et, ayant dit ces paroles, il ajouta : « Si notre maître le khalifat me le permet, je vais faire ouvrir les coffres que j’ai apportés avec moi, en cadeau d’un féal à son souverain ! » Et le khalifat lui dit : « Je n’y vois point d’inconvénient. »
Alors Abou-Môhammad fit monter les coffres dans la salle de réception. Et il ouvrit le premier coffre, et en tira, entre autres merveilles qui ravissaient la raison, trois arbres d’or dont les tiges étaient en or, les branches et les feuilles en émeraudes et en aigues-marines, et les fruits, des rubis, des perles et des topazes au lieu d’oranges, de pommes et de grenades.
Puis, pendant que le khalifat s’émerveillait de la beauté de ces arbres, il ouvrit le second coffre et, entre autres splendeurs, en tira…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Puis, pendant que le khalifat s’émerveillait de la beauté de ces arbres, il ouvrit le second coffre, et, entre autres splendeurs, en tira un pavillon de soie et d’or, incrusté de perles, d’hyacinthes, d’émeraudes, de rubis, de saphirs et de bien d’autres gemmes aux noms inconnus ; et le poteau central de ce pavillon était en bois d’aloès indien ; et tous les pans de ce pavillon étaient piqués de gemmes de toutes les couleurs, et l’intérieur en était ornementé de dessins d’un art merveilleux qui représentaient des ébats gracieux d’animaux et des vols d’oiseaux ; et tous ces animaux et ces oiseaux étaient en or, en chrysolithes, en grenats, en émeraudes et en bien d’autres variétés de gemmes et de métaux précieux.
Et lorsque le jeune Abou-Môhammad eut tiré du coffre ces différents objets, qu’il disposait au fur et à mesure sur les tapis, pêle-mêle, il se tint debout et, sans bouger la tête, il éleva et abaissa ses sourcils. Et aussitôt le pavillon tout entier se dressa de lui-même au milieu de la salle avec autant de promptitude, d’ordre et de symétrie que s’il avait été manié par vingt personnes exercées ; et les trois arbres merveilleux vinrent d’eux-mêmes se planter à l’entrée du pavillon et le protéger de leur ombrage.
Alors, Abou-Môhammad regarda une seconde fois le pavillon et fit entendre un très léger sifflement. Et aussitôt tous les oiseaux gemmés de l’intérieur se mirent à chanter, et les animaux d’or se mirent à leur répondre avec douceur et harmonie. Et Abou-Môhammad, au bout d’un instant, fit entendre un second sifflement, et le chœur tout entier se tut sur la note commencée.
Lorsque le khalifat et les assistants eurent vu et entendu ces choses extraordinaires, ils ne surent s’ils rêvaient ou s’ils veillaient. Et Abou-Môhammad embrassa encore une fois la terre entre les mains d’Al-Rachid, et dit : « Ô émir des Croyants, ne crois point que je t’apporte d’une âme intéressée ces petits cadeaux qui ont la chance de ne point te déplaire ; mais je te les apporte simplement en hommage d’un féal à son maître souverain. Et ils ne sont rien en comparaison de ceux que je pense encore t’offrir, si toutefois lu me le permets. »
Lorsque le khalifat fut un peu revenu de l’étonnement où l’avait plongé la vue de ces choses dont il n’avait jamais vu les pareilles, il dit au jeune homme : « Peux-tu me dire, ô jeune homme, d’où te viennent toutes ces choses-là, alors que tu es un simple sujet d’entre mes sujets ? Tu es connu sous le nom de Abou-Môhammad-les-Os-Mous, et je sais que ton père n’était qu’un simple ventouseur de hammam, mort sans te rien laisser en héritage ! Comment se fait-il donc que tu sois arrivé, en si peu de temps et bien jeune encore, à ce degré de richesse, de distinction et de puissance ? » Et Abou-Môhammad répondit : « Je te dirai donc mon histoire, ô émir des Croyants, qui est une histoire si merveilleuse et si pleine de faits extraordinairement prodigieux que si elle était écrite avec les aiguilles à tatouage sur le coin intérieur de l’œil, elle serait une leçon riche en profits à ceux qui voudraient en profiter ! » Et Al-Rachid, extrêmement intrigué, dit : « Hâte-toi alors de nous faire entendre ce que tu as à nous dire, ya Abou-Môhammad ! » Et le jeune homme dit :
« Sache donc, ô émir des Croyants (qu’Allah te hausse en puissance et en gloire !) que je suis, en effet, connu dans le commun sous le nom d’Abou-Môhammad-les-Os-Mous, et que je suis le fils d’un ancien pauvre ventouseur de hammam qui est mort sans nous laisser, à moi et ma mère, de quoi suffire à notre subsistance. Ainsi, ceux-là qui t’ont appris ces détails, te disaient la vérité ; mais ils ne t’ont point dit pourquoi ni comment m’était venu ce surnom ! Or, voici ! Dès mon enfance, ô émir des Croyants, j’étais le garçon le plus mou et le plus paresseux qui pût se rencontrer sur la face de la terre. Et, en vérité, si grandes étaient ma mollesse et ma paresse, que si j’étais couché par terre et que le soleil tombât de tous ses feux sur mon crâne nu, en plein midi, je n’avais pas le courage de changer de place pour me mettre à l’ombre, et je me laissais cuire, comme un colocase, plutôt que de remuer une jambe ou un bras. Aussi mon crâne devint bientôt à l’épreuve de tous les coups ; et tu peux maintenant, ô émir des Croyants, commander à Massrour, ton porte-glaive, de me fendre la tête, et tu verras son glaive s’ébrécher et voler en éclats sur les os de mon crâne.
Or, à la mort de mon défunt père (qu’Allah l’ait en sa miséricorde !) j’étais un garçon de quinze ans ; mais c’était comme si je n’avais que deux ans d’âge, car je continuais à ne vouloir ni travailler ni bouger de ma place ; et ma pauvre mère était obligée de servir les gens du quartier pour me nourrir, tandis que je passais mes journées étendu sur le flanc, et que je n’avais même pas la force de lever la main pour chasser les mouches qui avaient établi domicile
dans tous les creux de ma figure…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… les mouches qui avaient établi domicile dans tous les creux de ma figure.
Or, un jour, par une coïncidence bien rare entre les coïncidences, ma mère, qui avait peiné tout un mois au service de ceux qui la faisaient travailler, entra auprès de moi en tenant dans sa main cinq pièces d’argent, fruit de tout son labeur. Et elle me dit : « Ô mon enfant, je viens d’apprendre que notre voisin le cheikh Mouzaffar va partir pour la Chine ! Or, tu sais, mon fils, que ce vénérable cheikh est un homme excellent, un homme de bien qui ne méprise pas les pauvres comme nous et ne les repousse pas. Prends donc les cinq drachmes d’argent et lève-toi pour m’accompagner chez le cheikh ; et tu lui remettras ces cinq drachmes et tu le prieras de t’en acheter, en Chine, des marchandises que tu revendras ensuite ici et dont (qu’Allah le veuille dans sa compassion sur nous !) tu feras, sans aucun doute, un bénéfice considérable. Voilà donc pour nous, ô mon fils, l’occasion de nous enrichir ! Et celui qui refuse le pain d’Allah est un mécréant ! »
Or, moi, à ce discours de ma mère, j’augmentai encore en mollesse, et je fis le mort tout à fait. Et ma mère me supplia et me conjura de toutes les manières, par le nom d’Allah et par le tombeau de mon père, et par tout ! Mais ce fut en vain ! Car je fis semblant de ronfler. Alors elle me dit : « Par les vertus du défunt ! je jure, ô Abou-Môhammad-les-Os-Mous, que si tu ne veux pas m’écouter et m’accompagner chez le cheikh, je ne te donnerai plus à manger ni à boire, et que je te laisserai mourir d’inanition ! » Et elle dit ces paroles d’un ton si résolu, ô émir des Croyants, que je compris qu’elle mettrait cette fois ses paroles à exécution ; et je fis entendre un sourd grognement qui signifiait : « Aide-moi à m’asseoir ! » Et elle me prit le bras et m’aida à me lever et à m’asseoir. Alors moi, épuisé de fatigue, je me mis à pleurer, et, entre mes gémissements, je soupirai : « Donne-moi mes savates ! » Et elle me les apporta, et je lui dis : « Passe-les-moi aux pieds ! » Et elle me les passa aux pieds. Et je lui dis : « Aide-moi à me mettre debout ! » Et elle me souleva et me fit tenir debout. Et moi, gémissant à rendre l’âme, je lui dis : « Soutiens-moi pour que je marche ! » Et elle vint derrière moi et me soutint, en me poussant doucement pour me faire avancer. Et moi, je me mis à marcher d’un pas lent, en m’arrêtant à chaque pas pour souffler, et en penchant la tête sur mes épaules comme pour rendre l’âme. Et je finis par arriver sur le bord de la mer, en cette posture, auprès du cheikh Mouzaffar, entouré de ses proches et amis, qui se disposait à s’embarquer pour le départ. Et mon arrivée fut accueillie avec stupéfaction par tous les assistants qui s’écriaient, en me regardant : « Ô prodige ! C’est la première fois que nous voyons marcher Abou-Môhammad-les-Os-Mous ! Et c’est la première fois qu’il sort de sa maison ! »
Or, moi, lorsque je fus arrivé auprès du cheikh, je lui dis : « Ô mon oncle, est-ce toi le cheikh Mouzaffar ? » Il me dit : « À tes ordres, ô Abou-Môhammad, ô fils de mon ami le défunt ventouseur (qu’Allah l’ait en Sa grâce et en Sa pitié !) » Je lui dis, en lui tendant les cinq pièces d’argent : « Prends ces cinq drachmes, ô cheikh, et achète-m’en des marchandises de la Chine ! Et peut-être qu’ainsi, par ton entremise, cela nous sera l’occasion de nous enrichir ! » Et le cheikh Mouzaffar ne refusa point de prendre les cinq drachmes ; et il les serra dans sa ceinture, en disant : « Au nom d’Allah ! » et me dit : « Sur la bénédiction d’Allah ! » Et il prit congé de moi et de ma mère ; et, accompagné de plusieurs marchands qui s’étaient joints à lui pour le voyage, il s’embarqua pour la Chine.
Or, Allah écrivit la sécurité au cheikh Mouzaffar qui arriva sans encombre au pays de la Chine. Et il acheta, lui, ainsi que tous les marchands qui étaient avec lui, ce qu’il avait à acheter, et vendit ce qu’il avait à vendre, et trafiqua et fit ce qu’il avait à faire. Après quoi, il se rembarqua, pour le retour au pays, avec ses compagnons, sur le même navire qu’ils avaient affrété à Bassra. Et ils mirent à la voile et quittèrent la Chine.
Au bout de dix jours de navigation, le cheikh Mouzaffar, un matin, se leva soudain, et frappa de désespoir ses mains l’une contre l’autre, et s’écria « Qu’on ramène les voiles ! » Et les marchands, fort surpris, lui demandèrent : « Quelle est l’affaire, ô cheikh Mouzaffar ? » Il dit : « Il faut que nous retournions en Chine ! » Et, à la limite de la stupéfaction, ils lui demandèrent : « Pourquoi cela, ô cheikh Mouzaffar ? » Il dit : « Sachez donc que j’ai oublié d’acheter la commande de marchandises pour laquelle Abou-Môhammad-les-Os-Mous m’avait donné les cinq drachmes d’argent ! » Et les marchands lui dirent : « Par Allah sur toi, ô notre cheikh, ne nous oblige pas, après toutes les fatigues essuyées et les dangers courus et la déjà si longue absence de notre pays, à retourner en Chine pour si peu de chose ! » Il dit : « Il faut absolument que nous retournions en Chine ! Car ma foi est engagée par ma promesse à Abou-Môhammad et à sa pauvre mère, la femme de mon ami, le défunt ventouseur ! » Ils dirent : « Que cela ne t’arrête point, ô cheikh ! Car nous sommes disposés à te payer, chacun, cinq dinars d’or comme intérêts des cinq pièces d’argent que t’a remises Abou-Môhammad-les-Os-Mous ! Et tu lui donneras tout cet or à notre arrivée ! » Il dit : « J’accepte pour lui votre offre ! » Alors les marchands payèrent chacun cinq dinars d’or, en mon nom, au cheikh Mouzaffar, et continuèrent leur voyage.
Or, en cours de route, le navire s’arrêta, pour faire des provisions, à une île d’entre les îles. Et les marchands et le cheikh Mouzaffar descendirent se promener à terre. Et le cheikh, après s’être promené et avoir respiré l’air de cette île, retournait s’embarquer quand il vit, sur le bord de la mer, un marchand de singes qui avait une vingtaine de ces animaux à vendre. Mais, parmi tous ces singes, il y en avait un qui était bien misérable d’aspect, pelé, grelottant et les larmes aux yeux. Et les autres singes, chaque fois que leur maître détournait la tête pour s’occuper des clients, ne manquaient pas de sauter sur leur misérable compagnon, et de le mordre et de le griffer et de lui pisser sur la tête. Et le cheikh Mouzaffar, qui avait le cœur compatissant, fut ému de l’état de ce pauvre singe et demanda au marchand : « À combien ce singe-là ? » Il dit : « Celui-là, ô mon maître, ne vaut pas cher. Je te le laisse, pour m’en débarrasser, à cinq drachmes seulement ! » Et le cheikh se dit : « C’est juste la somme que m’a donnée l’orphelin ! Et je vais lui acheter cet animal, afin qu’il puisse s’en servir pour le montrer dans les souks et gagner son pain et celui de sa mère ! » Et il paya les cinq drachmes au marchand, et fit prendre le singe par l’un des matelots du navire. Après quoi, il s’embarqua, avec ses compagnons les marchands, pour le départ.
Or, avant de mettre à la voile, ils virent des pêcheurs qui plongeaient jusqu’au fond de la mer, et sortaient, chaque fois, de l’eau en tenant dans leurs mains des coquillages remplis de perles. Et le singe vit cela également…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade, vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le singe vit cela également. Et aussitôt il fit un bond et sauta dans la mer. Et il plongea jusqu’au fond de l’eau pour en sortir au bout d’un certain temps, en tenant entre ses mains et dans sa bouche des coquillages remplis de perles d’une grosseur et d’une beauté merveilleuses. Et il grimpa sur le navire et vint remettre sa pêche au cheikh. Puis il lui fit, avec la main, plusieurs signes qui signifiaient : « Attache-moi quelque chose au cou ! » Et le cheikh lui attacha un sac au cou, et le singe sauta de nouveau dans la mer, et ressortit avec le sac rempli de coquillages pleins de perles plus grosses et plus belles que les premières. Puis il sauta encore dans la mer plusieurs fois de suite, et chaque fois il revenait remettre au cheikh le sac plein de sa pêche merveilleuse.
Tout cela ! Et le cheikh et tous les marchands étaient à la limite de la stupéfaction. Et ils se disaient : « Il n’y a de puissance et de force qu’en Allah l’Omnipotent ! Ce singe possède des secrets que nous ne connaissons pas ! Mais tout cela est pour la chance d’Abou-Môhammad-les-Os-Mous, le fils du ventouseur ! » Après quoi ils mirent à la voile et quittèrent l’île des perles. Et, après une navigation excellente, ils arrivèrent à Bassra.
Or, dès qu’il eut mis pied à terre, le cheikh Mouzaffar vint frapper à notre porte. Et ma mère demanda de l’intérieur : « Qui est là ? » Et il répondit : « C’est moi ! Ouvre, ô mère d’Abou-Môhammad ! Je reviens de la Chine ! » Et ma mère me cria : « Lève-toi, les-Os-Mous ! Voilà le cheikh Mouzaffar qui revient de la Chine ! Va lui ouvrir la porte, et le saluer et lui souhaiter la bienvenue ! Puis tu lui demanderas ce qu’il t’a apporté, dans l’espoir qu’Allah t’aura envoyé, par son entremise, de quoi suffire à nos besoins ! » Et je lui dis : « Aide-moi à me lever et à marcher ! » Et elle le fit. Et je me traînai, en me prenant les pieds dans les pans de ma robe, jusqu’à la porte, que j’ouvris.
Et le cheikh Mouzaffar, suivi de ses esclaves, entra dans le vestibule et me dit : « Le salam et la bénédiction sur celui dont les cinq drachmes ont porté bonheur à notre voyage ! Voici, ô mon fils, ce qu’ils t’ont rapporté ! » Et il fit ranger dans le vestibule les sacs de perles, me remit l’or que lui avaient donné les marchands, et me mit dans la main la corde à laquelle était attaché le singe. Puis il me dit : « C’est là tout ce que t’ont rapporté les cinq drachmes ! Quant à ce singe, ô mon fils, ne le maltraite pas, car c’est un singe de bénédiction ! » Et il prit congé de nous et s’en alla avec ses esclaves.
Alors moi, ô émir des Croyants, je me tournai vers ma mère et lui dis : « Tu vois, ô mère, qui de nous deux a raison ! Tu m’as torturé la vie en me disant tous les jours : « Lève-toi, les-Os-Mous, et travaille ! »
Et moi, je te disais : « Celui qui m’a créé, me fera vivre ! » Et ma mère me répondit : « Tu as raison, mon fils ! Chacun porte sa destinée attachée à son cou, et, quoi qu’il fasse, il ne lui échappera pas ! » Puis elle m’aida à compter les perles et à les diviser suivant leur grosseur et leur beauté. Et moi, j’abandonnai la mollesse et la fainéantise, et je me mis à aller tous les jours au souk vendre les perles aux marchands. Et je fis un bénéfice immense qui me permit d’acheter des terres, des maisons, des boutiques, des jardins, des palais et des esclaves hommes, et des esclaves femmes et des jeunes garçons.
Or, le singe me suivait partout, et mangeait de ce que je mangeais et buvait de ce que je buvais, et ne me quittait jamais des yeux. Mais un jour, comme j’étais assis dans le palais que je m’étais fait bâtir, le singe me fit signe qu’il voulait un encrier, un papier et un calam. Et je lui apportai les trois choses. Et il prit le papier, qu’il posa sur sa main gauche, comme font les scribes, et prit le calam qu’il plongea dans l’encrier, et écrivit : « Ô Abou-Môhammad, va me chercher un coq blanc ! Et viens me rejoindre dans le jardin ! » Et moi, ayant lu ces lignes, j’allai chercher un coq blanc, et courus au jardin le donner au singe, que je trouvai tenant un serpent entre ses mains. Et il prit le coq et le lâcha sur le serpent. Et aussitôt les deux animaux luttèrent entre eux, et le coq finit par vaincre le serpent et par le tuer. Puis, contrairement à ce que font les coqs, il le dévora jusqu’au bout.
Alors le singe prit le coq, lui arracha toutes les plumes, et les planta l’une après l’autre dans le jardin. Puis il tua le coq et arrosa de son sang toutes les plumes. Et il prit le gésier du coq, le nettoya, et le posa au milieu du jardin. Après quoi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-ONZlÈME NUIT
— La petite Doniazade dit à sa sœur : « Ô ma sœur, de grâce ! hâte-toi de nous dire ce que fit le singe d’Abou-Môhammad, après qu’il eut planté les plumes du coq dans le jardin et les eut arrosées avec le sang du coq ! » El Schahrazade dit : « De tout cœur amical ! » Et elle continua ainsi :
… Le singe prit le gésier du coq, le nettoya, et le posa au milieu du jardin. Après quoi il alla devant chaque plume, fit claquer ses mâchoires en poussant quelques cris que je ne pus comprendre et revint près de moi, pour faire un saut prodigieux qui le souleva de terre et le fit disparaître à mes yeux, dans les airs. Et au même moment toutes les plumes du coq se changèrent, dans mon jardin, en arbres d’or avec des branches et des feuilles d’émeraudes et d’aigues-marines qui portaient, comme fruits, des rubis, des perles et toutes sortes de pierreries. Et le gésier du coq fut changé en ce pavillon merveilleux que je me suis permis de t’offrir, ô émir des Croyants, avec trois des arbres de mon jardin !
Alors moi, riche désormais de ces biens inestimables dont chaque pierrerie valait un trésor, je demandai en mariage la fille du chérif de Bassra, le descendant de notre Prophète. Et le chérif, après avoir visité mon palais et mon jardin, m’accorda sa fille. Et je vis maintenant avec elle dans les délices et le bonheur ! Et tout cela, pour avoir, dans ma jeunesse, mis ma confiance dans la générosité sans bornes du Rétributeur, qui ne laisse jamais Ses Croyants dans le besoin ! »
Lorsque le khalifat Haroun Al-Rachid eut entendu cette histoire, il s’émerveilla à la limite de l’émerveillement et s’écria : « Les faveurs d’Allah sont illimitées ! » Et il retint Abou-Môhammad auprès de lui, pour qu’il pût dicter cette histoire aux scribes du palais. Et il ne le laissa partir de Baghdad qu’après l’avoir comblé d’honneurs et de cadeaux d’une magnificence égale à celle dont son hôte avait fait preuve à son égard. Mais Allah est plus généreux et plus puissant !
Lorsque le roi Schahriar eut entendu cette histoire, il dit à Schahrazade : « Ô Schahrazade, cette histoire me satisfait par sa morale ! » Et Schahrazade dit : « Oui, ô Roi, mais elle n’est rien, comparée à celle que je veux encore te raconter ce soir ! » Et elle dit…
