Manuel-Roret du relieur/II-III
CHAPITRE III
Opérations du relieur
Ire SECTION
Reliure pleine
Les livres arrivent entre les mains du relieur dans l’un des trois états suivants en feuilles, brochés ou pourvus d’une reliure usée qui doit être remplacée. S’ils sont en feuilles, il faut nécessairement les assembler et les plier, comme il a été dit ci-dessus ; s’ils sont reliés, il faut les démonter en prenant toutes les précautions nécessaires pour n’en rien endommager. Nous supposerons qu’il les a reçus brochés. Son travail commence alors par le débrochage, qui est suivi du collationnement, et ce n’est que lorsque celui-ci est terminé qu’ont lieu les opérations de la reliure proprement dite, que nous supposerons pleine. Ces opérations se succèdent comme nous l’indiquons ci-après :
1. Le débrochage, le repliage, le placement et le redressage des planches.
2. Le collationnement.
3. Le battage.
4. Le grecquage.
5. La couture.
6. L’endossure.
7. La rognure.
8. Faire la tranche.
9. Faire la tranchefile.
10. La rabaissure.
11. Le coupage des coins.
12. Le collage de la carte.
13. Le collage des coins.
14. Le coupage et le parage des coins.
15. La couvrure.
16. Le collage des angles.
17. L’achevage de la coiffe.
18. Le fouettage et le défouettage.
19. La mise en place des pièces blanches.
20. Le battage des plats.
21. La pose des pièces de titre.
22. La dorure.
23. Le brunissage de la tranche.
24. Le collage des gardes
25. La polissure.
26. Le vernissage.
Débrocher un livre, c’est en défaire la brochure. On commence par enlever la couverture, mais en agissant de telle sorte qu’il n’en reste, autant que possible, aucun fragment sur le dos. Si l’on éprouvait quelque difficulté de ce côté, on enduirait de colle de pâte les parties rétives afin de détremper, c’est-à-dire de ramollir l’ancien travail, ce qui exige quelques minutes de repos.
La couverture arrachée, on prend le volume par la tranche, le dos en dessus, et de telle sorte qu’il fasse ce qu’on appelle le dos rond, afin que la couture devienne parfaitement visible. On coupe alors une ou plusieurs chaînettes de celle-ci, on enlève le fil avec la main gauche, puis avec cette même main, on détache successivement les cahiers, en commençant par le premier.
Les livres déjà reliés ou cartonnés se défont de la même manière ; seulement il faut couper les fils presque à chaque cahier et, de plus, on est obligé de détremper plus souvent l’ancien encollage.
Pour collationner, on saisit le livre de la main gauche, on élève cette main vers l’angle supérieur, et de la main droite on ouvre les cahiers par le dos, en les écartant assez pour pouvoir lire la signature du premier cahier, on laisse alors tomber chaque cahier l’un sur l’autre, et l’on s’assure si les signatures se suivent dans l’ordre voulu.
On examine également si toutes les feuilles appartiennent au même volume. Dans le cas contraire, on suspend le travail jusqu’à ce qu’on se soit procuré la feuille qui manque, et l’on met de côté celle qu’on a de trop, pour la rendre à celui à qui elle apppartient, afin qu’il complète l’exemplaire auquel elle pourrait manquer.
Une autre précaution importante consiste à replier les feuilles qui ont été mal pliées. Enfin, on examine s’il y a ou non des cartons à placer.
On nomme cartons, des feuillets que l’auteur a eu l’intention de substituer à d’autres qu’il veut supprimer, soit pour corriger quelques fautes typographiques trop importantes ou trop considérables pour faire partie de l’errata, qui se place ordinairement à la fin du volume, soit pour faire quelque changement notable. Les imprimeurs désignent ces cartons par une marque de convention qui est ordinairement un astérisque, c’est-à-dire une petite étoile. Cette marque se place à côté de la signature, lorsque la page porte une signature, ou à la place de la signature, lorsque celle-ci ne doit pas se trouver sur cette page. Quelquefois aussi, mais rarement, elle accompagne le chiffre de la pagination.
Dans la vue d’éviter toute erreur dans le placement des cartons, on emploie l’un des deux moyens suivants :
1o Dans le magasin où l’ouvrage s’assemble, on déchire, par le milieu de sa longueur, le feuillet qui doit être supprimé, ce qui avertit le relieur, qui cherche alors le carton.
2o On imprime, à la tête du livre, un petit avis au relieur, qui indique les places où il faut intercaler les cartons, les tableaux, les planches, etc.
Quand le relieur a préparé ses cartons pour être mis en place, il coupe, dans la marge du côté du dos, le feuillet qu’il veut supprimer, en laissant, de ce côté, une petite bande qu’on nomme onglet, sur laquelle il colle proprement le carton, de manière que les chiffres de la pagination de ce carton tombent exactement sur les chiffres du feuillet qui précède, comme sur ceux du feuillet qui suit. Cette opération se fait plus proprement comme nous venons de l’indiquer, que si l’on avait coupé le feuillet dans le pli du dos sans laisser d’onglet ; car alors on serait obligé de coller le carton sur les deux côtés du dos, ce qui serait très-désagréable à la vue, lorsqu’on ouvrirait le livre en ce point.
Les in-folio et les in-quarto se collationnent avec un poinçon, en soulevant les feuilles ; mais il faut s’abstenir de ce moyen le plus qu’il est possible, afin d’éviter les trous que fait le poinçon.
S’il y a des tableaux à intercaler dans le texte, il faut avoir soin de les coller immédiatement, de la manière que nous venons d’indiquer pour les cartons, c’est-à-dire que l’on forme un pli qu’on colle comme un onglet, en faisant attention que les tableaux soient placés exactement vis-à-vis des pages qu’ils doivent regarder ; et si leur justification est égale à celle du texte, on les dispose de manière qu’ils soient placés juste sur la justification du texte. Si, au contraire, cette justification est plus grande, en largeur ou en hauteur, que celle du texte, on les plie de façon qu’après les plis ils ne débordent pas, soit en hauteur, soit en largeur, la justification du texte.
Ce que nous venons de dire des tableaux, s’applique absolument aux planches ou gravures hors texte, sauf qu’il ne faut les mettre en place qu’après le battage.
Il est essentiel de faire ici une observation importante. Il n’est pas besoin d’onglet pour les planches plates, c’est-à-dire, pour les planches qui n’ont pas besoin d’être pliées. Quand, au contraire, les planches sont plus grandes que la justification du texte, on ne peut pas se dispenser de les plier ; alors on ajoute un onglet qu’on met double, afin de conserver au dos la même épaisseur que le volume doit avoir devant, à cause du pli de la planche.
Lorsque le volume contient un nombre considérable de planches ou de tableaux, que l’auteur a eu l’intention de réunir à la fin du volume, le relieur en forme des cahiers de quatre ou cinq planches chacun, plus ou moins, selon le nombre qu’il en a ; il coud ces cahiers sur un surjet, dont les points sont distants l’un de l’autre de 4 millimètres environ. Ce sont les fils de ces points qui serviront à les assembler avec le texte de l’ouvrage, quand il s’agira de la couture.
On peut encore monter les planches sur un onglet à un ou deux plis de retour, ce qui permet de réunir les planches en cahiers ; ainsi établi, le livre s’ouvrira mieux que si les planches étaient surjetées, opération économique qui est souvent cause de la destruction de la reliure.
La manière de plier les planches, pour les placer à la fin des volumes, demande des soins et plus d’intelligence qu’on ne suppose. En premier lieu, il faut toujours les faire sortir en entier hors des volumes, afin que le lecteur puisse les consulter, sans difficulté, en lisant leurs descriptions pour cela on colle à chacune un morceau de papier blanc d’une grandeur suffisante, si les planches n’en portent pas assez, et c’est sur ce papier blanc qu’on coud, comme nous l’avons dit. En second lieu, il faut avoir soin en les pliant, de ne faire que la plus petite quantité de plis possible.
Quand on veut faire un atlas particulier de toutes les planches, l’opération donne lieu à plusieurs observations, que nous allons développer.
1o Si les planches sont d’un format in-folio, on peut les réduire en un volume in-quarto, en les pliant par le milieu, bien exactement, et les coller sur un onglet double, afin de conserver toujours la même épaisseur dans le dos et dans la tranche ; mais il faut avoir soin de faire ce double onglet assez large, pour que la planche, en s’ouvrant, présente une surface bien horizontale et ne montre aucun pli dans le dos, qui puisse nuire soit à la lecture, soit au calque si on en avait besoin.
2o On en userait de même si l’on voulait réduire les planches in-4o en un atlas de format in-8o.
3o Dans tous les cas, on ne doit faire que les plis indispensables, et ils doivent être disposés de telle sorte qu’à la rognure on ne puisse pas les atteindre, ce qui couperait les planches.
4o Il est inutile d’ajouter, que lorsque les planches sont réunies en atlas, on n’a pas besoin de les agrandir en y collant du papier blanc, puisqu’elles ne doivent pas sortir du volume, comme celles qui sont placées à la fin ou dans le corps des volumes.
5o On ne doit placer les planches ou gravures, autant que cela est possible, qu’après que le volume est battu. Cette recommandation ne se rapporte qu’aux planches qui accompagnent le texte.
Lorsqu’on a reconnu que tout est en règle, si le livre a été lu en brochure, par conséquent si les feuilles ont été coupées, on visite tous les feuillets l’un après l’autre. On redresse les coins qui pourraient avoir été pliés, et l’on examine si la marge de tête est, à peu de chose près, égale partout. Dans le cas de la différence de marge, cela prouverait que les feuilles ont été mal pliées : alors il faut les compasser, afin de ne pas se mettre dans le cas d’enlever au volume entier trop de marge à la rognure, ce qui est extrêmement désagréable.
Pour éviter ce défaut, on examine, sur un feuillet bien plié, quelle est la marge qu’il présente ; l’on ouvre son compas à cette distance ; on plie bien exactement chaque feuillet, en faisant tomber les chiffres de la pagination l’un sur l’autre, et on l’intercalle à sa place, en mettant un peu de colle au dos de la feuille courte. Ce moyen suffit pour coller assez cette feuille courte sur celle qui suit, afin qu’elle ne glisse pas dans les opérations subséquentes, pendant lesquelles on secoue souvent le volume pour en égaliser les feuilles.
On ne rencontre pas, dans un cahier, un feuillet court, qu’on n’en trouve en même temps un plus long de toute la quantité qui manque au feuillet court. C’est ici que le compas est nécessaire, car si on laissait cet excédant, ce feuillet rentrerait plus que les autres, dans le secouage, et l’ouvrage présenterait une irrégularité insoutenable. Alors on marque, avec le compas, deux points, l’un vers le commencement de la ligne et l’autre vers la fin, et l’on coupe cet excédant avec des ciseaux, ou mieux avec une règle de fer et un couteau, en dirigeant la règle sur ces deux points. On coupe à la fois les deux feuillets l’un sur l’autre, après les avoir pliés avec soin, comme il a été dit ci-dessus.
Par ce moyen, tous les feuillets se présenteront au couteau à rogner à une distance égale, et ils offriront tous une même marge. Les feuillets courts qu’on y remarquera se trouveront intercalés à des distances plus ou moins grandes ; ils ne paraîtront pas lorsque le volume sera fermé : on ne les verra qu’à la lecture. Loin de nuire à la réputation du relieur, comme ils ne seront pas de son fait, ils seront une preuve incontestable des soins qu’il a pris pour corriger la faute commise, avant lui, par la plieuse, faute qu’il lui est impossible de réparer autrement.
C’est pour éviter toutes ces imperfections que les relieurs soigneux préfèrent recevoir les ouvrages en feuilles, afin d’en pouvoir exécuter eux-mêmes le pliage ou du moins le faire effectuer sous leurs yeux.
On ne refait presque jamais le pliage pour les livres déjà reliés. La chose est pourtant possible, mais on n’y a recours que lorsque les ouvrages ont une certaine valeur. Dans ce cas, on obtient une cadence de feuillets qui permet d’en rafraîchir les tranches sans les raccourcir à la vue.
Lorsque toutes ces opérations sont terminées, on doit assurer la solidité du commencement et de la fin du volume. Le meilleur moyen d’obtenir ce résultat, est le surjetage du premier et du dernier cahier. Mais cette méthode, assez dispendieuse, ne garantit que ces deux cahiers ; les gardes ne sont pas garanties, malgré la sauve-garde et même à cause de celle-ci, qui se colle à plat sur les gardes.
Il est préférable de garnir les premier et dernier cahiers d’un onglet de 3 à 6 centimètres de largeur, en papier de bonne qualité et d’épaisseur variable, suivant les formats des volumes. On colle cet onglet à la largeur de 2 à 3 millimètres sur la partie antérieure du cahier, puis on le rabat en entier à l’extérieur. Lorsque le pli est fait, on colle, au-dessus et à fleur du dos, la sauve-garde, qui reste mobile et que l’on peut toujours soulever lorsqu’on le veut. Cette disposition permet de placer, après le grecquage, les gardes blanches, qui, autrement, seraient trouées par cette opération. Cet onglet protège les gardes ainsi que les premier et dernier cahiers du volume, ce qui est très important.
Quelques relieurs ont l’habitude, pour les travaux soignés, de coudre les gardes aux volumes ; ce procédé est bon si le papier qui a servi à l’impression est de très bonne qualité, ce qui est l’exception aujourd’hui. En ce cas, on doit, intercaler deux gardes l’une dans l’autre, le premier feuillet servant de sauve-garde et le quatrième se fixant par un collage étroit sur toute la longueur du volume.
Le battage a pour objet de rendre toutes les pages parfaitement planes.
Avant de se disposer à battre un livre, le relieur doit examiner si ce livre peut être battu sans risque de faire des maculatures, ce qui arrive toujours lorsque l’impression est fraîche, parce que l’encre d’imprimerie, qui est un composé d’huile grasse et de noir de fumée, n’a pas eu le temps suffisant pour sécher parfaitement.
Les indices qui peuvent faire connaître si le volume peut être battu ou non sans inconvénient, sont les suivants :
1o La date de l’impression, que l’on trouve toujours sur la page du titre ; si l’impression a plus d’un an, il n’y a rien à craindre.
2o Les soins qu’on a portés à l’impression, c’est-à-dire si les caractères n’ont pas été trop chargés d’encre ;
3o En flairant le livre à plusieurs endroits : en effet, on distingue parfaitement, par l’odeur, si l’huile de l’encre est sèche ou non.
4o Si le livre a été satiné, ce qui se reconnaît aisément ; dans ce cas, on peut le battre avec moins de crainte.
Nous venons de dire qu’on ne bat ordinairement les feuilles, qu’après qu’elles ont été pliées, et lorsque l’impression est parfaitement sèche, afin d’éviter les maculatures. Cependant, il y a des circonstances où l’on est obligé de relier un livre immédiatement après son impression. Dans ce cas, il y a des précautions à prendre.
On met le volume dans un four, après que le pain en a été retiré, ou dans une étuve suffisamment chaude, pour le faire sécher. Toutefois, ce moyen n’est pas sans danger, parce qu’il arrive souvent que le papier noircit, ce qui est un grand inconvénient. Il vaut mieux battre les feuilles avant de les plier entièrement. Pour cela, on les plie dans la ligne des pointures seulement, on intercale une feuille de papier blanc dans chacune, et l’on bat les feuilles ainsi préparées. Ce papier reçoit alors les impressions de l’encre.
On doit aussi ne pas négliger de placer une feuille de papier serpente devant chaque planche, parce que l’encre des imprimeurs en taille-douce est beaucoup plus longue à sécher que celle des imprimeurs typographes.
En faisant satiner les planches, on évite cette manipulation, qui a l’inconvénient d’enlever une certaine quantité d’encre. Dans ce cas, on plie les feuilles, on les affaisse un peu avec le marteau, et on les met en presse en petites parties, afin de remplacer le battage, qui doit, du reste, être généralement supprimé.
Décrivons maintenant l’opération du battage. Elle se fait sur la pierre à battre et avec le marteau à battre.
L’ouvrier commence par secouer le volume sur la pierre par le dos et par le haut, afin d’en bien égaliser les cahiers, ensuite il le divise en autant de parties, appelées battées, qu’il le juge nécessaire, et qui comprennent d’autant moins de cahiers que l’ouvrage doit être plus soigné. Il se place devant la pierre, en ayant soin de rapprocher les jambes l’une de l’autre, afin de ne pas contracter des hernies, ce à quoi sont fréquemment exposés les ouvriers qui, dans l’intention d’être plus à leur aise, prennent la mauvaise habitude d’écarter les jambes.
Il faut plus d’adresse que de force pour battre.
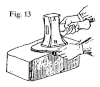
L’ouvrier doit être seulement assez fort pour soulever constamment le marteau et le laisser retomber presque par son propre poids, bien parallèlement à la surface de la pierre. Il tient la battée d’une main, et le marteau de l’autre (fig. 13) ; le premier coup de marteau se donne au milieu de la feuille, le second et les suivants se donnent en tirant la battée à soi, mais de manière que le coup qui suit tombe sur le coup qui précède au tiers de sa distance, afin que le coup suivant couvre des deux tiers le coup précédent, et d’éviter par là de faire des bosses, qu’on appelle noix. On tire toujours la feuille vers soi jusqu’à ce qu’on soit arrive à l’extrémité la plus éloignée du corps ; alors on tourne la battée entière du haut en bas, et l’on frappe du même côté en commençant à couvrir des deux tiers le premier coup qu’on a donné, et l’on continue de même avec les mêmes précautions.
On sépare la battée en plaçant dessus ce qui était dessous, on ballotte les cahiers sur le dos et par le haut pour les bien égaliser, on bat comme la première fois, et l’on remet les battées comme elles étaient d’abord ; on ballotte de nouveau les cahiers, et l’on termine en donnant quelques coups de marteau pour les bien aplanir.
Pour les livres un peu soignés, on met de chaque côté de la battée une garde, ou chemise ; on bat, on passe ensuite le premier cahier sous la battée, et l’on bat, puis le deuxième, et ainsi de suite jusqu’au dernier, en battant chaque fois.
L’ouvrier doit bien faire attention que son marteau tombe bien d’aplomb sur la battée ; sans cela il risquerait de pincer et couperait la battée.
Après le battage, on collationne de nouveau, pour s’assurer que dans cette dernière opération, les cahiers n’ont pas été dérangés.
Lorsque les battées sont terminées, l’ouvrier les place entre deux ais de la grandeur du volume, et les met à la presse les unes sur les autres. Il les serre fortement, et les laisse ainsi le plus longtemps qu’il peut, trois à quatre heures au moins.
Ainsi que nous le verrons plus loin, dans les grands ateliers, on remplace par un laminage l’opération si longue et si coûteuse du battage, qui serait d’ailleurs impraticable, tant est considérable le nombre des volumes qu’on y relie à la fois.
Mentionnons, en passant, un mode de préparation à la reliure qui s’applique surtout aux livres en feuilles, et qui, fréquemment employé autrefois, ne l’est plus ou presque plus aujourd’hui.
Dès que les feuilles arrivent de l’atelier de l’assembleur, elles sont égalisées par corps et debout pour les disposer carrément les unes sur les autres, puis battues, comme on dit, pour les déplisser. Pour cela on se sert d’une pierre à battre dure et à surface bien polie, ou d’une plaque peu épaisse en fer assujettie sur un bloc de bois, et l’on frappe ces feuilles avec un marteau du poids de 5 à 6 kilogrammes, à peu près semblable à celui qui sert à battre les livres, en commençant au milieu des feuilles et gagnant successivement les bords de tous les côtés pour en faire disparaître les plis d’étendage, les rides, les bords plissés, froncés, etc. ; seulement si l’impression est assez récente, ce battage doit être exécuté avec modération.
Dans ce battage, qui constitue plutôt une sorte de lissage ou de glaçage, le papier ne doit pas être trop sec et plutôt imprégné d’une légère moiteur, ce qu’on obtient en lui faisant passer la nuit dans un local ou une capacité où règne une atmosphère humide. On pose sous le corps qu’on bat et dessus une maculature bien propre, et l’on bat à coups d’égale force et modérés, surtout sur les bords, où l’on pourrait amener des déchirures.
Si l’opération du battage est trop pénible en raison de la grandeur du format, de l’épaisseur du papier ou de celle des corps, on le remplace par un léger cylindrage entre tôles polies : c’est même ainsi que les choses se font généralement aujourd’hui.
Dès que les feuilles ont été lissées, elles sont pliées suivant le format, on assemble les corps, on collationne les signatures, on met les volumes en presse entre des ais où on les laisse suffisamment de temps pour leur donner le degré de fermeté convenable, puis on procède au battage proprement dit, qui s’exécute comme à l’ordinaire, mais qui devient plus facile et moins prolongé à cause de la première opération qu’on a fait subir aux feuilles.
Quand il y a des planches séparées du texte, quelques relieurs assurent qu’on peut les mettre en place avant le battage. C’est une erreur ; car, malgré l’intercalation du papier joseph, les planches sont toujours gâtées par cette opération, et un retard de vingt-quatre heures suffit rarement pour empêcher la colle de s’étendre sur les marges, et le marteau de couper ou du moins de froisser les parties humides.
D’ailleurs, pour disposer les gravures et les cartons à être mis dans le volume, on commence par les couper en dos et en tête afin de les adapter à la justification de la page à laquelle ils doivent faire face puis on encolle derrière la gravure, excepté lorsqu’on agit avant le battage, et quand la gravure regarde la première ou la dernière page d’un cahier : alors on la colle sur le devant pour éviter qu’elle ne soit souillée en battant le livre, ce qui est encore une crainte et une sujétion.
Comme nous l’avons dit, les planches doivent être très-rarement battues. Il vaut même mieux ne les soumettre jamais à cette opération. En conséquence, il faut les mettre de côté et ne les classer qu’après le battage.
Nous savons que dans la reliure à nerfs, les ficelles ou nerfs qui réunissent et soutiennent la couture, font saillie sur le dos, tandis qu’elles ne paraissent pas dans la reliure à la grecque. C’est en vue de cette dernière que se fait le grecquage.
Grecquer un volume, c’est faire des entailles sur son dos, afin d’y loger les ficelles.
Après avoir bien ballotté le volume afin d’en égaliser les cahiers, on le place entre deux ais épais pour que le dos ne sorte que de 5 à 6 millimètres, puis on met le tout dans la presse à grecquer et l’on serre modérément.
On prend alors une scie à main plus ou moins épaisse, suivant la grosseur de la ficelle, ce qui dépend de la grandeur du volume, et l’on fait des entailles d’une profondeur égale au diamètre, de cette ficelle. On donne autant de coups de scie, également espacés entre eux, qu’on veut placer de ficelles.
Au-dessus de la première et au-dessous de la dernière ficelle, on donne un léger coup de scie pour loger la chaînette.
Il est important que l’ouvrier dirige la scie toujours parallèlement à la surface de la presse ; sans cette précaution les entailles seraient plus profondes d’un côté du dos que de l’autre, la grecque serait mal faite, et la ficelle se cacherait plus d’un côté que de l’autre.
On ne doit grecquer que très-peu, on devrait même ne pas le faire du tout ; mais l’usage de cette pratique est devenu universel. Dans tous les cas, il est presque impossible que la grecqure ne paraisse pas en dedans du volume, auquel elle ôte de sa solidité.
Ce qui contribue à perpétuer une méthode si nuisible, c’est la facilité que l’on y trouve pour coudre les livres. Effectivement, les trous pour passer l’aiguille sont tout faits, et si une ouvrière peut coudre 300 cahiers non grecqués, en les alignant et en les cousant tout du long, elle peut en coudre 1500 en cousant deux ou trois cahiers, et en sautant un nerf à chaque passe, comme le font la plupart des femmes, malgré les recommandations qu’on leur adresse à cet égard. La grecqure, ainsi manœuvrée, diminue donc la main-d’œuvre des quatre cinquièmes, elle dispense l’ouvrier d’une infinité de soins, et dissimule les défauts de l’endossure ; aussi n’est-elle pas applicable aux reliures de luxe et d’amateur, dans lesquelles on aime une endossure solide et peu susceptible de se froisser ou de faire des plis.
Dans quelques grands ateliers, on exécute le grecquage au moyen de machines, dites presses à grecquer. Nous en parlerons plus loin.
Il est convenable de placer les grecques de manière qu’elles concordent avec les nerfs que l’on veut simuler ; de cette manière, l’entaille faite sur le dos du volume est suffisante si elle peut recevoir les trois quarts de l’épaisseur de la ficelle. La petite saillie qui subsistera sera cachée par les faux nerfs, et les trous, devenant presque invisibles, l’intérieur des cahiers sera plus propre ; en outre, le volume, étant moins grecqué, s’ouvrira mieux.
Pour la couture sur nerfs, on remplace le grecquage par un traçage, que l’on exécute ainsi :
Le volume étant bien égalisé au dos et en tête, on le place entre deux ais, sans laisser dépasser le dos, et on le met en presse, comme s’il s’agissait de le grecquer ; puis, au moyen d’un compas, on marque la place de toutes les nervures que le dos doit porter.
Toutes les distances étant ainsi convenablement réglées, on prend une équerre munie d’un rebord qui en facilite le maintien sur le dos du volume, puis, en appuyant dessus avec la main gauche, on trace avec la main droite, au travers du dos, des lignes au crayon.
On fait cette opération de deux manières :
On trace une ligne à la place de chaque chaînette et deux lignes à la place de chaque ficelle, de l’épaisseur de la ficelle qu’on veut employer, afin d’appeler sur cette place l’attention de l’ouvrière qui doit exécuter, la couture et de la guider dans son travail.
Ou bien, on prend une pointe coupante, telle qu’un canif, et, au lieu de marques au crayon, on fait de légères entailles, qu’on proportionne à l’épaisseur des cahiers, de manière à faciliter l’entrée et la sortie de l’aiguille. Ces guides sont indispensables pour obtenir une couture correcte ; si l’on négligeait de les faire, malgré l’habileté de l’ouvrière, on pourrait craindre les déviations, et l’ensemble de la reliure s’en ressentirait.
Ces entailles ne doivent être que très légères et les trous qui résultent de ce traçage ne doivent pas être plus grands que ceux que peut faire une aiguille en traversant le cahier.
Pour qu’un volume soit solidement établi, chaque cahier doit être cousu isolément, et se rattacher à la nervure surtout dans les grands volumes. Il faut donc faire grande attention à la ficelle et au fil qu’on emploie. La ficelle doit être à deux brins et de première qualité ; le fil doit être très solide, bien tordu et d’une grosseur uniforme d’un bout à l’autre.
On distingue trois genres de couture :
Sur nerfs simples ou doubles ; sur ficelles à la grecque ; sur rubans ou lacets.
La couture se fait sur le métier qu’on appelle cousoir (voir page 99). Pour exécuter son travail, la couseuse prend la chevillette de la main gauche, de manière que la tête r soit devant elle : de la droite elle fait entrer le bout de la ficelle g dans le trou carré ; elle ramène le petit bout de cette ficelle vers la main droite, la passe sur la traverse t de la chevillette, en entortille une ou les deux branches s, s, selon qu’elle a plus ou moins de longueur, et en réserve un petit bout qu’elle passe sous la ficelle qui se trouve sur la traverse t, afin de l’y arrêter.
Cela fait, elle retourne la chevillette dans le sens vertical, la tête en haut, en faisant attention de ne pas laisser lâcher la ficelle ; elle la passe dans l’entaille f du cousoir, les branches les premières ; et la couche horizontalement sous la table, les branches devant elle, comme le montre la figure 16.

La ficelle doit se trouver alors suffisamment tendue pour que la chevillette ne se dérange pas. L’habitude indique assez quelle est la longueur de la ficelle qu’on doit réserver pour arriver juste au but. Il faut avoir soin que les chevillettes soient plus longues que la largeur de l’entaille, sans quoi elles ne pourraient pas être retenues par dessous, et la tension de la ficelle les ferait passer au travers.
Lorsque la couseuse a placé toutes ses chevilles, elle présente le livre par le dos aux ficelles ; elle les avance vers la droite ou vers la gauche pour les faire concorder avec les grecques marquées ; ensuite elle achève de tendre les ficelles en tournant les vis, de façon à leur donner une égale tension. Cela fait elle ferme l’entaille ff avec un liteau de bois vv, nommé templet, qui a la même épaisseur à peu près que la table, et qui affleure le dessus.
Il existe plusieurs manières de coudre :
À point-devant, que l’on emploie pour la couture à la grecque ;
À point-arrière, indispensable pour la couture sur nerf ;
À un ou deux cahiers.
Nous allons décrire ci-après ces divers genres.
L’ouvrière, ayant tendu son cousoir et placé les ficelles d’après les mesures qui lui ont été tracées, prend le premier cahier de la main gauche, l’ouvre en s’aidant de la main droite pour s’assurer qu’elle tient bien le milieu, puis, en maintenant de la main gauche le milieu du cahier, elle le place à plat sur le cousoir, le dos en regard des ficelles tendues, en suivant les mesures tracées. Alors, prenant de la main droite l’aiguille enfilée, elle la pique, de dehors en dedans, dans la ligne tracée pour la chaînette de tête, en traversant le dos du cahier et en restant exactement dans le pli, ce qui est absolument nécessaire. De la main gauche, elle prend l’aiguille, pendant que la main droite, devenue libre, maintient en place le cahier, et elle la tire à l’intérieur pour la piquer et la faire ressortir à gauche de la première ficelle, en la serrant de très près. Alors, pendant que la main gauche maintient à son tour le cahier, l’ouvrière tire à elle toute l’aiguillée, sauf l’extrémité du fil qu’elle laisse pendre en dehors pour le nouer à la sortie du second cahier ; elle pique à la droite de la ficelle, de manière à l’entourer en la serrant encore de très près ; enfin, elle reprend l’aiguille de la main gauche, la passe à la seconde ficelle, et ainsi de suite, pendant que la main droite attire à chaque point toute la longueur du fil, en serrant fortement, afin que le fil soit bien tendu et que les ficelles soient solidement maintenues sur le dos du volume.
Quand le second cahier est cousu et que le fil est sorti à la place marquée pour la chaînette de queue, l’ouvrière ferme le cahier de la main gauche, en s’aidant de la main droite, et le fait descendre bien à plat sur le cousoir, en appuyant les ongles sur les ficelles. Cette opération est répétée à chaque cahier.
Alors, elle pose le second cahier à plat et bien exactement sur le premier ; de la main droite, elle pique l’aiguille dans la trace de la chaînette de queue et, de la main gauche, elle la fait ressortir cette fois à la droite de la première ficelle. Elle tire l’aiguillée de la main droite, serre solidement les deux cahiers l’un contre l’autre, puis, piquant à gauche de la première ficelle pour l’entourer dans le sens inverse, elle continue jusqu’au bout du cahier ; alors, elle noue les fils pour bien joindre les cahiers en tête et en queue.
Pour rattacher le troisième cahier aux deux premiers, l’ouvrière passe l’aiguille entre ceux-ci et serre le fil, en ayant soin de le croiser, pour éviter de déchirer le cahier ; elle forme ainsi la chaînette. Les cahiers suivants sont mieux assujettis, à la condition que l’ouvrière prenne deux cahiers à la fois à chaque point d’arrêt.
On a pu se rendre compte qu’il s’agit de la couture à point-arrière, le fil revenant sur lui-même, pour entourer chaque ficelle. Il ne saurait en être autrement pour la couture sur nerfs, dont les ficelles formant saillie doivent être fortement serrées et ne pourraient l’être sans cette méthode.
Lorsque l’ouvrière est arrivée au dernier cahier et qu’elle l’a attaché comme les autres, elle doit, avant de couper le fil, le fixer par un ou deux points dans la chaînette, les aiguillées étant jointes au moyen d’un nœud de tisserand. Nous recommandons même de les rattacher aux chaînette ; on évitera ainsi les nœud, qui font toujours mauvais effet dans l’intérieur des cahiers.
Quand le volume est entièrement cousu, on coupe les ficelles supérieures, en leur laissant 6 centimètres de longueur au moins ; on enlève le templet qui forme la rainure du cousoir, on détache les ficelles des chevillettes, puis on les coupe à la longueur des premières ficelles. Ces longueurs sont nécessaires pour attacher les cartons de la couverture au volume.
Ce genre de couture, auquel on a donné le nom de Couture croisée du XVe siècle, diffère de la couture sur nerfs simples en ce que les ficelles sont accouplées de manière à former des nervures doubles. On applique généralement ce genre de couture aux reliures des incunables, pour imiter autant que possible les reliures de cette époque.
Cette couture s’exécutait autrefois de la manière suivante :
L’ouvrière, piquant l’aiguille dans la trace de la chaînette de tête, la faisait sortir à gauche de la seconde ficelle de la première nervure double ; elle attirait alors à elle toute l’aiguillée, sauf un bout qu’elle laissait pendre pour l’attacher à la sortie du deuxième cahier ; puis, piquant l’aiguille entre les deux ficelles de la nervure, elle la faisait sortir à droite de la première ficelle, pour la faire rentrer de nouveau entre les deux. Elle s’occupait alors de la seconde ficelle de la seconde nervure, et ainsi de suite, ce qui justifiait le nom de couture croisée donné à ce procédé. Cette opération produisait la couture la plus solide ; pour la réussir parfaitement, l’ouvrière devait être très capable et avoir été très bien guidée.
De nos jours, on a simplifié cette couture par le moyen, suivant :
La place des nervures étant exactement tracée, l’ouvrière peut s’occuper isolément de chaque ficelle, ce qui lui permet de les distancer de 1 à 2 millimètres l’une de l’autre. L’opération est la même que pour la couture sur nerfs simples, dont nous avons parlé précédemment ; elle n’en diffère que dans la forme des nerfs qui sont accouplés.
L’ouvrière, après avoir préparé son cousoir, prend le premier cahier, comme pour la couture sur nerfs, et présente les grecques en regard des ficelles. Ella passe l’aiguille dans le trou de la chaînette de tête pour la faire sortir par le trou de la grecque ; non à gauche, mais cette fois à droite de la première ficelle ; ensuite, elle passe l’aiguille par dessus la première ficelle et la fait rentrer dans le même trou pour la faire ressortir à droite de la seconde ficelle, et ainsi de suite pour les autres. Au second cahier, le retour se fait de même, l’aiguille sortant cette fois à gauche de chaque ficelle pour rentrer à droite.
On comprend qu’il s’agit ici de la couture à point-devant. Le fil n’entoure pas la ficelle, mais il passe au-dessus et sert à maintenir celle-ci dans la grecque Les attaches se font comme pour la couture sur nerfs.
On peut aussi coudre à la grecque à point-arrière. Mais ce système, plus dispendieux, ne peut s’appliquer qu’aux reliures soignées ; il a, de plus, le grave inconvénient de ne permettre de coudre qu’un volume à la fois sur chaque tendée, tandis que la couture à point-devant permet de coudre plusieurs volumes les uns sur les autres, les ficelles étant moins serrées que pour le point-arrière.
La tendée étant terminée et les ficelles tendues sur une longueur suffisante pour le nombre de volumes cousus, on sépare ceux-ci les uns des autres en les faisant glisser sur les ficelles jusqu’à ce que chaque volume ait la longueur nécessaire pour être passé en carton, c’est à dire 6 centimètres de chaque côté, comme pour les volumes cousus sur nerfs.
On emploie principalement cette couture pour la reliure des registres ou pour celle des volumes de grand format destinés à un usage fréquent. On s’en sert encore pour les volumes qui n’ont presque pas de marges intérieures ou sur lesquelles on veut écrire ; on l’emploie surtout pour les albums et les partitions de musique, qui ont besoin d’être ouverts tout à fait à plat. Cette couture se fait à point-devant et toujours dans toute la longueur du volume.
Il est toujours nécessaire qu’un volume à gros cahiers et mince soit cousu tout du long, afin de laisser plus de dos, et de donner plus de solidité au volume. On est même forcé de coudre tout du long un cahier qui contient une gravure, ou une carte géographique, ou un tableau, lors même qu’il se trouve dans un volume qu’on désirerait coudre à plusieurs cahiers.
Lorsqu’on veut coudre à deux cahiers, on place deux ou trois ficelles. Supposons qu’on n’en mette que deux, on coud le premier cahier en entrant d’abord l’aiguille dans le trou de la chaînette, on la sort par la première ficelle en dehors, on place le second cahier, on entre l’aiguille par le trou de la première ficelle en dedans, c’est-à-dire que le fil embrasse la ficelle avant d’entrer dans le second cahier, puis l’aiguille sort par le trou de la seconde ficelle en dehors ; ensuite il entre dans le premier cahier après avoir embrassé la ficelle, et sort par le trou de la chaînette. On recommence le train de deux cahiers en allant de gauche à droite.
On opère de même lorsqu’on coud à deux cahiers et à trois ficelles ; la seule différence consiste en ce que le second cahier est plus solide, parce qu’il est retenu par les deux ficelles.
Lorsqu’on veut coudre à trois cahiers, on place quatre ficelles. Le premier cahier se trouve pris depuis la chaînette jusqu’à la première ficelle ; le second, de la première ficelle à la seconde ; le troisième, de la seconde à la troisième : ensuite on reprend le premier de la troisième ficelle à la quatrième, et le second de la quatrième ficelle à la chaînette de la queue ; de sorte que le troisième cahier n’est pris qu’une seule fois ; aussi a-t-on bien soin de grecquer cette distance plus large que les autres. Ce moyen n’est employé que rarement et dans les cas indispensables, comme, par exemple, lorsqu’on a à coudre un volume in-quarto à feuilles simples. Alors, pour donner plus de solidité, il faudrait coudre à cinq ficelles, ou même à un plus grand nombre, si le volume était d’un plus grand format, un in-folio, par exemple.
Lorsque le volume est cousu avant de procéder à son endossage, il est nécessaire d’y placer les gardes blanches.
Si ces gardes ont été cousues au volume, cette opération se réduit à un simple collage, que l’on peut facilement exécuter en plaçant le volume à plat, le dos au bord de la table. On rabat le cahier de gardes, on place une bande de papier sur le premier cahier du volume, à la distance de 2 à 3 millimètres du dos, puis on prend au bout du doigt un peu de colle de pâte et l’on en met légèrement, mais uniformément, sur toute la longueur du cahier. On retire alors la bande qui a servi de guide à la colle et l’on referme le cahier de gardes sur la partie collée. On obtient ainsi un double résultat : fixer le cahier et attacher définitivement le feuillet correspondant à la sauvegarde, celle-ci devant être enlevée lors de l’achèvement de la reliure.
S’il s’agit de placer les gardes blanches après la couture achevée, on les coupe de la grandeur du volume ouvert à plat et on les plie en deux, en les plaçant l’une sur l’autre et en les étageant de manière à faire des collages de 2 à 3 millimètres ; ensuite on les enduit de colle de pâte et, en soulevant la sauvegarde, on fixe la garde bien à fleur du dos, en ayant soin de ne rien laisser déborder en tête ; enfin, on rabat la sauve-garde avec tout le soin nécessaire pour ne pas déranger le collage récent, et on laisse sécher.
Il est essentiel d’employer pour les gardes du papier collé, se rapprochant le plus possible comme teinte et comme épaisseur du papier sur lequel le volume a été imprimé.
Endosser un volume, c’est en arrondir le dos et y produire la saillie, appelée mors, que chacun de ces longs côtés forme sur les plats, et qui est destinée à recevoir la couverture en carton. Cette opération peut se faire de deux manières : à la française ou à l’anglaise ; mais le premier procédé, ou procédé ancien, nommé encore endossure au poinçon, n’est plus pratiqué, à cause de ses inconvénients, que par les relieurs routiniers. Dans tous les ateliers bien tenus, on n’endosse plus qu’à l’anglaise. Avant de décrire l’un et l’autre système, nous devons dire quelques mots sur les opérations préliminaires.
En sortant de la couture, le volume est battu de tête et de dos pour en égaliser les cahiers, les ficelles sont couchées sur les flancs et on le place à plat sur deux ais, le dos au bord de la table. De la main gauche, on le presse fortement ; de la main droite, on applique sur le dos une bonne couche de colle forte.
Nous disons une bonne couche, non à l’avance de la quantité de colle que le dos doit recevoir, mais par la manière dont on l’applique pour la faire pénétrer parfaitement dans le dos ; pour cela, on promène un pinceau en tous sens, afin d’obtenir une répartition bien égale. Ensuite, on laisse sécher, en plaçant le volume bien à plat sur un ais, le dos débordant légèrement.
On peut encoller en même temps plusieurs volumes d’un même format, jusqu’à huit volumes à la fois, selon leur épaisseur. Lorsque cette opération est achevée, on les empile bien d’aplomb, pour qu’ils ne se déforment pas, en les plaçant tête-bêche, c’est à dire le dos de l’un du côté de la barbe de l’autre, et ainsi de sui te, en laissant déborder légèrement le dos, pour que la colle encore liquide ne puisse toucher les barbes des volumes voisines.
Il faut bien se garder d’ouvrir un livre qui vient d’être cousu avant qu’il n’ait été endossé et qu’il n’ait eu le temps de sécher parfaitement. Si une circonstance quelconque oblige à le faire, on doit toujours en tenir fortement le dos avec la main gauche ; autrement la couture rentrerait en dedans, ce qui empêcherait de bien arrondir le dos et de former le mors.
Quand le volume est sec, on s’occupe de préparer les ficelles, qui ne pourraient être employées telles qu’elles sortent des mains de la couseuse : on est obligé de les effilocher.
Ordinairement, les ficelles sont composées de deux brins ; généralement, on emploie pour la couture sur nerfs des ficelles cablées qui comportent cinq ou six brins et exceptionnellement jusqu’a seize brins.
Pour les effilocher, on prend l’une d’elles entre le pouce et l’index de la main gauche, on la détord et l’on en sépare les brins à l’aide d’un poinçon. On prend alors un couteau dont le tranchant est émoussé et, de la main droite, on passe les brins de la ficelle entre le pouce et la lame du couteau, depuis le dos du volume jusqu’à l’extrémité de la ficelle, tandis que, de la main gauche, on la lisse en faisant un mouvement semblable.
On obtient ainsi un faisceau soyeux et souple, qu’on roule du plat de la main sur le genou ou sur le tablier, ce qu’on nomme tortiller, lorsqu’on veut s’en servir. Cette manipulation simple et facile rend les fils souples et fermes et les dispose à passer dans les trous du carton.
Pour préparer le carton, on commence par le découper de la grandeur convenable. À cet effet, on le divise au moyen du couteau ou pointe à rabaisser sur l’ais dit à rabaisser. Quand il est réduit en morceaux de la dimension désirée, s’il n’a pas été cylindré, et que sa surface soit raboteuse, on le bat sur la pierre avec soin et propreté, de la même manière qu’on a battu le volume. On le rogne légèrement d’un seul côté, qui doit être celui du côté du dos ; on abat la bavure avec le marteau à battre,. ou bien avec un rouleau de bois ; enfin, on le raffine, c’est-à-dire qu’on colle du côté du mors une bande de papier plus ou moins large qui enveloppe l’épaisseur du carton de ce côté.
Il s’agit maintenant de percer le carton et de l’attacher au volume. Dans l’endossage à la française, on fait trois trous et l’on attache avant d’endosser. Dans l’endossage à l’anglaise on ne fait que deux trous, et l’on n’attache qu’après avoir endossé. Disons d’abord comment les choses se passent dans le premier système.
On présente chaque morceau de carton sur le volume, les ficelles relevées, à la place qu’il doit occuper devant le mors, en le laissant déborder de 2 millimètres, ou plus, selon le format, du côté de la tête, et l’on fait, avec un poinçon, vis-à-vis de chaque ficelle, un trait de 10 à 12 millimètres de long dans une direction perpendiculaire au bord du carton. On pose ensuite le carton sur une planche, et l’on fait, à 2 millimètres du bord, et en face de chaque marque, avec le même poinçon, un trou incliné du dedans au dehors ; les deux trous sont audessus l’un de l’autre, à 5 millimètres de distance.
On retourne alors le carton, pour faire à côté des deux trous, et au milieu de leur distance, un troisième trou, de manière qu’il y ait deux trous de percés en dehors et le troisième en dedans.
Les trous étant percés, on prend le volume de la main gauche, on passe chaque ficeIle en dehors dans le premier trou, en dedans dans le troisième, et en dehors dans le second, et l’on en glisse le bout sous la ficelle qui traverse d’un trou à l’autre en dedans. Enfin, on serre cette espèce de couture pour rapprocher le carton du volume.
Quand on veut faire un ouvrage très-propre, on doit chercher à cacher le pli de la ficelle dans l’intérieur du carton. Pour cela, on incline le poinçon lorsqu’on fait le premier trou, de manière que sur la face supérieure il se trouve à 2 millimètres du bord, et que sur la face inférieure, il sorte à 4 millimètres du même bord. Après avoir retourné le carton, on met la pointe du poinçon dans le même trou, et on l’incline de 2 millimètres pour qu’il présente un trou sur l’autre face à 3 millimètres du premier, et dans la même direction que dans le premier cas ; il est facile de concevoir que la ficelle, passant dans ces deux trous qui forment un trou continu, ne paraîtra pas en dedans.
Lorsque les ficelles sont toutes placées, il faut que les cartons se tiennent naturellement perpendiculaires au volume, afin de ne pas gêner le mors. On coupe les bouts excédants de manière qu’ils ne puissent pas gêner dans le mors.
Ensuite, tenant le volume par la tranche, on en laisse tomber successivement chaque carton sur la pierre à battre, et l’on frappe, sur les trous, en dedans, pour les boucher, et sur les ficelles pour les aplatir, afin qu’elles ne fassent aucune saillie. Enfin, pour en rendre parfaite l’adhérence au carton, on en étale les bouts avec un plioir ou simplement avec le pouce, et l’on enduit d’un peu de colle les brins de ces bouts.
Toutes, ces manipulations achevées, on prend le volume entre les deux mains ouvertes, en laissant tomber librement les cartons sur la pierre, et l’on frappe le dos sur celle-ci afin de le bien égaliser. On place ensuite le livre sur le bord de la pierre, en laissant tomber au dehors le carton de dessous ; on plie le carton de dessus sur le livre, en ayant soin que la sauvegarde et la garde ne soient ni trop en arrière, ni trop en avant. On en fait autant pour l’autre carton, et l’on a soin, avant de quitter le volume, de bien redresser la tête, si cela est nécessaire.
On a vu que dans l’endossage à l’anglaise, on ne fait que deux trous. Pour cela, après avoir, comme ci-dessus, marqué par des traits les points où l’on doit enfoncer le poinçon, on perce un trou vertical, à 2 millimètres du bord, sur chaque trait. On retourne ensuite, le carton et, dans la même direction du trait, on perce de la même manière un second trou, à une distance de 3 millimètres du premier s’il s’agit d’un volume in-octavo, et plus grande ou plus petite suivant que le format est plus grand ou plus petit.
Quand on attache les cartons au volume, on passe chaque ficelle dans chaque paire de trous ; d’abord de dehors en dedans, puis de dedans en dehors, et l’on continue comme ci-dessus.
Les châsses, c’est-à-dire les parties de carton qui dépassent les feuilles, doivent être de dimensions convenables. Trop hautes ou trop grandes, elles rendent sans nécessité le volume trop lourd et sont, en outre, exposées à se casser. Trop basses ou trop petites, elles ne protègent pas suffisamment la gouttière et les autres extrémités.
Le carton doit avoir une épaisseur en rapport avec celle du volume, mais néanmoins sans dépasser les limites raisonnables.
Ce système d’endossage exige l’emploi d’une presse, qui n’est autre que celle dont il a été question au grecquage.
On endosse tout à la fois un tas ou paquet, qui est habituellement composé de huit à dix volumes. Après avoir disposé un certain nombre d’ais à droite, et les volumes à gauche, on place sur le bord de la presse, d’abord une membrure, puis un ais, puis un volume, on continue par un autre ais, un autre volume, et ainsi de suite, et l’on termine par un ais et une membrure.
En formant le tas, on a soin de l’élever le plus verticalement possible, les dos tournés vers la droite. Quand il est achevé, on le fait pirouetter de manière que les dos soient tournés vers soi, après quoi on le saisit des deux mains, la gauche en dessous, la droite par dessus le paquet, on le couche horizontalement et le place dans la presse, où on le serre légèrement.
Alors, au moyen d’un ais qui lui sert de marteau, l’ouvrier dresse les ais et les volumes dans une même direction ; puis, à l’aide des mains, qu’il tient ouvertes de chaque côté du paquet, les doigts en dessous et les pouces en dessus, il élève les volumes ou les abaisse selon le besoin, afin que les dos soient tous à la même hauteur. Les ais ne doivent pas déborder les cartons vers le mors.
Prenant alors le poinçon à endosser, qu’il tient par le manche, il l’introduit entre les cahiers qui sont trop élevés ou trop abaissés, et en le tournant’ légèrement dans la main, il les fait abaisser ou élever selon le besoin, et, par un mouvement léger à droite ou à gauche, il donne la rondeur qu’il désire. Il ne doit pas se servir de la pointe de cet outil qui, quoique arrondie, pourrait laisser des marques désagréables dans le volume et en percer même les feuilles.
Pour exécuter cette opération, l’ouvrier se met en face de la presse ; il se sert de la main gauche pour travailler à la queue et de la main droite pour travailler à la tête. Il peut, s’il le préfère, se placer au bout de la presse pour travailler à la queue, et alors tenir son poinçon de la main droite. Dans le cas où les presses ne seraient pas, comme elles le sont ordinairement, appuyées vers l’autre bout, le long d’un appui de boutique ou d’une croisée, il pourrait se tourner de ce côté, et alors il lui serait également facile de travailler de la main droite. Tous ces moyens sont bons : il suffit que l’ouvrier soit intelligent pour qu’il, réussisse toujours à bien faire. Le paquet doit être serré seulement de manière que les volumes ne puissent pas tomber ; l’ouvrier le soutient avec la main qui ne tient pas le poinçon, et avec le pouce qu’il appuie sur les feuillets qu’il ne soulève pas, il les empêche de se déranger
Le même outil sert à ramener les cartons à la hauteur qu’ils doivent avoir, selon le mors qu’on veut donner ; il sert aussi à ramener les ais à la hauteur des cartons. C’est ici que l’ouvrier doit bien raisonner son ouvrage : il a dû former les dos plus ou moins arrondis, ou les laisser presque plats, selon que les volumes qu’il endosse sont cousus à gros ou à fins cahiers[1]. Il doit de même former les mors plus ou moins profonds, selon qu’il présume que les cahiers formeront plus ou moins de mors, et que l’épaisseur des cartons doit être plus ou moins forte, mais surtout que les cartons et les ais ne soient ni élevés, ni abaissés pas plus les uns que les autres de chaque côté des volumes. Il est même indispensable qu’il règne une grande harmonie entre les ais, les cartons et les volumes sur toute la longueur du paquet.
On doit tenir la queue du volume plus ronde que la tête, celle-ci étant toujours plus ferme que la queue. Les opérations suivantes seraient défectueuses si l’on ne prenait pas ce soin.
On serre ensuite fortement le tas avec une ficelle grosse de 4 millim. au bout de laquelle ont fait une boucle. Il faut au moins quatre tours de ficelle, l’un au-dessus de l’autre, et sans qu’aucun chevauche. Ces quatre tours faits, on arrête la ficelle en la dirigeant contre la membrure, sous le dernier tour. On desserre alors la presse et on enlève le paquet, ou bien on se contente de le soulever de manière à laisser le bas de la membrure engagé avec la ficelle qui lui reste, puis on serre de nouveau.
Il s’agit maintenant de tremper le paquet c’est-à-dire de l’enduire de colle. L’ouvrier le trempe d’abord à la colle de farine, en commençant du côté de la tête, qu’il met en face de lui. À l’aide d’un pinceau, il commence par le milieu de la hauteur du dos du volume, et il vient vers lui jusqu’au haut de la tête ; il retourne le paquet et en fait autant pour la queue. Par ce moyen, la colle ne risque pas d’entrer dans les feuillets ni de glisser sur la tête ou sur la queue. Il laisse tremper ainsi le paquet pendant 3 ou 4 heures.
Après ce temps, l’endosseur met le paquet en presse, et serre légèrement pour l’empêcher de vaciller. Il se place au bout de la presse, le paquet devant lui, du côté de la tête, et avec le grattoir il gratte fortement d’un bout à l’autre pour faire bien pénétrer la colle. Il trempe de nouveau comme la première fois, desserre la presse, retourne le paquet, la queue devant lui, serre suffisamment et gratte de nouveau dans ce sens, en commençant toujours d’un mors à l’autre et en arrondissant. Il trempe encore, sort le paquet de la presse et le laisse ainsi pendant environ quatre heures, après quoi il recommence la même opération, le retourne et le laisse de deux à trois heures sans le travailler. Enfin, il le reprend pour le frottoir.
Il est infiniment important de remarquer que les volumes dont les cahiers sont surjetés ne doivent pas être grattés ; l’ouvrier les pique avec les dents du grattoir, en évitant de frapper sur les ficelles. S’il s’écartait de cette observation, il arracherait à coup sûr le fil, et la reliure n’aurait plus aucune solidité. Règle générale : lorsque dans un volume il se trouve un cahier surjeté, fût-il seul, l’ouvrier ne doit pas gratter, il faut qu’il pique tout le volume.
Le frottage se fait toujours à la presse, et avec l’outil nommé frottoir. L’ouvrier le tient comme une fourchette, l’index allongé sur la tige ; il renverse la main, le bout des doigts en dessus ; et avec la main gauche il empoigne tout à la fois l’outil et le doigt index de la main droite allongé, et il frotte avec toute sa force sur le dos du livre en arrondissant et en tâchant de réparer les omissions qu’il aurait pu faire dans les opérations précédentes avec le poinçon à endosser. Il doit avoir soin de tenir son outil ferme, de ne pas trop l’élever ou l’abaisser : sans cela, il risquerait d’écorcher le volume. Il opère ensuite de la même manière en se servant d’un frottoir de buis. Enfin, à l’aide du marteau, il enfonce les ficelles sur le dos du volume ; avec un frottoir de fer, il égalise les mors, c’est-à-dire qu’il serre et appuie plus ou moins pour les dresser parfaitement en ligne droite et à vive arête ; et il termine en frottant le tout, dos et mors, avec une poignée de rognures.
Pour sécher rapidement le volume, on l’expose du côté du dos devant le feu ou au soleil, en évitant que les feuilles godent et forment des noix ou bosses, défaut très apparent qu’on ne peut faire disparaître.
Quand les volumes sont presque secs, on en revisite les mors avec le frottoir en fer, afin de les bien égaliser ; on en frappe de nouveau les ficelles ; on en frotte le dos avec le frottoir de buis, afin de le rendre parfaitement lisse, et l’on y passe une conche de colle forte légère, qu’on fait sécher devant le feu.
L’endossage à l’anglaise a été inventé pour prévenir les inconvénients que présente le système à la française, quand un ouvrier maladroit ne se sert pas du poinçon avec les précautions convenables. Il est d’ailleurs plus simple et donne beaucoup de facilité pour faire les mors, surtout quand ils ont à loger des cartons épais. Enfin, c’est presque le seul que l’on puisse employer pour les volumes qui ont une grande quantité de planches, de cartes ou de tableaux qui se plient, parce que, dans ce cas, le dos étant moins fourni que la tranche, l’on aurait trop de peine à faire agir le poinçon sans danger.
Ainsi que dans l’endossage à la française, on opère sur un certain nombre de volumes à la fois ; mais on travaille les volumes l’un après l’autre.
On procède ensuite à l’endossure proprement dite. Pour cela, l’ouvrier place le volume entre deux membrures garnies de bandes de fer sur leur épaisseur ; il fait déborder le volume au-dessus de l’ais, d’une hauteur plus ou moins grande, mais égale de chaque côté, selon qu’il veut former un mors plus ou moins épais, et selon que le carton qu’il se propose d’employer est plus ou moins fort. Il descend le volume entre les deux membrures d’une presse horizontale ou étau, dont les mâchoires sont inclinées de dedans en dehors, en ayant soin de ne laisser sortir que la partie nécessaire pour former le mors. En serrant cet étau, le volume est fortement comprimé, les longs côtés du dos font saillie sur les mâchoires, et on les rabat sur celles-ci à petits coups de marteau, en sorte que lorsqu’on desserre, le mors se trouve entièrement fait.
Si par cas il arrivait qu’on eût employé de la colle un peu trop forte, et qu’on craignit qu’elle ne s’écaillât en frappant avec le marteau ; soit en formant le mors, soit en arrondissant le dos, on donnerait l’élasticité nécessaire à la colle, en l’humectant un peu avec une éponge légèrement mouillée.
Dans certains cas, on remplace l’étau par de petites machines, dites à endosser, dont il existe plusieurs espèces.
Le mors formé, on place les cartons, puis, mettant le volume entre deux ais avec les mêmes précautions que si l’on endossait à la française, on le trempe à la colle de farine, comme s’il n’avait pas déjà été encollé à la colle forte. On le gratte ou non, suivant que les cahiers sont plus ou moins durs. On ne le frotte guère qu’avec le frottoir de buis. Enfin, on n’a recours au poinçon que pour égaliser les ais avec les cartons, et jamais pour les feuilles.
À la trempe succède le séchage, qui, se fait devant le feu ou au soleil, comme dans le système français. Enfin, quand le volume est sec, on en lisse le dos, puis on y passe de la colle forte légère, et l’on fait sécher devant le feu.
Pour arrondir convenablement le dos d’un volume, on le pose à plat sur un tas en fer ou sur la tablette de l’étau à endosser, puis on place la main gauche à plat sur le volume, le pouce sur la tranche, afin d’obtenir un point d’appui ; alors, avec les quatre doigts de la même main, on attire les cahiers vers soi, de manière à les coucher légèrement, pendant que, de la main droite, on les frappe avec le marteau à endosser. Les coups de marteau doivent porter sur l’angle du dos et être dirigés du centre aux extrémités, d’abord d’un côté, puis de l’autre, pour revenir, sur le premier côté et partout où il en est besoin afin de former le dos en couchant les cahiers et de l’arrondir convenablement.
La forme à donner au dos n’est pas indifférente : elle correspond à l’ellipse tracée par un compas, en prenant le demi-cercle comme maximum de courbe et le tiers de cercle comme minimum. Cette forme doit toujours être la même : on peut s’en assurer en constatant la rectitude de la tranche de tête ; c’est à cet endroit qu’on peut le mieux s’apercevoir des inexactitudes résultant d’une mauvaise courbure.
1o Nous ne conseillons pas à nos relieurs de faire les dos trop ronds, encore moins de suivre l’exemple de leurs confrères anglais qui font les dos trop plats et par conséquent ayant peu de relief et de coup-d’œil. Un dos bombé suivant une courbure gracieuse, sera toujours plus élégant et fera mieux ressortir les ornements et briller les dorures. On ne devrait pas non plus adopter les dos brisés pour les plus belles reliures, comme font nos voisins.
2o La colle forte qui sert à faire l’endossure doit présenter, une fois sèche, une certaine souplesse. Pour lui communiquer cette propriété, les relieurs anglais sont dans l’usage d’y ajouter de la mélasse dans la proportion de cinq cents grammes par kilogramme de colle fondue, et ils éclaircissent le mélange avec la quantité d’eau qu’ils jugent nécessaire : Outre qu’il est très-économique, ce procédé a l’avantage de conserver à la colle assez d’humidité pour permettre, même après plusieurs jours, d’endosser avec facilité. Toutefois, comme le sucre contenu dans la mélasse cristallise avec le temps et que, de plus, il fond à la moindre humidité, il peut résulter de ces deux faits des inconvénients assez graves pour la conservation des reliures.
Après l’endossage, on colle à chaque volume la garde blanche ; on laisse tomber librement dessus le papier de couleur qui avait déjà été collé à l’endossure ; on appuie légèrement dessus les deux feuillets de papier de couleur, et on laisse tomber dessus le carton sans le forcer. Nous devons faire cette observation sans le forcer, parce que, si l’on conduisait ce carton avec la main, et pour peu qu’on le forçât, il ferait reculer les sauvegardes et les gardes ; on ferait un paquet dans le mors, ce qui gâterait ensuite la reliure ; on ne pourrait plus le réparer à moins d’en mettre de nouvelles. Il faut que les sauvegardes et les gardes restent toujours bien étendues. On met alors les volumes à la presse, entre des ais. Pour peu que l’ouvrier apporte de soin à son ouvrage, il réussira parfaitement, de même qu’aux manipulations qui vont suivre : on n’a pas encore placé la garde de papier de couleur : c’est ici le moment de la coller. Lorsqu’on veut faire un ouvrage très propre, on a dû avoir soin de faire coudre des sauvegardes de la même grandeur que les gardes, ou d’en poser seulement sans les coudre, comme nous l’avons dit plus haut, en rabaissant avant l’endossure, ou au moins que la moitié de la sauvegarde, qui touchera le carton, soit une simple bande, tandis que l’autre moitié, qui touche le volume, soit un feuillet entier. Cela évite ces demi-largeurs de papier qui, appliquées l’une sur l’autre, forment des épaisseurs qui font des marques désagréables dans le volume.
Si l’on veut placer une charnière en peau, il faut toujours qu’elle soit parée, pour en réduire l’épaisseur sur les bords ; il faut de plus la coller avant la garde. Cette charnière est une bande de 4 à 5 centimètres de large, que l’on plie par le milieu de sa longueur, après l’avoir parée. On n’en colle qu’une moitié sur la garde blanche et vers le mors ; l’autre moitié se coIlera plus tard, lorsque le livre sera ouvert ; mais avant de coller cette moitié sur la garde blanche, on doit la doubler d’un morceau de papier blanc et la laisser sécher parfaitement. Sans cette précaution, cette bande de la charnière déposerait une partie de sa couleur sur la garde blanche, et formerait une tache dans toute sa longueur, tache qui serait très-désagréable à l’ouverture du volume.
On met le volume en presse entre des ais de la grandeur du volume et à surfaces parallèles, et on l’y laisse le plus longtemps possible.
En ôtant les volumes de la presse, et après les avoir sortis de dessous les ais, on dégage les cartons des sauvegardes que la pression y a fait adhérer et qui y tiennent un peu ; on fait vaciller les cartons pour les faire monter et descendre.
Ébarber un livre, c’est enlever avec des ciseaux le plus gros de la tranche. Le rogner, c’est en retrancher toute la saillie des marges jusque et y compris les plis, que l’on doit atteindre légèrement, juste ce qu’il faut pour fendre les feuillets.
On ébarbe tous les volumes brochés, mais on ne rogne pas toujours les volumes qu’on relie. On laisse toutes leurs marges aux éditions de luxe ou aux albums de planches montés sur onglet, ce qui leur donne plus de prix pour certains amateurs.
La rognure consiste, en principe, à serrer fortement un livre dans une presse et à en couper les tranches avec un outil tranchant. La presse se nomme presse à rogner, et l’outil tranchant fût à rogner ou rognoir.
Le plus important dans la rognure des volumes est que le dos fasse, avec le haut et le bas des cartons, deux angles bien droits, et que la tranche soit bien parallèle au dos, de sorte que tous les angles se trouvent droits sur les deux faces du volume : on ne peut pas s’écarter de cette règle sans présenter une forme désagréable à l’œil. Le moyen le plus simple et que l’on emploie habituellement est de se servir d’une équerre qu’on applique sur la partie du carton qui se trouve dans les mors.

Pour opérer avec exactitude et sans tâtonnement, on a imaginé une équerre particulière, dite à rebord, (fig. 41), que nous décrirons ci-après.
Sur une plaque de fer de 14 à 17 centimètres de long, 4 centimètres de large, et 5 à 7 millimètres d’épaisseur, on pratique dans sa partie supérieure, et dans le milieu de sa largeur, une entaille de 7 millimètres de large et 5 centimètres et demi de long. On ajuste dans cette entaille une plaque de tôle de 7 millimètres d’épaisseur, 17 centimètres de long, et 3 centimètres et demi de large dans la partie qui doit se trouver dans l’entaille, et qui se termine à 10 millimètres de large par son autre extrémité. On soude, à la soudure forte, ces deux pièces l’une sur l’autre, et l’on a formé, de cette manière, à peu près une équerre qu’il ne s’agit plus que de rectifier à la lime.
À l’aide de cette équerre, il est facile de marquer la rognure à angles droits. Voici comment on s’y prend. On descend les deux cartons au niveau des feuilles de la tête, on appuie le rebord de l’équerre contre le dos du livre, tandis qu’on dirige l’autre branche vers le haut du carton, et l’on marque un trait le long de cette branche : ce trait indique tout le papier qu’on doit enlever, en atteignant tous les feuillets et en laissant le plus de marge possible.
Si, pour un in-folio, ou tout autre format, l’ouvrier n’avait pas d’équerre à rebord assez grande, ou qu’il n’en eût pas du tout, il y suppléerait de la manière suivante : il mettrait entre les deux jumelles de la presse un ais à mettre en presse, de la longueur du volume, mais excédant de 17 centimètres environ la surface de la presse, et après avoir serré la vis il poserait à plat le volume sur la première jumelle, en appuyant son dos contre l’ais ; puis il placerait son équerre ordinaire sur le volume, de manière qu’une des branches de l’équerre touchât l’ais dans toute son étendue, tandis que l’autre servirait à marquer la ligne perpendiculaire sur laquelle doit passer le tranchant du couteau.
De quelque manière qu’on ait marqué la rognure à angles droits, avec l’équerre à rebord ou sans elle, on choisit un morceau de carton pour placer derrière le volume. Ce carton doit être également épais partout, quand le couteau marche bien, c’est-à-dire parallèlement à la surface de la presse à rogner. Quand, au contraire, le couteau marche mal, il faut l’amincir, soit par le haut, soit par le bas.
Souvent aussi, le couteau marche mal, parce que le talon ou la coulisse en fer qui le fixe dans le fût à rogner est mal ajusté. On remédie à ce défaut en haussant ou en abaissant ce talon.
Tout étant ainsi bien disposé l’ouvrier prend le carton de la main gauche, et le place sous le volume, qu’il tient de la main droite, le dos tourné vers lui. Cela fait, avec la même main gauche qui tient le carton ; il saisit légèrement le volume par la tête, en ayant soin de ne le forcer ni de la main gauche ni de la main droite ; pour ne pas faire monter ou descendre les feuilles, il le met dans la presse sans le contraindre, puis, après l’avoir descendu au niveau du trait, il serre la presse.
L’ouvrier se plaçant alors au bout de la presse, la jambe droite en avant, fait agir le rognoir. Il le prend de la main droite, par la tête de la vis, le place sur la coulisse, et avec le pouce et les trois derniers doigts de la main gauche, dont la paume appuie sur la première clé, il empoigne la vis, tandis qu’il appuie l’index sur l’autre clé. Par ce moyen, il empêche le fût de vaciller. Il ne doit faire avancer le couteau que peu à la fois, en tournant faiblement la vis de la main droite. Il doit rogner tout un côté sans discontinuer ; car autrement il s’exposerait à faire des sauts, et la rognure ne serait pas unie. Enfin, il ne faut pas qu’il fasse de grands mouvements ; l’avant-bras doit seul travailler ; et le couteau ne doit, dans sa marche, couper qu’en s’éloignant du corps. Plus on tourne doucement la vis du fût, plus la rognure est unie.
Après avoir rogné la tête, on s’occupe de la rognure de la queue, Il faut d’abord marquer le trait qui doit guider la marche du couteau. Pour cela, on. ouvre le volume, on cherche le feuillet le plus court, puis appuyant le pouce de la main gauche contre la tranche de la tête, on appuie contre ce pouce une pointe de compas, et on ouvre l’autre jusqu’au bout de cette feuille, en y comprenant en plus les châsses que l’on se propose de faire ; encore est-il bon, dans la vue de laisser une plus grande marge à la queue, de ne pas atteindre, à la rognure, tous les feuillets de la queue, ce qu’en langage d’atelier, on appelle laisser les témoins.
Il faut que les deux pointes soient exactement dans la direction d’une ligne parallèle au dos du volume ; car si on les prenait dans une ligne qui ne lui fût pas parallèle, on aurait une distance d’autant plus grande qu’elle s’en éloignerait davantage.
Pour les déterminer, on ferme le volume, on appuie le pouce de la main gauche contre le bord du carton près du dos, et avec l’autre pointe, dont on a soin de ne pas déranger la distance, on marque un point sur le carton. On porte ensuite le pouce vers la gouttière, et l’on marque un second point de ce côté, en ayant soin que dans ces deux opérations les deux points de compas se trouvent dans une ligne parallèle à celle du dos. On trace sur le carton, un trait qui passe par ces deux points. On peut se servir pour cela de l’équerre à rebords. Dans ce cas, on descend également les deux cartons du côté de la tête, d’une quantité égale à deux fois la distance dont on veut que la couverture dépasse la tranche d’un seul côté, et après avoir fait une marque sur la couverture, on trace avec l’équerre un trait qui passe par ce point. Il n’y a plus alors qu’à placer le carton derrière comme on l’a fait pour la tête, et l’on rogne la queue de la même manière que l’on a rogné la tête.
La tête et la queue étant rognées, il s’agit d’effectuer la même opération sur la tranche et de faire la gouttière. À cet effet, avant d’enlever le volume de la presse, on trace sur le bord de la tranche un arc de cercle dont le centre est sur le bord du dos, au milieu de l’épaisseur du volume, et la circonférence à l’endroit où l’on veut rogner la gouttière. Pour cela on appuie le pouce de la main gauche sur le bord du milieu du dos, et contre ce pouce on pose l’une des pointes du compas. On porte l’autre pointe, qui doit être armée d’un crayon, sur le bord de la tranche, à l’endroit où l’on veut rogner la gouttière. On décrit un arc de cercle d’un carton à l’autre ; on retourne le volume vers la queue, et avec la même ouverture de compas on décrit avec les mêmes précautions un arc de cercle semblable. En armant le compas d’un crayon ; on évite de faire un trait ineffaçable que la pointe du compas imprimerait, ce que le crayon ne fait pas.
Pour rogner la tranche, il y a plusieurs précautions à prendre :
1o L’ouvrier saisit de la main gauche un ais en bois de hêtre, d’une épaisseur égale, de 5 centimètres et demi de large et un peu plus long que le volume ; cet ais se nomme ais de derrière. De la main droite, il pose, sur cet ais, le volume par la tranche, en’ laissant pendre les cartons ; puis, par dessus le volume, il met un ais étroit en bois dur. Cet ais étroit est non-seulement plus épais du côté de la tranche que de l’autre côté ; mais son épaisseur est en talus du côté de cette tranche, afin que la tringle qui est fixée au-dedans de la presse ne gêne pas le volume en sens contraire.
2o Il saisit ces deux ais et le volume avec la main gauche, en les serrant assez pour que le volume ne se dérange pas, mais pas assez pour qu’il ne puisse pas céder un peu pour former la gouttière.
3o Il place l’ais de devant au niveau du trait qu’il a marqué avec le compas sur les deux bouts du volume.
4o Il berce le volume, c’est-à-dire qu’il Ie balance de droite à gauche et de gauche à droite, pour faire prendre au trait une forme concave, régulière et égale des deux côtés, tête et queue.
5o Alors l’ouvrier fait monter tant soit peu, du côté de la queue, l’ais de devant, afin de remédier, par la rognure, à une faute qu’on fait indispensablement à la pliure[2]. Ce mouvement d’ascension doit être plus ou moins grand, selon la grandeur du volume, car dans l’in-32, par exemple, l’épaisseur de la trace suffit, tandis que dans l’in-folio, il faut de 3 à 5 millimètres, et quelquefois plus. Cependant lorsqu’un volume est composé de feuilles simples, le même inconvénient n’ayant pas lieu, on est dispensé d’en tenir compte.
6o Il place le volume, ainsi préparé, dans la presse ; il serre fortement et rogne la gouttière de la même manière qu’il a rogné les deux côtés, tête et queue.
7o Quand les volumes contiennent beaucoup de planches, de cartes géographiques ou de tableaux qui se plient, et même dans ceux qu’on nomme atlas qui ne contiennent que des planches, il y a des précautions à prendre pour les rogner en tête et en queue, et pour donner à la tranche la forme de gouttière.
Dans le premier cas, on doit remplir les cavités qui existent, soit avec des rabaissures de carton, soit avec des morceaux de papier, afin que l’épaisseur du volume soit uniforme partout lorsqu’il est serré dans la presse. Par ce moyen, le couteau à rogner éprouve partout la même résistance, et il coupe uniformément sans faire aucune déchirure, aucune écorchure, aucune bavure.
Dans le second cas, c’est-à-dire pour faire les gouttières, après avoir laissé tomber les cartons, on place deux ais de derrière, un dans chaque mors, de manière qu’ils dépassent le volume par chaque bout, puis, posant le dos sur la presse, on appuie fortement avec les ais sur les mors, en frappant le dos sur la presse, ce qui aplatit ce dos. Alors, tandis que l’ouvrier maintient le volume dans cette position, un autre ouvrier lie fortement les deux bouts des ais avec des ficelles, ce qui rend le tout très-solide.
En liant les feuillets pour les empêcher de s’ouvrir, on doit se servir d’un ruban de fil grossier, mais bien étendu, afin de ne pas faire au volume, sur les angles de la rognure, les marques que ferait une corde, marques qu’on ne pourrait pas effacer. Cette ligature se place un peu au-dessus des plis des planches, afin de laisser au-dessus toute la partie qui n’est pas soutenue. Alors on remplit les vides, que les plis des planches occasionnent, avec des bandes de papier ou des bandes de carton plus ou moins épais, selon que les vides sont plus ou moins considérables.
Tout étant ainsi disposé, on place à l’ordinaire, les ais de derrière et de devant, on met le volume en presse, et l’on rogne. Lorsque la rognure est terminée ; on dépresse le volume, on le dégage de toutes ses ligatures et des ais, le dos revient à sa place, et la gouttière se trouve formée.
Faire la tranche., c’est couvrir cette tranche d’une couleur unie, ou la jasper, ou la marbrer, ou la dorer. Ainsi que nous l’avons dit, le relieur de petite ville est obligé de savoir faire toutes ces opérations, et il s’en acquitte tant bien que mal, trop souvent plutôt mal que bien. Dans les grands centres, au contraire, et même dans tous les grands ateliers, elles sont effectuées par des ouvriers spéciaux qui, principalement pour la dorure, sont quelquefois de véritables artistes. Nous ne nous occuperons ici que des tranches unies ou jaspées, les seules que font à peu près tous les relieurs ; quant à la marbrure et à la dorure, nous leur avons consacré des chapitres particuliers.
Pour les tranches en couleurs unies, on n’emploie guère, du moins en France, que le rouge, le jaune et le bleu.
On obtient généralement le rouge avec le vermillon, composé de mercure et de soufre, dont il existe plusieurs variétés. Le plus beau est celui qu’on appelle vermillon de Chine.
Pour le jaune, on pourrait employer ou l’orpin jaune seul, ou le stil-de-grain seul ; mais l’orpin donnerait un jaune trop orangé, et le stil-de-grain un jaune trop pâle. On mêle donc le stil-de-grain avec l’orpin dans une proportion telle qu’on obtienne la nuance de jaune qu’on désire, On se sert aussi du jaune de Cassel. Le jaune de chrome seul est très-beau. Il y en a plusieurs espèces dont les teintes varient du jaune clair au jaune orangé.
Pour le bleu, on prend le bleu de Prusse, l’outre-mer artificiel ou bleu Guimet, le bleu de cobalt ou bleu Thénard, etc.
Si l’on avait besoin d’un vert, on l’obtiendrait avec un mélange de bleu et de jaune.
Toutes ces matières sont en poudre plus ou moins grossière. Pour les employer, on les broie parfaitement à l’eau, sur un porphyre, avec la molette, puis on les délaie avec de la colle de farine suffisamment liquide ou bien dans une eau de gomme ou de gélatine. Après cela, on les met chacune dans des vases particuliers, jusqu’au moment où l’on veut s’en servir.
Les Anglais emploient pour le même usage des couleurs liquides qu’ils conservent toutes prêtes à servir. Voici, suivant Andrew Arnott, comment ils les préparent :
Bleu. ─ Mêlez dans une bouteille 64 grammes du meilleur indigo réduit en poudre très-fine ; une cuillerée à café d’acide chlorhydrique, et 64 grammes d’acide sulfurique. Tenez le tout dans l’eau bouillante (au bain-marie), pendant 6 ou 8 heures ; ensuite ajoutez à froid la quantité d’eau nécessaire pour avoir la nuance de bleu que l’on désire. Ce bleu doit être maintenu très-foncé, par ce qu’on sera toujours maître de le rendre clair en ajoutant de l’eau.
Jaune. ─ Faites bouillir dans de l’eau du safran ou de la graine d’Avignon avec égale quantité d’alun : filtrez et conservez pour l’usage.
Vert. ─ Le bleu et le jaune ci-dessus, combinés en diverses proportions, donnent des verts plus ou moins foncés, d’un bon usage. On obtient aussi un très bon vert en faisant bouillir, dans un peu d’eau, 128 grammes de vert-de-gris et 64 grammes de crème de tartre.
Orange. ─ Faites une décoction dans de l’eau, de 64 grammes de bois de Brésil râpé, et de 32 grammes de graine d’Avignon écrasée ; ajoutez au mélange un peu d’alun.
Rouge. ─ Faites bouillir jusqu’à réduction de moitié, 250 grammes de bois de Brésil râpé, 64 grammes d’alun en poudre fine, un litre d’eau, un litre de vinaigre. Quand l’évaporation a réduit le liquide à un litre, filtrez et mettez en bouteille.
Pourpre. ─ On obtient une bonne couleur pourpre en faisant bouillir, dans trois litres d’eau, jusqu’à réduction à moitié, 225 grammes de bois de Campêche, 64 grammes d’alun et 64 grammes de couperose verte. Le bois de Brésil soumis à l’action d’une forte dissolution de potasse donne aussi une couleur pourpre.
Brun. ─ Faites bouillir ensemble dans de l’eau, 125 grammes de bois de Campêche, avec autant de graine d’Avignon. L’addition d’un peu de couperose verte le rendra plus foncé.
On prend trois ou quatre volumes entre les deux mains, on les bat ensemble par la tête sur la table ou sur le bord de la presse, afin de faire rentrer les cartons au niveau du volume. Cela fait, on les empile au nombre de huit à dix, couchés sur le bord de la table, puis, appuyant fortement la main gauche sur le plat du livre le plus haut, avec un pinceau qu’on a trempé dans la : couleur préparée, et qu’on a essuyé sur le bord du vase, on passe la couleur sur la tranche de la tête, en commençant par le milieu de la tranche et allant vers la gouttière d’un côté et vers le dos de l’autre. On prend cette précaution afin de ne pas laisser amasser de la couleur sur l’angle de la gouttière, parce que cette couleur, en séchant formerait une élévation désagréable à la vue. On donne deux ou trois couches, suivant la nuance que l’on veut produire. On fait la même opération sur la queue et on laisse bien sécher.
La tête et la queue étant sèches, on reprend les volumes, on en fait tomber les cartons et l’on pose l’un d’eux, ainsi débarrassé de ses cartons, sur un ais ; on met un autre ais sur ce volume, et ainsi de suite jusqu’à la fin du tas, qui se compose toujours pour la gouttière, de trois ou quatre volumes, qu’on termine par un ais. On appuie la main gauche à plat sur ce dernier ais, et I’on peint la gouttière comme on a peint les deux bouts, en commençant par le milieu de sa longueur et pour les mêmes raisons ; on laisse bien sécher.
On vient de voir, qu’il faut toujours appuyer fortement sur le volume le plus élevé du tas ; c’est pour comprimer les feuillets, afin que la couleur ne s’insinue pas entre eux.
Si malgré cette précaution, on craignait que la couleur pénétrât dans le volume, on mettrait le tas en presse, on serrerait fortement, et lon passerait la couleur dans cette position. Il est même indispensable d’agir ainsi pour les volumes qui renferment beaucoup de planches. Alors, pour ne pas perdre de temps, et afin que l’ouvrage soit plus régulier, on peut passer la couleur aussitôt que le côté sur lequel on travaille vient d’être rogné, et avant de le retirer de la presse.
Jasper signifie littéralement imiter le jaspe, mais ce mot est ici mal appliqué, puisque c’est plutôt le granit qu’on imite. Quoi qu’il en soit, le relieur appelle jaspure ou jaspage, l’action de rompre l’uniformité d’une tranche peinte d’une couleur, en répandant sur toute la surface de cette tranche des points d’une autre ou de plusieurs couleurs différentes de la première.
Les couleurs les plus usitées pour la jaspure sont le rouge ; le rose tendre, le jaune, le bleu clair, le vert pâle, et le gris.
Pour le rouge et le rose, on emploie le vermillon ; pour le jaune, le jaune de chrôme ; pour le bleu, le bleu de Prusse ou l’outremer artificiel ; pour le noir, du charbon de braise lavé. On broie bien toutes ces matières sur le porphyre, en y ajoutant du blanc de plomb pour en affaiblir l’intensité ; puis on les délaie avec de la colle de farine ou de parchemin bien claire et bien liquide, et on les conserve dans des vases séparés.
On ne jaspe guère que sur le jaune ou sur le blanc ; on pourrait jasper sur le rouge, mais cette sorte de jaspe ne produit un effet agréable que lorsque le rouge est très-pâle.
Pour jasper, on peut avoir recours à plusieurs procédés, mais le plus usité est le dernier que nous décrivons, c’est-à-dire celui de grillage.
Beaucoup de petits relieurs opèrent encore comme on faisait autrefois. Dans ce système, on place les volumes debout sur une table entre deux forts billots de bois, ou dans une vieille presse, afin de les bien serrer ; ensuite avec un gros pinceau à long manche, en forme de petit balai, fait avec des racines de chiendent ou de riz, on prend de la main droite de la couleur bleu très-pâle, et qu’on a bien essuyée sur le bord du pot qui la contient ; on saisit de la main gauche une barre de fer de la presse, on élève les bras en s’éloignant suffisamment des volumes, et l’on frappe du manche du pinceau sur la barre de fer pour faire tomber de haut, sur les volumes, de petites gouttes de couleur comme une légère pluie fine. On frappe légèrement en commençant, et de plus fort en plus fort à mesure que le pinceau devient de moins en moins chargé de couleur. Plus les gouttes sont fines, et plus le jaspé est beau.
On peut jasper en deux couleurs, sur le jaune et sur le rouge pâle. Sur le jaune, d’abord avec le bleu clair, et ensuite avec le rouge ; sur le rouge, d’abord avec le bleu un peu plus foncé que sur le blanc, ensuite avec le jaune foncé.
Le vert mêlé dans les jaspures fait aussi un assez joli effet, lorsqu’il est combiné avec goût. On se sert pour cela du vert de vessie, qui n’a pas besoin d’être broyé ; il se délaie dans l’eau facilement, et il porte sa gomme ou sa colle. On le mêle avec de la gomme-gutte, qui se délaie de même dans l’eau, et l’on produit ainsi des nuances de vert extrêmement agréables. Il se combine très-bien avec le jaune, le bleu et le rouge dans les jaspés.
On connaît une autre manière de jasper, également ancienne, et qui consiste en ceci : L’ouvrier se sert d’une brosse en soies de sanglier, dont les soies ont de 6 à 8 centimètres de long. Après avoir placé solidement les volumes entre deux billots sur une table, il prend, avec la brosse, un peu de couleur, et tournant les soies en dessus, il les frotte avec une règle de fer, pour enlever le plus gros. Ensuite, se plaçant au-dessus des livres, il passe la même règle sur les soies en les agitant. Cette agitation fait vibrer les poils, qui jettent de très-petites gouttes de couleur, et l’on jaspe aussi fin qu’on veut.
Ce procédé a été modifié de la manière suivante : On se procure un cadre de chêne, de 11 centimètres de largeur extérieure, 8 centimètres d’épaisseur, 1 mètre de long, et 33 centimètres de largeur intérieure. Sur les deux longs côtés, on fixe de petits clous à tête ronde, aussi près les uns des autres que la grosseur de la tête le permet, mais cependant sans qu’ils se touchent. Ces clous servent à fixer des fils de laiton d’un millimètre et demi d’épaisseur qu’on tend aussi fortement que l’on peut. Les volumes étant disposés comme ci-dessus, sur une table entre deux billots, on place le cadre au-dessus à une certaine élévation, et l’on promène sur toute sa longueur la brosse chargée de couleur, les soies tournées vers les livres, par conséquent au-dessus du treillage en fil de laiton, qui les agite plus ou moins, selon que l’on frotte plus ou moins légèrement.
Cet outil ayant été reconnu trop embarrassant on l’a remplacé par un grillage formé de fils de laiton tendus sur un châssis rectangulaire en fer, qui est muni d’un manche sur un des côtés et dont le poids est assez léger, pour qu’on puisse le manier sans peine avec une seule main. De la main gauche on tient ce grillage au-dessus des livres, toujours rangés comme précédemment, et, avec la droite ; on promène dessus la brosse chargée de couleur et à laquelle on fait décrire des cercles. C’est ainsi qu’opèrent actuellement tous les relieurs.
Les Anglais font usage pour jasper, de quelques tours de main, sur lesquels nous croyons utile de donner quelques détails, en désignant ces procédés par leur nom anglais, qui n’a pas toujours un équivalent français.
On appelle ainsi ce procédé, parce qu’on y emploie des grains de riz, qu’on peut remplacer par la graine de lin ou de la mie de pain réduite en poudre. D’ailleurs, on distribue à sa fantaisie les grains de riz ou la mie de pain sur la tranche, et l’on asperge ensuite celle-ci avec une couleur quelconque, comme si l’on voulait jasper. Les petits grains semés sur la tranche forment, des réserves blanches, ou de couleur, suivant que l’on a laissé la tranche blanche ou qu’on l’a teinte.
Réduisez en poudre fine dans un mortier, du carmin, du vert de vessie ou tout autre couleur végétale. Mélangez un peu cette couleur avec de l’esprit-de-vin, au moyen d’un couteau à palette. Puis, avec ce même couteau, faites, tomber la couleur petit à petit au milieu d’un plat, que vous aurez préalablement rempli d’eau bien claire. En distribuant la couleur avec précaution, sur les différents points du vase, elle flottera à la surface de l’eau et l’esprit-de-vin lui fera prendre une multitude de formes agréables. Si alors on y plonge la tranche du livre, comme on le fait pour marbrer à la manière ordinaire, on obtient à fort peu de frais les plus jolis effets.
Après que la tranche a été colorée, jaspée ou marbrée, on peut obtenir un effet très-beau et très-riche en la jaspant avec de l’or liquide préparé comme nous allons le dire.
Prenez un livret d’or, mettez les feuilles qu’il contient avec 16 grammes de miel et broyez le tout dans un mortier jusqu’à ce que l’or soit réduit à la plus grande ténuité. Ajoutez-y alors un litre d’eau, mélangez bien le tout et versez-le dans un vase en forme d’entonnoir ou de verre à vin de Champagne. L’or se précipite au fond et le miel surnage. On décante l’eau et le miel et l’on ajoute de nouvelle eau. En répétant plusieurs fois ce lavage, on finit par avoir l’or pur et bien dégagé du miel, qui n’avait été ajouté que pour rendre la trituration possible.
L’or étant ainsi obtenu, faites dissoudre dans une petite cuillerée d’alcool, environ 6 centigrammes de sublimé corrosif ; quand la dissolution est faite, joignez-y un peu d’eau fortement gommée, et enfin l’or broyé. La bouteille dans laquelle est conservé ce mélange doit être agitée lorsqu’on veut s’en servir. Quand la jaspure faite avec cet or liquide est sèche, on brunit ; puis, on couvre la tranche avec un papier fin jusqu’à ce que le travail soit achevé.
On appelle tranchefile, une sorte d’ornement en fil, en coton ou en soie de diverses couleurs, quelquefois même en fil d’or et d’argent, qu’on place en tête et en queue d’un livre, du côté du dos. Elle sert, d’une part, à assujétir les cahiers et à consolider la partie de la couverture qui les déborde ; d’autre part, et surtout, à mettre le dos du livre à la hauteur des cartons.
La tranchefile n’est pas absolument indispensable ; néanmoins, on y a recours pour toute reliure tant soit peu soignée. Des femmes sont habituellement chargées de l’exécuter. Pour les reliures communes, on la supprime ou bien on la remplace par une fausse tranchefile, c’est-à-dire par un bout de ficelle sur lequel on rabat et colle l’extrémité de la peau.
Quand on ne veut pas faire soi-même la tranchefile, on y substitue un morceau de comète : on nomme ainsi une tranchefile toute prête à être mise en place, qu’on trouve dans le commerce où elle se vend au mètre.
La tranchefile se fait ordinairement sur des noyaux de papier roulé, et dont l’extrémité est collée pour que le noyau ne se déroule pas. Lorsqu’elle est faite sur des noyaux plats, la tranchefile produit un bien meilleur effet. Pour cela on prend une feuille de carton plus ou moins épaisse, selon la grandeur des livres qu’on veut tranchefiler ; on colle sur les deux faces de ce carton, avec de la colle de farine, du parchemin mince ; et après l’avoir laissé bien sécher, on coupe, à la presse à rogner, des bandes assez étroites pour faire la hauteur de la châsse des cartons.
On distingue deux sortes de tranchefiles : la tranchefile simple et la tranchefile à chapiteau. Dans l’une et dans l’autre, pour les ouvrages ordinaires, ou emploie le fil, pour les ouvrages recherchés, on se sert de soie, et quelquefois de fils d’or ou d’argent, comme nous l’avons dit plus haut.
Quelle que soit la sorte de tranchefile qu’on veut former, on prend autant d’aiguillées de fil ou de soie qu’on veut employer de couleurs différentes, et on les noue ensemble par un bout, au moyen d’un nœud de tisserand, après quoi on enfile un bout de l’une d’elles dans une longue aiguille, et, afin qu’elle ne se désenfile pas, on fait près de la tête un petit nœud à boucle. On place le volume entre les genoux, ou dans une petite presse, la gouttière devant soi, après avoir baissé les cartons.
Tout étant ainsi disposé, supposons qu’on ait pris une aiguillée de fil blanc et une de fil rouge, et que celle de fil blanc soit enfilée dans l’aiguille.
On pique l’aiguille dans le volume à cinq ou six feuillets, en commençant par la gauche, de manière qu’elle sorte sur le dos de 20 à 22 millimètres de la tête, et l’on tire le fil jusqu’à ce qu’on soit arrêté par le nœud, qui se cache dans le cahier ; on pique une seconde fois à peu près au même endroit, et l’on ne serre le point qu’après avoir passé le rouleau de papier ou la petite bande de carton sous l’espèce de boucle que forme le fil blanc, qui n’est pas tendu : on serre alors ce point, et la tranchefile est assujettie.
Avant de la mettre en place, on a eu soin de la courber entre les doigts pour lui faire prendre la rondeur du dos du livre. On prend de la main droite le fil rouge qui pend à la gauche du livre sur le carton ; on le fait passer de la gauche vers la droite, en croisant par-dessus le fil blanc ; on le passe sous la tranchefile, on en entoure cette dernière, on l’amène vers le côté droit du carton, et l’on serre de manière que le croisement des deux fils touche la tranche du volume.
La même opération que nous venons de décrire se répète avec le fil blanc. Ainsi, de la main droite on prend le fil blanc qui pend alors sur le carton à gauche, on le fait passer, en croisant, par-dessus le fil rouge, on en enveloppe la tranchefile en le passant par-dessous de dedans en dehors, et on l’amène vers le côté droit du carton.
En répétant ainsi alternativement cette opération, en croisant les deux fils, et passant chaque fois pardessous la tranchefile qu’on enveloppe, on arrive au côté droit du livre ; mais avant d’y arriver, on a soin, quand on a fait un certain nombre de points croisés, qui forment ce qu’on nomme une chaînette, laquelle touche la tranche, de faire une passe, c’est-à-dire de piquer l’aiguille entre les feuillets, comme on l’a fait la première fois, mais en ne formant qu’un seul point : cette passe donne du soutien à la tranchefile, et lui fait prendre plus exactement la courbure du dos du livre. On fait plus ou moins de ces passes, selon la grosseur du livre ; mais ordinairement, pour un in-12 ou un in-8o, on n’en fait pas moins de trois ni plus de quatre.
Quand on est arrivé au côté droit du livre, on fait une dernière passe en piquant deux fois l’aiguille comme on l’a fait en commençant. On arrête le fil par un nœud, et la tranchefile est terminée.
On coupe des deux côtés, avec un couteau bien tranchant, les deux bouts de la tranchefile, au niveau de l’épaisseur du volume, afin que ces bouts ne gênent pas les cartons lorsqu’on veut les fermer.
Cette tranchefile se fait avec de la soie de deux couleurs bien tranchantes. Elle diffère de la tranchefile simple :

1o En ce qu’elle est composée de deux noyaux, un gros a a, et un petit b b, qu’on place l’un au-dessus de l’autre, comme on les voit fig. 63 ;
2o En ce que la manière de faire la passe est tout à fait différente. Cette même figure 63 représente ce nœud en grand et en donne une idée. On n’a point serré les nœuds dans le dessin, afin de laisser apercevoir les différents tours que doit faire le fil ou la soie. On commence comme pour la tranchefile simple.
Quand on a assujetti la tranchefile, on prend de la main droite la soie rouge e qui pend vers le côté gauche du livre ; on la croise par-dessus la soie blanche d, on la fait passer vers la droite par-dessus la tranche-file a a, entre les feuillets du livre en r, on la rejette par-dessus le chapiteau b b en s ; puis on la ramène par derrière le chapiteau en t, et on la fait passer par-dessus la tranchefile a a. En serrant ce nœud, on fait une petite chaînette entre la tranchefile et les feuilles du livre, telle qu’on le voit au point q. On répète la même chose avec la soie blanche. Le reste se pratique comme à la tranchefile simple.
Cette sorte de tranchefile se fait comme celle à chapiteau ; la seule différence, c’est qu’on emploie un fil d’or et un fil d’argent. Il faut bien serrer les chaînettes.
Cette tranchefile se fait de la même manière qu’on fait les bagues en crin ou en cheveux. On forme toujours au-dessous une chaînette.

La seule différence entre cette tranchefile (fig. 64) et les autres, consiste en ce qu’on passe plusieurs tours de suite la soie rouge sur la tranchefile, en faisant la chaînette à chaque tour, et qu’on passe le même nombre de tours la soie blanche autour de la tranchefile, en n’oubliant jamais de faire la chaînette à chaque tour. De cette manière on aperçoit un petit ruban rouge, ensuite un ruban blanc, ce qui produit un effet assez agréable.
Les cartons de la couverture ont été coupés en tête et en queue, en même temps qu’on a rogné le volume par ses deux bouts ; mais il reste à les couper, du côté de la gouttière, à la longueur convenable. Cette opération se nomme rabaisser.
Pour cela on place sur la presse un ais à rabaisser. On pose le volume dessus, la tête devant soi et le dos à gauche. Par conséquent, le livre est couché sur le premier feuillet qui repose sur le carton de ce côté ; on ouvre l’autre carton qu’on laisse tomber vers la gauche sur l’ais à rabaisser ; on passe une règle d’acier bien droite entre le volume et le carton sur lequel il est couché ; on enfonce bien ce carton contre le mors, et, sans le déranger de cette position, on fait sortir la règle, parallèlement à la première page de la gouttière, d’une quantité un peu plus grande que celle dont le carton doit excéder le volume en tête ou en queue.
Alors, de la main gauche ouverte, on appuie fortement sur le bord du volume du côté de la gouttière, on pèse par conséquent sur la règle qu’on tient fixement, tandis que de la main droite armée de la pointe ou couteau à rabaisser, qui est le même couteau que nous avons décrit pour tailler le carton, et dont on a le manche appuyé contre lépaule, on coupe le carton, en faisant agir le tranchant contre la règle d’acier. Au lieu de cet instrument, on peut se servir de la pointe représentée dans la figure 24.

Il faut faire attention, pendant qu’on effectue cette opération, de ne pencher la pointe à rabaisser ni sur la droite, ni sur la gauche, parce qu’on couperait alors le carton en biseau, ce qui serait fort désagréable à la vue quand le volume serait couvert.
Lorsque le premier carton est coupé, on retourne le volume, on passe la règle d’acier entre le dernier feuillet et le carton, on pousse bien ce carton contre le mors, et l’on fait sortir la règle au niveau de l’autre carton qu’on a poussé aussi contre le mors. Alors on coupe ce second carton comme on a coupé le premier. En redressant le livre sur les cartons, du côté de la gouttière, sur l’ais à rabaisser, le volume ne doit pencher ni sur la droite, ni sur la gauche, si l’ais à rabaisser est bien horizontal.
L’habitude qu’a contractée le relieur d’opérer ainsi à vue-d’œil lui suffit ; mais s’il craignait de se tromper, il mesurerait ses distances avec un compas, et marquerait un point sur chaque bout du carton ; il dirigerait alors sa règle sur les deux points, ce qui est plus parfait et toujours plus sûr. Toutefois, rabaisser à la presse vaut beaucoup mieux. Voici comment on opère :
Après avoir marqué les deux points, on place par derrière un ais (l’un de ceux qui ont servi pour la gouttière) ; et l’on met en presse, en ayant soin, si le volume est gros et lourd, de le supporter par quelques billots qu’on fait reposer sur une planche placée en travers sur les parois du porte-presse. On est sûr, par ce moyen d’avoir les bords des cartons à angles droits avec les surfaces.
La rabaissure terminée, on bat le carton sur la pierre, en donnant des coups de marteau tout autour, de manière que le second coup couvre le premier sans laisser aucune bosse : On en donne ensuite quelques-uns dans le milieu. De cette manière, le carton est aminci partout et devenu plus dur.
Autrefois, les relieurs coupaient les coins intérieurs des cartons du côté du dos, en prenant de loin environ 3 centimètres et arrivant au bord ; mais, en couvrant le volume et en collant les gardes, il se formait dans ce vide un paquet de papier plissé qui produisait un vilain effet. Aujourd’hui on n’opère plus de même et l’ouvrage est plus propre ; on coupe seulement, avec de gros ciseaux ou avec le couteau à parer, le petit angle qui excède la tranche.
Cela fait, on abat avec un morceau de bois rond, en frottant fortement, les nœuds des tranchefiles ; ensuite on colle sur le dos proprement, soit une bande de parchemin mouillé, avec de la colle de farine, soit, ce qui vaut mieux une bande de toile ou de mousseline, avec de la colle forte légère et chaude. Ces bandes doivent partir de l’extrémité supérieure d’une tranchefile à l’autre, être collées sur les tranchefiles du côté du dos, ainsi que sur le dos, et avoir toujours la largeur du dos.
L’usage de la toile a été introduit en France par Bozérian et Courteval, à l’imitation des Hollandais, des Anglais et des Allemands. Appliquée à la colle demi-forte, la toile est d’un bon emploi ; elle tient le dos ferme et lui procure une élasticité que n’avaient pas les reliures anciennes. Elle tient fort bien sur les dos et s’en détache avec peine, et lorsqu’il faut relier de nouveau le livre qu’elle protège, elle s’enlève facilement au moyen d’une éponge humide. Qu’on laisse sécher le dos un quart d’heure, et l’on peut ensuite séparer les cahiers sans nul dommage. Cependant la toile n’exclut pas l’usage des parchemins qui, bien plus que les nerfs, font tenir le carton au livre.
Pour que les volumes grecqués s’ouvrent à dos brisé, il est nécessaire que la couverture ne soit pas collée immédiatement sur le dos.
Il existe deux moyens, l’ancien et le nouveau, pour obtenir l’effet voulu.
Dans le procédé ancien, on colle sur le dos un carton mince et fort, qu’on nomme carte. Après avoir coupé ce carton de la largeur du dos et de la longueur du volume, on encolle seulement les bords, qui viennent se coller sur le mors, et qu’on serre avec de la ficelle dont on enveloppe le volume et la carte sur toute la longueur, sans laisser le moindre intervalle, et en dirigeant, avec le pouce et l’index de la main gauche, la carte, afin qu’elle appuie également sur les deux côtés du mors, ce qui est très-important. Quand la colle, est, sèche on délie la ficelle et l’on unit les bords avec un morceau de bois rond et uni.
Dans le procédé nouveau, on ne fait pas usage de ficelles, considérées comme inutiles, ce qui abrège beaucoup l’opération.
Quand la reliure est à la fois à nerfs et à dos brisé, on a imaginé de simuler les nerfs en les rapportant sur la carte, de sorte qu’on peut en même temps avoir des nerfs larges ou étroits, minces ou gros, et même former différentes éminences ou creux sur le dos. La dorure produit un effet agréable sur les nerfs ainsi disposés. Les volumes ainsi reliés sont toujours cousus à la grecque.
Pour rapporter les nerfs, on colle des bandes, des morceaux de cuir ou de carton plus ou moins épais sur la carte, et on les espace comme l’on veut. On prépare à l’avance des feuilles de carte sur lesquelles on colle des bandes de cuir ou de carton aux distances convenables, et l’on coupe ensuite ces cartes de la largeur qu’exige l’épaisseur du volume, mais perpendiculairement aux petites bandes. On les colle sur les bords par les mors comme nous venons de le dire.
On sait que les nerfs ainsi rapportés se nomment faux-nerfs.
On colle aux quatre coins, des morceaux de parchemin mince, avec les mêmes précautions qu’on colle les coins de la peau de la couverture, ainsi que nous l’expliquerons plus loin.
Lorsque nous nous servirons à l’avenir du mot colle, sans autre addition, il faut toujours entendre colle de farine. Bien que la colleforte, dite de Flandre, puisse s’employer avec le plus grand avantage et devienne indispensable pour coller proprement le papier en général, les cartes du dos, et même le parchemin, cependant la gomme est très-utile pour les ouvrages très-propres, dont les autres colles pourraient ternir les couleurs ou le blanc.
La manière de couper les peaux est une opération importante ; le relieur peut faire d’assez grandes économies lorsqu’il sait bien s’y prendre. Il a ordinairement des patrons pour tous les formats ; ces patrons sont en carton, et ils ont une étendue de 3 centimètres tout autour plus grande que celle du volume tout ouvert.
On ne doit jamais tremper la basane ou le veau avant de les employer ; au moment de les travailler, il suffit de les humecter légèrement avec de l’eau bien claire. On les plie ordinairement en deux, fleur contre fleur, afin que celles-ci ne soient ni altérées, ni salies, puis on les place entre des cartons épais, qu’on pose sur une table bien plane et que l’on charge de poids, afin de les bien sécher. C’est alors qu’on tire dans tous les sens les peaux ainsi assouplies, afin de les étendre et d’effacer les plis qui pourraient s’être formés. On termine l’opération en les découpant au moyen de patrons.
Lorsque le veau doit rester fauve ou d’une couleur unie, on le coupe à sec et on le passe rapidement dans un plat avec de l’eau bien claire ; on le plie en deux, fleur contre fleur : on ne le tord pas. On doit employer cette peau le plus promptement possible et surtout, pour éviter les taches, en éloigner tous les objets en fer, qui la rendraient défectueuse.
Le maroquin, le mouton maroquiné et le chagrin ne se trempent pas ; on détruirait le grain, et ils se tacheraient.
Les peaux préparées pour la reliure sont apprêtées exprès ; elles sont minces et d’égale épaisseur partout ; elles sont drayées, comme disent les ouvriers.
Si l’on a des patrons, on les présente sur la peau, et on les tourne dans tous les sens pour tirer de celle-ci le plus grand nombre de morceaux, soit pour le même format, soit pour des formats plus petits. De cette manière, l’on met tout à profit, soit pour les dos des demi-reliures, soit pour les coins.
Quand on n’a pas de patron, on prend le livre par la gouttière, on laisse tomber les cartons sur la peau, en appuyant le dos, et avec un couteau de bois on marque tout autour sur la peau, à 2 centimètres et demi de distance du livre : on coupe selon cette marque. On plie chaque morceau en deux, fleur contre fleur, afin qu’ils conservent leur humidité, et on les entasse les uns sur les autres pour les parer ensemble.
Le maroquin, avons-nous dit, ne doit pas être mouillé. Avant de le parer, on se contente de le bien étendre, la fleur en dessus. On ne le marque pas non plus avec le plioir, pour le couper, mais avec de la craie. Enfin, pour le parer, on mouille les bouts des doigts avec de la salive, et l’on roule les bords de la peau en les prenant successivement du côté de la chair. On parvient ainsi à les ramollir et alors le couteau à parer prend beaucoup mieux.
On pare les peaux sur la pierre à parer avec le paroir ; on les ponce de temps en temps jusqu’à ce que la surface soit devenue bien douce et qu’il n’y existe plus aucun grain qui puisse arrêter le couteau à parer. Alors on les laisse sécher complètement. On doit éviter de graisser la pierre avec de l’huile, ce qui constitue un danger permanent pour la peau.
Le couteau doit être bien affilé, et pour entretenir son tranchant, les ouvriers le passent de temps en temps sur leur pierre. Toutefois, leur but, en le passant sur la pierre, n’est pas tant de l’affiler, que de faire passer le morfil de l’acier du côté de la lame qui touche le cuir, et qui la fait mordre davantage. Par le travail, ce morfil se rejette en dessus, et en le passant sur la pierre, on le fait revenir en dessous, ce qui le fait mieux couper.
On étend la peau sur le bord de la pierre, du côté de la fleur, et avec le couteau on enlève de l’épaisseur de la peau, du côté de la chair, en prenant un peu diagonalement à partir de 3 à 5 centimètres du bord, et en allant en mourant jusqu’au bord.
Il faut avoir soin de tenir bien tendue la peau de la main gauche, et de ne pas élever ou trop abaisser la main droite qui tient le couteau à parer. Si cette dernière main était trop élevée, on couperait la peau avant d’être arrivé au bord ; si elle était trop abaissée, on ne couperait pas : il faut un juste milieu, et l’habitude rend bientôt maître.
Toutes les peaux se parent de la même manière. On les plie en deux, fleur contre fleur, au fur et à mesure qu’on les pare, et on les entasse afin qu’elles conservent leur humidité.
Le maroquin est un peu plus difficile à parer, parce qu’il n’est pas mouillé, et il demande une main plus exercée. Il est quelquefois si coriace sur les bords, qu’on est obligé, pour le parer, de le mouiller légèrement avec une éponge humide. Alors, en agissant avec précaution, il n’y a plus de ces duretés que les relieurs attribuent à tort au cylindre.
Le relieur n’emploie aucune peau qu’il ne l’ait parée, afin de faire disparaître les épaisseurs sur les bords. Le but de la parure est, en effet, d’amincir la peau en partant, comme on l’a vu, de 3 à 5 centimèt.</abrr> du bord, et réduisant insensiblement l’épaisseur jusqu’à ce qu’il ne reste que l’épiderme sur le bord. Il faut que chaque coup de couteau enlève une épaisseur égale de peau, afin que celle-ci ne présente ni creux ni bosses. Il faut aussi nettoyer de temps en temps la pierre et la peau, de manière qu’il ne s’introduise entre les deux aucun corps étranger, qui, faisant paraître la peau plus épaisse en apparence sur ces points, rendrait l’opération défectueuse.
Si l’on aperçoit un défaut dans la peau, on doit éviter d’employer cette partie, mais si la chose n’est pas possible, ou que l’accident soit arrivé depuis qu’elle a été taillée, le bon goût indique assez qu’il ne faut pas s’en servir, à moins qu’on ne parvienne à masquer tellement bien ce défaut qu’on ne puisse pas l’apercevoir. Par exemple, si ce défaut se rencontrait sur le dos, il faudrait tourner la peau de manière qu’il pût se trouver placé sous la pièce du titre, qui le couvrirait parfaitement, soit sur une autre place, où l’on mettrait beaucoup de dorure qui le masquerait. S’il devait se rencontrer sur le plat, ce qui serait toujours très-vilain, il faudrait au moins tourner la peau de manière à placer ce défaut sur la surface de derrière, et tâcher de le cacher, autant que possible, par de la dorure, ou du moins par de la gaufrure. Le bon goût du relieur doit présider à tout cela, et il ferait mieux de faire le sacrifice des morceaux défectueux.
Quelle que soit la nature de la peau avec laquelle on se propose de couvrir un volume, les manipulations sont les mêmes ; il ne s’agit que de coller cette peau avec de la colle de farine.
Il n’existe de différence, que dans les précautions à prendre pour ne pas tacher les matières précieuses qui se salissent ou se ternissent facilement, telles que le maroquin, le mouton maroquiné, la moire, le satin, le papier maroquiné ou d’une couleur unie et délicate. Nous expliquerons ces différences. Occupons-nous d’abord du veau ordinaire et de la basane.
Pendant que la peau est encore humide, on l’étend sur un carton, puis avec un gros pinceau, on la trempe avec de la colle du côté de la chair, qui est celui qu’on doit appliquer sur le carton, et l’on a soin de distribuer la colle bien également sur toute la surface, et de ne pas en mettre trop. On enlève ensuite le carton, et l’on étend la peau sur la table, ou mieux sur un autre carton sec. On place la carte sur le milieu de la peau, si elle n’a pas été déjà collée sur le dos, comme nous l’avons dit, et l’on passe un peu de colle sur le bord du mors du volume, des deux côtés, afin que la carte se colle dans ces deux parties. On pose le volume, la tête en haut, à côté de la carte, après avoir mis les châsses bien égales ; on retrousse la peau et la carte sur le dos et le restant de la peau sur l’autre carton, en ayant soin de ne pas déranger les châsses.
En prenant ces précautions, on voit que les châsses sont à la hauteur des tranchefiles et ne les excèdent pas, ce qu’on appelle arranger les châsses droit à la tranchefile, et l’on s’aperçoit que la peau dépasse de trois centimètres environ tout le tour du volume.
Tout étant ainsi disposé, on place le livre en travers devant soi, posé sur les cartons de la gouttière, le dos en haut, après avoir retiré çà et là la peau qui dépasse les cartons. On le saisit alors des deux mains, et à pleines mains, et l’on appuie avec force pour tendre bien la peau sur le dos. On tire fortement cette peau, afin de la tendre parfaitement et qu’elle ne fasse pas de plis.
Lorsque la peau est bien tendue sur le dos, on pose le livre à plat sur la table, la gouttière vers soi, on étire la peau avec soin, et, avec le plat de la main, on la fait bien adhérer au carton ; on tourne le dos vers soi, puis, avec un plioir uni, on frotte légèrement la peau, sans en altérer l’épiderme, pour effacer les rides et les plis, et afin d’abattre le grain. On retourne le livre, toujours la gouttière devant soi, et l’on opère sur ce côté comme on l’a fait sur le premier.
On ne saurait trop bien tirer la peau sur le dos et sur les cartons du volume. Cette opération est indispensable pour que la peau s’applique exactement tant sur le dos que sur les plats du livre, et qu’il n’y reste aucun pli, et en même temps pour amener vers la gouttière l’excédant de colle qui peut s’y trouver.
L’on pourra, avec quelque raison, craindre qu’en tirant de toute sa force et à poignées de mains, une couverture sur un volume, par des efforts qui agissent principalement sur le dos, les mors ne se trouvent tellement gênés, qu’ils ne puissent ensuite s’ouvrir qu’avec peine, ou bien qu’ils ne soient dans le cas de casser dans la charnière ; l’expérience prouve qu’on doit être sans inquiétude. Le relieur ne trouve pas pour ce travail la main d’une femme assez forte, à moins que ce ne soit pour de très-petits formats. Il ne s’agit ici que de tendre parfaitement la peau, et toutes les précautions ont été prises, comme on l’a vu aux § 9 et 10, pour serrer les cartons, contre les mors, de la quantité nécessaire pour ne rien gêner. Les ficelles sont assez fortes pour soutenir l’effort, et la couverture conserve l’élasticité suffisante pour se prêter à tous les mouvements.
La couverture ne saurait être jamais trop tendue. On enlève légèrement avec le doigt la colle qui se présente au bord du carton, et l’on tourne le volume la queue vers soi ; on ouvre la couverture, et avec le pouce de la main gauche et le plioir de la droite, on rabat la peau qui dépasse sur le dedans du carton le long de la gouttière, en la tendant toujours et empêchant toute espèce de pli. On passe le plioir sur la tranche du carton, afin d’en rendre les angles bien vifs. On en fait autant de l’autre côté en retournant le volume.
Il arrive souvent que, malgré tous les soins possibles, la peau, et surtout le maroquin, se ride sur le long des mors, auprès des nerfs : aussi, les bons ouvriers mettent-ils des nerfs très-minces, surtout pour les petits formats.
Ce qui précède se rapporte aux dos à nerfs. Pour les dos brisés, la peau du dos est soutenue par une bande de carte que l’on y colle et sur les extrémités de laquelle on rabat le bord excédant de la peau.
Quand les deux côtés de la gouttière sont bien couverts, on s’occupe de rabattre de même la peau sur les cartons en tête et en queue, et de faire la coiffe. Pour cela, on prend le volume par la gouttière ; on pose le dos du livre sur le bout de la table, en laissant tomber dessus les deux cartons, le livre un peu incliné du haut en bas, et l’angle inférieur de la gouttière appuyé contre le bas de l’estomac, où il est tenu solidement dans une situation verticale. Le relieur ayant ainsi les deux mains libres, appuie légèrement sur la tête, en décolle un peu la carte, qu’il pousse en arrière, afin d’obtenir la place nécessaire pour remployer la peau devant la tranchefile et sur les cartons.
Ce pli se fait selon la ligne droite que présente l’extrémité des deux cartons, en ayant toujours soin de tenir la peau avec les pouces, de maniére qu’il ne se fasse ni rides ni plis, et que la coiffe, qui est à l’extrémité du dos qui recouvre la tranchefile, la déborde un peu. Alors on abat le volume sur la table, on l’y fait reposer sur le dos, en le tenant par la gouttière, les cartons libres : ceux-ci tombent à droite et à gauche ; on achève de coller la peau sur les deux cartons, en se servant du plioir, et avec les précautions que nous avons indiquées pour la coller du côté de la gouttière. Il ne restera plus que les angles à coller, ce qui se fera dans un instant. On retourne le volume de haut en bas, et l’on colle la peau de ce côté, comme on vient de le faire du côté de la tête.
Le relieur soigneux apporte une grande attention à coiffer ses livres, parce qu’il sait que c’est par là qu’ils commencent à se détériorer. Les coiffes des anciennes reliures dépassaient presque toujours les cartons, et cela nuisait à leur conservation dans la bibliothèque.
Avant d’aller plus loin, nous avons quelques observations importantes à faire.
1o Si l’on s’aperçoit, en rabattant la peau sur la carte pour faire la coiffe, que celle-ci ne forme pas une assez grande épaisseur, on introduit sous la peau, avant de la rabattre, un petit morceau de peau mince ou un morceau de papier, après l’avoir collé sur les deux surfaces, ce qui donne l’épaisseur convenable.
2o Si la couverture est en maroquin, en mouton maroquiné, en soie, etc. matières qui par leur nature exigent la plus grande propreté, pour ne pas les tacher, ou pour ne pas altérer leurs formes, on ne les tire pas avec toute la force que nous avons prescrite pour la basane et le veau ordinaire. On se contente de bien appliquer la couverture en serrant avec le pouce et le restant de la main, en même temps sur les deux faces du livre auprès du dos ; il faut surtout avoir les mains très-propres, un tablier blanc, et travailler sur une table couverte d’une serviette propre pliée en deux ou en quatre. Le maroquin exige surtout de grandes précautions, ainsi que les peaux maroquinées, afin de ne pas abattre leur grain ; il faut bien se garder de frotter sur ces peaux avec le plioir, au moins aussi fort que nous l’avons indiqué pour les autres peaux,
3o Lorsqu’il s’agit de faire la coiffe à ces couvertures délicates, il y a aussi une précaution importante à prendre. Pour les couvertures ordinaires, nous avons dit d’appuyer le dos du livre sur le bord de la table, qui doit être arrondi, en l’inclinant un peu vers soi, et le tenant par la gouttière avec l’estomac. Ici, cela se fait de même, mais, pour ne pas s’exposer à tacher le dos, ou pour ne pas faire des marques qu’on ne pourràit peut-être plus enlever, on prend un morceau de carton de la grandeur du volume fermé ; on le met sur le bord de la table, on appuie le dos dessus, et, en le faisant basculer, on entraîne le carton qui garantit le dos précieux qu’on a l’intention de préserver de tout accident. On ne saurait recommander une trop grande propreté dans ces divers cas.
4o Lorsqu’il s’agit de couvertures précieuses ou délicates, on doit coller sur le carton du papier blanc, afin d’éviter les taches que le carton pourrait communiquer aux couvertures. Les ouvriers appellent cela blanchir le carton.
5o Avant de couvrir un volume doré sur tranche, on enveloppe les trois parties de la tranche avec du papier bien propre dont on colle les extrémités l’une sur l’autre légèrement, afin de ne pas dégrader la dorure dans les opérations subséquentes, ou lui fairé perdre sa fraîcheur. On enlève ces papiers lorsque la reliure est terminée.
6o Si l’on venait à faire disparaître le grain du maroquin, on pourrait y remédier en retravaillant la peau à l’aide de la paumelle, pour en relever le grain, comme on le fait dans la maroquinerie.
On ouvre le volume, on redresse les peaux qui, dans les diverses opérations qui viennent d’être décrites, se sont couchées l’une sur l’autre du côté des angles. On les relève dans une position à peu près perpendiculaire au carton ; on les pince entre le pouce et l’index, comme si l’on voulait les coller l’une sur l’autre, puis avec des ciseaux, on les coupe en biais jusque tout auprès de la pointe de l’angle du coin, et l’on ne laisse que ce qui est nécessaire pour que les peaux se recouvrent sans laisser voir le carton.
Après cette préparation, on met, avec le bout du doigt, un peu de colle sur les peaux et sur le carton, et on les applique l’une sur l’autre en appuyant avec l’ongle des deux pouces, pour faire passer, sans laisser d’épaisseur, la peau des bords des côtés, sous celle de devant, ensuite on frotte avec le plioir, afin d’éviter tous les plis.
Les angles en parchemin que l’on place avant de coller la couverture, ainsi que nous l’avons dit page 180, se collent de la même manière que nous venons de l’indiquer.
On passe le plioir fortement dans les mors, afin de faire bien coller la couverture dans cette partie, pour les bien arranger et les rendre parfaitement uniformes.
La coiffe est une des parties les plus importantes du volume ; on doit la rendre le plus solide possible. C’est par la coiffe qu’on prend le volume pour le sortir de la bibliothèque ; l’on court le risque de la déchirer si elle ne présente pas une grande solidité, et le volume perd toute sa grâce.
Dans l’état où nous l’avons laissée, elle n’est qu’à moitié faite. Pour la terminer, on prend, un petit plioir en os dont le bout est bien arrondi, quoique un peu pointu, et ne présente aucune partie tranchante. On enfonce la pointe du plioir dans les angles du dos près de la tranchefile, afin de bien appliquer les peaux l’une sur l’autre. On appuie fortement avec le même plioir sur les angles du carton, qu’on a coupés près du dos, et qu’on nomme mors du car- ton, afin d’y faire bien appliquer la peau dans tous les sens. On rabat ensuite la peau sur la tranchefile, en frappant doucement dessus avec le plat du plioir incliné vers soi, ce qui s’appelle coiffer la tranchefile.
Cette dernière opération ne se fait plus guère aujourd’hui comme nous venons de le dire. On obtient le même résultat d’une manière plus simple.
On prend le volume de la main gauche, on le pose verticalement en travers devant soi, le dos appuyé sur la table ; et de la main droite on tient le plioir en os, le même dont on vient de se servir, pourvu qu’il soit bien plat.
Au lieu du plioir, il vaut mieux employer une petite règle en buis, de 5 centimètres de large et de 5 à 7 millimètres d’épaisseur, dont cette petite surface soit bien à angle droit avec sa largeur.
On peut encore y suppléer par une équerre dont l’une des branches repose sur la table, par son épaisseur, tandis que l’autre est bien verticale. On présente celle branche verticale contre la coiffe, on fait basculer circulairement le volume sur son dos, en appuyant le plioir ou mieux l’équerre contre la peau.
Par ce moyen, la coiffe prend une jolie forme régulière, la tranchefile se trouve bien couverte, et cette opération n’exige que quelques instants pour que la coiffe et les cartons ne forment qu’une ligne droite. On en fait autant sur la queue et avec les mêmes précautions.
On place le même plioir sur les bords des cartons, afin qu’ils présentent une face bien carrée, les angles saillants et non arrondis, comme ils le seraient sans cette manipulation.
On glisse, entre les deux cartons de la couverture et le volume, un morceau de papier qu’on a arraché de la couverture d’une brochure en la débrochant pour la relier. Ce papier, plus épais qu’une feuille simple, garantit le volume de l’humidité. Il ne faut pas perdre de vue que pendant toutes les opérations qui se rapportent à la couvrure, l’ouvrier doit porter la plus grande attention à tenir ses deux cartons toujours à la même hauteur l’un de l’autre.
Aussitôt que le volume est arrivé à ce point, on le met à la presse entre deux ais à mettre en presse, afin de bien marquer le mors. Ces ais sont plus épais d’un côté que de l’autre ; on place l’angle du côté épais dans le mors et bien également des deux côtés du volume, de sorte qu’en serrant la presse, le volume est seulement comprimé dans ces points ; tout le reste est libre.
Lorsque le mors est bien marqué, ce qui a lieu après quelques minutes, on passe un gros fil qui entoure le volume en passant dans les mors, près du dos, sur la tête et sur la queue, dans les coins de la coiffe. On arrête ce fil après avoir fait plusieurs tours ; il sert à conserver la forme que l’on a désiré donner aux angles de la coiffe. Cela fait, on ôte le volume de la presse, et on le met en pile pour le faire sécher.
Pour les volumes couverts de maroquin, etc., on les met en presse en sens contraire, la gouttière en dessus, afin que les plats ne touchent pas la presse.
Si le volume est couvert en veau, qui doit rester fauve, on frotte toute la couverture avec une légère dissolution d’alun.
Nous devons faire à ce sujet quelques observations. Il faut, pour aluner le veau, se servir d’une éponge fine et pure. Ce genre de reliure veut être traité avec soin. Presque toutes les reliures en veau des XVe et XVIe siècles étaient fauves. Pasdeloup s’est illustré dans la teinte égale d’un jaune-brun, parfois très-foncée, qu’il donnait à ses reliures, qui sont, comme on sait, fort recherchées des grands amateurs.
On n’a prodigué le velours et surtout la moire qu’à la fin du XVIIIe siècle. Ce n’est pas que, bien employée, bien dorée, la moire ne produise un très-joli effet. On double rarement un livre de moire, sans y mettre des charnières (ou mors) pareilles au cuir qui couvre le livre. Lorsqu’ils en sont dépourvus, ces livres restent presque toujours raides dans les mors, parce que, pour être employée proprement, la moire doit être collée sur un papier mince, et que cette double épaisseur de papier et de moire rend les mors un peu grossiers.
Lorsque le volume a été cousu à nerfs, ces nerfs doivent être saillants, et le volume ne peut pas être à dos brisé. Il en est de même des nerfs rapportés sur les volumes grecqués à dos brisé. Pour faire bien paraître les nerfs des uns et des autres, il faut fouetter les volumes, c’est-à-dire les lier d’une certaine manière avec une sorte de petite corde qu’on nomme corde à fouet.
On prend deux ais plus longs que le volume ; on place ce volume entre les ais, de manière que ceux-ci débordent la gouttière. On fait une boucle au bout de la ficelle, on enveloppe les bouts des deux ais, et l’on serre fortement ; on fait deux ou trois tours et l’on arrête la ficelle : de là on passe à l’autre bout et l’on enveloppe l’excédant des ais de ce côté avec la même ficelle, en serrant bien et faisant deux ou trois tours, et l’on arrête de même : alors, avec le restant de la ficelle, on enveloppe les nerfs en croisant les ficelles.
Pour bien concevoir cette opération, supposons, par exemple, que le dos n’ait que trois nerfs, un vers la queue, un vers la tête et un au milieu. On prend le volume de la main gauche, tournant la queue vers soi ; on arrête la ficelle sous les ais près de la queue ; on la fait passer tout près du premier nerf, en laissant le nerf entre la ficelle et la queue ; on entoure le volume et l’on ramène la ficelle contre le même nerf. Les deux ficelles bien tendues se trouvent croisées sur le plat du livre, et le nerf est pris entre deux ficelles. De là on passe au second nerf qu’on embrasse par-dessus, puis par-dessous au second tour ; on en fait autant au troisième et à tous les autres ; enfin, on arrête la ficelle et l’on met le livre à sécher. On conçoit facilement que le nerf est parfaitement détaché et très-bien marqué.
Lorsque le volume est bien sec, on détache la ficelle, et c’est ce qu’on appelle défouetter ou ôter le fouet. On ne peut pas fouetter les volumes couverts en maroquin ou en peau dont la fleur est trop délicate ; on risquerait de gâter le grain qui constitue la beauté de ces couvertures. Dans ce cas, on se sert d’une palette à dorer à deux filets, on la fait un peu chauffer, et l’on embrasse le nerf entre ces deux filets, ce qui les détache parfaitement. On se sert aussi d’un outil spécial nommé pince à nervures, au moyen duquel le travail sa fait plus vite.
Lorsqu’on désire former un double nerf sur le dos du volume, et dans le même cas, on se sert d’une palette à trois filets qu’on applique de même après l’avoir fait un peu chauffer. Aussitôt que le volume a été porté à ce point, et qu’il est aux trois quarts sec, afin qu’il se trouve toujours dégagé dans les mors, on ouvre les cartons, l’un après l’autre, et avec le tranchant du plioir couché sur le carton et sur le mors tout à la fois, on le passe sur l’angle du carton, et l’on examine le mors, afin d’y passer de la colle dans le cas où il en manquerait dans sa longueur. Il faut bien examiner si le carton touche bien également dans toute sa longueur. On le laisse sécher entièrement dans cette position, les cartons ouverts.
Avant d’aller plus loin, on s’occupe de boucher les trous qu’on a pu remarquer dans la peau. Cette opération, qu’on appelle placer les pièces blanches, consiste à coller sur les trous, à la colle de pâte, des morceaux de peau absolument semblables à la peau de la couverture.
On commence par remplir les trous jusqu’au niveau de la couverture, avec des rognures de parage légèrement enduites de colle, et l’on pose par-dessus les pièces blanches. Ces pièces doivent être aussi petites et parées aussi fin que possible.
Si, au lieu de trous, on n’a trouvé que de simples piqûres, on les remplit, toujours au moyen de la colle, avec des fragments infiniment petits pris sur le bord des parures ; cela suffit pour ne pas mettre de pièces blanches, lesquelles, quoiqu’on fasse, sont toujours plus grandes que les trous des piqûres.
Les pièces blanches étant placées, si le volume doit rester uni, on le met en presse entre deux ais de bois blanc, de carton ou de poirier, puis, pendant qu’il est en presse, on en redresse le dos, opération consistant à le frotter fortement avec un frottoir de buis. On a soin de poser sur le dos un morceau de parchemin, afin que le frottoir ne puisse en altérer la couleur.
Quand le volume ne doit pas rester uni, on en rabat les plats, c’est-à-dire qu’avec le marteau à battre on aplanit les plats de la couverture sur la pierre à battre.
Prenant donc le volume de la main gauche, on pose l’un des côtés de la couverture sur le bord de la pierre, la peau en dessus, puis, à petits coups de marteau, on frappe régulièrement sur toutes les parties du plat, en prenant la précaution de ne pas toucher au dos et manœuvrant le marteau de façon qu’il ne laisse aucune empreinte visible. On répète ensuite l’opération sur l’autre plat.
Après le battage des plats, on procède, s’il y a lieu, au racinage et à la marbrure de la couverture, opérations dont nous parlerons plus loin.
Le titre des ouvrages est ordinairement imprimé directement sur le dos des volumes en lettres dorées, rarement à froid. Mais il est des cas, par exemple lorsque la peau est racinée ou bien teinte en fauve, où il est nécessaire d’y coller des pièces de titre, c’est à dire des morceaux de peau de couleur plus foncée, destinés à recevoir le titre de l’ouvrage, afin de le rendre plus apparent et plus lisible. Nous allons dire comment on procède à cette opération.
Le relieur doit avoir des patrons pour tous les formats. S’il n’en a pas, voici de quelle manière il se les procure :
Après avoir choisi la palette qui doit lui servir pour marquer le nerf, il la place trois fois de suite à la queue, et il partage le reste du dos en six parties égales. Chacune de ces parties est la hauteur du titre.
Une des trois palettes placées en queue est rapportée en tête, les six entre-nerfs viennent ensuite, et les deux autres palettes restent en queue. Il suit de là que le dos doit être divisé entre six entre-nerfs, et que la tête doit être plus longue d’une palette, et la queue plus longue de deux palettes. Cette règle est générale pour tous les formats.
Ces préparatifs achevés, on prend des morceaux de maroquin ou de mouton maroquiné non cylindrés, c’est-à-dire à grain carré (peu importe la couleur, dont le choix est une affaire de goût), puis, après les avoir étendus sur une planche de hêtre, bien unie, on pose dessus, pour les maintenir, une règle de fer parfaitement droite, et on les découpe en bandes d’une largeur égale à la hauteur d’un des six entre-nerfs.
On pare d’abord ces bandes dans toute la longueur, de manière à les réduire à presque rien sur les bords. On divise ensuite chacune d’elles en fragments d’une longueur égale à la largeur du dos, et on pare les nouveaux côtés qu’on vient de former, comme on a paré les premiers. On diminue également l’épaisseur du milieu, afin de la rendre la plus petite possible.
Quand le volume n’a qu’un titre, la pièce qui doit porter ce titre se place sur le premier entre-nerf et le second. Quand il en a deux, le second, qui est le titre du tome, se met entre le troisième entre-nerf et le quatrième.
On encolle chaque pièce séparément, mais plusieurs à la fois, pour qu’elles aient le temps de bien tremper. On les fixe sur le dos, d’abord avec les deux pouces, puis on met dessus un morceau de papier, et l’on appuie avec la paume de la main.
Sur les volumes auxquels on ne veut pas rapporter des pièces de titre, tels que ceux qui sont couverts en veau, ou en basane de couleur, il est d’usage de donner une teinte plus foncée aux places qui doivent recevoir les titres ou les tomes. On y parvient facilement en se servant d’une forte dissolution de potasse que l’on prend avec un petit morceau de peau coupé parallèlement, d’une largeur un peu moindre que ne serait la pièce de titre, et d’environ 14 à 17 centimètres de long.
Après avoir placé le volume entre deux billots, sur la gouttière, on prend la bande de peau, la chair en dehors, avec le pouce et le troisième doigt, l’index entre les deux bouts, et l’on trempe l’endroit du pli dans la potasse. Alors on déploie la bande, l’on en prend un bout entre le pouce et l’index de chaque main, on l’applique sur le dos à la place, ou aux places qu’on veut foncer, en agitant et en pressant de droite à gauche, afin de faire bien pénétrer la potasse.
Il y a des précautions à prendre pour que la pièce soit bien nette dans tous les sens, car rien ne serait plus laid que si elle était baveuse.
Si l’on ne trouvait pas que le titre fût encore assez foncé, on pourrait y passer du noir de racinage, de la même manière et avec les mêmes précautions.
En remplacement de la potasse et du noir, on peut se servir de l’une des encres dont il sera question plus loin ; mais il faut les placer avec un pinceau à plume.
Comme nous avons réservé un chapitre spécial à la dorure., nous ne nous arrêterons pas ici à cette opération, ou plutôt à l’ensemble d’opérations que l’on désigne sous ce nom. En conséquence, nous supposerons que la tranche n’a pas été dorée, mais simplement teinte d’une couleur unie, ou bien jaspée, ou encore marbrée.
{{c|§ 23. — brunissage de la tranche.
brunir la tranche, c’est en unir toutes les parties au moyen d’un frottement énergique et la rendre aussi brillante que possible.
On commence le brunissage par la gouttière. On prend des ais bien unis, un peu plus longs que le volume, mais à peu près de la largeur du format. Ces ais sont, dans le sens de leur largeur, beaucoup plus épais d’un côté, que de l’autre ; on les nomme ais à brunir. On met quatre de ces ais sur une pressée de dix volumes, un à chaque bout, et les deux autres disposés entre les volumes. Pour cela on appuie les volumes sur la presse par la gouttière, on place les deux ais intérieurs, et enfin les ais des deux bouts, en ayant soin de mettre leur côté épais vers la gouttière ; par ce moyen, en serrant toute la pile dans la presse, les gouttières sont plus serrées que le reste du volume.
L’ouvrier placé au bout de la presse met les livres de son côté, et les élève de ce même côté plus que de l’autre, de manière que les volumes sont dans un sens incliné, puis il serre fortement la presse. Saisissant un brunissoir d’agate ou de caillou très-dur, en forme de dent de loup, et d’une grosseur proportionnée à la tranche, il frotte fortement celle-ci. En exécutant son travail, il tient l’instrument à deux mains, l’extrémité libre appuyée sur son épaule, et il le fait agir partout, sur la gouttière de chaque volume, en évitant de faire des ondes et ayant soin de n’oublier aucune place.
Quand la gouttière est terminée d’une manière satisfaisante, on dépresse et on enlève le paquet de volumes ; on ôte les ais et l’on en prend d’autres qui sont, comme les premiers, plus épais d’un côté que de l’autre, mais dans le sens inverse, c’est-à-dire que, dans le sens de leur longueur, ils sont plus épais d’un bout que de l’autre ; ceux-ci servent pour brunir la tête et la queue, au moyen d’une dent plate.
Dans cette deuxième opération, on emploie un plus grand nombre d’ais que pour la gouttière ; on en met six, dont un à chaque extrémité, et les quatre autres divisés entre les volumes, à volonté. On les place en presse comme dans le premier cas, et, avec le même soin, on brunit la tête. Cela fait, on dépresse, on change les ais de place pour brunir la queue, et l’on emploie les mêmes précautions pour ne pas faire des ondes, et ne pas laisser des places qui n’aient pas été brunies.
1o Pour la demi-reliure, on brunit les tranches avant d’avoir couvert les cartons en papier, parce que le papier n’a pas assez de consistance pour pouvoir résister, sans danger de se déchirer ou de se ternir, à toutes les opérations qui suivent celles de la couverture en peau.
2o Les volumes couverts en basane ou en veau doivent être traités avec précaution ; ces peaux peuvent s’écorcher ou se déchirer, et si l’on n’y porte pas continuellement beaucoup d’attention, on peut être dupe de sa négligence ou de son peu de soin.
3o D’un autre côté, la dent à brunir, quoique très dure, puisqu’elle est d’agate, peut s’écailler par un choc, ou en tombant ; d’ailleurs, elle s’use à la longue et devient tranchante ; si l’on s’en servait sans l’avoir regardée, elle gâterait tout l’ouvrage.
4o Il est toujours très-avantageux de brunir les volumes avant de les couvrir.
5o Si un volume était trop mince pour qu’on pût le brunir, ainsi que nous venons de l’indiquer, il faudrait ouvrir les cartons et placer les ais sur les gardes ; alors on les brunira sans difficulté, et avec la même facilité qu’un gros volume.
L’ouvrier pose le volume sur la table, le dos tourné vers lui ; il ouvre la couverture qu’il fait tomber de son côté. Alors il fend avec les doigts la fausse garde ou l’onglet par le milieu de sa longueur, et déchire à droite et à gauche ; et si I’onglet a été cousu, il enlève le fil qui le tenait et qui pourrait le gêner dans le mors. Il fait pirouetter le volume sur lui-même et place la queue devant lui, la couverture toujours rabattue sur la table ; dans cette position, avec le plioir il nettoie le carton sur le bord du mors et sur le plat, afin d’en enlever toutes les ordures et les aspérités qui, enfermées ensuite sous la garde, dépareraient l’ouvrage lorsqu’il serait terminé ; ensuite il fait cambrer le carton en forme de gouttière, en dedans, avant de coller la garde, et il laisse sécher dans cette position, afin que le carton conserve cette cambrure qui fait que le volume paraît parfaitement clos lorsqu’il est fermé.
Pour les papiers ordinaires, on emploie généralement la colle forte ou la colle de pâte. Pour les étoffes, les papiers satinés ou moirés, le maroquin, qui pourraient perdre de leur lustre, on se sert de colle de gélatine, qui est plus blanche. Cette règle concerne surtout le collage de la garde. On emploie aussi la gomme arabique bien blanche, dissoute dans de l’eau tiède, ou encore un empois très concentré.
Pour préparer cet empois, on délaie à froid dans de l’eau pure de l’amidon bien blanc, en ayant bien soin qu’il ne s’y fasse pas de grumeaux ; on met sur le feu et l’on fait bouillir ; on remue continuellement, afin que l’amidon ne se grumelle pas, et on laisse bouillir jusqu’à ce que l’empois ait pris la consistance qu’on désire : il s’épaissit en se refroidissant. Si on l’avait fait trop consistant, on y ajouterait de l’eau bouillante petit à petit en remuant toujours. Quand cet empois a une consistance suffisante, il sèche très rapidement et ne tache pas.
Quelle que soit la matière agglutinante employée, on la passe sur le volume avec un pinceau, en commençant par le mors, vers le milieu, et allant vers les bords de la feuille tout le tour. Si l’on ne prenait cette précaution, on courrait le risque de mettre de la colle sur la tranche du livre, et l’on collerait les feuilles entre elles, ce qu’il faut surtout éviter et qu’on évite toujours, en plaçant sous la garde qu’on veut enduire de colle, un papier plus grand que le volume ; par ce moyen, la colle ne peut pas atteindre la tranche.
La garde ayant été ainsi bien trempée, sur toute sa surface, on laisse tomber, la couverture dessus, elle saisit la garde et l’entraîne avec elle. Ouvrant alors le volume, avec l’index de la main droite, on fait descendre la garde pour la placer bien carrément dans le mors, et de la main gauche posée à plat sur la couverture, on étend doucement la garde, et l’on fait en sorte qu’elle soit bien tendue et bien unie.
Enfin, on pose une feuille de papier sur le tout, et en pinçant par dessus le bord intérieur du carton avec le pouce et l’index réunis, on donne au mors intérieurement une forme bien carrée. On passe également la main à plat sur le papier ; au besoin même, on s’aide du plioir, pour que la garde se trouve bien unie, sans plis et sans grosseurs.
Quand la garde est collée sur l’un des côtés de la couverture, on passe à l’autre côté. Pour cela on place un ais sur le volume, et laissant ouvert le côté de la couverture sur lequel on vient de travailler, on retourne le livre, et alors il repose sur l’ais qu’on appuie contre le mors. L’on opère sur ce côté comme on a opéré sur l’autre.
Il est bon d’entrer ici dans quelques détails sur plusieurs circonstances particulières que présentent des ouvrages plus soignés que ceux que nous venons de décrire.
1o Si le volume avait, dans l’intérieur de la couverture, une bordure dorée ou gaufrée, qu’il importe de conserver entièrement à découvert, on doit concevoir qu’en mouillant la garde, le papier s’étend dans tous les sens, de sorte que si on collait sans précaution, une partie de la bordure serait cachée. Pour éviter cet inconvénient, on coupe en tête et en queue une petite bande proportionnée à l’extension que prend le papier, et à la largeur de la bordure. On en ferait autant du côté de la gouttière, si la garde se trouvait trop large et couvrait la bordure.
2o Si le volume avait des charnières en maroquin ou en veau, on se rappellera ce qui est dit, pages 154-155, sur la manière de les placer. Nous avons fait observer que cette bande, qui doit former charnière, est pliée en deux dans sa longueur, qu’une partie est d’abord collée sur la garde, et qu’on se réserve de coller l’autre moitié sur le carton, après que le volume aura été couvert. C’est ici le moment de terminer cette opération. On doit d’abord couper et parer les deux angles de cette bande, afin qu’ils forment l’angle d’un cadre. Cette opération doit se faire avant de dorer la bordure, puisque cette partie de la charnière qui forme l’encadrement doit être dorée, mais il faut cependant faire attention qu’on doit laisser assez de peau pour couvrir parfaitement et carrément toute l’épaisseur du carton qui forme le mors. Il faut donc, en coupant ces coins, ne pas aller jusqu’au pli de la peau, mais en laisser une quantité suffisante pour que, lorsque la garde sera collée, on ne puisse pas s’apercevoir que les angles ont été coupés. On pare d’abord le bord de ces deux coupures sur un petit ais ou sur un morceau d’ivoire, que l’on passe par dessous : ensuite on colle cette demi-charnière sur le mors et sur le carton, avec les précautions que nous avons indiquées, en mouillant la peau avec de la colle de farine à l’aide d’un petit pinceau, et se servant, pour la bien appliquer, du pouce, de l’index et du plioir.
La charnière ainsi collée, on colle la garde bien proprement avec de la gomme ou de l’empois bien blanc et très-fort, qui sèchent très-vite, et n’altèrent ni la soie, ni le papier précieux dont on veut former la garde.
3o Il faut faire attention que dans le cas où l’on met une charnière en peau, cette charnière doit être vue et ne peut être couverte ni par la soie, ni par le papier, quelque précieux qu’il soit. Par conséquent, la garde ne peut être d’une seule pièce, comme dans les ouvrages ordinaires ; elle doit être de deux pièces, l’une qui sera collée sur le côté du volume, et l’autre sur le carton de la couverture.
4o On est assez souvent dans l’usage d’orner les gardes en soie d’un cadre doré. Dans ce cas, avant de les livrer au doreur, on leur fait subir une préparation particulière. Cette préparation consiste à coller la soie sur un papier fin, afin de donner de la consistance au tissu et de l’empêcher de se défiler.
À cet effet, on coupe les gardes à peu près de la grandeur convenable, les laissant de quelques millimètres plus grandes tout autour qu’elles ne doivent être et l’on prend un carton blanc ou propre. On encolle, avec de l’empois blanc, un papier fin ; on pose dessus l’envers de la soie ou de l’étoffe, en ayant bien soin que celle-ci dépasse le papier de 3 à 5 centimètres tout autour ; on encolle alors avec précaution les bords de la soie et on la rabat avec soin sur le papier que l’on fixe ensuite en appuyant doucement avec la main ouverte, de manière que le tout soit bien tendu et bien uni.
Un seul pli dans le papier ou dans la soie, ou une seule place qui n’aurait pas été bien encollée, produiraient des effets très-désagréables à la vue. Si l’étoffe de soie était destinée à un in-4o ou à un infolio, un ouvrier seul ne réussirait pas à bien la placer sur la feuille mouillée, il doit se faire aider par un autre ouvrier. L’un tient, à une certaine hauteur, l’étoffe avec les deux mains, pendant que l’autre pose et fixe le bout opposé ; et au fur et à mesure qu’il appuie les doigts sur l’étoffe, l’autre obéit insensiblement en laissant descendre successivement l’autre bout, jusqu’à ce que le tout soit bien placé. On met dessus une feuille de carton et on laisse bien sécher soit à la presse, soit sous la pression d’un poids suffisant
Quand le tout est bien sec, à l’aide d’une règle en acier bien droite, d’une bonne équerre, et de l’angle arrondi du couteau à parer, on coupe bien carrément les deux demi-gardes, l’une selon la dimension que présente le cadre du carton, et l’autre selon la dimension du volume. Aussitôt que le carton de la garde est coupé, le papier sur lequel reposait la soie, et qui n’a pas été collé, se détache, et l’on voit la soie à découvert. Il passe alors entre les mains du doreur, et ce n’est qu’après qu’elles ont été dorées qu’on les colle sur le volume.
Quelques relieurs avaient autrefois l’habitude de coller la garde de soie sur le côté du volume avant de le rogner. Cette méthode est tout à fait défectueuse et elle doit être rejetée : dans tous les ateliers, les bons ouvriers ont été obligés d’y renoncer, et d’adopter le procédé que nous indiquons et que nous conseillons d’après l’expérience. Cette manipulation nouvelle met à l’abri de tous les risques qu’on a à courir lorsqu’on opère d’après l’ancien procédé, tant pour la propreté de l’ouvrage, que pour conserver à la dorure tout son brillant et toute sa fraîcheur.
5o Quand un volume est couvert en maroquin, en mouton ou en papier maroquiné, on doit, avant de coller la garde, abattre le grain avec le couteau à parer, sur la partie seulement que la garde doit couvrir, afin d’éviter les épaisseurs que le grain formerait dans ces parties.
On doit encore avoir soin de coller une garde en papier blanc collé, de la grandeur de la garde précieuse, et laisser bien sécher. On colle ensuite avec propreté la garde précieuse sur cette garde blanche ; si l’on ne prenait pas cette précaution, il arriverait presque toujours que les acides qui entrent dans la composition du maroquin se déchargeraient sur la belle garde, et formeraient tout autour une tache d’un jaune rougeâtre. Cette tache se porte sur le papier blanc qui, lorsqu’il a été collé, la laisse très-rarement traverser ; et, par ce moyen, on évite que la garde précieuse soit tachée.
Lorsqu’on colle cette belle garde avec de la colle forte bien consistante, on évite ces taches.
La polissure est la dernière des opérations du relieur. Elle a lieu après la dorure, quand on a eu recours à celle-ci, et consiste à donner à la surface de la couverture, plats et dos, le même aspect uni et glacé que le brunissage a donné à la tranche.
Le volume étant terminé, on le met à la presse entre des ais, et on l’y laisse aussi longtemps qu’on le peut. Au sortir de la presse, on le prépare pour la polissure.
Si le volume est en basane ou en veau, on met un peu de suif sur un tampon de laine, on frotte bien sur toute la surface du plat de la couverture, et non sur le dos, en décrivant des petits ronds. On a pour but dans cette opération, de graisser légèrement et uniformément toute la surface, afin de donner au fer à polir (fig. 98) la facilité de glisser sur la couverture sans effort.

Pour avoir une idée exacte du fer à polir, il faut le considérer comme si on le tenait à la main par son manche en bois, et qu’on le regardât par sa surface inférieure, partie qui sert à polir, et qu’on met en contact avec la couverture. C’est un bloc de fer forgé qui est fixé à l’extrémité d’un manche de bois d’environ trois centimètres de diamètre et de 30 à 35 centimètres de long. La forme de ce bloc est presque impossible à définir. On peut, jusqu’à un certain point, la comparer à celle d’un gros œuf coupé dans sa longueur. La partie inférieure, très-unie et parfaitement lisse, présente tout autour un large biseau. C’est par là que l’outil fonctionne.
Pour se servir du fer à polir, on le fait chauffer plus ou moins, selon que l’exige la peau sur laquelle on doit travailler. On ne peut donner aucune règle invariable sur le degré de chaleur auquel il convient de l’élever. Ici, l’expérience seule peut servir de guide. Toutefois ; on ne saurait apporter une trop grande attention dans cette opération, car on peut tout gâter si le fer est trop chaud, et ne pas atteindre le but proposé s’il ne l’est pas assez.
L’ouvrier commence par polir le dos. Pour cela, il place le volume sur la table, d’aplomb sur le châssis de devant, en le maintenant de la main gauche, et en tenant le fer de la main droite. Appuyant alors le bout du manche de celui-ci sur la table contre un point résistant, il en fait glisser, en appuyant suffisamment, la partie polie du fer sur toute la surface du dos, à peu près du milieu de sa longueur jusqu’au haut de la tête. En opérant ainsi, il se propose non-seulement de polir cette surface, mais en même temps, si le volume a été doré, de faire disparaître les enfoncements formés sur la peau, par les fers de la dorure, et de ramener cette dorure à la surface, ce à quoi il parvient facilement en appuyant plus ou moins ; cependant, il ne doit appuyer, ni frotter assez fort pour enlever l’or.
Quand cette première moitié du dos est terminée, on retourne le volume et l’on opère de la même manière sur l’autre moitié.
On ne doit pas oublier de ne passer le fer que sur les parties qu’on veut rendre brillantes, il faut donc se garder de toucher celles qui sont destinées à rester mates.
Après avoir poli le dos, ou fait la même opération sur les plats.
Quel que soit le plat qu’on travaille, le travail se fait exactement de la même manière.
Après avoir placé le volume sur la table, la queue vers lui, l’ouvrier l’assujettit suffisamment pour qu’il ne puisse pas glisser par le mouvement du fer, puis, saisissant ce dernier avec les deux mains, le bout du manche arc-bouté contre l’épaule, il le promène sur le plat en appuyant suffisamment, et en allant du mors vers la gouttière.
Quand le plat a été ainsi travaillé sur toute la surface, l’ouvrier retourne le livre en plaçant le dos vers lui, et après l’avoir bien calé, comme d’abord, il polit dans un sens qui croise le premier à angles droits. Par ce moyen, il parvient facilement à atteindre les places sur lesquelles il n’aurait pas passé dans son opération précédente.
Si la garde est de nature à être polie, on commence par placer le volume en long, devant l’ouvrier, c’est-à-dire la queue vers lui. Il appuie d’abord le fer contre le mors, et il polit cette partie. Ensuite, il fait pirouetter le volume, en amenant la gouttière vers lui, et il polit le bord du carton. Il fait pirrouetter une seconde fois, pour tourner la tête de son côté, et, dans cette position, il achève de polir toute la surface intérieure, en ayant soin d’appuyer fortement sur les coins, qui sont plus épais, afin de les rabattre.
Nous n’avons décrit qu’un seul fer à polir, quoi qu’il en existe d’autres, que chaque ouvrier emploie selon son idée et son goût. Ainsi, il y’en a dont le fer est petit, cambré et arrondi sur le bout, de sorte qu’il peut être utilisé sur les dos et sur les plats ; ce qui donne beaucoup plus de force, parce qu’on appuie le manche sur l’épaule.
Toutes les étoffes en général, la soie, le papier maroquiné ou chagriné, ne se polissent jamais. On ne doit pas non plus polir les couvertures en papier gaufré ; on se contente de les vernir, ainsi que nous allons l’expliquer ci-après.
Pour les papiers qui sont susceptibles d’être polis, on ne peut bien réussir, et surtout sur les papiers unis, sans avoir préalablement encollé le papier avec une eau de colle bien blanche et assez forte, et même délayée sans mélange d’eau, si toutefois la couleur du papier peut la soutenir. Dès, qu’il est sec, on le glaire comme si le volume était couvert de peau, et l’on obtient un poli superbe. On peut vernir sur ce poli.
On vient de voir que lorsque les volumes sont recouverts de soie, ou de maroquin, ou de mouton maroquiné, ou de papier maroquiné, ou enfin de peau ou de papier gaufré, on remplace la polissure par un vernissage.
Quoique les vernis se trouvent dans le commerce, tout fabriqués et prêts à servir, nous allons indiquer, à titre d’exemple, la préparation de quelques-uns d’entre eux.
Dans un matras à col court, d’une contenance au moins de 3 kilogrammes d’eau, on introduit un mélange de 180 grammes de mastic en larmes, 92 grammes de sandaraque en poudre, et 120 grammes de verre blanc grossièrement pilé, dont on a séparé les parties les plus fines au moyen d’un tamisage, puis on y verse 975 grammes d’alcool pur de 86 à 93 degrés centigrades.
On a eu soin de préparer un bâton de bois blanc, arrondi par le bout, et d’une plus grande longueur que la hauteur du matras, afin qu’on puisse agiter facilement les substances mises en digestion dans ce dernier.
Cela fait, on place le matras sur une couronne de paille ; dans un plat rempli d’eau, et l’on expose le tout à la chaleur. On soutient l’ébullition de l’eau pendant environ deux heures.
La première impression de la chaleur tend à réunir les résines en masse ; on s’oppose à cette réunion en entretenant les matières dans un mouvement de rotation, qu’on opère facilement avec le bâton, sans bouger le matras.
Quand la solution paraît assez étendue, on ajoute 92 grammes de térébenthine, qu’on tient séparément dans une fiole ou dans un pot, et qu’on fait liquéfier en la plongeant un moment dans le bain-marie.
On laisse encore le matras pendant une demi-heure dans l’eau ; on le retire enfin, et l’on continue d’agiter le vernis jusqu’à ce qu’il soit un peu refroidi. Le lendemain on le retire et on le filtre au coton ; par ce moyen, il acquiert la plus grande limpidité.
L’addition du verre peut paraître extraordinaire. Cependant l’expérience prouve que l’on doit insister sur son usage. Il divise les parties dans le mélange, qu’on doit faire à sec, et il conserve cette propriété lorsqu’il est sur le feu ; il obvie aussi, avec succès, à deux inconvénients qui font le tourment des compositeurs de vernis : d’abord en divisant les matières, il facilite et augmente l’action de la chaleur ; en second lieu, il trouve dans sa pesanteur, qui surpasse celle des résines, un moyen sûr d’empêcher l’adhérence de ces mêmes résines dans le fond du matras, ce qui colore le vernis.
La recette suivante est de Tingry ; Mairet l’a reproduite avec quelques erreurs que nous ferons remarquer, afin qu’on les évite.
Dans trois litres d’esprit-de-vin de la force déjà indiquée, on fait dissoudre 250 grammes de sandaraque en poudre, 62 grammes de mastic en larmes également en poudre, 250 grammes de gomme laque en tablettes, et 62 grammes de térébenthine de Venise.
On doit opérer comme Tingry l’indique ; si l’on se contentait de concasser les résines, comme Mairet le conseille, elles ne se dissoudraient que difficilement. On doit mettre la bouteille dans l’eau froide et faire chauffer le tout ensemble, car si on la mettait dans l’eau très-chaude, elle casserait infailliblement. Enfin, il faut remuer avec un bâton de bois blanc, sans déplacer la bouteille, parce qu’en la retirant très chaude, et l’exposant à la température ordinaire de l’atmosphère on en déterminerait aussitôt la rupture. Ce n’est qu’après que le bain-marie est froid, qu’on peut la retirer. Enfin, on filtre le vernis le lendemain de sa fabrication, et on le conserve dans une bouteille bien bouchée.
Quel que soit le vernis employé, c’est avec un pinceau de poil de blaireau qu’il se pose.
On commence par le dos du volume, en ayant bien soin de ne pas en mettre sur les points qui doivent rester mats. Quand le vernis est presque sec, on le polit avec un nouet de drap fin, blanc, rempli de coton en laine, et sur lequel on met une goutte d’huile d’olive ; on frappe d’abord légèrement, et au fur et à mesure que le vernis sèche et s’échauffe, on frotte plus fort ; l’huile fait glisser le nouet, et le vernis devient brillant.
On fait la même opération sur chacun des plats du volume l’un après l’autre.
Au lieu de pinceau, on peut se servir d’une éponge fine. Elle étend parfaitement le vernis ; mais pour empêcher qu’elle ne durcisse pendant qu’on vernit, et lorsque le vernis se sèche, il faut la laver dans de bon esprit-de-vin.
Pendant l’hiver et dans les temps humides, les vernis ne prennent pas de brillant, à moins qu’on ne fasse chauffer les plats du volume et l’éponge qui contient le vernis.
Nous venons de voir qu’on passe le vernis sur les volumes qui ne peuvent pas être polis avec le fer, lorsqu’on ne les trouve pas assez brillants. Dans ce cas ; il faut que le volume soit entièrement terminé, parfaitement sec, et sans la plus légère humidité ; sans cela, le vernis ne prendrait pas, ou l’on ne pourrait pas parvenir à le polir.
Le vernis ne donne pas seulement du brillant aux livres ; il a encore l’avantage de préserver la couverture des gouttes d’eau ou d’huile qu’on peut y laisser tomber par maladresse.
Nous n’avons indiqué ici que deux recettes de vernis, qui nous paraissent suffisantes pour toutes les opérations de la reliure ; ceux de nos lecteurs qui voudraient varier ces produits pourront consulter avec fruit le Manuel du Fabricant de Vernis, par M. Romain, où ils trouveront une foule de formules dont ils pourront tirer parti.
IIe SECTION.
Demi-Reliure.
C’est aux Allemands que nous devons la demi-reliure : c’est du moins l’opinion commune. Elle ne diffère de la reliure proprement dite, ou reliure pleine, qu’en ce que, dans celle-ci, le volume est couvert en entier de peau, veau, maroquin, mouton maroquiné, chagrin, tandis que dans la demi-reliure, le dos seul est couvert en peau ; quant aux plats, ils sont couverts en papier de couleur ou en percaline, que l’on colle sur les cartons quand le volume est entièrement terminé.
Dans les bibliothèques, la demi-reliure fait absolument le même effet que la reliure pleine ; puisque les volumes ne se voient que par le dos. Elle a d’ailleurs l’avantage de coûter infiniment moins cher que celle-ci, et quand elle est faite avec soin, elle en présente toutes les qualités.
Sauf certains détails que nous allons indiquer, la demi-reliure se fait absolument comme la reliure pleine, qu’elle soit à nerfs saillants ou à la grecque, à dos brisé ou à dos plein.
Les opérations sont absolument les mêmes jusqu’au moment où l’on a collé les coins. Cela fait, on prépare une bande de peau de 8 centimètres plus large et de 8 centimètres plus longue que le dos. Après avoir paré cette bande de la même manière que nous l’avons décrit pour la couverture entière, on la colle avec les mêmes précautions que nous avons prescrites pour le dos de la couverture pleine (page 185). Elle doit déborder de 4 centimètres sur chaque carton.
On ne couvre les cartons en papier qu’après que le dos a été doré et que le volume est presque terminé. Ce papier, qui doit former la couverture, se colle sur les cartons à une distance du mors plus ou moins grande, selon le goût de l’ouvrier et la grandeur du format. On peut établir, comme règle générale, que le bord du papier doit arriver près du mors, à la distance où se trouverait un filet d’or que l’on voudrait pousser sur le plat, ainsi qu’on le pratique presque toujours lorsque l’on couvre le dos en maroquin, et les plats avec du papier maroquiné. Dans ce cas, le filet qu’on pousse tout autour doit être disposé de manière que celui qui se trouve du côté du mors couvre la jointure du papier et du maroquin.
Dès qu’on a collé les deux côtés de la couverture, on laisse bien sécher ; ensuite on colle les gardes ; on met le volume en presse aussi longtemps qu’on le peut, et on le polit avec le fer, si le papier est susceptible de l’être ; dans le cas contraire, on le vernit de la manière prescrite. Enfin, on termine le volume comme s’il s’agissait d’une reliure entière.
IIIe SECTION
Cartonnages.
Sous le nom de cartonnages, on désigne des reliures légères, dont les unes sont provisoires et les autres définitives. On les exécute suivant trois systèmes. Le plus ancien constitue le cartonnage commun, qui a précédé le cartonnage allemand ou cartonnage à la Bradel, comme celui-ci, à son tour, a précédé le cartonnage anglais ou cartonnage emboîté.
Le cartonnage commun est le plus ancien de tous. C’est celui qu’on emploie pour les livres à bas prix et, plus particulièrement pour ceux des écoles. Dans les villes où il y a des ateliers distincts de brochage, c’est dans ces ateliers qu’on l’exécute habituellement, et, dans ce cas, comme nous l’avons dit ailleurs, le brocheur prend le nom de cartonneur.
Le travail du cartonneur ne comprend que les opérations indispensables de la reliure, c’est-à-dire le cousage, la rognure, la confection de la tranche et la couvrure. Encore même, la troisième est-elle souvent supprimée.
Anciennement, la couverture des cartonnages communs était tout entière en parchemin, ou bien elle avait le dos seulement en parchemin et les plats en papier de couleur. Aujourd’hui, tantôt on recouvre les livres, dos et plats, avec une couverture imprimée, tantôt on fait le dos en percaline et les plats seuls avec les parties correspondantes de la couverture imprimée. Dans ce dernier cas, on colle sur le dos une pièce de titre en papier, qui est généralement imprimée. On prend la même précaution quand, comme l’usage commence à s’en répandre, on se sert, pour le dos seulement ou pour le volume entier, soit de papier parcheminé, soit de parchemin végétal proprement dit.
De quelque manière qu’il opère, le relieur-cartonneur ne doit pas oublier que les ouvrages qui sortent de ses mains sont destinés à des consommateurs peu soigneux, et qu’il doit, par conséquent, par devoir professionnel, faire tous ses efforts pour leur donner relativement au prix qu’on lui en paie, la solidité la plus grande possible.
Le cartonnage à la bradel est d’origine allemande. Le nom qu’on lui donne en France n’est autre que celui du relieur qui l’a importé dans notre pays ou du moins qui l’a pratiqué le premier avec le plus de succès. C’est une véritable reliure à dos brisé où la tranche peut être rognée ou conservée, et dont le dos et les cartons ne sont couverts que de papier. On l’emploie surtout comme moyen de conservation provisoire, pour les livres auxquels on se propose de faire mettre plus tard un riche habillement, et lorsqu’il est exécuté avec soin, il est solide, propre, et figure assez agréablement sur les rayons d’une bibliothèque.
Peu de mots suffiront pour faire comprendre comment on exécute un cartonnage à la Bradel.
Les feuilles sont pliées et battues à l’ordinaire. Ensuite, comme il faut que la bonne marge soit conservée, c’est-à-dire qu’on ne doit couper de chaque feuillet, du côté de la gouttière, que ce qui excède les plis que présente de ce côté chaque feuillet, et en queue ce qui excède la bonne marge, sans toucher en aucune manière à la tête, on se sert d’un patron qui guide dans cette opération. Ce patron est fait d’un morceau de carton fin et laminé que l’on coupe bien carrément à l’aide d’une équerre de tôle ou de fer-blanc de la grandeur de la feuille pliée bien d’équerre. On pose le patron sur chaque cahier, puis on les bat ensemble sur la table, en dos et en tête, pour les faire bien rapporter, en commençant par la première feuille, et l’on coupe avec de grands ciseaux ou avec des cisailles, tout ce qui excède le carton, en gouttière ou en queue. On renverse la feuille coupée et on la met de côté ; on en fait autant à chacune des suivantes, et on les renverse l’une après l’autre sur la précédente. Et lorsqu’on a fini le volume, les cahiers se trouvent rangés dans l’ordre numérique ou alphabétique des signatures. Si les cahiers n’étaient pas gros, on pourrait en travailler plusieurs à la fois.
On emploie quelquefois un procédé plus expéditif. On prend le volume en entier avant de le coudre, et, après avoir collé les gardes blanches et l’avoir grecqué, s’il doit l’être, on pose dessus le patron ou carton modèle ; on les bat sur la table en tête et en dos afin de les bien égaliser ; on met derrière un carton plus grand ou une planche en hêtre bien rabotée ; on place le tout dans la presse à rogner, et l’on serre fortement. On rogne alors tout l’excédant du carton sans former la gouttière, mais on ne rogne pas en tête. Comme les feuilles qui excèdent la bonne marge n’ont pas de soutien, si l’on se servait du fer ordinaire à rogner, qui est pointu ; il déchirerait ou écorcherait les feuillets de fausse marge. Pour éviter cet inconvénient, on a un couteau exprès qu’on a aiguisé en rond, qui ne sert qu’à cela, et on le monte dans un talon à la lyonnaise qui, ne lui laissant que peu de lame en dehors de la monture, le tient ferme et ne lui permet pas d’écart. Enfin, on coud le volume à la grecque avec les précautions d’usage.
La couture terminée, on met le livre en presse entre deux ais, sans arrondir le dos, et l’on passe sur le dos plusieurs couches légères de colle forte assez épaisse ; puis on épointe les ficelles, que l’on coupe à 20 ou 25 millimètres de long, et on les colle avec de la pâte sur l’onglet de la fausse garde, qui doit être plus large que dans les reliures ordinaires ; cet onglet doit être fait avec du papier fort et collé.
On met le volume à la presse entre deux ais ferrés, ou entre les mâchoires d’un étau à endosser, on l’endosse à l’anglaise (page 150), et l’on forme le mors. On peut aussi, pour plus de solidité, et lorsqu’on est parvenu à ce point, le mettre en paquet avec d’autres et le frotter.
Arrivé à ce point, on prépare une carte, que l’on coupe de 8 centimètres plus large que la largeur du dos, et d’une longueur égale à celle des cartons qui doivent former les chasses. Ensuite on marque en haut et en bas de la carte, deux points, à la distance exacte de la largeur du dos, en laissant à droite et à gauche de ces deux points une distance égale ; mais comme on a formé le dos en arc de cercle, afin d’avoir sa largeur égale, on doit aplatir le dos, ce qui se fait en prenant le volume de la main gauche, par la tête, et dans l’intérieur, en laissant libres à droite et à gauche deux ou trois cahiers, ce qui force le dos à s’aplatir.
Cela fait, avec un compas, on prend la largeur exacte du dos ; on porte cette largeur au milieu de la carte, et l’on marque en haut et en bas deux points. On pose une règle de fer sur ces deux points dans le sens de la longueur de la carte ; on appuie fortement sur la règle, et passant un plioir sous la carte, on la soulève contre l’épaisseur de la règle ; on détermine un pli qu’on forme bien avec le plioir. On fait pirouetter la carte, on en fait autant de l’autre côté. On aplatit ce pli avec le plioir. On retourne la carte sens dessus dessous, et à côté de ce pli et en dehors du dos, on fait de la même manière, de chaque côté, un second pli, en sens inverse du premier, à une distance égale à la largeur du mors du livre. On arrondit la carte au milieu, dans sa longueur, en passant le plioir intérieurement par son tranchant. Cette carte, ainsi pliée, présente la forme du dos d’un volume avec les mors.
Il ne s’agit plus que de coller la carte sur le dos du volume. Pour cela, avec un petit pinceau on passe de la colle de pâte dans le mors et sur les bords qui sont à côté, en ayant l’attention de ne pas en mettre sur la partie qui doit toucher le dos, afin que le volume, soit à dos brisé. On met ce dernier en presse entre les deux mêmes ais ferrés, et l’on unit la carte avec le frottoir en buis.
Il s’agit maintenant de préparer les cartons. On en prend deux, qu’on rogne du côté du mors, en tête et en queue, à l’équerre et de la longueur des châsses. Mais nous avons ici une observation à faire sur cette opération, afin d’éviter des erreurs.
Lorsqu’on fait une reliure ordinaire, on rogne les cartons en tête et en queue, en rognant le volume, et alors les cartons ont leurs bords supérieurs et inférieurs parallèles à la rognure du volume ; et si l’on avait commis une erreur en ne rognant pas parfaitement à l’équerre, cette erreur ne serait presque pas sensible. Il n’en serait pas de même dans le cartonnage dont nous nous occupons. Les cartons que l’on rogne ne tiennent pas au volume pendant cette opération, et si l’on était toujours parfaitement assuré de la rognure aux angles droits, il n’y aurait aucun inconvénient ; mais, comme on ne peut pas avoir cette certitude absolue, et si, par exemple, l’angle de la tête excédait l’angle droit, et que celui de la queue fût plus petit, on concevra facilement que le volume ne pourrait pas se placer perpendiculairement sur la tablette, et que les quatre angles ne porteraient pas également.
On rogne ordinairement dix cartons à la fois, après les avoir battus sur la pierre avec le marteau, pour les aplanir et leur donner plus de consistance. Lorsqu’ils sont rognés, on est obligé de les placer l’un sur l’autre, à 3 centimètres environ de distance, c’est-à-dire à une distance égale à la largeur de la partie de la carte qui se trouve sur le plat du livre, puisque c’est sur cette bande de carte qu’ils doivent être collés. On les met l’un sur l’autre pour les tremper de colle tous à la fois ; mais si on les plaçait tels qu’ils se trouvent en sortant de la rognure, sans aucune distinction, et qu’on les trempât ainsi, il arriverait que si l’on, avait marqué tous les cartons en tête, du même côté, tels qu’ils se trouvent placés en sortant de la rognure, et si on les avait disposés l’un sur l’autre à la distance convenable, en mettant toutes les marques du même côté, en haut par exemple, lorsqu’on les collerait sur la carte, un des cartons aurait la marque en tête du volume, et l’autre l’aurait en queue, et s’il y avait eu erreur dans la rognure et qu’elle ne fût pas parfaitement à l’équerre, l’erreur aurait doublé et le volume présenterait un aspect désagréable. Pour éviter cet inconvénient, qui, après coup, ne pourrait être que très-difficilement réparé, nous allons voir comment s’y prend un ouvrier intelligent.
Nous venons de voir qu’on rogne ordinairement dix cartons à la fois, ce qui suffit pour la couverture de cinq volumes. Supposons, pour nous faire bien comprendre, qu’on les a tous marqués en tête d’un des premiers chiffres, 1, 2, 3, 4, etc. ; on pose le no 1 sur la table, la tête en haut ; à 3 centimètres de distance on place le no 2 par-dessus, mais en retournant la tête en queue ; ou ce qui revient au même, le chiffre 2 du côté de la queue, le no 3 par-dessus le no 2, à la même distance, mais le chiffre en haut ; le no 4 comme le no 2, par-dessus, et ainsi de suite jusqu’au dernier. Il résulte de cet arrangement que tous les chiffres impairs sont du côté de la tête, et tous les chiffres pairs du côté de la queue.
D’après cela, en collant chaque carton sur la carte, et les prenant dans le même ordre naturel des chiffres, comme l’on est obligé de retourner les cartons pour les coller, les chiffres 1 et 2, qui sont sur le premier volume, se trouvent tous les deux du même côté, soit en tête soit en queue, selon qu’on a posé le premier dans un sens ou dans l’autre. Cette observation est une des plus importantes, et la précaution que nous indiquons remédie à un inconvénient des plus graves.
Avec un petit pinceau, on passe de la colle sur la carte qui est déjà collée sur le volume, sans la dépasser du côté de la garde, et l’on place dessus le premier carton ; on en fait autant de l’autre côté, et l’on y place le carton no 2, et ainsi de suite sur les autres quatre volumes ; alors on met les cinq volumes à la presse entre les ais, on serre fortement, et on les y laisse aussi longtemps qu’on le peut.
On a soin, en collant les deux cartons sur chaque volume, de les placer de manière qu’ils arrivent des deux côtés aux extrémités des deux chasses, déjà déterminées par la hauteur de la carte. Il faut aussi avoir soin de bien serrer les deux extrémités des châsses, entre le pouce et l’index, afin de faire coller parfaitement entre elles les extrémités des châsses des cartons, et celles des châsses de la carte, qui, n’ayant aucun soutien en dedans, ont toujours une tendance à se séparer. On laisse bien sécher.
Quand le volume est parfaitement sec, on compasse sur la marge la largeur qu’on veut donner aux cartons sur le devant, et on les rabaisse de la même manière que pour la reliure pleine.
On colle ensuite les coins en parchemin très-fin ; on colle pareillement, en tête et en queue, du même parchemin, que l’on replie en coiffe, en embrassant la carte, afin de donner plus de solidité au dos dans cette partie, et suppléer par là à la tranchefile, que n’a pas ce genre de reliure. On a soin de parer, sur le volume, quand il est sec, le parchemin des coins, pour que, sous le papier, il ne présente pas d’épaisseur saillante.
On pourrait couvrir le dos en peau et le reste en papier, mais, c’est le propre de ce cartonnage de n’employer que du papier, lequel est ordinairement de couleur. Ce papier peut recevoir, par les procédés de la dorure, de l’impression, de la marbrure et de la gaufrure, les enjolivements les plus variés. On le colle sur les cartons avec presque les mêmes soins que la peau.
Il y a une trentaine d’années, le cartonnage à la Bradel avait une vogue qui paraissait devoir durer très-longtemps. Il ne se fait plus guère aujourd’hui, où le cartonnage emboîté l’a remplacé.
Le cartonnage emboîté, appelé aussi et le plus souvent emboîtage, n’a d’abord été employé que pour les almanachs qu’on offrait en étrennes, Ce sont les Anglais qui ont imaginé de l’appliquer aux livres de consommation générale. Chez eux, il a à peu près la même destination qu’avait autrefois chez nous le cartonnage à la Bradel : c’est une reliure provisoire qui tient lieu, dans la librairie de nos voisins, de la brochure, à laquelle ils ont rarement recours. En Angleterre, très-peu de livres sont brochés ; la plupart ne sont mis en vente qu’après avoir été emboîtés.
Pour emboîter un volume, on en coud les feuilles sur un certain nombre de ficelles, en plaçant une garde en papier au commencement du premier cahier et une autre garde semblable à la fin du dernier. La couture terminée, on applique les bouts des ficelles sur les gardes.
Cela fait, on rogne le volume, on l’endosse, et l’on en jaspe, marbre ou dore la tranche.
Quand ces diverses opérations sont effectuées, on prépare les cartons. Après que ceux-ci ont été coupés et équarris, on les couche sur une table, à côté l’un de l’autre, mais bien parallèlement, et à une distance égale à l’épaisseur du volume, puis on colle par-dessus une toile taillée dans les dimensions convenables. Cette toile couvre ainsi, tout à la fois, les cartons et l’espace qui les sépare et qui est destiné à recevoir le dos du livre. On la soutient parfois, dans la partie qui correspond au dos, en y collant une bande de carte très-mince.
La couverture est donc faite d’une seule pièce. Par les moyens ordinaires on en décore les plats et le dos, en même temps qu’on ajoute à ce dernier les pièces de titre, s’il y en a, ou mieux le titre lui-même, après quoi on l’attache au volume. À cet effet, on introduit le dos de ce dernier dans la partie de la toile qui a été préparée pour cela, et l’on colle les gardes sur les cartons. Il n’y a plus alors qu’à mettre à la presse.
Il résulte de ce qui précède, que dans ce mode de reliure la couverture n’adhère au corps du livre que par le collage des feuilles de garde, en sorte que si ces feuilles viennent à se déchirer, elle se sépare aussitôt du volume. On atténue en partie cet inconvénient en fixant sur le dos à la colle forte une toile solide que l’on fait assez large pour recouvrir une partie des gardes.
L’emboîtage est, avant tout, une reliure à bon marché. Importé en France, il y est devenu, en quelques années, d’un usage général, pour habiller les livres de prix ou d’étrennes et les ouvrages illustrés.
À l’exemple des Anglais, on y a même très souvent recours pour remplacer la brochure. À mesure que la mode s’en est répandue, plusieurs grands relieurs parisiens en ont fait une spécialité qui leur a permis d’y introduire des améliorations très importantes, au quadruple point de vue de la solidité, de l’élégance, de la richesse vraie ou apparente, de la rapidité d’exécution, et de l’économie de la main-d’œuvre.
- ↑ Les cahiers contiennent un nombre diffèrent de feuillets ; ceux qui en ont le plus sont nommés forts, et ceux qui en contiennent le moins sont nommés faibles.
- ↑ La plieuse, lorsqu’elle plie une feuille, supposons un in-quarto, met son couteau de bois, ou plioir, dans le milieu de la feuille ; de la main gauche, elle renverse la moitié de celle-ci sur l’autre, et marque le pli, qu’elle achève en passant son plioir dessus aussitôt qu’elle a mis les chiffres des pages l’un sur l’autre. Elle plie une seconde fois de la même manière. Les pages sont bien de la même hauteur en tête, mais le papier n’est pas de la même dimension en queue, et c’est à ce défaut qu’on remédie en remontant l’ais de devant.
