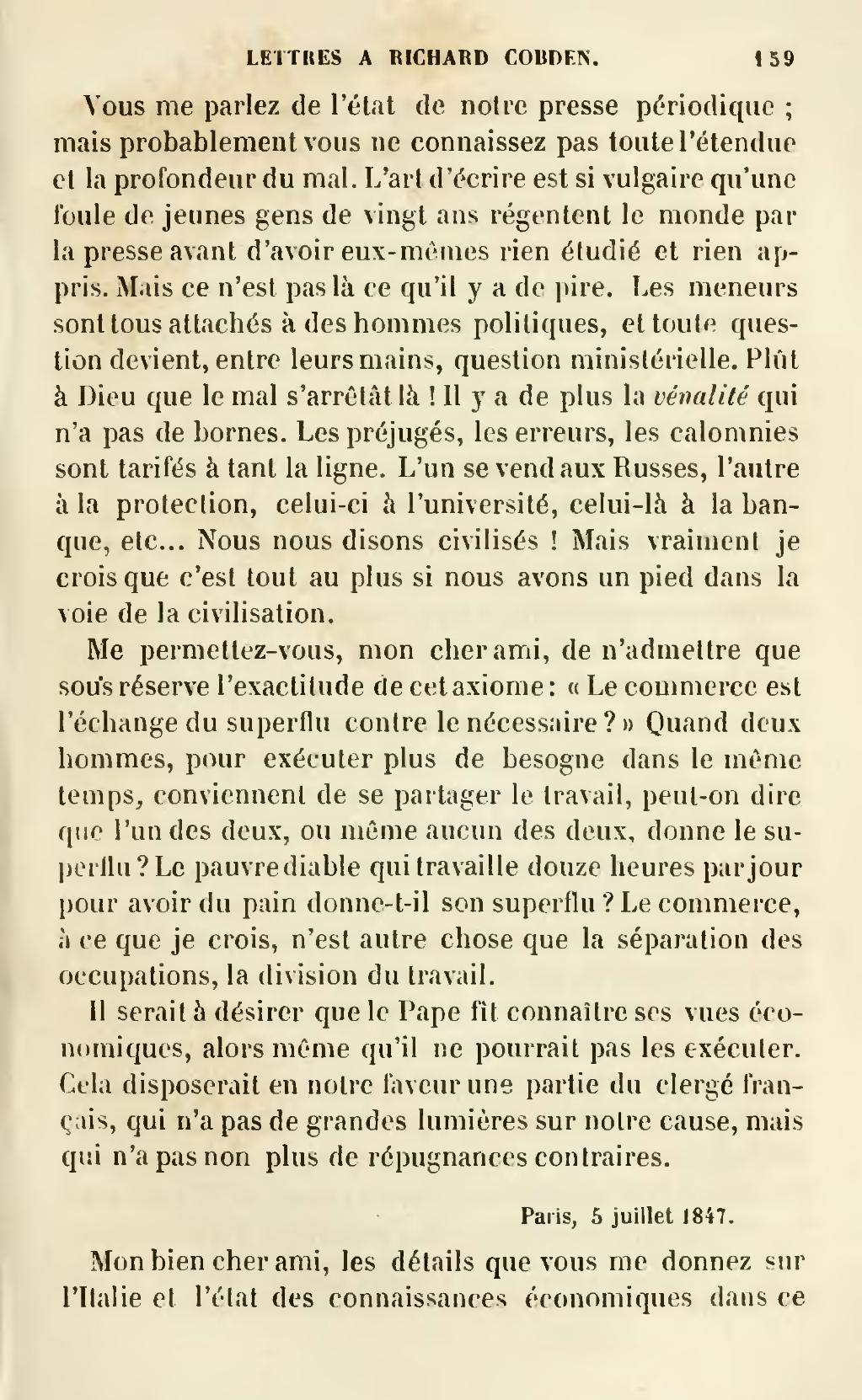Vous me parlez de l’état de notre presse périodique ; mais probablement vous ne connaissez pas toute l’étendue et la profondeur du mal. L’art d’écrire est si vulgaire qu’une foule de jeunes gens de vingt ans régentent le monde par la presse avant d’avoir eux-mêmes rien étudié et rien appris. Mais ce n’est pas là ce qu’il y a de pire. Les meneurs sont tous attachés à des hommes politiques, et toute question devient, entre leurs mains, question ministérielle. Plût à Dieu que le mal s’arrêtât là ! Il y a de plus la vénalité qui n’a pas de bornes. Les préjugés, les erreurs, les calomnies sont tarifés à tant la ligne. L’un se vend aux Russes, l’autre à la protection, celui-ci à l’université, celui-là à la banque, etc… Nous nous disons civilisés ! Mais vraiment je crois que c’est tout au plus si nous avons un pied dans la voie de la civilisation.
Me permettez-vous, mon cher ami, de n’admettre que sous réserve l’exactitude de cet axiome : « Le commerce est l’échange du superflu contre le nécessaire ? » Quand deux hommes, pour exécuter plus de besogne dans le même temps, conviennent de se partager le travail, peut-on dire que l’un des deux, ou même aucun des deux, donne le superflu ? Le pauvre diable qui travaille douze heures par jour pour avoir du pain donne-t-il son superflu ? Le commerce, à ce que je crois, n’est autre chose que la séparation des occupations, la division du travail.
Il serait à désirer que le Pape fît connaître ses vues économiques, alors même qu’il ne pourrait pas les exécuter. Cela disposerait en notre faveur une partie du clergé français, qui n’a pas de grandes lumières sur notre cause, mais qui n’a pas non plus de répugnances contraires.
Paris, 5 juillet 1847.
Mon bien cher ami, les détails que vous me donnez sur l’Italie et l’état des connaissances économiques dans ce