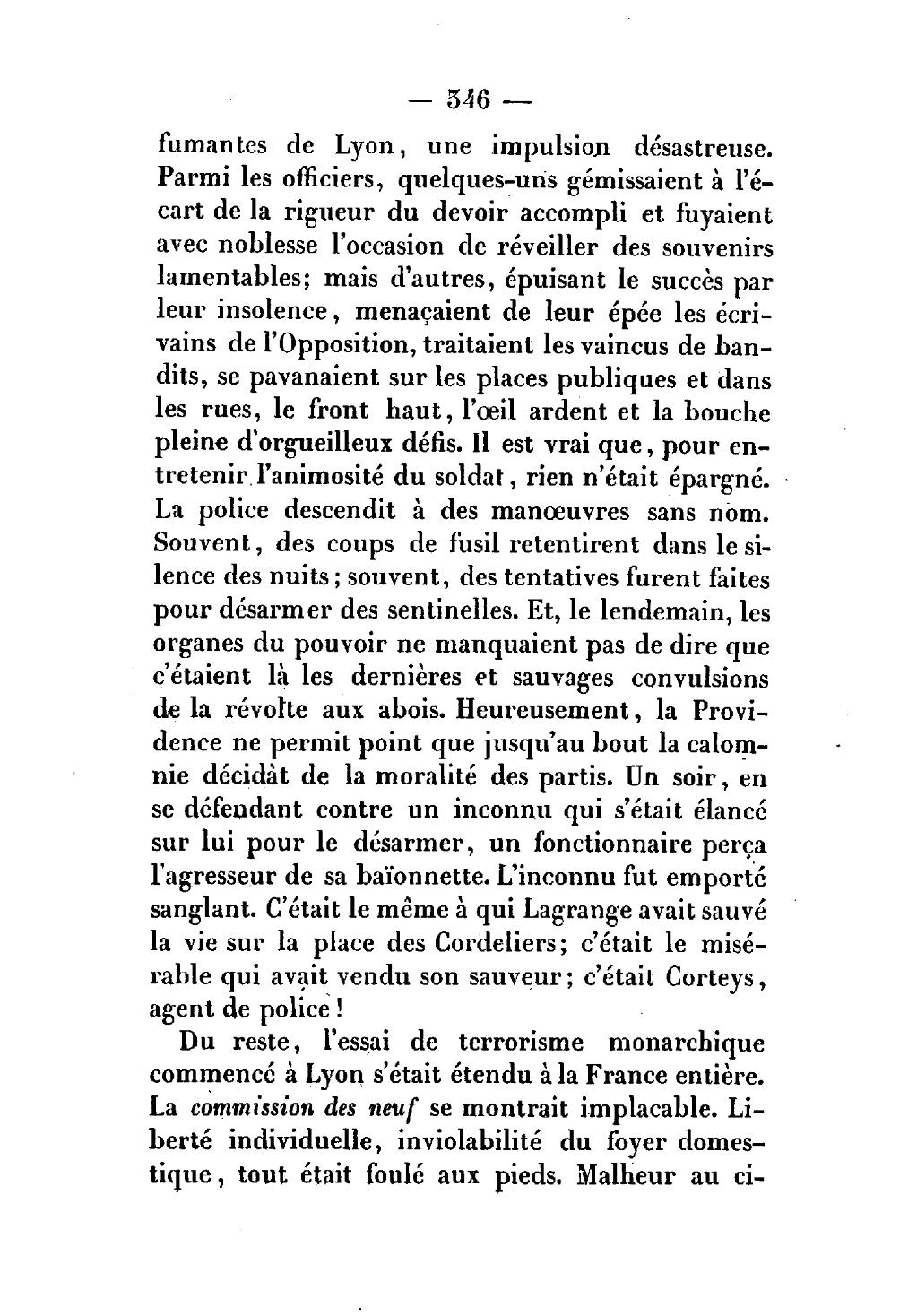fumantes de Lyon, une impulsion désastreuse. Parmi les officiers, quelques-uns gémissaient à l’écart de la rigueur du devoir accompli et fuyaient avec noblesse l’occasion de réveiller des souvenirs lamentables ; mais d’autres, épuisant le succès par leur insolence, menaçaient de leur épée les écrivains de l’Opposition, traitaient les vaincus de bandits, se pavanaient sur les places publiques et dans les rues, le front haut, l’œil ardent et la bouche pleine d’orgueilleux défis. Il est vrai que, pour entretenir l’animosité du soldat, rien n’était épargné. La police descendit à des manœuvres sans nom. Souvent, des coups de fusil retentirent dans le silence des nuits ; souvent, des tentatives furent faites pour désarmer des sentinelles. Et, le lendemain, les organes du pouvoir ne manquaient pas de dire que c’étaient là les dernières et sauvages convulsions de la révolte aux abois. Heureusement, la Providence ne permit point que jusqu’au bout la calomnie décidât de la moralité des partis. Un soir, en se défendant contre un inconnu qui s’était élancé sur lui pour le désarmer, un fonctionnaire perça l’agresseur de sa baïonnette. L’inconnu fut emporté sanglant. C’était le même à qui Lagrange avait sauvé la vie sur la place des Cordeliers ; c’était le misérable qui avait vendu son sauveur ; c’était Corteys, agent de police !
Du reste, l’essai de terrorisme monarchique commencé à Lyon s’était étendu à la France entière. La commission des neuf se montrait implacable. Liberté individuelle, inviolabilité du foyer domestique, tout était foulé aux pieds. Malheur au ci-