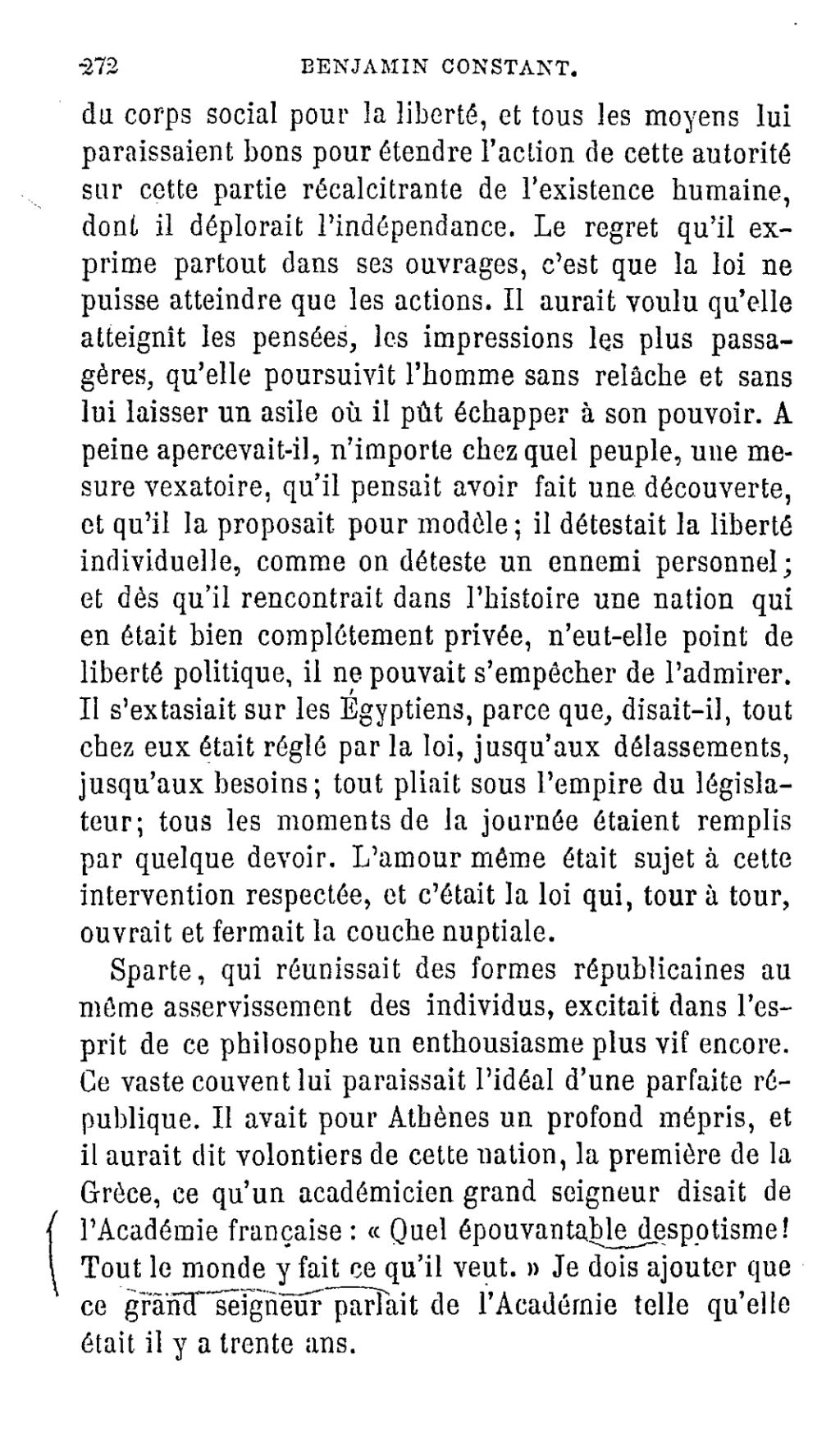du corps social pour la liberté, et tous les moyens lui paraissaient bons pour étendre l’action de cette autorité sur cette partie récalcitrante de l’existence humaine, dont il déplorait l’indépendance. Le regret qu’il exprime partout dans ses ouvrages, c’est que la loi ne puisse atteindre que les actions. Il aurait voulu qu’elle atteignît les pensées, les impressions les plus passagères, qu’elle poursuivît l’homme sans relâche et sans lui laisser un asile où il pût échapper à son pouvoir. À peine apercevait-il, n’importe chez quel peuple, une mesure vexatoire, qu’il pensait avoir fait une découverte et qu’il la proposait pour modèle ; il détestait la liberté individuelle, comme on déteste un ennemi personnel ; et dès qu’il rencontrait dans l’histoire une nation qui en était bien complètement privée, n’eût-elle point de liberté politique, il ne pouvait s’empêcher de l’admirer. Il s’extasiait sur les Égyptiens, parce que, disait-il, tout chez eux était réglé par la loi, jusqu’aux délassements, jusqu’aux besoins ; tout pliait sous l’empire du législateur ; tous les moments de la journée étaient remplis par quelque devoir. L’amour même était sujet à cette intervention respectée, et c’était la loi qui, tour à tour, ouvrait et fermait la couche nuptiale.
Sparte, qui réunissait des formes républicaines au même asservissement des individus, excitait dans l’esprit de ce philosophe un enthousiasme plus vif encore. Ce vaste couvent lui paraissait l’idéal d’une parfaite république. Il avait pour Athènes un profond mépris, et il aurait dit volontiers de cette nation, la première de la Grèce, ce qu’un académicien grand seigneur disait de l’Académie française : « Quel épouvantable despotisme ! Tout le monde y fait ce qu’il veut. » Je dois ajouter que ce grand seigneur parlait de l’Académie telle qu’elle était il y a trente ans.