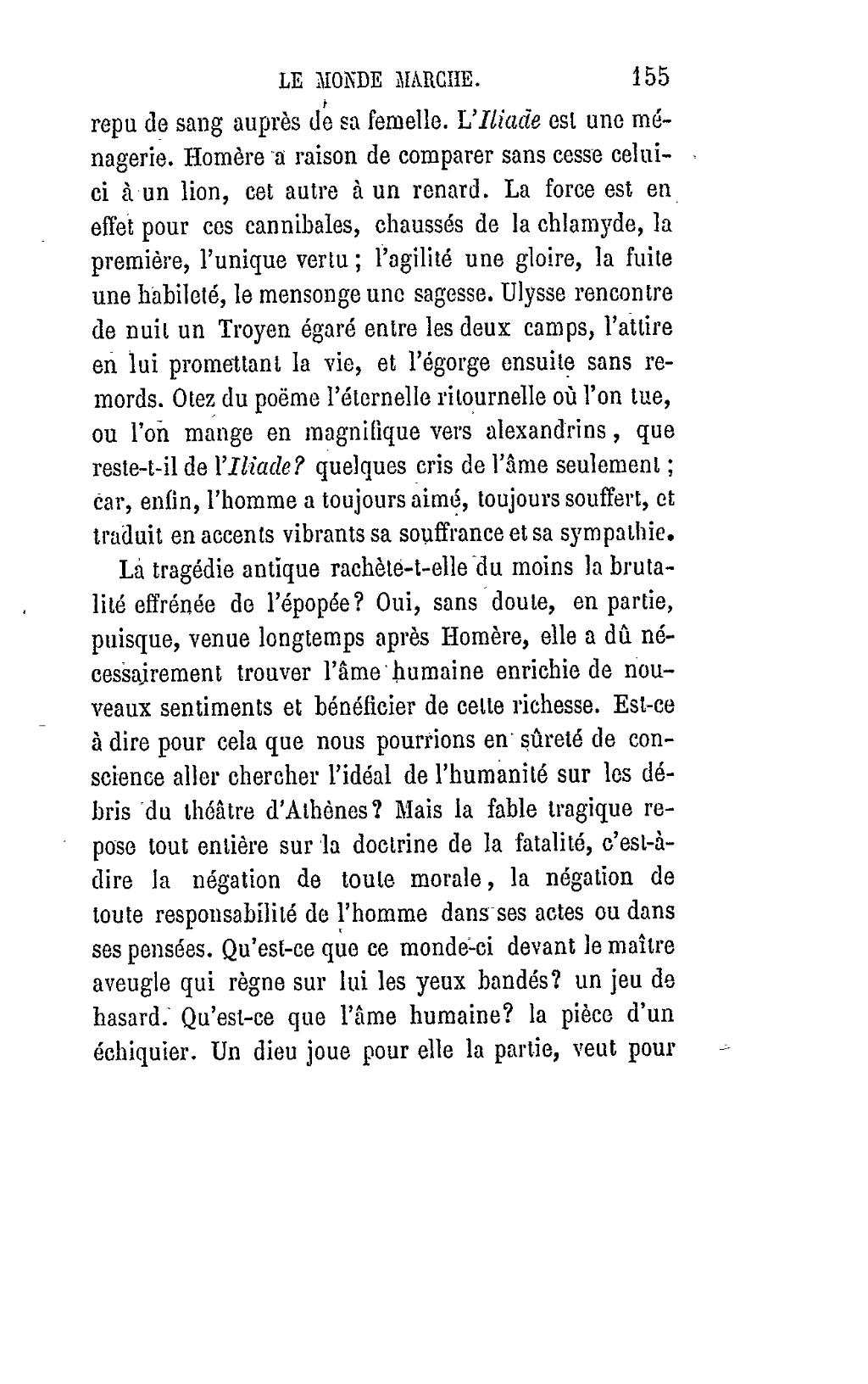repu de sang auprès de sa femelle. L’Iliade est une ménagerie. Homère a raison de comparer sans cesse celui-ci à un lion, cet autre à un renard. La force est en effet pour ces cannibales, chaussés de la chlamyde, la première, l’unique vertu ; l’agilité une gloire, la fuite une habileté, le mensonge une sagesse. Ulysse rencontre de nuit un Troyen égaré entre les deux camps, l’attire en lui promettant la vie, et l’égorge ensuite sans remords. Ôtez du poëme l’éternelle ritournelle où l’on tue, ou l’on mange en magnifique vers alexandrins, que reste-t-il de l’Iliade ? quelques cris de l’âme seulement ; car, enfin, l’homme a toujours aimé, toujours souffert, et traduit en accents vibrants sa souffrance et sa sympathie.
La tragédie antique rachète-t-elle du moins la brutalité effrénée de l’épopée ? Oui, sans doute, en partie, puisque, venue longtemps après Homère, elle a dû nécessairement trouver l’âme humaine enrichie de nouveaux sentiments et bénéficier de cette richesse. Est-ce à dire pour cela que nous pourrions en sûreté de conscience aller chercher l’idéal de l’humanité sur les débris du théâtre d’Athènes ? Mais la fable tragique repose tout entière sur la doctrine de la fatalité, c’est-à-dire la négation de toute morale, la négation de toute responsabilité de l’homme dans ses actes ou dans ses pensées. Qu’est-ce que ce monde-ci devant le maître aveugle qui règne sur lui les yeux bandés ? un jeu de hasard. Qu’est-ce que l’âme humaine ? la pièce d’un échiquier. Un dieu joue pour elle la partie, veut pour