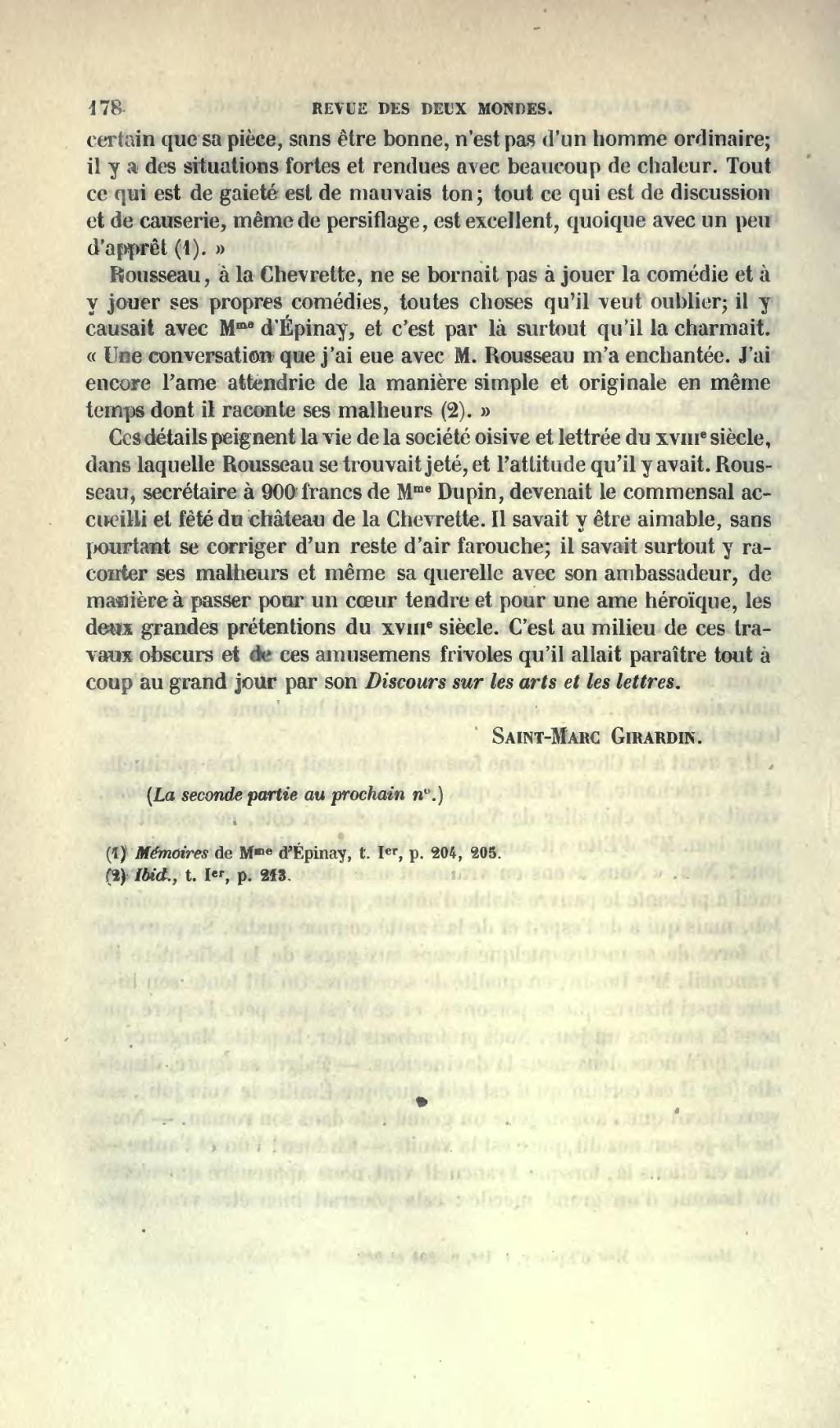certain que sa pièce, sans être bonne, n’est pas d’un homme ordinaire ; il y a des situations fortes et rendues avec beaucoup de chaleur. Tout ce qui est de gaieté est de mauvais ton ; tout ce qui est de discussion et de causerie, même de persiflage, est excellent, quoique avec un peu d’apprêt[1]. »
Rousseau, à la Chevrette, ne se bornait pas à jouer la comédie et à y jouer ses propres comédies, toutes choses qu’il veut oublier ; il y causait avec Mme d’Épinay, et c’est par là surtout qu’il la charmait. « Une conversation que j’ai eue avec M. Rousseau m’a enchantée. J’ai encore l’ame attendrie de la manière simple et originale en même temps dont il raconte ses malheurs[2]. »
Ces détails peignent la vie de la société oisive et lettrée du XVIIIe siècle, dans laquelle Rousseau se trouvait jeté, et l’attitude qu’il y avait. Rousseau, secrétaire à 900 francs de Mme Dupin, devenait le commensal accueilli et fêté du château de la Chevrette. Il savait y être aimable, sans pourtant se corriger d’un reste d’air farouche ; il savait surtout y raconter ses malheurs et même sa querelle avec son ambassadeur, de manière à passer pour un cœur tendre et pour une ame héroïque, les deux grandes prétentions du XVIIIe siècle. C’est au milieu de ces travaux obscurs et de ces amusemens frivoles qu’il allait paraître tout à coup au grand jour par son Discours sur les arts et les lettres.