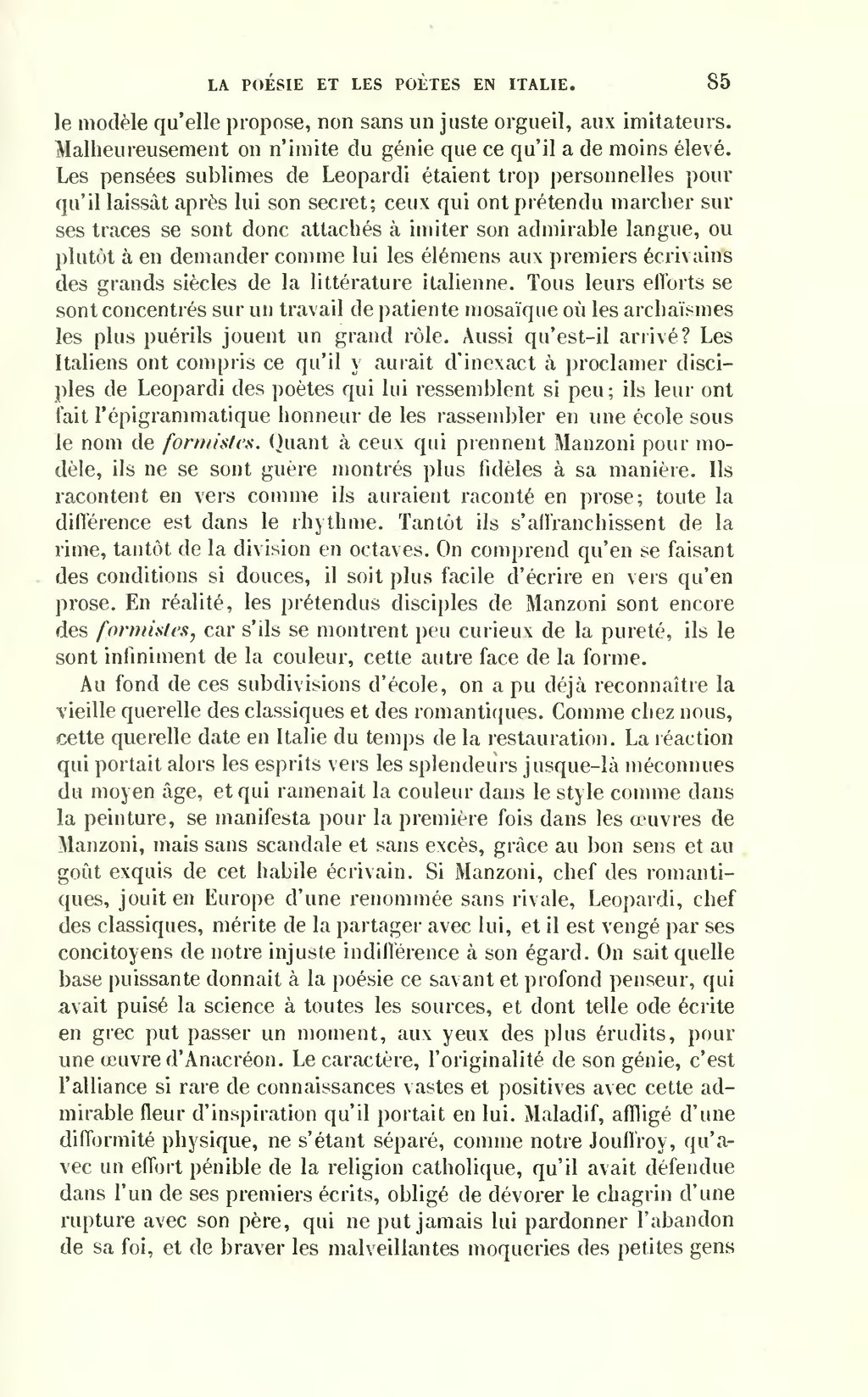le modèle qu’elle propose, non sans un juste orgueil, aux imitateurs. Malheureusement on n’imite du génie que ce qu’il a de moins élevé. Les pensées sublimes de Leopardi étaient trop personnelles pour qu’il laissât après lui son secret; ceux qui ont prétendu marcher sur ses traces se sont donc attachés à imiter son admirable langue, ou plutôt à en demander comme lui les élémens aux premiers écrivains des grands siècles de la littérature italienne. Tous leurs efforts se sont concentrés sur un travail de patiente mosaïque où les archaïsmes les plus puérils jouent un grand rôle. Aussi qu’est-il arrivé? Les Italiens ont compris ce qu’il y aurait d’inexact à proclamer disciples de Leopardi des poètes qui lui ressemblent si peu; ils leur ont fait l’épigrammatique honneur de les rassembler en une école sous le nom de formistes. Quant à ceux qui prennent Manzoni pour modèle, ils ne se sont guère montrés plus fidèles à sa manière. Ils racontent en vers comme ils auraient raconté en prose; toute la différence est dans le rhythme. Tantôt ils s’affranchissent de la rime, tantôt de la division en octaves. On comprend qu’en se faisant des conditions si douces, il soit plus facile d’écrire en vers qu’en prose. En réalité, les prétendus disciples de Manzoni sont encore des formistes, car s’ils se montrent peu curieux de la pureté, ils le sont infiniment de la couleur, cette autre face de la forme.
Au fond de ces subdivisions d’école, on a pu déjà reconnaître la vieille querelle des classiques et des romantiques. Comme chez nous, cette querelle date en Italie du temps de la restauration. La réaction qui portait alors les esprits vers les splendeurs jusque-là méconnues du moyen âge, et qui ramenait la couleur dans le style comme dans la peinture, se manifesta pour la première fois dans les œuvres de Manzoni, mais sans scandale et sans excès, grâce au bon sens et au goût exquis de cet habile écrivain. Si Manzoni, chef des romantiques, jouit en Europe d’une renommée sans rivale, Leopardi, chef des classiques, mérite de la partager avec lui, et il est vengé par ses concitoyens de notre injuste indifférence à son égard. On sait quelle base puissante donnait à la poésie ce savant et profond penseur, qui avait puisé la science à toutes les sources, et dont telle ode écrite en grec put passer un moment, aux yeux des plus érudits, pour une œuvre d’Anacréon. Le caractère, l’originalité de son génie, c’est l’alliance si rare de connaissances vastes et positives avec cette admirable fleur d’inspiration qu’il portait en lui. Maladif, affligé d’une difformité physique, ne s’étant séparé, comme notre Jouffroy, qu’avec un effort pénible de la religion catholique, qu’il avait défendue dans l’un de ses premiers écrits, obligé de dévorer le chagrin d’une rupture avec son père, qui ne put jamais lui pardonner l’abandon de sa foi, et de braver les malveillantes moqueries des petites gens