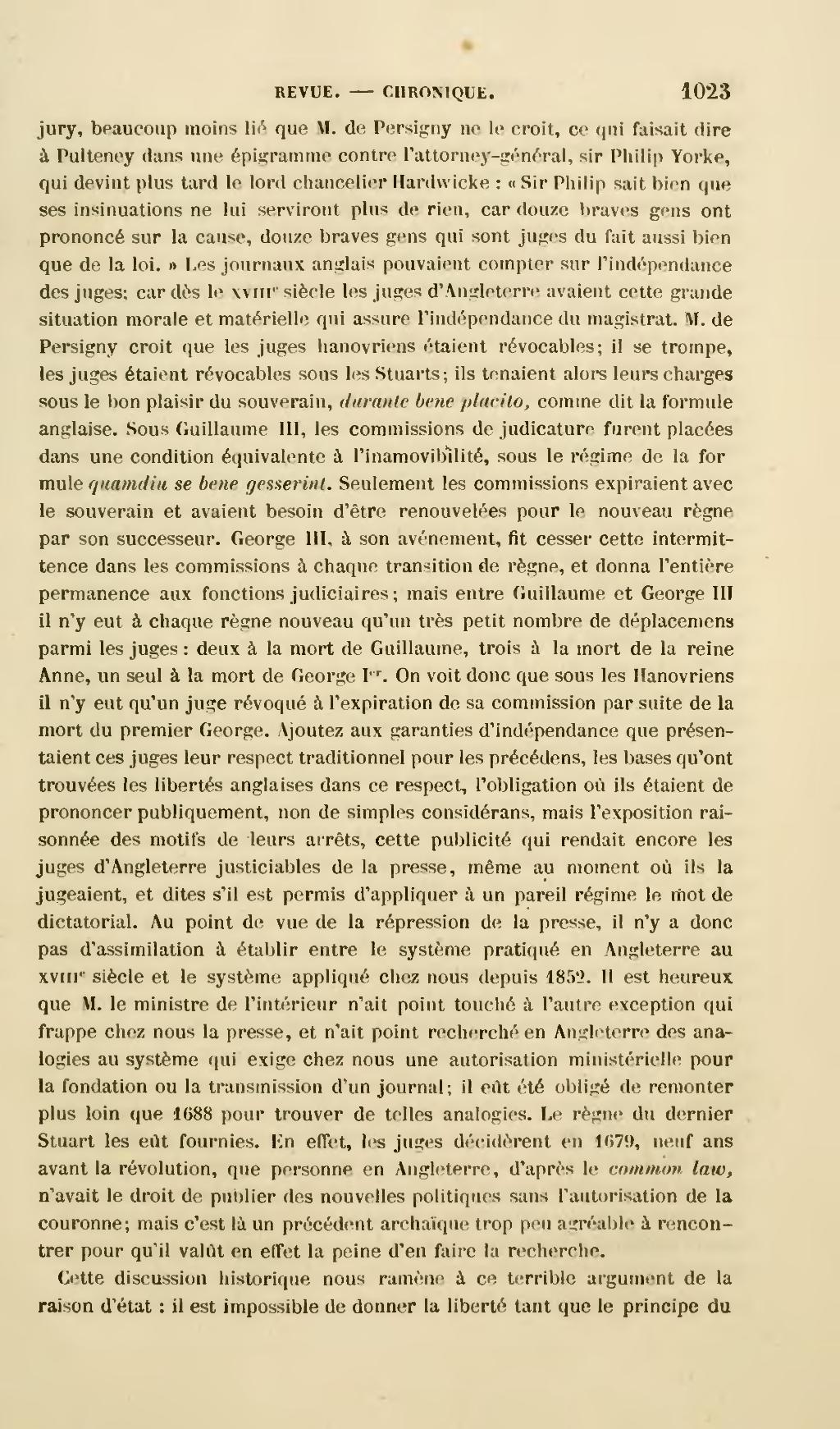jury, beaucoup moins lié que M. de Persigny ne le croit, ce qui faisait dire à Pulteney dans une épigramme contre l’attorney-général, sir Philip Yorke, qui devint plus tard le lord chancelier Hardwicke : « Sir Philip sait bien que ses insinuations ne lui serviront plus de rien, car douze braves gens ont prononcé sur la cause, douze braves gens qui sont juges du fait aussi bien que de la loi. » Les journaux anglais pouvaient compter sur l’indépendance des juges ; car dès le xviiie siècle les juges d’Angleterre avaient cette grande situation morale et matérielle qui assure l’indépendance du magistrat. M. de Persigny croit que les juges Hanovriens étaient révocables ; il se trompe, les juges étaient révocables sous les Stuarts ; ils tenaient alors leurs charges sous le bon plaisir du souverain, durante bene placito, comme dit la formule anglaise. Sous Guillaume III, les commissions de judicature furent placées dans une condition équivalente à l’inamovibilité, sous le régime de la formule quamdiu se bene gesserint. Seulement les commissions expiraient avec le souverain et avaient besoin d’être renouvelées pour le nouveau règne par son successeur. George III, à son avènement, fit cesser cette intermittence dans les commissions à chaque transition de règne, et donna l’entière permanence aux fonctions judiciaires ; mais entre Guillaume et George III il n’y eut à chaque règne nouveau qu’un très petit nombre de déplacemens parmi les juges : deux à la mort de Guillaume, trois à la mort de la reine Anne, un seul à la mort de George Ier. On voit donc que sous les Hanovriens il n’y eut qu’un juge révoqué à l’expiration de sa commission par suite de la mort du premier George. Ajoutez aux garanties d’indépendance que présentaient ces juges leur respect traditionnel pour les précédons, les bases qu’ont trouvées les libertés anglaises dans ce respect, l’obligation où ils étaient de prononcer publiquement, non de simples considérans, mais l’exposition raisonnée les motifs de leurs arrêts, cette publicité qui rendait encore les juges d’Angleterre justiciables de la presse, même au moment où ils la jugeaient, et dites s’il est permis d’appliquer à un pareil régime le mot de dictatorial. Au point de vue de la répression de la presse, il n’y a donc pas d’assimilation à établir entre le système pratiqué en Angleterre au xviiie siècle et le système appliqué chez nous depuis 1852. Il est heureux que M. le ministre de l’intérieur n’ait point touché à l’autre exception qui frappe chez nous la presse, et n’ait point recherché en Angleterre des analogies au système qui exige chez nous une autorisation ministérielle pour la fondation ou la transmission d’un journal ; il eût été obligé de remonter plus loin que 1688 pour trouver de telles analogies. Le règne du dernier Stuart les eût fournies. En effet, les juges décidèrent en 1679, neuf ans avant la révolution, que personne en Angleterre, d’après le commom law, n’avait le droit de publier des nouvelles politiques sans l’autorisation de la couronne ; mais c’est là un précédent archaïque trop peu agréable à rencontrer pour qu’il valût en effet la peine d’en faire la recherche.
Cette discussion historique nous ramène à ce terrible argument de la raison d’état : il est impossible de donner la liberté tant que le principe du