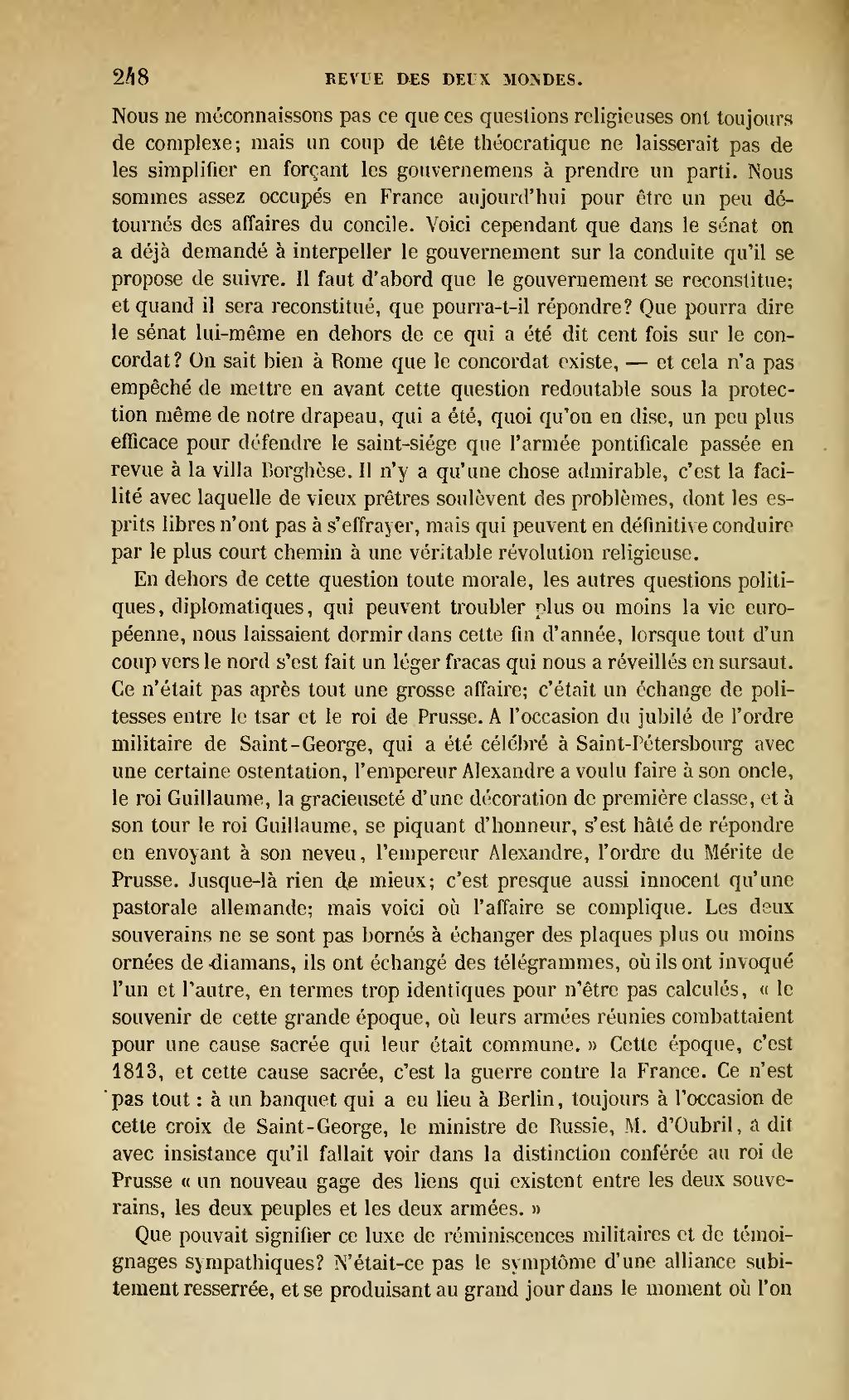Nous ne méconnaissons pas ce que ces questions religieuses ont toujours de complexe ; mais un coup de tête théocratique ne laisserait pas de les simplifier en forçant les gouvernemens à prendre un parti. Nous sommes assez occupés en France aujourd’hui pour être un peu détournés des affaires du concile. Voici cependant que dans le sénat on a déjà demandé à interpeller le gouvernement sur la conduite qu’il se propose de suivre. Il faut d’abord que le gouvernement se reconstitue ; et quand il sera reconstitué, que pourra-t-il répondre ? Que pourra dire le sénat lui-même en dehors de ce qui a été dit cent fois sur le concordat ? On sait bien à Rome que le concordat existe, — et cela n’a pas empêché de mettre en avant cette question redoutable sous la protection même de notre drapeau, qui a été, quoi qu’on en dise, un peu plus efficace pour défendre le saint-siège que l’armée pontificale passée en revue à la villa Borghèse. Il n’y a qu’une chose admirable, c’est la facilité avec laquelle de vieux prêtres soulèvent des problèmes, dont les esprits libres n’ont pas à s’effrayer, mais qui peuvent en définitive conduire par le plus court chemin à une véritable révolution religieuse.
En dehors de cette question toute morale, les autres questions politiques, diplomatiques, qui peuvent troubler plus ou moins la vie européenne, nous laissaient dormir dans cette fin d’année, lorsque tout d’un coup vers le nord s’est fait un léger fracas qui nous a réveillés en sursaut. Ce n’était pas après tout une grosse affaire ; c’était un échange de politesses entre le tsar et le roi de Prusse. À l’occasion du jubilé de l’ordre militaire de Saint-George, qui a été célébré à Saint-Pétersbourg avec une certaine ostentation, l’empereur Alexandre a voulu faire à son oncle, le roi Guillaume, la gracieuseté d’une décoration de première classe, et à son tour le roi Guillaume, se piquant d’honneur, s’est hâté de répondre en envoyant à son neveu, l’empereur Alexandre, l’ordre du Mérite de Prusse. Jusque-là rien de mieux ; c’est presque aussi innocent qu’une pastorale allemande ; mais voici où l’affaire se complique. Les deux souverains ne se sont pas bornés à échanger des plaques plus ou moins ornées de diamans, ils ont échangé des télégrammes, où ils ont invoqué l’un et l’autre, en termes trop identiques pour n’être pas calculés, « le souvenir de cette grande époque, où leurs armées réunies combattaient pour une cause sacrée qui leur était commune. » Cette époque, c’est 1813, et cette cause sacrée, c’est la guerre contre la France. Ce n’est pas tout : à un banquet qui a eu lieu à Berlin, toujours à l’occasion de cette croix de Saint-George, le ministre de Russie, M. d’Oubril, a dit avec insistance qu’il fallait voir dans la distinction conférée au roi de Prusse « un nouveau gage des liens qui existent entre les deux souverains, les deux peuples et les deux armées. »
Que pouvait signifier ce luxe de réminiscences militaires et de témoignages sympathiques ? N’était-ce pas le symptôme d’une alliance subitement resserrée, et se produisant au grand jour dans le moment où l’on