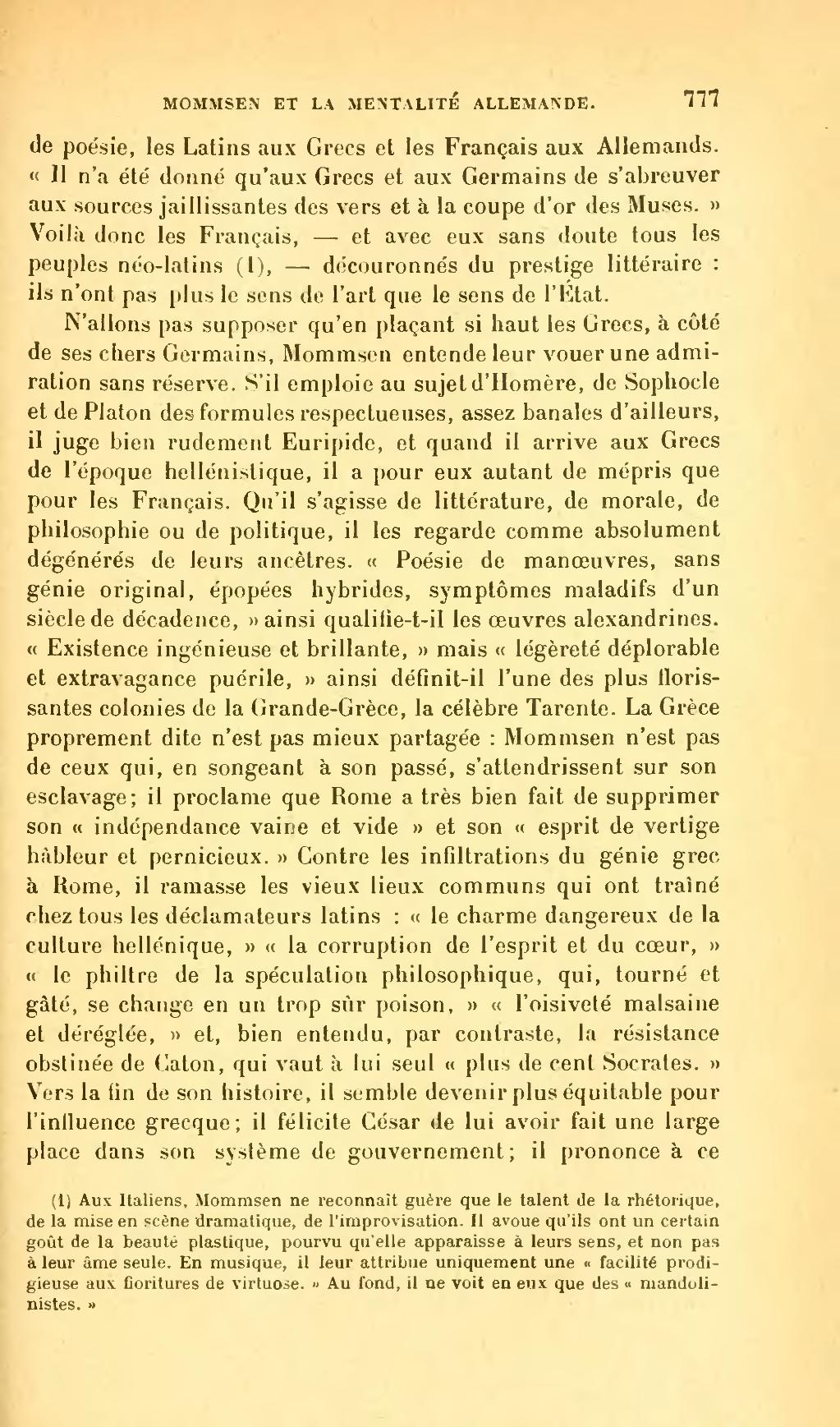de poésie, les Latins aux Grecs et les Français aux Allemands. « Il n’a été donné qu’aux Grecs et aux Germains de s’abreuver aux sources jaillissantes des vers et à la coupe d’or des Muses. » Voilà donc les Français, — et avec eux sans doute tous les peuples néo-latins[1], — découronnés du prestige littéraire : ils n’ont pas plus le sens de l’art que le sens de l’Etat.
N’allons pas supposer qu’en plaçant si haut les Grecs, à côté de ses chers Germains, Mommsen entende leur vouer une admiration sans réserve. S’il emploie au sujet d’Homère, de Sophocle et de Platon des formules respectueuses, assez banales d’ailleurs, il juge bien rudement Euripide, et quand il arrive aux Grecs de l’époque hellénistique, il a pour eux autant de mépris que pour les Français. Qu’il s’agisse de littérature, de morale, de philosophie ou de politique, il les regarde comme absolument dégénérés de leurs ancêtres. « Poésie de manœuvres, sans génie original, épopées hybrides, symptômes maladifs d’un siècle de décadence, » ainsi qualifie-t-il les œuvres alexandrines. « Existence ingénieuse et brillante, » mais « légèreté déplorable et extravagance puérile, » ainsi définit-il l’une des plus florissantes colonies de la Grande-Grèce, la célèbre Tarente. La Grèce proprement dite n’est pas mieux partagée : Mommsen n’est pas de ceux qui, en songeant à son passé, s’attendrissent sur son esclavage ; il proclame que Rome a très bien fait de supprimer son « indépendance vaine et vide » et son « esprit de vertige hâbleur et pernicieux. » Contre les infiltrations du génie grec à Rome, il ramasse les vieux lieux communs qui ont traîné chez tous les déclamateurs latins : « le charme dangereux de la culture hellénique, » « la corruption de l’esprit et du cœur, » « le philtre de la spéculation philosophique, qui, tourné et gâté, se change en un trop sûr poison, » « l’oisiveté malsaine et déréglée, » et, bien entendu, par contraste, la résistance obstinée de Caton, qui vaut à lui seul « plus de cent Socrates. » Vers la fin de son histoire, il semble devenir plus équitable pour l’influence grecque ; il félicite César de lui avoir fait une large place dans son système de gouvernement ; il prononce à ce
- ↑ Aux Italiens, Mommsen ne reconnaît guère que le talent de la rhétorique, de la mise en scène dramatique, de l’improvisation. Il avoue qu’ils ont un certain goût de la beauté plastique, pourvu qu’elle apparaisse à leurs sens, et non pas à leur âme seule. En musique, il leur attribue uniquement une « facilité prodigieuse aux fioritures de virtuose. » Au fond, il ne voit en eux que des « mandolinistes. »…