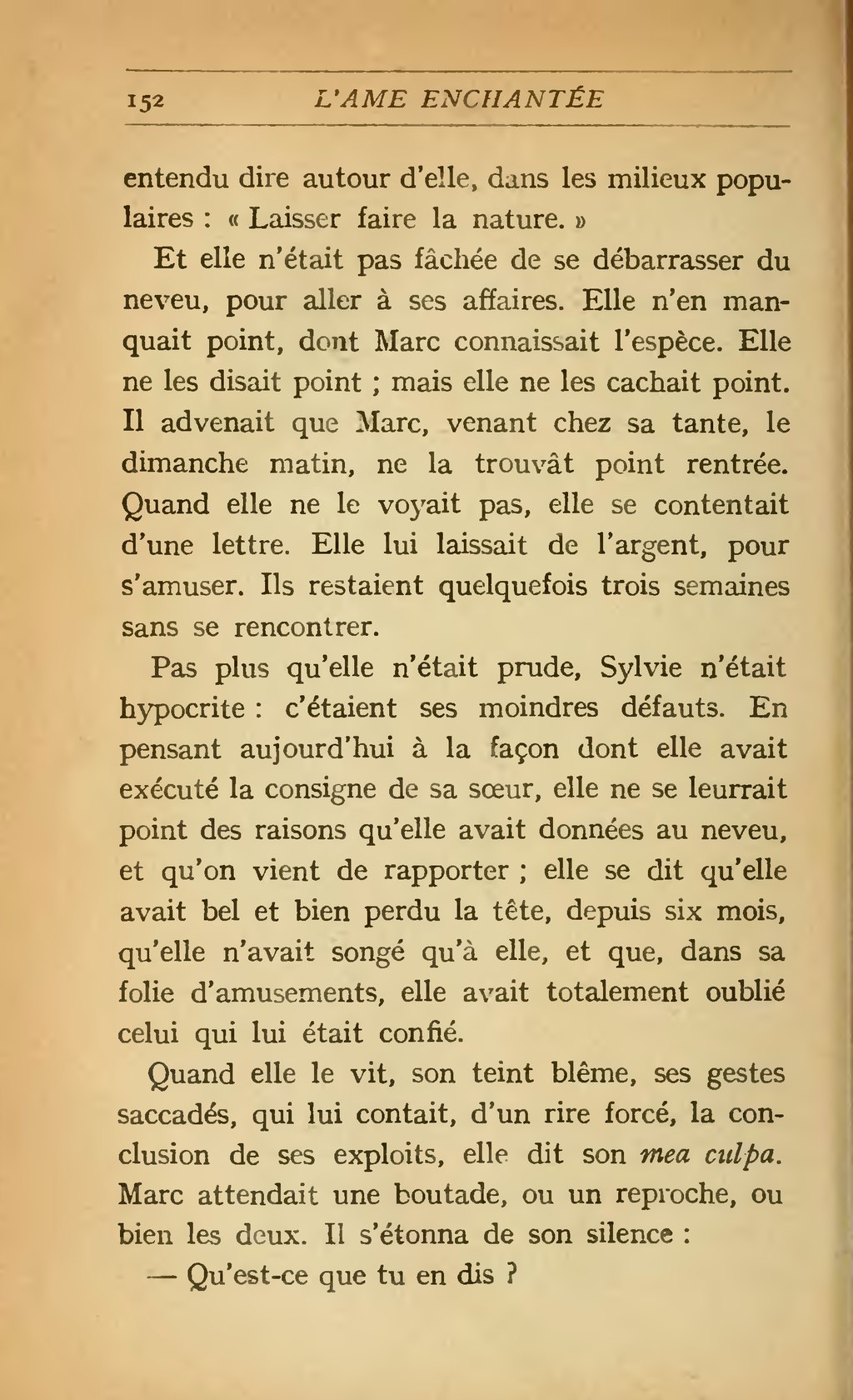entendu dire autour d’elle, dans les milieux populaires : « Laisser faire la nature. »
Et elle n’était pas fâchée de se débarrasser du neveu, pour aller à ses affaires. Elle n’en manquait point, dont Marc connaissait l’espèce. Elle ne les disait point ; mais elle ne les cachait point. Il advenait que Marc, venant chez sa tante, le dimanche matin, ne la trouvât point rentrée. Quand elle ne le voyait pas, elle se contentait d’une lettre. Elle lui laissait de l’argent, pour s’amuser. Ils restaient quelquefois trois semaines sans se rencontrer.
Pas plus qu’elle n’était prude, Sylvie n’était hypocrite : c’étaient ses moindres défauts. En pensant aujourd’hui à la façon dont elle avait exécuté la consigne de sa sœur, elle ne se leurrait point des raisons qu’elle avait données au neveu, et qu’on vient de rapporter ; elle se dit qu’elle avait bel et bien perdu la tête, depuis six mois, qu’elle n’avait songé qu’à elle, et que, dans sa folie d’amusements, elle avait totalement oublié celui qui lui était confié.
Quand elle le vit, son teint blême, ses gestes saccadés, qui lui contait, d’un rire forcé, la conclusion de ses exploits, elle dit son mea culpa. Marc attendait une boutade, ou un reproche, ou bien les deux. Il s’étonna de son silence :
— Qu’est-ce que tu en dis ?