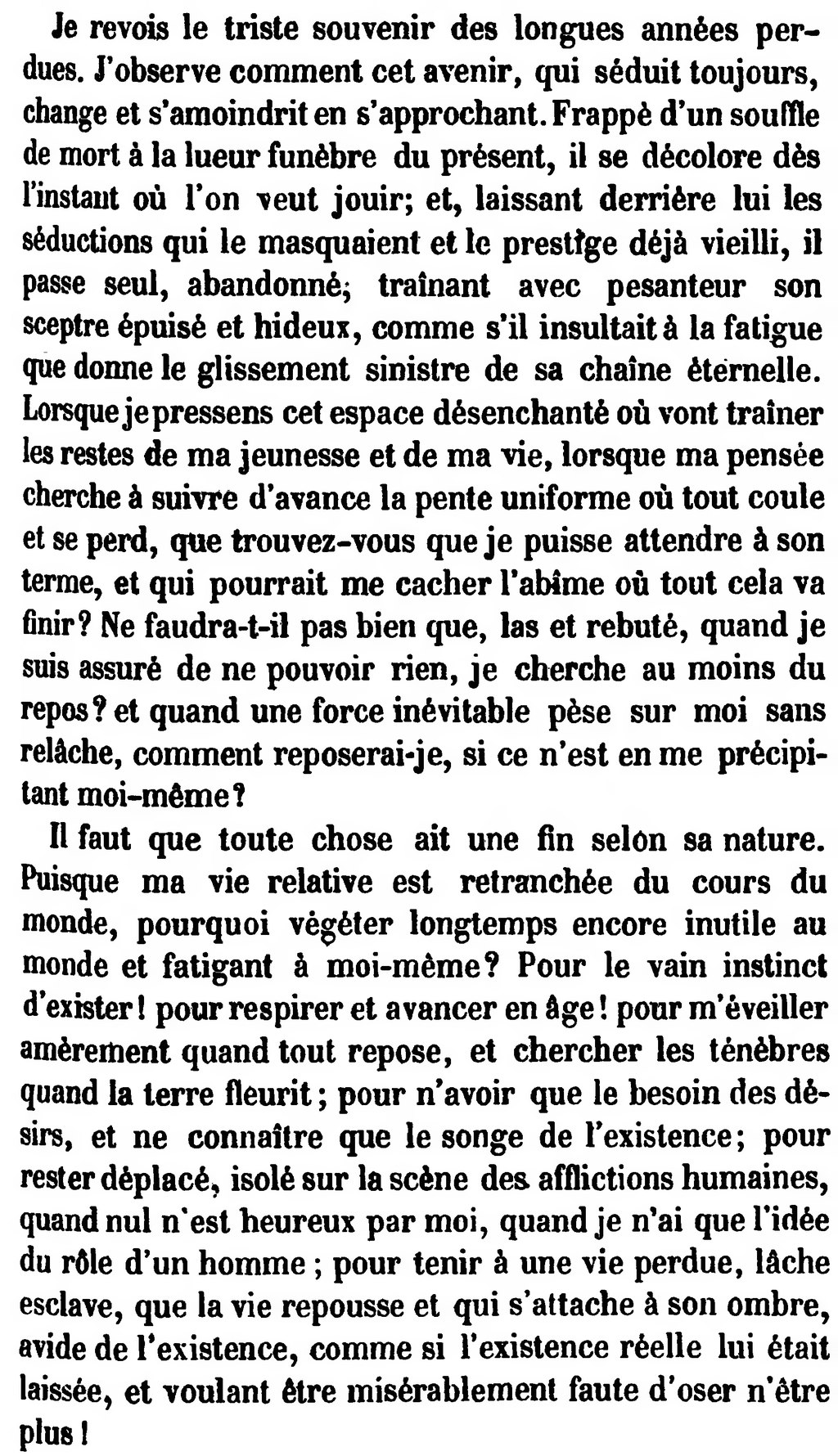Je revois le triste souvenir des longues années perdues. J’observe comment cet avenir, qui séduit toujours, change et s’amoindrit en s’approchant. Frappé d’un souffle de mort à la lueur funèbre du présent, il se décolore dès l’instant où l’on veut jouir ; et, laissant derrière lui les séductions qui le masquaient et le prestige déjà vieilli, il passe seul, abandonné ; traînant avec pesanteur son sceptre épuisé et hideux, comme s’il insultait à la fatigue que donne le glissement sinistre de sa chaîne éternelle. Lorsque je pressens cet espace désenchanté où vont traîner les restes de ma jeunesse et de ma vie, lorsque ma pensée cherche à suivre d’avance la pente uniforme où tout coule et se perd, que trouvez-vous que je puisse attendre à son terme, et qui pourrait me cacher l’abîme où tout cela va finir ? Ne faudra-t-il pas bien que, las et rebuté, quand je suis assuré de ne pouvoir rien, je cherche au moins du repos ? et quand une force inévitable pèse sur moi sans relâche, comment reposerai-je, si ce n’est en me précipitant moi-même ?
Il faut que toute chose ait une fin selon sa nature. Puisque ma vie relative est retranchée du cours du monde, pourquoi végéter longtemps encore inutile au monde et fatigant à moi-même ? Pour le vain instinct d’exister ! pour respirer et avancer en âge ! pour m’éveiller amèrement quand tout repose, et chercher les ténèbres quand la terre fleurit ; pour n’avoir que le besoin des désirs, et ne connaître que le songe de l’existence ; pour rester déplacé, isolé sur la scène des afflictions humaines, quand nul n’est heureux par moi, quand je n’ai que l’idée du rôle d’un homme ; pour tenir à une vie perdue, lâche esclave, que la vie repousse et qui s’attache à son ombre, avide de l’existence, comme si l’existence réelle lui était laissée, et voulant être misérablement faute d’oser n’être plus !