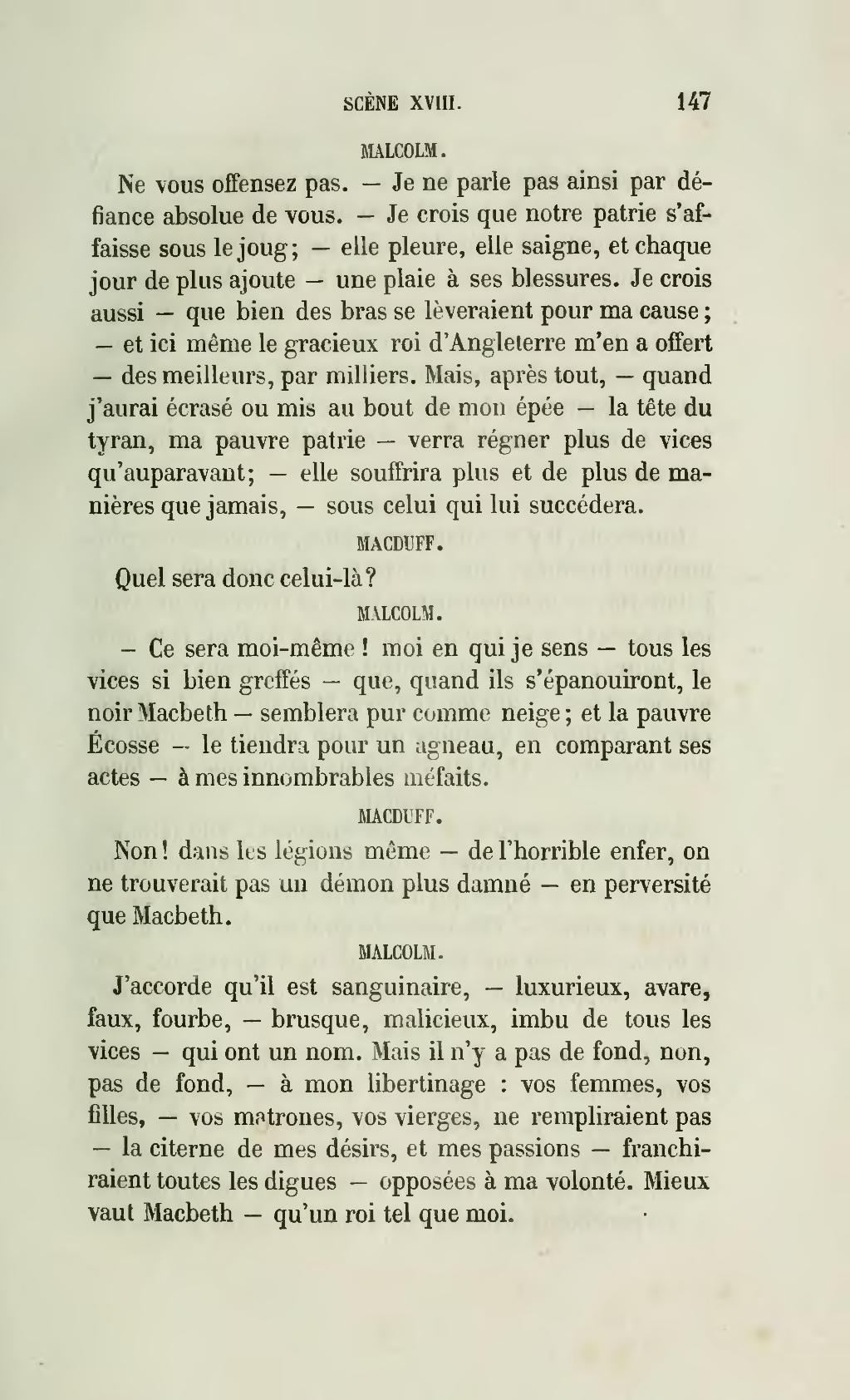Ne vous offensez pas. — Je ne parle pas ainsi par défiance absolue de vous. — Je crois que notre patrie s’affaisse sous le joug ; — elle pleure, elle saigne, et chaque jour de plus ajoute — une plaie à ses blessures. Je crois aussi — que bien des bras se lèveraient pour ma cause ; — et ici même le gracieux roi d’Angleterre m’en a offert — des meilleurs, par milliers. Mais, après tout, — quand j’aurai écrasé ou mis au bout de mon épée — la tête du tyran, ma pauvre patrie — verra régner plus de vices qu’auparavant ; — elle souffrira plus et de plus de manières que jamais, — sous celui qui lui succédera.
Quel sera donc celui-là ?
— Ce sera moi-même ! moi en qui je sens — tous les vices si bien greffés — que, quand ils s’épanouiront, le noir Macbeth — semblera pur comme neige ; et la pauvre Écosse — le tiendra pour un agneau, en comparant ses actes — à mes innombrables méfaits.
Non ! dans les légions même — de l’horrible enfer, on ne trouverait pas un démon plus damné — en perversité que Macbeth.
J’accorde qu’il est sanguinaire, — luxurieux, avare, faux, fourbe, — brusque, malicieux, imbu de tous les vices — qui ont un nom. Mais il n’y a pas de fond, non, pas de fond, — à mon libertinage : vos femmes, vos filles, — vos matrones, vos vierges, ne rempliraient pas — la citerne de mes désirs, et mes passions — franchiraient toutes les digues — opposées à ma volonté. Mieux vaut Macbeth — qu’un roi tel que moi.