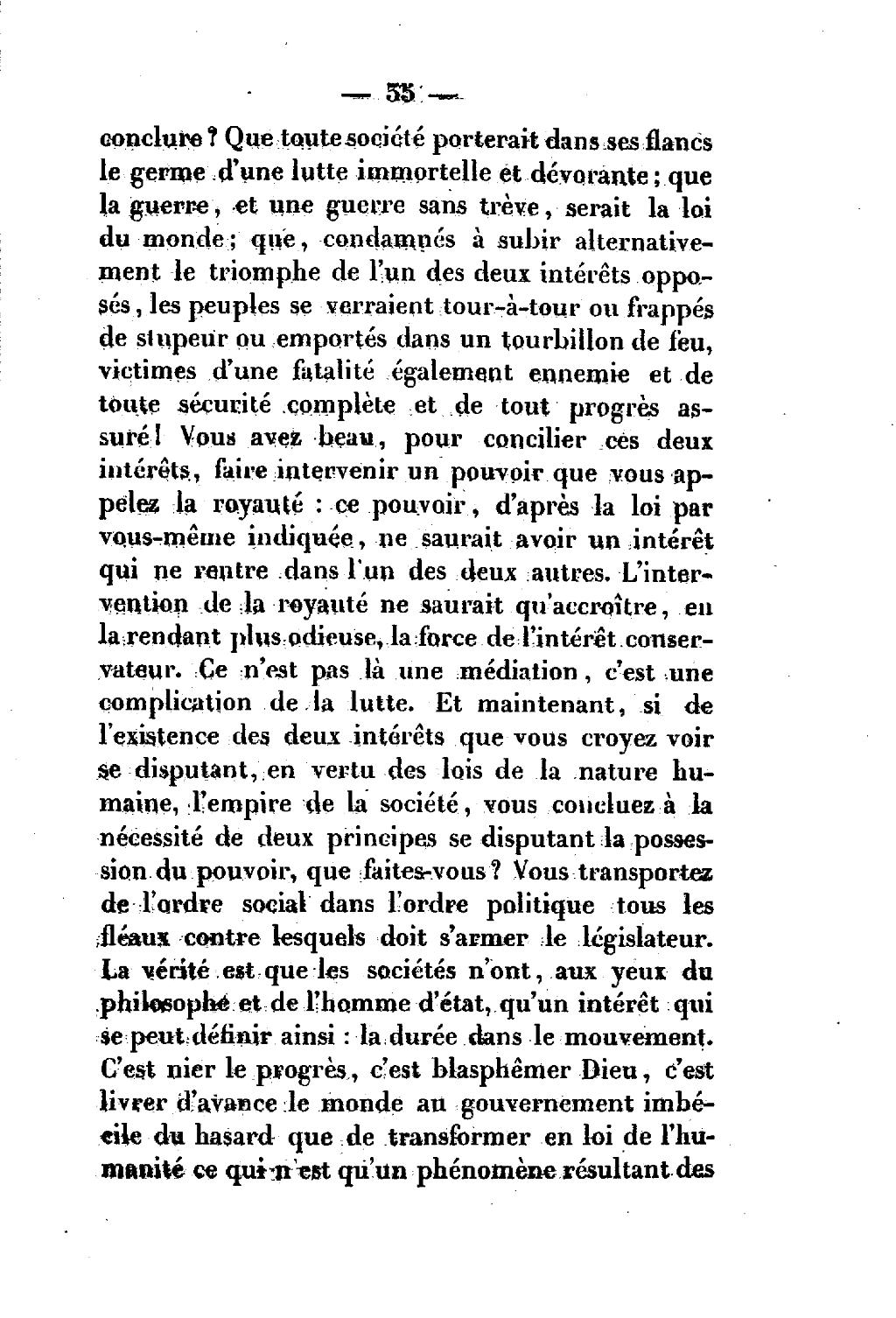conclure ? Que toute société porterait dans ses flancs le germe d’une lutte immortelle et dévorante ; que la guerre, et une guerre sans trêve, serait la loi du monde ; que, condamnés à subir alternativement le triomphe de l’un des deux intérêts opposés, les peuples se verraient tour-à-tour ou frappés de stupeur ou emportés dans un tourbillon de feu, victimes d’une fatalité également ennemie et de toute sécurité complète et de tout progrès assuré ! Vous avez beau, pour concilier ces deux intérêts, faire intervenir un pouvoir que vous appeler la royauté : ce pouvoir, d’après la loi par vous-même indiquée, ne saurait avoir un intérêt qui ne rentre dans l’un des deux autres. L’intervention de la royauté ne saurait qu’accroire, en la rendant plus odieuse, la force de l’intérêt conservateur. Ce n’est pas là une médiation, c’est une complication de la lutte. Et maintenant, si de l’existence des deux intérêts que vous croyez voir se disputant, en vertu des lois de la nature humaine, l’empire de la société, vous concluez à la nécessité de deux principes se disputant la possession du pouvoir, que faites-vous ? Vous transportez de l’ordre social dans l’ordre politique tous les fléaux contre lesquels doit s’armer le législateur. La verité est que les sociétés n’ont, aux yeux du philosophe et de l’homme d’état, qu’un intérêt qui se peut définir ainsi : la durée dans le mouvement. C’est nier le progrès, c’est blasphêmer Dieu, c’est livrer d’avance le monde au gouvernement imbécile du hasard que de transformer en loi de l’humanité ce qui n’est qu’un phénomène résultant des