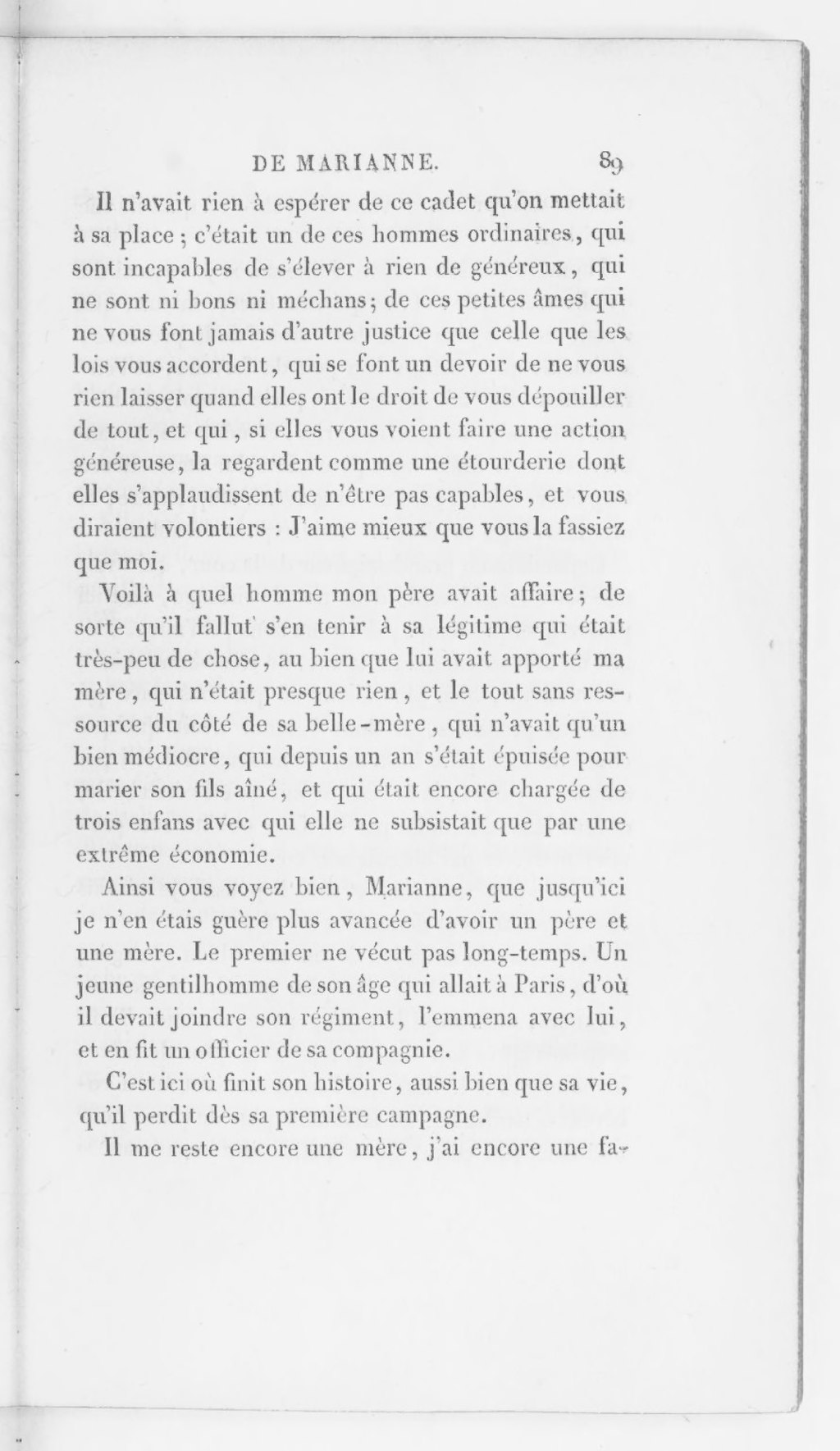Il n’avait rien à espérer de ce cadet qu’on mettait à sa place ; c’était un de ces hommes ordinaires, qui sont incapables de s’élever à rien de généreux, qui ne sont ni bons ni méchants, de ces petites âmes qui ne vous font jamais d’autre justice que celle que les lois vous accordent, qui se font un devoir de ne vous rien laisser quand elles ont droit de vous dépouiller de tout, et qui, si elles vous voient faire une action généreuse, la regardent comme une étourderie dont elles s’applaudissent de n’être pas capables, et vous diraient volontiers : J’aime mieux que vous la fassiez que moi.
Voilà à quel homme mon père avait affaire ; de sorte qu’il fallut s’en tenir à sa légitime qui était très peu de chose, à ce que lui avait apporté ma mère, qui n’était presque rien, et le tout sans ressource du côté de sa belle-mère, qui n’avait qu’un bien médiocre, qui depuis un an s’était épuisée pour marier son fils aîné, et qui était encore chargée de trois enfants avec qui elle ne subsistait que par une extrême économie.
Ainsi vous voyez bien, Marianne, que jusqu’ici je n’en étais guère plus avancée d’avoir un père et une mère. Le premier ne vécut pas longtemps. Un jeune gentilhomme de son âge qui allait à Paris, d’où il devait joindre son régiment, l’emmena avec lui, et en fit un officier de sa compagnie.
C’est ici où finit son histoire, aussi bien que sa vie, qu’il perdit dès sa première campagne.
Il me reste encore une mère, j’ai encore une famille