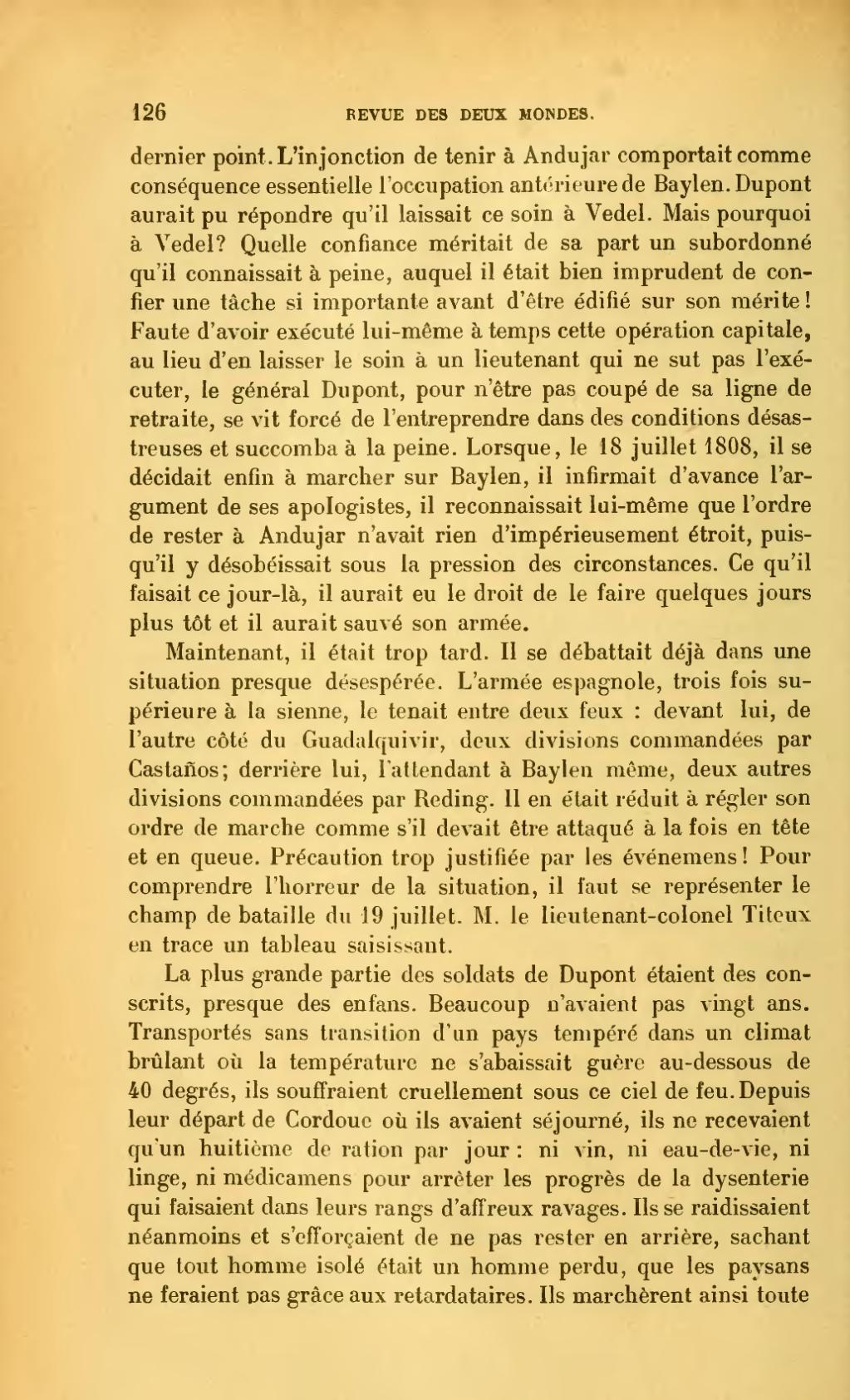dernier point. L’injonction de tenir à Andujar comportait comme conséquence essentielle l’occupation antérieure de Baylen. Dupont aurait pu répondre qu’il laissait ce soin à Vedel. Mais pourquoi à Vedel ? Quelle confiance méritait de sa part un subordonné qu’il connaissait à peine, auquel il était bien imprudent de confier une tâche si importante avant d’être édifié sur son mérite ! Faute d’avoir exécuté lui-même à temps cette opération capitale, au lieu d’en laisser le soin à un lieutenant qui ne sut pas l’exécuter, le général Dupont, pour n’être pas coupé de sa ligne de retraite, se vit forcé de l’entreprendre dans des conditions désastreuses et succomba à la peine. Lorsque, le 18 juillet 1808, il se décidait enfin à marcher sur Baylen, il infirmait d’avance l’argument de ses apologistes, il reconnaissait lui-même que l’ordre de rester à Andujar n’avait rien d’impérieusement étroit, puisqu’il y désobéissait sous la pression des circonstances. Ce qu’il faisait ce jour-là, il aurait eu le droit de le faire quelques jours plus tôt et il aurait sauvé son armée.
Maintenant, il était trop tard. Il se débattait déjà dans une situation presque désespérée. L’armée espagnole, trois fois supérieure à la sienne, le tenait entre deux feux : devant lui, de l’autre côté du Guadalquivir, deux divisions commandées par Castaños ; derrière lui, l’attendant à Baylen même, deux autres divisions commandées par Reding. Il en était réduit à régler son ordre de marche comme s’il devait être attaqué à la fois en tête et en queue. Précaution trop justifiée par les événemens ! Pour comprendre l’horreur de la situation, il faut se représenter le champ de bataille du 19 juillet. M. le lieutenant-colonel Titeux en trace un tableau saisissant.
La plus grande partie des soldats de Dupont étaient des conscrits, presque des enfans. Beaucoup n’avaient pas vingt ans. Transportés sans transition d’un pays tempéré dans un climat brûlant où la température ne s’abaissait guère au-dessous de 40 degrés, ils souffraient cruellement sous ce ciel de feu. Depuis leur départ de Cordoue où ils avaient séjourné, ils ne recevaient qu’un huitième de ration par jour : ni vin, ni eau-de-vie, ni linge, ni médicamens pour arrêter les progrès de la dysenterie, qui faisaient dans leurs rangs d’affreux ravages. Ils se raidissaient néanmoins et s’efforçaient de ne pas rester en arrière, sachant que tout homme isolé était un homme perdu, que les paysans ne feraient pas grâce aux retardataires. Ils marchèrent ainsi toute