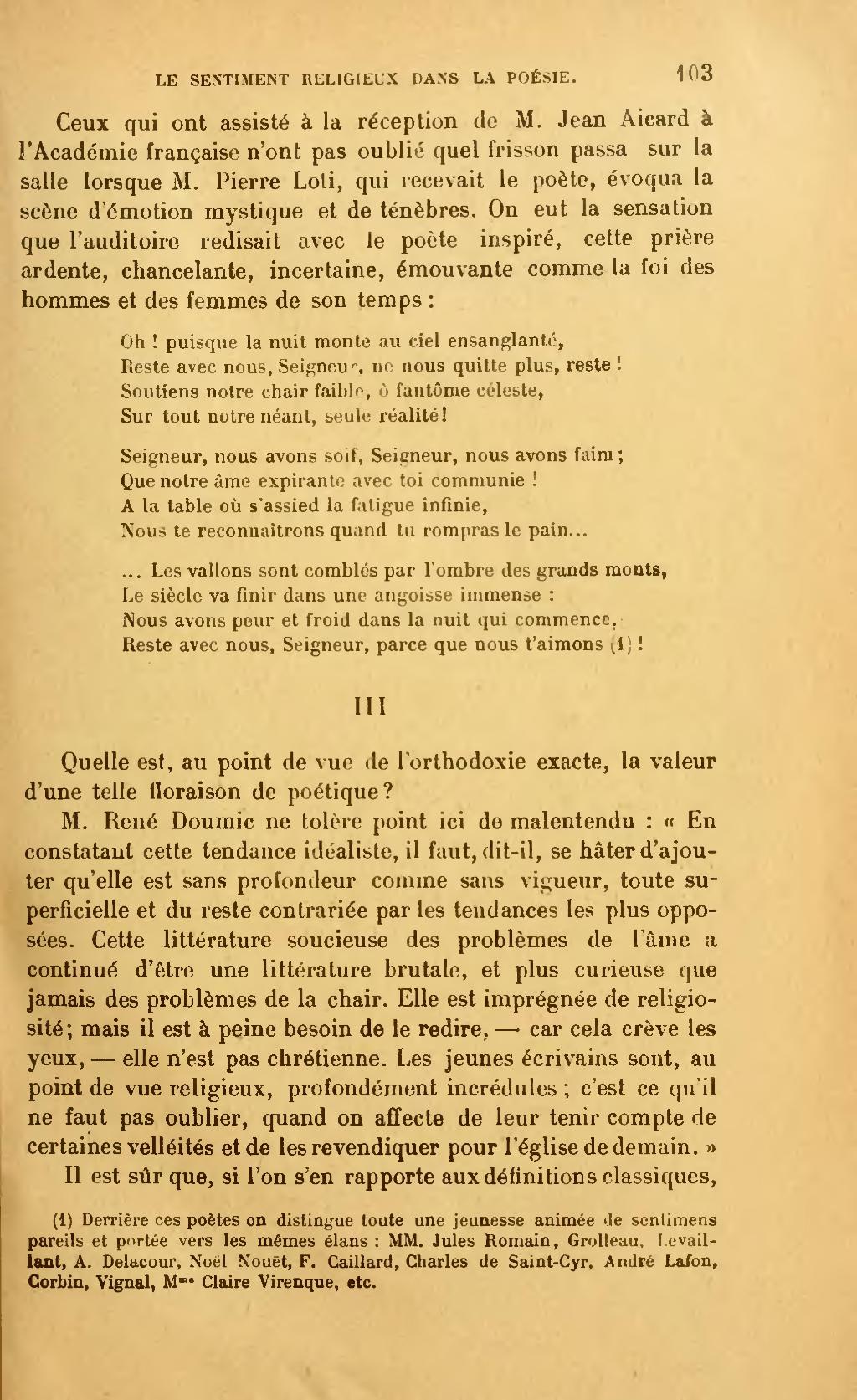Ceux qui ont assisté à la réception de M. Jean Aicard à l’Académie française n’ont pas oublié quel frisson passa sur la salle lorsque M. Pierre Loti, qui recevait le poète, évoqua la scène d’émotion mystique et de ténèbres. On eut la sensation que l’auditoire redisait avec le poète inspiré, cette prière ardente, chancelante, incertaine, émouvante comme la foi des hommes et des femmes de son temps :
Oh ! puisque la nuit monte au ciel ensanglanté,
Reste avec nous, Seigneur, ne nous quitte plus, reste !
Soutiens notre chair faible, ô fantôme céleste,
Sur tout notre néant, seule réalité !
Seigneur, nous avons soif, Seigneur, nous avons faim ;
Que notre âme expirante avec toi communie !
À la table où s’assied la fatigue infinie,
Nous te reconnaîtrons quand tu rompras le pain…
… Les vallons sont comblés par l’ombre des grands monts,
Le siècle va finir dans une angoisse immense :
Nous avons peur et froid dans la nuit qui commence.
Reste avec nous, Seigneur, parce que nous t’aimons[1] !
Quelle est, au point de vue de l’orthodoxie exacte, la valeur d’une telle floraison de poétique ?
M. René Doumic ne tolère point ici de malentendu : « En constatant cette tendance idéaliste, il faut, dit-il, se hâter d’ajouter qu’elle est sans profondeur comme sans vigueur, toute superficielle et du reste contrariée par les tendances les plus opposées. Cette littérature soucieuse des problèmes de l’âme a continué d’être une littérature brutale, et plus curieuse que jamais des problèmes de la chair. Elle est imprégnée de religiosité ; mais il est à peine besoin de le redire, — car cela crève les yeux, — elle n’est pas chrétienne. Les jeunes écrivains sont, au point de vue religieux, profondément incrédules ; c’est ce qu’il ne faut pas oublier, quand on affecte de leur tenir compte de certaines velléités et de les revendiquer pour l’église de demain. »
Il est sûr que, si l’on s’en rapporte aux définitions classiques,
- ↑ Derrière ces poètes on distingue toute une jeunesse animée de sentimens pareils et portée vers les mêmes élans : MM. Jules Romain, Grolleau, le vaillant, A. Delacour, Noël Nouët, F. Gaillard, Charles de Saint-Cyr, André Lafon, Corbin, Vignal, Mme Claire Virenque, etc.