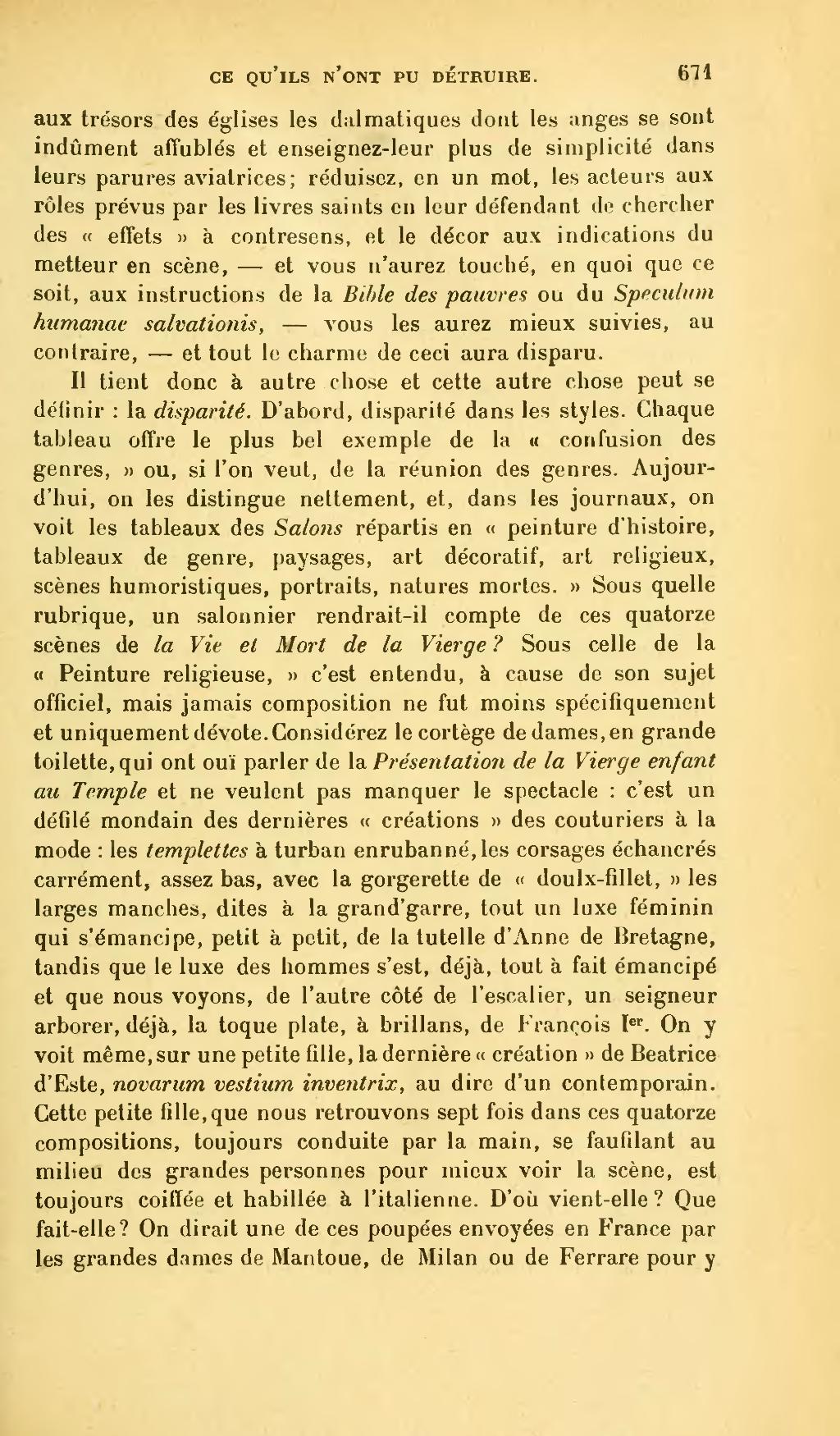aux trésors des églises les dalmatiques dont les anges se sont indûment affublés et enseignez-leur plus de simplicité dans leurs parures aviatrices ; réduisez, en un mot, les acteurs aux rôles prévus par les livres saints en leur défendant de chercher des « effets » à contresens, et le décor aux indications du metteur en scène, — et vous n’aurez touché, en quoi que ce soit, aux instructions de la Bible des pauvres ou du Speculum humanac salvationis, — vous les aurez mieux suivies, au contraire, — et tout le charme de ceci aura disparu.
Il tient donc à autre chose et cette autre chose peut se définir : la disparité. D’abord, disparité dans les styles. Chaque tableau offre le plus bel exemple de la « confusion des genres, » ou, si l’on veut, de la réunion des genres. Aujourd’hui, on les distingue nettement, et, dans les journaux, on voit les tableaux des Salons répartis en « peinture d’histoire, tableaux de genre, paysages, art décoratif, art religieux, scènes humoristiques, portraits, natures mortes. » Sous quelle rubrique, un salonnier rendrait-il compte de ces quatorze scènes de la Vie et Mort de la Vierge ? Sous celle de là « Peinture religieuse, » c’est entendu, à cause de son sujet officiel, mais jamais composition ne fut moins spécifiquement et uniquement dévote. Considérez le cortège de dames, en grande toilette, qui ont ouï parler de la Présentation de la Vierge enfant au Temple et ne veulent pas manquer le spectacle : c’est un défilé mondain des dernières « créations » des couturiers à la mode : les templettes à turban enrubanné, les corsages échancrés carrément, assez bas, avec la gorgerette de « doulx-fillet, » les larges manches, dites à la grand’garre, tout un luxe féminin qui s’émancipe, petit à petit, de la tutelle d’Anne de Bretagne, tandis que le luxe des hommes s’est, déjà, tout à fait émancipé et que nous voyons, de l’autre côté de l’escalier, un seigneur arborer, déjà, la toque plate, à brillans, de François Ier. On y voit même, sur une petite fille, la dernière « création » de Béatrice d’Esté, novarum vestium inventrix, au dire d’un contemporain. Cette petite fille, que nous retrouvons sept fois dans ces quatorze compositions, toujours conduite par la main, se faufilant au milieu des grandes personnes pour mieux voir la scène, est toujours coiffée et habillée à l’italienne. D’où vient-elle ? Que fait-elle ? On dirait une de ces poupées envoyées on France par les grandes dames de Mantoue, de Milan ou de Ferrare pour y