CHATEAU, chastel. Le château du moyen âge n’est pas le castellum romain ; ce serait plutôt la villa antique munie de défenses extérieures. Lorsque les barbares s’emparèrent du sol des Gaules, le territoire fut partagé entre les chefs conquérants ; mais ces nouveaux propriétaires apportaient avec eux leurs mœurs germaines et changèrent bientôt l’aspect du pays qu’ils avaient conquis ; le propriétaire romain ne songeait pas à fortifier sa demeure des champs, qui n’était qu’une maison de plaisance, entourée de toutes les dépendances nécessaires à l’exploitation des terres, à la nourriture et à l’entretien des bestiaux, au logement de clients et d’esclaves vivant sur le sol à peu près comme nos fermiers et nos paysans. Quels que soient les changements qui s’opèrent dans les mœurs d’un peuple, il conserve toujours quelque chose de son origine ; les citoyens romains, s’ils avaient cessé de se livrer aux occupations agricoles depuis longtemps lorsqu’ils s’établirent sur le sol des Gaules, conservaient encore, dans les siècles de la décadence, les mœurs de propriétaires fonciers ; leurs habitations des campagnes étaient établies au centre de riches vallées, le long des cours d’eau, et s’entouraient de tout ce qui est nécessaire à la vie des champs et à la grande culture. Possesseurs tranquilles de la plus grande partie du sol gaulois pendant trois siècles, n’ayant à lutter ni contre les populations soumises et devenues romaines, ni contre les invasions des barbares, ils n’avaient pas eu le soin de munir leurs villæ de défenses propres à résister à une attaque à main armée. Lorsque commencèrent les débordements de barbares venus de la Germanie, les derniers Possesseurs du sol gallo-romain abandonnèrent les villæ pour s’enfermer dans les villes fortifiées à la hâte ; le flot passé, ils réparaient leurs habitations rurales dévastées ; mais, soit mollesse, soit force d’habitude, ils ne songèrent que rarement à mettre leurs bâtiments d’exploitation agricole à l’abri d’un coup de main. Tout autre était l’esprit germain. « C’est l’honneur des tribus, dit César[1], de n’être environnées que de vastes déserts, d’avoir des frontières dévastées. Les Germains regardent comme une marque éclatante de valeur, de chasser au loin leurs voisins, de ne permettre à personne de s’établir près d’eux. Ils y trouvent, d’ailleurs, un moyen de se garantir contre les invasions subites… » « Les Germains, dit Tacite[2], n’habitent point dans des villes ; ils ne peuvent même souffrir que leurs habitations y touchent ; ils demeurent séparés et à distance, selon qu’une source, une plaine, un bois, les a attirés dans un certain lieu. Ils forment des villages, non pas comme nous, par des édifices liés ensemble et contigus ; chacun entoure sa maison d’un espace vide… » Des trois peuples germaniques qui envahirent les Gaules, Bourguignons, Visigoths et Francs, ces derniers, au milieu du VIe siècle, dominaient seuls toute la Gaule, sauf une partie du Languedoc et la Bretagne ; et de ces trois peuples, les Francs étaient ceux qui avaient le mieux conservé les mœurs des Germains[3]. Mais peu à peu ce peuple avait abandonné ses habitudes errantes ; il s’était établi sur le sol ; la vie agricole avait remplacé la vie des camps, et cependant il conservait son caractère primitif, son amour pour l’isolement et son aversion pour la vie civilisée des villes. Il ne faudrait pas se méprendre sur ce que nous entendons ici par isolement ; ce n’était pas la solitude, mais l’isolement de chaque bande de guerriers attachés à un chef. Cet isolement avait existé en Germanie, chez les peuples qui se précipitèrent en Occident, ainsi que le prouvent les textes que nous venons de citer. « Lorsque la tribu fut transplantée sur le sol gaulois, dit M. Guizot[4], les habitations se dispersèrent bien davantage ; les chefs de famille s’établirent à une bien plus grande distance les uns des autres : ils occupèrent de vastes domaines ; leurs maisons devinrent plus tard des châteaux : les villages qui se formèrent autour d’eux furent peuplés, non plus d’hommes libres, leurs égaux, mais de colons attachés à leurs terres. Ainsi, sous le rapport matériel, la tribu se trouva dissoute par le seul fait de son nouvel établissement… L’assemblée des hommes libres, où se traitaient toutes choses, devint beaucoup plus difficile à réunir… » L’égalité qui régnait dans les camps entre le chef et ses compagnons dut s’effacer et s’effaça bientôt en effet, du moment que la bande germaine fut établie sur le sol. « Le chef, devenu grand propriétaire, disposa de beaucoup de moyens de pouvoir ; les autres (ses compagnons) étaient toujours de simples guerriers ; et plus les idées de la propriété s’affermirent et s’étendirent dans les esprits, plus l’inégalité se développa avec tous ses effets… Le roi, ou les chefs considérables qui avaient occupé un vaste territoire, distribuaient des bénéfices à leurs hommes, pour les attacher à leur service ou les récompenser de services rendus… Le guerrier à qui son chef donnait un bénéfice allait l’habiter ; nouveau principe d’isolement et d’individualité… Ce guerrier avait d’ordinaire quelques hommes à lui ; il en cherchait, il en trouvait qui venaient vivre avec lui dans son domaine ; nouvelle source d’inégalité. »
Cette société, qui se décomposait ainsi au moment où elle s’établissait sur le sol conquis après avoir dissous la vieille société romaine, ne devait se constituer que par le régime féodal ; elle en avait d’ailleurs apporté les germes. Mais il fallut quatre siècles d’anarchie, de tâtonnements, de tentatives de retour vers l’administration impériale, de luttes, pour faire sortir une organisation de ce désordre.
Quelles étaient les habitations rurales de ces nouveaux possesseurs des Gaules, pendant ce long espace de temps ? On ne peut, à cet égard, que se livrer à des conjectures, car les renseignements nous manquent ou sont très-vagues. Tout porte à supposer que la villa romaine servait encore de type aux constructions des champs élevées par les conquérants. Grégoire de Tours parle de plusieurs de ces habitations, et ce qu’il en dit se rapporte assez aux dispositions des villæ. C’étaient des bâtiments isolés destinés à l’exploitation, à l’emmagasinage des récoltes, au logement des familiers et des colons, au milieu desquels s’élevait la salle du maître ou même une enceinte en plein air, aula, dans laquelle se réunissait le chef franc et ses leudes ; cette enceinte, à ciel ouvert ou couverte, servait de salle de festin, de salle de conseil ; elle était accompagnée de portiques, de vastes écuries, de cuisines, de bains. Le groupe formé par tous ces bâtiments était entouré d’un mur de clôture, d’un fossé ou d’une simple palissade. Le long des frontières, ou sur quelques points élevés, les rois mérovingiens avaient bâti des forteresses ; mais ces résidences paraissent avoir eu un caractère purement militaire, comme le castrum romain ; c’étaient plutôt des camps retranchés destinés à abriter un corps d’armée que des châteaux propres à l’habitation permanente et réunissant dans leur enceinte tout ce qui est nécessaire à la vie d’un chef et de ses hommes[5]. Nous ne pouvons donner le nom de château qu’aux demeures fortifiées bâties pendant la période féodale, c’est-à-dire du Xe au XVIe siècle. Ces demeures sont d’autant plus formidables qu’elles s’élevaient dans des contrées où la domination franque conservait avec plus de pureté les traditions de son origine germanique, sur les bords du Rhin, de la Meuse, dans le Soissonnais et l’Île de France, sur une partie du cours de la Loire et de la Saône.
Pendant la période carlovingienne, les princes successeurs de Charlemagne avaient fait quelques efforts pour s’opposer aux invasions des Normands ; ils avaient tenté à plusieurs reprises de défendre le cours des fleuves, mais ces ouvrages, ordonnés dans des moments de détresse, construits à la hâte, devaient être plutôt des postes en terre et en bois que des châteaux proprement dits. Les nouveaux barbares venus de Norvége ne songeaient guère non plus à fonder des établissements fixes au milieu des contrées qu’ils dévastaient ; attirés seulement par l’amour du butin, ils s’empressaient de remonter dans leurs bateaux dès qu’ils avaient pillé une riche province. Cependant ils s’arrêtèrent parfois sur quelque promontoire, dans quelques îles au milieu des fleuves, pour mettre à l’abri le produit des pillages, sous la garde d’une partie des hommes composant l’expédition ; ils fortifiaient ces points déjà défendus par la nature, mais ce n’était encore là que des camps retranchés plutôt que des châteaux. On retrouve un établissement de ce genre sur les côtes de la Normandie, de la Bretagne ou de l’Ouest, si longtemps ravagées par les pirates normands ; c’est le Haguedike situé à l’extrémité nord-ouest de la presqu’île de Cotentin, auprès de l’île d’Aurigny. « Un retranchement ou fossé d’une lieue et demie de long sépare ce promontoire du continent ; c’est là le Haguedike[6]… Il se peut que le Haguedike, ou fossé de la Hague, soit antérieur à l’époque normande ; mais les pirates ont pu se servir des anciens retranchements du promontoire, et en faire une place de retraite. »
Lorsqu’au Xe siècle les Normands furent définitivement établis sur une partie du territoire de la France, ils construisirent des demeures fortifiées, et ces résidences conservèrent un caractère particulier, à la fois politique et féodal. Le château normand, au commencement de la période féodale, se distingue du château français ou franc ; il se relie toujours à un système de défense territorial, tandis que le château français conserve longtemps son origine germanique ; c’est la demeure du chef de bande, isolée, défendant son propre domaine contre tous et ne tenant nul compte de la défense générale du territoire. Pour nous faire comprendre en peu de mots, le seigneur franc n’a pas de patrie, il n’a qu’un domaine ; tandis que le seigneur normand cherche, à la fois, à défendre son domaine et le territoire conquis par sa nation. Cette distinction doit être faite tout d’abord, car elle a une influence, non-seulement sur la position des demeures féodales, mais sur le système de défense adopté dans chacune d’elles. Il y a, dans la construction des châteaux normands, une certaine parité que l’on ne rencontre pas dans les châteaux français ; ceux-ci présentent une extrême variété ; on voit que le caprice du seigneur, ses idées particulières ont influé sur leur construction, tandis que les châteaux normands paraissent soumis à un principe de défense reconnu bon et adopté par tous les possesseurs de domaine, suivant une idée nationale. Lorsque l’on tient compte des circonstances qui accompagnèrent l’établissement définitif des Normands au nord-ouest de Paris, de l’intérêt immense que ces pirates tolérés sur le sol de la Normandie avaient à maintenir le cours des fleuves et rivières ouvert pour eux et les renforts qui leur arrivaient du Nord, fermé pour le peuple franc, possesseur de la haute Seine et de la plupart de ses affluents, on conçoit comment les Normands furent entraînés à adopter un système de défense soumis à une idée politique. D’ailleurs les Normands, lorsqu’ils se présentaient sur un point du territoire français, procédaient forcément partout de la même manière ; c’était en occupant le littoral, en remontant les fleuves et rivières sur leurs longs bateaux, qu’ils pénétraient jusqu’au cœur du pays. Les fleuves étaient le chemin naturel de toute invasion normande ; c’était sur leurs rives qu’ils devaient chercher à se maintenir et à se fortifier. Les îles, les presqu’îles, les escarpements commandant au loin le cours des rivières, devaient être choisis tout d’abord comme points militaires : la similitude des lieux devait amener l’uniformité des moyens de défense.
Les Francs, en s’emparant de la Gaule, s’étendirent sur un territoire très-vaste et très-varié sous le rapport géographique ; les uns restèrent dans les plaines, les autres sur les montagnes, ceux-ci au milieu de contrées coupées de ruisseaux, ceux-là près des grandes rivières ; chacun dut se fortifier en raison des lieux et de son intelligence personnelle ; ils cessèrent (hormis ceux voisins du Rhin) toute communication avec la mère patrie, et, comme nous l’avons dit ci-dessus, se trouvèrent bientôt isolés, étrangers les uns aux autres ; les liens politiques qui pouvaient encore les réunir se relâchaient chaque jour, et les idées de nationalité de lien entre les grands propriétaires d’un État ne devaient avoir aucune influence sur les successeurs de ces chefs de bande dispersés sur le sol. Les Normands, au contraire, étaient forcément dirigés par d’autres mobiles; tous pirates, tous solidaires, conservant longtemps des relations avec la mère patrie qui leur envoyait sans cesse de nouveaux contingents, arrivant en conquérants dans des contrées déjà occupées par des races guerrières, ils étaient liés par la communauté des intérêts, par le besoin de se maintenir serrés, unis, dans ces pays au milieu desquels ils pénétraient sans trop oser s’étendre loin des fleuves, leur seule voie de communication ou de salut en cas de désastre.
Si les traditions romaines avaient exercé une influence sur la disposition des demeures des propriétaires francs, elles devaient être très-affaiblies pour les pirates scandinaves qui ne commencèrent à fonder des établissements permanents sur le continent qu’au Xe siècle. Ces derniers, plus habitués à charpenter des bateaux qu’à élever des constructions sur la terre ferme, durent nécessairement profiter des dispositions du terrain pour établir leurs premiers châteaux forts, qui n’étaient que des campements protégés par des fossés, des palissades et quelques ouvrages de bois propres à garantir des intempéries les hommes et leur butin. Ils purent souvent aussi profiter des nombreux camps gallo-romains que l’on rencontre même encore aujourd’hui sur les côtes de la Manche et les bords de la Seine, les augmenter de nouveaux fossés, d’ouvrages intérieurs, et prendre ainsi les premiers éléments de la fortification de campagne. Cependant les Normands, actifs, entreprenants et prudents à la fois, tenaces, doués d’un esprit de suite qui se manifeste dans tous leurs actes, comprirent, très-promptement l’importance des châteaux pour garder les territoires sur lesquels les successeurs de Charlemagne avaient été forcés de les laisser s’établir; et, dès le milieu du Xe siècle, ils ne se contentèrent plus de ces défenses de campagne en terre et en bois, mais élevèrent déjà, sur le cours de la basse Seine, de l’Orne et des petites rivières qui se jettent dans la Manche, des demeures de pierre, construites avec soin, formidables pour l’époque, dont il nous reste des fragments considérables et remarquables surtout par le choix intelligent de leur assiette. Autres étaient alors les châteaux de France ; ils tenaient, comme nous l’avons dit, et du camp romain et de la villa romaine. Ils étaient établis soit en plaine, soit sur des montagnes, suivant que le propriétaire franc possédait un territoire plane ou montagneux. Dans le premier cas, le château consistait en une enceinte de palissade entourée de fossés, quelquefois d’une escarpe en terre, d’une forme ovale ou rectangulaire. Au milieu de l’enceinte, le chef franc faisait amasser des terres prises aux dépens d’un large fossé, et sur ce tertre factice ou motte se dressait la défense principale qui plus tard devint le donjon. On retrouve encore, dans le centre de la France, et surtout dans l’ouest, les traces de ces châteaux primitifs.
Un établissement de ce genre, la Tusque à Sainte-Eulalie d’Ambarès ( Gironde)[7], nous donne un ensemble assez complet des dispositions générales de ces sortes de châteaux défendus surtout par des ouvrages en terre.

Cet établissement est borné de trois côtés (1) par deux ruisseaux A, B ; un fossé C ferme le quatrième côté du parallélogramme, qui a 150 mètres de long sur 90 mètres à 110 mètres environ. Au milieu de ce parallélogramme s’élève une motte D de 27 mètres de diamètre dont le fossé varie en largeur de 10 à 15 mètres. Sur un des grands côtés en E s’élève un vallum haut de deux mètres environ et large de 10 mètres. Il n’est pas besoin de dire que toutes les constructions de bois que nous avons rétablies dans cette figure n’existent plus depuis longtemps. C’était, comme nous l’avons indiqué, au sommet de la motte que s’élevait le donjon, la demeure du seigneur, à laquelle on ne pouvait arriver que par un pont de bois facile à couper. L’enceinte renfermait les bâtiments nécessaires au logement des compagnons du seigneur, des écuries, hangars, magasins de provisions, etc. Probablement plusieurs portes s’ouvraient dans les palissades, au milieu de trois des faces, peut-être sur chacune d’elles. Ces portes étaient, suivant l’usage, garnies de défenses extérieures, comme le camp romain, avec lequel cette enceinte a plus d’un rapport. Ordinairement un espace, tracé au moyen de pierres brutes rangées circulairement sur le sol de la cour, indiquait la place des assemblées. Souvent, à l’entour de ces demeures, on rencontre des tumuli qui ne sont que des amas de terre recouvrant les ossements de guerriers remarquables par leur courage. Ces tertres pouvaient d’ailleurs servir, au besoin, de défenses avancées. Une guette, placée au sommet du donjon, permettait d’observer ce qui se passait dans les environs.
Si le château franc était posté sur une colline, sur un escarpement, on profitait alors des dispositions du terrain, et c’était l’assiette supérieure du plateau qui donnait la configuration de l’enceinte. Le donjon s’élevait soit sur le point le plus élevé pour dominer les environs, soit près de l’endroit le plus faible pour le renforcer. C’est dans ces établissements que l’on voit souvent, dès une époque reculée, le moellon remplacer le bois, à cause de la facilité qu’on trouvait à se le procurer dans des pays montagneux. Mais il arrivait fréquemment alors que l’assiette du château n’était pas assez vaste pour contenir toutes ses nombreuses dépendances ; le long des rampants de la colline ou au bas de l’escarpement on élevait alors une première enceinte en palissades ou en pierres sèches protégées par des fossés, au milieu de laquelle on construisait les logements propres à renfermer la garnison, les magasins, écuries, etc. Cette première enceinte, que nous retrouvons dans presque tous les châteaux du moyen âge, était désignée sous le nom de basse-cour. En général, cette enceinte inférieure était protégée par le donjon. On ne fut pas d’ailleurs sans reconnaître que le donjon posé au centre des enceintes, à l’instar du prætorium du camp romain, était, appliqué aux châteaux, une disposition vicieuse, en ce qu’elle ne pouvait permettre à la garnison de faire des sorties, de se jeter sur les derrières des assiégeants après que l’enceinte extérieure avait été forcée. Nous voyons le donjon des châteaux, dès le XIe siècle, posté généralement près de la paroi de l’enceinte, ayant ses poternes particulières, ses sorties dans les fossés, et commandant le côté de la place dont l’accès était le plus facile. Toutefois, nous penchons à croire que le château féodal n’est arrivé à ses perfectionnements de défense qu’après l’invasion normande, et que ces peuples du Nord ont été les premiers qui aient appliqué un système défensif soumis à certaines lois, suivi bientôt par les seigneurs du continent après qu’ils en eurent à leurs dépens reconnu la supériorité. Le système défensif normand est né d’un profond sentiment de défiance, de ruse, étranger au caractère franc. Pour appuyer notre opinion sur des preuves matérielles, nous devons faire observer que les châteaux dont il nous reste des constructions comprises entre les Xe et XIIe siècles, élevés sur côtes de l’ouest, le long de la Loire et de ses affluents, de la Gironde, de la Seine, c’est-à-dire sur le cours des irruptions normandes ou dans le voisinage de leurs possessions, ont un caractère particulier, uniforme, que l’on ne retrouve pas, à la même époque, dans les provinces du centre de la France, dans le midi et en Bourgogne.
Il n’est pas besoin, nous le pensons, de faire ressortir la supériorité de l’esprit guerrier des Normands, pendant les derniers temps de la période carlovingienne, sur l’esprit des descendants des chefs francs établis sur le sol gallo-romain. Ces derniers, comme nous l’avons dit plus haut, étaient d’ailleurs dispersés, isolés, et n’avaient aucun de ces sentiments de nationalité que les Normands possédaient à un haut degré. La féodalité prit des caractères différents sur le sol français, suivant qu’elle fut plus ou moins mélangée de l’esprit normand, et cette observation, si elle était développée par un historien, projetterait la lumière sur certaines parties de l’histoire politique du moyen âge qui paraissent obscures et inexplicables. Ainsi, c’est peut-être à cet esprit anti-national d’une partie de la féodalité française, qui avait pu résister à l’influence normande, que nous devons de n’être pas devenus Anglais au XVe siècle. Ce n’est point là un paradoxe, comme on pourrait le croire au premier abord. Si tout le sol français avait été imprégné de l’esprit national normand, comme la Normandie, le Maine, l’Anjou, le Poitou, la Saintonge et la Guienne, au XVe siècle, la conquête anglaise était assurée à tout jamais. C’est à l’esprit individuel et nullement national des seigneurs féodaux de la Bretagne, qui était toujours restée opposée à l’influence normande[8], et du centre de la France, secondé par le vieil esprit national du peuple gallo-romain, que nous devons d’être restés Français ; car, à cette époque encore, l’invasion anglaise n’était pas considérée, sur une bonne partie du territoire de la France, comme une invasion étrangère.
Si nous nous sommes permis cette digression, ce n’est pas que nous ayons la prétention d’entrer dans le domaine de l’historien, mais c’est que nous avons besoin d’établir certaines classifications, une méthode, pour faire comprendre à nos lecteurs ce qu’est le château féodal pendant le moyen âge, pour faire ressortir son importance, ses transformations et ses variétés, les causes de sa grandeur et de sa décadence. Voilà pour les caractères généraux politiques, dirons-nous, de la demeure féodale primitive. Ses caractères particuliers tiennent aux mœurs et à la vie privée de ses habitants. Or, qu’on se figure ce que devait être la vie du seigneur féodal pendant les XIe et XIIe siècles en France ! c’est-à-dire pendant la période de développement de la féodalité. Le seigneur normand est sans cesse occupé des affaires de sa nation ; la conquête de l’Angleterre, les luttes nationales sur le continent où il n’était admis qu’à regret, lui conservent un rôle politique qui l’occupe, lui fait entrevoir un but qui n’est pas seulement personnel. Si remuant, insoumis, ambitieux que soit le baron normand, il est forcé d’entrer dans une lice commune, de se coaliser, de faire la grande guerre, de conserver l’habitude de vivre dans les armées et les camps. Son château a quelque chose de la forteresse territoriale ; il n’a pas le loisir de s’y enfermer longtemps ; il sait enfin que pour garder son domaine il faut défendre le territoire, car, en Angleterre comme en France, il est à l’état de conquérant. La vie du seigneur féodal français est autre ; il est possesseur ; le souvenir de la conquête est effacé depuis longtemps chez lui ; il se considère comme indépendant ; il ne comprend ses devoirs de vassal que parce qu’il profite du système hiérarchique de la féodalité, et que, s’il refuse de reconnaître son suzerain, il sait que le lendemain ses propres vassaux lui dénieront son pouvoir ; étranger aux intérêts généraux du pays (intérêts qu’il ne peut comprendre puisque à peine ils se manifestent au XIIe siècle), il vit seul ; ceux qui l’entourent ne sont ni ses soldats, ni ses domestiques, ni ses égaux ; ils dépendent de lui dans une certaine limite, qui, dans la plupart des cas, n’est pas nettement définie. Il ne paye pas les hommes qui lui doivent le service de guerre, mais la durée de ce service est limitée. Le seigneur ayant un fief, compte plusieurs classes de vassaux : les uns, comme les chevaliers, ne lui doivent que l’hommage et l’aide de leurs bras en cas d’appel aux armes, ou une somme destinée à racheter ce service, encore faut-il que ce ne soit pas pour l’aider dans une entreprise contre le suzerain. D’autres tenanciers roturiers, tenant terres libres, devaient payer des rentes au seigneur, avec la faculté de partager leur tenure en parcelles, mais restant responsables du payement de la rente, comme le sont de principaux locataires. D’autres tenanciers, les vilains, d’une classe inférieure, les paysans, les bordiers[9], les derniers sur l’échelle féodale, devaient des corvées de toutes natures. Cette diversité dans l’état des personnes, dans le partage du sol et le produit que le seigneur en retirait amenait des complications infinies ; de là des difficultés perpétuelles, des abus, une surveillance impossible, et par suite des actes arbitraires, car cet état de choses, à une époque où l’administration était une science à peine connue, était souvent préjudiciable au seigneur. Ajoutons à cela que les terres nobles, celle qui étaient entre les mains des chevaliers, se trouvaient soumises à la garde pendant la minorité du seigneur, c’est-à-dire que le suzerain jouissait pendant ce temps du revenu de ces terres. Si aujourd’hui, avec l’uniformité des impôts, il faut une armée d’administrateurs pour assurer la régularité du revenu de l’État, et une longue habitude de l’unité gouvernementale, on comprendra ce que devait être pendant les XIe et XIIe siècles l’administration d’un domaine fieffé. Si le seigneur était débonnaire, il voyait la source de ses revenus diminuer chaque jour ; si au contraire il était âpre au gain, ce qui arrivait souvent, il tranchait les difficultés par la violence, ce qui lui était facile, puisqu’il réunissait sous la main le droit fiscal et les droits de justicier. Pour vivre et se maintenir dans une pareille situation sociale, le seigneur était amené à se défier de tout et de tous ; à peine s’il pouvait compter sur le dévouement de ceux qui lui devaient le service militaire. Pour acquérir ce dévouement il lui fallait tolérer des abus sans nombre de ses vassaux nobles, qui lui prêtaient le secours de leurs armes, les attirer et les entretenir près de lui par l’appât d’un accroissement de biens, par l’espoir d’un empiètement sur les terres de ses voisins. Il n’avait même pas de valets à ses gages, car, de même que ses revenus lui étaient payés en grande partie en nature, le service journalier de son château était fait par des hommes de sa terre qui lui devaient, l’un le balayage, l’autre le curage des égouts, ceux-ci l’entretien de ses écuries, ceux-là l’apport de son bois de chauffage, la cuisson de son pain, la coupe de son foin, l’élagage de ses haies, etc. Retiré dans son donjon avec sa famille et quelques compagnons, la plupart ses parents moins riches que lui, il ne pouvait être assuré que ses hommes d’armes, dont le service était temporaire, séduits par les promesses de quelque voisin, n’ouvriraient pas les portes de son château à une troupe ennemie. Cette étrange existence de la noblesse féodale justifie ce système de défiance dont ses habitations ont conservé l’empreinte ; et si aujourd’hui cette organisation sociale nous semble absurde et odieuse, il faut convenir cependant qu’elle était faite pour développer la force morale des individus, aguerrir les populations, qu’elle était peut-être la seule voie qui ne conduisît pas de la barbarie à la corruption la plus honteuse. Soyons donc justes, ne jetons pas la pierre à ces demeures renversées par la haine populaire aussi bien que par la puissance monarchique ; voyons-y au contraire le berceau de notre énergie nationale, de ces instincts guerriers, de ce mépris du danger qui ont assuré l’indépendance et la grandeur de notre pays.
On conçoit que cet état social dut être accepté par les Normands lorsqu’ils se fixèrent sur le sol français. Et en effet, depuis Rollon, chaque seigneur normand s’était prêté aux coutumes des populations au milieu desquelles il s’était établi ; car, pour y vivre, il n’était pas de son intérêt de dépeupler son domaine. Il est à croire qu’il ne changea rien aux tenures des fiefs dont il jouit par droit de conquête, car dès le commencement du XIIe siècle nous voyons le seigneur normand, en temps de paix, entouré d’un petit nombre de familiers, habitant la salle, le donjon fortifié ; en temps de guerre, lorsqu’il craint une agression, appeler autour de lui les tenanciers nobles et même les vavasseurs, hôtes[10] et paysans. Alors la vaste enceinte fortifiée qui entourait le donjon se garnissait de cabanes élevées à la hâte, et devenait un camp fortifié dans lequel chacun apportait ce qu’il avait de plus précieux, des vivres et tout ce qui était nécessaire pour soutenir un siège ou un blocus. Cela explique ces défenses étendues qui semblent faites pour contenir une armée, bien qu’on y trouve à peine des traces d’habitation. Cependant les Normands conçoivent la forteresse dans des vues politiques autant que personnelles ; les seigneurs français profitent de la sagacité déployée par les barons normands dans leurs ouvrages militaires, mais seulement avec l’idée de défendre le domaine, de trouver un asile sûr pour eux, leur famille et leurs hommes. Le château normand conserve longtemps les qualités d’une forteresse combinée de façon à se défendre contre l’assaillant étranger ; son assiette est choisie pour commander des passages, intercepter des communications, diviser des corps d’armée, protéger un territoire ; ses dispositions intérieures sont comparativement larges, destinées à contenir des compagnies nombreuses. Le château français ne s’élève qu’en vue de la garde du domaine féodal ; son assiette est choisie de façon à le protéger seul ; ses dispositions intérieures sont compliquées, étroites, accusant l’habitation autant que la défense ; elles indiquent la recherche d’hommes réunis en petit nombre, dont toutes les facultés intellectuelles sont préoccupées d’une seule pensée, celle de la défense personnelle. Le château français est comme un groupe de châteaux qui, au besoin, peuvent se défendre les uns contre les autres. Le seigneur français s’empare, au XIIe siècle, de l’esprit de ruse normand, et il l’applique aux moindres détails de sa résidence, en le rapetissant, pour ainsi dire.
Cet aperçu général tracé, nous passerons à l’examen des monuments. Nous nous occuperons d’abord du château normand ; le plus avancé au point de vue militaire pendant le cours du XIe siècle. Le château d’Arques, près de Dieppe, nous servira de point de départ, car nous retrouvons encore dans son assiette et ses combinaisons de détail les principes de la défense normande primitive. Sur le versant sud-ouest de la vallée d’Arques, à quelques kilomètres de la mer, se détache une langue de terre crayeuse qui forme comme une sorte de promontoire défendu par la nature de trois côtés. C’est à l’extrémité du promontoire que Guillaume[11], oncle de Guillaume le Bâtard, par suite de la donation que son neveu lui avait faite du comté d’Arques vers 1040, éleva la forteresse dont nous allons essayer de faire comprendre l’importance. Peut-être existait-il déjà sur ce point un château ; des constructions antérieures à cette époque, il ne reste pas trace. Guillaume d’Arques, plein d’ambition, reconnut le don de son neveu en cherchant à lui enlever le duché de Normandie ; en cela il suivait l’exemple de la plupart des seigneurs normands, qui, voyant à la tête du duché un jeune homme à peine sorti de l’adolescence, se préparaient à lui ravir un héritage qui ne paraissait pas dû à sa naissance illégitime. En effet, « dans les premiers temps de la vie de Guillaume le Bâtard, dit Guillaume de Jumiéges[12], un grand nombre de Normands égarés et infidèles élevèrent dans beaucoup de lieux des retranchements et se construisirent de solides forteresses. » Sans perdre de temps, et avant de dévoiler ses projets de révolte, Guillaume d’Arques se mit à l’œuvre, et, peu d’années après l’investiture de son comté, le village d’Arques voyait s’élever, à l’extrémité de la langue de terre qui le domine, une vaste enceinte fortifiée, protégée par des fossés profonds et un donjon formidable. Mais c’est ici qu’apparaît tout d’abord le génie normand.

Au lieu de profiter de tout l’espace donné par l’extrémité du promontoire crayeux, et de considérer les escarpements et les vallées environnantes comme un fossé naturel, ainsi que l’eût fait un seigneur français, Guillaume d’Arques fit creuser au sommet de la colline un large fossé, et c’est sur l’escarpe de ce fossé qu’il éleva l’enceinte de son château, laissant, ainsi que l’indique la fig. 2, entre les vallées et ses défenses une crête A, sorte de chemin couvert de deux mètres de largeur, derrière lequel l’assaillant trouvait, après avoir gravi les escarpements naturels B, un obstacle infranchissable entre lui et les murs du château. Les crêtes A étaient d’ailleurs munies de palissades, hériçuns, qui protégeaient le chemin couvert et permettaient de le garnir de défenseurs, ainsi qu’on le voit en C. Un peu au-dessus du niveau du fond du fossé, les Normands avaient le soin de percer des galeries longitudinales S qui permettaient de reconnaître et d’arrêter le travail du mineur qui se serait attaché à la base de l’escarpe. À Arques, ces galeries souterraines prennent entrée sur certains points de la défense intérieure, après de nombreux détours qu’il était facile de combler en un instant, dans le cas où l’assaillant aurait pu parvenir à s’emparer d’un de ces couloirs.
Cette disposition importante est une de celles qui caractérisent l’assiette des châteaux normands pendant les XIe et XIIe siècles. Ce fossé, fait à main d’homme et creusé dans la craie, n’a pas moins de 25m à 30m de largeur de la crête de la contrescarpe à la base des murailles.


La place d’Arques était à peine construite que le duc Guillaume dut l’assiéger, son oncle s’étant déclaré ouvertement contre lui. Ne pouvant tenter de prendre le château de vive force, le Bâtard de Normandie prit le parti de le bloquer. À cet effet, il fit creuser un fossé de contrevallation qui, partant du ravin au nord-ouest, passait devant la porte nord du château, descendait jusqu’à la rivière de la Varenne et remontait dans la direction du sud-est vers le ravin. Il munit ce fossé de bastilles pour loger et protéger son monde contre les attaques du dedans ou du dehors :
« De fossez è de hériçun
Et de pel fist un chasteillon
El pié del teltre en la vallée,
Ki garda tute la cuntrée :
Ne pristrent puiz cels del chastel
Ne bués ne vache ne véel.
Li Dus tel chastelet i fist
Tant chevaliers è tel i mist
Ki bien le porreient desfendre
Ke Reis ne Quens ne porreit prendre[15]. »
Après une tentative infructueuse du roi de France pour faire lever le blocus, le comte Guillaume fut obligé de capituler faute de vivres :
« Willame d’Arches lungement
Garda la terre è tint forment,
E plus lungement la tenist,
Se viande ne li fausist :
Maiz pur viande ki failli,
Terre è chastel è tur guerpi ;
Al Duc Willame tut rendi,
Et al Rei de France s’enfui. »
Il n’était guère possible, en effet, avec les moyens d’attaque dont on disposait alors, de prendre un château aussi bien défendu par la nature et par des travaux d’art formidables.

On comprendra ainsi plus facilement les dispositions intérieures de cette place forte.
Déjà, du temps de Guillaume le Bâtard, les barons normands construisaient donc de vastes châteaux de maçonnerie possédant tout ce qui constitue les places de ce genre au moyen âge : fossés profonds et habilement creusés, enceintes inférieures et supérieures, donjon, etc. Le duc de Normandie, pendant les longues luttes du commencement de son règne, éleva des châteaux, ou tout au moins des donjons, pour tenir en bride les villes qui avaient pris parti contre lui :
« E il fist cax è pierre atraire ;
Iloec (au Mans) fist une tur faire[16] »
Après la descente en Angleterre, l’établissement des châteaux fut un des moyens que Guillaume le Conquérant employa pour assurer sa nouvelle royauté, et ce fut, en grande partie, à ces forteresses élevées sur des points stratégiques ou dans les villes mêmes qu’il dut de pouvoir se maintenir au milieu d’un pays qui tentait chaque jour des soulèvements pour chasser l’étranger et reconquérir son indépendance. Mais beaucoup de seigneurs, du moment que la guerre générale était terminée, tenant ces châteaux en fief, se prenaient de querelle avec leurs voisins, faisaient des excursions sur les terres les uns des autres, et en venaient à s’attaquer dans leurs places fortes. Ou bien, mécontents de voir la faveur du suzerain tomber sur d’autres que sur eux, cherchaient à rendre leurs châteaux plus formidables afin de vendre leurs services plus cher aux rivaux de leur seigneur et de faire cause commune avec eux :
« Li Reis se fia as deniers[17],
K’il ont à mines, à sestiers[18]
En Normandie trespassa (passa),
Mult out od li grant gent e a
Od granz tonels, od grant charrei,
Fet li denier porter od sei.
As chastelains et as Barons
Ki orent turz (donjons) è forz maisons,
As boens guerriers et as marchis[19]
A tant doné è tant promis,
Ke li Dus Robert unt lessié,
Et por li Reis l’unt guerréié. »
C’est ainsi que, par suite de l’organisation féodale, même en Normandie où l’esprit national s’était maintenu beaucoup mieux qu’en France, les seigneurs étaient chaque jour portés à rendre leurs châteaux de plus en plus forts, afin de s’affranchir de toute dépendance et de pouvoir dicter des conditions à leur suzerain. Le château normand du XIe siècle ne consistait qu’en un donjon carré ou rectangulaire, autour duquel on élevait quelques ouvrages de peu d’importance, protégés surtout par ce fossé profond pratiqué au sommet d’un escarpement ; c’était là le véritable poste normand de cette époque, destiné à dominer un territoire, à fermer un passage ou contenir la population des villes. Des châteaux munis de défenses aussi étendues que celles d’Arques étaient rares ; mais les barons normands devenant seigneurs féodaux, en Angleterre ou sur le continent, se virent bientôt assez riches et puissants pour augmenter singulièrement les dépendances du donjon qui dans l’origine était le seul point sérieusement fortifié. Les enceintes primitives, faites souvent en palissades, furent remplacées par des murs flanqués de tours. Les plus anciens documents écrits touchant les manoirs et même les châteaux (documents qui en Angleterre remontent au XIIe siècle) désignent souvent la demeure fortifiée du seigneur par le mot aula, hall ; c’est qu’en effet ces sortes d’établissements militaires ne consistaient qu’en une salle défendue par d’épaisses murailles, des créneaux et des contreforts munis d’échauguettes ou de bretèches flanquantes. Les dépendances de la demeure seigneuriale n’avaient relativement qu’une importance minime ; en cas d’attaque sérieuse, la garnison abandonnait bientôt les ouvrages extérieurs et se renfermait dans le donjon, dont les moyens défensifs étaient formidables pour l’époque. Pendant le cours du XIIe siècle, cette tradition se conserve dans les contrées où l’influence normande prédomine ; le donjon, la salle fortifiée prend une valeur relative que nous ne lui trouvons pas au même degré sur le territoire français ; le donjon est mieux isolé des défenses secondaires dans le château normand des XIe et XIIe siècles que dans le château d’origine française ; il est plus élevé, présente une masse plus imposante ; c’est un poste autour duquel est tracé un camp fortifié plutôt qu’un château. Cette disposition est apparente non-seulement en Normandie et en Angleterre, comme au Pin (Calvados), à Saint-Laurent-sur-Mer, à Nogent-le-Rotrou, à Domfront, à Falaise, à Chamboy (Orne), à Newcastle, à Rochester et à Douvres (Angleterre), mais sur les côtes de l’Ouest, dans l’Anjou, le Poitou et le Maine, c’est-à-dire dans toutes les contrées où pénètre l’influence normande ; nous la retrouvons, accompagnée du fossé normand dont le caractère est si nettement tranché, à Pouzanges (Vendée), à Blanzac, à Broue, à Pons (Charente-Inférieure), à Chauvigny près Poitiers, et jusqu’à Montrichard, à Beaugency-sur-Loire et à Loches (voy. Donjon). Les défenses extérieures qui accompagnent ces gros donjons rectangulaires, ou ne présentent que des terrassements sans traces de constructions importantes, ou si elles sont élevées en maçonnerie, sont toutes postérieures d’un siècle au moins à l’établissement de ces donjons, ce qui indique assez clairement que les enceintes primitives des XIe et XIIe siècles avaient peu d’importance et qu’elles durent être remplacées lorsqu’au XIIIe siècle ce système défensif des châteaux fut modifié, et qu’on eut reconnu la nécessité d’élargir et de renforcer les ouvrages extérieurs.


Les châteaux que Guillaume le Conquérant fit élever dans les villes d’Angleterre pour tenir les populations urbaines en respect n’étaient que, des donjons rectangulaires, bien munis et entourés de quelques ouvrages en terre, de palissades, ou d’enceintes extérieures qui n’étaient pas d’une grande force. Cela explique la rapidité avec laquelle se construisaient ces postes militaires et leur nombre prodigieux ; mais cela explique aussi comment, dans les soulèvements nationaux dirigés avec énergie, les garnisons normandes qui tenaient ces places, obligées de se réfugier dans le donjon après l’enlèvement des défenses extérieures, qui ne présentaient qu’un obstacle assez faible contre une troupe nombreuse et déterminée, étaient bientôt réduites par famine, se défendaient mal dans un espace aussi étroit, et étaient forcées de se rendre à discrétion. Guillaume, pendant son règne, malgré son activité prodigieuse, ne pouvait faire plus sur l’étendue d’un vaste pays toujours prêt à se soulever ; ses successeurs eurent plus de loisirs pour étudier l’assiette et la défense de leurs châteaux ; ils en profitèrent, et bientôt le château normand augmenta et perfectionna ses défenses extérieures. Le donjon prit une moins grande importance relative ; il se relia mieux aux ouvrages secondaires, les protégea d’une manière plus efficace ; mieux encore, le château tout entier ne fut qu’un vaste donjon dont toutes les parties furent combinées avec art et devinrent indépendantes les unes des autres, quoique protégées par une construction plus forte. On commença dès lors à appliquer cette loi « que tout ce qui se défend doit être défendu. »
Il nous faut donc atteindre la fin du XIIe siècle pour rencontrer le véritable château féodal, c’est-à-dire un groupe de bâtiments élevés avec ensemble, se défendant isolément, quoique réunis par une pensée de défense commune, disposés dans un certain ordre, de manière à ce qu’une partie étant enlevée, les autres possèdent encore leurs moyens complets de résistance, leurs ressources en magasins de munitions et de vivres, leurs issues libres soit pour faire des sorties et prendre l’offensive, soit pour faire échapper la garnison si elle ne peut plus tenir. Nous verrons tout à l’heure comment ce programme difficile à réaliser fut rempli avec une sagacité rare par Richard Cœur de Lion, pendant les dernières années du XIIe siècle, lorsqu’il fit construire l’importante place du château Gaillard. Mais avant de nous occuper de cette forteresse remarquable, nous devons parler d’un château qui nous paraît être antérieur, qui est comme la transition entre le château primitif (celui qui ne possède qu’un donjon avec une enceinte plus ou moins étendue tracée d’après la configuration du sol) et le château féodal du XIIIe siècle. C’est le château de la Roche-Guyon, situé à quinze kilomètres de Mantes en aval sur la Seine. Son assiette est d’ailleurs la même que celle du château Gaillard.
Au-dessous de Mantes, la Seine coule vers l’ouest ; à Rolleboise, elle se détourne vers le nord-est, forme un vaste coude, revient vers le sud-ouest, et laisse ainsi, sur la rive gauche, une presqu’île d’alluvions dont la longueur est environ de huit kilomètres et la plus grande largeur de quatre. La gorge de cette presqu’île n’a guère que deux kilomètres d’ouverture. C’était là un lieu de campement excellent, car un corps d’armée, dont la droite était appuyée à Bonnières et la gauche à Rolleboise, défendait sans peine l’entrée de la presqu’île. Mais il fallait prévoir qu’un ennemi en forces, en attaquant la gorge, pouvait, en filant le long de la rive droite, essayer de passer la Seine à l’extrémité de la plaine de Bonnières et prendre ainsi la presqu’île par ses deux points les plus distants. Or la rive droite, en face de la presqu’île de Bonnières, se compose d’un escarpement crayeux, abrupt, qui se rapproche de la Seine à Vétheuil, pour la quitter à la Roche-Guyon au sommet de son coude. Sur ce point, à la Roche-Guyon, l’escarpement n’est éloigné du fleuve que de cent mètres environ ; autrefois il en était plus rapproché encore, la Seine ayant reculé ses rives.


À quelques kilomètres de la Roche-Guyon, en descendant la Seine, nous rencontrons un château dont la position stratégique est plus forte et mieux choisie encore que celle de la Roche-Guyon ; c’est le château Gaillard, près les Andelys. Bâti par Richard Cœur de Lion, après que ce prince eut reconnu la faute qu’il avait faite, par le traité d’Issoudun, en laissant à Philippe-Auguste le Vexin et la ville de Gisors, ce château conserve encore, malgré son état de ruine, l’empreinte du génie militaire du roi anglo-normand. Mauvais politique, Richard était un homme de guerre consommé, et il réparait les fautes de l’homme d’État à force de courage et de persévérance. À notre sens, le château Gaillard des Andelys dévoile une partie des talents militaires de Richard. On est trop disposé à croire que cet illustre prince n’était qu’un batailleur brave jusqu’à la témérité ; ce n’est pas seulement avec les qualités d’un bon soldat, payant largement de sa personne, qu’on acquiert dans l’histoire une aussi grande place. Richard était mieux qu’un Charles le Téméraire, c’était un héros d’une bravoure à toute épreuve ; c’était encore un habile capitaine dont le coup d’œil était sûr, un ingénieur plein de ressources, expérimenté, prévoyant, capable de devancer son siècle, et ne se soumettant pas à la routine. Grâce à l’excellent travail de M. A. Deville sur Château-Gaillard[21], chacun peut se rendre un compte exact des circonstances qui déterminèrent la construction de cette forteresse, la clef de la Normandie, place frontière capable d’arrêter longtemps l’exécution des projets ambitieux du roi français. La rive droite de la Seine étant en la possession de Philippe-Auguste jusqu’aux Andelys, une armée française pouvait, en une journée, se trouver au cœur de la Normandie et menacer Rouen. S’apercevant trop tard de ce danger, Richard voulut en garantir sa province du continent. Avec ce coup d’œil qui n’appartient qu’aux grands capitaines, il choisit l’assiette de la forteresse destinée à couvrir la capitale normande, et une fois son projet arrêté, il en poursuivit l’exécution avec une ténacité et une volonté telles qu’il brisa tous les obstacles opposés à son entreprise, et qu’en un an, non-seulement la forteresse fut bâtie, mais encore un système complet d’ouvrages défensifs fut appliqué, avec un rare talent, sur les rives de la Seine, au point où ce fleuve peut couvrir Rouen contre une armée sortie de Paris. Nous trouvons encore là les qualités qui distinguent les fortifications normandes, mais mises en pratique par un homme de génie. Il s’agit ici non de la défense d’un domaine, mais d’une grande province, d’un point militaire aussi bon pour protéger une capitale contre un ennemi que pour le surprendre et l’attaquer, et cela dans les conditions de délimitation de frontières les plus défavorables. Nos lecteurs voudront bien nous permettre dès lors de nous étendre quelque peu sur la position et la construction du château Gaillard.
De Bonnières à Gaillon, la Seine descend presque en ligne droite vers le nord-nord-ouest. Près de Gaillon, elle se détourne brusquement vers le nord-est jusqu’aux Andelys, puis revient sur elle-même et forme une presqu’île, dont la gorge n’a guère que deux mille six cents mètres d’ouverture. Les Français, par le traité qui suivit la conférence d’Issoudun, possédaient sur la rive gauche Vernon, Gaillon, Pacy-sur-Eure ; sur la rive droite, Gisors, qui était une des places les plus fortes de cette partie de la France. Une armée dont les corps, réunis à Évreux, à Vernon et à Gisors, se seraient simultanément portés sur Rouen, le long de la Seine, en se faisant suivre d’une flottille, pouvait, en deux journées de marche, investir la capitale de la Normandie et s’approvisionner de toutes choses par la Seine. Planter une forteresse à cheval sur le fleuve, entre les deux places de Vernon et de Gisors, en face d’une presqu’île facile à garder, c’était intercepter la navigation du fleuve, couper les deux corps d’invasion, rendre leur communication avec Paris impossible, et les mettre dans la fâcheuse alternative d’être battus séparément avant d’arriver sous les murs de Rouen. La position était donc, dans des circonstances aussi défavorables que celles où se trouvait Richard, parfaitement choisie. La presqu’île de Bernières, située en face les Andelys, pouvant être facilement retranchée à la gorge, appuyée par une place très-forte de l’autre côté du fleuve, permettait l’établissement d’un camp approvisionné par Rouen et que l’on ne pouvait songer à forcer. La ville de Rouen était couverte, et Philippe-Auguste, s’il eût eu l’intention de marcher sur cette place, n’aurait pu le faire sans jeter un regard d’inquiétude sur le château Gaillard qu’il laissait entre lui et la France. Cette courte description fait déjà connaître que Richard était mieux qu’un capitaine d’une bravoure emportée.


Une année avait suffi à Richard pour achever le château Gaillard et toutes les défenses qui s’y rattachaient. « Qu’elle est belle, ma fille d’un an ! » s’écria ce prince lorsqu’il vit son entreprise terminée[26]. L’examen seul de ce plan fait voir que Richard n’avait nullement suivi les traditions normandes dans la construction du château Gaillard, et l’on ne peut douter que non-seulement les dispositions générales mais aussi les détails de la défense n’aient été ordonnés par ce prince. Cet ouvrage avancé très-important qui s’avance en coin vers la langue de terre rappelle les enceintes extérieures du donjon de la Roche-Guyon ; mais le fossé qui sépare cet ouvrage du corps de la place, qui l’isole complètement, les flanquements obtenus par les tours, appartiennent à Richard. Jusqu’alors les flanquements, dans les châteaux des XIe et XIIe siècles, sont faibles, autant que nous pouvons en juger ; les constructeurs paraissent s’être préoccupés de défendre leurs enceintes par l’épaisseur énorme des murs, bien plus que par de bons flanquements. Richard, le premier peut-être, avait cherché un système de défense des murailles indépendant de leur force de résistance passive. Avait-il rapporté d’Orient ces connaissances très-avancées pour son temps ? C’est ce qu’il nous est difficile de savoir. Était-ce un reste des traditions romaines[27] ?… Ou bien ce prince avait-il, à la suite d’observations pratiques, trouvé dans son propre génie les idées dont il fit alors une si remarquable application ?… C’est dans la dernière enceinte du château Gaillard, celle qui entoure le donjon des trois côtés nord, est et sud, que l’on peut surtout reconnaître la mise en pratique des idées ingénieuses de Richard.
Si nous jetons les yeux sur le plan fig. 11, nous remarquerons la configuration singulière de la dernière enceinte elliptique ; c’est une suite de segments de cercle de trois mètres de corde environ, séparés par des portions de courtine d’un mètre seulement.
Le plan d’une portion de la muraille elliptique (fig. 12), est en cela d’un grand intérêt ; son tracé dénote de la part de son auteur un soin, une recherche, une étude et une expérience de l’effet des armes de jet qui ne laissent pas de surprendre. Les portions de cylindre composant cette courtine ne descendent pas verticalement jusqu’à l’escarpe du fossé, mais pénètrent des portions de cônes en se rapprochant de la base, de manière à ce que les angles rentrants compris entre ces cônes et les murs intermédiaires ne puissent masquer un mineur. C’est enfin la ligne tirée dans l’axe des meurtrières latérales A qui a fait poser les points de rencontre B des bases des cônes inférieurs avec le talus du pied de la muraille. De plus, par les meurtrières A on pouvait encore, à cause de la disposition des surfaces courbes, viser un mineur attaché au point tangeant D, ainsi que l’indique la ligne C D.

Si les portions de cylindres eussent été descendues verticalement, ou si ces segments eussent été des portions de cône sans surfaces gauches et sans changements de courbes, ainsi qu’il est indiqué en X, fig. 12 (en ne supposant pas les empattements plus forts que ceux donnés au rempart du château Gaillard, afin de ne pas faciliter l’escalade), les triangles P eussent été à l’abri des traits tirés dans l’axe des meurtrières latérales A. Par ces pénétrations très-subtiles de cylindres et de cônes, visibles dans la fig. 13, Richard découvrit tous les points de la base de la courtine à flanquement continu, ce qui était fort important dans un temps où l’attaque et la défense des places fortes ne devenaient sérieuses que lorsqu’elles étaient très-rapprochées. Aujourd’hui, tous les ingénieurs militaires nous diront que le tracé d’un bastion, ses profils bien ou mal calculés, peuvent avoir une influence considérable sur la conservation plus ou moins longue d’une place attaquée. Ces soins minutieux apportés par Richard dans le tracé de la dernière défense du château Gaillard, défense qui n’était prévue qu’en cas d’une attaque à pied-d’œuvre par la sape et la mine, nous indiquent assez le génie particulier de cet homme de guerre, sachant calculer, prévoir, attachant une importance considérable aux détails les moins importants en apparence, et possédant ainsi ce qui fait les grands hommes, savoir : la justesse du coup d’œil dans les conceptions d’ensemble et le soin, la recherche même, dans l’exécution des détails.
Dans tous ces ouvrages, on ne rencontre aucune sculpture, aucune moulure ; tout a été sacrifié à la défense ; la maçonnerie est bien faite, composée d’un blocage de silex reliés par un excellent mortier revêtu d’un parement de petit appareil exécuté avec soin et présentant sur quelques points des assises alternées de pierres blanches et rousses.
Tant que vécut Richard, Philippe-Auguste, malgré sa réputation bien acquise de grand preneur de forteresses, n’osa tenter de faire le siége du château Gaillard ; mais après la mort de ce prince, et lorsque la Normandie fut tombée aux mains de Jean sans Terre, le roi français résolut de s’emparer de ce point militaire qui lui ouvrait les portes de Rouen. Le siège de cette place, raconté jusque dans les plus menus détails par le chapelain du roi Guillaume le Breton, témoin oculaire, fut un des plus grands faits militaires du règne de ce prince ; et si Richard avait montré un talent remarquable dans les dispositions générales et dans les détails de la défense de cette place, Philippe-Auguste conduisit son entreprise en homme de guerre consommé.
Le triste Jean sans Terre ne sut pas profiter des dispositions stratégiques de son prédécesseur. Philippe-Auguste, en descendant la Seine, trouve la presqu’île de Bernières inoccupée ; les troupes normandes, trop peu nombreuses pour la défendre, se jettent dans le châtelet de l’île et dans le petit Andely, après avoir rompu le pont de bois qui mettait les deux rives du fleuve en communication. Le roi français commence par établir son campement dans la presqu’île, en face du château, appuyant sa gauche au village de Bernières et sa droite à Toëni (voy. fig. 10), en réunissant ces deux postes par une ligne de circonvallation dont on aperçoit encore aujourd’hui la trace K L. Afin de pouvoir faire arriver la flottille destinée à l’approvisionnement du camp, Philippe fait rompre par d’habiles nageurs l’estacade qui barre le fleuve, et cela sous une grêle de projectiles lancés par l’ennemi[30].
« Aussitôt après, dit Guillaume le Breton, le roi ordonne d’amener de larges navires, tels que nous en voyons voguer sur le cours de la Seine, et qui transportent ordinairement les quadrupèdes et les chariots le long du fleuve. Le roi les fit enfoncer dans le milieu du fleuve, en les couchant sur le flanc, et les posant immédiatement l’un à la suite de l’autre, un peu au-dessous des remparts du château ; et, afin que le courant rapide des eaux ne pût les entraîner, on les arrêta à l’aide de pieux enfoncés en terre et unis par des cordes et des crochets. Les pieux ainsi dressés, le roi fit établir un pont sur des poutres soigneusement travaillées, » afin de pouvoir passer sur la rive droite… « Puis il fit élever sur quatre navires deux tours, construites avec des troncs d’arbres et de fortes pièces de chêne vert, liés ensemble par du fer et des chaînes bien tendues, pour en faire en même temps un point de défense pour le pont et un moyen d’attaque contre le châtelet. Puis les travaux, dirigés avec habileté sur ces navires, élevèrent les deux tours à une si grande hauteur, que de leur sommet les chevaliers pouvaient faire plonger leurs traits sur les murailles ennemies » (celles du châtelet situé au milieu de l’île).
Cependant Jean sans Terre tenta de secourir la place : il envoya un corps d’armée composé de trois cents chevaliers et trois mille hommes à cheval, soutenus par quatre mille piétons et la bande du fameux Lupicar[31]. Cette troupe se jeta la nuit sur les circonvallations de Philippe-Auguste, mit en déroute les ribauds, et eût certainement jeté dans le fleuve le camp des Français s’ils n’eussent été protégés par le retranchement et si quelques chevaliers, faisant allumer partout de grands feux, n’eussent rallié un corps d’élite qui, reprenant l’offensive, rejeta l’ennemi en dehors des lignes. Une flottille normande qui devait opérer simultanément contre les Français arriva trop tard ; elle ne put détruire les deux grands beffrois de bois élevés au milieu de la Seine, et fut obligée de se retirer avec de grandes pertes.
« Un certain Galbert, très-habile nageur, continue Guillaume le Breton, ayant rempli des vases avec des charbons ardents, les ferma et les frotta de bitume à l’extérieur avec une telle adresse, qu’il devenait impossible à l’eau de les pénétrer. Alors il attache autour de son corps la corde qui suspendait ces vases, et plongeant sous l’eau, sans être vu de personne, il va secrètement aborder aux palissades élevées en bois et en chêne, qui enveloppaient d’une double enceinte les murailles du châtelet. Puis, sortant de l’eau, il va mettre le feu aux palissades, vers le côté de la roche Gaillard qui fait face au château, et qui n’était défendu par personne, les ennemis n’ayant nullement craint une attaque sur ce point… Tout aussitôt le feu s’attache aux pièces de bois qui forment les retranchements et aux murailles qui enveloppent l’intérieur du chatelet. » La petite garnison de ce poste ne pouvant combattre les progrès de l’incendie, activée par un vent d’est violent, dut se retirer comme elle put sur des bateaux. Après ces désastres, les habitants du petit Andely n’osèrent tenir, et Philippe-Auguste s’empara en même temps et du châtelet et du bourg dont il fit réparer les défenses pendant qu’il rétablissait le pont. Ayant mis une troupe d’élite dans ces postes, il alla assiéger le château de Radepont, pour que ses fourrageurs ne fussent pas inquiétés par sa garnison, s’en empara au bout d’un mois et revint au château Gaillard. Mais laissons encore parler Guillaume le Breton, car les détails qu’il nous donne des préparatifs de ce siége mémorable sont du plus grand intérêt.
« La roche Gaillard cependant n’avait point à redouter d’être prise à la suite d’un siége, tant à cause de ses remparts, que parce qu’elle est environnée de toutes parts de vallons, de rochers taillés à pic, de collines dont les pentes sont rapides et couvertes de pierres, en sorte que, quand même elle n’aurait aucune autre espèce de fortification, sa position naturelle suffirait seule pour la défendre. Les habitants du voisinage s’étaient donc réfugiés en ce lieu, avec tous leurs effets, afin d’être plus en sûreté. Le roi, voyant bien que toutes les machines de guerre et tous les assauts ne pourraient le mettre en état de renverser d’une manière quelconque les murailles bâties sur le sommet du rocher, appliqua toute la force de son esprit à chercher d’autres artifices pour parvenir, à quelque prix que ce fût, et quelque peine qu’il dût lui en coûter, à s’emparer de ce nid dont toute la Normandie est si fière.
« Alors donc le roi donne l’ordre de creuser en terre un double fossé sur les pentes des collines et à travers les vallons (une ligne de contrevallation et de circonvallation), de telle sorte que toute l’enceinte de son camp soit comme enveloppée d’une barrière qui ne puisse être franchie, faisant, à l’aide de plus grands travaux, conduire ces fossés depuis le fleuve jusqu’au sommet de la montagne, qui s’élève vers les cieux, comme en mépris des remparts abaissés sous elle[32], et plaçant ces fossés à une assez grande distance des murailles (du château) pour qu’une flèche, lancée vigoureusement d’une double arbalète, ne puisse y atteindre qu’avec peine. Puis, entre ces deux fossés, le roi fait élever une tour de bois et quatorze autres ouvrages du même genre, tous tellement bien construits et d’une telle beauté, que chacun d’eux pouvait servir d’ornement à une ville, et dispersés en outre de telle sorte, qu’autant il y a de pieds de distance entre la première et la seconde tour, autant on en retrouve encore de la seconde à la troisième… Après avoir garni toutes ces tours de serviteurs et de nombreux chevaliers, le roi fait en outre occuper tous les espaces vides par ses troupes, et, sur toute la circonférence, disposant les sentinelles de telle sorte qu’elles veillent toujours, en alternant d’une station à l’autre ; ceux qui se trouvaient ainsi en dehors s’appliquèrent alors, selon l’usage des camps, à se construire des cabanes avec des branches d’arbre et de la paille sèche, afin de se mettre à l’abri de la pluie, des frimas et du froid, puisqu’ils devaient demeurer longtemps en ces lieux. Et, comme il n’y avait qu’un seul point par où l’on pût arriver vers les murailles (du château), en suivant un sentier tracé obliquement et qui formait diverses sinuosités[33], le roi voulut qu’une double garde veillât nuit et jour et avec le plus grand soin à la défense de ce point, afin que nul ne pût pénétrer du dehors dans le camp, et que personne n’osât faire ouvrir les portes du château ou en sortir, sans être aussitôt ou frappé de mort, ou fait prisonnier… »
Pendant tout l’hiver de 1203 à 1204, l’armée française resta dans ses lignes. Roger de Lascy, qui commandait dans le château pour Jean sans Terre, fut obligé, afin de ménager ses vivres, de chasser les habitants du petit Andely qui s’étaient mis sous sa protection derrière les remparts de la forteresse. Ces malheureux, repoussés à la fois par les assiégés et les assiégeants, moururent de faim et de misère dans les fossés, au nombre de douze cents.
Au mois de février 1204, Philippe-Auguste, qui sait que la garnison du château Gaillard conserve encore pour un an de vivres, « impatient en son cœur, » se décide à entreprendre un siége en règle. Il réunit la plus grande partie de ses forces sur le plateau dominant, marqué R sur notre fig. 10. De là il fait faire une chaussée pour aplanir le sol jusqu’au fossé en avant de la tour A (fig. 11)[34]. « Voici donc, du sommet de la montagne, jusqu’au fond de la vallée, et au bord des premiers fossés, la terre est enlevée à l’aide de petits hoyaux, et reçoit l’ordre de se défaire, de ses aspérités rocailleuses, afin que l’on puisse descendre du haut jusqu’en bas. Aussitôt un chemin, suffisamment large et promptement tracé à force de coups de hache, se forme à l’aide de poutres posées les unes à côté des autres et soutenues des deux côtés par de nombreux poteaux en chêne plantés en terre pour faire une palissade. Le long de ce chemin, les hommes, marchant en sûreté, transportent des pierres, des branches, des troncs d’arbres, de lourdes mottes de terre garnies d’un gazon verdoyant, et les rassemblent en monceaux, pour travailler à combler le fossé… (14)[35]…
« À l’extrémité de la Roche et dans la direction de l’est (sud-est), était une tour élevée (la tour A, fig. 11), flanquée des deux côtés par un mur qui se terminait par un angle saillant au point de sa jonction. Cette muraille se prolongeait sur une double ligne depuis le plus grand des ouvrages avancés (la tour A) et enveloppait les deux flancs de l’ouvrage le moins élevé[36]. Or voici par quel coup de vigueur nos gens parvinrent à se rendre d’abord maîtres de cette tour (A). Lorsqu’ils virent le fossé à peu près comblé, ils y établirent leurs échelles et y descendirent promptement. Impatients de tout retard, ils transportèrent alors leurs échelles vers l’autre bord du fossé, au-dessus duquel se trouvait la tour fondée sur le roc. Mais nulle échelle, quoiqu’elles fussent assez longues, ne se trouva suffisante pour atteindre au pied de la muraille, non plus qu’au sommet du rocher, d’où partait le pied de la tour. Remplis d’audace, nos gens se mirent à percer alors dans le roc, avec leurs poignards ou leurs épées, pour y faire des trous où ils pussent poser leurs pieds et leurs mains, et, se glissant ainsi le long des aspérités du rocher, ils se trouvèrent tout à coup arrivés au point où commençaient les fondations de la tour[37]. Là, tendant les mains à ceux de leurs compagnons qui se traînaient sur leurs traces, ils les appellent à participer à leur entreprise ; et, employant des moyens qui leur sont connus, ils travaillent alors à miner les flancs et les fondations de la tour, se couvrant toujours de leurs boucliers, de peur que les traits lancés sur eux sans relâche ne les forcent à reculer, et se mettant ainsi à l’abri jusqu’à ce qu’il leur soit possible de se cacher dans les entrailles mêmes de la muraille, après avoir creusé au-dessous. Alors ils remplissent ces creux de troncs d’arbres, de peur que cette partie du mur, ainsi suspendue en l’air, ne croule sur eux et ne leur fasse beaucoup de mal en s’affaissant ; puis aussitôt qu’ils ont agrandi cette ouverture, ils mettent le feu aux arbres et se retirent en un lieu de sûreté. » Les étançons brûlés, la tour s’écroule en partie. Roger, désespérant alors de s’opposer à l’assaut, fait mettre le feu à l’ouvrage avancé et se retire dans la seconde enceinte. Les Français se précipitent sur les débris fumants de la brèche, et un certain Cadoc, chevalier, plante le premier sa bannière au sommet de la tour à demi renversée. Le petit escalier de cette tour, visible dans notre plan, date de la construction première ; il avait dû, à cause de sa position enclavée, rester debout. C’est probablement par là que Cadoc put atteindre le parapet resté debout.
Mais les Normands s’étaient retirés dans le château séparé de l’ouvrage avancé par un profond et large fossé. Il fallait entreprendre un nouveau siége. « Jean avait fait construire l’année précédente une certaine maison, contiguë à la muraille et placée du côté droit du château, en face du midi[38]. La partie inférieure de cette maison était destinée à un service qui veut toujours être fait dans le mystère du cabinet[39], et la partie supérieure, servant de chapelle, était consacrée à la célébration de la messe : là il n’y avait point de porte au dehors, mais en dedans (donnant sur la cour) il y en avait une par où l’on arrivait à l’étage supérieur, et une autre qui conduisait à l’étage inférieur. Dans cette dernière partie de la maison était une fenêtre prenant jour sur la campagne et destinée à éclairer les latrines. » Un certain Bogis, ayant avisé cette fenêtre, se glissa le long du fond du fossé, accompagné de quelques braves compagnons, et s’aidant mutuellement, tous parvinrent à pénétrer par cette fenêtre dans le cabinet situé au rez-de-chaussée. Réunis dans cet étroit espace, ils brisent les portes, l’alarme se répand parmi la garnison occupant la basse-cour, et croyant qu’une troupe nombreuse envahit le bâtiment de la chapelle, les défenseurs accumulent des fascines et y mettent le feu pour arrêter l’assaillant ; mais la flamme se répand dans la seconde enceinte du château, Bogis et ses compagnons passent à travers le logis incendié et vont se réfugier dans les grottes marquées G sur notre plan (fig. 11). Roger de Lascy et les défenseurs, réduits au nombre de cent quatre-vingt, sont obligés de se réfugier dans la dernière enceinte, chassés par le feu. « À peine cependant la fumée a-t-elle un peu diminué, que Bogis sortant de sa retraite, et courant à travers les charbons ardents, aidé de ses compagnons, coupe les cordes et abat, en le faisant rouler sur son axe, le pont mobile qui était encore relevé[40], afin d’ouvrir un chemin aux Français pour sortir par la porte. Les Français donc s’avancent en hâte et se préparent à assaillir la haute citadelle dans laquelle l’ennemi venait de se retirer en fuyant devant Bogis.
« Au pied du rocher par lequel on arrivait à cette citadelle était un pont taillé dans le roc vif[41], que Richard avait fait ainsi couper autrefois, en même temps qu’il fit creuser les fossés. Ayant fait glisser une machine sur ce pont[42], les nôtres vont, sous sa protection, creuser au pied de la muraille. De son côté, l’ennemi travaille aussi à pratiquer une contre-mine, et ayant fait une ouverture, il lance des traits contre nos mineurs et les force ainsi à se retirer[43]. Les assiégés cependant n’avaient pas tellement entaillé leur muraille qu’elle fût menacée d’une chute ; mais bientôt une catapulte lance contre elle d’énormes blocs de pierre. Ne pouvant résister à ce choc, la muraille se fend de toutes parts, et, crevant par le milieu, une partie du mur s’écroule… » Les Français s’emparent de la brèche, et la garnison, trop peu nombreuse désormais pour défendre la dernière enceinte, enveloppée, n’a même pas le temps de se réfugier dans le donjon et de s’y enfermer. C’était le 6 mars 1204. C’est ainsi que Philippe-Auguste s’empara de ce château, que ses contemporains regardaient comme imprenable.
Si nous avons donné à peu près en entier la description de ce siége mémorable écrit par Guillaume le Breton, c’est qu’elle met en évidence un fait curieux dans l’histoire de la fortification des châteaux. Le château Gaillard, malgré sa situation, malgré l’habileté déployée par Richard dans les détails de la défense, est trop resserré ; les obstacles accumulés sur un petit espace devaient nuire aux défenseurs en les empêchant de se porter en masse sur le point attaqué. Richard avait abusé des retranchements, des fossés intérieurs ; les ouvrages amoncelés les uns sur les autres servaient d’abri aux assaillants, qui s’en emparaient successivement ; il n’était plus possible de les déloger ; en se massant derrière ces défenses acquises, ils pouvaient s’élancer en force sur les points encore inattaqués, trop étroits pour être garnis de nombreux soldats. Contre une surprise, contre une attaque brusque tentée par un corps d’armée peu nombreux, le château Gaillard était excellent ; mais contre un siége en règle dirigé par un général habile et soutenu par une armée considérable et bien munie d’engins, ayant du temps pour prendre ses dispositions et des hommes en grand nombre pour les mettre à exécution sans relâche, il devait tomber promptement du moment que la première défense était forcée ; c’est ce qui arriva. Il ne faut pas moins reconnaître que le château Gaillard n’était que la citadelle d’un vaste ensemble de fortifications étudié et tracé de main de maître, que Philippe-Auguste, armé de toute sa puissance, avait dû employer huit mois pour le réduire, et qu’enfin Jean sans Terre n’avait fait qu’une tentative pour le secourir. Du vivant de Richard, l’armée française, harcelée du dehors, n’eût pas eu le loisir de disposer ses attaques avec cette méthode ; elle n’aurait pu conquérir cette forteresse importante, le boulevard de la Normandie, qu’au prix de bien plus grands sacrifices, et peut-être eût-elle été obligée de lever le siége du château Gaillard avant d’avoir pu entamer ses ouvrages extérieurs. Dès que Philippe se fut emparé de ce point stratégique si bien choisi par Richard, Jean sans Terre ne songea plus qu’à évacuer la Normandie, ce qu’il fit peu de temps après, sans même tenter de garder les autres forteresses qui lui restaient encore en grand nombre dans sa province, tant l’effet moral produit par la prise du château Gaillard fut décisif[44].
Nous avons dû nous occuper des châteaux normands des XIe et XIIe siècles de préférence à tous ceux qui furent élevés pendant cette période dans les autres provinces de la France, parce que ces châteaux ont un caractère particulier, qu’ils diffèrent en beaucoup de points des premières forteresse du moyen âge bâties pendant le même temps sur le sol français, et surtout parce qu’ils nous semblent avoir fait faire un pas considérable à l’art de la fortification.
Au XIIIe siècle, les châteaux français semblent avoir profité des dispositions de détails prises par les Normands dans leurs châteaux, mais en conservant cependant quelque chose des traditions mérovingiennes et carlovingiennes. Nous en trouvons un exemple remarquable dans le château de Montargis, dont la construction remontait au XIIIe siècle et dont nous donnons le plan (15).

Bâti en plaine, il commandait la route de Paris à Orléans qui passait sous les portes défendues A et B. Des fossés S enveloppaient les défenses extérieures. La route était battue de flanc par un front flanqué de tours et communiquait au château par une porte C (voy. Porte). Une autre porte D, passant à travers une grosse tour isolée (suivant une méthode qui appartient à la Loire, et que nous voyons surtout pratiquée au XIVe siècle dans la basse Loire et la Bretagne par le connétable Olivier de Clisson), était d’un accès très-difficile.
Quant aux dispositions intérieures du château, elles sont d’un grand intérêt et indiquent nettement les moyens défensifs des garnisons des châteaux français. Les tours sont très-saillantes sur les courtines, afin de les bien flanquer ; au nord, point saillant, et faible par conséquent, était élevé un gros ouvrage présentant deux murs épais élevés l’un derrière l’autre, éperonnés par un mur de refend flanqué de deux tours d’un diamètre plus fort que les autres. En G était la grand’salle, à deux étages, dans laquelle toute la garnison pouvait être réunie pour recevoir des ordres, et de là se répandre promptement sur tous les points de l’enceinte par un escalier à trois rampes I. La réunion de cet escalier à la grand’salle pouvait être coupée, et la grand’salle servir de retrait si l’enceinte était forcée. La grand’salle est un des traits caractéristiques du château français, ainsi que nous l’avons dit au commencement de cet article. Dans le château normand, la grand’salle est située dans le donjon, ou plutôt le donjon n’est que la grand’salle devenue défense principale.
Dans le château français du XIIIe siècle, la grand’salle se distingue du donjon ; c’est le lieu de réunion des hommes d’armes du seigneur franc ; il y a là un dernier souvenir des mœurs du chef germain et de ses compagnons.
Le gros donjon F est au centre de la cour, comme dans le château primitif du moyen âge (fig. 1) ; il est à plusieurs étages, avec une cour circulaire au centre ; il était mis en communication avec la grand’salle, au premier étage, au moyen d’une galerie K, pouvant être de même coupée à son extrémité. Ce donjon commandait toute l’enceinte et ses bâtiments ; mais, n’ayant pas de sortie sur les dehors comme le donjon normand, il n’offrait pas les mêmes avantages pour la défense. La garnison était casernée dans les bâtiments L du côté où l’enceinte était le plus accessible. En O étaient les écuries, la boulangerie, les magasins ; en H la chapelle, et en N un poste à proximité de l’entrée D. Les petits bâtiments qui entouraient le donjon étaient d’une date postérieure à sa construction. La poterne E donnait accès dans de vastes jardins entourés eux-mêmes d’une enceinte[45].
En France et en Normandie, dès l’époque carlovingienne, les enceintes des châteaux étaient flanquées de tours. Mais sur les bords du Rhin et les provinces voisines de la Germanie, il ne paraît pas que ce moyen de défense ait été usité avant le XIIIe siècle, ce qui ferait supposer que les tours flanquantes étaient une tradition gallo-romaine.
« Les monuments féodaux du Xe siècle jusqu’aux croisades, dit M. de Krieg[46], ont, sur les deux rives du Rhin, leur type commun. On y trouve d’abord la tour carrée (rarement cylindrique) qui est ou assise sur des soubassements romains, ou copiée religieusement d’après ces modèles, avec leur socle, leur porte d’entrée au-dessus du sol et leur plate-forme. Ces tours ont pris le nom allemand de berch frid, en latin berefredus, en français beffroi… Les enceintes de ces plus anciens châteaux manquent absolument de flanquement extérieur. Elles sont surmontées d’une couronne de merlons… »
Nous irons plus loin que M. de Krieg, et nous dirons même que les tours employées comme moyen de flanquement des enceintes ne se rencontrent que très-rarement dans les châteaux des bords du Rhin et des Vosges avant le XVe siècle. Le château de Saint-Ulrich, la partie ancienne du château de Hohenkœnigsbourg, le château de Kœnigsheim, celui de Spesbourg, bien que bâtis pendant les XIIIe et XIVe siècles, sont totalement dépourvus de tours flanquantes[47]. Ce sont des bâtiments formant des angles saillants, des figures géométriques rectilignes à l’extérieur et venant se grouper autour du donjon ou beffroi. La plupart de ces châteaux, élevés sur des points inaccessibles, prennent toute leur force dans la situation de leur assiette et ne sont que médiocrement défendus. Le donjon surmontant les bâtiments permettait de découvrir au loin la présence d’un ennemi, et la garnison, prévenue, pouvait facilement empêcher l’escalade de rampes abruptes, barrer les sentiers et arrêter un corps d’armée nombreux loin du château, sans même être obligée de se renfermer derrière ses murs.
Cependant des situations analogues n’empêchaient pas les seigneurs français de munir de tours les flancs et angles saillants de leurs châteaux pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles.
Il se fit, dans la construction des châteaux, au XIIIe siècle, une révolution notable. Jusqu’alors ces résidences ne consistaient, comme nous l’avons vu, que dans des enceintes plus ou moins étendues, simples ou doubles, au milieu desquelles s’élevaient le donjon qui servait de demeure seigneuriale et la salle quelquefois comprise dans le donjon même. Les autres bâtiments n’étaient que des appentis en bois séparés les uns des autres, ayant plutôt l’apparence d’un cantonnement que d’une résidence fixe. La chapelle, les réfectoires, cuisines, magasins et écuries étaient placés dans l’intérieur de l’enceinte et ne se reliaient en aucune façon aux fortifications. Nous avons vu que, dans le plan du château de Montargis (fig. 15), déjà les bâtiments de service sont attenants aux murailles, qu’ils sont bâtis dans un certain ordre et que ce sont des logis fixes. Il semblerait qu’au XIIIe siècle les habitudes des seigneurs et de leurs gens, plus civilisés, demandaient des dispositions moins barbares que celles acceptées jusqu’alors. Nous voyons combien les logis fixes ont peu d’importance encore dans le château Gaillard, résidence souveraine élevée à la fin du XIIe siècle. On a peine à comprendre comment une garnison de quelques centaines d’hommes pouvait vivre dans cet étroit espace, presque exclusivement occupé par les défenses. Les soldats devaient coucher pêle-mêle dans les tours et sous quelques appentis adossés aux murailles.
En Angleterre, où les documents écrits abondent sur les habitations seigneuriales anciennes, on trouve les preuves de cette révolution apportée par le XIIIe siècle. À cette époque, les résidences royales fortifiées reçoivent de nombreuses adjonctions en bâtiments élevés avec un certain luxe, les châteaux des barons prennent un caractère plus domestique ; souvent même le donjon, ainsi que le dit M. Parker dans son Architecture domestique[48], fut abandonné pour une salle et des chambres construites dans l’enceinte intérieure. C’est à cause de ce changement que, dans presque toutes les descriptions de châteaux bâtis du temps de Henri III et d’Edward Ier, les grandes tours ou donjons sont représentés comme étant dans un état délabré et généralement sans couvertures. Ils avaient été abandonnés, comme habitation, à cause de leur peu de commodité, bien que par la force de leur construction ils pussent encore, moyennant quelques réparations, être employés en temps de guerre. Les ordres de restaurations aux « maisons royales » dans divers châteaux sont très-nombreux pendant le XIIIe siècle. Ces ordres ne s’appliquent pas aux châteaux d’Edward (Edwardian castles), édifices généralement bâtis par Edward Ier, et dans lesquels de nombreux appartements destinés à différents usages étaient disposés suivant un plan général, mais bien aux châteaux de date normande, qui dès lors prirent un caractère d’habitation par des constructions plus récentes. Les ordres donnés par Henri III pour les réparations et additions aux manoirs royaux prouvent qu’aucun plan systématique n’était adopté lorsqu’il s’agissait de ces adjonctions. Lorsqu’une grande surface de terrain était entourée d’une clôture fortifiée et formait ce que l’on appelait une cour (curia), dans laquelle le logis primitif était insuffisant, il devint assez ordinaire, au XIIIe siècle, d’augmenter ce logement, selon les besoins, en élevant successivement de nouvelles constructions, telles que chambres, chapelles, cuisines, qui d’abord furent semées çà et là sur la surface de l’enclos. Lorsqu’un certain nombre de ces bâtiments avaient ainsi été appropriés ou créés, on les réunissait successivement par des passages couverts (aleia) construits en bois, quelquefois en façon de portiques ouverts, mais plus souvent fermés sur les côtés. Ces bâtiments étaient jetés au milieu des enceintes, laissant les défenses libres, comme le serait un bourg ou village enclos de murs. Au XIIIe siècle, les services se relient davantage à l’enceinte même, que les bâtiments intérieurs contribuent à renforcer ; c’est seulement alors qu’apparaît le château sous le rapport architectonique, les établissements antérieurs n’étant que des défenses plus ou moins fortes et étendues enveloppant des habitations et des bâtiments de service de toute nature et de dimensions fort diverses sans aucune idée d’ensemble. Le XIIIe siècle vit élever de magnifiques châteaux qui joignaient à leurs qualités de forteresses celles de résidences magnifiques abondamment pourvues de leurs services et de tout ce qui est nécessaire à la vie d’un seigneur vivant au milieu de son domaine entouré d’une petite cour et d’une garnison.
À partir de saint Louis, la féodalité décroît ; elle est absorbée par la royauté d’une part, et entamée par le peuple de l’autre ; les édifices qu’elle élève se ressentent naturellement de cette situation politique ; ils se dressent sur le sol lorsqu’elle reprend de l’influence ; ils sont plus rares ou plus pauvres lorsque le pouvoir royal et l’organisation nationale prennent de la force et se constituent. À la mort de Philippe-Auguste, en 1223, la féodalité, qui avait aidé ce prince à réunir à la couronne les plus belles provinces de France, se trouvait riche et puissante ; à l’exemple du roi, quelques grands vassaux avaient absorbé nombre de fiefs, soit par des alliances, soit comme prix de leurs services, soit par suite de la ruine des nobles qui avaient tout perdu pendant les croisades du XIIe siècle. Pendant les premières années de la minorité de saint Louis, il s’était formé, comme chacun sait, une ligue formidable contre la couronne de France gardée par une femme encore jeune et dont on ne soupçonnait pas les grandes qualités politiques. Parmi les vassaux de la couronne de France coalisés contre le roi enfant, un des plus puissants était Enguerrand III, sire de Coucy, seigneur de Saint-Gobain, d’Assis, de Marle, de la Fère, de Folembray, etc. Son esprit indomptable, son caractère indépendant étaient excités par d’immenses richesses ; un instant ce vassal pensa pouvoir mettre la main sur la couronne de France ; mais ses sourdes menées et ses projets ambitieux furent déjoués par la politique adroite de la reine Blanche, qui sut enlever à la coalition féodale un de ses plus puissants appuis, le comte de Champagne. Le sire de Coucy fut bientôt obligé de prêter serment de fidélité entre les mains du roi, qui ne voulut pas se souvenir de ses projets. C’est à l’époque des rêves ambitieux d’Enguerrand III qu’il faut faire remonter la construction du château magnifique dont nous voyons encore les ruines gigantesques. Le château de Coucy dut être élevé très-rapidement, ainsi que l’enceinte de la ville qui l’avoisine, de 1225 à 1230. Le caractère de la sculpture, les profils, ainsi que la construction, ne permettent pas de lui assigner une époque plus ancienne ni plus récente[49].
Le château de Coucy n’est plus une enceinte flanquée enveloppant des bâtiments disposés au hasard ; c’est un édifice vaste, conçu d’ensemble et élevé d’un seul jet, sous une volonté puissante et au moyen de ressources immenses. Son assiette est admirablement choisie et ses défenses disposées avec un art dont la description ne donne qu’une faible idée[50].
Bâti à l’extrémité d’un plateau de forme très-irrégulière, le château de Coucy domine des escarpements assez roides qui s’élèvent de cinquante mètres environ au-dessus d’une riche vallée, terminée au nord-ouest par la ville de Noyon et au nord-nord-est par celle de Chauny ; il couvre une surface de dix mille mètres environ. Entre la ville et le château est une vaste basse-cour fortifiée, dont la surface est triple au moins de celle occupée par le château. Cette basse-cour renfermait des salles assez étendues dont il reste des amorces visibles encore aujourd’hui, enrichies de colonnes et chapiteaux sculptés, avec voûtes d’arêtes, des écuries et une chapelle orientée tracée en A sur notre plan du rez-de-chaussée (16).
Les magasins N, au premier étage, portaient la grand’salle éclairée sur les dehors. En O, les soubassements de la chapelle qui, au premier étage, se trouvait de plain-pied avec la grand’salle. Les cuisines étaient très-probablement placées en P, avec escalier particulier P′ communiquant aux caves ; elles possédaient une cour particulière en R à laquelle on arrivait sous la chapelle dont le rez-de-chaussée reste à jour. Les tours C, D, S, T possèdent deux étages de caves et trois étages de salles au-dessus du sol, sans compter l’étage des combles. Elles sont, comme on le remarquera, très-saillantes sur les courtines, de manière à les bien flanquer. Ces tours, qui n’ont pas moins de dix-huit mètres de diamètre hors œuvre sur trente-cinq mètres de hauteur environ au-dessus du sol extérieur, ne sont rien auprès du donjon qui porte trente-un mètres de diamètre hors œuvre sur soixante-quatre mètres depuis le fond du fossé jusqu’au couronnement. Outre son fossé, ce donjon possède une enceinte circulaire extérieure ou chemise qui le protège contre les dehors du côté de la basse-cour. On montait du sol de la cour au chemin de ronde de la chemise par la rampe V, près l’entrée du donjon. On communiquait des salles P, au moyen d’un escalier, au fond du fossé de la chemise, avec les dehors par une poterne percée en X, munie de vantaux, de machicoulis et de herses, correspondant à une seconde poterne Y avec pont-levis donnant sur l’escarpement et masquée par la tour C. Un chemin de ronde inférieur X′ voûté en demi-berceau percé au niveau du fond du fossé suit la circonférence de la courtine, et était évidemment destiné à arrêter les travaux des mineurs, comme nos galeries de contre-mine permanentes ménagées sous les revêtements des courtines et bastions. Dans ce souterrain en X″ se trouve une source excellente à fleur de terre, à l’usage de la cuisine. En W sont des latrines prises aux dépens de l’épaisseur du mur de la chemise, pour les gardes de cette enceinte et les gens de cuisine. En Z était une cage avec escalier de bois pouvant être détruit facilement, qui mettait le souterrain intérieur en communication avec le chemin de ronde supérieur. Le petit escalier Q donnant dans la salle P desservait la herse et le machicoulis de la poterne X. Le souterrain inférieur X′ se trouvait encore en communication avec l’escalier U desservant les ouvrages supérieurs de la porte. Si l’assiégeant s’était emparé de la poterne X (ce qui était difficile, puisqu’il fallait franchir la première porte Y et son pont-levis, traverser le chemin Y X sous les projectiles lancés de la partie supérieure de la chemise et du crénelage ouvert sur le mur J, forcer deux vantaux et affronter un machicoulis), il se trouvait en face la herse donnant sur le fond du fossé de la chemise, ayant à sa gauche la porte ferrée qui fermait le bas de l’escalier de la cuisine, et arrêté dans la galerie inférieure X′ par la source X″ qui est un véritable puits dans un souterrain obscur. S’il forçait la herse, il pénétrait dans le fond du fossé intérieur V′, lequel est dallé et sans communication avec le sol de la cour ; battu par les défenses supérieures du donjon qui lui envoyaient des projectiles d’une hauteur de 60 mètres et par le chemin de ronde de la courtine, il était perdu, d’autant plus que les hommes occupant ce chemin de ronde pouvaient descendre par l’escalier Z, passer dans le souterrain X′, traverser la source sur une planche, et lui couper la retraite en reprenant la poterne derrière lui. Si, du fond du fossé extérieur, il parvenait à miner le pied de la chemise, il trouvait le souterrain occupé ; ce travail de sape ne pouvait en aucune façon affaiblir les murs de la chemise, car on remarquera que ce souterrain est pris aux dépens d’un talus, d’un soubassement, derrière lequel la maçonnerie de la chemise reste intacte.
De toutes les défenses du château de Coucy, le donjon est de beaucoup la plus forte et la mieux traitée. Cette belle construction mérite une étude particulière, que nous développons à l’article Donjon.
Les tours et donjon du château de Coucy sont garnis, dans leur partie supérieure, de corbeaux saillants en pierre destinés à recevoir des hourds en bois (voy. Hourd). À la fin du XIVe siècle, la grand’salle et les bâtiments d’habitation M furent reconstruits, ainsi que les étages supérieurs de la porte ; des jours plus larges furent percés à l’extérieur, et les courtines reçurent des machicoulis avec parapets en pierre, suivant la méthode du temps, au lieu des consoles avec hourds en bois. Les autres parties du château restèrent telles qu’Enguerrand III les avait laissées.
Ce ne fut que pendant les troubles de la Fronde que cette magnifique résidence seigneuriale fut entièrement ravagée. Son gouverneur, nommé Hébert, fut sommé, par le cardinal Mazarin, de rendre la place entre les mains du maréchal d’Estrée, gouverneur de Laon. Hébert ayant résisté à cette sommation, en prétextant d’ordres contraires laissés par le roi Louis XIII, le siége fut mis, le 10 mai 1652, devant la ville, qui fut bientôt prise ; puis, quelque temps après, la garnison du château se vit contrainte de capituler. Le cardinal Mazarin fit immédiatement démanteler les fortifications. Le sieur Métezeau, fils de l’ingénieur qui construisit la digue de la Rochelle, fut celui que le cardinal envoya à Coucy pour consommer cette œuvre de destruction. Au moyen de la mine, il fit sauter la partie antérieure de la chemise du donjon et la plupart de celles des autres tours, incendia les bâtiments du château et le rendit inhabitable. Depuis lors, les habitants de Coucy, jusqu’à ces derniers temps, ne cessèrent de prendre dans l’enceinte du château les pierres dont ils avaient besoin pour la construction de leurs maisons, et cette longue destruction compléta l’œuvre de Mazarin. Cependant, malgré ces causes de ruine, la masse du château de Coucy est encore debout et est restée une des plus imposantes merveilles de l’époque féodale[52]. Si on eût laissé au temps seul la tâche de dégrader la résidence seigneuriale des sires de Coucy, nous verrions encore aujourd’hui ces énormes constructions dans toute leur splendeur primitive, car les matériaux, d’une excellente qualité, n’ont subi aucune altération ; les bâtisses étaient conçues de manière à durer éternellement, et les peintures intérieures, dans les endroits abrités, sont aussi fraîches que si elles venaient d’être faites[53].
Autant qu’on peut le reconnaître dans la situation actuelle, le château de Coucy est traversé dans ses fondations par de nombreux et vastes souterrains, qui semblent avoir été systématiquement disposés pour établir des communications cachées entre tous les points de la défense intérieure et les dehors. La tradition va même jusqu’à prétendre qu’un de ces souterrains, dont l’entrée se voit dans les grandes caves sous les bâtiments d’habitation M, se dirigeait à travers les coteaux et vallées jusqu’à l’abbaye de Prémontré. Nous sommes loin de garantir le fait, d’autant que des légendes semblables s’attachent aux ruines de tous les châteaux du moyen âge en France ; mais il est certain que de tous côtés, dans les cours, on aperçoit des bouches de galeries voûtées qui sont aujourd’hui remplies de décombres[54].
Nous donnons (17) le plan du premier étage du château de Coucy. On voit en A les logis placés au-dessus de la porte d’entrée, en B le donjon avec sa chemise. On trouvera, à l’article Donjon, la description de cette magnifique construction. En B la chapelle orientée, largement conçue et exécutée avec une grandeur sans pareille, si l’on en juge par les fragments des meneaux des fenêtres qui jonchent le sol ; en D la grand’salle du tribunal, dite des Preux, parce qu’on y voyait, dans des niches, les statues des neuf preux. Deux cheminées chauffaient cette salle, largement éclairée à son extrémité méridionale par une grande verrière ouverte dans le pignon. Une charpente en bois avec berceau ogival en bardeaux couvrait cette salle. En E la salle des neuf Preuses, dont les figures étaient sculptées en ronde-bosse sur le manteau de la cheminée. Un boudoir F, pris aux dépens de l’épaisseur de la courtine, accompagnait cette salle ; cette pièce, éclairée par une grande et large fenêtre donnant sur la campagne du côté de Noyon, était certainement le lieu le plus agréable du château ; elle était chauffée par une petite cheminée et voûtée avec élégance par de petites voûtes d’arêtes.
Ces dernières bâtisses datent de la fin du XIVe siècle ; on voit parfaitement comment elles furent incrustées dans les anciennes constructions ; comment, pour les rendre plus habitables, on suréleva les courtines d’un étage ; car, dans la construction primitive, ces courtines n’atteignaient certainement pas un niveau aussi élevé, laissaient aux cinq tours un commandement plus considérable, et les bâtiments d’habitation avaient une beaucoup moins grande importance. Du temps d’Enguerrand III, la véritable habitation du seigneur était le donjon ; mais quand les mœurs féodales, de rudes qu’elles étaient, devinrent au contraire, vers la fin du XIVe siècle, élégantes et raffinées, ce donjon dut paraître fort triste, sombre et incommode ; les seigneurs de Coucy bâtirent alors ces élégantes constructions ouvertes sur la campagne, en les fortifiant suivant la méthode de cette époque.

Le donjon et sa chemise, les quatre tours d’angle, la partie inférieure des courtines, les soubassements de la grand’salle, le rez-de-chaussée de l’entrée et la chapelle, ainsi que toute l’enceinte de la basse-cour, appartiennent à la construction primitive du château de Coucy sous Enguerrand III.


Philippe-Auguste, par ses conquêtes, put satisfaire largement cette hiérarchie d’ambitions, et, quoiqu’il ne perdît aucune des occasions qui s’offrirent à lui d’englober les fiefs dans le domaine royal, de les diviser et de diminuer l’importance politique des grands vassaux, en faisant relever les petits fiefs directement de la couronne ; cependant il laissa, en mourant, bon nombre de seigneurs dont la puissance pouvait porter ombrage à un suzerain ayant un bras moins ferme et moins d’activité à déployer. Si Philippe-Auguste eût vécu dix ans de plus et qu’il eût eu à gouverner ses provinces en pleine paix, il est difficile de savoir ce qu’il aurait fait pour occuper l’ambition des grands vassaux de la couronne, et comment il s’y serait pris pour étouffer cette puissance qui pouvait se croire encore rivale de la royauté naissante. Le court règne de Louis VIII fut encore rempli par la guerre ; mais pendant la minorité de Louis IX, une coalition des grands vassaux faillit détruire l’œuvre de Philippe-Auguste. Des circonstances heureuses, la division qui se mit parmi les coalisés, l’habileté de la mère du roi, sauvèrent la couronne ; les luttes cessèrent, et le pouvoir royal sembla de nouveau raffermi.
Un des côtés du caractère de saint Louis qu’on ne saurait trop admirer, c’est la parfaite connaissance du temps et des hommes au milieu desquels il vivait ; avec un esprit de beaucoup en avance sur son siècle, il comprit que la paix était pour la royauté un dissolvant en face de la féodalité ambitieuse, habituée aux armes, toujours mécontente lorsqu’elle n’avait plus d’espérances d’accroissements ; les réformes qu’il méditait n’étaient pas encore assez enracinées au milieu des populations pour opposer un obstacle à l’esprit turbulent des seigneurs. Il fallait faire sortir de leurs nids ces voisins dangereux qui entouraient le trône, user leur puissance, entamer leurs richesses ; pour obtenir ce résultat, le roi de France avait-il alors à sa disposition un autre moyen que les croisades ? Nous avons peine à croire qu’un prince d’un esprit aussi droit, aussi juste et aussi éclairé que saint Louis n’ait eu en vue, lorsqu’il entreprit sa première expédition en Orient, qu’un but purement personnel. Il ne pouvait ignorer qu’en abandonnant ses domaines pour reconquérir la terre sainte, dans un temps où l’esprit des croisades n’était rien moins que populaire, il allait laisser en souffrance les grandes réformes qu’il avait entreprises, et que devant Dieu il était responsable des maux que son absence volontaire pouvait causer parmi son peuple. Le royaume en paix, les membres de la féodalité entraient en lutte les uns contre les autres ; c’était la guerre civile permanente, le retour vers la barbarie ; vouloir s’opposer par la force aux prétentions des grands vassaux, c’était provoquer de nouvelles coalitions contre la couronne. Entraîner ces puissances rivales loin de la France, c’était pour la monarchie, au XIIIe siècle, le seul moyen d’entamer profondément la féodalité et de réduire ces forteresses inexpugnables assises jusque sur les marches du trône. Si saint Louis n’avait été entouré que de vassaux de la trempe du sire de Joinville, il est douteux qu’il eût entrepris ses croisades ; mais l’ascendant moral qu’il avait acquis, ses tentatives de gouvernement monarchique n’eussent pu rompre peut-être le faisceau féodal, s’il n’avait pas occupé et ruiné en même temps la noblesse par ces expéditions lointaines. Saint Louis avait pour lui l’expérience acquise par ses prédécesseurs, et chaque croisade, quelle que fut son issue, avait été, pendant les XIe et XIIe siècles, une cause de déclin pour la féodalité, un moyen pour le suzerain d’étendre le pouvoir monarchique. Quel moment saint Louis choisit-il pour son expédition ? C’est après avoir vaincu la coalition armée, à la tête de laquelle se trouvait le comte de Bretagne, après avoir protégé les terres du comte de Champagne contre les seigneurs ligués contre lui, c’est après avoir délivré la Saintonge des mains du roi d’Angleterre et du comte de la Marche, c’est enfin après avoir donné la paix à son royaume avec autant de bonheur que de courage, et substitué la suzeraineté de fait à la suzeraineté de nom. Dans une semblable occurrence, la paix, le calme, les réformes et l’ordre pouvaient faire naître les plus graves dangers au milieu d’une noblesse inquiète, oisive, et qui sentait déjà la main du souverain s’étendre sur ses privilèges.
Il est d’ailleurs, dans l’histoire des peuples, une disposition morale à laquelle, peut-être, les historiens n’attachent pas assez d’importance, parce qu’ils ne peuvent pénétrer dans la vie privée des individus ; c’est l’ennui. Lorsque la guerre était terminée, lorsque l’ordre renaissait et par suite l’action du gouvernement, que pouvaient faire ces seigneurs féodaux dans leurs châteaux fermés, entourés de leurs familiers et gens d’armes ? S’ils passaient les journées à la chasse et les soirées dans les plaisirs, s’ils entretenaient autour d’eux, pour tuer le temps, de joyeux compagnons, ils voyaient bientôt leurs revenus absorbés, car ils n’avaient plus les ressources éventuelles que leur procuraient les troubles et les désordres de l’état de guerre. Si, plus prudents, ils réformaient leur train, renvoyaient leurs gens d’armes et se résignaient à vivre en paisibles propriétaires, leurs forteresses devenaient un séjour insupportable, les heures pour eux devaient être d’une longueur et d’une monotonie désespérantes ; car si quelques nobles, au XIIIe siècle, possédaient une certaine instruction et se livraient aux plaisirs de l’esprit, la grande majorité ne concevait pas d’autres occupations que celles de la guerre et des expéditions aventureuses. L’ennui faisait naître alors les projets les plus extravagants dans ces cerveaux habitués à la vie bruyante des camps, aux émotions de la guerre.
Saint Louis, qui n’avait pas cédé à la noblesse armée et menaçante, après l’avoir forcée de remettre l’épée au fourreau, ne se crut peut-être pas en état de lutter contre l’ennui et l’oisiveté de ses vassaux, de poursuivre, entre les forteresses jalouses dont le sol était couvert, les réformes qu’il méditait.
« Les croisades dévorèrent une grande quantité de seigneurs, et firent retourner au trône leurs fiefs devenus vacants. Mais, sous aucun règne, elles ne contribuèrent davantage à l’accroissement du domaine royal que sous celui de saint Louis ; il est facile de s’en rendre raison : les croisades étaient déjà un peu vieillies au temps de saint Louis, les seigneurs ne croyaient plus y être exposés, et n’avaient par conséquent ni armes ni chevaux, ni provisions de guerre ; il fallait emprunter ; ils engagèrent leurs fiefs au roi, qui, étant riche, pouvait prêter. À la fin de la croisade, ceux des seigneurs qui survivaient à leurs compagnons d’armes revenaient si pauvres, si misérables, qu’ils étaient hors d’état de dégager leurs fiefs, qui devenaient alors la propriété définitive de ceux qui les avaient reçus en nantissement. Cette espèce d’usure politique parut naturelle dans le temps où elle eut lieu ; les envahissements de saint Louis étaient couverts par la droiture de ses intentions ; personne n’eût osé le soupçonner d’une chose injuste. Il semblait, par l’empire de ses vertus, consacrer jusqu’aux dernières conséquences de sa politique[57]. »
Saint Louis, au moyen de ces expéditions outre-mer, non-seulement ruinait la féodalité, l’enlevait à ses châteaux, mais centralisait encore, sous son commandement, une nombreuse armée, qu’à son retour, et malgré ses désastres, il sut employer à agrandir le domaine royal, sous un prétexte religieux. De même que, sous le prétexte de se prémunir contre les menaces du Vieux de la Montagne, il établit une garde particulière autour de sa personne, qui « jour et nuit étoit en cure diligente de son corps bien garder[58], » mais qui, par le fait, était bien plutôt destinée à prévenir les perfidies des seigneurs.
Joinville rapporte qu’en partant pour la croisade et pour se mettre en état, il engagea à ses amis une grande partie de son domaine, « tant qu’il ne lui demoura point plus hault de douze cens livres de terre de rente. » Arrivé en Chypre, il ne lui restait plus d’argent vaillant que deux cent livres tournois d’or et d’argent lorsqu’il eut payé son passage et celui de ses chevaliers. Saint Louis, l’ayant su, l’envoya quérir et lui donna huit cents livres tournois pour continuer l’expédition. Au moment de partir pour la seconde croisade, « le roy de France et le roy de Navarre, dit Joinville, me pressoient fort de me croisser, et entreprandre le chemin du pélerinage de la croix. Mais je leur répondi, que tandis que j’avois esté oultre mer ou service de Dieu, que les gens et officiers du roy de France avoient trop grevé et foullé mes subgets, tant qu’ilz en estoient apovriz : tellement que jamais il ne seroit, que eulz et moy ne nous ensantissions. » Certes il y a tout lieu de croire que Joinville était un bon seigneur et qu’il disait vrai ; mais combien d’autres, en se croisant et laissant leurs sujets gouvernés par les officiers du roi, leur permettaient ainsi de passer d’un régime insupportable sous un gouvernement moins tracassier en ce qu’il était moins local et partait de plus haut ? Les seigneurs féodaux possédaient l’autorité judiciaire sur leurs terres ; les baillis royaux, chargés par Philippe-Auguste de recevoir tous les mois aux assises les plaintes des sujets du roi, de nommer dans les prévôtés un certain nombre d’hommes sans lesquels aucune affaire concernant les villes ne pouvait être décidée, de surveiller ces magistrats, furent entre les mains de saint Louis une arme puissante dirigée contre les prérogatives féodales. Ce prince fit instruire dans le droit romain ceux qu’il destinait aux fonctions de baillis ; il étendit leur pouvoir en dehors des tribunaux en les chargeant de la haute administration, et bientôt ces hommes dévoués à la cause royale attaquèrent ouvertement l’autorité judiciaire des barons en créant les cas royaux. « C’est-à-dire qu’ils firent recevoir en principe, que le roi, comme chef du gouvernement féodal, avait, de préférence à tout autre, le droit de juger certaines causes nommées pour cela cas royaux. À la rigueur, cette opinion était soutenable ; mais il fallait déterminer clairement les cas royaux, sous peine de voir le roi devenir l’arbitre de toutes les contestations ; or, c’est ce que ne voulurent jamais faire les baillis : prières, instances, menaces, rien ne put les y décider ; toutes les fois qu’ils entendaient débattre dans les cours seigneuriales une cause qui paraissait intéresser l’autorité du roi, ils s’interposaient au milieu des partis, déclaraient la cause cas royal, et en attiraient le jugement à leurs cours[59]. » Les empiétements des baillis sur les juridictions seigneuriales étaient appuyés par le parlement, qui enjoignait, dans certains cas, aux baillis, d’entrer sur les terres des seigneurs féodaux et d’y saisir tels prévenus, bien que ces seigneurs fussent hauts-justiciers, et, selon le droit, pouvant « porter armes pour justicier leurs terres et fiefs[60]. » En droit féodal, le roi pouvait assigner à sa cour le vassal qui eût refusé de lui livrer un prévenu, considérer son refus comme un acte de félonie, prononcer contre lui les peines fixées par l’usage, mais non envoyer ses baillis exploiter dans une seigneurie qui ne lui appartenait pas[61].
À la fin du XIIIe siècle, la féodalité, ruinée par les croisades, attaquée dans son organisation par le pouvoir royal, n’était plus en situation d’inspirer des craintes sérieuses à la monarchie, ni assez riche et indépendante pour élever des forteresses comme celle de Coucy. D’ailleurs, à cette époque, aucun seigneur ne pouvait construire ni même augmenter et fortifier de nouveau un château, sans en avoir préalablement obtenu la permission de son suzerain. Nous trouvons, dans les Olim, entre autres arrêts et ordonnances sur la matière, que l’évêque de Nevers, qui actionnait le prieur de la Charité-sur-Loire parce qu’il voulait élever une forteresse, avait été lui-même actionné par le bailli du roi pour avoir simplement fait réparer les créneaux de la sienne. Saint Louis s’était arrogé le droit d’octroyer ou de refuser la construction des forteresses ; et s’il ne pouvait renverser toutes celles qui existaient de son temps sur la surface de ses domaines et qui lui faisaient ombrage, il prétendait au moins empêcher d’en construire de nouvelles ; et, en effet, on rencontre peu de châteaux de quelque importance élevés de 1240 à 1340, c’est-à-dire pendant cette période de la monarchie française qui marche résolument vers l’unité de pouvoir et de gouvernement.
À partir du milieu du XIVe siècle, au contraire, nous voyons les vieux châteaux réparés ou reconstruits, de nouvelles forteresses s’élever sur le territoire français, à la faveur des troubles et des désastres qui désolent le pays ; mais alors l’esprit féodal s’était modifié, ainsi que les mœurs de la noblesse, et ces résidences revêtent des formes différentes de celles que nous leur voyons choisir pendant le règne de Philippe-Auguste et au commencement de celui de saint Louis ; elles deviennent des palais fortifiés, tandis que, jusqu’au XIIIe siècle, les châteaux ne sont que des forteresses pourvues d’habitations. Ces caractères bien tranchés sont faciles à saisir ; ils ont une grande importance au point de vue architectonique, et le château de Coucy, tel qu’il devait exister avant les reconstructions de la fin du XIVe siècle, sert de transition entre les châteaux de la première et de la seconde catégorie ; ce n’est plus l’enceinte contenant des habitations disséminées, comme un village fortifié dominé par un fort principal, le donjon ; et ce ne devait pas être encore le palais, la réunion de bâtiments placés dans un ordre régulier soumettant la défense aux dispositions exigées par l’habitation, le véritable château construit d’après une donnée générale, une ordonnance qui rentre complètement dans le domaine de l’architecture.
Aujourd’hui, toutes les résidences seigneuriales sont tellement ruinées qu’on ne peut plus guère se faire une idée exacte des parties qui servaient à l’habitation ; les tours et les courtines, plus épaisses que le reste des constructions, ont pu résister à la destruction, et nous laissent juger des dispositions défensives permanentes, sans nous donner le détail des distributions intérieures, ainsi que des nombreuses défenses extérieures qui protégeaient le corps de la place. Il nous faut, pour nous rendre compte de ce que devait être un château pendant la première moitié du XIIIe siècle, avoir recours aux descriptions contenues dans les chroniques et les romans ; heureusement ces descriptions ne nous font pas défaut et elles sont souvent assez détaillées. L’une des plus anciennes, des plus complètes et des plus curieuses, est celle qui est contenue dans la première partie du Roman de la Rose, et qui, sous le nom du Château de la Jalousie, nous dépeint le Louvre de Philippe-Auguste. Personne n’ignore que la grosse tour ou donjon du Louvre avait été bâtie par ce prince pour renfermer son trésor et servir au besoin de prison d’État ; tous les fiefs de France relevaient de la tour du Louvre, dans laquelle les grands vassaux rendaient hommage et prêtaient serment de fidélité au roi. Les autres constructions de ce château avaient été également élevées par Philippe-Auguste. Mais laissons parler Guillaume de Lorris[62] :
« Dès or est drois que ge vous die
« La contenance Jalousie,
« Qui est en male souspeçon :
« Où païs ne remest maçon
« Ne pionnier qu’ele ne mant.
« Si fait faire au commancement
« Entor les Rosiers uns fossés
« Qui cousteront deniers assés,
« Si sunt moult lez et moult parfont.
« Li maçons sus les fossés font
« Ung mur de quarriaus tailléis,
« Qui ne siet pas sus croléis (qui n’est pas assis sur terre meuble),
« Ains est fondé sus roche dure :
« Li fondement tout à mesure
« Jusqu’au pié du fossé descent,
« Et vait amont en estrecent (et s’élève en talus) ;
« S’en est l’uevre plus fors assés.
« Li murs si est si compassés,
« Qu’il est de droite quarréure ;
« Chascuns des pans cent toises dure,
« Si est autant lons comme lés[63].
« Les tornelles sunt lés à lés (de distance en distance),
« Qui richement sunt bataillies (fortifiées)
« Et sunt de pierres bien taillies,
« As quatre coingnés (coins) en ot quatre
« Qui seroient fors à abatre ;
« Et si i a quatre portaus
« Dont li mur sunt espés et haus,
« Ung en i a ou front devant
« Bien déffensable par convant[64],
« Et deux de coste, et ung derriere[65],
« Qui ne doutent cop de perrière.
« Si a bonnes portes coulans
« Por faire ceus defors doulans,
« Et por eus prendre et retenir,
« S’il osoient avant venir[66].
« Ens où milieu de la porprise (de l’enceinte)
« Font une tor par grant mestrise
« Cil qui du fere furent mestre[67] ;
« Nule plus bele ne pot estre,
« Qu’ele est et grant, et lée, et haute[68] ;
« Li murs ne doit pas faire faute
« Por engin qu’on saiche getier ;
« Car l’en destrempa le mortier
« De fort vin-aigre et de chaus vive[69]
« La pierre est de roche naïve
« De quoi l’en fist le fondement,
« Si iert dure cum aïment.
« La tor si fu toute réonde,
« Il n’ot si riche en tout le monde,
« Ne par dedens miex ordenée.
« Elle iert dehors avironnée
« D’un baille qui vet tout entor,
« ......
« Dedens le chastel ot perrières
« Et engins de maintes manières.
« Vous poïssiés les mangonniaus
« Véoir pardessus les creniaux[70] ;
« Et as archieres tout entour
« Sunt les arbalestes à tour[71],
« Qu’armeure n’i puet tenir (résister),
« Qui près du mur vodroit venir,
« Il porroit bien faire que nices.
« Fors des fossés a unes lices
« De bons murs fors à creniaux bas,
« Si que cheval ne puent pas
« Jusqu’as fossés venir d’alée,
« Qu’il n’i éust avant mellée[72].
« Jalousie a garnison mise
« Où chastel que ge vous devise,
« Si m’est avis que Dangier porte
« La clef de la première porte
« Qui ovre devers orient[73] ;
« Avec li, au mien escient,
« A trente sergens tout à conte[74].
« Et l’autre porte garde Honte,
« Qui ovre par devers midi[75],
« El fut moult sage, et si vous di
« Qu’el ot sergens à grant planté (en grand nombre)
« Près de faire sa volenté,
« Paor (Peur) ot grant connestablie,
« Et fu à garder establie,
« L’autre porte, qui est assise,
« A main senestre devers bise[76],
« Paor n’i sera ja seure,
« S’el n’est fermée à serréure,
« Et si ne l’ovre pas sovent ;
« Car, quant el oit (entend) bruire le vent,
« Ou el ot saillir deus langotes,
« Si l’en prennent fievres et gotes (gouttes).
« Male-bouche (Mauvais propos, médisance), que Diex maudie !
« Ot sodoiers de Normandie[77].
« Si garde la porte destrois[78] ;
« Et si sachiés qu’as autres trois
« Va souvent et vient[79]. Quant il scet
« Qu’il doit par nuit faire le guet,
Il monte le soir as creniaus[80],
« Et atrempe ses chalemiaus (prépare ses chalumeaux)
« Et ses busines (trompettes), et ses cors.
« .............
« Jalousie, que Diex confonde !
« A garnie la tor réonde (le donjon) :
« Et si sachiés qu’ele i a mis
« Des plus privés de ses amis,
« Tant qu’il i ot grant garnison[81]. »
C’est là un château royal ; la nécessité où se trouvait un seigneur de placer un poste, une petite garnison, dans chaque porte principalement, faisait qu’on ne multipliait pas les issues, d’autant plus que les attaques étaient toujours tentées sur ces points. Ce passage du Roman de la Rose nous fait connaître que, dans les châteaux considérables, la multiplicité des défenses exigeait des garnisons comparativement nombreuses. Or ces garnisons ruinaient les seigneurs ; s’ils les réduisaient, le système défensif adopté au commencement du XIIIe siècle, excellent lorsqu’il était convenablement muni d’hommes, était mauvais lorsque tous les points ne pouvaient pas être bien garnis et surveillés. Alors ces détours, ces solutions de communications devenaient au contraire favorables aux assiégeants. Nous verrons comme, au XIVe siècle, les châtelains ayant reconnu ces défauts cherchèrent à y remédier et à se bien défendre avec des garnisons que leur état de fortune ne leur permettait plus d’entretenir très-nombreuses.
Voici maintenant des descriptions de travaux exécutés dans des châteaux de seigneurs féodaux qui datent de la même époque (commencement du XIIIe siècle) :
« Vers son chastel point tant et broche[82]
« Qu’il en a véue la roche[83] ;
« Venuz est, si descent au pont[84].
« Les ovriers qui les euvres font
« Amoneste de tost ovrer[85]
« Et de lor porte delivrer,
« Et de reparer ses fossez,
« Car moult bien estoit apanssez (il se préoccupait fort)
« Se li Rois vient sur lui à ost (avec son armée),
« Qu’il n’a pas pooir qu’il l’en ost,
« Einçoiz en seroit moult penez.
« Moult s’esforce li forcenez
« De faire fossez et tranchiées,
« Tot entor lui à sis archiées,
« Fait un fossé d’eve parfont (rempli d’eau profonde)
Riens n’i puet entrer qui n’afont (qui ne tombe au fond).
« Desor fu li ponz tornéiz
« Moult bien tornez toz coléiz[86].
« Desor la tor sont les perrieres
« Qui lanceront pierres plenieres[87] :
« N’est nus hom qui en fust féruz,
« Qui à sa fin ne fust venuz.
« Les archières sont as querniax
« Par où il trairont les quarriax
« Por damagier la gent le roi.
« Moult est Renart de grant desroi
« Qui si contre le roi s’afete (se prépare).
« Sor chascune tor une gaite
« A mise por eschargaitier[88],
« Qar il en avoit grant mestier (grand besoin).
« Moult fut bien d’eye (d’eau) avironez,
« Einsi s’est Renart atornez.
« Hordéiz ot et bon et bel,
« Par defors les murs dou chastel[89]
« Ses barbacanes fist drecier
« Por son chastel miaux enforcier[90].
« ........... »
Il mande des soldats, des gens de pied et à cheval pour défendre le château ; ils se rendent en grand nombre à son appel.
« ....Grant joie en fist
« Renart, et maintenant les mist
« Es barbacanes por deffense[91],
« Nus ne puet savoir ce qu’il pense,
« Moult s’est Renart bien entremis
« D’aide faire à ses amis,
« Que bien quide sanz nul retor
« Qu’il soit assis dedenz sa tor[92]. »
Outre les dépenses qu’occasionnaient aux seigneurs féodaux la construction des châteaux et l’entretien d’une garnison suffisante en prévision d’une attaque, il leur fallait faire exécuter des travaux considérables, s’ils voulaient être en état de résister à un siége en règle, approvisionner quantité de munitions de bouche et de guerre. Les hourdages en bois dont, pendant les XIIe et XIIIe siècles, on garnissait les sommets des tours et courtines, exigeaient l’apport, la façon et la pose d’une quantité considérable de charpentes, par conséquent un nombre énorme d’ouvriers. Ces ouvrages transitoires se détérioraient promptement pendant la paix ; ce n’était pas une petite affaire de posséder et de garder un château à cette époque.
Dans un autre poëme, contemporain de ce dernier (commencement du XIIIe siècle), nous trouvons encore des détails intéressants, non-seulement sur les défenses des châteaux, mais sur les logements, les dépendances, les armes et les passe-temps des seigneurs. Nous demanderons à nos lecteurs la permission de leur citer encore ce passage :
« .........
« Li chastiax sist an une roche[93] ;
« Li aigue jusc’à mur s’aproche,
« La roche fut dure et naïve,
« Haute et large jusc’à la rive ;
« Et sist sor une grant montaigne
« Qui samble qu’as nues se teigne.
« El chastel n’avoit c’une entrée[94] ;
« Trop riche porte i ot fermée[95]
« Qui sist sor la roche entaillie.
« De cele part fut la chaucie,
« Li fossez et li rolléis (les palissades, littéralement les bâtons).
« Et si fut li ponz levéiz[96]
« Si estoit assiz li chastiax
« Que parrière ne mangoniax
« Ne li grevast de nulle part :
« Por nul anging, ne por nul art
« Nel’poïst-on adamaigier,
« Tant k’il éussent à maingier
« Cil ki del chastel fussent garde,
« N’éussent de tot le monde garde.
« Moult fut estroite li antreie,
« Qu’ansi fut faite et compasseie,
« Par devant la haute montaigne ;
« I covient c’uns solx hom i veigne.
« J’ai dui ni vauroient ansamble[97].
« D’autre part devers l’aigue sambre,
« Por ceu k’il siet en si haut mont,
« Qu’il doie chéoir en .i. mont.
« De tant com om trait d’un quarrel
« N’aprochoit nuns hons lo chastel.
« Il i ot portes colléisces (herses),
« Bailles (enceintes extérieures), fossez et murz et lices[98],
« Trestot fut an roche antaillet.
« Moult i ot ferut et tailliet
« Ainçoiz ke li chastels fust fais ;
« Onkes tels ne fut contrefaiz
« Trop par fut fors et bien assiz[99].
« .........
« Sor la roche ki fut pandans,
« Grant fut et large par dedans,
« Trop i ot riche herberjaige[100] ;
« En la tor (le donjon) ot moult riche estaige,
« Bien fut herbergiez tot entor[101]
« Li pallais sist prest de la tor[102]
« Qui moult fut haus et bons et leis (larges)
« Li estauble (écuries) furent deleis,
« Greniers et chambres et cuisines ;
« Moult i ot riches officines.
« Moult fut la salle grans et large[103] :
« Maint fort escut et mainte targe
« Et mainte lance et maint espiet (épieu)
« Et bon cheval et bon apiet
« Dont li fer sont bon et tranchant,
« Et maint cor bandeit d’argent
« Avoit pandut por lo pallais[104].
« .........
« Vers l’estanc furent les fenestres,
« Lai fut li sires apoieis ;
« Ne sai c’il estoit annuiés,
« Mais, en pansant, l’aigue esgardoit (regardait l’eau),
« An esgardant, les cignes voit
« Qui estoient et bel et gent.
« Dont comandoit tote sa gent
« Que moult doucement les véissent ;
« .......... »
Les fenêtres des appartements donnent sur l’étang dont les eaux enveloppent le château ; le seigneur, qui s’ennuie (le poëte penche à le croire et nous aussi), regarde l’eau, puis les cygnes ; il leur jette du pain et du blé, et appelle ses gens afin de jouir de ce spectacle en compagnie… Tout est bon à ceux qui s’ennuient, et cette vie monotone du château, lorsqu’elle n’était pas remplie par la guerre ou la chasse, s’attachait aux moindres accidents pour y trouver un motif de distraction. Le pèlerin qui frappait à la porte et réclamait un gîte pour la nuit, le moine qui venait demander pour son couvent, le trouvère qui débitait ses vers, apportaient seuls des bruits et nouvelles du dehors entre ces murailles silencieuses. Cela explique le succès de ces lais, gestes, chansons et légendes qui abondaient à cette époque et occupaient les longs loisirs d’un châtelain, de sa famille et de ses gens.
Si le seigneur était riche, il cherchait à embellir sa demeure féodale, faisait bâtir une chapelle, et la décorait de peintures et de vitraux ; il garnissait ses appartements de tapisseries, de meubles précieux, de belles armes ; de là ce goût effréné pour le luxe qui, dès le XIIIe siècle, trouve sa place chez des hommes encore rudes, cette excitation de l’imagination, cet amour pour le merveilleux, pour la poésie, la musique, le jeu, les aventures périlleuses. Pendant que le peuple des villes participait chaque jour davantage à la vie politique du pays, devenait industrieux, riche par conséquent, était tout occupé de l’existence positive et prenait ainsi une place plus large, le seigneur, isolé dans son château, repaissait son imagination de chimères, comprimait difficilement ses instincts turbulents, nourrissait des projets ambitieux de plus en plus difficiles à réaliser entre la royauté qui s’affermissait et s’étendait, et la nation qui commençait à se sentir et se connaître.
Dès l’époque de saint Louis, la féodalité française n’était plus qu’un corps hétérogène dans l’État, elle ne pouvait plus que décroître. Au point de vue militaire, les guerres du XIVe siècle lui rendirent une certaine importance, la forcèrent de rentrer dans la vie publique (sous de tristes auspices, il est vrai), et prolongèrent ainsi son existence ; la noblesse releva ses châteaux, adopta des moyens de défense nouveaux, appropriés aux temps, fit faire ainsi un pas à l’art de la fortification, jusqu’au moment où, l’artillerie à feu devenant un moyen d’attaque puissant, elle dut se résigner à ne plus jouer qu’un rôle secondaire en face de la royauté, et à ne considérer ses châteaux que comme de vieilles armes que l’on conserve en souvenir des services qu’elles ont rendus, sans espérer pouvoir s’en servir pour se défendre. De Charles VI à Louis XI, les barons semblent ne vouloir pas faire à l’artillerie l’honneur de la reconnaître ; ils persistent, dans la construction de leurs châteaux, à n’en point tenir compte, jusqu’au moment où ses effets terribles viennent détruire cette vaine protestation au moyen de quelques volées de coups de canon[105].
Mais nous n’en sommes pas encore arrivés à cette époque de transition où le château n’est plus qu’un vain simulacre de défense militaire, et cache encore, par un reste des traditions antérieures, la maison de plaisance sous une apparence guerrière.
Revenons au Louvre, non plus au Louvre de Philippe-Auguste, mais au Louvre tel que l’avait laissé Charles V, c’est-à-dire à la forteresse qui se transforme en palais réunissant les recherches d’une habitation royale à la défense extérieure.

La porte de la ville (voy. la fig. 20) donnait issue entre deux murs flanqués de tournelles, le long de la rivière, et aboutissait à une première porte extérieure K donnant sur la berge, au point où se trouve aujourd’hui le balcon de la galerie d’Apollon. À côté de cette porte était la tour du Bois, qui correspondait à la tour de Nesle sur l’emplacement de l’Institut. On entrait, de la ville, dans les lices du Louvre par la porte H ; c’était la porte principale. Mais, pour pénétrer dans le château, il fallait traverser un châtelet N construit en avant du fossé. La tour I faisait le coin sur la Seine, vers Paris. En A était le donjon de Philippe-Auguste, entouré de son fossé particulier B ; son entrée en C était protégée par un corps-de-garde G. En F était une fontaine. Un large fossé à fond de cuve, avec contrescarpe revêtue, chemin de ronde et échauguettes, régnait en U tout autour du château. Les basses-cours du côté de la ville se trouvaient en R entre la muraille de Philippe-Auguste et le fossé. Du côté du nord en W et sur le terre-plain O étaient plantés des jardins avec treilles. Les tours d’angle X et la porte principale avec ses deux tours Y devaient appartenir à la construction du commencement du XIIIe siècle. La chapelle était en a ; en m un grand vestibule servant de salle des gardes. Les appartements de la reine tenaient l’aile h, c, e, f, k, j ; le jeu de paume, la salle g. Le bâtiment V contenait la ménagerie, et ceux P T Q le service de l’artillerie depuis Charles V. Ce qui faisait l’orgueil de Raimond du Temple était l’escalier à vis E, qui passait pour un chef-d’œuvre, construction à jour ornée de niches et statues représentant les rois de France ; puis la galerie D mettant le donjon en communication avec le premier étage de l’aile du nord.

Au premier étage (21), la chambre des comptes occupait en D le dessus de la porte principale ; la salle des joyaux (le trésor de Charles V était fort riche en objets d’or et d’argent) était placée en A au-dessus de la salle des gardes, et la bibliothèque dans la tournelle B[108]. Le cabinet du roi était en C ; la chambre des requêtes en E ; la chambre à coucher du roi en F, son oratoire en G ; un cabinet et une salle de bain en H H. Le jeu de paume prenait la hauteur du rez-de-chaussée et du premier étage en I. Une chapelle haute en M se trouvait au-dessus de la chapelle basse, cette dernière étant réservée aux gens du château. En N, le roi possédait une seconde chambre à coucher, précédée d’une antichambre P, d’un oratoire O, d’une salle de bain et cabinet R R. La salle de parade (du Trône) était en Q, et la grand’salle dite de Saint-Louis en S. Il existait un appartement d’honneur avec salle de parade en V, X, T. Le premier étage du donjon L était divisé en quatre pièces contenant une chambre, un oratoire et des cabinets. Les galeries Y ou portiques servaient de communication pour le service, et, comme nous l’avons dit plus haut, la galerie K donnait entrée dans le donjon, au premier étage.
Au moyen du tableau de Saint-Germain-des-Prés, des gravures d’Israël Sylvestre et d’un dessin du commencement du XVIIe siècle qui est en notre possession, nous avons essayé de restituer une vue cavalière du château du Louvre de Charles V ; nous la donnons ici (22).

L’aspect que nous avons choisi est celui du sud-est, car c’est sur ce côté du Louvre que l’on peut réunir le plus de documents antérieurs aux reconstructions des XVIe et XVIIe siècles. Notre vue montre la quantité de défenses qui protégeaient les abords du château, et le soin apporté par Charles V dans les reconstructions ; elle fait comprendre comment les tours de Philippe-Auguste avaient dû être engagées par la surélévation des courtines servant de façades extérieures aux bâtiments neufs. Vers le nord, on aperçoit l’escalier de Raimond du Temple et les riches bâtiments auxquels il donnait accès. Du côté de l’est, sur le devant de notre dessin, passe l’enceinte de la ville bâtie par Philippe-Auguste, terminée sur la Seine par une haute tour qui subsista jusqu’au commencement du XVIIe siècle ; derrière cette tour sont les deux portes, l’une donnant entrée dans la ville le long de la première enceinte du Louvre, l’autre entrant dans cette enceinte. Ce front de l’enceinte de Paris, bâti par Philippe-Auguste, se défendait nécessairement du dehors au dedans depuis la Seine jusqu’à la barrière des Sergents ; c’est-à-dire que le fossé de ses courtines et tours était creusé du côté de la ville et non du côté du Louvre. Cette portion d’enceinte dépendait ainsi du château et le protégeait contre les entreprises des habitants.
Du temps de Charles V, le château du Louvre et ses dépendances contenaient tout ce qui est nécessaire à la vie d’un prince. Il y avait, dit Sauval, « la maison du four, la panneterie, la sausserie, l’épicerie, la pâtisserie, le garde-manger, la fruiterie, l’échançonnerie, la bouteillerie, le lieu où l’on fait l’hypocras… On y trouvait la fourerie, la lingerie, la pelleterie, la lavanderie, la taillerie, le buchier, le charbonnier ; de plus la conciergerie, la maréchaussée, la fauconnerie, l’artillerie, outre quantité de celliers et de poulaillers ou galliniers, et autres appartements de cette qualité. » Les bâtiments de l’artillerie, situés au sud-ouest, avaient une grande importance. Ils sont indiqués dans notre plan (fig. 20), en P Q T. « Dans le compte des baillis de France rendu en la Chambre en 1295, dit Sauval, il est souvent parlé des cuirs, des nerfs de bœuf, et des arbalètes gardées dans l’artillerie du Louvre… Lorsque les Parisiens s’emparèrent du Louvre en 1358, ils y trouvèrent engins, canons, arbalètes à tour, garrots et autre artillerie en grande quantité… » Le maître de l’artillerie y était logé, y possédait un jardin et des étuves ; en 1391, quoique l’artillerie à feu fût déjà connue, elle n’était guère employée à la défense des places fortes. Il y avait encore, ajoute Sauval, à cette époque, « une chambre pour les empenneresses, qui empennoient les sagettes et viretons ; de plus un atelier où l’on ébauchoit tant les viretons que les flèches, avec une armoire à trois pans (trois côtés), longue de cinq toises, haute de sept pieds, large de deux et demi, où étoient enfermés les cottes de mailles, platers, les bacinets, les haches, les épées, les fers de lance et d’archegayes et quantité d’autres sortes d’armures nécessaires pour la garnison du Louvre. » Ainsi, au XIVe siècle, un château devait contenir non-seulement ce qui était nécessaire à la vie journalière, mais de nombreux ateliers propres à la confection et à l’entretien des armes ; il devait se suffire à lui-même sans avoir besoin de recourir aux fournisseurs du dehors. Comme l’abbaye du XIIe siècle, le château féodal formait une société isolée, une petite ville renfermant ses soldats, ses ouvriers, fabricants, sa police particulière. Résidence royale, le château du Louvre avait, comme tous les châteaux féodaux, dans ses basses-cours, des fermiers qui, par leurs baux, devaient fournir la volaille, les œufs, le blé ; il possédait en outre une ménagerie bâtie par Philippe de Valois, en 1333, sur l’emplacement de granges achetées à Geoffroi et Jacques Vauriel ; de beaux jardins ; plantés à la mode du temps, c’est-à-dire avec treilles, plants de rosiers, tonnelles, préaux, quinconces[109].
Le plan carré ou parallélogramme paraît avoir été adopté pour les châteaux féodaux de plaine depuis le XIIIe siècle ; mais il est rare de rencontrer, ainsi que nous l’avons dit précédemment, le donjon placé au milieu du rectangle ; cette disposition est particulière au château du Louvre. Au château de Vincennes, bâti pendant le XIVe siècle, le donjon est placé le long de l’un des grands côtés, et pouvait, dès lors, se rendre indépendant de l’enceinte en ayant sa poterne s’ouvrant directement sur les dehors ; mais il faut voir dans le château de Vincennes une place forte, une vaste enceinte fortifiée, plutôt qu’un château proprement dit[110] (voy. Architecture Militaire). Les tours carrées qui flanquent ses courtines appartiennent bien plus à la défense des villes et places fortes de cette époque qu’à celle des châteaux.
Un des caractères particuliers aux châteaux de la fin du XIIIe siècle et du XIVe, c’est l’importance relative des tours, qui sont, sauf de rares exceptions, cylindriques, d’un fort diamètre, épaisses dans leurs œuvres, hautes et très-saillantes en dehors des courtines, de manière à les bien flanquer. Les engins d’attaque s’étant perfectionnés pendant le XIIIe siècle, on avait jugé nécessaire d’augmenter le diamètre des tours, de faire leurs murs plus épais et de rendre leur commandement très-puissant. Cette observation vient encore appuyer notre opinion sur la date des défenses du Louvre. Si Charles V les eût rebâties, il n’eût certainement pas conservé ces tours d’un faible diamètre et passablement engagées dans les courtines.

Le château de Villandraut près Bazas, bâti vers le milieu du XIIIe siècle, nous fait voir déjà des tours très-fortes et saillantes sur les courtines, flanquant à chaque angle un parallélogramme de 47m,50 sur 39m,00 dans œuvre. Ce château, publié déjà par la commission des monuments historiques de la Gironde, et dont nous donnons le plan (23), est parfaitement régulier, comme presque tous les châteaux de plaine ; son unique entrée est flanquée de deux tours très-fortes et épaisses ; des logements étaient disposés à l’intérieur le long des quatre faces, de manière à laisser une cour de 25m,00 sur 30m,00 environ[111]. Ici, pas de donjon, ou plutôt le château lui-même compose un véritable donjon entouré de fossés larges et profonds. Les dépendances, et probablement des enceintes extérieures, protégeaient cette forteresse, qui était très-bien défendue pour l’époque, puisque, en 1592, les ligueurs s’étant emparés de la place, le maréchal de Matignon dut en faire le siége, qui fut long et opiniâtre, les assiégés ne s’étant rendus qu’après avoir essuyé douze cent soixante coups de canon. Les tours du château de Villandraut ont 27m,00 de hauteur, non compris les couronnements qui sont détruits, sur 11m,00 et 12m,00 de diamètre ; elles commandaient de beaucoup les courtines, dont l’épaisseur est de 2m,70. Ce plan paraît avoir été fréquemment suivi à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, pour les châteaux de plaine d’une médiocre étendue ; toutefois l’importance que l’on attachait à la défense des portes (point vers lequel tendaient tous les efforts de l’assaillant avant l’artillerie à feu) fit que l’on ne se contenta pas seulement des deux tours flanquantes, et qu’on éleva en avant un châtelet isolé au milieu du fossé. C’est ainsi qu’était défendue la porte du château de Marcoucies élevé, sous Charles VI, par Jean de Montaigu. Ces châtelets remplaçaient les anciennes barbacanes des XIIe et XIIIe siècles, qui, le plus souvent, n’étaient que des ouvrages de terre et de bois, et furent remplacés à leur tour, à la fin du XVe siècle, par des boulevards en terre, avec ou sans revêtements, faits pour recevoir du canon.
Sous Philippe le Hardi, Philippe le Bel et Philippe de Valois, les dispositions des châteaux se modifient peu ; la France n’avait pas à lutter contre les invasions étrangères ; elle était forte et puissante ; la noblesse féodale semblait se résigner à laisser prendre à la monarchie une plus grande place dans l’État. Saint Louis n’avait vu qu’un péril pour le trône ; c’était celui qu’il avait eu à combattre dans sa jeunesse : le pouvoir démesuré des grands vassaux. Pendant qu’il cherchait, par de nouvelles institutions, à conjurer à jamais un danger qui avait failli lui faire perdre la couronne de Philippe-Auguste ; qu’il ruinait ses barons, empiétait sur leurs droits et les mettait dans l’impossibilité d’élever des forteresses, il cédait une partie des provinces françaises au roi Henri III d’Angleterre, par des considérations toutes personnelles et dont il est bien difficile aujourd’hui de reconnaître la valeur. Aux yeux de l’histoire, cette concession est une faute grave, peut-être la seule commise par ce prince ; elle eut, cent ans plus tard, des résultats désastreux, et provoqua les longs revers de la France pendant les XIVe et XVe siècles ; elle eut encore pour effet, contrairement aux tendances de celui qui l’avait commise, de prolonger l’existence de la féodalité ; car, pendant ces guerres funestes, ces troubles et cette fermentation incessants, les seigneurs, reprenant leurs allures de chefs de bandes, vendant tour à tour leurs services à l’un et à l’autre parti, quelquefois aux deux à la fois, regagnèrent cette indépendance, cet esprit d’isolement, de domination sans contrôle, qui, sous les derniers Carlovingiens, les avaient poussés à s’enfermer dans des demeures imprenables pour, de là, se livrer à toutes sortes de méfaits et d’actes d’agression. Après une première crise terrible, la France, sous Charles V, retrouva pendant quelques années le repos et la prospérité. De tous côtés, les seigneurs, instruits sur ce qu’ils pouvaient redouter du peuple par la Jacquerie, et de la prédominance croissante des habitants des cités, songèrent à mettre leurs demeures en état de résister aux soulèvements populaires, aux empiétements de la royauté et aux courses périodiques des ennemis du dehors. Déjà habitués au luxe, à une vie recherchée cependant, les seigneurs qui élevèrent des châteaux, vers la fin du XIVe siècle, modifièrent leurs anciennes résidences, en leur donnant une apparence moins sévère, se plurent à y introduire de la sculpture, à rendre les bâtiments d’habitation plus étendus et plus commodes, à les entourer de jardins et de vergers, en modifiant le système défensif de manière à pouvoir résister plus efficacement à l’agression extérieure avec des garnisons moins nombreuses mais plus aguerries. Sous ce rapport, les châteaux de la fin du XIVe siècle sont fort remarquables, et les crises par lesquelles la féodalité avait dû passer lui avaient fait faire de notables progrès dans l’art de fortifier ses demeures. Ce ne sont plus, comme au XIIe siècle, des enceintes étendues assez basses, flanquées de quelques tours étroites, isolées, protégées par un donjon et ne contenant que des bâtiments de peu de valeur, mais de nobles et spacieux corps de logis adossés à des courtines très-élevées, bien flanqués par des tours rapprochées et formidables, réunies par des chemins de ronde couverts, munis également dans tout leur pourtour de bonnes défenses. Le donjon se fond dans le château ; il n’est plus qu’un corps de logis dominant les autres, dont les œuvres sont plus épaisses et mieux protégées ; le château tout entier devient comme un vaste donjon bâti avec un grand soin dans tous ses détails. Déjà le système de défense isolée perd de son importance ; le seigneur paraît se moins défier de sa garnison, car il s’efforce de la réduire autant que possible et de gagner, par les dispositions défensives d’ensemble, ce qu’il perd en hommes. La nécessité faisait loi ; après les effroyables désordres qui ensanglantèrent la France, et particulièrement les provinces voisines de l’Île de France, vers le milieu du XIVe siècle, après que la Jacquerie eut été étouffée, les campagnes, les villages et même les petits bourgs s’étaient dépeuplés ; les habitants s’étaient réfugiés dans les villes et bourgades fermées. Lorsque le calme fut rétabli, les seigneurs revenant de courses ou des prisons d’Angleterre trouvèrent leurs terres abandonnées, partant leurs revenus réduits à rien. Les villes affranchissaient les paysans, qui s’étaient réfugiés derrière leurs murailles, de la servitude de main-morte, des corvées et vexations de toutes natures auxquelles ils étaient soumis sur les terres seigneuriales. Les barons furent obligés, pour repeupler leurs domaines, de faire des concessions, c’est-à-dire d’offrir à leurs sujets émigrés ainsi qu’à ceux qui menaçaient d’abandonner leurs domaines les avantages qu’ils trouvaient dans les villes. C’est ainsi qu’Enguerrand VII, sire de Coucy, en rentrant en France après avoir été envoyé en Angleterre comme otage de la rançon du roi Jean, se vit contraint d’accorder à vingt-deux des bourgs et villages qui relevaient de son château une charte collective d’affranchissement. Cette charte, dont le texte nous est conservé, explique clairement les motifs qui l’avaient fait octroyer ; en voici quelques passages : «…Lesquelles personnes (nos hommes et femmes de main-morte et de fourmariaige[112]) en allant demourer hors de nostre dicte terre, en certains lieux, se affranchissent sanz notre congié et puet afranchir toutes fois que il leur plaist ; et pour haine d’icelle servitude plusieurs personnes délaissent à demourer en nostre dicte terre, et par ce est et demoure icelle terre en grant partie non cultivée, non labourée et en riez (en friche), pourquoy nostre dicte terre en est grandement moins valable ; et pour icelle servitude détruire et mettre au néant, ont ou temps passé nos devanciers seigneurs de Coucy, et par espécial nostre très-chéer et amé père, dont Diex ait l’âme, esté requis de par les habitans pour le temps en ladicte terre, en offrant par iceulz certaine revenue perpétuelle… Et depuis que nous fûmes venus en aaige et que nous avons joy pleinement de nostre dicte terre, les habitanz de nos villes de nostre dicte terre sont venuz par plusieurs foiz devers nous, en nous requérant que ladicte coustume et usaige voulsissions destruire et mettre au néant, et (de) nostre dicte terre et villes, tous les habitans présens et advenir demourans en icelles, afranchir desdites servitudes et aultres personnelles quelzconques à tous jours perpétuelment, en nous offrant de chacune ville ou pour la plus grande partie desdictes villes, certaine rente et revenue d’argent perpétuelle pour nous, nos successeurs, etc… Nous franchissons du tout, de toutes mortes mains et fourmariaige et leur donnons pleine et entière franchise et à chascun d’eux perpétuelment et à touz jours tant pour estre clerc comme pour avoir tous aultres estats de franchise ; sans retenir à nous servitude ne puissance de acquérir servitude aulcune sur eulx… Toutes lesquelles choses dessus dictes nous avons fait et faisons, se il plaist au roy nostre sire, auquel seigneur nous supplions en tant que nous povons que pour accroistre et profiter le fief que nous tenons de luy, comme dessus est dict, il veille confirmer, loer et aprouver les choses dessus dictes… L’an MCCCLXVIII au mois d’aoust… » Le roi confirma cette charte au mois de novembre suivant[113].
La nécessité seule pouvait obliger les seigneurs féodaux à octroyer de ces chartes d’affranchissement, qui leur assuraient à la vérité des revenus fixes (car les sujets des bourgs, villes et villages, ne les obtenaient qu’en payant au seigneur une rente annuelle), mais qui leur enlevaient des droits dont ils abusaient souvent, mettaient à néant des ressources de toutes natures que, dans l’état de féodalité pure, les barons savaient trouver au milieu des populations qui vivaient sur leurs domaines. Une fois les revenus des seigneurs limités, établis par des chartes confirmées par le roi, il fallait songer à limiter les dépenses, à diminuer ces garnisons dispendieuses, à prendre un train en rapport avec l’étendue des rentes fixes, et dont les sujets n’étaient pas disposés à augmenter la quotité. D’un autre côté, le goût du luxe, des habitations plaisantes, augmentait chez les barons, ainsi que le besoin d’imposer aux populations par un état de défense respectable, car l’audace de sujets auxquels on est contraint de faire des concessions s’accroît en raison de l’étendue même de ces concessions.
Plus la nation tendait vers l’unité du pouvoir, plus la féodalité, opposée à ce principe par son organisation même, cherchait, dans ses châteaux, à former comme une société isolée, en opposition permanente contre tout acte émané soit du roi et de ses parlements, soit du sentiment populaire. Ne pouvant arrêter le courant qui s’était établi depuis saint Louis et ne voulant pas le suivre, les seigneurs cherchaient du moins à lui faire obstacle par tous les moyens en leur puissance. Sous des princes dont la main était ferme et les actes dictés par une extrême prudence, cette conspiration permanente de la féodalité contre l’unité, l’ordre et la discipline dans l’État, n’était pas dangereuse, et ne se trahissait que par de sourdes menées bientôt étouffées ; mais si le pouvoir royal tombait en des mains débiles, la féodalité retrouvait, avec ses prétentions et son arrogance, ses instincts de désorganisation, son égoïsme, son mépris pour la discipline, ses rivalités funestes à la chose publique. Brave isolément, la féodalité agissait ainsi devant l’ennemi du pays, en bataille rangée, comme si elle eût été lâche ou traître, sacrifiant souvent à son orgueil les intérêts les plus sacrés de la nation. Vaincue par sa faute en rase campagne, elle se réfugiait dans ses châteaux, en élevait de nouveaux, ne se souciant ni de l’honneur du pays, ni de l’indépendance du souverain, ni des maux de la nation, mais agissant suivant son intérêt personnel ou sa fantaisie. Ce tableau de la féodalité sous le règne du malheureux Charles VI n’est pas assombri à dessein, il n’est que la fidèle image de cette triste époque.
« Et quant les vaillans entrepreneurs (chefs militaires), dit Alain Chartier[114], dont mercy Dieu encores en a en ce royaulme de bien esprouvez, mettent peine de tirer sur champs les nobles pour aucun bienfaire, ils delaient si longuement à partir bien enuis, et s’avancent si tost de retourner voulentiers, que à peine se puet riens bien commencer ; mais à plus grant peine entretenir ne parfaire. Encores y a pis que ceste négligence. Car avec la petite voulenté de plusieurs se treuve souvent une si grant arrogance que ceulx qui ne sçauroient riens conduire par eux, ne vouldroyent armes porter soubz autruy ; et tiennent à deshonneur estre subgects à celuy soubz qui leur puet venir la renommée d’honneur, que par eulx ils ne vouldroyent de acquerir. O arrogance aveugle de folie, et petite congnoissance de vertus ! O très-périlleuse erreur en faits d’armes et de batailles ! Par ta malediction sont desconfites et desordonnées les puissances, et les armes desjoinctes et divisées ; quant chascun veult croire son sens, et suyvre son opinion. Et pour soy cuyder equiparer aux meilleurs, font souvent telles faultes, dont ilz sont deprimez soubz tous les moindres… En mémoire me vient, que j’ai souvent à plusieurs ouy dire : « Je n’iroye pour riens soubz le panon de tel. Car mon père ne fu onques soubz le sien. » Et ceste parolle n’est pas assez pesée, avant que dicte. Car les lignaiges ne font pas les chiefz de guerre, mais ceulx à qui Dieu, leurs sens, ou leurs vaillances, et l’auctorité du Prince en donnent la grâce, doivent estre pour telz obeitz : laquelle obéissance n’est mie rendue à personne, mais à l’office et à l’ordre d’armes (grade) et discipline de chevalerie, que chascun noble doit preferer à tout aultre honneur… »
Cette noblesse indisciplinée qui n’avait guère conservé de l’ancienne féodalité que son orgueil, qui fuyait en partie à la journée d’Azincourt, corrompue, habituée au luxe, aimait mieux se renfermer dans de bonnes forteresses, élégamment bâties et meublées ; que de tenir la campagne :
« Les bons anciens batailleurs,
dit encore Alain Chartier dans ses vers pleins d’énergie et de droiture de cœur[115],
« Furent-ilz mignotz, sommeilleurs,
« Diffameurs, desloyaulx, pilleurs ?
« Certes nenny.
« Ilz estoient bons, et tous uny.
« Pourquoy est le monde honny,
« Et sera encores comme ny
« A secouru.
« Car honneur a bien peu couru,
« Et n’y a on point recouru.
« Puisque le bon Bertran (Duguesclin) mouru.
« On a gueuchié
« Aux coups, et de costé penchié.
« Prouffit a honneur devanchié.
« On n’a point les bons avanchié.
« Mais mignotise,
« Flaterie, oultrage, faintise,
« Vilain cueur paré de cointise,
« Ont régné avec convoitise,
« Qui a tiré ;
« Dont tout a été deciré,
« Et le bien publique empiré.
« ........ »
Alors, les romans de chevalerie étaient fort en vogue ; on aimait les fêtes, les tournois, les revues ; chaque petit seigneur, sous cette monarchie en ruine, regrettant les concessions faites, songeait à se rendre important, à reconquérir tout le terrain perdu pendant deux siècles, non par des services rendus à l’État, mais en prêtant son bras au plus offrant, en partageant les débris du pouvoir royal, en opprimant le peuple, en pillant les villages et les campagnes, et, pour s’assurer l’impunité, les barons couvraient le sol de châteaux mieux défendus que jamais. Les mœurs de la noblesse offraient alors un singulier mélange de raffinements chevaleresques et de brigandage, de courtoisie et de marchés honteux. Au delà d’un certain point d’honneur et d’une galanterie romanesque, elle se croyait tout permis envers l’État, qui n’existait pas à ses yeux, et le peuple qu’elle affectait de mépriser d’autant plus qu’elle avait été forcée déjà de compter avec lui. Aussi est-ce à dater de ce moment que la haine populaire contre la féodalité acquit cette énergie active qui, transmise de générations en générations, éclata d’une manière si terrible à la fin du siècle dernier. Haine trop justifiée, il faut le dire ! Mais ces derniers temps de la féodalité chevaleresque et corrompue, égoïste et raffinée, doivent-ils nous empêcher de reconnaître les immenses services qu’avait rendus la noblesse féodale pendant les siècles précédents ?… La féodalité fut la trempe de l’esprit national en France ; et cette trempe est bonne. Aujourd’hui que les châteaux seigneuriaux sont détruits pour toujours, nous pouvons être justes envers leurs anciens possesseurs ; nous n’avons pas à examiner leurs intentions, mais les effets, résultats de leur puissance.
Au XIe siècle, les monastères attirent tout à eux, non-seulement les âmes délicates froissées par l’effrayant désordre qui existait partout, les esprits attristés par le tableau d’une société barbare où rien n’était assuré, où la force brutale faisait loi, mais aussi les grands caractères qui prévoyaient une dissolution générale si on ne parvenait pas à établir, au milieu de ce chaos, des principes d’obéissance et d’autorité absolue, appuyés sur la seule puissance supérieure qui ne fût pas contestée, celle de Dieu (voy. Architecture Monastique). Bientôt, en effet, les monastères, qui renfermaient l’élite des populations, furent non-seulement un modèle de gouvernement, le seul, mais étendirent leur influence en dehors des cloîtres et participèrent à toutes les grandes affaires religieuses et politiques de l’Occident. Mais, par suite de son institution même, l’esprit monastique pouvait maintenir, régenter, opposer une digue puissante au désordre ; il ne pouvait constituer la vie d’une nation, sa durée eût enfermé la civilisation dans un cercle infranchissable. Chaque ordre religieux était un centre dont on ne s’écartait que pour retomber dans la barbarie.
À la fin du XIIe siècle, l’esprit monastique était déjà sur son déclin ; il avait rempli sa tâche. Alors l’élément laïque s’était développé dans les villes populeuses ; les évêques et les rois lui offrirent, à leur tour, un point de ralliement en bâtissant les grandes cathédrales (voy. Cathédrale). Autre danger ; il y avait à craindre que la puissance royale, secondée par les évêques, ne soumît cette société à un gouvernement théocratique, immobile comme les anciens gouvernements de l’Égypte. C’est alors que la féodalité prend un rôle politique, peut-être à son insu, mais qu’il n’est pas moins important de reconnaître. Elle se jette entre la royauté et l’influence cléricale, empêchant ces deux pouvoirs de se confondre en un seul, mettant le poids de ses armes tantôt dans l’un des plateaux de la balance, tantôt dans l’autre. Elle opprime le peuple, mais elle le force de vivre ; elle le réveille, elle le frappe ou le seconde, mais l’oblige ainsi à se reconnaître, à se réunir, à défendre ses droits, à les discuter, à en appeler même à la force ; en lui donnant l’habitude de recourir aux tribunaux royaux, elle jette le tiers-état dans l’étude de la jurisprudence ; par ses excès mêmes, elle provoque l’indignation de l’opprimé contre l’oppresseur. L’envie que causent ses priviléges devient un stimulant énergique, un ferment de haine salutaire, car il empêche les classes inférieures d’oublier un instant leur position précaire, et les force à tenter chaque jour de s’en affranchir. Mieux encore, par ses luttes et ses défiances, la féodalité entretient et aiguise l’esprit militaire dans le pays, car elle ne connaît que la puissance des armes ; elle enseigne aux populations urbaines l’art de la fortification ; elle les oblige à se garder ; elle conserve d’ailleurs certains principes d’honneur chevaleresque que rien ne peut effacer, qui relevèrent l’aristocratie pendant les XVIe et XVIIe siècles, et qui pénétrèrent peu à peu jusque dans les plus basses classes de la société.
Il en est de l’éducation des peuples comme de celle des individus, qui, lorsqu’ils sont doués d’un tempérament robuste, apprennent mieux la vie sous des régents fantasques, durs et injustes même, que sous la main indulgente et paternelle de la famille. Sous le règne de Charles VI, la féodalité défendant mal le pays, le trahissant même, se fortifiant mieux que jamais dans les domaines, n’ayant d’autres vues que la satisfaction de son ambition personnelle, dévastant les campagnes et les villes sous le prétexte de nuire à tel ou tel parti, met les armes dans les mains du peuple, et Charles VII trouve des armées.
Si les provinces françaises avaient passé de l’influence monastique sous un régime monarchique absolu, elles eussent eu certainement une jeunesse plus heureuse et tranquille ; leur agglomération sous ce dernier pouvoir eût pu se faire sans secousses violentes, mais auraient-elles éprouvé ce besoin ardent d’union, d’unité nationale qui fait notre force aujourd’hui et qui tend tous les jours à s’accroître ? C’est douteux. La féodalité avait d’ailleurs un avantage immense chez un peuple qui se développait : elle entretenait le sentiment de la responsabilité personnelle, que le pouvoir monarchique absolu tend au contraire à éteindre ; elle habituait chaque individu à la lutte ; c’était un régime dur, oppressif, vexatoire, mais sain. Il secondait le pouvoir royal en forçant les populations à s’unir contre les châtelains divisés, à former un corps de nation.
Parmi les lois féodales qui nous paraissent barbares, il en était beaucoup de bonnes et dont nous devons, à nos dépens, reconnaître la sagesse, aujourd’hui que nous les avons détruites. L’inaliénabilité des domaines, les droits de chasse et de pêche entre autres, n’étaient pas seulement avantageux aux seigneurs, ils conservaient de vastes forêts, des étangs nombreux dont le défrichement et l’assèchement deviennent la cause de désastres incalculables pour le territoire, en nous envoyant ces inondations et ces sécheresses périodiques qui commencent à émouvoir les esprits disposés à trouver que tout est pour le mieux dans notre organisation territoriale actuelle. À cet égard, il est bon d’examiner d’un œil non prévenu ces lois remplies de détails minutieux sur la conservation des domaines féodaux. Ces lois sont dictées généralement par la prudence, par le besoin d’empêcher la dilapidation des richesses du sol. Si aujourd’hui, malgré tous les soins des gouvernements armés de lois protectrices, sous une administration pénétrant partout, il est difficile d’empêcher les abus de la division de la propriété, dans quels désordres la culture des campagnes ne serait-elle pas tombée au moyen âge, si la féodalité n’eût pas été intéressée à maintenir ses priviléges de possesseurs de terres, priviléges attaqués avec plus de passion que de réflexion, par un sentiment d’envie plutôt que par l’amour du bien général. Si ces priviléges sont anéantis pour jamais ; s’ils sont contraires au sentiment national, ce que nous reconnaissons ; s’ils ne peuvent trouver place dans notre civilisation moderne, constatons du moins ceci : c’est qu’ils n’étaient pas seulement profitables aux grands propriétaires du sol, mais au sol lui-même, c’est-à-dire au pays. Laissons donc de côté les discours banals des détracteurs attardés de la féodalité renversée, qui ne voient, dans chaque seigneur féodal, qu’un petit tyran tout occupé à creuser des cachots et des oubliettes ; ceux de ses amis qui nous veulent représenter ces barons comme des chevaliers défenseurs de l’opprimé et protecteurs de leurs vassaux, couronnant des rosières, et toujours prêts à monter à cheval pour Dieu et le roi ; mais prenons la féodalité pour ce qu’elle fut en France, un stimulant énergique, un de ces éléments providentiels qui concoururent (aveuglément, peu importe) à la grandeur de notre pays ; respectons les débris de ses demeures, car c’est peut-être à elles que nous devons d’être devenus en Occident la nation la plus unie, celle dont le bras et l’intelligence ont pesé et pèseront longtemps sur les destinées de l’Europe.
Examinons maintenant cette dernière phase, brillante encore, de la demeure féodale, celle qui commence avec le règne de Charles VI.
La situation politique du seigneur s’était modifiée ; il ne pouvait plus compter, comme dans les beaux temps de la féodalité, sur le service de ses hommes des villages et campagnes (ceux-ci ayant manifesté leur haine profonde pour le système féodal) ; il savait que leur concours forcé eût été plus dangereux qu’utile ; c’était donc à leurs vassaux directs, aux chevaliers qui tenaient des fiefs dépendant de la seigneurie et à des hommes faisant métier des armes qu’il fallait se fier, c’est-à-dire à tous ceux qui étaient mus par les mêmes intérêts et les mêmes goûts ; c’est pourquoi le château de la fin du XIVe siècle prend, plus encore qu’avant cette époque, l’aspect d’une forteresse, bien que la puissance féodale ait perdu la plus belle part de son prestige. Le château du commencement du XVe siècle proteste contre les tendances populaires de son temps, il s’isole et se ferme plus que jamais ; les défenses deviennent plus savantes parce qu’elles ne sont garnies que d’hommes de guerre. Il n’est plus une protection pour le pays, mais un refuge pour une classe privilégiée qui se sent attaquée de toutes parts, et qui fait un suprême effort pour ressaisir la puissance.
Au XIIe siècle, le château de Pierrefonds, ou plutôt de Pierre-fonts, était déjà un poste militaire d’une grande importance, possédé par un comte de Soissons, nommé Conon. Il avait été, à la mort de ce seigneur qui ne laissait pas d’héritiers, acquis par Philippe-Auguste, et ce prince avait confié l’administration des terres à un bailli et un prévôt, abandonnant la jouissance des bâtiments seigneuriaux aux religieux de Saint-Sulpice. Par suite de cette acquisition, les hommes coutumiers du bourg avaient obtenu du roi une « charte de commune qui proscrivoit l’exercice des droits de servitude, de main-morte et de formariage et en reconnaissance de cette immunité, les bourgeois de Pierrefonds devaient fournir au roi soixante sergents, avec une voiture attelée de quatre chevaux[116]. » Par suite de ce démembrement de l’ancien domaine, le château n’était guère plus qu’une habitation rurale ; mais sous le règne de Charles VI, Louis d’Orléans, premier duc de Valois, jugea bon d’augmenter ses places de sûreté, et se mit en devoir, en 1390, de faire reconstruire le château de Pierrefonds sur un point plus fort et mieux choisi, c’est-à-dire à l’extrémité du promontoire qui domine une des plus riches vallées des environs de Compiègne, en profitant des escarpements naturels pour protéger les défenses sur trois côtés, tandis que l’ancien château était assis sur le plateau même, à cinq cents mètres environ de l’escarpement. La bonne assiette du lieu n’était pas la seule raison qui dût déterminer le choix du duc d’Orléans. Si l’on jette les yeux sur la carte des environs de Compiègne, on voit que la forêt du même nom est environnée de tous côtés par des cours d’eau, qui sont : l’Oise, l’Aisne et les deux petites rivières de Vandi et d’Automne. Pierrefonds, appuyé à la forêt vers le nord, se trouvait ainsi commander un magnifique domaine facile à garder sur tous les points, ayant à sa porte une des plus belles forêts des environs de Paris. C’était donc un lieu admirable, pouvant servir de refuge et offrir les plaisirs de la chasse au châtelain. La cour de Charles VI était très-adonnée au luxe, et parmi les grands vassaux de ce prince, Louis d’Orléans était un des seigneurs les plus magnifiques, aimant les arts, instruit, ce qui ne l’empêchait pas d’être plein d’ambition et d’amour du pouvoir ; aussi voulut-il que son nouveau château fut, à la fois, une des plus somptueuses résidences de cette époque et une forteresse construite de manière à défier toutes les attaques. Monstrelet en parle comme d’une place de premier ordre et un lieu admirable.
Pendant sa construction, le château de Pierrefonds, défendu par Bosquiaux, capitaine du parti des Armagnacs, fut attaqué par le comte de Saint-Pol, envoyé par Charles VI pour réduire les places occupées par son frère ; Bosquiaux, plutôt que de risquer de laisser assiéger ce beau château encore inachevé, sur l’avis du duc d’Orléans, rendit la place, qui, plus tard, lui fut restituée. Le comte de Saint-Pol ne la quitta toutefois qu’en y mettant le feu. Louis d’Orléans répara le dommage et acheva son œuvre. En 1420, le château de Pierrefonds, dont la garnison était dépourvue de vivres et de munitions, ouvrit ses portes aux Anglais. Charles d’Orléans et Louis XII complétèrent cette résidence ; toutefois il est à croire que ces derniers travaux ne consistaient guère qu’en ouvrages intérieurs, car la masse encore imposante des constructions appartient aux commencements du XVe siècle.

À Pierrefonds, le donjon est non-seulement le point principal de la défense, c’est encore l’habitation seigneuriale, construite avec recherche, et contenant un grand nombre de services propres à rendre ses appartements agréables. Il se compose d’un étage de caves, d’un rez-de-chaussée voûté dont nous donnons le plan, qui ne pouvait servir que de magasins, de dépôts de provisions, et de trois étages de salles munies de cheminées. À chaque étage, la distribution était pareille à celle du rez-de-chaussée ; mais les salles, séparées par des planchers, ne possédaient plus les colonnes que nous voyons sur notre plan. De la salle principale des étages supérieurs, à laquelle on arrivait par le grand escalier P, on communiquait à la tour carrée O par un passage pratiqué dans l’angle de jonction, et ces salles principales étaient éclairées chacune par deux larges et hautes fenêtres percées dans le mur oriental de chaque côté des cheminées. Ce donjon était couvert par deux combles avec chéneau intermédiaire sur le mur de refend qui le coupe de l’est à l’ouest. Deux pignons à l’est et deux pignons à l’ouest fermaient ces deux combles. Entre le donjon et la tour sud-est étaient de grandes latrines J auxquelles on arrivait par un passage détourné ; entre ces latrines et la petite salle sud-est du donjon est un retrait prenant jour sur la cour Q. De cette même salle sud-est, au niveau des caves, on communiquait à une petite poterne R donnant sur le fossé et à l’escalier de la tour d’angle. Un gros contrefort S, à l’angle du donjon, sur la cour principale, était probablement terminé par une échauguette, sorte de petit redan qui commandait le couloir de l’entrée L. Le grand escalier P était précédé, du côté le plus en vue, sur la cour, par un large perron et une loge ou portique qui permettaient au seigneur et à ses principaux officiers de réunir la garnison dans la cour et de lui donner des ordres d’un point élevé[118]. La disposition de ce perron dut être modifiée ; nous avons lieu de croire qu’il n’était dans l’origine qu’une terrasse avec un petit escalier posé sur le côté. Une annexe importante du donjon de Pierrefonds, c’est la tour carrée O. Posée à l’angle nord-est, elle est flanquée de contreforts portant à leur sommet des échauguettes, qui permettaient de voir ce qui se passait dans la campagne par-dessus la courtine T, la seule qui ne soit pas doublée par des bâtiments, car l’espace Q est une cour. En V, la courtine T est percée d’une large poterne munie de vantaux et d’un pont-levis ; le seuil de cette poterne est placé à huit mètres au-dessus de la base extérieure de la muraille. À partir de cette base, l’escarpement du plateau étant assez abrupt, il n’est guère possible d’admettre qu’un pont à niveau donnait accès à la poterne ; quoique en face, à cinquante mètres environ du rempart, il existe un mamelon qui paraît élevé en partie à main d’homme et qui semble avoir été surmonté d’un châtelet. Nous serions disposés à croire que la poterne V était munie d’une de ces trémies assez fréquemment employées dans les châteaux pour faire entrer, au moyen d’un treuil, les approvisionnements de toute nature, sans être obligé d’admettre des personnes étrangères à la garnison dans l’enceinte intérieure ; dans ce cas, le châtelet, placé sur le mamelon en dehors, aurait été destiné à masquer et à protéger l’introduction des approvisionnements. Comme surcroît de précaution, le contrefort nord-est de la tour O, relié à la chapelle Y, est percé d’une porte garnie de vantaux et d’une herse. Si donc il était nécessaire d’admettre des étrangers dans la cour Q pour l’approvisionnement du château, ceux-ci ne pouvaient pénétrer dans la cour intérieure, ni même voir ce qui s’y passait. Nous verrons tout à l’heure quelle était l’utilité double de cette porte X. La tour carrée O possède cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée, se démanchant avec les planchers du donjon et ne communiquant, comme nous l’avons dit, avec ceux-ci que par des passages détournés et des bouts de rampes. C’était un ouvrage qui, au besoin, pouvait s’isoler, commandait les dehors par son élévation, donnait des signaux aux défenses supérieures de la grosse tour I et en pouvait recevoir. Les deux entrées principales du château G et V étaient ainsi fortement protégées par des ouvrages très-élevés et puissants, et les deux angles sud-ouest et nord-est du donjon, bien appuyés, bien flanqués, couvraient sa masse. Quant à l’angle sud-est, le plus exposé, il était devancé par une tour très-haute Z possédant une guette et cinq étages de défenses. Ce n’était pas par sa propre construction que le donjon de Pierrefonds, l’habitation seigneuriale, se défendait, mais par les appendices considérables dont il était entouré.
Les autres parties du château de Pierrefonds ne sont pas moins intéressantes à observer. La grand’salle était en a, couverte par une charpente avec entraits apparents, suivant l’usage. Une large cheminée la chauffait. La grand’salle était en communication avec une seconde salle b, d’où l’on parvenait à la tour du coin c. La construction de cette tour est fort singulière, et nous pensons qu’on peut la regarder comme destinée aux oubliettes. Il n’est pas un château dans lequel les Guides ne vous fassent voir des oubliettes, et généralement ce sont les latrines qui sont accusées d’avoir englouti des victimes humaines sacrifiées à la vengeance des châtelains féodaux ; mais, cette fois, il nous paraît difficile de ne pas voir de véritables oubliettes dans la construction de la tour sud-ouest du château de Pierrefonds. Au-dessus du rez-de-chaussée est un étage voûté en arcs ogives, et au-dessous de cet étage une cave d’une profondeur de 7 mètres, voûtée en calotte elliptique. On ne peut descendre dans cette cave que par un œil percé à la partie supérieure de la voûte, c’est-à-dire au moyen d’une échelle ou d’une corde à nœuds ; au centre de l’aire de cette cave circulaire est creusé un puits, qui nous a paru avoir huit mètres de profondeur, bien qu’en partie comblé ; puits dont l’ouverture de 1m,60 de diamètre correspond à l’œil pratiqué au centre de la voûte elliptique de la cave. Cette cave, qui ne reçoit ni jour ni air de l’extérieur, est accompagnée d’un siége d’aisance pratiqué dans l’épaisseur du mur. Elle était donc destinée à recevoir un être humain, et le puits creusé au centre de son aire était probablement une tombe toujours ouverte pour les malheureux que l’on voulait faire disparaître à tout jamais[119] (voy. Oubliettes).
Ce qui viendrait appuyer encore notre opinion, c’est que la grand’salle a servait, suivant l’usage, de tribunal (son parquet était placé en a′). Les justiciables cités devant le tribunal du seigneur étaient introduits par le corps de garde M dans la salle d’attente b, sans pouvoir entrer dans la cour du château, puisque la herse du passage L est placée au delà de l’entrée du corps de garde. C’était là, en effet, un point important, aucune personne étrangère à la garnison ne devant, à cette époque, pénétrer dans un château, à moins d’une permission spéciale. Après avoir subi la question dans la tour e joignant la grand’salle, si les accusés étaient reconnus coupables, ils étaient ramenés devant la tribune a′ pour entendre prononcer leur condamnation, et de là entraînés dans la tour du coin c pour y être enfermés soit dans la salle du rez-de-chaussée, soit dans la cave, soit enfin dans le cul de basse-fosse que nous venons de décrire, suivant la rigueur de la peine qu’ils devaient subir. S’ils étaient reconnus innocents, ils sortaient par le corps de garde comme ils étaient entrés, sans pouvoir donner les moindres détails sur les dispositions intérieures du château, puisqu’ils n’avaient vu que le tribunal et ses annexes. La grand’salle a et cette annexe b occupaient toute la hauteur du bâtiment en aile. La tour e était munie de cinq étages de défenses, flanquait la courtine et commandait le dehors des lices.
La garnison logeait dans l’aile du nord, et au rez-de-chaussée les cuisines étaient très-probablement disposées en l. Un grand escalier à vis f montait aux deux étages de cette aile au-dessus du rez-de-chaussée. La tour g contient de grandes latrines à tous les étages, ce qui indique sur ce point un nombreux personnel. Ces latrines sont ingénieusement disposées pour éviter l’odeur. Elles ont à l’étage inférieur une large fosse avec conduit latéral pour l’extraction des matières, et tuyau de ventilation[120]. Un poste était établi dans les salles h. Les deux tours UU’, les mieux conservées de tout le château, sont admirables comme construction et dispositions défensives ; tous leurs étages, sauf les caves, sont munis de cheminées. Deux autres salles réservées à la garnison sont situées en m. C’était par la salle n que l’on descendait aux vastes caves qui s’étendent sous l’aile de l’ouest. Nous donnons en B le plan de l’étage inférieur de l’aile du nord au niveau du sol des lices, qui se trouve à huit mètres en contrebas du sol de la cour intérieure. En p est une petite poterne fermée seulement par des vantaux. C’était par cette poterne que devaient sortir et rentrer les rondes en cas de siége et avant la prise des lices. Pour se faire ouvrir la porte, les rondes se faisaient reconnaître au moyen d’un porte-voix pratiqué à la gauche de cette poterne, et qui, se divisant en deux branches dans l’épaisseur du mur de refend, correspondait au poste du rez-de-chaussée h et au premier étage. Il fallait ainsi que deux postes séparés eussent reconnu la ronde pour faire ouvrir la poterne par des hommes placés dans un entresol situé au-dessus de l’espace q, à mi-étage. Mais ces hommes n’entendaient pas le mot de passe jeté par ceux du dehors dans le porte-voix, et ne devaient aller ouvrir la poterne, en descendant par un escalier de bois pratiqué en u, qu’après en avoir reçu avis du poste supérieur. D’ailleurs, en cas de trahison, le poste voûté de l’entresol, ne communiquant pas avec le rez-de-chaussée de la cour, n’eût pas permis à l’ennemi de s’introduire dans le château, en admettant qu’il fût parvenu à surprendre ce poste. Une fois la ronde entrée par la poterne p, il était nécessaire qu’elle connût les distributions intérieures du château ; car, pour parvenir à la cour, il lui fallait suivre à gauche le couloir s, se détourner sous l’aile de l’est, monter par le petit escalier à vis t, passer sur un pont volant assez élevé au-dessus de la cour Q, et se présenter devant la porte X fermée de vantaux et par une herse. Si une troupe ennemie s’introduisait par la poterne p, trois couloirs se présentaient à elle, dont deux, les couloirs r et k, sont des impasses ; elle risquait ainsi de s’égarer et de perdre un temps précieux.
Si les dispositions défensives du château de Pierrefonds n’ont pas la grandeur majestueuse de celles du château de Coucy, elles ne laissent pas d’être combinées avec un art, un soin et une recherche dans les détails, qui prouvent à quel degré de perfection étaient arrivées les constructions des places fortes seigneuriales à la fin du XIVe siècle, et jusqu’à quel point les châtelains à cette époque étaient en défiance des gens du dehors.
Les lices EE′E″ étaient autrefois munies de merlons détruits pour placer du canon à une époque plus récente ; elles dominent l’escarpement naturel qui est de vingt mètres environ au-dessus du fond du vallon. Au sud de la basse-cour, le plateau s’étend de plain-pied en s’élargissant et se relie à une chaîne de collines en demi-lune présentant sa face concave vers la forteresse. Cette situation était fâcheuse pour le château, du moment que l’artillerie à feu devenait un moyen ordinaire d’attaque, car elle permettait d’envelopper la face sud d’un demi-cercle de feux convergents. Aussi, dès l’époque de Louis XII, deux forts en terre, dont on retrouve encore la trace, avaient été élevés au point de jonction du plateau avec la chaîne de collines. Entre ces forts et la basse-cour, de beaux jardins s’étendaient sur le plateau, et ils étaient eux-mêmes entourés de murs de terrasses avec parapets.
Nous avons vainement cherché les restes des aqueducs qui devaient nécessairement amener de l’eau dans l’enceinte du château de Pierrefonds. Nulle trace de puits dans cette enceinte, non plus que dans la basse-cour. Les approvisionnements d’eau étaient donc obtenus au moyen de conduites qui prenaient les sources que l’on rencontre sur les rampants des collines se rattachant au plateau. Tout ce qui est nécessaire à la vie journalière d’une nombreuse garnison et à sa défense est trop bien prévu ici pour laisser douter du soin apporté par les constructeurs dans l’exécution des aqueducs. Il serait intéressant de retrouver la trace de ces conduits au moyen de fouilles dirigées avec intelligence.

Mais ce qui doit particulièrement attirer notre attention dans cette magnifique résidence, c’est le système de défense nouvellement adopté à cette époque. Chaque portion de courtine est défendue à sa partie supérieure par deux étages de chemins de ronde, l’étage inférieur étant muni de machicoulis, créneaux et meurtrières ; l’étage supérieur, sous le comble, de créneaux et meurtrières seulement (voy. Architecture Militaire, fig. 37). Les sommets des tours possèdent trois, quatre et cinq étages de défenses, un chemin de ronde avec machicoulis et créneaux au niveau de l’étage supérieur des courtines, un ou deux étages de créneaux avec meurtrières intermédiaires et un parapet crénelé autour des combles. Si l’on s’en rapporte à une vignette assez ancienne (XVIe siècle), la tour e, bâtie au milieu de la courtine de l’ouest, vers la ville, possédait cinq étages de défenses, ainsi que celles du coin Z et du donjon I. Une guette très-élevée surmontait celle du coin. Malgré la multiplicité de ces défenses, elles pouvaient être garnies d’un nombre de défenseurs relativement restreint, car elles sont disposées avec ordre, les communications sont faciles, les courtines sont bien flanquées par des tours saillantes et rapprochées, les rondes peuvent se faire de plain-pied tout autour du château à la partie supérieure sans être obligé de descendre des tours sur les courtines et de remonter de celles-ci dans les tours, ainsi que l’on était forcé de le faire dans les châteaux des XIIe et XIIIe siècles. On remarquera qu’aucune meurtrière n’est percée à la base des tours. Ce sont les crénelages des murs extérieurs des lices qui seuls défendaient les approches. La garnison, forcée dans cette première enceinte, se réfugiait dans le château, et, occupant les étages supérieurs, bien couverts par de bons parapets, écrasait les assaillants qui tentaient de s’approcher du pied des remparts.
Bertrand Du Guesclin avait attaqué quantité de châteaux bâtis pendant les XIIe et XIIIe siècles, et profitant du côté faible des dispositions défensives de ces places fortes, il faisait, le plus souvent, appliquer des échelles le long des courtines basses des châteaux de cette époque, en ayant le soin d’éloigner les défenseurs par une grèle de projectiles ; il brusquait l’assaut et prenait les places autant par échelades que par les moyens lents de la mine et de la sape.
Nous avons indiqué, dans les notes sur la description du Louvre de Guillaume de Lorris, comment la défense des anciens châteaux des XIIe et XIIIe siècles exigeait un grand nombre de postes divisés, se défiant les uns des autres et se gardant séparément. Ce mode de défense était bon contre des troupes n’agissant pas avec ensemble, et procédant, après un investissement préalable, par une succession de sièges partiels ou par surprise ; il était mauvais contre des armées disciplinées entraînées par un chef habile qui, abandonnant les voies suivies jusqu’alors, faisait sur un point un grand effort, enlevait les postes isolés sans leur laisser le temps de se reconnaître et de se servir de tous les détours et obstacles accumulés dans la construction des forteresses. Pour se bien défendre dans un château du XIIIe siècle, il fallait que la garnison n’oubliât pas un instant de profiter de tous les détails infinis de la fortification. La moindre erreur ou négligence rendait ces obstacles non-seulement inutiles, mais même nuisibles aux défenseurs ; et dans un assaut brusqué, dirigé avec énergie, une garnison perdait ses moyens de résistance à cause même de la quantité d’obstacles qui l’empêchaient de se porter en masses sur un point attaqué. Les défenseurs, obligés de monter et de descendre sans cesse, d’ouvrir et de fermer quantité de portes, de filer un à un dans de longs couloirs et des passages étroits, trouvaient la place emportée avant d’avoir pu faire usage de toutes leurs ressources. Cette expérience profita certainement aux constructeurs de forteresses à la fin du XIVe siècle ; ils élevèrent les courtines pour se garantir des échelades, n’ouvrirent plus de meurtrières dans les parties basses des ouvrages, mais les renforcèrent par des talus qui avaient en outre l’avantage de faire ricocher les projectiles tombant des machicoulis ; ils mirent les chemins de ronde et courtines en communication directe, afin de présenter, au sommet de la fortification, une ceinture non-interrompue de défenseurs pouvant facilement se rassembler en nombre vers le point attaqué et recevant les ordres avec rapidité ; ils munirent les machicoulis de parapets solides bien crénelés et couverts, pour garantir les hommes contre les projectiles lancés du dehors. Les chemins de ronde donnant dans les salles supérieures servant de logements aux troupes (des bâtiments étant alors adossés aux courtines), les soldats pouvaient à toute heure et en un instant occuper la crête des remparts.
Le château de Pierrefonds remplit exactement ce nouveau programme. Nous avons fait le calcul du nombre d’hommes nécessaire pour garnir l’un des fronts de ce château. Ce nombre pouvait être réduit à soixante hommes pour les grands fronts et à quarante pour les petits côtés. Or pour attaquer deux fronts à la fois, il faudrait supposer une troupe très-nombreuse, deux mille hommes au moins, tant pour faire les approches que pour forcer les lices, s’établir sur les terre-plains E E′E″, faire approcher les engins et les protéger. La défense avait donc une grande supériorité sur l’attaque. Par les larges machicoulis des chemins de ronde inférieurs, elle pouvait écraser les pionniers qui auraient voulu s’attacher à la base des murailles. Pour que ces pionniers pussent commencer leur travail, il eût fallu soit creuser des galeries de mines, soit établir des passages couverts en bois ; ces opérations exigeaient beaucoup de temps, beaucoup de monde et un matériel de siège. Les tours et courtines sont d’ailleurs renforcées à la base par un empattement qui double à peu près l’épaisseur de leurs murs, et la construction est admirablement faite en bonne maçonnerie, avec revêtement de pierre de taille dure. Les assaillants se trouvaient, une fois dans les lices, sur un espace étroit, ayant derrière eux un précipice et devant eux de hautes murailles couronnées par plusieurs étages de défenses ; ils ne pouvaient se développer, leur grand nombre devenait un embarras ; exposés aux projectiles de face et d’écharpe, leur agglomération sur un point devait être une cause de pertes sensibles ; tandis que les assiégés, bien protégés par leurs chemins de ronde couverts, dominant la base des remparts à une grande hauteur, n’avaient rien à redouter et ne perdaient que peu de monde. Une garnison de trois cents hommes pouvait tenir en échec un assiégeant dix fois plus fort pendant plusieurs mois. Si, après s’être emparé des deux forts du jardin et de la basse-cour de Pierrefonds, l’assiégeant voulait attaquer le château par le côté de l’entrée, il lui fallait combler un fossé très-profond enfilé par la grosse tour I du donjon et par les deux tours de coin ; sa position était plus mauvaise encore, car soixante hommes suffisaient largement sur ce point pour garnir les défenses supérieures ; et, pendant l’attaque, une troupe, faisant une sortie par la poterne p, allait prendre l’ennemi en flanc dans le fossé, soit par le terre-plain E, soit par celui E″. Le châtelain de Pierrefonds pouvait donc, à l’époque où ce château fut construit, se considérer comme à l’abri de toute attaque, à moins que le roi n’envoyât une armée de plusieurs mille hommes bloquer la place et faire un siège en règle. L’artillerie à feu seule pouvait avoir raison de cette forteresse, et l’expérience prouva que, même devant ce moyen puissant d’attaque, la place était bonne ; Henri IV voulut la réduire ; elle était encore entre les mains d’un ligueur nommé Rieux[121] ; le duc d’Épernon se présenta devant Pierrefonds, en mars 1591, avec un gros corps d’armée et du canon ; mais il n’y put rien faire, et leva le siège après avoir reçu un coup de feu pendant une attaque générale qui fut repoussée par Rieux et quelques centaines de routiers qu’il avait avec lui. Toutefois, ce capitaine, surpris avec un petit nombre des siens pendant qu’il faisait le métier de voleur de grand chemin, fut pendu à Noyon, et la place de Pierrefonds, commandée par son lieutenant, Antoine de Saint-Chamant, fut de nouveau assiégée par l’armée royale, sous les ordres de François des Ursins, qui n’y fit pas mieux que d’Épernon. Une grosse somme d’argent donnée au commandant de Pierrefonds fit rentrer enfin cette forteresse dans le domaine royal[122].
En 1616, le marquis de Cœuvre, capitaine de Pierrefonds, ayant embrassé le parti des Mécontents, le cardinal de Richelieu fit décider dans le conseil du roi que la place serait assiégée par le comte d’Auvergne. Cette fois elle fut attaquée avec méthode et en profitant de la disposition des collines environnantes. Des batteries, protégées par de bons épaulements qui existent encore, furent élevées sur la crête de la demi-lune de coteaux qui cerne le plateau à son extrémité sud. Les deux fortins ayant été écrasés de feux furent abandonnés par les assiégés ; le comte d’Auvergne s’en empara aussitôt, y établit des pièces de gros calibre, et, sans laisser le temps à la garnison de se reconnaître, ouvrit contre la grosse tour du donjon, la courtine sud et les deux tours du coin, un feu terrible qui dura deux jours sans relâche. À la fin du second jour, la grosse tour du donjon s’écroula, entraînant dans sa chute une partie des courtines environnantes. Le capitaine Villeneuve, qui commandait pour le marquis, s’empressa dès lors de capituler, et Richelieu fit démanteler la place, trancher les tours du nord, et détruire la plus grande partie des logements.
Tel qu’il est encore aujourd’hui, avec ses bâtiments rasés et ses tours éventrées à la sape, le château de Pierrefonds est un sujet d’études inépuisable. Des fouilles ont déjà dégagé les ouvrages du sud vers le fossé, et si ces travaux étaient continués, ils donneraient des renseignements précieux ; car c’est de ce côté que devaient être les défenses les plus fortes, comme étant le plus accessible. On voit encore dans les salles ruinées du donjon des traces qui indiquent leur décoration intérieure et qui consistait principalement en boiseries appliquées contre les murs. Les rainures destinées à recevoir les bâtis de ces lambris existent, ainsi que de nombreux scellements et quantité de clous à crochets propres à suspendre des tapisseries. Bien que la destruction de cette forteresse ait été une nécessité, on ne peut, en voyant ses ruines importantes, s’empêcher de regretter qu’elle ne soit pas parvenue intacte jusqu’à nos jours, car elle présentait certainement le spécimen le plus complet d’un château bâti d’un seul jet, à une époque où l’artillerie à feu n’était pas encore employée comme moyen d’attaque contre les forteresses, et où cependant les armes à jet du moyen âge et tous les engins de siège avaient atteint leur plus grande perfection. Il nous donnerait une idée de ce qu’étaient ces demeures déjà richement décorées à l’intérieur, où les habitudes de luxe et de comfort même commençaient à prendre, dans la vie des seigneurs, une grande place.

Si nous voulons voir un château de la même époque, mais bâti dans des proportions plus modestes, il nous faut aller à Sully-sur-Loire. Le plan que nous en donnons (26) est à la même échelle que celui de Pierrefonds[123]. Les tours de ces deux forteresses, combinées de la même manière au point de vue de la défense à leur sommet, sont de diamètres égaux. Mais Pierrefonds est un château bâti sur un escarpement, tandis que Sully est un château de plaine élevé sur le bord de la Loire, entouré de larges et profonds fossés B alimentés par le fleuve. C’est le bâtiment principal F, le donjon, qui fait face à la Loire et qui n’en est séparé que par un fossé et une levée assez étroite. En avant de l’unique entrée C est la basse-cour entourée d’eau et protégée par des murs d’enceinte dont les soubassements existent seuls aujourd’hui. La porte est, conformément aux dispositions adoptées dès le XIIIe siècle, divisée en porte charretière et poterne, ayant l’une et l’autre leur pont-levis particulier. Lorsqu’on est entré dans la cour D, on ne peut pénétrer dans le donjon F qu’en passant sur un second pont-levis jeté sur un fossé et une porte bien défendue flanquée de deux tourelles, dont l’une contient l’escalier qui dessert les trois étages de ce bâtiment. Outre cet escalier principal, chaque tour possède son escalier de service. Les étages des tours, comme à Pierrefonds, ne sont point voûtés, mais séparés par des planchers en bois. Le corps de logis F, divisé en deux salles, possède un rez-de-chaussée et deux étages fort beaux[124], le second étant mis en communication avec les chemins de ronde munis de machicoulis, de meurtrières et de créneaux. Comme à Pierrefonds aussi, les tours dominent de beaucoup le grand corps de logis F, qui lui-même commande les bâtiments en aile. Les côtés G étaient seulement défendus par des courtines couvertes et une tour de coin[125].

Nous ne croyons pas nécessaire de multiplier les exemples de châteaux bâtis de 1390 à 1420, car, en ce qui touche à la défense, ces constructions ont, sur toute la surface de la France, une analogie frappante. Si, au XIIe siècle, on rencontre des différences notables dans la façon de fortifier les résidences seigneuriales, au commencement du XVe siècle il y avait unité parfaite dans le mode général de défense des places et dans les habitudes intérieures du châtelain. Une grande révolution se préparait cependant, révolution qui devait à tout jamais détruire l’importance politique des châteaux féodaux ; l’artillerie à feu devenait un moyen terrible d’attaque et de défense ; employée d’abord en campagne contre les armées mobiles, on reconnut bientôt qu’elle pouvait servir à la défense des forteresses. On plaça donc des bouches à feu à l’entour des châteaux, le long des lices et sur les plates-formes. Beaucoup de donjons et de tours virent enlever leur toiture, qui fut remplacée par des terrasses pour loger de l’artillerie. Toutefois ces engins, posés sur des points très-élevés, devaient causer au milieu des assaillants plus d’effroi que de mal ; leur feu plongeant et assez rare (ces pièces étant fort longues à charger) ne causait pas grand dommage. D’un autre côté, les assiégeants amenèrent aussi des pièces de fort calibre pour battre les murailles, et leur effet fut tel que les possesseurs des châteaux reconnurent bientôt qu’il fallait modifier les défenses pour les préserver contre ces nouveaux engins de destruction. Ce ne fut qu’à grand’peine cependant qu’ils se rendirent à l’évidence, tant les vieilles tours de leurs châteaux leur inspiraient de confiance. L’artillerie à feu fut, au contraire, adoptée avec empressement par les armées nationales, par le peuple et la royauté. Le peuple, soit instinct, soit calcul, comprit rapidement qu’il avait enfin entre les mains le moyen de détruire cette puissance féodale à laquelle, depuis le XIVe siècle, il avait voué une haine mortelle. Une armée de vilains ne savait pas résister à ces hommes couverts de fer, habitués dès l’enfance au maniement des armes et possédant cette confiance en leur force et leur courage qui supplée au nombre. Les tentatives de révolte ouverte avaient été d’ailleurs cruellement châtiées pendant le XIVe siècle, et à la place des vieux châteaux du XIIe siècle, les populations des campagnes et des bourgades avaient vu, pendant le règne de Charles V et au commencement de celui de Charles VI, leurs seigneurs dresser de nouvelles forteresses aussi imposantes d’aspect qu’elles étaient bien munies et combinées pour la défense. Les barons, plus orgueilleux que jamais, malgré la diminution de leur puissance politique, n’avaient pas à craindre les soulèvements populaires derrière leurs murailles, et regardaient alors un bon château comme un moyen de composer avec les partis qui déchiraient le pays. La royauté affaiblie, ruinée, sans influence sur ses grands vassaux, semblait en être revenue aux humiliations des derniers Carlovingiens. L’invasion étrangère ajoutait encore à ces malheurs, et les seigneurs, soit qu’ils restassent fidèles au roi de France, soit qu’ils prissent parti pour les Bourguignons et les Anglais, conservaient leurs places fortes comme un moyen d’obtenir des concessions de l’un ou l’autre parti au détriment des populations, qui, dans ces intrigues et ces marchés, étaient toujours foulées et supportaient seules les frais et les dommages d’une guerre désastreuse.
Cependant des bourgeois, des gens de métier cherchaient à tirer parti de la nouvelle puissance militaire que le XIVe siècle avait vu naître, et, vers 1430, grâce à leurs efforts, les armées royales pouvaient déjà dresser des batteries de canons devant les châteaux (voy. Architecture Militaire).
Mais alors, en France, la noblesse comme le peuple étaient tout occupés à chasser les Anglais du royaume, et la grande guerre étouffait ces querelles de seigneur à seigneur, non qu’elles n’eussent toujours lieu, mais elles n’avaient pas d’importance en face des événements qui agitaient la nation. Aussi, peu de châteaux furent élevés pendant cette période de luttes terribles. Dans les châteaux bâtis vers le milieu du XVe siècle, on voit cependant que l’artillerie à feu commence à préoccuper les constructeurs ; ceux-ci n’abandonnent pas l’ancien système de courtines flanquées de tours, système consacré par un trop long usage pour être mis brusquement de côté ; mais ils le modifient dans les détails ; ils étendent les défenses extérieures et ne songent pas encore à placer du canon sur les tours et courtines. Conservant les couronnements pour la défense rapprochée, ils garnissent de bouches à feu les parties inférieures des tours.
Cette transition est fort intéressante à étudier, et quoique nous possédions peu de châteaux qui aient été bâtis d’un seul jet pendant le règne de Charles VII, il en est un cependant que nous donnerons ici, tant à cause de son état de conservation que parce que son système de défense est suivi avec méthode dans toutes ses parties ; c’est le château de Bonaguil. Sis à quelques kilomètres de Villeneuve-d’Agen, ce château est bâti sur un promontoire qui commande un défilé ; son assiette est celle de tous les châteaux de montagne ; entouré d’escarpements, il n’est accessible que d’un seul côté.
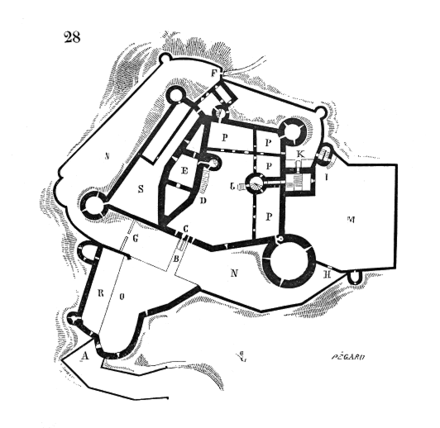
En voici le plan (28)[127] : en A est la première entrée, munie d’un pont-levis et s’ouvrant dans un ouvrage avancé, sorte de barbacane ou de boulevard O. On voit ici déjà que les constructeurs se sont efforcés de flanquer cette première défense. En R étaient des écuries probablement. Un large fossé taillé dans le roc sépare l’ouvrage avancé du château, dans lequel on pénètre par un second pont-levis B avec porte et poterne C. Un donjon E, de forme bizarre, commande les dehors, l’ouvrage avancé O et les fossés. En P sont élevés les bâtiments d’habitation auxquels on arrive par un bel escalier à vis J. D est la rampe qui monte à la porte surélevée du donjon E. En S est un ouvrage séparé du château par le donjon. Comme à Pierrefonds, le donjon établit une séparation entre deux cours. Les ponts-levis relevés, on ne pouvait s’introduire dans le château qu’en franchissant la poterne F percée dans le mur de contre-garde extérieur, en suivant le fond du fossé N, en franchissant une seconde porte G percée dans une traverse, une troisième porte H donnant sur une belle plate-forme M, en prenant l’escalier I, et passant par un petit pont-levis K. Là on trouvait un bel et large escalier à paliers ne communiquant à l’escalier J intérieur que par un étroit et sombre couloir sur lequel, à droite et à gauche, s’ouvrent des meurtrières. Le grand escalier ne monte que jusqu’au rez-de-chaussée, surélevé de la cour intérieure ; sa cage se termine à son sommet par une grosse tour carrée en communication avec les appartements. On voit qu’ici, comme dans les anciens châteaux féodaux, toutes les précautions les plus minutieuses étaient prises pour masquer les entrées et les rendre d’un accès difficile. Par le fait, il n’y a qu’une seule entrée, celle A B, les détours que nous venons de décrire ne pouvant être pratiqués que par les familiers du château et pour faire des sorties lorsque besoin était. Mais des dispositions, toutes nouvelles alors, viennent modifier l’ancien système défensif ; d’abord l’ouvrage avancé O avec la plate-forme M donnent des saillants considérables, qui battent les dehors au loin, et flanquent le château du côté où il est accessible de plain-pied ; puis au ras de la contrescarpe des fossés, au niveau de la crête des murs de contre-garde, des embrasures pour du canon sont percées à rez-de-chaussée dans les courtines et les étages inférieurs des tours ; les tours sont à peine engagées, pour mieux flanquer les courtines. Si l’on en juge par l’ouverture des portes qui donnent entrée dans les tours, les pièces mises ainsi en batterie à rez-de-chaussée ne pouvaient être d’un gros calibre. Quant aux couronnements, ils sont munis de chemins de ronde saillants avec machicoulis et créneaux ; mais les consoles portant les parapets de la grosse tour cylindrique ne sont plus de simples corbeaux de 0,30 c. à 0,40 c. d’épaisseur ; ce sont de gros encorbellements, des pyramides posées sur la pointe, qui résistaient mieux au boulet que les supports des premiers machicoulis (voy. Mâchicoulis). Les merlons des parapets sont percés de meurtrières qui indiquent évidemment, par leur disposition, l’emploi d’armes à feu de mains.

Sous Louis XI, la ligue du Bien Public marqua le dernier effort de l’aristocratie féodale pour ressaisir son ancienne puissance ; à cette époque, beaucoup de seigneurs garnirent leurs châteaux de nouvelles défenses appropriées à l’artillerie ; ces défenses consistaient principalement en ouvrages extérieurs, en grosses tours épaisses et percées d’embrasures pour recevoir du canon, en plates-formes ou boulevards commandant les dehors.
Le plan du château d’Arques, que nous avons donné (fig. 4), a conservé en B un ouvrage de la fin du XVe siècle, disposé en avant de l’ancienne entrée pour battre le plateau situé en face du côté du nord, et empêcher un assiégeant d’enfiler la cour du château, au moyen de batteries montées sur ce plateau, qui n’en est séparé que de deux cents mètres. Ces défenses jouèrent un rôle assez important pendant la journée d’Arques, le 21 septembre 1589, en envoyant quelques volées de leurs pièces au milieu de la cavalerie de Mayenne, au moment où la victoire était encore incertaine. L’ouvrage avancé du château d’Arques est bien construit et possède, pour l’époque, d’assez bons flanquements. Dans les positions déjà très-fortes par la situation des lieux, les seigneurs féodaux prirent généralement peu de souci de l’artillerie et se contentèrent de quelques fortins élevés autour de leurs demeures pour protéger les abords et commander les chemins ; c’est surtout autour des châteaux de plaine que des travaux furent exécutés, à la fin du XVe siècle, pour présenter des obstacles à l’artillerie à feu, que l’on découronna un grand nombre de tours afin de les terrasser et d’y placer du canon, que l’on fit des remblais derrière les courtines pour pouvoir mettre sur leur crête des pièces en batterie, et que l’on supprima les vieilles barbacanes pour les remplacer par des plates-formes ou boulevards, carrés ou circulaires. Cependant les seigneurs qui bâtissaient à neuf des châteaux de montagne avaient égard aux nouveaux moyens d’attaque.
Le château de Bonaguil nous a fait voir déjà comment on avait cherché, vers le milieu du XVe siècle, à munir d’artillerie une demeure féodale par certaines dispositions de détail qui ne changeaient rien, en réalité, aux dispositions générales antérieures à cette époque. Il n’en fut pas longtemps ainsi, et les châtelains reconnurent, à leurs dépens, que, pour protéger leur demeure féodale, il fallait planter des défenses en avant et indépendantes des bâtiments d’habitation ; qu’il fallait s’étendre en dehors, sur tous les points saillants, découverts, afin d’empêcher l’ennemi de placer ses batteries de siége sur quelque plateau commandant le château.
Ce commencement de la transition entre l’ancien système de défense et le nouveau est visible dans le château du Hohenkœnigsbourg, situé entre Sainte-Marie aux Mines et Schelestadt, sur le sommet d’une des montagnes les plus élevées de l’Alsace. Au XVe siècle, les seigneurs du Hohenkœnigsbourg s’étaient rendus redoutables à tous leurs voisins par leurs violences et leurs actes de brigandage[130]. Les plaintes devinrent si graves que l’archiduc Sigismond d’Autriche, landgrave de l’Alsace supérieure,  s’allia avec l’évêque de Strasbourg, landgrave de l’Alsace inférieure, avec les seigneurs de Ribeaupierre, l’évêque et la ville de Bâle, pour avoir raison des seigneurs du Hohenkœnigsbourg.
Les alliés s’emparèrent en effet du château, en 1462, et le démolirent. Ce domaine, par suite d’une de ces transmissions si fréquentes dans l’histoire des fiefs, fut cédé à la maison d’Autriche. Dix-sept ans après la destruction du Hohenkœnigsbourg, l’empereur Frédéric IV le concéda en fief aux frères Oswald et Guillaume, comtes de Thierstein, ses conseillers et serviteurs[131]. Ceux-ci s’empressèrent de relever le Hohenkœnigsbourg de ses ruines et en firent une place très-forte pour l’époque, autant à cause de son assiette naturelle que par ses défenses propres à placer de l’artillerie à feu.
s’allia avec l’évêque de Strasbourg, landgrave de l’Alsace inférieure, avec les seigneurs de Ribeaupierre, l’évêque et la ville de Bâle, pour avoir raison des seigneurs du Hohenkœnigsbourg.
Les alliés s’emparèrent en effet du château, en 1462, et le démolirent. Ce domaine, par suite d’une de ces transmissions si fréquentes dans l’histoire des fiefs, fut cédé à la maison d’Autriche. Dix-sept ans après la destruction du Hohenkœnigsbourg, l’empereur Frédéric IV le concéda en fief aux frères Oswald et Guillaume, comtes de Thierstein, ses conseillers et serviteurs[131]. Ceux-ci s’empressèrent de relever le Hohenkœnigsbourg de ses ruines et en firent une place très-forte pour l’époque, autant à cause de son assiette naturelle que par ses défenses propres à placer de l’artillerie à feu.
Nous donnons (30) le plan de l’ensemble de la place. Pour s’expliquer la forme bizarre de ce plan, il faut savoir que le Hohenkœnigsbourg est assis sur le sommet d’une montagne formant une crête de rochers abrupts dominant la riche vallée de Schelestadt et commandant deux défilés. Les constructions, à des niveaux très-différents, par suite de la nature du sol, s’enfoncent dans un promontoire de roches du côté A, et, se relevant sur un pic en B, suivent la pente de la montagne jusqu’au point C. Les bâtiments d’habitation sont élevés en D, probablement sur l’emplacement du vieux château dont on retrouve des portions restées debout et englobées dans les constructions de 1479. Les frères Oswald et Guillaume firent trancher une partie du plateau pour établir les gros ouvrages de contre-approche E.  Car c’est par ce côté seulement que le château est abordable. À deux cents mètres environ de ce point, sur le prolongement de la crête de la montagne, s’élevait un fortin détruit aujourd’hui, mais dont l’assiette importait à la sûreté de la place. L’ouvrage E, terrassé en F, oppose des épaisseurs énormes de maçonnerie du seul côté où l’assiégeant pouvait établir des batteries de siège. Vers le rampant de la crête en G est un ouvrage supérieur muni de tours flanquantes pour du canon, et en H une enceinte inférieure se terminant en étoile et percée d’embrasures pour des arquebusiers ou des pièces de petit calibre. Outre ces défenses majeures, une enceinte I flanquée de tourelles bat l’escarpement et devait enlever aux assaillants tout espoir de prendre le château par escalade. L’entrée est en K, et l’on arrive, après avoir pourtourné le gros ouvrage G, aux parties supérieures occupées par les bâtiments d’habitation, dont nous donnons le plan (31). La tour carrée L est le donjon qui domine l’ensemble des défenses et paraît appartenir à l’ancien château ; en M est la grand’salle, une des plus grandioses conceptions du moyen âge qui se puisse voir. Nous avons l’occasion de revenir sur cette belle construction au mot Salle.
Car c’est par ce côté seulement que le château est abordable. À deux cents mètres environ de ce point, sur le prolongement de la crête de la montagne, s’élevait un fortin détruit aujourd’hui, mais dont l’assiette importait à la sûreté de la place. L’ouvrage E, terrassé en F, oppose des épaisseurs énormes de maçonnerie du seul côté où l’assiégeant pouvait établir des batteries de siège. Vers le rampant de la crête en G est un ouvrage supérieur muni de tours flanquantes pour du canon, et en H une enceinte inférieure se terminant en étoile et percée d’embrasures pour des arquebusiers ou des pièces de petit calibre. Outre ces défenses majeures, une enceinte I flanquée de tourelles bat l’escarpement et devait enlever aux assaillants tout espoir de prendre le château par escalade. L’entrée est en K, et l’on arrive, après avoir pourtourné le gros ouvrage G, aux parties supérieures occupées par les bâtiments d’habitation, dont nous donnons le plan (31). La tour carrée L est le donjon qui domine l’ensemble des défenses et paraît appartenir à l’ancien château ; en M est la grand’salle, une des plus grandioses conceptions du moyen âge qui se puisse voir. Nous avons l’occasion de revenir sur cette belle construction au mot Salle.
Quoique le château du Hohenkœnigsbourg présente un singulier mélange des anciennes et nouvelles dispositions défensives, on y trouve déjà cependant une intention bien marquée d’employer l’artillerie à feu et de s’opposer à ses effets ; sous ce rapport, et à cause de la date précise de sa construction, cette place mérite d’être étudiée. Les constructions paraissent avoir été élevées à la hâte et en partie avec des débris plus anciens ; mais on trouve dans leur ensemble une grandeur, une hardiesse qui produisent beaucoup d’effet. La partie réservée à l’habitation particulièrement semble appartenir à des temps héroïques. La grand’salle M, à deux étages, était voûtée à sa partie supérieure, probablement pour placer du canon sur la terrasse. Posées en travers de la crête du rocher, les batteries en barbette, établies sur cette plate-forme très-élevée, commandaient d’un côté le gros ouvrage E et le revers de celui G. Le donjon L est complétement dépourvu d’ouvertures, sauf la porte, qui est étroite et basse. C’était probablement dans cette tour qu’étaient conservées les poudres. Sa partie supérieure, à laquelle on ne pouvait arriver que par un petit escalier extérieur, servait de guette, car elle domine, autant par son assiette sur une pointe de rocher que par sa hauteur, l’ensemble des défenses.
En 1633, le château de Hohenkœnigsbourg, entretenu et habité par une garnison jusqu’alors, fut assiégé par les Suédois. Ceux-ci, s’étant emparés du fortin extérieur, y montèrent une batterie de mortiers et bombardèrent la place, qui n’était pas faite pour résister à ces terribles engins. Elle fut en partie détruite, incendiée, et la garnison fut obligée de se rendre.
Mais, à la fin du XVe siècle, l’artillerie à feu allait commencer le grand nivellement de la société française. L’artillerie à feu exigeait l’emploi de moyens de défense puissants et dispendieux. Les seigneurs n’étaient plus assez riches pour bâtir des forteresses en état de résister d’une manière sérieuse à ce nouvel agent de destruction, pour les munir efficacement, ni assez indépendants pour pouvoir élever des châteaux purement militaires en face de l’autorité royale, sous les yeux de populations décidées à ne plus supporter les abus du pouvoir féodal. Déjà à cette époque les seigneurs paraissent accepter leur nouvelle condition ; s’ils bâtissent des châteaux, ce ne sont plus des forteresses qu’ils élèvent, mais des maisons de plaisance dans lesquelles cependant on trouve encore, comme un dernier reflet de la demeure féodale du moyen âge. Le roi donne lui-même l’exemple ; il abandonne les châteaux fermés. La forteresse, devenue désormais citadelle de l’État destinée à la défense du territoire, se sépare du château qui n’est plus qu’un palais de campagne, réunissant tout ce qui peut contribuer au bien-être et à l’agrément des habitants. Le goût pour les résidences somptueuses que la noblesse contracta en Italie pendant les campagnes de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier, porta le dernier coup au château féodal. Beaucoup de seigneurs ayant visité les villas et les palais d’outre-mont trouvèrent, au retour, leurs vieilles forteresses patrimoniales sombres et tristes. Conservant le donjon et les tours principales comme signe de leur ancienne puissance, ils jetèrent bas les courtines fermées qui les réunissaient, et les remplacèrent par des bâtiments largement ouverts, accompagnés de loges, de portiques décorés avec luxe. Les bailles ou basses-cours, entourées de défenses et de tours, furent remplacées par des avant-cours contenant des communs destinés au logement des serviteurs, des écuries splendides, des parterres garnis de fleurs, des fontaines, jeux de paume, promenoirs, etc. Les seigneurs ne songeaient plus alors à se faire servir par leurs hommes de corvée, comme cela avait lieu deux siècles avant ; ils avaient des serviteurs à gages, qu’il fallait loger et nourrir dans le château et ses dépendances. Peu à peu, les tenanciers à tous les degrés s’étaient exonérés, au moyen de rentes perpétuelles ou de sommes une fois payées, des corvées et de tous les droits seigneuriaux qui sentaient la servitude.
Dès le commencement du XVIe siècle, beaucoup de paysans étaient propriétaires et n’avaient, les divers impôts payés, rien à démêler avec leur seigneur. Depuis le XIIIe siècle, la population des campagnes n’a pas abandonné un seul jour l’espoir de s’affranchir d’abord, puis de devenir propriétaire du sol qu’elle cultive. Il serait curieux (si la chose était possible) de supputer les sommes énormes qu’elle a successivement sacrifiées à cette passion pour la terre. Elle a peu à peu racheté les droits seigneuriaux sur les personnes, droits de main-morte, de formariage, de corvées, de redevances en nature, puis les droits sur la terre ; puis enfin, poursuivant son but jusqu’à nos jours, elle a consenti des baux, sous forme de fermages ; d’amphithéoses, ne laissant échapper aucune occasion, non-seulement de se maintenir sur le sol, mais de l’acquérir. Aujourd’hui, le paysan achète la terre à des prix énormes, bien plus par amour de la propriété que par intérêt, puisque son capital ne lui rapporte souvent qu’un demi pour cent. Il semble ainsi, par instinct, destiné combattre l’abus du principe de la division de la propriété admis par la révolution du siècle dernier. En face de cette marche persistante de la classe agricole, la féodalité, au XVIe siècle, ayant besoin d’argent pour reconstruire ses demeures et entretenir un personnel toujours croissant de serviteurs à gages, abandonne la plus grande partie de ses droits, se dépouille de ses privilèges, droits de chasse, de pêche, droits sur les routes, ponts, cours d’eau. Les uns sont absorbés par la royauté, les autres par la population des campagnes. Pendant que la noblesse songe à ouvrir ses châteaux, ne comptant plus s’y défendre, qu’elle les rebâtit à grands frais, que son amour pour le luxe et le bien-être s’accroît, elle tarit la source de ses revenus pour se procurer de l’argent comptant. Une fois sur cette voie, on peut prévoir sa ruine définitive. Quelque étendues que fussent ses concessions, quelque affaiblie que fût sa puissance, le souvenir de l’oppression féodale du moyen âge resta toujours aussi vif dans les campagnes ; et le jour où, criblés de dettes, leurs châteaux ouverts, la plupart de leurs droits n’existant plus que dans leurs archives, les seigneurs furent surpris par les attaques du tiers-état, les paysans se ruèrent sur leurs demeures pour en arracher jusqu’aux dernières pierres.
La nouvelle forme que revêt la demeure féodale au commencement du XVIe siècle mérite toute notre attention ; car, à cette époque, si l’architecture religieuse décroît rapidement pour ne plus se relever, et ne présente que de pâles reflets d’un art mourant qui ne sait où il va, ce qu’il veut ni ce qu’il fut, il n’en est pas de même de l’architecture des demeures seigneuriales. En perdant leur caractère de forteresses, elles en prennent un nouveau, plein de charmes, et dont l’étude est une des plus intéressantes et des plus instructives qui se puisse faire. On a répété partout et sous toutes les formes que l’architecture de la renaissance en France avait été chercher ses types en Italie ; on a même été jusqu’à dire que ses plus gracieuses conceptions étaient dues à des artistes italiens. On ne saurait nier que la révolution qui se produit dans l’art de l’architecture, à la fin du XVe siècle, coïncide avec nos conquêtes en Italie ; que la noblesse française, sortant de ses tristes donjons, s’était éprise des riantes villas italiennes, et que, revenue chez elle, son premier soin fut de transformer ses sombres châteaux en demeures somptueuses, étincelantes de marbres et de sculptures. Mais ce qu’il faut bien reconnaître, en face des monuments témoins irrécusables, c’est que le désir des seigneurs français fut interprété par des artistes français qui surent satisfaire à ces nouveaux programmes d’une manière complétement originale, qui leur appartient, et qui n’emprunte que bien peu à l’Italie. Il ne faut pas être très-expert en matière d’architecture pour voir qu’il n’y a aucun rapport entre les demeures de campagne des Italiens de la fin du XVe siècle et nos châteaux français de la renaissance. Nulle analogie dans les plans, dans les distributions, dans la façon d’ouvrir les jours et de couvrir les édifices ; aucune ressemblance dans les décorations intérieures et extérieures. Le palais de ville et celui des champs, en Italie, présentent toujours une certaine masse rectiligne, des dispositions symétriques, que nous ne retrouvons dans aucun château français de la renaissance et jusqu’à Louis XIV. Si l’architecture ne consistait qu’en quelques profils, quelques pilastres ou frises décorés d’arabesques, nous accorderions volontiers que la renaissance française s’est faite italienne ; mais cet art est heureusement au-dessus de ces puérilités ; les principes en vertu desquels il doit se diriger et s’exprimer dérivent de considérations bien autrement sérieuses. La convenance, la satisfaction des besoins, l’harmonie qui doit exister entre les nécessités et la forme, entre les mœurs des habitants et l’habitation, le judicieux emploi des matériaux, le respect pour les traditions et les usages du pays, voilà ce qui doit diriger l’architecte avant tout, et ce qui dirigea les artistes français de la renaissance dans la construction des demeures seigneuriales : ils élevèrent des châteaux encore empreints des vieux souvenirs féodaux, mais revêtant une enveloppe nouvelle en rapport avec cette société élégante, instruite, polie, chevaleresque, un peu pédante et maniérée que le XVIe siècle vit éclore et qui jeta un si vif éclat pendant le cours du siècle suivant. Soit instinct, soit raison, l’aristocratie territoriale comprit que la force matérielle n’était plus la seule puissance prépondérante en France, que ses forteresses devenaient presque ridicules en face de la prédominance royale ; ses donjons redoutables, de vieilles armes rouillées ne pouvant plus inspirer le respect et la crainte au milieu de populations chaque jour plus riches, plus unies, et commençant à sentir leur force, à discuter, à vivre de la vie politique. En gens de goût, la plupart des seigneurs s’exécutèrent franchement et jetèrent bas les murs crénelés, les tours fermées, pour élever à leur place des demeures fastueuses, ouvertes, richement décorées à l’intérieur comme à l’extérieur, mais dans lesquelles cependant on retrouve bien plus la trace des arts français que celle des arts importés d’Italie. Les architectes français surent tirer un parti merveilleux de ce mélange d’anciennes traditions avec des mœurs nouvelles, et les châteaux qu’ils élevèrent à cette époque sont, la plupart, des chefs-d’œuvre de goût, bien supérieurs à ce que la renaissance italienne sut faire en ce genre. Toujours fidèles à leurs anciens principes, ils ne sacrifièrent pas la raison et le bon sens à la passion de la symétrie et des formes nouvelles, et n’eurent qu’un tort, celui de laisser dire et croire que l’Italie était la source de leurs inspirations.
Mais, avant de présenter à nos lecteurs quelques exemples de ces châteaux des premiers temps de la renaissance, et pour faire comprendre comment ils satisfaisaient aux mœurs de leurs habitants, il est nécessaire de connaître les penchants des seigneurs à cette époque. On a pu voir que le château féodal fortifié sacrifia tout à la défense, même dans des temps où l’aristocratie avait déjà pris des habitudes de luxe et de bien-être fort avancées. Les moyens de défense de ces demeures consistaient principalement en dispositions imprévues, singulières, afin de dérouter un assaillant ; car si tous les châteaux forts eussent été bâtis à peu près sur le même modèle, les mêmes moyens qui eussent réussi pour s’emparer de l’un d’eux auraient été employés pour les prendre tous. Il était donc important, pour chaque seigneur qui construisait une place de sûreté, de modifier sans cesse les détails de la défense, de surprendre l’assaillant par des dispositions que celui-ci ne pouvait deviner. De là une extrême variété dans ces demeures, un raffinement de précautions dans les distributions intérieures, une irrégularité systématique ; car chacun s’ingéniait à faire mieux ou autrement que son voisin. Des habitudes de ce genre, contractées par des générations qui se succèdent pendant plusieurs siècles, ne peuvent être abandonnées du jour au lendemain ; et un châtelain, faisant rebâtir son château au commencement du XVIe siècle, eût été fort mal logé, à son point de vue, s’il n’eût rencontré à chaque pas, dans sa nouvelle demeure, ces détours, ces escaliers interrompus, ces galeries sans issues, ces cabinets secrets, ces tourelles flanquantes du château de son père ou de son aïeul. Les habitudes journalières de la vie s’étaient façonnées, pendant plusieurs siècles, à ces demeures compliquées à l’intérieur, et ces habitudes, une fois prises, devaient influer sur le programme des nouveaux châteaux, bien que l’utilité réelle de tant de subterfuges architectoniques, commandés par la défense, n’existât plus de fait. Un seigneur du moyen âge, logé dans un des châteaux du XVIIe siècle, où les distributions sont larges et symétriques, où les pièces s’enfilent, sont presque toutes de la même dimension et comprises dans de grands parallélogrammes, où le service est direct, facile, où les escaliers sont vastes et permettent de pénétrer immédiatement au cœur de l’édifice, se fût trouvé aussi mal à l’aise que si on l’eût parqué, lui et sa famille, dans une grande pièce divisée par quelques cloisons. Il voulait des issues secrètes, des pièces petites et séparées des grandes salles par des détours à lui connus, des vues de flanc sur ses façades, des chambres fermées et retirées pour le soir, des espaces larges et éclairés pour les assemblées ; il voulait que sa vie intime ne fût pas mêlée à sa vie publique, et le séjour du donjon laissait encore une trace dans ses habitudes. Telle salle devait s’ouvrir au midi, telle autre au nord. Il voulait voir ses bois et ses jardins sous certains aspects, ou bien l’église du village sous laquelle reposaient ses ancêtres, ou telle route, telle rivière. Les yeux ont leurs habitudes comme l’esprit, et on peut faire mourir d’ennui un homme qui cesse de voir ce qu’il voyait chaque jour, pour peu que sa vie ne soit pas remplie par des préoccupations très-sérieuses. La vie des seigneurs, lorsque la guerre ne les faisait pas sortir de leurs châteaux, était fort oisive, et ils devaient passer une bonne partie de leur temps à regarder l’eau de leurs fossés, les voyageurs passant sur la route, les paysans moissonnant dans la plaine, l’orage qui s’abattait sur la forêt, les gens qui jouaient dans la basse-cour. Le châtelain contractait ainsi, à son insu, des habitudes de rêverie qui lui faisaient préférer telle place, telle fenêtre, tel réduit. Il ne faut donc pas s’étonner si, dans des châteaux rebâtis au XVIe siècle, on conservait certaines dispositions étranges qui étaient évidemment dictées par les habitudes intimes du seigneur et des membres de sa famille ; certes, l’Italie n’avait rien à voir là-dedans, mais bien les architectes auxquels les châtelains confiaient leurs désirs, résultats d’un long séjour dans un même lieu. Il existe encore en France un assez grand nombre de ces châteaux qui servent de transition entre la demeure fortifiée des seigneurs du moyen âge et le palais de campagne de la fin du XVIe siècle. Leurs plans sont souvent irréguliers comme ceux des châteaux du XIIe au XIVe siècle, soit parce qu’en les rebâtissant on utilisait les anciennes fondations, soit parce qu’on voulait jouir de certains points de vue, conserver des dispositions consacrées par l’usage, ou profiter de l’orientation la plus favorable à chacun des services.


C’était d’après ces données que le château de Chantilly avait été élevé un peu plus tard, mais sur des proportions plus grandioses. Chantilly, situé à quatre kilomètres environ de Senlis, est un des plus charmants lieux de cette partie de la France ; de belles eaux, des prairies étendues, des bois magnifiques avaient fait choisir l’assiette du château, qui était moins encore que Creil destiné à la défense.

Nous donnons (34) le plan des dispositions d’ensemble de cette résidence, qui fut l’asile de tant de personnages illustres et de beaux esprits. Voici ce qu’en dit Ducerceau[134] : « Le bastiment consiste en deux places ; la première est une court E, en laquelle sont quelques bastimens ordonnez pour les offices ; la seconde est une autre court estant comme triangulaire, et est eslevée plus haute que la première de quelque neuf ou dix pieds, et faut monter de la première pour parvenir à la seconde. » On voit en effet, à côté du pont, le petit escalier qui gagne la différence de niveau entre les deux cours. « Entour de laquelle (court triangulaire) de tous costez est le bastiment seigneurial, faict de bonne manière et bien basty. Iceluy bastiment et court sont fondez sur un rocher, dans lequel y a caves à deux estages, sentant plutost, pour l’ordonnance, un laberinthe qu’une cave, tant y a d’allées les unes aux autres, et toutes voultées. Pour le regard de l’ordonnance du bastiment seigneurial il ne tient parfaictement de l’art antique ne moderne, mais des deux meslez ensemble. Les faces en sont belles et riches… En la court première est l’entrée du logis, » par la grande salle D. « Les faces des bastimens estans en icelle tant dans la court que dehors, suivent l’art antique, bien conduicts et accoustrez. Ces deux courts avec leurs bastimens sont fermez d’une grande eau en manière d’estang dont entre icelles y a séparation comme d’un fossé, par laquelle séparation ladite eau passe au travers. Au-dessus y a un pont pour aller et venir d’une des courts à l’autre. Joignant le grand corps de logis y a une terrace A, pratiquée d’un bout du parc, à laquelle on va de la court du logis seigneurial par le moyen d’un pont P estant sur l’eau, lequel faict séparation du logis seigneurial et de la terrace, et d’icelle on vient au parc pardessus un arc, sur lequel est praticqué un passage couvert… Ce lieu est accompagné d’un grand jardin B, à l’un des costez duquel est une galerie à arceaux (portique), eslevée un peu plus haut que le rez du jardin. D’un costé d’iceluy jardin est la basse-court I, en laquelle sont plusieurs bastimens ordonnés pour écuries. Outre le grand jardin, et prochain iceluy, y en a un autre, non pas de telle grandeur. Iceux jardins sont environnés de places, esquelles aucunes sont bois, prez, taillis, cerizaies, forts d’arbres, et autres commoditez. Aucunes d’icelles places sont fermées par canaux, les autres non ; et en ces places est la haironnerie. Le parc est fort grand, à l’entrée duquel à sçavoir du costé du chasteau, est une eau, qui donne un grand plaisir. Ce lieu est fermé du costé de Paris, de la forest de Senlis, dans laquelle y a une voûte pour aller du lieu au grand chemin de Paris. En somme, ce lieu est tenu pour une des plus belles places de France. »
Dans cette résidence, qui, au point de vue de la construction, n’a rien en réalité d’une forteresse ; nous voyons encore toutes les dispositions du château féodal conservées. Isolement au moyen d’étangs et de fossés pleins d’eau, ponts étroits d’un accès peu facile, tourelles flanquantes aux angles, avant-cour avec les offices, basse-cour avec ses dépendances, jardins clos avec promenoir, logis irréguliers et disposés suivant la dimension des pièces qu’ils contiennent, passages détournés, caves immenses permettant d’amasser des provisions considérables, et enfin passage long, voûté pour communiquer, sans être vu, avec la grande route. Cependant le château de Chantilly ne pouvait, pas plus que celui de Creil, opposer une défense sérieuse à une attaque à main armée[135]. Les courtines et les tourelles du château étaient ouvertes par de larges fenêtres, les combles garnis de belles lucarnes ; mais le chemin de ronde supérieur avec les machicoulis traditionnels sont encore conservés. Si ces galeries supérieures ne pouvaient plus protéger le château contre les effets de l’artillerie, elles étaient souvent conservées pour les besoins du service ; car elles donnaient de longs couloirs permettant de desservir toutes les pièces des étages élevés, et facilitaient la surveillance.
On remarquera que tous les corps de logis des châteaux, encore à cette époque, sont simples en épaisseur, c’est-à-dire qu’ils n’ont que la largeur des pièces disposées en enfilade ; celles-ci se commandaient, et les couloirs supérieurs, comme les caves, offraient du moins une circulation indépendante des salles et chambres, à deux hauteurs différentes[136]. Ce ne fut guère qu’au XVIIe siècle que l’on commença, dans les châteaux, à bâtir des corps de logis doubles en épaisseur.
Cependant, il ne faudrait pas croire que l’irrégularité des plans fût, au commencement du XVIe siècle, une sorte de nécessité, le résultat d’une idée préconçue ; au contraire, à cette époque, on cherchait, dans les demeures seigneuriales, la symétrie ; on lui sacrifiait même déjà les distributions intérieures, avec l’intention de présenter, à l’extérieur, des façades régulières, un ensemble de bâtiments d’un aspect monumental. Sous ce rapport, l’Italie avait exercé une influence sur les constructeurs français ; mais c’était, avec l’emprunt de quelques détails architectoniques, tout ce que les architectes avaient pris aux palais italiens ; car, d’ailleurs, le château seigneurial conservait son caractère français, soit dans l’ensemble des dispositions générales, soit dans les distributions intérieures, ses flanquements par des tourelles, ou par la manière de couvrir les bâtiments.
Le beau château du Verger en Anjou, demeure des princes de Rohan-Guémené, joignait ainsi les anciennes traditions du château féodal aux dispositions monumentales en vogue au commencement du XVIe siècle.



Nous ne multiplierons pas ces exemples ; ils sont entre les mains de tout le monde, et les monuments sont là qui parlent éloquemment. Blois, Gaillon, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Amboise, le château neuf de Loches, le château d’Ussé et tant d’autres demeures seigneuriales du commencement du XVIe siècle, offrent un charmant sujet d’études pour les architectes ; elles sont la plus brillante expression de la renaissance française et, ce qui ne gâte rien, la plus raisonnable application de l’art antique chez nous. La royauté donnait l’exemple, et c’est autour d’elle que s’élèvent les plus beaux châteaux du XVIe siècle. Souveraine de fait, désormais, elle donnait l’impulsion aux arts comme à la politique. François Ier, ce roi chevalier qui porta le dernier coup à la chevalerie, détruisait les anciennes résidences royales, et son exemple fit renverser plus de donjons que tous ses devanciers et successeurs réunis ne purent faire par la force. Il jeta bas la grosse tour du Louvre, de laquelle relevaient tous les fiefs de France. Quel seigneur de la cour, après cela, pouvait songer à conserver son nid féodal ? Ce prince commence et achève la transition entre la demeure seigneuriale du moyen âge et le château moderne, celui de Louis XIII et de Louis XIV. Il bâtit Chambord et Madrid. Le premier de ces deux palais conserve encore l’empreinte du château féodal ; le second n’est qu’une demeure de plaisance, dans laquelle on ne trouve plus trace des anciennes traditions. Quoique nous ne soyons pas un admirateur passionné du château de Chambord, il s’en faut de beaucoup, cependant nous ne pouvons le passer sous silence ; il doit naturellement clore cet article. Nous en donnons ici le plan (38)[138].

Il n’est personne en France qui n’ait vu cette singulière résidence. Vantée par les uns comme l’expression la plus complète de l’art de l’architecture au moment de la renaissance, dénigrée par les autres comme une fantaisie bizarre, un caprice colossal, une œuvre qui n’a ni sens ni raison, nous ne discuterons pas ici son mérite ; nous prendrons le château de Chambord pour ce qu’il est, comme un essai dans lequel on a cherché à réunir deux programmes sortis de deux principes opposés, à fondre en un seul édifice le château fortifié du moyen âge et le palais de plaisance. Nous accordons que la tentative était absurde ; mais la renaissance française est, à son début, dans les lettres, les sciences ou les arts, pleine de ces hésitations ; elle ne marche en avant qu’en jetant parfois un regard de regret derrière elle ; elle veut s’affranchir du passé et n’ose rompre avec la tradition ; le vêtement gothique lui paraît usé, et elle n’en a pas encore un autre pour le remplacer.
Le château de Chambord est bâti au milieu d’un territoire favorable à la chasse, entouré de bois couvrant une plaine agreste ; éloigné des villes, c’est évidemment un lieu de plaisir, retiré, parfaitement choisi pour jouir à la fois de tous les avantages qu’offrent la solitude et l’habitation d’un palais somptueux. Pour comprendre Chambord, il faut connaître la cour de François Ier. Ce prince avait passé les premières années de sa jeunesse près de sa mère, la duchesse d’Angoulême, qui, vivant en mauvaise intelligence avec Anne de Bretagne, éloignée de la cour, résidait tantôt dans son château de Cognac, tantôt à Blois, tantôt à sa maison de Romorantin. François avait conservé une affection particulière pour les lieux où s’était écoulée son enfance dans la plus entière liberté. Parvenu au trône, il voulut faire de Chambord, qui n’était jusqu’alors qu’un vieux manoir bâti par les comtes de Blois, un château magnifique, une résidence royale. On prétend que le Primatice fut chargé de la construction de Chambord ; le Primatice serait-il là pour nous l’assurer, nous ne pourrions le croire, car Chambord n’a aucun des caractères de l’architecture italienne du commencement du XVIe siècle ; c’est, comme plan, comme aspect et comme construction, une œuvre non-seulement française, mais des bords de la Loire. Si l’on veut nous accorder que le Primatice ait élevé Chambord en cherchant à s’approprier le style français, soit ; mais alors cette œuvre n’est pas de lui, il n’y a mis que son nom, et cela nous importe peu[139].
Le plan de Chambord est le plan d’un château français ; au centre est l’habitation seigneuriale, le donjon, flanqué de quatre tours aux angles. De trois côtés, ce donjon est entouré d’une cour fermée par des bâtiments, munis également de tours d’angles. Conformément à la tradition du château féodal, le donjon donne d’un côté directement sur les dehors et ne se réunit aux dépendances que par deux portiques ou galeries. La grand’salle, figurant une croix, forme la partie principale du donjon. Au centre est un grand escalier à double vis permettant à deux personnes de descendre et monter en même temps sans se rencontrer, et qui communique du vestibule inférieur à la grand’salle, puis à une plate-forme supérieure. Cet escalier se termine par un couronnement à jour et une lanterne qui sert de guette. Dans les quatre tours et les angles compris entre les bras de la salle, en forme de croix, sont des appartements ayant chacun leur chambre de parade, leur chambre, leurs retraits, garde-robes, privés et escalier particulier. La tour A contient, au premier étage, la chapelle. Les bâtiments des dépendances, simples en épaisseur suivant l’usage, sont distribués en logements ; des fossés entourent l’ensemble des constructions. Du donjon on descendait dans un jardin terrassé et environné de fossés, situé en B. Les écuries et la basse-cour occupaient les dehors du côté de l’arrivée par la route de Blois. Comme ensemble, c’est là un château féodal, si ce n’est que tout est sacrifié à l’habitation, rien à la défense ; et cependant ces couloirs, ces escaliers particuliers à chaque tour, cet isolement du donjon rappellent encore les dispositions défensives du château fortifié, indiquent encore cette habitude de l’imprévu, des issues secrètes et des surprises. Ce n’était plus, à Chambord, pour dérouter un ennemi armé que toutes ces précautions de détail étaient prises, mais pour faciliter les intrigues secrètes de cette cour jeune et toute occupée de galanteries. C’était encore une guerre.
Chambord est au château féodal des XIIIe et XIVe siècles ce que l’abbaye de Thélème est aux abbayes du XIIe siècle ; c’est une parodie. Plus riche que Rabelais, François Ier réalisait son rêve ; mais ils arrivaient tous deux au même résultat : la parodie écrite de Rabelais sapait les institutions monastiques vieillies, comme la parodie de pierre de François Ier donnait le dernier coup aux châteaux fermés des grands vassaux. Nous le répétons, il n’y a rien d’italien en tout ceci, ni comme pensée ni comme forme.
À l’extérieur, quel est l’aspect de cette splendide demeure ? C’est une multitude de combles coniques et terminés par des lanternes s’élevant sur les tours, des clochetons, d’immenses tuyaux de cheminée richement sculptés et incrustés d’ardoises, une forêt de pointes, de lucarnes de pierre ; rien enfin qui ressemble à la demeure seigneuriale italienne, mais, au contraire, une intention évidente de rappeler le château français muni de ses tours couvertes par des toits aigus, possédant son donjon, sa plate-forme, sa guette, ses escaliers à vis, ses couloirs secrets, ses souterrains et fossés.
Mais Chambord nous donne l’occasion de signaler un fait curieux. Dans beaucoup de châteaux reconstruits en partie au commencement du XVIe siècle, on conserva les anciennes tours, autant à cause de leur extrême solidité et de la difficulté de les démolir que parce qu’elles étaient la marque de la demeure féodale.  Mais pour rendre ces tours habitables, il fallait les éclairer par de larges fenêtres. Pratiquer des trous à chaque étage et construire des baies en sous-œuvre eût été un travail difficile, dispendieux et long. On trouva plus simple, dans ce cas, pour les tours avec planchers de bois (et c’était le plus grand nombre), de pratiquer du haut en bas une large tranchée verticale et de remonter dans cette espèce de créneau autant de fenêtres qu’il y avait d’étages, en reprenant seulement ainsi les pieds-droits les linteaux et allèges. Une figure est nécessaire pour faire comprendre cette opération. Soit (39) une tour fermée ; on y pratiquait une tranchée verticale, ainsi qu’il est indiqué en A, tout en conservant les planchers intérieurs. Puis (39 bis) on bâtissait les fenêtres nouvelles, ainsi qu’il est indiqué dans cette figure. Pour dissimuler la reprise et éviter la difficulté de raccorder les maçonneries neuves des pieds-droits avec les vieux parements extérieurs des tours, qui souvent étaient fort grossiers, on monta, de chaque côté des baies, des pilastres peu saillants se superposant à chaque étage. Cette construction en raccordement, donnée par la nécessité, devint un motif de décoration dans les tours neuves que l’on éleva au commencement du XVIe siècle, ainsi que nous le voyons dans les vues des châteaux de Bury et de Chambord. Les machicoulis devinrent aussi l’occasion d’une décoration architectonique là où on n’en avait plus que faire pour la défense ; à Chambord, les tours et murs des bâtiments sont couronnés par une corniche qui rappelle cette ancienne défense ; elle se compose de coquilles posées sur des corbeaux et formant ainsi un encorbellement dont la silhouette figure des machicoulis. Rien d’italien dans ces traditions, qui sont à Chambord la décoration principale de tous les extérieurs.
Mais pour rendre ces tours habitables, il fallait les éclairer par de larges fenêtres. Pratiquer des trous à chaque étage et construire des baies en sous-œuvre eût été un travail difficile, dispendieux et long. On trouva plus simple, dans ce cas, pour les tours avec planchers de bois (et c’était le plus grand nombre), de pratiquer du haut en bas une large tranchée verticale et de remonter dans cette espèce de créneau autant de fenêtres qu’il y avait d’étages, en reprenant seulement ainsi les pieds-droits les linteaux et allèges. Une figure est nécessaire pour faire comprendre cette opération. Soit (39) une tour fermée ; on y pratiquait une tranchée verticale, ainsi qu’il est indiqué en A, tout en conservant les planchers intérieurs. Puis (39 bis) on bâtissait les fenêtres nouvelles, ainsi qu’il est indiqué dans cette figure. Pour dissimuler la reprise et éviter la difficulté de raccorder les maçonneries neuves des pieds-droits avec les vieux parements extérieurs des tours, qui souvent étaient fort grossiers, on monta, de chaque côté des baies, des pilastres peu saillants se superposant à chaque étage. Cette construction en raccordement, donnée par la nécessité, devint un motif de décoration dans les tours neuves que l’on éleva au commencement du XVIe siècle, ainsi que nous le voyons dans les vues des châteaux de Bury et de Chambord. Les machicoulis devinrent aussi l’occasion d’une décoration architectonique là où on n’en avait plus que faire pour la défense ; à Chambord, les tours et murs des bâtiments sont couronnés par une corniche qui rappelle cette ancienne défense ; elle se compose de coquilles posées sur des corbeaux et formant ainsi un encorbellement dont la silhouette figure des machicoulis. Rien d’italien dans ces traditions, qui sont à Chambord la décoration principale de tous les extérieurs.

Au XVIe siècle, le sol français était couvert d’une multitude de châteaux qui faisaient l’admiration des étrangers. Car, à côté des vieilles demeures féodales que leur importance ou leur force avaient fait conserver, à la place de presque tous les châteaux de second ordre, les seigneurs avaient élevé des habitations élégantes et dans la construction desquelles on cherchait à conserver l’ancien aspect pittoresque des demeures fortifiées. Les guerres de religion, Richelieu et la Fronde en détruisirent un grand nombre. Alors la noblesse dut s’apercevoir, un peu tard, qu’en rasant elle-même ses forteresses pour les remplacer par des demeures ouvertes, elle avait donné une force nouvelle aux envahissements de la royauté. C’est surtout pendant les luttes de la fin du XVIe siècle et du commencement du XVIIe que les suprêmes efforts de la noblesse féodale se font sentir. Agrippa d’Aubigné nous paraît être le dernier rejeton de cette race puissante ; c’est un héros du XIIe siècle qui surgit, tout d’une pièce, dans des temps déjà bien éloignés, par les mœurs, de cette grande époque. Le dernier peut-être il osa se renfermer dans les forteresses de Maillezay et du Dognon, les garder contre les armées du roi, auxquelles il ne les rendit pas ; en quittant la France il les vendit à M. de Rohan. Avec cet homme d’un caractère inébranlable, mélange singulier de fidélité et l’indépendance, plus partisan que français, s’éteint l’esprit de résistance de la noblesse. Quand, de gré ou de force, sous la main de Richelieu et le régime absolu de Louis XIV, la féodalité eut renoncé à lutter désormais avec le pouvoir royal, ses demeures prirent une forme nouvelle qui ne conservait plus rien de la forteresse seigneuriale du moyen âge.
Cependant le château français, jusqu’au XVIIIe siècle, fournit des exemples fort remarquables et très-supérieurs à tout ce que l’on trouve en ce genre en Angleterre, en Italie et en Allemagne. Les châteaux de Tanlay, d’Ancy-le-Franc, de Verneuil, de Vaux, de Maisons, l’ancien château de Versailles, les châteaux détruits de Meudon, de Rueil, de Richelieu, de Brèves en Nivernais, de Pont en Champagne, de Blérancourt en Picardie, de Coulommiers en Brie, offrent de vastes sujets d’études pour l’architecte. On y trouve la grandeur du commencement du XVIIe siècle, grandeur solide, sans faux ornements ; des dispositions larges et bien entendues, une richesse réelle. Dans ces demeures, il n’est plus trace de tours, de créneaux, de passages détournés ; ce sont de vastes palais ouverts, entourés de magnifiques jardins, faciles d’accès. Le souverain peut seul aujourd’hui remplir de pareilles demeures, aussi éloignées de nos habitudes journalières et de nos fortunes de parvenus que le sont les châteaux fortifiés du moyen âge.
La révolution de 1792 anéantit à tout jamais le château, et ce que l’on bâtit en ce genre aujourd’hui, en France, ne présente que de pâles copies, d’un art perdu, parce qu’il n’est plus en rapport avec nos mœurs. Un pays qui a supprimé l’aristocratie et tout ce qu’elle entraîne de priviléges avec elle ne peut sérieusement bâtir des châteaux. Car qu’est-ce qu’un château avec la division de la propriété, sinon un caprice d’un jour ? Une demeure dispendieuse qui périt avec son propriétaire et ne laissant aucun souvenir, est destinée à servir de carrière pour quelques maisons de paysans ou des usines.
Nos vieilles églises du moyen âge, toutes dépouillées qu’elles soient, sont encore vivantes ; le culte catholique, ne s’est pas modifié ; et s’il est survenu, depuis le XIIIe siècle, quelques changements dans la liturgie, ces changements n’ont pas une assez grande importance pour avoir éloigné de nous les édifices sacrés. Mais les châteaux féodaux appartiennent à des temps et à des mœurs si différents des nôtres, qu’il nous faut, pour les comprendre, nous reporter par la pensée à cette époque héroïque de notre histoire. Si leur étude n’a pour nous aujourd’hui aucun but pratique, elle laisse dans l’esprit une trace profondément gravée. Cette étude n’est pas sans fruits ; sérieusement faite, elle efface de la mémoire les erreurs qu’on s’est plu à propager sur la féodalité ; elle met à nu des mœurs empreintes d’une énergie sauvage, d’une indépendance absolue, auxquelles il est bon parfois de revenir, ne fût-ce que pour connaître les origines des forces, encore vivantes heureusement, de notre pays. La féodalité était un rude berceau ; mais la nation qui y passa son enfance et put résister à ce dur apprentissage de la vie politique, sans périr, devait acquérir une vigueur qui lui a permis de sortir des plus grands périls sans être épuisée. Respectons ces ruines, si longtemps maudites, maintenant qu’elles sont silencieuses et rongées par le temps et les révolutions ; regardons-les, non comme des restes de l’oppression et de la barbarie, mais bien comme nous regardons la maison, désormais vide, où nous avons appris, sous un recteur dur et fantasque, à connaître la vie et à devenir des hommes. La féodalité est morte ; elle est morte vieillie, détestée ; oublions ses fautes, pour ne nous souvenir que des services qu’elle a rendus à la nation entière en l’habituant aux armes, en la plaçant dans cette alternative ou de périr misérablement ou de se constituer, de se réunir autour du pouvoir royal ; en conservant au milieu d’elle et perpétuant certaines lois d’honneur chevaleresque que nous sommes heureux de posséder encore aujourd’hui et de retrouver dans les jours difficiles. Ne permettons pas que des mains cupides s’acharnent à détruire les derniers vestiges de ses demeures, maintenant qu’elles ont cessé d’être redoutables, car il ne convient pas à une nation de méconnaître son passé, encore moins de le maudire.
- ↑ De bell. Gall., I, VI, c. 23.
- ↑ Demor. Germ., c. 16.
- ↑ Voy. l’Hist. de la civil. en France, par M. Guizot, leçon 8e.
- ↑ Hist. de la civil. en France, leçon 8e.
- ↑ Grégoire de Tours parle de plusieurs châteaux assiégés par l’armée de Théodoric… « Ensuite, dit-il, liv. III, Chastel-Marlhac fut assiégé (dans le Cantal, arrond. de Mauriac). Tunc obsessi Meroliacensis castri… Il est entouré, non par un mur, mais par un rocher taillé de plus de cent pieds de hauteur. Au milieu est un grand étang, dont l’eau est très-bonne à boire ; dans une autre partie sont des fontaines si abondantes, qu’elles forment un ruisseau d’eau vive qui s’échappe par la porte de la place ; et ses remparts renferment un si grand espace, que les habitants y cultivent des terres et y recueillent des fruits en abondance. » On le voit, cet établissement présente plutôt les caractères d’un vaste camp retranché que d’un château proprement dit.
- ↑ Expéd. des Normands, par M. Depping, liv. IV, chap. III. — Recherches sur le Haguedike et les prem. étab. milit. des Normands sur nos côtes. — Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, ann. 1831-33, par M. de Gerville.
- ↑ Voy., dans les Actes de l’ac. imp. de Bordeaux, la notice de M. Léo Drouyn sur quelques châteaux du moyen âge, 1854.
- ↑ En Angleterre même, les Gallois qui sont de même race que les Bretons, encore aujourd’hui, ne se regardent pas comme Anglais ; pour eux les Anglais sont toujours des Saxons ou des Normands.
- ↑ Les bordiers devaient le curage des biefs de moulins, la couve des blés et du foin, des redevances en nature comme chapons, œufs, taillage des haies, certains transports, etc.
- ↑ Les vavasseurs et les hôtes étaient des hommes libres : les premiers tenant des terres par droit héréditaire et payant une rente au seigneur ; les seconds possédant un tènement peu important, une maison, une cour et un jardin, et payant cette jouissance au seigneur au moyen de redevances en nature s’ils étaient établis à la campagne, ou d’une charge d’hébergeage s’ils étaient dans une ville. La condition des hôtes diffère peu d’ailleurs de celle du paysan.
- ↑ Hic Willelmus castrum Archarum in cacumine ipsius montis condidit (Guillaume de Jumiéges). Arcas castrum in pago Tellau primus statuit. Chron. de Fontenelle.
- ↑ Lib. VII, cap. I.
- ↑ On voit encore des restes assez considérables de cette enceinte extérieure, notamment du côté de la porte vers Dieppe.
- ↑ Le plan est complété, en ce qui regarde les bâtiments intérieurs, au moyen du plan déposé dans les archives du château de Dieppe, dressé au commencement du XVIIIe siècle, et réduit par M. Deville dans son Histoire du château d’Arques. Rouen, 1839.
- ↑ Le Roman de Rou, Rob. Wace, vers 8 600 et suiv.
- ↑ Le Roman de Rou, vers 10 211.
- ↑ Le roi de France, afin de corrompre les vassaux du duc Robert de Normandie. Roman de Rou, vers 15960.
- ↑ Il avait de l’or à boisseaux.
- ↑ Marquis, seigneurs chargés de la défense des marches ou frontières.
- ↑ Le château inférieur fut presque entièrement reconstruit au XVe siècle ; cependant de nombreux fragments de constructions antérieures à cette époque existent encore, entre autres une poterne du commencement du XIIIe siècle et des caves qui paraissent fort anciennes.
- ↑ Hist. du château Gaillard et du siége qu’il soutint contre Philippe-Auguste, en 1203 et 1204, par A. Deville. Rouen, 1849.
- ↑ Les parties intérieures de cet ouvrage existent encore :
« Endroit la vile d’Andeli,
« Droit en mi Sainne, a une ilete,
« Qui comme un cerne est réondete ;
« Et est de chascune partie
« Sainne parfonde et espartie.
« Cele ilete, qui s’en eléve,
« Est si haute au-dessus de l’éve (l’eau),
« Que Sainne par nule cretine (crue)
« N’a povoir d’i faire ataïne.
« Ne jusqu’au plain desus reclorre,
« Li Roy Richart l’ot faite clorre,
« A cui ele estoit toute quite,
« De forz murs à la circuite,
« Bien crenelez d’euvre nouvele.
« En mi ot une tour trop bele ;
« Le baille (l’enceinte extérieure) et le maisonnement,
« Fu atournez si richement
« Aus pierres metre et asséoir,
« Que c’iert un déduit du veoir.
« Pont i ot qui la rabeli,
« Pour passer Sainne à Andeli
« Qui là endroit est grant et fiére.(Guill. Guiart, Branche des roy. lignages, vers 3 162 et suiv.) - ↑
« Au desus et travers de Sainne,
« Estoïent en cete semainne
« Ordenéement, comme aliz,
« Entroit Gaillart trois granz paliz
« A touchant l’une et l’autre rive.
« N’i furent pas mis par oidive,
« Mes pour faire aus nés destourbance
« Que l’en amenast devers France.
« Jamais nule nef ne fut outre
« Qui ne féist les piex descoutre ;
« Dont là ot plainnes maintes barges. »(Guill. Guiart, Branche des roy. lignages, vers 3 299 et suiv.) - ↑ Ces quatre tours sont dérasées aujourd’hui ; on n’en distingue plus que le plan et quelques portions encore debout.
- ↑ Les traces des défenses de ce chemin de ronde sont à peine visibles aujourd’hui. Nous avons eu le soin de n’indiquer que par un trait les ouvrages complétement dérasés.
- ↑ « Ecce quam pulchra filia unius anni ! » (Bromton, Hist. angl. scriptores antiqui, col. 1276.)--Hist. du chât. Gaillard, par A. Deville. C’était, comme le dit Guillaume Guiart,
« Un des plus biaus chastiaus du monde
« Et des plus forz, si com je cuide,
« Au deviser mist grant estuide (Richard)
« Tuit cil qui le voïent le loent.
« Trois paires de forz murs le cloent,
« Et sont environ adossez
« De trois paires de granz fossez
« Là faiz on le plain de sayve,
« Acisel, en roche nayve,
« Ainz que li liens fu entaillez,
« En fu maint biau deniers bailliez.
« Ne croi, ne n’ai oï retraire,
« Que nus homs féist fossez faire
« En une espace si petite
« Comme est la place desus dite,
« Puis le tens au sage Mellin (l’enchanteur Merlin) ;
« Qui coustassent tant estellin. »(Guill. Guiart, vers 3 202 et suiv.)Nous verrons tout à l’heure comment cette agglomération de défenses sur un petit espace fut précisément la cause, en grande partie, de la prise du château Gaillard.
- ↑ Jean de Marmoutier, moine chroniqueur du XIIe siècle, raconte que Geoffroy Plantagenet, grand-père de Richard Cœur de Lion, assiégeant un certain château fort, étudiait le traité de Végèce.
- ↑
.......
« Mes l’autre (la seconde enceinte) est quatre tanz plus bèle,
« Trop sont plus bèles les entrées ;
« Et les granz tours, dont les ventrées
« Ens el fonz du fossé s’espandent,
« Trop plus haut vers le ciel s’estandent.
« ......
« Entre les deus a grant espace,
« Pour ce que, se l’en préist l’une,
« L’autre à deffendre fut commune.
« Tout amont comme en réondèce,
« Resiet la mestre forterèce (la dernière enceinte)
« Qui rest noblement façonnée,
« Et de fossez environnée ;
« Onques tiex ne feurent véuz.
« S’un rat estoit dedanz chéuz,
« Là seroit qui ne l’iroit querre. »(Guill. Guiart, vers 3 238 et suiv.)En effet, les fossés sont creusés à pic, et, comme le dit Guillaume, nul n’aurait pu aller chercher un rat qui serait tombé au fond.
- ↑ Les constructions sont dérasées aujourd’hui au niveau du point O (fig. 13) ; il est probable que des hourds ou bretèches se posaient, en cas de siège, au sommet de la partie antérieure des segments, ainsi que nous l’avons indiqué en B, afin d’enfiler les fossés, de battre leur fond et d’empêcher ainsi le mineur de s’y attacher. Nous en sommes réduits sur ce point aux conjectures.
- ↑
« Pluseurs François garnis de targes,
« Que l’en doit entiex faiz loer,
« Prennent nus par Sainne à noer ;
« À dalouères et à haches,
« Vont desrompant piex et estaches ;
« Les gros fuz de leur place lièvent.
« Cil de Gaillart forment les grièvent,
« Qui entr’eus giètent grosses pierres,
« Dars et quarriaus à tranchanz quierres,
« Si espés que tous les en queuvrent.
« Non-pour-quant ileuques tant euvrent,
« Comment qu’aucuns ocis i soient,
« Que les trois paliz en envoient,
« Ronz et tranchiez, contreval Sainne,
« Si que toute nef, roide ou plainne
« Puet par là, sans destourbement,
« Passer assez legièrement. »(Guill. Guiart, vers 3 310 et suiv.) - ↑
« Anglois meuvent, le jour décline ;
« Leur ost, qui par terre chemine,« S’en va le petit pas serrée.
« Là ot tante lance serrée,
« Tante arbaleste destendue,
« Et tante targe à col pendue,
« Painte d’or, d’azur et de sable,
« Que li véoirs est délitable.(Guill. Guiart, vers 3 445 et suiv.) - ↑ Ce passage explique parfaitement l’assiette du camp de Philippe-Auguste qui se trouvait en R (fig. 10), précisément au sommet de la colline qui domine la roche Gaillard et qui ne s’y réunit que par cette langue de terre dont nous avons parlé. On voit encore, d’ailleurs, les traces des deux fossés de contrevallation et de circonvallation creusés par le roi. Ces travaux de blocus ont les plus grands rapports avec ceux décrits par César et exécutés à l’occasion du blocus d’Alésia ; ils rappellent également ceux ordonnés par Titus lors du siége de Jérusalem.
- ↑ C’est le sentier qui aboutit à la poterne S (voy. la fig. 11) ; c’était en effet la seule entrée du château Gaillard.
- ↑ Cette chaussée est encore visible aujourd’hui.
- ↑ La fig. 14 représente à vol d’oiseau le château Gaillard au moment où, les approches étant à peu près terminées, les assiégeants se disposent à aller combler le fossé. On voit en A l’estacade rompue par les gens de Philippe-Auguste pour pouvoir faire passer les bateaux qui devaient attaquer l’île B ; en C le Petit-Andely, en E l’étang entre le petit et le grand Andely ; D les tours de la ligne de circonvallation et de contrevallation tracée par Philippe-Auguste, afin de rendre l’investissement du château Gaillard complet ; F le val où moururent de faim et de misère la plupart des malheureux qui s’étaient réfugiés dans le château et que la garnison renvoya pour ne pas épuiser ses vivres. On voit aussi, à l’extrémité de la chaussée faite par l’armée assiégeante, pour arriver par une pente au fossé de l’ouvrage avancé, deux grandes pierrières qui battent la tour saillante contre laquelle toute l’attaque est dirigée ; puis, en arrière, un beffroi mobile que l’on fait avancer pour battre tous les couronnements de cet ouvrage avancé et empêcher les assiégés de s’y maintenir.
- ↑ Il s’agit ici, comme on le voit, de tout l’ouvrage avancé dont les deux murailles, formant un angle aigu au point de leur réunion avec la tour principale A, vont en déclinant suivant la pente du terrain. La description de Guillaume est donc parfaitement exacte.
- ↑ La fidélité scrupuleuse de la narration de Guillaume ressort pleinement lorsqu’on examine le point qu’il décrit ici. En effet, le fossé est creusé dans le roc, à fond de cuve ; il a dix mètres de large environ sur sept à huit mètres de profondeur. On comprend très-bien que les soldats de Philippe-Auguste, ayant jeté quelques fascines et des paniers de terre dans le fossé, impatients, aient posé des échelles le long de la contrescarpe et aient voulu se servir de ces échelles pour escalader l’escarpe, espérant ainsi atteindre la base de la tour ; mais il est évident que le fossé devait être comblé en partie du côté de la contrescarpe, tandis qu’il ne l’était pas encore du côté de l’escarpe, puisqu’il est taillé à fond de cuve ; dès lors les échelles qui étaient assez longues pour descendre ne l’étaient pas assez pour remonter de l’autre côté. L’épisode des trous creusés à l’aide de poignards sur les flancs de la contrescarpe n’a rien qui doive surprendre, le rocher étant une craie mêlée de silex. Une saillie de soixante centimètres environ qui existe entre le sommet de la contrescarpe et la base de la tour a pu permettre à de hardis mineurs de s’attacher aux flancs de l’ouvrage. Encore aujourd’hui, le texte de Guillaume à la main, on suit pas à pas toutes ces opérations de l’attaque, et pour un peu on retrouverait encore les trous percés dans la craie par ces braves pionniers lorsqu’ils reconnurent que leurs échelles étaient trop courtes pour atteindre le sommet de l’escarpe.
- ↑ C’est le bâtiment H tracé sur notre plan, fig. 11.
- ↑ C’étaient les latrines ; dans son histoire en prose, l’auteur s’exprime ainsi : Quod quidem religioni contrarium videbatur. Les latrines étaient donc placées sous la chapelle, et leur établissement, du côté de l’escarpement, n’avait pas été suffisamment garanti contre une escalade, comme on va le voir. Les latrines jouent un rôle important dans les attaques des châteaux par surprise ; aussi on verra comme, pendant les XIIIe et XIVe siècles, elles furent l’objet d’une étude toute spéciale.
- ↑ C’est le pont marqué sur notre plan et communiquant de l’ouvrage avancé à la basse-cour E.
- ↑ C’est le pont L (fig. 14).
- ↑ Un chat (voy. Architecture Militaire).
« Un chat fait sur le pont atraire. »
(Guill. Guiart, vers 4 340.) - ↑ Richard avait eu le tort de ne pas ménager des embrasures à rez-de-chaussée pour enfiler ce pont, et le chat garantissant les mineurs français contre les projectiles lancés du sommet de la muraille, les assiégés sont obligés de créneler la muraille au niveau du sol de la cour.
- ↑ Le château Gaillard fut réparé par Philippe-Auguste après qu’il s’en fut emparé, et il est à croire qu’il améliora même certaines parties de la défense. Il supprima, ainsi qu’on peut encore aujourd’hui s’en assurer, le massif de rocher réservé au milieu du fossé de la dernière enceinte elliptique, et supportant le pont, ce massif ayant contribué à la prise de la porte de cette enceinte. Le château Gaillard fut assiégé une seconde fois au XVe siècle, et repris par le roi Charles VII aux Anglais, ainsi que le raconte Alain Chartier dans son histoire de ce prince. « Ce mois de septembre (1449), le seneschal de Poictou, et Monseigneur de Cullant, mareschal de France, messire Pierre de Brezé, messire Denys de Chailly, et plusieurs autres, le roy présent, firent mettre le siége devant Chasteau Gaillard, où eut à l’arrivée de grans vaillances faictes, et de belles armes. Le siége y fut longuement. Car c’est un des plus forts chateaulz de Normandie, assis sur tout le hault d’un rocq ioignant de la rivière de Seine ; en telle manière que nuls engins ne le pouvoient grever. Le roy s’en retourna au soir au giste à Louviers, et de jour en jour, tant qu’il y fut, alloit veoir et fortifier ledit siége, auquel l’en fit plusieurs bastilles. Et après la fortification s’en retournèrent lesdits seigneurs françois, fors seulement lesdits de Brezé et de Chailly, qui là demourèrent accompaignez de plusieurs francs-archers pour la garde d’icelles bastilles. Ils se y gouvernèrent tous grandement et sagement ; et tant que au bout de cinq sepmaines, lesdits Anglois se rendirent, et mirent ledit Chasteau Gaillard en l’obéissance du roy… » Il est évident que ce siége n’est qu’un blocus et que les Anglais n’eurent pas à soutenir d’assauts ; le manque de vivres les décida probablement à capituler, car ils sortirent leurs corps et biens saufs ; la garnison se composait de deux cent vingt combattants. Même à cette époque encore, où l’artillerie à feu était en usage, le château Gaillard était une place très-forte.
- ↑ Ce château n’existe plus ; le plan des élévations et détails, d’un grand intérêt, sont donnés par Ducerceau dans ses Maisons royales de France.
- ↑ Notes insérées dans le Bulletin monum. Vol. IX, p. 246 et suiv.
- ↑ Voy. les Notes sur quelques châteaux de l’Alsace, par M. Al. Ramé. Paris, 1855.
- ↑ Some account of Domest. Archit. in Eng. from the conq. to the end of the thirteenth century. Ch. III.
- ↑ Il est entendu que nous ne parlons pas ici des reconstructions entreprises et terminées à la fin du XIVe siècle.
- ↑ Voyez, pour l’assiette du château de Coucy, à l’article Architecture Militaire, fig.20.
- ↑ Cette porte pouvait aussi être défendue, mais beaucoup plus faiblement, contre la baille, dans le cas où celle-ci eût été prise avant la ville.
- ↑ Depuis peu, M. le ministre d’État et de la maison de l’Empereur a donné des ordres pour que ces restes puissent être conservés et pour que des fouilles soient entreprises. Ces travaux, commencés sous la surveillance de la Commission des monuments historiques, sauveront d’une ruine totale le château de Coucy, et permettront de retrouver des dispositions anciennes d’un grand intérêt pour l’histoire de l’art de la fortification au moyen âge.
- ↑ Les peintures, en grand nombre, que l’on trouve encore dans les intérieurs des tours du château de Coucy, sont d’un grand intérêt, et nous aurons occasion d’en parler dans l’article Peinture.
- ↑ Nous espérons bientôt reconnaître et dégager l’ensemble des souterrains de Coucy et pouvoir dire le dernier mot sur cette partie si peu connue de l’art de la fortification au XIIIe siècle.
- ↑ Cette vue est faite au moyen des ruines existantes et de la vue donnée par Ducerceau dans ses plus excellents bâtiments de France. Nous avons figuré, au sommet du donjon et de la tour de droite, une portion de hourds posés.
- ↑ Cette vue de l’intérieur de la cour du château de Coucy est supposée prise à côté de la chapelle regardant l’entrée. À droite, on voit se dresser le donjon avec sa
- ↑ Instit. de saint Louis, le comte Beugnot.
- ↑ Guill. de Nangis.
- ↑ Instit. de saint Louis, le comte Beugnot.
- ↑ Les Olim (Ordonnances, t. I, p. 411).
- ↑ Ibid., note 35.
- ↑ Le Roman de la Rose, vers 3 813.
- ↑ Guillaume de Lorris double ici les dimensions en longueur et largeur ; mais il faut bien permettre l’exagération aux poëtes.
- ↑ En effet, devant la porte principale, vers la Seine, était un petit ouvrage avancé propre à contenir un poste.
- ↑ Ces quatre portes étaient une exception ; généralement les châteaux ne possédaient, à cette époque, qu’une ou deux portes au plus, avec quelques poternes. Mais le Louvre était un château de plaine à proximité d’une grande ville, et la multiplicité des portes était motivée par les défenses extérieures qui étaient fort importantes et par la nécessité où se trouvait le souverain de pouvoir recevoir dans son château un grand concours de monde. Nous voyons cette disposition de quatre portes conservée, au XIVe siècle, à Vincennes et au château de la Bastille, qui n’était cependant qu’un fort comparativement peu important comme étendue. Les quatre portes étaient surtout motivées, nous le croyons, par le besoin qui avait fait élever ces forteresses plantées autour de la ville de Paris pour maintenir la population dans le respect. Il ne s’agissait pas ici de se renfermer et de se défendre comme un seigneur au milieu de son domaine ; mais encore, dans un cas pressant, de détacher une partie de la garnison sur un point de la ville en insurrection, et, par conséquent, de ne pas se laisser bloquer par une troupe d’insurgés qui se seraient barricadés devant l’unique porte. Bien en prit, longtemps après, à Henri III, d’avoir plusieurs portes à son Louvre.
- ↑ Il est évident qu’il s’agit ici de herses (portes coulans).
- ↑ Les maîtres de l’œuvre élèvent une tour avec une grande habileté au milieu de l’enceinte ; il est question ici du donjon du Louvre, qui, contrairement aux habitudes des XIIe et XIIIe siècles, se trouvait exactement au milieu de l’enceinte carrée. Mais n’oublions pas que le donjon du Louvre était une tour exceptionnelle, un trésor autant qu’une défense. D’ailleurs les quatre portes expliquent parfaitement la situation de ce donjon, qui les masquait et les enfilait toutes les quatre.
- ↑ Il y a encore ici exagération de la part de Guillaume de Lorris ; le donjon du Louvre n’avait que vingt mètres de diamètre environ sur trente mètres de haut ; le donjon de Coucy est bien autrement important, son diamètre étant de trente-un mètres et sa hauteur de soixante-cinq environ ; cependant le donjon de Coucy devait être élevé lorsque notre poëte écrivait son roman. Il est certain que ce donjon ne fut bâti qu’après celui de Philippe-Auguste. L’orgueilleux châtelain de Coucy, faisant dresser à la hâte les murs de son château, dans l’espoir de mettre la couronne de France sur sa tête, voulut-il faire plus et mieux que le suzerain auquel il prétendait succéder ?
- ↑ Pensait-on, du temps de Guillaume de Lorris, que la chaux éteinte avec du vinaigre fit de meilleur mortier ? et cette méthode était-elle employée ?
- ↑ Ce passage mérite la plus sérieuse attention ; il ne s’agit plus ici du donjon, mais de l’ensemble du château. Les courtines du Louvre de Philippe-Auguste n’étaient point doublées de bâtiments à l’intérieur, et le château du Louvre se composait seulement encore, comme les châteaux des XIe et XIIe siècles, d’une enceinte flanquée de tours avec un donjon au centre. Le seigneur habitait le donjon et la garnison les tours. On comprend comment alors on pouvait voir par-dessus les crénelages des courtines la partie supérieure des pierrières et mangonneaux établis sur l’aire de la cour. Il n’était pas possible de songer à placer ces énormes engins sur les chemins de ronde des courtines, encore moins sur les tours. Guillaume de Lorris dit bien « dedens le chastel, » c’est-à-dire en dedans des murs ; et les descriptions de Guillaume de Lorris sont toujours précises. S’il y eût eu des bâtiments adossés aux courtines, ces bâtiments auraient été couverts par des combles, et on n’aurait pu voir le sommet des engins par-dessus les créneaux. Ce passage du poëte explique un fait qui paraît étrange lorsqu’on examine les fortifications de la première moitié du XIIIe siècle, et particulièrement celles des châteaux. Presque toutes les forteresses féodales de cette époque qui n’ont point été modifiées pendant les XIVe et XVe siècles présentent une suite de tours très-élevées et de courtines relativement basses ; c’est qu’en effet, alors, les tours étaient des postes, des fortins protégeant une enceinte, qui avaient assez de relief pour garantir les grandes machines de jet, mais qui n’étaient pas assez élevées pour que ces machines ne pussent jeter des pierres sur les assaillants par-dessus les crénelages. Lorsque Simon de Montfort assiége Toulouse, il s’empare du château extérieur, qui passait, à tort ou à raison, pour être un ouvrage romain, mais dont les murs étaient fort élevés. Pressé par le temps, plutôt que de déraser les murs entre les tours, pour permettre l’établissement de grands engins, il fait faire des terrassements à l’intérieur. Ainsi, le système défensif des châteaux antérieurs à la seconde moitié du XIIIe siècle consiste en des tours d’un commandement considérable, réunies par des courtines peu élevées, libres à l’intérieur, afin de permettre l’établissement de puissantes machines de jet posées sur le sol. Ceci explique comment il se fait que, dans la plupart de ces châteaux, on ne voit pas trace de bâtiments d’habitation adossés à ces courtines. Au Château-Gaillard des Andelys, il n’y a que deux logis adossés aux courtines, l’un dans l’enceinte extérieure, l’autre dans l’enceinte intérieure ; mais ces logis sont élevés du côté de l’escarpement à pic, qui ne pouvait permettre à l’assiégeant de s’établir en face des remparts. Nous verrons bientôt comment et pourquoi ce système fut complétement modifié au XVe siècle.
- ↑ Les chemins de ronde supérieurs des donjons se trouvaient munis d’armes de jet à demeure, outre les armes transportables apportées par chaque soldat au moment de la défense.
- ↑ En dehors de la porte du sud (porte principale) donnant sur la Seine, une première défense, assez basse, flanquée de tours, avait été bâtie à cinquante mètres environ de l’entrée du Louvre ; cette première défense était double avec une porte à chaque bout. C’était comme un petit camp entouré de murailles formant, en avant de la façade sud du Louvre, ce qu’on appelait alors une lice. Ces ouvrages avaient une grande importance, car ils laissaient à la garnison d’un château, si elle parvenait à les conserver, toute sa liberté d’action ; elle facilitait les sorties et remplissait l’office des Barbacanes des grandes places fortes (voy. ce mot). Comme le dit Guillaume de Lorris, ces ouvrages bas, plantés en dehors des fossés, empêchaient la troupe ennemie de venir d’emblée jusqu’au bord du fossé, sans trouver de résistance. À une époque où les armes de jet n’avaient pas une portée très-longue, il était fort important d’entourer les châteaux d’ouvrages extérieurs très-considérables ; car, autrement, la nuit et par surprise, une troupe aurait pu combler le fossé en peu d’instants et écheller les murailles. Ce fait se présente fréquemment dans l’histoire de nos guerres en France, lorsqu’il s’agit de châteaux de peu de valeur ou qui n’avaient pas une garnison assez nombreuse pour garnir les dehors.
- ↑ Du côté de Saint-Germain-l’Auxerrois.
- ↑ Ce passage est fort curieux ; il nous donne une idée de la disposition des postes dans les châteaux. Chaque porte composait une défense qui pouvait s’isoler du reste de la forteresse, véritable châtelet muni de ses tours, de ses salles, cuisines, fours, puits, caves, moulins même ; le seigneur en confiait la garde à un capitaine ayant un certain nombre d’hommes d’armes sous ses ordres. Il en était de même pour la garde des tours de quelque importance. Ces postes, habituellement, n’étaient pas relevés comme de nos jours ; la garnison d’un château n’était dès lors que la réunion de plusieurs petites garnisons, comme l’ensemble des défenses n’était qu’une réunion de petits forts pouvant au besoin se défendre séparément. Les conséquences du morcellement féodal se faisaient ainsi sentir jusque dans l’enceinte des châteaux. De là ces fréquentes trahisons d’une part, ou ces défenses désespérées de l’autre, de postes qui résistent encore lorsque tous les autres ouvrages d’une forteresse sont tombés. De là aussi l’importance des donjons qui peuvent protéger le seigneur contre ces petites garnisons séparées qui l’entourent. Nous trouvons encore, dans ce passage de la description du Louvre, la confirmation de ce que nous disions tout à l’heure au sujet de la disposition des courtines et des tours. Les tours étant des ouvrages isolés reliés seulement par des courtines basses qu’elles commandaient, les rondes étaient difficiles, ou du moins ne pouvaient se faire qu’à un étage ; les communications entre ces postes séparés étaient lentes ; cela était une conséquence du système défensif de cette époque, basé sur une défiance continuelle. Ainsi, à une attaque générale, à un siége en règle, on opposait 1o les courtines basses munies par-derrière d’engins envoyant des projectiles par-dessus les remparts ; 2o les crénelages de ces courtines garnis d’archers et d’arbalétriers ; 3o les tours qui commandaient la campagne au loin et les courtines si elles étaient prises par escalade. Pour se garantir contre les surprises de nuit, pour empêcher qu’une trahison partielle pût faire tomber l’ensemble des défenses entre les mains de l’ennemi, on renfermait, chaque soir, les postes dans leurs tours séparées, et on évitait qu’ils pussent communiquer entre eux. Des guetteurs placés aux créneaux supérieurs des tours par les postes qu’elles abritaient, des sentinelles sur les chemins de ronde posées par le connétable et qui ne dépendaient pas des postes enfermés dans les tours, exerçaient une surveillance double, contrôlée pour ainsi dire. Ce ne sont pas là des conjectures basées sur un seul texte, celui d’un poëte ; Sauval, qui a pu consulter un grand nombre de pièces perdues aujourd’hui, entre autres les registres des œuvres royaux de la chambre des comptes, et qui donne sur le Louvre des détails d’un grand intérêt, dit (p. 14, liv, VII.) : « Une bonne partie des tours, chacune, avoit à part son capitaine ou concierge, plus ou moins qualifié, selon que la tour étoit grosse, ou détachée du Louvre. Le comte de Nevers fut nommé, en 1411, concierge de celle de Windal, le 20 septembre. Sous Charles VI, les capitaines de celles du Bois, de l’Écluse et de la Grosse tour furent cassés plusieurs fois. » Le commandement d’une tour n’était donc pas une fonction transitoire, mais un poste fixe, une charge donnée par le seigneur.
- ↑ Du côté de la Seine.
- ↑ Du côté de la rue du Coq. Peur a la charge de grand connestable ; la porte qui lui est confiée restant toujours fermée. Il semblerait que, du temps de Guillaume de Lorris, la porte du nord demeurait le plus souvent fermée, à cause du vent de bise. Cette porte n’était d’ailleurs qu’une poterne percée à la base d’une grosse tour servant probablement de logement à la connétablie du Louvre. La garde de cette poterne étant facile, puisqu’elle était fort étroite et habituellement fermée, pouvait être confiée au connétable, dont les fonctions consistaient à surveiller tous les postes, à donner les ordres généraux et à se faire remettre chaque soir les clefs des différentes portes.
- ↑ Ceci est une épigramme à l’adresse des Normands.
- ↑ Du côté des Tuileries.
- ↑ Pour médire, répandre de mauvais bruits.
- ↑ Chaque chef de poste faisait donc le guet à tour de rôle.
- ↑ La garnison du donjon, composée des plus fidèles, et en grand nombre.
- ↑ Le Roman du Renart, vers 18 463 et suiv.
- ↑ Renart fuit et se réfugie dans son château qu’il fait réparer.
- ↑ Il était rare que l’on entrât à cheval dans le château même, les écuries étant généralement bâties dans la basse-cour comprise dans une première enceinte ; on laissait les montures devant le pont du château.
- ↑ Renart engage les ouvriers à terminer promptement leur travail.
- ↑ Il fait faire un pont à bascule (voy. Pont ).
- ↑ Il est encore question ici d’engins fixes dressés sur les chemins de ronde des tours.
- ↑ Il fait élever une guette sur chaque tour pour guetter les dehors.
- ↑ Il fait faire des hourds en dehors des murs (voy. Hourd).
- ↑ Des ouvrages avancés en bois pour défendre les dehors.
- ↑ En temps de guerre, on faisait faire, en dehors des châteaux, de grandes barbacanes de bois, que l’on garnissait de gens d’armes appelés par le seigneur. Celui-ci n’aimait guère à introduire, dans l’enceinte même du château, des soudoyers, les hommes qui lui devaient un service temporaire, et de la fidélité desquels il ne pouvait être parfaitement assuré.
- ↑ Ce dernier trait peint les mœurs du seigneur féodal. Personne du dehors ne connaît ses desseins.
- ↑ Extraits de Dolopathos d’Herbers, p. 282.
- ↑ Presque tous les châteaux n’ont qu’une entrée, ainsi que nous l’avons dit plus haut à propos du Louvre. Dans Li Romans de Parise la Duchesse, nous trouvons ces vers :
« An la porte devant a fet .i. pont lever.
« ..........
« N’i ot que .i. antrée, bien la firent garder. »Et dans la seconde branche du roman d’Auberi le Bourguignon (voy. la chanson de Roland, XIIe siècle, pub. par Francisque Michel, 1837, p. XL) :
« Fu li chastiax et la tors environ ;
« Bien fu assise par grant devision (réflexion, prévoyance)
« De nulle part habiter (entrer) n’i puet-on
« Fors d'une part, si comme nous cuidonz ;
« Là est l’antrée et par là i va-on.
« Pont torneiz (à bascule) et barre à quareillon (à serrure)
« Selve (forêt) i ot vielle dès le tans Salemon ;
« Bien fu garnie de riche venoison.
« Las (proche) la rivière sont créu li frès jon
« Et l’erbe drue que coillent li garson.
« Li marois sont entor et environ
« Et li fossé qui forment (entourent) sont parfont ;« Li mur de maubre, de chaus et de sablon,
« Et les tornelles où mainnent li baron.
« Et li vivier où furent li poisson.
« Si fort chastel ne vît onques nus hom ;
« Là dedens ot sa sale et son donjon
« Et sa chapelle por devant sa maison.
« .......... » - ↑ La défense de la porte est toujours considérée comme devant être très-forte.
- ↑ Les ponts-levis étaient assez rares au XIIIe siècle ; du moins ils ne tenaient pas encore aux ouvrages mêmes des portes, mais ils étaient posés en avant, à l’entrée ou au milieu des ponts, et se composaient d’un grand châssis mobile posé sur deux piles ou deux poteaux, roulant sur un axe et relevant un tablier au moyen de deux chaînes de suspension (voy. Architecture Militaire, Pont ).
- ↑ Une chaussée conduisait à l’entrée, qui était fort étroite. Deux hommes n’y pouvaient passer de front.
- ↑ On faisait une distinction entre les bailles et les lices, les premières étaient, comme nous l’avons vu au château d’Arques, une encloserie extérieure, une basse-cour, comme encore au château de Coucy ; les lices étaient les espaces laissés entre deux enceintes à peu près parallèles, entre les murs du château et les palissades extérieures.
- ↑ Lorsque l’assiette d’un château avait été choisie sur le sommet d’un escarpement, on taillait souvent le rocher qui devait lui servir de base de manière à rendre les escarpements plus formidables ; souvent même on creusait les fossés à même le rocher, comme à Château-Gaillard, à la Roche-Guyon, et on réservait, à l’extérieur, une défense prise aux dépens du roc. Ces travaux sont ordinaires autour des châteaux assis sur du tuf, de la craie ou des calcaires tendres.
- ↑ Il s’y trouvait de nombreux logements.
- ↑ Des logements étaient encore disposés autour du donjon.
- ↑ Li palais, c’est la demeure du seigneur, distincte des herberjaiges, qui paraissent destinés au casernement de la garnison.
- ↑ Voici la grand’salle, cette dépendance indispensable de tout château.
- ↑ Dans les salles étaient suspendues les armes, les écus, les cors ; c’était la principale décoration des intérieurs ; et dans un grand nombre de châteaux, on voit encore la place des tablettes, des crochets de fer qui servaient à porter des panoplies d’armes et d’ustensiles de guerre et de chasse.
- ↑ N’avons-nous pas vu encore, à la fin du dernier siècle, la noblesse française agir en face des grandes émotions populaires comme elle avait agi, deux siècles et demi plus tôt, en face de l’artillerie ?
- ↑ Ce plan est réduit sur celui donné par M. le comte de Clarac dans son Musée de sculpture ant. et mod., 1826-1827.
- ↑ Voy. les Titres concern. Raimond du Temple, archit. du roi Charles V. Bib. de l’École des chartes, 2e série, t. III, p. 55. Raimond du Temple cumulait, auprès du roi Charles V, les fonctions de sergent d’armes et de maître des œuvres, et les titres dont il est ici question font connaître les sentiments d’estime que le roi de France professait pour son garde-du-corps, architecte.
- ↑ La bibliothèque de Charles V était nombreuse et riche ; c’est dans cette petite salle ronde que se forma l’un des noyaux de la Bibliothèque impériale.
- ↑ Lorsque Charles V veut faire les honneurs de son Louvre à l’empereur Charles IV, il y fait conduire ce prince en bateau : « Au Louvre arrivèrent ; le Roy monstra à l’Empereur les beauls murs et maçonnages qu’il avoit fait au Louvre édifier ; l’Empereur, son filz et ses barons moult bien y logia, et partout estoit le lieu moult richement paré ; en la sale dina le Roy, les barons avec lui, et l’Empereur en sa chambre. » Des faits du sage Roy Charles V, Cristine de Pizan, ch. XLII.
- ↑ Ce qui prouve encore que la place de Vincennes n’avait pas été considérée par son fondateur comme un château, c’est ce passage de Cristine de Pisan, extrait de son Livre des faits et bonnes meurs du sage Roy Charles V. « Item, dehors Paris, le chastel du bois de Vincenes, qui moult est notable et bel, avoit entencion (le roi) de faire ville fermée ; et là aroit establie en beauls manoirs la demeure de pluseurs seigneurs, chevaliers et autres ses mieulz amez, et à chascun y asseneroit rente à vie selon leur personne : celleci lieu voult le Roy qu’il fust franc de toutes servitudes, n’aucune charge par le temps avenir, ne redevance demander. » Chap, XI.
- ↑ M. Jules Quicherat a trouvé, dans la province de Burgos (vieille Castille), un village qui porte le nom de ce château devenu célèbre, au XIIIe siècle, par le séjour qu’y fit l’archevêque Bertrand de Goth, après l’avoir fait reconstruire. Selon M. Quicherat, au commencement du XIIIe siècle, un cadet de Biscaye, don Alonzo Lopès, apanagé de Villandraut (villa Andrando), eut deux fils, dont le plus jeune, don André, vint en France à la suite de Blanche de Castille, et s’arrêta en Guienne près Bazas, dans le lieu qui a conservé le nom de Villandraut. Un demi-siècle plus tard, l’alliance de la fille ou petite-fille d’André avec un membre de la famille de Goth fit passer cette seigneurie dans cette maison et bientôt dans la possession de celui qui, d’abord archevêque de Bordeaux, ne tarda pas à être élevé dans la chaire de saint Pierre, sous le nom de Clément V. 1306-1316. Comm. des mon. hist. de la Gironde.
- ↑ Fourmariaige, forimarige, taxe qu’un serf était tenu de payer à son seigneur pour pouvoir épouser une femme de condition libre ou une serve d’un autre seigneur.
- ↑ Hist. de Coucy-le-Château, par Melleville ; Laon, 1848.
- ↑ Le Quadrilogue invectif, édit. de 1617, p. 447.
- ↑ Le Livre des quatre Dames, édit. de 1617, p. 665.
- ↑ Compiègne et ses environs, par L. Ewig.
- ↑ Ce plan est à l’échelle de 0,001 mill. pour mètre.
- ↑ Les perrons jouent un rôle important, à partir du XIIIe siècle, dans les châteaux (voy. Perron ).
- ↑ Ces sortes de tours servant de prisons sont désignées, pendant les XIIe et XIIIe siècles, sous le nom de cartre.
« Or fu Ogier en la grant cartre obscure
Où il estoit et en fers et en buis.
...... »(Ogier l’Ardenois vers 10 281).Et plus haut :
« Et morrai chi en celle cartre obscure.
....... »
En une crote (grotte) estoit li dux Ogier
Qui si iert basse ne se pooit drechier
Et si estroite ne se pooit couchier. »(Vers 10 254). - ↑ Voy. Privé.
- ↑ Voyez le curieux discours de ce chef de bande, dans la Satyre Ménippée.
- ↑ Il existait, dans la galerie des Cerfs de Fontainebleau, une vue peinte de Pierrefonds, qui se trouvait ainsi au nombre des premières places du royaume.
- ↑ Échelle de 0,001 mill. pour mètre.
- ↑ Nous avons donné, à l’article Charpente, la coupe de l’étage supérieur. Autrefois il n’y avait qu’une seule salle occupant toute la longueur du bâtiment F, et la cheminée qui la chauffait était pratiquée dans le pignon de gauche à l’ouest. (Voir la vue cavalière, fig. 27.)
- ↑ Cette dernière partie du château est dérasée aujourd’hui à quelques mètres au-dessus du sol de la cour.
- ↑ Aujourd’hui, quoique le château soit en partie habité par M. de Sully, les tours sont démantelées et le donjon à peu près abandonné ; mais il existe, dans le château même, un modèle en relief des bâtiments exécuté dans le dernier siècle, et qui est fort exact ; ce modèle nous a servi à compléter les parties détruites pendant la révolution, Le grand Sully habita ce château après la mort de Henri IV et fit percer, à tous les étages, des fenêtres qui n’existaient pas avant cette époque, les jours étant pris du côté de la cour intérieure.
- ↑ Ce plan est à l’échelle de 0,007 mill. pour mètre.
- ↑ Nous n’avons rétabli dans cette vue que les charpentes qui n’existent plus ; quant aux maçonneries, elles sont presque intactes.
- ↑ Voy. Architecture Militaire.
- ↑ Nous devons les curieux renseignements que nous possédons sur ce château à l’obligeance bien connue du savant archiviste de Strasbourg, M. Schéegans, et à notre confrère M. Bœswilwald.
- ↑ «Une lettre fort importante,» dit M. Schéegans dans une notice inédite sur le Hohenkœnigsbourg, «que l’empereur écrivit aux magistrats de Strasbourg, et conservée dans les archives de cette ville, donne acte de cette cession. Par cette lettre, datée du 14 mars 1479, l’empereur Frédéric informe les magistrats : qu’en reconnaissance des services à lui rendus par les comtes de Thierstein, et pour d’autres motifs justes, il leur a concédé en fief le château ruiné de Hohenkœnigsbourg, avec ses dépendances, et qu’il leur a permis de le reconstruire. En conséquence, l’empereur, en vertu du pouvoir impérial, prie les magistrats de Strasbourg et leur ordonne de venir en aide aux comtes de Thierstein, de leur prêter secours et assistance contre tous ceux qui chercheraient à les contrarier dans la prise de possession, reconstruction et jouissance dudit château, de ne pas souffrir qu’ils y soient troublés, et de leur fournir secours fidèle, au nom du Saint-Empire, contre tous ceux qui oseraient porter atteinte à leurs droits. »
- ↑ À l’échelle de 0,007 mil. pour dix mètres.
- ↑ Cette vue ainsi que le plan sont tirés de l’œuvre de Ducerceau sur les Bâtiments en France, le château étant détruit depuis la Révolution.
- ↑ Les plus excellens bastimens de France, liv. II.
- ↑ Toutes les constructions ne dataient pas de la même époque ; les plus anciennes remontaient à la fin du XVe siècle. Mais, pendant le XVIe siècle, les bâtiments, surtout à l’intérieur, furent en grande partie décorés avec un grand luxe d’architecture. Plus tard encore, pendant le XVIIe siècle, les communs furent modifiés.
- ↑ Voy., dans Les plus excellens bastimens de France, de Ducerceau, les vues et détails des constructions de Chantilly.
- ↑ Voy. Ducerceau et l’œuvre (petite) d’Israël Sylvestre. Voy. aussi, dans le Guide hist. du voyage à Blois et aux environs, par M. De la Saussaye, 1815, une excellente notice sur ce beau château de la renaissance.
- ↑ À l’échelle d’un demi-millimètre pour mètre.
- ↑ Notre vieux poëte, Charles de Sainte-Marthe, né en 1542, mort en 1555, écrivait, dans ses Conseils aux poëtes, pendant que l’on bâtissait Chambord, ces vers pleins de sens, et qui font connaître quelle était alors la manie des beaux-esprits en France de ne rien trouver de bon que ce qui venait d’Italie :
« Ne veulx-tu donq, ô François, y entendre ?
Ne veulx-tu donq virilement contendre
Contre quelcuns barbares estrangiers
Qui les François disent estre légiers ?
D’où prennent-ils d’ainsi parler audace ?
C’est seulement à la mauvaise grace
Que nous avons des nostres dépriser
Et sans propos les aultres tant priser.
Qu’a l’Italie ou toute l’Allemaigne,
La Grèce, Escosse, Angleterre ou Espaigne
Plus que la France ? Est-ce point de tous biens ?
Est-ce qu’ils ont aux arts plus de moyens ?
Ou leurs esprits plus aiguz que les nostres ?
Ou bien qu’ils sont plus savants que nous aultres ?
Tant s’en fauldra que leur veuillons céder
Que nous dirons plus tost les excéder.
Un seul cas ont (et cela nous fait honte),
C’est que des leurs ils tiennent un grand compte,
Et par amour sont ensemble conjoincts,
Mais nous, François, au contraire, disjoincts.
Car nous avons à écrire invectives.
............ »C’est quelque maître des œuvres français, quelque Claude ou Blaise de Tours ou de Blois, qui aura bâti Chambord ; et si le Primatice y a mis quelque chose, il n’y paraît guère. Mais avoir à la cour un artiste étranger, en faire une façon de surintendant des bâtiments, le combler de pensions, cela avait meilleur air que d’employer Claude ou Blaise, natif de Tours ou de Blois, bonhomme qui était sur son chantier pendant que le peintre et architecte italien expliquait les plans du bonhomme aux seigneurs de la cour émerveillés. Nos lecteurs voudront bien nous pardonner cette sortie à propos du Primatice ; mais nous ne voyons en cet homme qu’un artiste médiocre qui, ne pouvant faire ses affaires en Italie, où se trouvaient alors cent architectes et peintres supérieurs à lui, était venu en France pour emprunter une gloire appartenant à des hommes modestes, de bons praticiens dont le seul tort était d’être né dans notre pays et de s’appeler Jean ou Pierre.
poterne et son pont à bascule ; au troisième plan est la porte principale et la chemise ; au premier plan, la chapelle et le commencement du degré montant au chemin de ronde de la chemise.
