Le Livre des mille nuits et une nuit/Tome 04/Texte entier
strictement réservés.
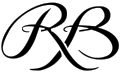
LES MILLE NUITS ET UNE NUIT
FIN DE L’HISTOIRE DU ROI OMAR AL-NÉMÂN…
Et le jeune Aziz raconta ainsi son histoire au beau prince Diadème :
Sache, mon jeune seigneur, que mon père était un d’entre les grands marchands ; et il n’avait point d’autre fils que moi. Mais j’avais une cousine qui avait été élevée avec moi dans la maison de mon père, vu que son père à elle était mort.
Or, avant de mourir, mon oncle avait fait promettre à mon père et à ma mère de nous marier ensemble à notre majorité.
Aussi nous laissa-t-on toujours ensemble ; et nous nous attachâmes de la sorte l’un à l’autre ; et la nuit on nous faisait coucher dans le même lit, sans nous séparer. D’ailleurs nous ne nous doutions guère des inconvénients que cela pouvait avoir, bien que, toutefois, ma cousine fût, sur ces questions, beaucoup plus clairvoyante que moi et plus instruite et plus expérimentée ; ce dont je jugeai plus tard, en réfléchissant à la façon dont elle m’enlaçait de ses bras et dont elle serrait les cuisses en s’endormant contre moi.
Sur ces entrefaites, comme nous venions d’atteindre l’âge voulu, mon père dit à ma mère : « Il nous faut, cette année, marier sans retard notre fils Aziz avec sa cousine Aziza. » Et il tomba d’accord avec elle sur le jour de l’écriture du contrat, et se mit aussitôt à faire les préparatifs des festins pour la cérémonie ; et il alla inviter les parents et les amis, leur disant : « Ce vendredi, après la prière, nous allons écrire le contrat du mariage d’Aziz avec Aziza. » Et ma mère, de son côté, alla prévenir de la chose toutes les femmes de sa connaissance et toutes ses proches. Et, pour bien recevoir les invités, ma mère et les femmes de la maison lavèrent à grande eau la salle de réception et firent étinceler les marbres qui la pavaient, et étendirent les tapis par terre et ornèrent les murs des belles étoffes et des tapisseries ouvrées d’or contenues dans les grands coffres. Quant à mon père, il se chargea, lui, de faire les commandes de pâtisseries et de douceurs, et de préparer et de ranger avec soin les grands plateaux des boissons. Moi, enfin, ma mère m’envoya, avant l’heure fixée pour l’arrivée des invités, prendre un bain au hammam, et eut soin de faire porter derrière moi, par un esclave, une belle robe neuve, tout ce qu’il y avait de mieux, pour que je la vêtisse après le bain.
J’allai donc au hammam et, une fois mon bain fini, je vêtis la somptueuse robe en question qui était toute parfumée et si puissamment que, sur ma route, les passants s’arrêtaient pour en renifler l’arôme dans l’air.
Je me dirigeai donc vers la mosquée pour la prière qui, en ce jour du vendredi, devait précéder la cérémonie, quand je me rappelai, en route, un ami que j’avais oublié d’inviter. Et je me mis à marcher très vite pour ne pas être en retard, et si bien que je m’égarai dans une ruelle qui m’était inconnue. Alors, comme j’étais tout moite de sueur à cause du bain chaud et à cause aussi de la robe neuve, dont l’étoffe était rigide, je profitai de la fraîcheur d’ombre de cette ruelle pour m’asseoir un moment sur un banc le long du mur ; mais avant de m’asseoir je tirai de ma poche un mouchoir brodé d’or et je l’étendis sous moi. Et la sueur continuait à couler de mon front sur ma figure, tant la chaleur était intense ; et je n’avais rien sur moi pour l’essuyer, mon mouchoir étant étendu sous moi ; et j’en étais, bien marri ; et ma torture activait encore ma transpiration. Enfin, pour sortir de cette fâcheuse perplexité, je me disposais à relever le pan de ma robe neuve pour essuyer les grosses gouttes qui me sillonnaient les joues, quand soudain je vis tomber devant moi, léger comme un souffle de la brise, un mouchoir blanc en étoffe de soie, dont la seule vue me rafraîchit l’âme et dont le parfum eût guéri l’infirme. Je me hâtai de le ramasser et de regarder au-dessus de ma tête pour me rendre compte de ce que pouvait être l’affaire ; et alors mes yeux rencontrèrent les yeux d’une jeune personne, celle-là même, ô mon seigneur, qui, dans la suite de l’histoire, me donnera la première gazelle brodée sur l’étoffe carrée. Donc je la vis elle-même…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
Et je la vis elle-même penchée et souriante à la fenêtre de bronze de l’étage supérieur. Je n’essaierai même pas de dépeindre sa beauté, ma langue en étant trop incapable, en vérité.
Sache seulement que la jeune fille, à peine eut-elle remarqué mon regard attentif, me fit les signes suivants : elle enfonça son index entre ses lèvres ; puis elle abaissa son doigt du milieu et le colla contre son index gauche pour ensuite les porter tous les deux entre ses seins. Cela fait, elle rentra la tête et, refermant la fenêtre, elle disparut.
Et, tout saisi, tout perplexe et soudainement enflammé de désir, j’eus beau regarder vers la fenêtre, espérant revoir cette apparition qui m’enlevait l’âme, la fenêtre resta obstinément fermée. Et je ne désespérai que lorsque, ayant attendu là, sur ce banc, jusqu’au coucher du soleil, oubliant et mon contrat de mariage et ma fiancée, je constatai que décidément mon attente était vaine.
Alors je me levai, le cœur bien en peine, et je me dirigeai vers ma maison. En route je me mis à déplier le mouchoir en question, dont le seul parfum me délecta si intensément que je me crus déjà au paradis. Lorsque je l’eus tout à fait déplié, je vis qu’il portait, sur l’un de ses coins, ces vers inscrits d’une belle écriture entrelacée :
J’ai essayé de me plaindre pour lui faire sentir la passion de mon âme, au moyen de cette écriture fine et compliquée. Car toute écriture est l’empreinte même de l’âme qui l’imagine.
Mais il me dit, l’ami : « Ton écriture, pourquoi si fine et torturée, et telle qu’elle se subtilise à ma vue ? »
Je répondis : « Moi-même je suis si énervée et torturée ! Es-tu donc si naïf que tu n’y reconnaisses pas l’indice de l’amour ? »
Et sur l’autre coin du mouchoir, ces vers étaient écrits en grands caractères réguliers :
Les perles unies à l’ambre, et la pudeur incarnadine des pommes sous les feuilles jalouses, à peine pourraient-elles te dire la clarté de ses joues sous le duvet.
Et si tu cherchais la mort, tu la trouverais sous les lourds regards de ses yeux aux victimes sans nombre. Mais si c’est l’ivresse que tu désires, laisse les vins de l’échanson ! N’as-tu point les joues rougissantes de l’échanson ?
Et si tu veux connaître sa fraîcheur, les myrtes te la diront, et sa flexibilité, les courbes des rameaux !
Alors moi, ô mon maître, affolé, je finis tout de même par arriver à la maison, à la tombée de la nuit. Et je trouvai la fille de mon oncle assise tout en larmes ; mais, en me voyant, elle s’essuya rapidement les yeux et vint à moi et m’aida à me déshabiller et m’interrogea doucement sur le motif de mon retard et me dit que tous les invités, les émirs, les grands marchands et les autres, ainsi que le kâdi et les témoins, avaient longtemps attendu mon arrivée, mais que ne voyant rien venir, ils avaient mangé et bu à satiété et étaient tous partis en leur voie. Puis elle ajouta : « Quant à ton père, cela l’a mis dans une fort grande rage ; et il a juré que notre mariage serait retardé jusqu’à l’année prochaine ! Mais toi, ô fils de mon oncle, pourquoi enfin avoir agi de la sorte ? »
Alors moi je lui dis : « Il s’est passé telle et telle chose. » Et je lui racontai en détail l’aventure. Aussitôt elle prit le mouchoir que je lui tendais et, après avoir lu ce qui y était écrit, elle versa d’abondantes larmes. Puis elle me dit : « Mais ne t’a-t-elle pas parlé ? » Je répondis : « Par des signes seulement, auxquels d’ailleurs je n’ai rien compris, et dont je voudrais bien te voir me donner l’explication. » Et je lui mimai les signes en question. Elle me dit : « Ô mon très aimé cousin, si même tu me demandais mes yeux, je n’hésiterais pas à les faire sortir pour toi de mes paupières ! Sache donc que, pour rendre la paix à ton âme, je suis prête à te servir de tout mon dévouement et à te faciliter une rencontre avec cette femme qui te préoccupe et qui certainement est amoureuse de toi. Car ces signes, qui n’ont point de mystère pour nous autres femmes, signifient clairement qu’elle te désire avec passion et qu’elle te donne rendez-vous dans deux jours : ses doigts ramenés entre ses deux seins te fixent le nombre deux, tandis que son doigt entre ses lèvres t’indique que tu es pour elle à l’égal de son âme qui donne la vie à son corps. Sois donc sûr que mon amour pour toi me fera te rendre n’importe quel service ; et je vous mettrai tous deux sous mon aile qui vous protégera. » Alors moi je la remerciai pour son dévouement et ses bonnes paroles qui me donnaient de l’espoir, et je restai deux jours à la maison à attendre l’heure du rendez-vous. Et j’étais bien triste ; et je reposais ma tête sur les genoux de ma cousine qui ne cessait de m’encourager et de me raffermir le cœur. Aussi, lorsque fut proche l’heure du rendez-vous, ma cousine se hâta de m’aider à mettre mes habits ; et elle me parfuma de ses mains…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
Le bel Aziz continua ainsi son histoire au jeune prince Diadème :
Et elle me parfuma de ses mains et brûla sous ma robe du benjoin et m’embrassa tendrement et me dit : « Ô mon bien-aimé cousin, voici l’heure calmante. Prends courage et reviens-moi tranquillisé et satisfait. Et voici que moi-même je te souhaite la paix de l’âme, et je ne serai heureuse que de ton bonheur. Mais reviens-moi vite pour me raconter l’aventure. Et il y aura encore de beaux jours pour nous deux et de belles nuits bénies ! » Alors moi j’essayai de calmer les battements de mon cœur et de comprimer mon émotion ; et je pris congé de ma cousine et sortis. Arrivé à la ruelle ombreuse, j’allai m’asseoir sur le banc en question, dans un état d’excitation extrême. Et à peine étais-je là que je vis la fenêtre s’entr’ouvrir ; et aussitôt un vertige me passa devant les yeux. Mais je me raffermis et je regardai vers la fenêtre ; et de mes yeux je vis l’adolescente. À la vue de ce visage adoré, je chancelai et me laissai tomber tremblant sur le banc. Et l’adolescente restait toujours à la fenêtre à me regarder avec une lueur dans les yeux ; et elle tenait à la main ostensiblement un miroir et un mouchoir rouge. Mais bientôt, sans dire une seule parole, elle releva ses manches, découvrant ses bras jusqu’aux épaules ; puis elle ouvrit la main et, étendant ses cinq doigts, elle se toucha les seins ; puis elle tendit le bras hors de la fenêtre en tenant le miroir et le mouchoir rouge ; et par trois fois elle agita le mouchoir en l’élevant et en l’abaissant ; puis elle fit le geste de tordre le mouchoir et de le plier ; ensuite elle pencha la tête vers moi longuement et, rentrant vivement, elle referma la fenêtre et disparut. Tout cela ! et sans prononcer un seul mot. Au contraire ! Elle me laissa ainsi dans une perplexité inimaginable ; et je ne sus si je devais rester ou m’en aller ; et, dans le doute, je restai ainsi à regarder la fenêtre durant des heures, jusqu’à minuit. Alors, malade de mes pensées, je regagnai la maison, où je trouvai ma pauvre cousine dans l’attente, les yeux rouges de larmes versées et le visage empreint de tristesse et de résignation. Alors moi, à bout de forces, je me laissai tomber à terre dans un état pitoyable. Et ma cousine, qui s’était hâtée de courir à moi, me reçut dans ses bras, et m’embrassa sur les yeux et me les essuya du coin de sa manche et me donna à boire, pour calmer mes esprits, un verre de sirop légèrement parfumé à l’eau de fleurs ; et elle finit par doucement m’interroger sur tout ce retard et sur ma mine affligée.
Alors moi, bien que brisé de triste lassitude, je la mis au courant de tout, en lui répétant les gestes de la délicieuse inconnue. Et ma cousine Aziza me dit : « Ô Aziz de mon cœur, la signification qui pour moi ressort de ces gestes, surtout des cinq doigts et du miroir, est que la jeune fille t’enverra un message dans cinq jours chez le teinturier du coin de la ruelle. » Alors moi je m’écriai : « Ô fille de mon cœur, puissent tes paroles être vraies ! D’ailleurs, j’ai remarqué qu’au coin de la ruelle, il y a, en effet, la boutique d’un teinturier juif. » Puis ne pouvant plus résister à la houle de mes souvenirs, je me mis à sangloter dans le sein de ma cousine Aziza qui ne ménagea point, pour me consoler, les paroles de douceur et les caresses de tout charme ; et elle me disait : « Songe, ô Aziz, que d’ordinaire les amoureux souffrent des années et des années dans l’attente, et s’arment de fermeté tout de même ; et toi, il y a à peine une semaine que tu connais les tortures du cœur, et te voici dans une émotion et une tristesse sans exemple ! Prends courage, ô fils de mon oncle ! Et lève-toi et mange un peu de ces mets et bois de ce vin que je t’offre. »
Mais moi, ô mon jeune seigneur, je ne pus réussir à avaler ni une bouchée ni une gorgée ; et je perdis même tout sommeil ; et je devins jaune de teint et changé de traits. Car c’était la première fois que je sentais la chaleur de la passion, et que je goûtais à l’amour amer et délectable.
Aussi pendant les cinq jours que dura mon attente, je maigris à l’extrême, et ma cousine, affligée à cause de moi, ne me quitta pas un seul instant et passa jours et nuits assise à mon chevet à me raconter, pour me distraire, les histoires des amoureux ; et, au lieu de dormir, elle veillait sur moi ; et je la surprenais quelquefois essuyant à la hâte des larmes furtives. Enfin, au bout des cinq jours, elle me força à me lever et chauffa l’eau pour moi et me fit entrer au hammam de la maison ; puis elle m’habilla et me dit : « Va vite au rendez-vous ! Et qu’Allah te fasse parvenir à tes fins, et de ses baumes te guérisse l’âme ! » Alors, moi, je me hâtai de sortir et courus à la boutique du teinturier juif.
Or, ce jour-là était un samedi ; et ce juif n’avait malheureusement pas ouvert sa boutique. Malgré tout, je m’assis devant la porte de la boutique et j’attendis là jusqu’à la prière des muezzins sur les minarets, au coucher du soleil. Et comme la nuit s’avançait sans résultat aucun, je fus pris de la frayeur des ténèbres et me décidai à m’en retourner à la maison. Et j’y arrivai comme un homme ivre, ne sachant plus ce que je faisais et disais. Et je trouvai ma pauvre cousine Aziza debout dans la chambre, le visage tourné du côté du mur, un bras appuyé contre un meuble et une main sur le cœur ; et, tristement, elle soupirait des vers plaintifs sur l’amour malheureux.
Mais à peine se fut-elle aperçue de ma présence qu’elle s’essuya les yeux du coin de sa manche et vint au-devant de moi, en essayant de sourire pour me cacher sa douleur, et me dit : « Ô mon cousin bien-aimé, qu’Allah te rende durable la félicité ! Pourquoi, au lieu de revenir ainsi seul, pendant la nuit, par les rues désertes, n’as-tu pas passé le reste de la nuit chez la jeune fille, ton amoureuse ? » Alors moi, impatienté, et croyant un instant que ma cousine voulait me railler, je la repoussai durement et d’une façon si brusque, qu’elle alla tomber tout de son long contre le coin du divan et se fit au front une large blessure d’où le sang se mit à gicler à flots. Alors ma pauvre cousine, loin de s’emporter contre ma brutalité, n’eût pas un seul mot de révolte et se releva tranquillement et alla brûler un morceau d’amadou et en pansa sa blessure et se banda le front de son mouchoir ; puis elle essuya le sang qui tachait les marbres, et, comme si de rien n’était, elle revint près de moi avec un sourire tranquille, et me dit avec la plus grande douceur…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, s’arrêta dans les paroles permises.
LA CENT QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
Et, comme si de rien n’était, elle revint près de moi avec un sourire tranquille et me dit avec la plus grande douceur dans la voix : « Ô fils de mon oncle, je suis à la limite de la désolation de t’avoir peiné par des paroles inopportunes. Pardonne-moi, de grâce, et raconte-moi ce qui s’est passé, que je voie si je n’y puis porter remède ! » Alors je lui racontai le contre-temps que j’avais subi et le manque total de nouvelles de l’inconnue. Et Aziza me dit : « Ô Aziz de mes yeux, je puis, sans hésiter, t’annoncer que tu arriveras à tes fins ; car ce n’est là qu’une épreuve que l’adolescente fait subir à ta patience pour voir la force de ton amour et ta constance à son égard. Aussi, dès demain, hâte-toi d’aller t’asseoir sur le banc, sous sa fenêtre, et sûrement tu trouveras une solution au gré de tes désirs ! » Puis ma cousine m’apporta un plateau chargé de porcelaines remplies de mets ; mais je repoussai le tout avec brusquerie, et toutes les porcelaines sautèrent en l’air et roulèrent de tous côtés sur les tapis. Et je signifiai de la sorte que je ne voulais ni manger ni boire. Alors, ma pauvre cousine ramassa soigneusement et en silence les débris qui jonchaient le sol et essuya les tapis, et revint s’asseoir au pied du matelas sur lequel j’étais étendu ; et elle ne cessa, durant toute la nuit, de me faire de l’air avec un éventail en me disant des paroles gentilles et caressantes, avec une douceur infinie. Et moi je pensais : « Quelle folie d’être amoureux ! » Enfin le matin parut et je me levai en toute hâte et me rendis dans la ruelle sous la fenêtre de l’adolescente.
Or, à peine m’étais-je assis sur le banc que la fenêtre s’ouvrit et devant mes yeux éblouis apparut la tête délicieuse de celle qui était toute mon âme. Et elle me souriait de toutes ses dents d’un sourire savoureux. Puis elle disparut un instant pour réapparaître tenant entre les mains un sac, un miroir, un pot de fleurs et une lanterne. Et voici ce qu’elle fit : d’abord elle introduisit le miroir dans le sac, lia le sac, et jeta le tout dans la chambre ; puis, d’un geste adorable, elle dénoua sa chevelure qui retomba lourdement autour d’elle toute, et lui cacha un instant la figure ; ensuite elle plaça la lanterne au milieu des fleurs, dans le pot ; et enfin elle reprit le tout et disparut. Et la fenêtre se referma. Et mon cœur, avec l’adolescente, s’envola. Et mon état n’était plus un état.
Alors moi, sachant déjà par expérience qu’il était inutile d’attendre davantage, je m’acheminai, désolé et meurtri, vers la maison, où je retrouvai ma pauvre cousine tout en pleurs et la tête enveloppée d’un double bandeau, un autour de son front blessé et l’autre autour de ses yeux malades de toutes les larmes versées pendant mon absence et durant tous ces jours de tristesse. Et, sans me voir, elle avait la tête penchée et appuyée sur une main, et elle se berçait de l’harmonie pénétrante de ces vers admirables que tout doucement elle se murmurait :
« Ah ! je songe à toi, Aziz ! En quelle demeure loin de moi as-tu fui ? Réponds, Aziz ! Où as-tu élu domicile, ô vagabond adoré ?…
Songe à ton tour, Aziz ! Sache bien que partout où la destinée, jalouse de mon bonheur, te poussera, tu ne pourras trouver la chaleur d’asile que t’a réservée le pauvre cœur d’Aziza !
Tu ne m’écoutes pas, Aziz ! Et tu t’éloignes ! Et voici que mes yeux te regrettent dans ces larmes qui coulent intarissables.
Oh ! désaltère-toi à la limpidité d’une eau pure ou plus belle encore, et laisse ma douleur boire, pour toute fraîcheur, le sel des tristes larmes recélées dans mes orbites profondes.
Ah ! pleure, mon cœur, l’absence du bien-aimé !… Je songe à toi, Aziz ! En quelle demeure loin de moi as-tu fui ? Réponds, Aziz ! Où as-tu élu domicile, ô vagabond adoré ?… »
Lorsqu’elle eut fini ces vers, elle se retourna et me vit ; et aussitôt elle s’efforça de me cacher sa douleur et ses larmes, et elle vint à moi et se tint debout un moment en silence, sans pouvoir articuler une syllabe. Enfin elle me dit : « Ô mon cousin, assieds-toi et conte-moi ce qui t’es arrivé cette fois ! » Et je ne manquai pas de lui exposer par le menu les gestes pleins de mystère de l’adolescente. Et Aziza me dit : « Réjouis-toi, ô mon cousin, car tes souhaits sont exaucés ! Sache, en effet, que le miroir enfoncé dans le sac signifie le soleil qui disparaît : ce geste t’invite donc à te rendre demain soir à sa maison ; sa chevelure noire dénouée et lui voilant la face signifie la nuit qui couvre la terre de ses ténèbres : ce geste est une confirmation du premier ; le pot de fleurs signifie qu’il te faut entrer dans le jardin de la maison, situé derrière la ruelle ; quant à la lanterne sur le pot, elle signifie clairement qu’une fois dans le jardin tu dois te diriger du côté où tu trouveras une lanterne allumée, et attendre là la venue de ton amoureuse. » Mais moi, au comble du désappointement, je m’écriai : « Que de fois tu m’as donné de l’espoir avec tes explications erronées ! Allah ! Allah ! que je suis malheureux ! » Alors Aziza se fit encore plus caressante que d’habitude et se dépensa pour moi en paroles douces et pacifiantes. Mais elle n’osa pas bouger de sa place ni me porter à manger ou à boire par peur de mes accès de colère et d’impatience.
Pourtant, le lendemain, vers le soir, je me décidai à tenter l’aventure et, encouragé surtout par Aziza qui me donnait ainsi tant de preuves de son désintéressement et de l’abnégation absolue d’elle-même, alors qu’en secret elle pleurait toutes ses larmes, je me levai et pris mon bain et, aidé par. Aziza, je m’habillai de ma plus belle robe. Mais avant de me laisser sortir, Aziza me jeta un regard de désolation et, les larmes dans la voix, elle me dit : « Ô fils de mon oncle ! prends ce grain de musc pur et parfume t’en les lèvres. Puis, une fois que tu auras vu ton amoureuse et que tu en auras eu toute satisfaction à ton gré, promets-moi, de grâce, de lui réciter le vers que je vais te dire. » Et elle me jeta les bras autour du cou et sanglota longuement. Alors moi, je lui fis le serment de réciter à l’adolescente le vers en question. Et Aziza, tranquillisée, me récita ce vers et m’obligea à le répéter une fois avant de partir, bien que je n’en eusse pas compris l’intention ou la portée future :
« Ô vous tous, les amoureux ! par Allah ! dites-moi, si l’amour sans répit habitait le cœur de sa victime, où serait la délivrance ?… »
Puis je m’éloignai rapidement et j’arrivai au jardin en question, dont je trouvai la porte ouverte ; et, tout au fond, une lanterne était allumée, vers laquelle je me dirigeai dans les ténèbres.
Lorsque j’arrivai à l’endroit où était celle lumière, quelle surprise ne m’attendait-elle pas ! Je trouvai, en effet, une merveilleuse salle à la voûte cintrée et surmontée d’une coupole toute lamée intérieurement d’ivoire et d’ébène et éclairée agréablement par d’immenses flambeaux d’or et de grandes lampes de cristal suspendues au plafond par des chaînes d’or. Et, au milieu de cette salle, un bassin, orné d’incrustations de couleur et de dessins entrelacés d’une grande perfection, faisait un bruit d’eau dont la musique à elle seule rafraîchissait. Tout à côté de ce bassin, un grand escabeau de nacre soutenait un plateau d’argent recouvert d’un foulard de soie, et sur le tapis était posé un grand pot en terre cuite vernissée, dont le col élancé soutenait une coupe de cristal et d’or.
Alors moi, ô mon jeune seigneur, la première chose que je fis fut d’enlever le foulard de soie qui recouvrait le grand plateau d’argent. Et les choses délicieuses qui s’y trouvaient, je les vois encore devant mes yeux ! Il y avait là en effet…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et s’arrêta dans les paroles permises.
LA CENT SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
Le vizir Dandân continua de la sorte, pour le roi Daoul’makân, l’histoire que racontait le bel Aziz au jeune prince Diadème :
Il y avait là en effet, dorés et odorants, quatre poulets rôtis, assaisonnés aux épices fines ; il y avait là quatre porcelaines de grande capacité contenant, la première, de la mahallabia[1] parfumée à l’orange et saupoudrée de pistaches concassées et de cannelle ; la seconde, des raisins secs, macérés, puis sublimés et parfumés discrètement à la rose ; la troisième, oh ! la troisième ! de la baklawa[2] artistement feuilletée et divisée en losanges d’une suggestion infinie ; la quatrième, des kataïefs[3] au sirop bien lié et prêts à éclater tant ils étaient généreusement farcis ! Voilà pour la moitié du plateau. Quant à l’autre moitié, elle contenait justement mes fruits de prédilection : des figues toutes ridées de maturité, et nonchalantes tant elles se savaient désirables ; des cédrats, des limons, des raisins frais et des bananes. Et le tout était séparé par des intervalles où se voyaient les couleurs de fleurs telles que roses, jasmins, tulipes, lis et narcisses.
Alors moi je m’épanouis de tout cela à la limite de l’épanouissement et je dis à mes chagrins de s’envoler et à la joie de m’habiter. Mais je restai un tant soit peu préoccupé de ne voir pas, en ce lieu, trace d’une créature vivante d’entre les créatures d’Allah ! Et, comme je ne voyais ni servante ni esclave qui vînt me servir, je n’osai d’abord toucher à quoi que ce fût ; et j’attendis patiemment l’arrivée de la bien-aimée de mon cœur. Mais la première heure s’écoula, et rien ! puis la deuxième et la troisième heures, et rien encore ! Alors je commençai à éprouver violemment la torture de la faim, moi qui depuis si longtemps n’avais pas mangé, tout dominé que j’avais été par ma passion sans aboutissant ; mais maintenant que je constatais ce commencement de réalisation, l’appétit me revenait, par la grâce d’Allah, et j’en savais gré à ma pauvre Aziza qui m’avait toujours prédit le succès et expliqué exactement le mystère de ces rendez-vous.
Donc, ne pouvant davantage résister à la fringale énorme qui me creusait à vide, je me jetai d’abord sur les adorables kataïefs, que je préférais à tout, et je glissai dans mon gosier qui sait combien de ces délicieuses-là : on les eût dites pétries de parfums spirituels par les doigts diaphanes des houris. Puis je m’attaquai aux losanges croustillants de la juteuse baklawa, et je m’en posai facilement sur l’estomac ce qui m’était départi par le sort miséricordieux ; puis j’avalai la coupe entière de la blanche mahallabia saupoudrée de pistaches concassées, et si fraîche à mon cœur ; je me décidai ensuite pour les poulets, et j’en mangeai un ou deux ou trois ou quatre, tant était savante la farce cachée dans leur cavité, assaisonnée aux grains acides des grenades ; après quoi je me tournai vers les fruits pour me dulcifier et je caressai mon palais d’un choix lentement pesé ; et je terminai mon repas en goûtant une ou deux ou trois ou quatre cuillerées des grains doux des grenades, et je glorifiai Allah pour ses bienfaits. Et je mis fin à tout en étanchant ma soif au pot vernissé de terre cuite, sans me servir de la coupe inutile.
Alors, une fois mon ventre rempli, je sentis une grande lassitude m’envahir et m’annihiler tous les muscles ; et à peine avais-je eu la force de me laver les mains que je m’affalai sur les coussins des tapis et m’enfonçai dans un pesant sommeil.
Que se passa-t-il durant cette nuit ?… Tout ce que je sais, c’est qu’au matin, me réveillant sous les rayons ardents du soleil, j’étais étendu, non plus sur les doux tapis merveilleux, mais directement sur le marbre nu, et j’avais sur la peau du ventre une pincée de sel et une poignée de poudre de charbon. Alors je me levai vivement et me secouai et regardai à droite et à gauche ; mais je ne vis pas trace d’une créature vivante autour et alentour. Aussi, grande fut ma perplexité et mon émotion également ; et je fus contre moi-même dans une grande colère ; puis je me repentis de la faiblesse de ma chair et de mon peu d’endurance aux veilles et à la fatigue. Et je m’acheminai tristement vers ma maison, où je trouvai ma pauvre Aziza qui se lamentait doucement et récitait ces vers en pleurant :
« Dansante la brise se lève et vient à moi à travers la prairie. Je la reconnais à son odeur, avant même que sa caresse ne se pose sur mes cheveux.
Ô brise douce, viens ! les oiseaux chantent. Viens ! toute effusion suivra sa destinée.
Si je pouvais, ah ! si je pouvais, amour, te prendre dans mes bras, comme l’amant sur sa poitrine emprisonne la tête de sa bien-aimée !…
Oh ! adoucir à ton haleine l’amertume de ce cœur qui dans la douleur se plonge !…
Toi parti, ô Aziz, que me restera-t-il des joies de ce monde et quel goût désormais trouver à la vie !…
Ah ! qui me dira si le cœur du bien-aimé est comme mon cœur, liquéfié de la chaleur d’amour et de sa flamme !… »
Mais, en me voyant, Aziza se leva vivement en essuyant ses larmes et me reçut avec des paroles de toute douceur et m’aida à me débarrasser de mes vêtements qu’elle renifla à plusieurs reprises pour me dire : « Par Allah ! ô fils de mon oncle, ce ne sont vraiment pas là les parfums que laisse sur les habits le contact d’une femme amoureuse ! Raconte-moi donc ce qui s’est passé. » Et je me hâtai de la satisfaire. Alors son visage devint fort soucieux, et elle me dit sur un ton effrayé : « Par Allah ! ô Aziz, je ne suis plus tranquille à ton sujet, et j’ai bien peur maintenant que cette inconnue ne te fasse éprouver de grands désagréments. Sache, en effet, que le sel posé sur ta peau signifie qu’elle te trouve très fade, toi, un amoureux si passionné, de t’être laissé vaincre par le sommeil et la fatigue ; et le charbon signifie : « Puisse Allah te noircir le visage ! ô toi dont l’amour est mensonger ! » Ainsi donc, mon Aziz bien-aimé, cette femme, au lieu d’être gentille pour son hôte et de le réveiller doucement, l’a traité avec ce mépris et lui a fait ainsi savoir qu’il n’était bon qu’à manger, boire et dormir. Ah ! qu’Allah te délivre de l’amour de cette femme sans miséricorde et sans cœur ! » Alors moi, à ces paroles, je me frappai la poitrine et m’écriai : « C’est moi qui suis le coupable, car, par Allah ! cette femme a raison, les amoureux ne dorment pas. Ah ! c’est moi qui, par ma faute, me suis attiré cette calamité. De grâce ! que faire maintenant, ô fille de mon oncle ? ah ! dis-le-moi ! »
Or, ma pauvre cousine Aziza m’aimait considérablement ; et elle fut à la limite de l’attendrissement en me voyant si chagriné…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit au roi Schahriar :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le vizir Dandân continua de la sorte, pour le roi Daoul’makân, l’histoire que le bel Aziz racontait au jeune prince Diadème :
Or, ma pauvre cousine Aziza m’aimait considérablement ; et elle fut à la limite de l’attendrissement en me voyant si chagriné et elle me répondit : « Sur ma tête et sur mes yeux ! mais, ô Aziz, comme cela me serait bien plus facile de t’être utile si les convenances me permettaient de sortir, d’aller et de venir ! Prête à me marier, je dois, selon nos usages, garder la maison strictement. Pourtant, écoute-moi bien pour que, de loin, je puisse veiller sur ta réussite, du moment que je ne puis être un trait direct d’union entre elle et toi. Donc, ô Aziz, retourne encore ce soir au même endroit, et surtout résiste à la tentation du sommeil ! Et pour cela évite de manger, car la nourriture alourdit les sens et les amollit. Prends donc bien garde de dormir, et tu la verras venir à toi vers le quart de la nuit. Et qu’Allah t’ait sous sa protection et te défende contre les perfidies ! »
Alors moi je me mis à faire des vœux pour que la nuit vînt plus tôt. Et lorsque je fus sur le point de sortir, Aziza m’arrêta encore un instant pour me dire : « Et je te recommande, avant tout, lorsque la jeune fille t’aura accordé la satisfaction de tes désirs, de ne pas oublier de lui réciter la strophe que je t’ai apprise. » Et moi je répondis : « J’écoute et j’obéis ! » Puis je sortis de la maison.
En arrivant au jardin, je trouvai, comme la veille, la salle magnifique illuminée et, dans cette salle, de grands plateaux chargés de mets, de pâtisseries, de fruits et de fleurs. À peine l’odeur des fleurs et des mets et de toutes ces délices m’eut-elle attendri les narines, que mon âme ne put se contenir, et j’obéis à son désir et je mangeai mon plein de chaque chose et je bus à même le grand pot vernissé ; et comme il plaisait extrêmement à mon âme, j’en bus encore jusqu’à la dilatation complète de mon ventre. Alors je fus content. Mais bientôt mes paupières battirent ; et pour lutter contre le sommeil j’essayai de les ouvrir avec mes doigts, mais en vain. Alors je me dis : « Je vais simplement, sans dormir, m’étendre un peu, oh ! le temps de poser un instant ma tête sur le coussin, sans plus ! Mais je ne dormirai pas, oh ! non ! » Et je pris un coussin et m’y appuyai la tête. Mais ce fut pour ne me réveiller que le lendemain au jour ; et je me vis étendu, non plus dans la salle splendide, mais dans une misérable pièce qui devait probablement servir aux palefreniers ; et je trouvai sur mon ventre un os de patte de mouton et une balle ronde et des noyaux de dattes et des grains de caroubes ; et, à côté, deux drachmes et un couteau. Alors, plein de confusion, je me levai et secouai vivement tous ces déchets et, furieux de ce qui m’advenait, je ramassai seulement le couteau et j’arrivai bientôt à la maison, où je trouvai Aziza qui murmurait plaintivement ces strophes :
« Larmes de mes yeux ! vous avez dissous mon cœur et rendu liquide mon corps.
Et mon ami est de plus en plus cruel ! Mais n’est-il point doux de souffrir pour l’ami, quand il est si beau ?
Ô Aziz, mon cousin ! tu as rempli mon âme de passion et creusé en elle des abîmes de douleur ! »
Alors moi, encore tout plein de dépit, j’attirai brutalement son attention en lui lançant une ou deux injures. Mais sa patience n’en fut pas émue et, admirable de douceur, elle s’essuya les yeux et vint à moi et me jeta les bras autour du cou et me serra de force contre sa poitrine, alors que moi j’essayais de la repousser, et me dit : « Oh ! mon pauvre Aziz, je vois que tu t’es laissé encore aller à dormir cette nuit ! » Et moi, n’en pouvant plus, je m’affalai sur les tapis, suffoqué de dépit, et je lançai au loin le couteau que j’avais ramassé. Alors Aziza prit un éventail et s’assit à côté de moi et se mit à me faire de l’air et à me dire de prendre courage et que tout devait finir par s’arranger. Et, sur sa demande, je lui énumérai les différents objets qu’en me réveillant j’avais trouvés sur mon ventre. Puis je lui dis : « Par Allah ! hâte-toi de m’expliquer tout cela ! » Elle me répondit : « Ah ! mon Aziz, ne t’avais-je pas bien recommandé pour te faire éviter le sommeil, de résister à la tentation de la nourriture ! » Mais je m’écriai : « Oh ! hâte-toi de m’expliquer la chose ! » Elle dit : « Sache que la balle ronde signifie… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, s’arrêta dans les paroles permises.
LA CENT DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« Sache que la balle ronde signifie que ton cœur, malgré ta présence dans la maison de ton amoureuse, vagabonde dans l’air et décèle ton peu de ferveur ; les noyaux de dattes veulent dire que, comme eux, tu es dénudé de saveur puisque la passion, qui est la pulpe même du cœur, te manque totalement ; les grains du caroubier, qui est l’arbre d’Ayoub[4], père de la patience, sont là pour te rappeler cette vertu si précieuse pour les amoureux ; quant à l’os de patte de mouton, il ne supporte vraiment pas d’explication ! » Alors je m’écriai : « Mais, ô Aziza, tu oublies la lame effilée et les deux drachmes d’argent ! » Et Aziza devint toute tremblante et me dit : « Ô Aziz, comme j’ai peur pour toi ! Les deux drachmes d’argent symbolisent ses deux yeux. Et elle veut, par là, te dire : « Je jure sur mes deux yeux que, si tu revenais pour te rendormir, je t’égorgerais sans miséricorde avec le couteau ! » Ô fils de mon oncle, comme j’ai peur ! Et, pour ne pas t’ennuyer, je refoule toujours en moi-même mon effroi et je pleure en silence, seule dans la maison vide. Et pour toute consolation je n’ai que mes sanglots ! »
Alors mon cœur compatit à sa douleur et je lui dis : « Par ma vie sur toi, ô fille de mon oncle, quel est le remède à tout cela ? Ah ! aide-moi à sortir de cette calamité sans recours ! » Elle dit : « Avec amitié et respect ! Mais il te faut écouler mes paroles et t’y conformer, sinon rien n’est fait ! » Je répondis : « J’écoute et j’obéis ! je te le jure sur la tête de mon père ! »
Alors Aziza, confiante en ma promesse, devint heureuse et m’embrassa et me dit : « Eh bien ! voici. Il te faut dormir ici toute la journée ; de la sorte tu ne seras pas tenté cette nuit par le sommeil. Et à ton réveil, je te donnerai moi-même à manger et à boire ; et tu n’auras ainsi plus rien à redouter. » En effet, Aziza m’obligea à me coucher et se mit à me masser doucement ; et, sous l’influence de ce massage délicieux, je ne tardai pas à m’endormir ; et, à mon réveil, vers le soir, je la trouvai encore assise à côté de moi et qui me faisait de l’air avec l’éventail. Et je vis qu’elle avait dû pleurer tout le temps, car ses habits portaient les traces de ses larmes. Alors Aziza se hâta de m’apporter de quoi manger, et elle me mettait elle-même les morceaux à la bouche, et je n’avais que la peine d’avaler et cela jusqu’à ce que je me fusse repu complètement. Puis elle me donna à boire un bol d’une décoction de jujubes dans de l’eau de roses au sucre, ce qui me rafraîchit parfaitement. Puis elle me lava les mains et me les essuya avec une serviette parfumée au musc et m’aspergea avec de l’eau de senteur. Après quoi elle m’apporta une robe considérablement merveilleuse et m’en vêtit ; et elle me dit : « Si Allah veut, cette nuit sera sûrement pour toi la nuit de tes souhaits ! » Puis, en me conduisant jusqu’à la porte, elle ajouta : « Mais surtout n’oublie pas ma recommandation ! » Je dis : « Laquelle ? » Elle dit : « Ô Aziz ! la strophe que je t’ai apprise ! »
J’arrivai donc au jardin, et, comme les précédentes nuits, j’entrai dans la salle à la voûte cintrée et m’assis sur les riches tapis. Et comme vraiment j’étais bien repu, je regardai les plateaux avec indifférence, et me mis à veiller de la sorte jusque vers le milieu de la nuit. Et je ne voyais personne ; je n’entendais pas un bruit. Alors je commençai à trouver la nuit aussi longue qu’une année ; mais je patientai et attendis encore. Cependant les trois quarts de la nuit s’étaient écoulés, et déjà les coqs se mettaient à chanter la première aube. De sorte que la faim commença à se faire sentir ; et peu à peu elle devint si forte que mon âme désira le goût des plateaux ; et je ne pus guère résister à mon âme ; bientôt je fus debout ; j’enlevai alors les grands foulards, et je mangeai jusqu’à satiété, et je bus un verre et puis deux verres et jusqu’à dix verres. Alors ma tête s’alourdit ; mais je luttai avec énergie et me roidis et agitai ma tête dans tous les sens. Mais, au moment même où j’allais me laisser aller sans plus, j’entendis quelque chose comme un bruit de rires et de soieries. Et j’avais à peine eu le temps de sauter vivement sur mes pieds et de me laver les mains et la bouche, quand je vis le grand rideau du fond se relever. Et, souriante et entourée de dix jeunes femmes esclaves, belles comme les étoiles, elle entra. Et c’était la lune elle-même. Elle était vêtue d’une robe de satin vert toute brodée d’or rouge. Et, pour t’en donner une idée seulement, ô mon jeune seigneur, je te dirai les vers du poète :
La voici ! de regard hautain, la fille magnifique ! À travers la robe verte sans boutons les seins éclatants se tendent joyeux ; et la chevelure est dénouée.
Et moi, ébloui, si je lui demande son nom, elle me répond : « Je suis celle qui brûle les cœurs des amants sur un feu immortel ! »
Et si je parle des tortures d’amour, elle me dit : « Je suis la roche sourde et l’azur sans écho ! Ô naïf ! se plaint-on de la surdité de la roche ou de l’azur ? »
Mais je lui dis alors : « Ô femme ! si ton cœur est la roche, sache que mes doigts, comme autrefois Moïse, de la roche feront jaillir la limpidité d’une source ! »
Et, de fait, ô mon jeune seigneur, comme je lui récitais ces vers, elle me sourit et me dit : « C’est fort bien ! Mais comment as-tu pu réussir cette fois à ne point te laisser vaincre par le sommeil ? » Et je répondis : « C’est la brise de ta venue qui m’a vivifié l’âme ! »
Alors elle se tourna vers ses esclaves et leur fit un clignement d’œil ; et aussitôt elles s’éloignèrent et nous laissèrent seuls dans la salle. Alors elle vint s’asseoir tout près de moi et me tendit sa poitrine et me jeta les bras autour du cou. Et moi, je me jetai sur ses lèvres ; et je lui suçai la lèvre supérieure, cependant qu’elle me suçait la lèvre inférieure ; puis je la pris par sa taille, que je pliai ; et tous deux nous roulâmes ensemble sur les tapis. Alors je me glissai dans l’ouverture délicate de ses jambes et je lui défis toutes ses robes. Et nous commençâmes des ébats mêlés de baisers et de caresses, de pincements et de morsures, de levées de cuisses et de jambes, et de gambades folles à travers la salle. Si bien qu’elle finit par tomber épuisée dans mes bras, morte de désir. Alors cette nuit-là fut une nuit douce à mon cœur et une fête pour mes sens, comme dit le poète :
Joyeuse me fut la nuit et facile et délicieuse entre toutes les nuits de mon destin. La coupe ne se posa pas un instant vide de rougeur.
Cette nuit ! Je dis au sommeil : « Va ! crois-tu donc que mes paupières te désirent ?… » Et je dis aux jambes et aux cuisses d’argent : « Approchez-vous ! »
Mais lorsque vint le matin, comme je voulais prendre congé, elle m’arrêta encore un instant pour me dire : « Attends un peu ! J’ai quelque chose à te révéler… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Aziz continua de la sorte son histoire :
Elle m’arrêta encore un instant pour me dire : « Attends un peu ! J’ai quelque chose à te révéler, et une recommandation à te faire ! » Alors, un peu surpris, je m’assis de nouveau à côté d’elle ; et elle déplia un foulard et en retira l’étoffe carrée sur laquelle se trouve brodée la première gazelle, que tu vois là devant toi, ô mon jeune seigneur. Et elle me la donna en disant : « Garde cela soigneusement ! C’est le travail d’une jeune fille de mes amies, la princesse des Îles du Camphre et du Cristal. Ce signe sera pour toi, dans la vie, d’une importance très grande. Et de plus il te rappellera toujours celle qui t’a fait ce présent ! » Alors moi, à la limite de l’étonnement, je la remerciai avec effusion et, en prenant congé d’elle, j’oubliai, tant j’étais émerveillé de tout ce qui m’arrivait, de lui réciter la strophe que m’avait apprise Aziza.
Lorsque j’arrivai à la maison, je trouvai ma pauvre cousine couchée ; ses traits portaient l’indice d’un mal imminent ; mais, en me voyant entrer, elle fit effort sur elle-même pour se lever, et, les yeux mouillés de larmes, elle se traîna jusqu’à moi et m’embrassa la poitrine et me serra longtemps contre son cœur, et me demanda : « Lui as-tu récité la strophe ? » Alors je fus tout confus et répondis : « Ah ! je l’ai oublié. Et la cause en est à cette gazelle brodée sur cette étoffe de soie. » Et je dépliai devant elle l’étoffe et lui montrai la gazelle en question. Alors Aziza ne put se contenir davantage et éclata devant moi en sanglots et, entre ses larmes, elle récita ces vers :
« Ah ! pauvre cœur, dis-toi bien que la lassitude est la règle de tout attachement, et que la rupture est la conclusion de toute amitié ! »
Puis elle ajouta : « Ô mon cousin, pour toute grâce je te prie de ne pas oublier, la prochaine fois, de lui réciter la strophe ! » Je répondis : « Répète-la-moi encore une fois, car je l’ai oubliée à peu près. » Alors elle me la répéta et je la retins bien ; puis, le soir venu, elle me dit : « Voici l’heure ! Qu’Allah te conduise en sécurité ! »
En arrivant au jardin, j’entrai dans la salle, où je trouvai mon amoureuse dans l’attente de ma venue ; et aussitôt elle me prit et m’embrassa et me fit m’étendre dans son giron ; puis, après avoir mangé et bu, nous nous possédâmes dans toute notre plénitude. Et il est inutile de donner le détail de nos ébats qui durèrent jusqu’au matin. Alors moi je n’oubliai pas, cette fois, de lui réciter la strophe d’Aziza :
« Ô vous tous, les amoureux ! par Allah ! dites-moi, si l’amour sans répit habitait le cœur de sa victime, où serait la délivrance ? »
Je ne saurais te dire, seigneur, l’effet que ce vers produisit sur mon amie ; son émotion fut si forte que son cœur, qu’elle disait si dur, fondit dans sa poitrine ; et elle pleura abondamment et improvisa cette strophe :
« Honneur à la rivale à l’âme magnanime ! Elle sait tous les secrets et les garde en silence. Elle souffre du partage et se tait sans murmure. Elle connaît la valeur admirable de la patience ! »
Alors moi je retins soigneusement cette strophe pour la répéter à Aziza. Et, quand je fus de retour à la maison, je trouvai Aziza étendue sur les matelas, et ma mère, qui la soignait, était assise à côté d’elle. Et la pauvre Aziza avait sur son visage une très grande pâleur ; et elle était si faible qu’elle avait l’air d’être évanouie ; et elle leva douloureusement les yeux vers moi, sans pouvoir faire un mouvement. Alors ma mère me regarda avec sévérité, en hochant la tête, et me dit : « Quelle honte sur toi, ô Aziz ! Est-ce ainsi qu’on délaisse sa fiancée ? » Mais Aziza prit la main de ma mère et la baisa, et l’interrompit pour me dire, d’une voix à peine distincte : « Ô fils de mon oncle, as-tu oublié ma recommandation ? » Alors moi je lui dis : « Sois tranquille, ô Aziza ! Je lui ai récité la strophe, qui l’a émue à la limite de l’émotion, et tellement qu’elle me récita cette strophe-ci. » Et je lui répétai les vers en question. Et Aziza, en les entendant, pleura silencieusement et murmura ces paroles du poète :
« Celui qui ne sait taire le secret ni pratiquer la patience dans l’épreuve n’a plus qu’à souhaiter la mort comme partage.
Pourtant ! ma vie entière s’écoula dans le renoncement. Et je meurs sevrée des paroles de l’ami ! Ah ! quand je mourrai, faites parvenir mon salut à celle qui fut le malheur de ma vie ! »
Puis elle ajouta : « Ô fils de mon oncle, je te prie, lorsque tu reverras ton amoureuse, redis-lui ces deux strophes ! Et que la vie te soit douce et facile, ô Aziz ! »
Or, moi, lorsque vint la nuit, je retournai au jardin, selon mon habitude, et je trouvai mon amie qui m’attendait dans la salle ; et nous nous assîmes tous deux, côte à côte, à manger, à boire et à nous amuser de toutes façons, pour ensuite nous coucher, enlacés, jusqu’au jour. Alors je me rappelai ma promesse à Aziza, et je récitai à mon amie les deux strophes apprises.
Or, à peine les eut-elle entendues, que soudain elle poussa un grand cri et recula épouvantée et s’écria : « Par Allah ! la personne qui a dit ces vers, doit être sûrement morte à l’heure qu’il est ! » Puis elle ajouta : « J’espère pour toi que cette personne n’est point une parente à toi ni une sœur ni une cousine ! Car sûrement, je te le répète, cette personne est maintenant du nombre des morts ! » Alors je lui dis : « C’est ma fiancée, la fille même de mon oncle ! » Mais elle me cria : « Que dis-tu ? Et pourquoi mens-tu de la sorte ? Ce n’est pas vrai ! Si vraiment c’était ta fiancée, tu l’aimerais autrement ! » Je répétai : « C’est ma fiancée, la fille de mon oncle, Aziza ! » Alors elle dit : « Alors pourquoi ne me le disais-tu pas ? Par Allah ! jamais je ne me serais permis de lui ravir son fiancé, si j’avais eu connaissance de ces liens ! Malheur ! Mais, dis-moi, a-t-elle tout su de nos rencontres d’amour ? » Je dis : « Certes ! Et c’est elle-même qui m’expliquait les signes que tu me faisais ! Et sans elle je n’aurais jamais pu parvenir jusqu’à toi ! C’est grâce à ses bons conseils et à sa bonne direction que j’ai pu parvenir au but ! » Alors elle s’écria : « Eh bien ! c’est toi qui es la cause de sa mort ! Puisse Allah ne point abîmer ta jeunesse comme tu as abîmé la jeunesse de ta pauvre fiancée ! Va donc vite voir ce qu’il en est ! »
Alors moi je me hâtai de sortir, l’esprit préoccupé de cette mauvaise nouvelle. Et, en arrivant au coin de la ruelle où est située notre maison, j’entendis des cris lugubres de femmes qui se lamentaient à l’intérieur de la maison. Et comme je m’informais auprès des voisines qui entraient et sortaient, l’une d’elles me dit : « On a trouvé Aziza, derrière la porte de sa chambre, étendue morte ! » Alors moi je me précipitai à l’intérieur ; et la première personne qui me vit fut ma mère, qui me cria : « Tu es responsable devant Allah de sa mort ! Et le poids de son sang est attaché à ton cou ! Ah ! mon fils, quel triste fiancé tu as été ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
« Ah ! mon fils, quel triste fiancé tu as été ! » Et, comme elle allait continuer à m’accabler de reproches, mon père entra ; alors elle se tut devant lui, pour le moment. Et mon père commença à faire les préparatifs des funérailles ; et quand tous les amis et les proches furent là, et que tout fut prêt, alors nous célébrâmes les funérailles et nous fîmes les cérémonies d’usage pour les grands enterrements, en restant trois jours, sous les tentes, sur sa tombe, à réciter le Livre Saint.
Alors moi je revins à la maison, près de ma mère, et je me sentais le cœur pris de pitié pour l’infortunée défunte. Et ma mère vint à moi et me dit : « Mon fils, je veux que tu me dises enfin ce dont tu as bien pu te rendre coupable envers la pauvre Aziza pour lui avoir ainsi fait éclater le foie ! Car, ô mon fils, j’eus beau lui demander à elle-même la cause de sa maladie, elle n’a jamais rien voulu me révéler et surtout elle n’eût jamais un mot amer contre toi ; au contraire ! elle eut pour toi, jusqu’à la fin, des paroles de bénédiction. Donc, ô Aziz, par Allah sur toi ! raconte-moi ce que tu as fait à cette infortunée pour la faire ainsi mourir ! » Je répondis : « Moi ? rien du tout ! » Mais ma mère insista et me dit : « Quand elle fut sur le point d’expirer, j’étais à son chevet. Alors elle se tourna vers moi, ouvrit un instant les yeux et me dit : « Ô femme de mon oncle, je supplie le Seigneur de ne demander compte à personne du prix de mon sang, et de pardonner à ceux qui m’ont torturé le cœur ! Voici en effet que je quitte un monde périssable pour un autre, immortel ! » Et je lui dis : « Ô ma fille, ne parle pas de la mort ! Qu’Allah te rétablisse promptement ! » Mais elle me sourit tristement et me dit : « Ô femme de mon oncle, je te prie de transmettre à Aziz, ton fils, ma dernière recommandation, en le suppliant de ne pas l’oublier ! Lorsqu’il ira à l’endroit où il a l’habitude d’aller qu’il dise ces mots, avant de le quitter :
Que la mort est douce et préférable à la trahison ! »
Puis elle ajouta : « De la sorte il me rendra son obligée, et je veillerai sur lui après ma mort comme j’avais veillé sur lui de mon vivant ! » Ensuite elle souleva l’oreiller et sous l’oreiller elle prit un objet qu’elle me chargea de te donner ; mais elle me fit faire le serment de ne te donner cet objet que lorsque je t’aurais vu revenir à de meilleurs sentiments et pleurer sa mort et la regretter sincèrement. Or, moi, mon fils, je te garde soigneusement cet objet, et je ne te le donnerai qu’en te voyant remplir la condition imposée ! »
Alors moi je dis à ma mère : « Soit ! mais tu peux bien me montrer cet objet ! » Mais ma mère refusa avec énergie et me quitta.
Or, tu peux constater, seigneur, combien à cette époque là j’étais affligé d’étourderie et combien j’étais peu rassis de raison, puisque je ne voulais guère écouter la voix de mon cœur. Au lieu de pleurer ma pauvre Aziza et de porter son deuil en mon âme, je ne pensais qu’à m’amuser et me distraire. Et rien ne m’était plus délicieux que de continuer à me rendre chez mon amoureuse. Aussi, à peine la nuit venue, je me hâtai de me rendre chez elle ; et je la trouvai aussi impatiente de me revoir que si elle était assise sur le gril. Et à peine étais-je entré qu’elle courut à moi et se suspendit à mon cou et me demanda des nouvelles de ma cousine Aziza ; et quand je lui eus raconté les détails de sa mort et des funérailles, elle fut prise d’une grande compassion et me dit : « Ah ! que n’ai-je su, avant sa mort, les bons services qu’elle t’a rendus et son abnégation admirable ! Et comme je l’en eusse remerciée et récompensée de toute manière ! »
Alors, je lui dis : « Et surtout elle a bien recommandé à ma mère de me répéter, pour qu’à mon tour je te les dise, quatre mots, les derniers qu’elle ait prononcés :
Que la mort est douce et préférable à la trahison ! »
Lorsque l’adolescente eut entendu ces paroles elle s’écria : « Qu’Allah l’ait en sa miséricorde ! Voici que, même après sa mort, elle te devient d’un grand secours ! Car elle te sauve, par ces simples paroles, du projet de perdition que j’avais comploté contre toi et des embûches où j’avais résolu de te faire tomber ! »
À ces paroles étranges, je fus à la limite de l’étonnement et je m’écriai : « Que dis-tu là ? Comment ! nous étions liés par l’affection et tu avais résolu ma perte ! Quelles sont ces embûches où tu me voulais faire tomber ? »
Elle répondit : « Enfant ! ô naïf ! je vois que tu ne te doutes guère de toutes les perfidies dont nous, les femmes, sommes capables ! Mais je ne veux pas insister. Sache seulement que tu dois à ta cousine ta délivrance d’entre mes mains. Pourtant je ne me désiste qu’à la condition que tu n’adresses jamais un regard ni une parole à une autre femme que moi, que cette femme soit jeune ou vieille. Sinon malheur à toi ! Ah ! oui, malheur à toi ! Car alors tu n’auras plus personne qui te tire de mes mains, puisque celle qui te fortifiait de ses conseils est morte. Prends donc bien garde d’oublier cette condition ! Et maintenant j’ai à te faire une prière ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT VINGT-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« Et maintenant j’ai à te faire une prière. » Je dis : « Laquelle ? » Elle dit : « C’est de me conduire vers la tombe de la pauvre Aziza pour que je la visite et écrive sur la pierre qui la recouvre quelques mots de déploration. » Je répondis : « Ce sera pour demain, si Allah le veut ! » Puis je me couchai pour passer la nuit avec elle ; mais toutes les heures elle me posait des questions sur Aziza et me disait : « Ah ! pourquoi ne m’avais-tu averti qu’elle était la fille de ton oncle ? » Alors moi, à mon tour, je lui dis : « À propos, j’ai oublié de te demander la signification de ces paroles : « Que la mort est douce et préférable à la trahison ! » Mais elle ne me voulut rien dire à ce sujet.
Le matin, à la première heure, elle se leva et prit une grande bourse remplie de dinars et me dit : « Allons ! lève-toi et conduis-moi vers sa tombe. Car je veux également lui bâtir une coupole ! » Et je répondis : « J’écoute et j’obéis ! » Et je sortis et marchai devant elle ; et elle me suivait en distribuant aux pauvres, tout le long du chemin, des dinars qu’elle puisait dans la bourse, et elle disait chaque fois : « Cette aumône est pour le repos de l’âme d’Aziza ! » Et nous arrivâmes de la sorte au tombeau. Alors elle se jeta sur le marbre et y versa d’abondantes larmes. Puis elle sortit d’un sac de soie un ciseau d’acier et un marteau d’or, et grava sur le marbre poli ces vers en caractères charmants :
Une fois je fus le passant qui s’arrêta devant une tombe enfouie au milieu du feuillage avec, pleurant sur elle, sept anémones, la tête inclinée.
Et je dis : « Qui peut bien être dans cette tombe ? » Mais la voix de la terre me répondit : « Homme ! courbe ton front avec respect ! Ici, dans la paix du silence, dort une amoureuse ! »
Alors je m’écriai : « Ô toi qu’a tuée l’amour, femme qui dors dans le silence ! puisse le Seigneur te faire oublier les tribulations, et te placer sur le plus haut sommet du Paradis ! »
Infortunés amoureux, vous êtes délaissés jusque dans la mort, puisque nul ne vient essuyer la poussière de vos tombeaux !
Moi, ici, je veux planter des roses et des fleurs amoureuses et, pour les faire mieux fleurir, je les arroserai de mes larmes.
Ensuite elle se leva, et jeta un regard d’adieu à la tombe d’Aziza et reprit avec moi le chemin de son palais. Et elle était devenue très tendre soudain ; et à plusieurs reprises elle me dit : « Par Allah ! ne me délaisse jamais ! » Et moi je me hâtai de répondre par l’ouïe et l’obéissance. Et je continuai à me rendre régulièrement chez elle toutes les nuits ; et elle me recevait toujours avec beaucoup d’expansion et de chaleur, et n’épargnait rien pour me faire plaisir. Et je ne cessai d’être ainsi, à manger, à boire, à embrasser et à copuler, à vêtir tous les jours des robes plus belles les unes que les autres et des chemises plus fines les unes que les autres, jusqu’à ce que je fusse devenu extrêmement gras et à la limite dernière de l’embonpoint ; et je ne sentais plus ni peines ni soucis ; et j’oubliai complètement jusqu’au souvenir de la pauvre fille de mon oncle. Et je restai dans cet état de délices la longueur entière d’une année.
Or, un jour, au commencement de la nouvelle année, j’étais allé au hammam et j’avais revêtu ma robe la plus somptueuse ; et, en sortant du hammam, j’avais bu une coupe de sorbet et humé avec volupté les odeurs fines qui se dégageaient de ma robe imprégnée de parfums ; et je me sentais encore plus épanoui que d’habitude et je voyais toute chose en blanc autour de moi ; et le goût de la vie m’était délicieux à l’extrême, et tellement que j’en étais dans un état d’ivresse qui m’allégeait de mon propre poids et me faisait courir comme un homme pris de vin. Et c’est dans cet état que le désir me vint d’aller répandre l’âme de mon âme dans le sein de mon amie.
Je me dirigeais donc vers sa maison quand, en traversant une ruelle nommée l’Impasse de la Flûte, je vis s’avancer vers moi une vieille qui tenait à la main une lanterne pour éclairer sa route et une lettre dans son rouleau. Alors je m’arrêtai ; et elle, après m’avoir souhaité la paix, me dit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et ne voulut pas abuser des paroles permises.
LA CENT VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
Et elle, après m’avoir souhaité la paix, me dit : « Mon enfant, sais-tu lire ? » Je répondis : « Oui, ma bonne tante. » Elle me dit : « Alors, je te prie, prends cette lettre et lis m’en le contenu. » Et elle me tendit la lettre ; et je la pris et l’ouvris et lui en lus le contenu. Il y était dit que le signataire de cette lettre était en bonne santé et qu’il envoyait ses amitiés et son salut à sa sœur et à ses parents. Alors, en entendant la chose, la vieille leva les bras au ciel et fit des vœux pour ma prospérité, moi qui lui annonçais une si bonne nouvelle, et me dit : « Puisse Allah te soulager de toutes peines comme tu viens de me tranquilliser le cœur. » Puis elle reprit sa lettre et continua son chemin. Alors moi je fus pris d’un pressant besoin d’uriner, et je m’accroupis contre un mur et satisfis mon besoin ; puis je me relevai, après m’être bien secoué, et je ramenai ma robe et voulus m’en aller, quand je vis revenir la vieille qui me prit la main et la porta à ses lèvres et me dit : « Seigneur, excuse-moi, mais j’ai une grâce à te demander et, en me l’accordant, tu mettras le comble à tes bienfaits, et tu en seras rémunéré par le Rétributeur. Je te prie de m’accompagner tout près d’ici, jusqu’à la porte de notre maison, pour lire encore une fois, de derrière la porte, cette lettre aux femmes de la maison ; car sûrement elles ne voudront pas se fier au résumé que je leur donnerai moi-même de cette lettre, surtout ma fille, qui est très attachée à son frère, le signataire de cette lettre, lequel nous a quittées pour un voyage de commerce depuis déjà dix ans et dont c’est la première nouvelle, depuis le temps que nous le pleurons comme mort. Je t’en prie, ne me refuse pas cela ! Tu n’auras même pas la peine d’entrer, car tu leur liras cette lettre du dehors. D’ailleurs, tu sais les paroles du Prophète (sur lui la prière et la paix !) au sujet de ceux qui soulagent leurs semblables : « Celui qui tire un musulman d’une peine d’entre les peines de ce monde, Allah lui en tiendra compte en lui effaçant soixante-douze peines des peines de l’autre monde ! » Alors moi je me hâtai d’accéder à sa demande et je lui dis : « Marche devant moi pour m’éclairer et me montrer le chemin ! » Et la vieille me précéda ; et, au bout de quelques pas, nous arrivâmes à la porte d’un palais.
Et c’était une porte monumentale, toute lamée de bronze ouvragé et de cuivre rouge. Alors moi je me tins tout contre la porte ; et la vieille jeta un cri d’appel en langue persane. Et aussitôt, sans avoir le temps de me rendre compte de la chose, tant fut rapide le mouvement, devant moi, par la porte entrebâillée, une jeune fille légère et potelée, souriante, apparut, les pieds nus sur le marbre lavé ; et de ses mains elle tenait, de crainte de les mouiller, les plis de son caleçon relevés jusqu’à mi-hauteur de ses cuisses ; ses manches étaient également relevées plus haut que ses aisselles qui apparaissaient dans l’ombre des bras blancs. Et je ne sus ce que je devais le plus admirer, de ses cuisses, colonnes d’albâtre, ou de ses bras de cristal. Ses chevilles fines étaient cerclées de grelots d’or enrichis de pierreries, et ses poignets souples, de deux paires de lourds bracelets aux multiples feux ; aux oreilles, des pendeloques de merveilleuses perles ; au cou, une chaîne triple de joyaux inestimables ; sur les cheveux, un foulard d’un tissu subtil constellé de diamants. Mais, détail qui me fit supposer qu’elle devait être, avant de nous ouvrir, en train de se livrer à quelque exercice plutôt agréable, je remarquai que sa chemise, en désordre, sortait de son caleçon dont les cordons étaient desserrés. En tout cas, sa beauté et surtout ses cuisses admirables me donnèrent énormément à réfléchir ; et je pensai malgré moi à ces paroles du poète :
Ô jeune vierge, pour que je devine tous les trésors cachés, tâche de relever ta robe vers la naissance de tes cuisses, ô joie de mes sens ! Puis tends-moi la coupe fertile du plaisir !
Lorsque l’adolescente me vit, elle fut toute surprise, et d’un air candide avec de grands yeux, et d’une voix gentille, plus délicieuse que toutes celles entendues dans ma vie, elle demanda : « Ô ma mère, est-ce là celui qui va nous lire la lettre ? » Et la vieille ayant répondu : « Oui ! » la jeune fille tendit la main pour me remettre la lettre qu’elle venait de prendre de sa mère. Mais au moment où je m’inclinais vers elle pour recevoir la lettre, soudain, comme j’étais à une distance de deux pieds de la porte, je me sentis violemment projeté en avant par un coup de tête dans le dos, que venait de m’asséner la vieille, et poussé à l’intérieur du vestibule, alors que la vieille, plus rapide que l’éclair, se hâtait de rentrer derrière moi et fermait vivement la porte de la rue. Et je me vis ainsi prisonnier entre ces deux femmes, sans avoir le temps de réfléchir à ce qu’elles voulaient me faire, Mais je ne tardai pas à être fixé à ce sujet. En effet…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
En effet, à peine étais-je au milieu du corridor que la jeune fille, d’un croc-en-jambe donné avec une grande adresse, me jeta par terre et s’étendit tout de son long sur moi en me serrant dans ses bras à m’étouffer. Et moi je crus que c’était ma mort sans paroles. Or, pas du tout ! La jeune fille, après quelques mouvements divers, se releva à demi, s’assit sur mon ventre et de la main se mit à me frotter si furieusement et si longtemps et d’une manière tellement extraordinaire que j’en perdis l’usage de mes sens et fermai les yeux comme un idiot. Alors la jeune fille se mit debout et m’aida à me relever ; puis elle me prit par la main et, suivie de sa mère, me fit entrer, après que l’on eut traversé une série de sept corridors et de sept galeries, dans l’endroit où elle devait habiter. Et moi je la suivais absolument comme un homme ivre, par suite de l’effet produit sur moi par ses doigts terriblement experts. Elle s’arrêta alors et me fit asseoir et me dit : « Ouvre les yeux ! » Et j’ouvris les yeux et me vis dans une immense salle éclairée par quatre grandes arcades vitrées, et si vaste qu’elle eût pu servir de champ de course aux joutes des cavaliers ; elle était entièrement pavée de marbre, et les murs étaient recouverts de plaques aux couleurs vives mariées en dessins d’une finesse extrême. Elle était meublée de meubles d’une forme agréable et rehaussés de brocart et de velours, ainsi que les divans et les coussins. Et au fond de cette salle il y avait une vaste alcôve où se voyait un grand lit tout en or, avec des incrustations de perles et de pierreries, et vraiment digne d’un roi tel que toi, prince Diadème !
Alors la jeune fille, à mon grand ébahissement, m’appelant par mon propre nom, me dit : « Ô Aziz, que préfères tu ? la mort ou la vie ? » Je lui dis : « La vie ! » Elle reprit : « Du moment qu’il en est ainsi, tu n’as qu’à me prendre pour épouse ! » Mais je m’écriai : « Non, par Allah ! car plutôt que de me marier avec une libertine de ta sorte, je préfère la mort ! » Elle dit : « Ô Aziz, crois-moi ! marie-toi avec moi, et tu seras ainsi débarrassé de la fille de Dalila-la-Rouée ! » Je dis : « Mais qui est donc cette fille de Dalila-la-Rouée ? Je ne connais personne de ce nom. » Alors elle se mit à rire et me dit : « Comment, Aziz ! Tu ne connais pas la fille de Dalila-la-Rouée ? Et voilà déjà un an et quatre mois qu’elle est ton amante ! Pauvre Aziz, crains, oh ! crains les perfidies de cette coquine qu’Allah confonde ! En vérité, il n’y a pas sur terre âme plus corrompue que la sienne ! Que de victimes tuées de sa propre main ! Que de crimes commis sur ses nombreux amoureux ! Aussi suis-je bien étonnée de te voir encore sain et sauf toi-même, depuis le temps que tu la connais ! »
À ces paroles de la jeune fille, je fus à la limite dernière de l’ébahissement, et je dis : « Ô ma maîtresse, pourrais-tu m’expliquer comment tu es parvenue à connaître cette personne et tous ces détails inconnus de moi-même ? » Elle répondit : « Je la connais aussi bien que le Destin connaît ses propres décisions et les calamités qu’il recèle ! Mais avant de m’expliquer là-dessus, je désire apprendre de ta bouche le récit de ton aventure avec elle. Car, encore une fois, de te voir sortir vivant d’entre ses mains, je suis encore tout étonnée. »
Alors moi je racontai à la jeune fille tout ce qui m’était arrivé avec mon amoureuse du jardin et avec ma pauvre Aziza, la fille de mon oncle ; et elle, au nom d’Aziza, compatit énormément à ses peines et jusqu’à en pleurer à chaudes larmes, et, en signe de désespoir sans recours, elle frappa ses mains l’une contre l’autre et me dit : « Qu’Allah t’en dédommage par ses bienfaits, ô Aziz ! Je vois clairement à présent que tu ne dois ton salut d’entre les mains de la fille de Dalila-la-Rouée qu’à l’intervention de la pauvre Aziza ! Maintenant que tu l’as perdue, garde-toi bien des embûches de la perfide… Mais il ne m’est pas permis de t’en révéler davantage : le secret nous lie ! » Je dis : « Oui, certes ! tout cela m’est arrivé avec Aziza ! » Elle dit : « Ah ! vraiment, il n’y a plus aujourd’hui de femmes aussi admirables qu’Aziza ! » Je dis : « Bien plus, sache qu’avant de mourir elle me recommanda de dire à mon amoureuse, celle que tu appelles la fille de Dalila, ces simples paroles : « Que la mort est douce et préférable à la trahison ! » À peine venais-je de prononcer ces mots qu’elle s’écria : « Ô Aziz, voilà justement les paroles dont le simple effet te sauva d’une perdition certaine. Vivante ou morte, Aziza continue à veiller sur toi ! Mais laissons les morts : ils sont dans la paix d’Allah. Nous, occupons-nous du présent : sache donc, ô Aziz, qu’il y a longtemps que le désir de t’avoir à moi me possède toute, la nuit comme le jour ; et c’est aujourd’hui seulement que j’ai pu enfin mettre la main sur toi. Et tu vois que j’ai réussi ! » Je répondis : « Oui, par Allah ! » Elle continua : « Mais tu es jeune, ô Aziz, et tu ne te doutes pas de toutes les roueries dont est capable une vieille femme comme ma mère ! » Je dis : « Non, par Allah ! » Elle continua : « Résigne-toi donc à ta destinée et laisse-toi faire : tu n’auras qu’à te louer de ton épouse. Car, encore une fois, je ne veux m’unir avec toi que par contrat légitime devant Allah et son Prophète (sur lui la prière et la paix !). Et tous tes souhaits seront alors exaucés et au-delà : richesses, belles étoffes pour tes robes, turbans légers et immaculés, tout cela le viendra sans dépense de ta part ; et jamais je ne te permettrai de délier ta bourse, car chez moi le pain est toujours frais et la coupe remplie. Et, en retour, je ne te demanderai qu’une seule chose, ô Aziz ! » Je dis : « Laquelle ? » Elle dit : « C’est que tu fasses avec moi exactement ce que fait le coq ! » Je dis, étonné : « Et que te fait donc le coq ? »
À ces paroles, la jeune fille eut un retentissant éclat de rire et si fort qu’elle se renversa sur son derrière ; et elle se mit à trépider de joie en frappant ses mains l’une contre l’autre. Puis elle me dit : « Comment ! tu ne connais pas le métier du coq ? » Je dis : « Non, par Allah ! je ne connais point ce métier ! Quel est-il ? » Elle dit : « Le métier du coq, ô Aziz, est de manger, de boire et de copuler ! ».
Alors moi je fus vraiment tout à fait confus de l’entendre ainsi parler, et je dis : « Non, par Allah ! je ne savais point que ce fût là un métier ! » Elle répondit : « C’est le meilleur, ô Aziz ! Hardi donc ! Lève-toi, ceins ta taille, fortifie tes reins et puis fais-le dur, sec et longtemps ! » Et elle cria à sa mère : « Ô ma mère, viens vite ! »
Aussitôt je vis entrer la mère, suivie de quatre témoins officiels, tenant chacun un flambeau allumé, et ils s’avancèrent, après les salams d’usage, et s’assirent en rond.
Alors la jeune fille se hâta, selon la coutume, d’abaisser son voile sur son visage et de s’entourer de l’izar[5]. Et les témoins s’empressèrent d’écrire le contrat ; et elle voulut généreusement reconnaître avoir reçu de moi une dot de dix mille dinars pour tous comptes arriérés ou à venir ; et elle se constitua ma débitrice, sur sa conscience et devant Allah, de cette somme. Puis elle donna la gratification d’usage aux témoins, qui s’en allèrent, après les salams, par où ils étaient entrés. Et la mère aussi s’éclipsa.
Alors nous restâmes seuls tous deux, dans la grande salle aux quatre arcades vitrées.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
Nous restâmes seuls tous deux, dans la grande salle aux quatre arcades vitrées.
Alors la jeune fille se leva et se dévêtit et vint à moi avec, sur la peau, la chemise fine seulement. Et quelle chemise ! ô broderies ! Il y avait aussi le caleçon limpide ; mais elle se hâta de le faire glisser et, me prenant la main, elle me mena au fond de l’alcôve, où elle se jeta avec moi sur le grand lit d’or et, haletante, elle me dit : « Cela nous est maintenant permis. Il n’y a point de honte dans ce qui est licite ! » Et elle s’étendit, élastique, et m’attira tout contre elle ; puis elle gémit longuement et fit suivre cela d’un frémissement et cela de quelques coquettes minauderies ; et finit par relever sa chemise jusqu’au dessus de ses reins.
Alors moi je ne sus plus guère refréner mes longs désirs et, après lui avoir sucé les lèvres, alors qu’elle se pâmait et s’étirait et battait des paupières, je la pénétrai d’outre en outre. Et je vérifiai ainsi l’exactitude charmante de ce dire du poète :
Lorsque la jeune enfant eut relevé sa robe, ma vue put s’étendre avec aisance sur la terrasse de son ventre, ô jardins !
Et j’en découvris l’entrée qui était aussi étroite et difficile que ma patience et ma vie.
Mais je pus tout de même avec force y pénétrer, bien que de moitié seulement. Alors elle eut un grand soupir ; et je lui dis :
« Pourquoi soupires-tu ? » Elle répondit : « Pour la seconde moitié, ô lumière de mon œil ! »
En effet, une fois cela fait premièrement, elle me dit : « Agis comme tu l’entends, je suis ton esclave soumise. Va ! viens ! prends-le ! donne-le ! tout entier ! ou autrement ! Par ma vie chez toi ! donne-le plutôt pour que de ma main je m’en pénètre, et que je m’en pacifie les entrailles ! » Et elle ne cessa de me faire entendre des soupirs et des gémissements, au milieu de baisers, ébats, mouvements et multiples copulations, que nos cris n’eussent rempli la maison et mis toute la rue en émoi. Après quoi, nous nous endormîmes jusqu’au matin.
Alors, comme je me disposais à m’en aller, elle vint à moi avec un rire malin et me dit : « Où vas-tu ? Crois-tu donc, comme ça, que la porte de sortie est aussi large ouverte que la porte d’entrée ! Aziz, détrompe-toi, naïf Aziz ! Et surtout ne me prends pas pour la fille de Dalila-la-Rouée ! Ah oui ! Hâte-toi de délaisser cette injurieuse pensée, Aziz ! Oublies-tu donc que tu m’es légitimement uni par un mariage avec contrat, confirmé par la Sunna ? Si tu es ivre, Aziz, dégrise-toi ! Et rentre dans ta raison. Regarde ! La porte de cette demeure, où nous sommes, ne s’ouvre qu’une fois l’an pour un jour seulement. Lève-toi, d’ailleurs, et va contrôler mes paroles ! »
Alors moi je me levai, effaré, et me dirigeai vers la grande porte ; et, l’ayant examinée, je constatai qu’elle était verrouillée, barrée, clouée et condamnée définitivement. Et je m’en retournai vers l’adolescente et lui dis qu’en effet la chose était exacte. Elle sourit, heureuse, et me dit : « Aziz, sache qu’ici en abondance nous avons de la farine, des grains, des fruits frais et secs, des grenades à l’écorce desséchée, du beurre, du sucre, des confitures, des moutons, des poulets et autres choses semblables, de quoi nous suffire pendant un nombre appréciable d’années. De plus, je suis maintenant aussi sûre de ton séjour ici, avec moi, l’espace d’une année, que de l’existence de tout cela ! Résigne-toi donc et laisse cet air et ce visage de travers ! » Alors moi je soupirai : « Il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah ! » Elle dit : « Mais de quoi te plains-tu donc, imbécile ? Et qu’as-tu à soupirer, du moment que tu m’as donné les preuves de ton savoir dans ce métier du coq dont nous nous entretenions hier encore ! » Et elle se mit à rire. Et moi aussi je me mis à rire. Et je ne pus alors que lui obéir et me conformer à ses désirs.
Je restai donc dans cette demeure à exercer mon métier de coq, à manger, à boire et à faire l’amour dur, sec et longtemps, durant la longueur d’une année entière de douze mois. Aussi, au bout de l’année, elle était bien fécondée et accouchait d’un enfant. Et c’est alors seulement que, pour la première fois, j’entendis le bruit de la porte qui criait sur ses gonds. Et dans mon âme je poussai un profond « Ya Allah ! » de délivrance.
Une fois la porte ouverte, je vis entrer une quantité de serviteurs et de porteurs qui venaient chargés de nourritures fraîches pour l’année suivante : des charges entières de pâtisseries, de farine, de sucre, et autres provisions de ce genre. Alors moi je bondis et voulus m’en aller au plus vite vers la rue et la liberté. Mais elle me retint par le pan de ma robe et me dit : « Aziz, ingrat Aziz, attends au moins, jusqu’au soir, l’heure exacte où tu es entré chez moi il y a un an ! » Et moi je voulus bien patienter encore. Mais à peine le soir venu, je me levai et me dirigeai vers la porte. Alors elle m’accompagna jusqu’au seuil et ne me laissa partir que lorsqu’elle m’eut fait faire le serment de retourner chez elle avant que la porte ne fût refermée au matin. Et je ne pouvais d’ailleurs que m’exécuter, car je lui prêtai serment sur le Glaive du Prophète (sur lui la paix et la prière !), sur le Livre et sur le Divorce !
Je sortis donc enfin et me dirigeai en hâte vers la maison de mes parents, mais en passant par le jardin de mon amie, celle que ma nouvelle épouse appelait la fille de Dalila-la-Rouée. Et, à ma surprise extrême, je vis que le jardin était ouvert comme d’habitude avec, au fond des bosquets, allumée, la lanterne.
Alors je fus péniblement affecté et même bien furieux ; et je dis en mon âme…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
Alors je fus péniblement affecté et même bien furieux ; et je dis en mon âme : « Voilà déjà un an que je suis absent de ce lieu ; et j’arrive à l’improviste et je trouve toute chose comme par le passé ! Eh bien ! Aziz, il te faut avant d’aller revoir ta mère, qui doit te pleurer comme mort, savoir ce qu’est devenue ton ancienne amoureuse. Qui sait ce qui a pu se passer depuis le temps ! » Je me mis aussitôt à marcher très vite et, arrivé à la salle à la voûte cintrée, à la coupole d’ébène et d’ivoire, j’y pénétrai vivement. Et je trouvai mon amie elle-même assise dans une pose courbée, la tête penchée vers les genoux, et une main sur l’une de ses joues ; et son teint, qu’il était changé ! Ses yeux étaient humides de larmes et son visage, si triste ! Et soudain elle me vit devant elle. Et elle sursauta, puis essaya de se lever, mais elle retomba d’émotion. Enfin elle put parler, et me dit d’un ton pénétré : « Louange à Allah pour ton arrivée, ô Aziz ! »
Or, moi, vraiment, devant cette joie inconsciente de mes infidélités, je fus extrêmement confus et je baissai la tête ; mais je ne tardai pas à m’avancer vers mon amie et, l’ayant embrassée, je lui dis : « Comment as-tu pu deviner ma venue ce soir ? » Elle répondit : « Par Allah ! je ne savais rien de ta venue. Mais, depuis un an, toutes les nuits je t’attends ici même, et je pleure solitaire et me consume. Vois comme je suis changée par les veilles et les insomnies. Et je suis ainsi à t’attendre depuis le jour où je t’ai donné la robe en soie toute neuve et où je t’ai fait promettre de revenir. Ah ! dis-moi, Aziz, la cause qui t’a retenu si longtemps loin de moi ! »
Alors moi, ô prince Diadème, naïvement je lui racontai en détail toute mon aventure, et mon mariage avec l’adolescente aux belles cuisses. Puis je lui dis : « D’ailleurs, je dois te prévenir que je n’ai que cette seule nuit à passer avec toi, car avant le matin je dois être de retour chez mon épouse, qui m’a fait prêter serment sur les trois choses saintes ! »
Lorsque la jeune femme eut appris que j’étais marié, elle pâlit, puis resta immobile d’indignation ; et elle put enfin s’écrier : « Misérable ! j’ai été la première ô te connaître et tu ne m’accordes même pas une nuit entière ; ni à ta mère non plus ! T’imagines-tu donc que je sois aussi douée de patience que l’admirable Aziza — qu’Allah ait en sa miséricorde ! Et penses-tu que moi aussi je vais me laisser mourir de chagrin pour tes infidélités ! Ah ! perfide Aziz ! maintenant nul ne te sauvera de mes mains. Et je n’ai plus aucune raison de t’épargner, puisque tu n’es plus bon à rien, toi qui as maintenant une épouse et un enfant. Car moi, les hommes mariés, je les ai en horreur ; et je ne me délecte qu’avec les célibabataires ! Par Allah ! désormais tu ne peux plus me servir ; tu n’es plus mien ; et je ne veux pas non plus que tu appartiennes à qui que ce soit ! Attends un peu ! »
À ces paroles dites d’un accent terrible, tandis que les yeux de la jeune femme me perforaient déjà, je fus pris d’une certaine appréhension de ce qui allait m’arriver. Car soudain, et avant que j’eusse le temps de la réflexion, dix jeunes esclaves femmes, plus solides que des nègres, se précipitèrent sur moi et me jetèrent à terre et m’immobilisèrent. Alors elle se leva et prit un coutelas effroyable et me dit : « Nous allons t’égorger comme on égorge les boucs trop salaces ! Et je vais ainsi me venger et venger, par la même occasion, la pauvre Aziza dont tu as fait éclater le foie de chagrin rentré ! Aziz, tu vas mourir, fais ton acte de croyant ! » Et, en me disant ces paroles, elle appuyait son genou sur mon front cependant que ses esclaves ne me permettaient même pas de respirer. Aussi je n’eus plus aucun doute sur ma mort, surtout…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
Aussi je n’eus plus aucun doute sur ma mort, surtout lorsque je vis les manœuvres exécutées par les esclaves sur mon individu. En effet, deux d’entre elles s’assirent sur mon ventre, deux me tinrent les pieds et deux autres s’assirent sur mes genoux. Alors elle-même se leva et, aidée de deux autres esclaves, se mit à me donner sur la plante des pieds tant de coups de bâton que je m’évanouis de douleur. Elles durent alors prendre du répit, car je revins à moi et je criai : « Je préfère mille fois la mort à ces tortures ! »
Alors elle, comme pour me faire plaisir, reprit l’effroyable coutelas et l’aiguisa sur sa pantoufle et dit aux esclaves : « Tendez-lui la peau du cou ! »
À ce moment précis, Allah me fit me remémorer soudain les paroles dernières d’Aziza et je m’écriai :
« Que la mort est douce et préférable à la trahison ! »
À ces paroles, elle jeta un grand cri d’effarement, puis elle clama : « Qu’Allah ait pitié de ton âme, ô Aziza ! Tu viens de sauver d’une mort sans recours le fils de ton oncle ! »
Après quoi elle me regarda et me dit : « Mais pour toi, qui dois ainsi le salut à ces paroles d’Aziza, ne te crois pas tout à fait quitte pour cela ; car il me faut absolument me venger de toi et de la coquine dévergondée qui t’a retenu loin de moi ; et dans ce double but je vais me servir du vrai moyen, du seul moyen ! Hé ! vous autres ! » Et, ayant ainsi hélé ses esclaves, elle leur dit : « Pesez bien sur lui, et empêchez-le de bouger, et liez-lui solidement les pieds ! » Et cela fut immédiatement exécuté. Alors elle se leva et alla mettre sur le feu une poêle en cuivre rouge dans laquelle elle mit de l’huile et du fromage mou ; et elle attendit que le fromage eût fondu dans l’huile bouillante pour revenir vers moi toujours étendu par terre et maintenu par les femmes esclaves. Elle s’approcha et se baissa et me défit mon caleçon ; alors de cet attouchement un grand frisson me traversa par nappes de terreur et de honte : je devinai ce qui allait se passer. M’ayant donc mis le ventre à nu, elle saisit mes œufs et, avec une corde cirée, les attacha à la racine même ; puis elle donna les deux bouts de la corde à deux de ses esclaves et leur commanda de tirer avec énergie, alors qu’elle-même, un rasoir entre les doigts, d’un seul coup de tranchant, fauchait mon mâle, auquel elle en voulait spécialement.
Tu juges, prince Diadème, si la douleur et le désespoir me firent m’évanouir. Tout ce que je sais, après cela, c’est que, lorsque je revins de mon évanouissement, je me vis le ventre aussi net que celui d’une femme ; et les esclaves étaient en train d’appliquer sur ma blessure l’huile bouillie au fromage mou qui ne tarda pas à arrêter l’écoulement de mon sang. Puis, cela fait, l’adolescente vint à moi, me donna un verre de sirop pour étancher ma soif et me dit d’un ton méprisant : « Retourne maintenant là d’où tu étais venu ! Tu ne m’es plus rien, et tu ne peux plus me servir à quoi que ce soit, puisque, la seule chose dont j’avais besoin, je l’ai prise ! Et mon désir est assouvi ! » Et elle me repoussa du pied et me chassa de sa maison, en me disant : « Estime-toi heureux de pouvoir sentir encore ta tête sur tes épaules ! »
Alors moi, douloureusement, je me traînai jusqu’à la maison de ma jeune épouse, en marchant pas à pas ; et, arrivé à la porte, que je trouvai ouverte, je m’introduisis en silence et allai tomber massivement sur les coussins de la grande salle. Aussitôt accourut mon épouse qui, me trouvant tout pâle, m’examina attentivement et me força à lui raconter l’aventure et à lui montrer mon individu mutilé. Mais je ne pus supporter la vue de moi-même et tombai, encore une fois, évanoui.
Lorsque je revins de mon évanouissement, je me vis étendu dans la rue, au bas de la grande porte ; car mon épouse, elle aussi, m’ayant trouvé tel qu’une femme, m’avait jeté hors de sa demeure.
Alors, dans un état misérable, je me ramassai et m’acheminai vers ma maison, où j’allai me jeter dans les bras de ma mère qui depuis longtemps me pleurait et ne savait sur quelle terre j’étais égaré. Elle me reçut en sanglotant, et me vit dans un état de
pâleur et de faiblesse extrêmes…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Elle me reçut en sanglotant et me vit dans un état de faiblesse et de pâleur extrêmes, et elle en pleura davantage. Et moi, de mon côté, le souvenir me vint de ma pauvre, de ma douce Aziza, morte de chagrin, sans un mot de reproche ; et, pour la première fois, je la regrettai et versai sur elle des larmes de désespoir et de repentir. Puis, comme je venais de me calmer un instant, ma mère me dit, des pleurs plein les yeux : « Mon pauvre enfant, les malheurs habitent notre maison ; je dois t’apprendre la pire des choses : ton père est mort ! » À cette nouvelle, les sanglots me saisirent à la gorge et je restai immobile, puis je tombai la face contre terre et restai toute la nuit dans cet état.
Le matin, ma mère me força à me relever et s’assit à côté de moi ; mais je restai cloué sur place, à regarder le coin où avait l’habitude de s’asseoir ma pauvre Aziza, et les larmes coulaient silencieuses sur mes joues ; et ma mère me dit : « Ah ! mon fils, voilà dix jours déjà que je suis seule dans la maison vide de son maître, dix jours que ton père est mort dans la miséricorde d’Allah ! » Je dis : « Ô mère, laisse cela ! Pour le moment je suis tout entier plein de la pensée de la pauvre Aziza ; et je ne saurais consacrer ma douleur à d’autres souvenirs que les siens. Ah ! pauvre Aziza si délaissée par moi, toi qui m’aimais vraiment, pardonne au misérable qui t’a torturée, maintenant qu’il est puni, et au-delà, de ses fautes et de ses trahisons ! »
Or, ma mère remarquait l’étendue et la vérité de ma douleur ; mais elle se taisait ; pour le moment, elle se hâta de panser mes blessures et de m’apporter de quoi restaurer mes forces. Puis, ces soins une fois donnés, elle continua à me prodiguer les marques de sa tendresse, et à veiller à mes côtés, en me disant : « Qu’Allah soit béni, mon enfant, de ce que de pires calamités ne te soient pas arrivées, et que tu aies la vie sauve ! » et cela jusqu’à ce que je fusse complètement rétabli, tout en restant malade de mon âme et de mes souvenirs.
Alors ma mère, un jour, après notre repas, vint s’asseoir à côté de moi et me dit d’un ton pénétré : « Mon fils, je juge que pour moi le temps est venu de te remettre le souvenir d’adieu que m’avait confié à ton intention la pauvre Aziza : avant de mourir, elle m’a fait la recommandation de ne te le donner que lorsque j’aurais constaté chez toi de véritables marques de son deuil et vérifié que tu as définitivement délaissé les liens illégitimes où tu étais pris ! » Puis elle ouvrit un coffre et en tira un paquet, qu’elle défit pour y prendre l’étoffe précieuse sur laquelle est brodée la seconde gazelle que tu as devant tes yeux, prince Diadème ! Et tu vois ces vers qui s’y entrelacent en bordure :
De ton désir tu as rempli mon cœur pour t’asseoir dessus et le broyer ; mes yeux, tu les as habitués aux veilles pour toi-même t’endormir !
Sous mes yeux et au bruit des battements de mon cœur, tu eus des rêves étrangers à mon amour, alors que mon cœur et mes yeux fondaient de ton désir !
Mes sœurs, par Allah ! après ma mort, inscrivez sur le marbre de mon tombeau :
« Ô toi qui passes sur le chemin d’Allah, voici la terre où repose enfin une esclave d’amour ! »
Alors moi, seigneur, à la lecture de ces strophes je pleurai d’abondantes larmes et me frappai les joues de douleur et, en déroulant l’étoffe, je laissai tomber une feuille de papier sur laquelle ces lignes étaient tracées de la main même d’Aziza…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
En déroulant l’étoffe, je laissai tomber une feuille de papier sur laquelle ces lignes étaient tracées de la main même d’Aziza :
« Ô mon cousin bien-aimé, sache bien que tu me fus plus cher et plus précieux que mon propre sang et ma vie. Aussi après ma mort je continuerai à supplier Allah de te faire prospérer et réussir auprès de toutes celles que tu auras élues. Je sais que des malheurs t’atteindront du fait de la fille de Dalila-la-Rouée ! Qu’ils te servent de leçon : et puisses-tu extirper de ton cœur l’amour néfaste des femmes perfides et apprendre à ne plus t’attacher ! Et béni soit Allah qui m’a enlevée la première pour ne pas m’obliger à être le témoin douloureux de tes souffrances.
« Garde, je te prie, par Allah ! ce souvenir d’adieu, cette étoffe où se trouve brodée la gazelle. Elle me tenait compagnie, durant tes absences. Elle me fut envoyée par une fille de roi, la Sett-Donia, princesse des Îles du Camphre et du Cristal.
« Lorsque tu seras accablé par les malheurs, tu iras à la recherche de la princesse Donia, dans le royaume de son père qui est situé aux Îles du Camphre et du Cristal. Mais, ô Aziz, sache que la beauté et les charmes inégalables de cette princesse ne te sont pas destinés. Ne va donc pas t’enflammer d’amour pour elle ; car elle sera simplement pour toi la cause qui te tirera de tes afflictions et mettra fin aux tribulations de ton âme.
« Ouassalam, ô Aziz ! »
À la lecture de cette lettre d’Aziza, ô prince Diadème, je fus encore plus ému de tendresse, et je pleurai toutes les larmes de mes yeux, et ma mère pleura avec moi, et cela jusqu’à la tombée de la nuit. Et je restai dans cet état de tristesse morne, sans pouvoir m’en guérir, la longueur d’une année. Alors seulement je songeai au départ, pour aller à la recherche de la princesse Donia, dans les Îles du Camphre et du Cristal. Et ma mère m’encouragea beaucoup à voyager, me disant : « Le voyage, mon enfant, te distraira et fera s’évanouir tes chagrins. Et justement il y a dans notre ville une caravane de marchands qui s’apprête au départ ; joins-toi à elle, achète ici des marchandises et pars. Puis, au bout de trois ans, tu reviendras avec la même caravane. Et tu auras oublié tout ce deuil qui pèse sur ton âme ! Et je serai alors heureuse de te voir la poitrine dilatée de nouveau ! »
Je fis donc ce que me disait ma mère et, ayant acheté des marchandises de prix, je me joignis à la caravane, et je me mis à voyager partout avec elle, mais sans avoir le courage d’étaler ma marchandise comme mes compagnons. Au contraire ! chaque jour je m’asseyais à l’écart et je prenais l’étoffe, souvenir d’Aziza, et l’étendais devant moi, et la regardais longtemps en pleurant. Et cet état continua de la sorte jusqu’à ce que, au bout d’une année de voyages, nous eussions atteint les frontières du royaume où régnait le père de la princesse Donia. C’étaient les Sept Îles du Camphre et du Cristal.
Or, le roi de ces terres, ô prince Diadème, s’appelle le roi Schahramân. Et c’était bien lui, en effet, le père de la Sett-Donia qui savait broder avec tant d’art les gazelles en question sur les étoffes de soie qu’elle envoyait à ses amies.
Mais moi, en arrivant dans ce royaume, je pensai : « Ô Aziz, pauvre infirme, à quoi désormais peuvent te servir les princesses et toutes les adolescentes de la terre, ô Aziz devenu aussi lisse que le ventre d’une femme ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et s’arrêta dans les paroles permises.
LA CENT VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … À quoi désormais peuvent te servir les princesses et toutes les adolescentes de la terre, ô Aziz devenu aussi lisse que le ventre d’une femme ! »
Pourtant je me décidai, me souvenant des paroles d’Aziza, à commencer les recherches nécessaires et à prendre les renseignements qui pouvaient m’être utiles pour arriver à voir la fille du roi. Mais toutes mes peines furent vaines ; et nul ne sut m’indiquer le moyen que je cherchais. Et je commençais à me désespérer tout à fait quand un jour, comme je me promenais dans les jardins qui entourent la ville, et que je sortais de l’un pour entrer dans l’autre, et que je tâchais, par le spectacle de la verdure d’oublier mes soucis, j’arrivai à la porte d’un jardin aux arbres magnifiques dont la seule vue reposait l’âme endolorie. Et sur l’estrade d’entrée était assis le vieux gardien du jardin, un vénérable cheikh à bonne mine, de ceux sur le visage desquels est empreinte la bénédiction. Alors je m’avançai vers lui et, après les salams d’usage, je lui dis : « Ô cheikh, à qui ce jardin ? « Il dit : « À la fille du roi, Sett-Donia ! Tu peux même, ô bel adolescent, entrer te promener un moment et respirer l’odeur des fleurs et des plantes ! » Je lui dis : « Comme je te remercie ! Mais ne pourrais-tu pas me permettre, ô cheikh, d’attendre, caché derrière un massif de fleurs, l’arrivée de la fille du roi, simplement pour que je me réjouisse la vue d’un seul regard que je lui jetterai de mes paupières ? » Il dit : « Par Allah ! cela non ! » Alors je soupirai bien fort ; et il me regarda avec tendresse ; puis il me prit la main et entra avec moi dans le jardin.
Nous nous mîmes ainsi à marcher de compagnie ; et il me conduisit dans un endroit charmant, ombragé par les feuilles humides ; et il cueillit des fruits, les plus mûrs et les plus délicieux, et me les donna en me disant : « Rafraîchis-toi ! Il n’y a que la princesse Donia qui en connaisse le goût ! » Puis il me dit : « Assieds-toi ! Je vais revenir ! » Et il me quitta un moment pour revenir chargé d’un agneau grillé, et m’invita à le manger avec lui ; et il me dépeça les morceaux les plus délicats, et me les donna avec un plaisir extrême. Et moi j’étais bien confus de toutes ses bontés, et je ne savais comment le remercier.
Or, pendant que nous étions assis à manger et à causer amicalement, nous entendîmes la porte du jardin s’ouvrir en chantant. Alors le cheikh gardien me dit vivement : « Vite ! Lève-toi et cache-toi au milieu de ce massif. Et surtout ne bouge pas ! » Et je me hâtai de lui obéir.
À peine étais-je dans ma cachette que je vis, dans l’entre-bâillement de la porte du jardin, apparaître la tête d’un eunuque noir qui demanda à haute voix : « Ô cheikh gardien, y a-t-il quelqu’un par ici ? La princesse Donia arrive ! » Il répondit : « Ô chef du palais, je n’ai personne dans le jardin ! » Et il se hâta de courir et d’ouvrir toute grande la porte.
Alors, seigneur, je vis entrer par la porte Sett-Donia, et je crus que la lune elle-même descendait sur la terre. Et sa beauté était telle que je restai cloué sur place, hébété, sans mouvement, mort. Et je la suivais du regard, sans pouvoir émettre un souffle, malgré l’ardeur où j’étais de lui parler ; et je demeurai immobile à ma place, durant toute la promenade que fit la princesse, absolument comme l’altéré du désert qui tombe à bout de forces sur les bords du lac sans pouvoir se traîner jusqu’à l’eau limpide.
Je compris alors, seigneur, que ni la princesse Donia ni aucune autre femme ne pouvaient désormais courir de risques devant la femme que j’étais moi-même devenu.
J’attendis donc que la Sett-Donia fût sortie, pour prendre congé du cheikh gardien ; et je me hâtai d’aller rejoindre les marchands de la caravane, en me disant : « Ô Aziz, qu’es-tu devenu, Aziz ? Un ventre lisse qui ne peut plus dompter les amoureuses ! Va ! retourne près de ta pauvre mère mourir en paix dans la maison vide de son maître ! Car pour toi désormais la vie n’a plus de sens ! » Et, malgré toutes les peines du voyage que j’avais fait pour arriver dans ce royaume, mon désespoir fut tel, que je ne voulus plus mettre à exécution les paroles d’Aziza, qui m’avait formellement assuré que la princesse Donia devait être pour moi une cause de bonheur.
Je partis donc avec la caravane pour retourner dans mon pays. Et c’est ainsi que j’arrivai sur ces terres qui sont sous le pouvoir du roi Soleïmân-Schah, ton père, ô prince Diadème !
Et telle est mon histoire ! »
— Lorsque le prince Diadème eut entendu cette histoire admirable et…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT TRENTIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le grand vizir Dandân, qui racontait toute cette histoire au roi Daoul’makân pendant le siège de Constantinia, ayant fini l’aventure du jeune Aziz, continua ainsi la suite de cette histoire, où Aziz ne cesse d’être intimement mêlé à toutes les choses merveilleuses que nous allons voir :
HISTOIRE DE LA PRINCESSE DONIA AVEC LE PRINCE DIADÈME
Lorsque le prince Diadème eut entendu cette histoire admirable et qu’il eut appris combien la princesse Donia, si mystérieuse, était désirable et combien elle avait en elle de qualités de beauté et était experte dans l’art du dessin sur soie et des broderies, il fut pris, à l’heure même, d’une passion qui fit travailler son cœur énormément. Et il résolut de tout faire pour parvenir jusqu’à elle.
Il emmena donc avec lui le jeune Aziz, dont il ne voulait plus se séparer, remonta sur son cheval et reprit le chemin de la ville de son père, le roi Soleïmân-Schah, maître de la Ville-Verte et des montagnes d’Ispahân.
La première chose qu’il fit fut de mettre à la disposition de son ami Aziz une très belle maison où rien ne manquait. Et lorsqu’il se fut assuré de la sorte qu’Aziz avait tout ce qui pouvait lui convenir, il retourna au palais du roi son père, et courut s’enfermer dans son appartement en refusant de voir qui que ce fût et en pleurant passionnément. Car les choses que l’on entend font autant d’impression que celles que l’on voit ou que l’on sent.
Lorsque le roi Soleïmân-Schah, son père, le vit dans cet état de changement de teint, il comprit que Diadème avait du chagrin dans l’âme et des soucis. Il lui demanda donc : « Qu’as-tu, ô mon enfant, pour changer ainsi de teint et être si affligé ? »
Alors le prince Diadème lui raconta qu’il était amoureux de Sett-Donia, passionnément amoureux d’elle sans l’avoir jamais vue, rien qu’en entendant Aziz lui dépeindre sa démarche gracieuse, ses yeux, ses perfections et son art merveilleux dans le dessin des fleurs et des animaux.
À cette nouvelle, le roi Soleïmân-Schah fut à la limite de la perplexité et dit à son fils : « Mon enfant, ces Îles du Camphre et du Cristal sont un pays bien éloigné du nôtre ; et quoique Sett-Donia soit une princesse merveilleuse, ici, dans notre ville et dans le palais de ta mère nous ne manquons pas de filles magnifiques et de belles esclaves de toute la terre. Entre donc dans l’appartement des femmes, ô mon enfant, et choisis toutes celles qui t’agréeront parmi les cinq cents esclaves belles comme des lunes. Et si, malgré tout ce choix, aucune de ces femmes n’arrivait à te plaire, je prendrais pour toi, comme épouse, une fille d’entre les filles des rois des pays voisins ; et je te promets qu’elle sera bien plus belle et plus ingénieuse que Sett-Donia elle-même ! » Il répondit : « Mon père, je ne souhaite avoir comme épouse que la princesse Donia, celle-là même qui sait si bien peindre des gazelles sur les brocarts. Il me la faut absolument ; sinon je fuirai mon pays, mes amis et ma maison et je me tuerai à cause d’elle ! »
Alors son père vit qu’il était nuisible de le contrarier et lui dit : « Alors, mon fils, prends un peu patience, que j’aie le temps d’envoyer une députation au roi des Îles du Camphre et du Cristal pour lui demander régulièrement, et selon le cérémonial que j’employai anciennement pour moi-même quand je me mariai avec ta mère, de te donner sa fille en mariage. Et s’il refuse, j’ébranlerai sous lui la terre et ferai tomber en ruines sur sa tête son royaume tout entier, après avoir dévasté ses contrées avec une armée si nombreuse, qu’en se déployant elle atteindrait les Îles du Camphre par son avant-garde, tandis que l’arrière-garde serait encore derrière les montagnes d’Ispahân, frontières de mon empire ! »
Cela dit, le roi fit mander l’ami de Diadème, le jeune marchand Aziz, et lui dit : « Connais-tu la route qui mène aux Îles du Camphre et du Cristal ? » Il répondit : « Je la connais. » Le roi dit : « Je souhaiterais fort te voir accompagner là-bas mon grand-vizir que je vais envoyer auprès du roi de cette contrée. » Aziz répondit : « J’écoute et j’obéis, ô roi du temps ! »
Alors le roi Soleïmân-Schah fit appeler son grand-vizir et lui dit : « Arrange-moi cette affaire de mon fils comme tu le jugeras utile ; mais il te faut pour cela aller aux Îles du Camphre et du Cristal demander la fille du roi comme épouse pour Diadème. » Et le vizir répondit par l’ouïe et l’obéissance, tandis que le prince Diadème, impatient, se retirait dans son appartement, récitant ces vers du poète sur les peines d’amour :
« Interrogez la nuit ! Elle vous dira ma douleur et l’élégie pleine de larmes que ma tristesse module sur mon cœur.
Interrogez la nuit ! Elle vous dira que je suis le berger dont les yeux comptent les étoiles des nuits, alors que sur ses joues tombe la grêle des larmes.
Sur la terre je me sens seul, bien que mon cœur soit débordant de désirs, comme la femme aux flancs féconds qui ne trouve point la semence de gloire. »
Et il resta songeur toute la nuit, refusant la nourriture et le sommeil.
Mais, sitôt le jour levé, le roi son père se hâta de venir le trouver, et vit que son teint était encore plus pâle que la veille et son changement plus accentué ; alors pour le consoler et lui faire prendre patience, il fit hâter les préparatifs du départ d’Aziz et du vizir, et n’oublia pas de les charger de riches cadeaux pour le roi des Îles du Camphre et du Cristal et tous ceux de son entourage. Et aussitôt ils se mirent en route.
Et ils voyagèrent et voyagèrent des jours et des nuits, jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés en vue des Îles du Camphre et du Cristal. Alors ils dressèrent leurs tentes sur les bords d’un fleuve ; et le vizir dépêcha un courrier annoncer au roi leur arrivée. Et la journée n’était pas encore à sa fin qu’ils virent venir à leur rencontre les chambellans et les émirs du roi, qui se mirent aussitôt à leur disposition après les salams et les souhaits de bienvenue, et les accompagnèrent jusqu’au palais du roi.
Alors Aziz et le vizir entrèrent au palais et se présentèrent entre les mains du roi auquel ils remirent les présents de leur maître Soleïmân-Schah ; et il les en remercia, leur disant : « Je les agrée de tout cœur amical, sur ma tête et dans mes yeux ! » Et aussitôt Aziz et le vizir, selon l’usage, se retirèrent et restèrent cinq jours dans le palais à se reposer des fatigues de leur voyage.
Mais au matin du cinquième jour, le vizir s’habilla de sa robe d’honneur et alla, seul cette fois, se présenter devant le trône du roi. Et il lui soumit la demande de son maître et se tut respectueusement, attendant la réponse.
En entendant les paroles du vizir, le roi devint soudain fort soucieux et baissa la tête, et, tout perplexe et songeur, il resta longtemps ne sachant comment faire une réponse à l’envoyé du puissant roi de la Ville-Verte et des montagnes d’Ispahân.
Car il savait, par expérience, combien sa fille avait le mariage en horreur, et que la demande du roi allait être repoussée avec indignation comme toutes celles qui lui avaient été déjà faites par les principaux princes des royaumes avoisinants et de toutes les parties des terres autour et alentour.
Enfin le roi finit par relever la tête et fit signe au chef des eunuques de s’approcher et lui dit : « Va trouver immédiatement ta maîtresse Sett-Donia, présente-lui les hommages du vizir et les cadeaux qu’il nous apporte, et répète-lui exactement ce que tu viens d’entendre de sa bouche. » Et l’eunuque baisa la terre entre les mains du roi, et disparut.
Au bout d’une heure, il revint et il avait le nez allongé jusqu’à ses pieds ; et il dit au roi : « Ô roi des siècles et du temps, je me suis présenté devant ma maîtresse Sett-Donia ; mais à peine lui avais-je formulé la demande du seigneur vizir, que ses yeux furent pleins de colère, et elle se leva sur son séant et saisit une masse et courut à moi pour me casser la tête. Alors moi je me hâtai de fuir au plus vite ; mais elle me poursuivit à travers les portes en me criant : « Si mon père veut, malgré tout, me forcer quand même à me marier, qu’il sache bien que mon époux n’aura pas le temps de voir mon visage à découvert : je le tuerai de ma propre main et je me tuerai moi-même après ! »
À ces paroles du chef eunuque…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, comme elle était discrète, elle ne voulut pas prolonger davantage le récit, cette nuit-là.
LA CENT TRENTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, qu’à ces paroles du chef eunuque, le roi, père de Sett-Donia, dit au vizir et à Aziz : « Vous venez d’entendre de vos propres oreilles. Vous transmettrez donc mes salams au roi Soleïmân-Schah et vous lui rapporterez la chose en lui disant l’horreur que ma fille éprouve pour le mariage. Et qu’Allah vous fasse parvenir dans votre pays en toute sécurité ! »
Alors le vizir et Aziz, ayant vu le résultat négatif de leur mission, se hâtèrent de retourner dans la Ville-Verte et de rapporter au roi Soleïmân-Schah ce qu’ils avaient entendu.
À cette nouvelle, le roi entra dans une grande colère et voulut donner immédiatement l’ordre à ses émirs et à ses lieutenants de rassembler les troupes et d’aller envahir les contrées des Îles du Camphre et du Cristal.
Mais le vizir demanda la permission de parler et dit : « Ô roi, il ne faut point faire cela, car vraiment la faute n’est guère au père, mais à la fille ; et l’empêchement ne vient que d’elle seule. Et son père lui-même est aussi contrarié que nous tous. Et d’ailleurs je t’ai rapporté les paroles terribles qu’elle a dites à l’effaré chef eunuque ! »
Lorsque le roi Soleïmân-Schah eut entendu son vizir, il lui donna raison et fut fort effrayé pour son fils de la vengeance de la princesse. Et il se dit en lui-même : « Même si j’envahissais leur pays et réduisais la jeune fille en esclavage, cela ne nous servirait de rien, puisqu’elle a juré de se tuer ! »
Il fit alors monter le prince Diadème et, affligé d’avance de la peine qu’il allait lui causer, il le mit au courant de la vérité. Mais le prince Diadème loin de se désespérer, dit d’un ton ferme à son père : « Ô mon père, ne crois point que je vais laisser les choses en leur état : je le jure devant Allah, Sett-Donia sera mon épouse, ou je ne suis plus ton fils Diadème ! Au risque de ma vie, je parviendrai jusqu’à elle ! » Le roi dit : « Et comment cela ? » Il répondit : « J’irai en qualité de marchand ! » Le roi dit : « Dans ce cas, prends avec toi le vizir et Aziz. » Et aussitôt il fit acheter pour cent mille dinars de riches marchandises, qu’il lui offrit, et fit même vider dans les ballots des trésors contenus dans ses propres armoires. Et il lui donna cent mille dinars en or et des chevaux et des chameaux et des mulets et des tentes fastueuses doublées de soie aux couleurs agréables.
Alors Diadème baisa les mains de son père et mit ses habits de voyage et alla trouver sa mère et lui baisa les mains ; et sa mère lui donna cent mille dinars et pleura beaucoup et appela sur lui la bénédiction d’Allah et fit des vœux pour la satisfaction de son âme et pour son retour en sécurité au milieu des siens. Et les cinq cents femmes du palais se mirent aussi notoirement à pleurer, en entourant la mère de Diadème, et en le regardant, silencieuses, avec respect et tendresse.
Mais Diadème sortit bientôt de l’appartement de sa mère et emmena son ami Aziz et le vieux vizir et donna l’ordre du départ. Et comme Aziz pleurait, il lui dit : « Pourquoi pleures-tu, mon frère Aziz ? » Il dit : « Mon frère, je sens bien que je ne puis plus me séparer de toi ; mais il y a si longtemps que j’ai quitté ma pauvre mère ! Et maintenant que ma caravane va arriver dans mon pays, que deviendra ma mère quand elle ne me verra pas avec les marchands ? » Diadème dit : « Sois tranquille, Aziz ! Tu retourneras dans ton pays sitôt qu’Allah le voudra après nous avoir facilité les moyens de parvenir à notre but. » Et ils se mirent en route.
Ils ne cessèrent donc de voyager en compagnie du sage vizir qui, pour les distraire et faire prendre patience à Diadème, leur racontait des histoires admirables. Et Aziz aussi récitait à Diadème des poèmes sublimes et improvisait des vers pleins de charme sur l’attente d’amour et sur les amants, — tels que ceux-ci entre mille :
« Je viens, amis, vous conter ma folie et comme l’amour a su me rendre enfant et jeune à la vie.
Toi que je pleure ! la nuit ravive en mon âme ton souvenir, et le matin jaillit sur mon front qui n’a point connu le sommeil. Oh ! quand donc, après l’absence, viendra le retour ! »
Or, au bout d’un mois de voyage, ils arrivèrent dans la capitale des Îles du Camphre et du Cristal, et, en entrant dans le grand souk des marchands, Diadème sentit déjà s’alléger le poids de ses soucis, et des battements joyeux animèrent son cœur. Ils descendirent, sur l’avis d’Aziz dans le grand khân, et louèrent pour eux seuls tous les magasins du bas et toutes les chambres du haut, en attendant que le vizir allât leur louer une maison dans la ville. Et ils rangèrent dans les magasins leurs ballots de marchandises et, après s’être reposés quatre jours dans le khân, ils allèrent visiter les marchands du grand souk des soieries.
En chemin, le vizir dit à Diadème et à Aziz : « Je pense à une chose qu’il nous faudra faire avant tout, sans laquelle nous ne pourrions jamais atteindre le but souhaité. » Ils répondirent : « Nous sommes prêts à t’écouter, car les vieillards sont féconds en inspirations, surtout quand ils ont, comme toi, l’expérience des affaires. » Il dit : « Mon idée est que, au lieu de laisser les marchandises enfermées dans le khân où les clients ne peuvent les voir, nous ouvrions pour toi, prince Diadème, en qualité de marchand, une grande boutique dans le souk même des soieries. Et tu resteras toi-même à l’entrée de la boutique pour vendre et montrer, alors qu’Aziz se tiendra au fond de la boutique pour te passer les étoffes et les dérouler. Et, de la sorte, comme tu es parfaitement beau, et qu’Aziz ne l’est pas moins, en peu de temps la boutique sera la plus achalandée de tout le souk. » Et Diadème répondit : « L’idée est admirable ! » Et vêtu, comme il était, de sa belle robe de riche marchand, il pénétra dans le grand souk des soieries suivi d’Aziz, du vizir et de tous ses serviteurs.
Lorsque les marchands du souk virent passer Diadème, ils furent complètement éblouis de sa beauté et cessèrent de s’occuper de leurs clients ; et ceux qui coupaient les étoffes tinrent leurs ciseaux en l’air ; et ceux qui achetaient négligeaient leurs achats. Et tous à la fois se demandaient : « Est-ce que, par hasard, le portier Radouân, qui a les clefs des jardins du ciel, aurait oublié de fermer les portes, que soit ainsi descendu sur terre ce céleste adolescent ? » Et d’autres s’exclamaient sur son passage : « Ya Allah ! que tes anges sont beaux ! »
Arrivés au milieu du souk, ils s’informèrent de l’endroit où se tenait le grand cheikh des marchands, et se dirigèrent vers la boutique qu’on se hâta de leur montrer. Lorsqu’ils y arrivèrent, tous ceux qui étaient assis se levèrent en leur honneur, en pensant : « Ce vieillard vénérable est le père de ces deux adolescents si beaux ! » Et le vizir, après les salams, demanda : « Ô marchands, quel est d’entre vous celui qui est le grand cheikh du souk ? » Ils répondirent : « Le voici ! » Et le vizir regarda le marchand qu’on lui désignait, et vit que c’était un grand vieillard à la barbe blanche, à la mine respectable et à la figure souriante, qui se hâta aussitôt de leur faire les honneurs de sa boutique, avec de cordiaux souhaits de bienvenue, et qui les invita à s’asseoir sur le tapis, à ses côtés, et leur dit : « Je suis prêt à vous rendre tout service souhaité ! »
Alors le vizir dit : « Ô cheikh plein d’urbanité, voilà déjà des années que moi, avec ces deux enfants, je voyage par les villes et les contrées pour leur faire voir les peuples divers, compléter leur instruction, leur apprendre à vendre et à acheter et à tirer leur profit des usages et des mœurs des habitants. Et c’est dans ce but que nous venons nous établir ici pour quelque temps ; afin que mes enfants se réjouissent la vue de toutes les belles choses de cette ville et apprennent de ceux qui l’habitent la douceur des manières et la politesse. Nous te prions donc de nous faire louer une boutique spacieuse, bien située, pour que nous y exposions les marchandises de notre pays lointain. »
À ces paroles, le cheikh du souk répondit : « Certes ! il m’est fort agréable de vous satisfaire. » Et il se tourna vers les adolescents pour les mieux regarder et de ce seul coup d’œil il fut dans un saisissement sans bornes, tant leur beauté l’avait ému. Car ce cheikh du souk adorait ouvertement et à la folie les beaux yeux des adolescents, et sa prédilection allait à l’amour des jeunes garçons plutôt qu’à celui des jeunes filles ; et il préférait de beaucoup le goût acide des petits.
Donc il pensa en lui-même : « Gloire et louange à Celui qui les a créés et les a modelés, et d’une matière sans vie a formé pareille beauté ! » Et il se leva et les servit mieux qu’un esclave ne l’eût fait pour ses maîtres, et se consacra entièrement à leurs ordres. Et il se hâta de les emmener tous trois et de leur faire visiter les boutiques disponibles, et il finit par leur en choisir une au milieu même du souk. Cette boutique était la plus belle de toutes, la plus claire, le plus vaste et la mieux exposée aux regards ; elle était coquettement bâtie, ornée de devantures en bois ouvragé et d’étagères superposées et alternées, en ivoire, en ébène et en cristal ; et la rue à l’entour était bien balayée et bien arrosée ; et, la nuit, le gardien du souk stationnait de préférence devant sa porte. Et le cheikh, aussitôt le prix débattu, remit les clefs de la boutique au vizir, en lui disant : « Qu’Allah la rende une boutique prospère et bénie, sous les auspices de ce jour de blancheur, entre les mains de tes enfants ! »
Alors le vizir fit porter et ranger dans la boutique les marchandises de valeur, les belles étoffes, les brocarts et tous les trésors inestimables qui sortaient des armoires du roi Soleïmân-Schah. Et, ce travail une fois terminé, il emmena les deux adolescents prendre un bain au hammam situé à quelques pas, près de la grande porte du souk, hammam fameux pour sa propreté et ses marbres luisants et où l’on accédait par cinq marches où étaient rangées les socques de bois, en bon ordre.
Les deux amis, ayant vite fini de prendre leur bain, ne voulurent pas attendre que le vizir eût fini de prendre le sien, tant ils avaient hâte d’aller occuper leur poste dans la boutique. Ils sortirent donc joyeux, et la première personne qu’ils virent fut le vieux cheikh du souk, qui attendait passionnément sur les marches leur sortie du hammam. Or, le bain avait donné beaucoup plus d’éclat à leur beauté et de fraîcheur à leur teint ; et…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT TRENTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
Or, le bain avait encore donné beaucoup plus d’éclat à leur beauté et de fraîcheur à leur teint ; et le vieillard les compara, en son âme, à deux jeunes faons sveltes et gentils. Et il vit combien leurs joues étaient devenues roses, et comme leurs yeux noirs s’étaient foncés et leur visage éclairé ; et ils étaient devenus aussi tendres que deux rameaux colorés de leurs fruits ou comme deux lunes lactées et douces ; et il pensa à ce vers du poète :
À toucher sa main seulement, tous mes sens s’érigent, et je frissonne ! Comment ferais-je si je voyais son corps où se marient la limpidité de l’eau et l’or de la lumière !
Il alla donc au devant d’eux et leur dit : « Enfants, puissiez-vous vous être délectés de ce bain ! Et qu’Allah ne vous en prive jamais et vous le renouvelle éternellement ! » Et Diadème répondit de sa manière la plus charmante et avec une intonation parfaitement gentille : « Nous eussions souhaité partager avec toi ce plaisir ! » Et tous deux l’entourèrent respectueusement et, par déférence pour son âge et pour son rang de cheikh du souk, ils marchèrent devant lui, lui ouvrant la route, et prirent le chemin de leur boutique.
Or, comme ils marchaient ainsi les premiers, le vieux cheikh remarquait combien gracieuse était leur démarche et comme leur croupe frémissait sous la robe et tressaillait de leurs pas. Alors il ne put plus comprimer ses élans, et ses yeux étincelèrent, et il souffla et renifla, et il récita ces strophes au sens compliqué :
« Il n’y a point à s’étonner si, examinant les formes qui charment notre cœur, nous les voyons frémir, bien que massives de poids.
Car toutes les sphères du ciel tressaillent en tournoyant et tous les globes frémissent au mouvement. »
Lorsque les deux adolescents eurent entendu ces vers, ils furent loin d’en deviner le sens et de soupçonner la lubricité du vieux cheikh. Au contraire ! Ils crurent y saisir une délicate louange à leur intention, et ils en furent très touchés et le remercièrent et voulurent à toute force l’entraîner avec eux au hammam, pour lui faire plaisir, puisque c’était là la plus grande marque d’amitié. Et le vieux du souk, après quelques difficultés pour la forme, accepta en étincelant de désir dans son âme et reprit avec eux le chemin du hammam.
Lorsqu’ils furent entrés, le vizir, qui se séchait dans une des salles privées, les vit ; et, en apercevant le cheikh, il sortit au devant d’eux et s’avança vers le bassin central, où ils s’étaient arrêtés, et invita chaleureusement le cheikh à entrer dans sa salle à lui ; mais le vieillard ne voulait point, disait-il, abuser de tant de bonté, d’autant que Diadème et Aziz le tenaient chacun par une main et l’entraînaient déjà vers la salle qu’ils s’étaient réservée. Alors le vizir n’insista pas et rentra se sécher.
Une fois seuls, Aziz et Diadème déshabillèrent le vénérable cheikh et se dévêtirent eux-mêmes complètement et commencèrent par le masser énergiquement, pendant qu’il coulait vers eux, d’en dessous, des regards furtifs ; puis Diadème jura que c’était à lui seul que revenait l’honneur de le savonner, et Aziz jura qu’il lui restait, à lui, le plaisir de lui verser l’eau avec le petit bassin de cuivre. Et, entre eux deux, le vieux cheikh se croyait transporté au paradis.
Et ils ne cessèrent de la sorte de le frictionner, savonner et de lui verser l’eau, qu’une fois le vizir arrivé au milieu d’eux, à la grande désolation du vieux cheikh. Alors ils l’épongèrent avec les grandes serviettes chaudes, puis avec les serviettes fraîches et parfumées, et l’habillèrent et l’assirent sur l’estrade où ils lui offrirent des sorbets au musc et à l’eau de roses.
Alors le cheikh fit semblant de prendre intérêt à la conversation du vizir, mais en réalité il n’avait d’attention et de regards que pour les deux adolescents qui allaient et venaient, gracieux, pour le servir. Et, comme le vizir lui faisait les souhaits d’usage après le bain, il répondit : « Quelle bénédiction est entrée avec vous autres dans notre ville ! Et quel bonheur que votre arrivée ! » Et il leur récita cette strophe :
« À leur venue, nos collines ont reverdi et notre sol a tressailli et refleuri. Et la terre et les habitants de la terre ensemble se sont écriés : « Aisance douce et amitié aux hôtes charmants ! »
Et tous les trois le remercièrent pour son exquise urbanité ; et il répliqua : « Qu’Allah vous assure à tous la vie la plus agréable et préserve, ô marchand illustre, tes beaux enfants du mauvais œil ! » Le vizir dit : « Et que le bain te soit, par la grâce d’Allah, un redoublement de force et de santé ! Car, ô vénérable cheikh, n’est-ce point que l’eau est le vrai bien de la vie en ce monde et le hammam un séjour de délices ? » Le cheikh du souk dit : « Certes, par Allah ! Aussi que de poèmes admirables le hammam n’a-t-il pas inspirés aux grands poètes ! N’en connaissez-vous point quelques-uns ? » Diadème, le premier, s’écria : « Si j’en connais ? Écoutez ceux-ci :
« Vie du hammam, ta douceur est merveilleuse ! Ô hammam, ta durée est si brève ! Et que ne puis-je, dans ton sein, écouler ma vie toute ! hammam admirable, hammam de mes sens !
Quand tu existes, le Paradis lui-même devient exécrable ; et si tu étais l’Enfer, je m’y précipiterais, avec quel bonheur ! »
Lorsque Diadème eut récité ce poème, Aziz s’écria : « Moi aussi je sais des vers sur le hammam ! » Le cheikh du souk dit : « Réjouis-en notre goût ! » Aziz récita rythmiquement :
« C’est une demeure qui a pris aux roches fleuries leurs broderies. Sa chaleur te le ferait prendre pour une bouche d’enfer, si bientôt tu n’en éprouvais les délices, et si tu ne voyais en son milieu tant de lunes et de soleils ! »
Lorsqu’il eut fini cette strophe, Aziz s’assit à côté de Diadème. Alors le cheikh du souk fut extrêmement émerveillé de leur gentillesse et de leur talent et s’écria : « Par Allah ! vous avez su unir en vous l’éloquence et la beauté ! Laissez-moi maintenant vous dire à mon tour quelques vers délicieux. Ou plutôt, je vais vous les chanter, car nos chants seuls peuvent rendre la beauté de ces rythmes ! » Et le cheikh du souk appuya sa main contre sa joue, ferma les yeux à demi, dodelina de la tête et chanta avec mélodie :
« Feu du hammam, ta chaleur est notre vie. Ô feu, tu rends la force à nos corps ; et nos âmes par toi s’allègent et se refont.
Ô hammam, mon ami ! Ah ! tiédeur d’air, fraîcheur de bassins, bruit d’eau, lumière de haut, marbres purs, salles d’ombre, odeurs d’encens et de corps parfumés, je vous adore !
Tu brûles sans cesse d’une flamme qui jamais ne s’éteint, et tu restes frais à la surface et plein de ténèbres douces ! Tu es sombre, hammam, malgré le feu, comme mon âme et mes désirs. Ô hammam ! »
Puis il regarda les adolescents, laissa un instant son âme vagabonder dans le jardin de leur beauté et, s’en étant inspiré, il récita ces deux strophes à leur intention :
« J’allai à leur demeure, et, dès la porte, je fus reçu d’un visage gentil et d’un œil plein de sourires.
Je goûtai toutes les délices de leur hospitalité et sentis la douceur de leur feu ! Comment ne serais-je pas l’esclave de leurs charmes ! »
À l’audition de ces vers et de ce chant, ils furent extrêmement charmés et émerveillés de l’art du cheikh. Aussi le remercièrent-ils avec effusion et, comme le soir tombait, ils l’accompagnèrent jusqu’à la porte du hammam et, bien qu’il eût beaucoup insisté auprès d’eux pour leur faire accepter son invitation à un repas dans sa maison, ils s’excusèrent et, ayant pris congé de lui, ils s’éloignèrent, tandis que le vieux cheikh s’immobilisait à les regarder encore.
Ils rentrèrent donc chez eux où ils mangèrent et burent et se couchèrent ensemble dans un bonheur parfait, jusqu’au matin. Alors ils se levèrent, firent leurs ablutions et remplirent le devoir de la prière ; puis, à l’ouverture des portes du souk, ils se dirigèrent vers leur boutique qu’ils ouvrirent pour la première fois.
Or, les serviteurs avaient bien arrangé la boutique, car ils avaient du goût, et l’avaient tendue de draperies de soie et avaient placé à l’endroit qu’il fallait deux tapis royaux, qui pouvaient valoir chacun mille dinars, et deux coussins bordés de filets et brodés d’or, qui pouvaient valoir chacun cent dinars. Et sur les étagères, d’ivoire, d’ébène et de cristal étaient rangées en bon ordre les marchandises de prix et les trésors inestimables.
Alors Diadème s’assit sur l’un des tapis, Aziz sur l’autre et le vizir se plaça au milieu, entre eux, au centre même de la boutique ; et les serviteurs les entourèrent, rivalisant d’empressement dans l’exécution de leurs ordres.
Aussi bientôt tous les habitants entendirent parler de cette boutique admirable, et les clients y affluèrent de toutes parts, et c’était à qui recevrait ses emplettes de la main de cet adolescent qu’on nommait Diadème, et dont la réputation de beauté faisait tourner toutes les têtes et s’envoler toutes les raisons. De son côté, le vizir, ayant constaté que les affaires allaient à merveille, recommanda encore une fois à Diadème et à Aziz une grande discrétion, et rentra tranquillement se reposer à la maison.
Or, cet état dura de la sorte un certain temps, au bout duquel Diadème, ne voyant rien s’annoncer du côté de la princesse Donia, commençait à s’impatienter et même à se désespérer jusqu’à en perdre le sommeil, lorsqu’un jour, comme il s’entretenait de ses peines avec son ami Aziz, sur le devant de leur boutique…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT TRENTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
Un jour, comme il s’entretenait de ses peines avec son ami Aziz sur le devant de leur boutique, une vieille femme, très dignement drapée d’un grand voile de satin noir, vint à passer dans le souk ; et son attention ne tarda pas à être attirée par la boutique merveilleuse et la beauté du jeune marchand assis sur le tapis. Et elle fut tellement saisie d’émotion qu’elle en mouilla ses culottes. Puis elle attacha ses regards sur le jeune homme et pensa en son âme : « Ce n’est certes pas un homme, mais un ange ou quelque roi d’un pays de rêve ! » Alors elle s’approcha de la boutique et salua le jeune marchand qui lui rendit son salut et, sur les signes que lui fit Aziz du fond de la boutique, se leva en son honneur et lui sourit de son plus agréable sourire. Puis il l’invita à s’asseoir sur le tapis, et s’assit à côté d’elle et se mit à lui faire de l’air avec son éventail jusqu’à ce qu’elle se fût bien reposée dans la fraîcheur.
Alors la vieille dit à Diadème : « Mon enfant, ô toi qui réunis toutes les perfections et toutes les grâces, es-tu de ce pays ? » Et Diadème, de son parler gentil et pur et plein d’attirance dit : « Par Allah ! ô ma maîtresse, jamais avant cette fois je n’ai mis le pied dans ces contrées où je viens dans le simple but de me distraire en les visitant. Et, pour occuper une partie de mon temps, je vends et j’achète. » La vieille dit : « Bienvenu soit l’hôte gracieux de notre ville ! Et qu’apportes-tu avec toi en fait de marchandises des pays lointains ? Fais-moi voir ce que tu as de plus beau, car le beau attire la beauté ! » Diadème fut très touché de ses paroles exquises et lui sourit pour la remercier et dit : « Je n’ai dans ma boutique que des choses qui puissent te plaire, car elles sont dignes des filles des rois et des personnes comme toi ! » La vieille dit : « Justement je désirerais faire l’achat de quelque très belle étoffe pour une robe destinée à la princesse Donia, fille de notre roi Schahramân. »
En entendant prononcer le nom de celle qu’il aimait tant, Diadème ne se posséda plus d’émotion et cria à Aziz : « Aziz, apporte-moi vite ce qu’il y a de plus beau et de plus riche d’entre nos marchandises ! » Alors Aziz ouvrit une armoire ménagée dans le mur et où il n’y avait qu’un seul paquet, mais quel paquet ! L’étoffe extérieure, frangée de glands d’or, était d’un velours de Damas où couraient, légers et colorés, des dessins de fleurs et d’oiseaux avec, au milieu, un éléphant qui dansait enivré. Et de tout ce paquet se dégageait un parfum qui exaltait l’âme. Aziz l’apporta à Diadème qui le défit et en tira l’unique étoffe qui s’y trouvait et qui avait été sertie pour ne faire qu’une seule robe destinée à quelque houri ou à quelque princesse merveilleuse. Quant à la décrire, ou à énumérer les pierreries dont elle était enrichie ou les broderies sous lesquelles la trame disparaissait, les poètes seuls, inspirés d’Allah, pourraient le faire, en vers cadencés. Pour le moins, elle devait valoir, sans l’enveloppe, cent mille dinars d’or.
Alors Diadème déroula lentement l’étoffe devant la vieille qui ne savait plus que regarder de préférence, — la beauté de la robe ou la figure adorable aux yeux noirs de l’adolescent. Et à regarder ainsi les jeunes charmes du marchand, elle sentait sa vieille chair se réchauffer et ses cuisses se serrer avec fièvre ; et elle avait une envie considérable de se gratter là où çà la démangeait.
Donc, lorsqu’elle put parler, elle dit à Diadème en le regardant avec des yeux humides de passion : « L’étoffe convient. Combien dois-je te la payer ? » Il répondit en s’inclinant : « Je suis payé plus que mon dû par le bonheur de t’avoir connue ! » Alors la vieille s’écria : « Ô adorable garçon, heureuse la femme qui peut s’étendre dans ton giron et t’enlacer la taille de ses bras ! Mais où sont les femmes qui peuvent te mériter ! Pour ma part, je n’en connais qu’une seule sur la terre ! Dis-moi, ô jeune faon, quel est ton nom ? » Il répondit : « Je m’appelle Diadème ! » Alors la vieille dit : « Mais c’est là un nom qui n’est donné qu’aux fils de rois ! Comment un marchand peut-il s’appeler Couronne-des-rois ? »
À ces paroles, Aziz, qui jusque-là n’avait dit mot, intervint à propos pour tirer son ami d’embarras. Il répondit à la vieille : » Il est le fils unique de ses parents qui l’aiment tant, qu’ils ont voulu lui donner un nom comme on en donne aux fils de rois ! » Elle dit : « Certes ! si la Beauté devait élire un roi, c’est Diadème qu’elle choisirait ! Eh bien ! ô Diadème, sache que la vieille désormais est ton esclave ! Et Allah est garant de sa dévotion à ta personne ! Bientôt tu te ressentiras de ce qu’elle va faire pour toi. Et qu’Allah te protège et te garde du mauvais sort et de l’œil des curieux ! » Puis elle prit le précieux paquet et s’en alla.
Et elle arriva, encore tout émue chez Sett-Donia qu’elle avait allaitée, enfant, et à qui elle tenait lieu de mère. Et, en entrant, elle tenait le paquet sous le bras, gravement. Alors Donia lui demanda : « Ô nourrice, que m’apportes-tu encore ? Fais voir ! » Elle dit : « Ô ma maîtresse Donia, prends et regarde ! » Et elle déroula soudain l’étoffe. Alors Donia toute heureuse et les yeux en joie s’écria : « Ma bonne Doudou, oh ! la belle robe ! Ce n’est point là une étoffe de nos pays ! » La vieille dit : « Certes, elle est belle ! Mais que dirais-tu alors si tu voyais le jeune marchand qui me l’a donnée pour toi ? Allah ! qu’il est beau ! C’est le portier Radouân qui a oublié de fermer les portes d’Éden pour ainsi le laisser descendre réjouir le foie des créatures ! Ô maîtresse, combien souhaiterais-je voir cet adolescent radieux s’endormir sur tes seins et… » Mais Donia s’écria : « Ô nourrice, assez ! Comment oses-tu me parler d’un homme, et quelle fumée te noircit la raison ? Ah ! tais-toi ! Et donne-moi cette robe, que je la touche et que je la voie de plus près ». Et elle prit l’étoffe et se mit à la caresser et à la draper sur sa taille en se tournant vers sa nourrice qui lui dit : « Maîtresse, tu es belle ainsi, mais comme un couple de beauté est préférable à l’unité ! Ô Diadème… ! » Mais Sett-Donia s’écria : « Ah ! possédée Doudou, perfide Doudou ! ne dis plus rien. Mais va chez ce marchand et demande-lui s’il a un souhait à formuler ou un service à demander ; et aussitôt le roi mon père lui donnera satisfaction ! » La vieille se mit à rire et dit, en clignant de l’œil : « Un souhait ? par Allah ! je crois bien ! Qui n’a pas de souhait ? » Et elle se leva en toute hâte et courut à la boutique de Diadème.
En la voyant arriver, Diadème sentit son cœur s’envoler de joie, et il lui prit la main et la fit s’asseoir à côté de lui, et lui fit servir des sorbets et des confitures. Alors la vieille lui dit : « Je t’annonce la bonne nouvelle ! Ma maîtresse Donia te salue et te dit : « Tu as honoré notre ville de ta venue et tu l’as illuminée. Et si tu as un souhait à faire, formule-le ! »
À ces paroles Diadème se réjouit à la limite de la réjouissance, et sa poitrine se dilata d’aise et d’épanouissement et il pensa en son âme : « L’affaire est faite ! » Et il dit à la vieille : « Je n’ai qu’un vœu : que tu fasses parvenir à Sett-Donia une lettre que je vais lui écrire et m’en apportes la réponse ! » Elle répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Alors Diadème cria à Aziz : « Donne-moi l’écritoire de cuivre, le papier et le calam ! » Et, Aziz les lui ayant apportés, il écrivit cette lettre en vers cadencés :
« Le papier que voici te porte, ô très haute, les choses multiples, les choses diverses que j’ai trouvées en fouillant un cœur atteint du mal de l’attente !
« Je mets en première ligne les signes du feu qui me brûle au dedans ; en seconde ligne mon désir et mon amour ;
« En troisième ligne ma vie et ma patience ; en quatrième ligne mon ardeur entière ; en cinquième ligne l’extrême envie de mes yeux à se réjouir ;
« Et en sixième ligne une demande de rendez-vous ! »
Puis, au bas de la lettre, il mit ceci en guise de signature :
« Cet écrit en vers rythmés et sertis à ta beauté est de la main de l’esclave de ses longs désirs, de l’enfermé dans la prison de sa douleur, du malade de ses tortures, du postulant de tes regards, — le marchand diadème. »
Alors il relut sa lettre, la sabla, la plia, la cacheta et la remit à la vieille en lui glissant dans la main une bourse contenant mille dinars pour ses bons services. Et la vieille, après ses vœux pour la réussite revint en toute hâte près de sa maîtresse qui lui demanda : « Eh bien ! ma bonne Doudou, dis-moi ce qu’a demandé ce marchand, que j’aille aussitôt prier mon père de le satisfaire ! » La vieille dit : « En vérité, ô maîtresse, je ne sais ce qu’il demande, car voici une lettre dont j’ignore le contenu. » Et elle lui remit la lettre.
Lorsque la princesse Donia eut pris connaissance du contenu, elle s’écria : « Oh ! l’effronté marchand ! Comment ose-t-il lever les yeux jusqu’à moi ? » Et de rage elle se frappa les joues de ses mains et dit : « Je devrais le faire pendre à la porte de sa boutique, ce misérable ! » Alors la vieille, d’un air innocent, demanda : « Qu’y a-t-il donc de si effroyable dans cette lettre ? Le marchand réclamerait-il par hasard un prix exorbitant pour la robe en question ? » Elle dit : « Malheur ! il ne s’agit là que d’amour et de passion ! » La vieille répliqua : « C’est de l’audace, vraiment ; aussi devrais-tu, ô maîtresse, répondre à cet insolent pour le menacer, s’il continue ! » Elle dit : « Oui ! mais j’ai peur que cela ne contribue à l’enhardir encore ! » La vieille répondit : « Que non ! cela le fera rentrer en lui-même ! » Alors Sett-Donia dit : « Donne-moi mon écritoire et mon calam ! » Et elle écrivit ceci en construction de vers :
« Aveugle qui t’illusionnes, tu demandes à parvenir à l’astre, comme si jamais mortel a pu attendre à l’astre des nuits !
« Or, moi, pour t’ouvrir les yeux, je jure, par la vérité de Celui qui t’a formé d’un ver de terre et a créé de l’infini la virginité des astres immaculés,
« Que si tu oses répéter ton acte effronté, on te crucifiera sur une planche coupée dans le tronc de quelque arbre maudit. Et tu serviras d’exemple à tous les insolents ! »
Puis, ayant cacheté la lettre, elle la remit à la vieille ; celle-ci courut aussitôt la porter à Diadème, qui brûlait dans l’attente. Et Diadème, après l’avoir remerciée, ouvrit la lettre et, sitôt qu’il l’eut parcourue, fut pris d’un chagrin extrême et dit tristement à la vieille : « Elle me menace de la mort, mais je ne crains point la mort, car la vie m’est plus pénible. Et, au risque de mourir, je veux lui répondre ! » La vieille dit : « Par ta vie qui m’est chère ! je veux t’aider de tout mon pouvoir et partager avec toi tous les risques ! Écris donc ta lettre et me la donne ! » Alors Diadème cria à Aziz : « Donne à notre bonne mère mille dinars ! Et confions-nous à Allah le Tout-Puissant ! » Et il écrivit sur le papier les strophes suivantes :
« Voici que, pour mon souhait du soir, Elle me menace du deuil et de la mort, ignorant que la mort c’est le repos et que les choses n’arrivent qu’au signe du Destin.
« Par Allah ! Sa pitié ne devrait-elle pas un peu aller à ceux dont l’amour est voué aux très pures et très hautes que les yeux des humains n’osent regarder ?
« Ô mes désirs ! mes vains désirs ! ne souhaitez plus rien, et laissez mon âme s’ensevelir dans sa passion sans espérance !
» Mais toi, femme au cœur dur, ne crois point que je laisserai l’oppression devenir ma dominatrice. Et plutôt que de souffrir d’une vie sans but désormais et toute de douleur, je laisserai mon âme s’envoler avec mes espoirs ! »
Et il remit, les larmes aux yeux, la lettre à la vieille, en lui disant : « Nous te dérangeons inutilement, hélas ! je sens bien que je n’ai plus qu’à mourir ! » Elle lui dit : « Laisse-là ces tristes et faux pressentiments, et regarde-toi, ô bel adolescent ! N’es-tu point le soleil lui-même ? Et n’est-elle pas la lune ? El comment veux-tu que moi, celle dont la vie entière s’est écoulée dans les intrigues d’amour, je ne sache pas unir vos beautés ? Tranquillise donc ton âme et calme les soucis qui te désolent ! Bientôt je t’apporterai des nouvelles de joie ! » Et, sur ces paroles, elle le quitta…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT TRENTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Et sur ces paroles, elle le quitta et, après avoir caché le billet dans ses cheveux, elle alla trouver sa maîtresse. Elle entra chez elle et lui baisa la main et s’assit, sans dire une parole. Mais au bout de quelques instants elle dit : « Ma fille bien-aimée, mes vieux cheveux sont défaits et je n’ai plus la force de les tresser. Ordonne, je te prie, à l’une de tes esclaves de venir me les peigner. » Mais Sett-Donia s’écria : « Ma bonne Doudou, je vais moi-même te les peigner, office que tant de fois tu as rempli à mon égard ! » Et la princesse Donia dénoua les tresses blanches de sa nourrice et se disposa à les peigner ; et le billet aussitôt glissa sur le tapis.
Alors Sett-Donia, surprise, voulut le ramasser, mais la vieille s’écria : « Ma fille, rends-moi ce papier ! Il a dû se prendre dans mes cheveux chez le jeune marchand. Je vais courir le lui rendre ! » Mais Donia se hâta de l’ouvrir et d’en lire le contenu ; et elle fronça les sourcils et s’écria : « Ah ! Doudou scélérate, c’est là une de tes ruses ! Mais qui m’a envoyé ce marchand calamiteux et effronté, et de quelle terre ose-t-il ainsi venir jusqu’à moi ? Et comment, moi, Donia, me résoudre à regarder cet homme qui n’est ni de ma race ni de mon sang ? Ah ! Doudou, ne t’avais-je pas dit que cet insolent allait s’enhardir ? » La vieille dit : « En vérité, c’est un vrai Cheitân ! Et son audace est une audace d’enfer ! Mais, ô ma fille et ma maîtresse, écris-lui pour la dernière fois, et je me porte garante de sa soumission à tes volontés ! Sinon, qu’il soit sacrifié, et moi avec lui ! » Aussitôt la princesse Donia prit le calam et rangea ces paroles rythmiquement :
« Insensé qui sommeilles, quand le malheur et le danger sont planants dans l’air que tu respires,
« Ignores-tu qu’il est des fleuves dont il est défendu de remonter le cours, et des solitudes interdites que nul pied humain ne foulera jamais ?…
« Et penses-tu toucher aux étoiles de l’infini, quand tous les hommes unis ne peuvent de la main atteindre aux premiers astres de la nuit ?…
« Alors !… oseras-tu encore en tes rêves, caresser ou faire plier dans tes bras la taille des houris ?…
» Tu te leurres, ô naïf, crois ta reine ! Ou sinon les corbeaux de l’épouvante obscure croasseront bientôt la mort sur ta tête et, battant de leurs ailes de nuit, autour de la tombe où l’on t’étendra, tournoieront !
Puis, ayant plié et cacheté le papier, elle le remit à la vieille qui, le lendemain, au matin, se hâta de courir le remettre à Diadème.
À la lecture de ces paroles si dures, Diadème comprit que jamais plus l’espérance ne devait vivifier son cœur, et, se tournant vers Aziz, il lui dit : « Mon frère Aziz, dis-moi, que faire maintenant ? Je n’ai plus assez d’inspiration pour lui écrire une réponse décisive ! » Aziz dit : « Je vais essayer à ta place et en ton nom ! » Diadème dit : « Oui, Aziz, écris-lui en utilisant tout ton art ! » Alors Aziz prit un papier et y disposa ces strophes :
« Seigneur Dieu, par les cinq Justes ! aide-moi dans l’excès de mes chagrins et allège mon cœur assombri de la suie de mes soucis !
« Tu connais le secret dont la flamme me brûle au dedans, et la tyrannie de la jeune cruelle qui se refuse à la miséricorde.
« Je branle la tête, les yeux fermés, et je songe à l’adversité où je plonge sans espoir jamais de délivrance.
« Ma patience et mon courage sont finis, consumés dans l’attente d’un amour qui se refuse !
« Ô l’impitoyable aux cheveux de nuit, es-tu donc si assurée contre les coups du Destin et les accidents du sort capricieux, pour ainsi te plaire à torturer le malheureux qui t’appelle ?…
» Comprends ! Un malheureux qui pour ta beauté a quitté son père, sa maison, sa patrie et les yeux des favorites ! »
Puis Aziz tendit à Diadème le papier sur lequel il venait de tracer cette construction rimée. Et Diadème ayant récité les vers pour en apprécier la tonalité, se déclara satisfait de leur allure générale et dit à Aziz : « C’est excellent ! » Et il remit la lettre à la vieille nourrice qui courut aussitôt la porter à Donia.
Lorsque la princesse eut pris connaissance de la missive, sa colère bouillonna contre la vieille, et elle s’écria : « Maudite nourrice, Doudou de calamité, c’est toi seule qui es la cause de toutes ces humiliations que je subis ! Ah ! vieille de malheur, je ne veux plus te voir devant mes yeux ! Sors vite d’ici, ou je vais te faire mettre le corps en lambeaux sous les lanières des esclaves ! Et je te casserai moi-même les os avec mes talons ! » Alors la vieille nourrice sortit précipitamment, comme Donia se disposait, en effet, à appeler les esclaves ; et elle se hâta d’aller raconter son malheur aux deux amis et se mettre sous leur protection.
À cette nouvelle, Diadème fut très affecté et il dit à la vieille en lui touchant gentiment le menton : « Par Allah ! ô notre mère, je sens à cette heure doubler mes chagrins à te voir supporter de la sorte les conséquences de ma faute ! » Mais elle répondit : « Sois tranquille, mon fils, je suis loin de renoncer à la réussite. Car il ne sera jamais dit que j’aie été, une fois dans ma vie, impuissante à unir les amoureux ! Et la difficulté ici m’incite encore davantage à user de toute ma rouerie pour te faire parvenir au but de tes désirs ! » Alors Diadème demanda : « Mais dismoi enfin, ô notre mère, quelle est donc la cause qui a poussé Sett-Donia à prendre ainsi tous les hommes en horreur ? » La vieille dit : « C’est un songe qu’elle a eu ! » Il s’écria : « Un songe, pas plus ? » Elle dit : « Simplement ! Le voici :
« Une nuit que la princesse Donia était endormie, elle vit en rêve un oiseleur qui tendait des filets dans une clairière, et qui, après avoir semé des grains de blé tout autour, sur le sol, s’éloigna et se tint à l’affût à attendre la chance.
« Or, bientôt, de tous les points de la forêt accoururent les oiseaux et s’abattirent sur les filets. Et, parmi tous ces oiseaux qui becquetaient les grains de blé, il y avait deux pigeons, le mâle et la femelle. Et le mâle tout en becquetant, faisait de temps en temps la roue autour de son épouse, sans prendre garde aux lacs qui le guettaient : aussi, dans un de ces mouvements, sa patte fut prise dans les mailles, qui se rétrécirent et s’embrouillèrent et le firent prisonnier. Et les oiseaux, effrayés de ses coups d’aile, s’envolèrent tous avec bruit.
« Mais la femelle laissa là éparse la nourriture et, courageusement, n’eût d’autre souci que de délivrer son époux. Et du bec et de la tête elle travailla si bien qu’elle lacéra le filet et finit par délivrer son mâle imprudent, avant que l’oiseleur eût le temps de venir s’en emparer. Et elle s’envola avec lui, fit une promenade dans l’air, pour revenir becqueter les grains, autour des lacets.
« De nouveau, le mâle se met à tourner autour de la femelle qui, en reculant pour éviter ses déclarations sans répit, s’approcha trop, par inadvertance, des mailles, où elle fut prise à son tour. Alors le mâle, loin de se préoccuper du sort de sa compagne, s’envola à tire d’aile avec tous les oiseaux et laissa de la sorte l’oiseleur courir s’emparer de la captive, qui fut sur l’heure égorgée !
« À ce songe, qui la saisit d’émotion, la princesse Donia se réveilla tout en larmes et m’appela pour me raconter, tremblante, sa vision, et conclure en s’écriant : « Tous les mâles se ressemblent, et les hommes doivent être pires que les animaux : il n’y a, pour une femme, rien de bon à espérer de leur égoïsme ! Aussi, je jure devant Allah que jamais je ne connaîtrai l’horreur de leur approche ! »
Lorsque le prince Diadème entendit ces paroles de la vieille, il lui dit : « Mais, ô notre mère, ne lui as-tu donc pas dit que les hommes n’étaient pas tous comme ce traître de pigeon, et que les femmes n’étaient pas toutes comme sa fidèle et malheureuse compagne ? » Elle répondit : « Rien de tout cela ne put depuis la fléchir ; et elle vit solitaire dans l’adoration de sa seule beauté ! » Diadème dit : « Ô ma mère, je t’en prie, il me faut tout de même, au risque de mourir, la voir, ne fût-ce qu’une fois, et me pénétrer l’âme d’un seul de ses regards ! Ô vieille bénie, fais cela pour moi, en tirant quelque moyen de ta fertile sagesse ! »
Alors la vieille dit : « Sache, ô lumière de mes yeux, qu’au bas du palais où habite la princesse Donia, il y a un jardin, réservé à ses seules promenades, et où elle vient une fois par mois seulement, accompagnée de ses suivantes, et après avoir pris la précaution, pour éviter les regards des passants, d’y pénétrer par une porte secrète. Or, c’est justement dans une semaine le jour de promenade de la princesse. Et c’est moi-même qui viendrai te servir de guide et le mettre en présence de l’objet aimé. Et je suis persuadée que, malgré toutes ses préventions » lorsque la princesse t’aura seulement vu, elle ne pourra qu’être vaincue par ta beauté : car l’amour est un don d’Allah et vient quand Il lui plaît ! »
Alors Diadème respira un peu plus à son aise et remercia la vieille et l’invita, puisqu’elle ne pouvait plus se présenter devant sa maîtresse, à accepter l’hospitalité de sa maison. Et il ferma la boutique ; et tous trois prirent le chemin du logis.
En route, Diadème se tourna vers Aziz et lui dit : « Mon frère Aziz, comme je ne vais plus avoir le loisir d’aller à la boutique, je te la cède entièrement. Et tu en feras ce que bon te semble ! » Et Aziz répondit par l’ouïe et l’obéissance.
Sur ces entrefaites, ils arrivèrent à leur maison et se hâtèrent de mettre le vizir au courant de toute l’histoire, et lui parlèrent aussi du songe de la princesse et du jardin où l’on devait tenter de la rencontrer. Et ils lui demandèrent son avis sur la question.
Alors le vizir réfléchit pendant un bon moment, puis il releva tête et leur dit : « J’ai trouvé la solution ! Allons d’abord au jardin pour bien examiner les lieux. » Et il laissa la vieille au logis et se dirigea aussitôt avec Diadème et Aziz vers le jardin de la princesse. Lorsqu’ils y arrivèrent, ils virent, assis à la porte, le vieux gardien qu’ils saluèrent et qui leur rendit leur salut. Alors le vizir, avant tout, commença par glisser dans la main du vieux cent dinars en lui disant : « Brave oncle, nous désirerions tant entrer nous rafraîchir l’âme dans ce beau jardin et manger un morceau près des fleurs et de l’eau ! Car nous sommes des étrangers qui cherchons partout les beaux endroits où se réjouir ! » Alors le vieux prit l’argent et dit : « Entrez donc, mes hôtes, et prenez vos aises en attendant que je coure vous acheter ce qu’il faut pour manger. » Et il les fit pénétrer dans le jardin, pour aller au souk leur acheter les provisions de bouche et revenir bientôt avec un mouton rôti et des pâtisseries. Et ils s’assirent tous en rond sur le bord d’un ruisseau, et mangèrent leur plein. Alors le vizir dit au gardien : « Ô cheikh, ce palais qui est là, devant nous, a l’air en bien mauvais état. Pourquoi donc ne le fais-tu pas réparer ? » Alors le gardien s’écria : « Par Allah ! ce palais est celui de la princesse Donia, qui le laisserait tomber en ruines plutôt que de s’en occuper : elle vit trop retirée pour prêter son attention à ces choses-là. » Le vizir dit : « Que c’est dommage, ô brave cheikh ! Le rez-de-chaussée, au moins, devrait être un peu blanchi, ne fût-ce que pour tes propres yeux. Si tu veux, je ferai moi-même tous les frais de la réparation. » Le gardien dit : « Qu’Allah t’écoute ! » Le vizir dit : « Prends alors ces cent dinars pour ta peine, et va chercher les maçons, et aussi un peintre qui soit fort versé dans la délicatesse du coloris. »
Alors le gardien se hâta d’aller chercher les maçons et le peintre, auxquels le vizir donna les instructions nécessaires. En effet, une fois la grande salle du rez-de-chaussée bien réparée et bien blanchie, le peintre se mit au travail et, suivant les ordres du vizir, il peignit une forêt et, au cœur de la forêt, des filets tendus où un pigeon était pris et battait des ailes. Et lorsqu’il eut fini, le vizir lui dit : « Peins maintenant de l’autre côté la même chose, mais en figurant un pigeon mâle qui vient délivrer sa compagne et qui alors est capturé par l’oiseleur et sacrifié, victime de son dévouement. » Et le peintre exécuta le dessin en question ; puis, largement, rétribué, il s’en alla.
Alors le vizir et les deux jeunes gens et le gardien s’assirent un instant pour bien juger de l’effet et du ton. Et Diadème, malgré tout, était triste ; et il regardait cela, tout songeur ; puis il dit à Aziz : « Mon frère, dis-moi encore quelques vers pour faire diversion aux tortures de mes pensées. » Et Aziz dit :
« Ibn-Sina, dans ses écrits sur la médecine, prescrit ceci comme remède suprême :
La souffrance d’amour n’a d’autre remède que le chant bien rythmé et la coupe légère dans les jardins !
J’ai suivi les paroles d’Ibn-Sina, mais sans résultat, hélas ! Alors, pour essayer, je courus à d’autres amours, et je vis le Destin me sourire et me dispenser la guérison.
Ibn-Sina ! tu t’es trompé ! La seule médecine à l’amour, c’est encore l’amour ! »
Alors Diadème dit à Aziz : « Le poète a peut-être raison. Mais, comme c’est difficile, quand la volonté s’en est allée ! » Puis ils se levèrent et saluèrent le vieux gardien et rentrèrent à la maison, retrouver la vieille nourrice.
Or, comme la semaine était écoulée, Sett-Donia voulut, selon son habitude, faire sa promenade dans le jardin. Mais alors elle sentit combien sa vieille nourrice lui manquait, et elle se désola et fit un retour sur elle-même et s’aperçut qu’elle avait été inhumaine à l’égard de celle qui lui avait tenu lieu de mère ; et aussitôt elle envoya un esclave au souk et un autre esclave chez toutes les connaissances de Doudou pour la chercher et la ramener. Et justement Doudou, après avoir fait à Diadème toutes les recommandations nécessaires pour ce jour, qui était celui de la rencontre au jardin, se dirigeait seule du côté du palais, et l’un des esclaves l’aborda respectueusement et la pria, au nom de sa maîtresse, qui la pleurait, de rentrer pour la réconciliation. Ce qui fut fait, après quelques difficultés pour la forme : et Donia l’embrassa sur les joues, et Doudou lui baisa les mains, et toutes deux, suivies des esclaves femmes, franchirent la porte secrète et entrèrent au jardin.
Or, de son côté, Diadème s’était conformé aux instructions de sa protectrice. En effet, après le départ de Doudou, le vizir et Aziz se levèrent et l’habillèrent d’une magnifique robe vraiment royale et qui pouvait certainement valoir cinq mille dinars, et lui ceignirent la taille d’une ceinture d’or filigrané, toute incrustée de pierreries, avec une agrafe d’émeraudes, et autour du front ils lui mirent un turban de soie blanche avec de fins dessins d’or et une aigrette de diamants ; puis ils appelèrent sur lui les bénédictions d’Allah et, après l’avoir accompagné jusqu’en vue du jardin, ils s’en retournèrent pour l’y laisser pénétrer plus facilement.
Diadème donc, en arrivant à la porte, trouva assis le bon vieux gardien qui, en le voyant, se leva aussitôt en son honneur et lui rendit son salam avec respect et cordialité. Et, comme il ignorait que la princesse Donia fût entrée dans le jardin par la porte secrète, il dit à Diadème : « Le jardin est ton jardin, et je suis ton esclave ! » Et il lui ouvrit la porte en le priant de la franchir. Puis il la referma et revint s’asseoir à la place accoutumée en louant Allah dans ses créatures.
Quant à Diadème, il se hâta de faire ce que la vieille lui avait prescrit : il se blottit derrière le massif qu’elle lui avait indiqué, à attendre là le passage de la princesse. Voilà pour lui !
Mais pour ce qui est de Sett-Donia, voici ! La vieille, tout en se promenant, lui dit : « Ô ma maîtresse, j’ai à te dire quelque chose qui contribuera à te rendre plus reposante la vue de ces beaux arbres, de ces fruits et de ces fleurs ». Donia dit : « Je suis prête à t’écouter, ma bonne Doudou ». Elle dit : « Tu devrais, vraiment, renvoyer au palais toutes ces suivantes qui t’empêchent de jouir tout à ton aise de l’air du temps et de cette délicieuse fraîcheur. Elles ne sont vraiment qu’une gène pour toi. » Donia dit : « Tu dis vrai, ô nourrice ! » Et elle renvoya aussitôt, d’un signe, ses suivantes. Et c’est ainsi que, toute seule, suivie de la vieille seulement, la princesse Donia s’avança du côté du massif où se trouvait Diadème, invisible.
Et Diadème vit la princesse Donia ; et d’un regard il put juger de sa beauté et il en fut tellement saisi qu’il s’évanouit sur place. Et Donia continua son chemin et s’avança du côté de la salle où le vizir avait fait peindre la scène de l’oiseleur ; et, sur l’injonction de Doudou, elle y pénétra, pour la première fois de sa vie : car jamais auparavant elle n’avait eu la curiosité de visiter ce local réservé aux gens de service du palais.
À la vue de cette peinture, Sett-Donia fut à la limite de la perplexité et s’écria : « Ô Doudou, regarde ! c’est mon rêve d’autrefois, mais tout à rebours ! Seigneur ! Ya rabbi ! comme mon âme est émue ! » Et comprimant son cœur, elle s’assit sur le tapis et dit : « Ô Doudou, me serais-je donc trompée ? Et Éblis le Malin se serait-il ri simplement de ma crédulité aux songes ? » Et la nourrice dit : « Ma pauvre enfant, ma vieille expérience t’avait cependant bien prévenue de ton erreur ! Mais sortons nous promener encore, maintenant que le soleil descend et que la fraîcheur est plus douce dans l’air aromatique. » Et elles sortirent au jardin.
Or, Diadème était revenu de son évanouissement et, comme le lui avait recommandé Doudou, s’était mis à se promener lentement, d’un air indifférent, comme attentif seulement à la beauté du paysage.
Aussi, à un détour d’allée, Sett-Donia l’aperçut et s’écria : « Ô nourrice ! Vois-tu ce jeune homme ? Regarde comme il est beau, et quelle taille et quelle démarche ! Le connaîtrais-tu ? par hasard, dis ! » Elle répondit : « Je ne le connais point, mais ce doit être, à en juger sur son air, le fils de quelque roi. Ah ! ma maîtresse, qu’il est merveilleux ! ah ! combien ! ah ! mon âme ! » Et Sett-Donia dit : « Il est tout à fait beau ! » La vieille dit : « Tout à fait ! Heureuse son amante ! » Et, à la dérobée, elle fit signe à Diadème de sortir du jardin et de s’en retourner chez lui. Et Diadème comprit et continua son chemin vers le dehors, cependant que la princesse Donia le suivait encore du regard et disait à sa nourrice : « Sens-tu, ô Doudou, le changement qui se fait en moi ? Est-ce possible que moi, Donia, je puisse éprouver un tel trouble à la vue d’un homme ! Ô nourrice, je sens moi-même que je suis prise et que, maintenant, je vais à mon tour te demander tes bons offices. » La vieille dit : « Qu’Allah confonde le Tentateur maudit ! Te voilà, ô maîtresse, prise dans les filets ! Mais aussi, qu’il est beau, le mâle qui va te délivrer ! » Donia dit : « Ô Doudou, ma bonne Doudou, il te faut absolument m’amener ce beau jeune homme ! Je ne le veux que de tes mains, nourrice, chère nourrice ! Cours vite, de grâce, me le chercher ! Et voici, pour toi, mille dinars et une robe de mille dinars. Et si tu refuses, je meurs ! » La vieille dit : « Retourne alors au palais, et laisse-moi agir à ma guise. Je te promets la réalisation de cette union admirable ! »
Et aussitôt elle quitta Sett-Donia et sortit retrouver le beau Diadème, qui la reçut avec joie et commença par lui donner mille dinars d’or. Et la vieille lui dit : « Il s’est passé telle et telle chose. » Et elle lui raconta l’émotion de Sett-Donia et leur dialogue. Et Diadème dit : « Mais à quand notre union ? » Elle répondit : « Demain sans faute ! » Alors il lui donna encore une robe et des cadeaux pour mille dinars d’or, qu’elle accepta en lui disant : « Je viendrai moi-même te prendre à l’heure propice. » Et elle s’en alla en toute hâte retrouver sa maîtresse Donia, qui l’attendait anxieuse et qui lui dit : « Quelles nouvelles, ô Doudou, m’apportes-tu de l’ami ? » Elle répondit : « J’ai réussi à retrouver ses traces et à lui parler. Dès demain, je te l’amènerai par la main. » Alors Sett-Donia fut au comble du bonheur et donna à sa nourrice mille dinars d’or et des cadeaux pour mille autres dinars. Et, cette nuit-là, tous les trois s’endormirent l’âme imprégnée de l’espérance douce et du contentement.
Or, à peine matin, la vieille était déjà à la demeure de Diadème, qui l’attendait. Elle défit un paquet qu’elle avait apporté et en tira des vêtements de femme dont elle habilla Diadème, et finit par l’envelopper complètement du grand izar et lui couvrit le visage d’une voilette épaisse ; puis elle lui dit : « Maintenant imite dans ta démarche les mouvements des femmes qui balancent leurs hanches à droite et à gauche, et fais des petits pas, comme les jeunes vierges. Et surtout laisse-moi répondre seule à toutes les questions des gens, et sous n’importe quel prétexte ne fais entendre ta voix ! » Et Diadème répondit par l’ouïe et l’obéissance.
Alors ils sortirent tous deux et se mirent à marcher jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés à la porte du palais dont le gardien était justement le chef eunuque en personne. Aussi à la vue de la nouvelle venue, qu’il ne connaissait pas, le chef eunuque demanda à la vieille : « Qui est donc cette jeune personne que je n’ai jamais vue. Fais-là un peu approcher, que je l’examine : les ordres sont formels, et je dois palper en tous sens et, s’il le faut, mettre nues toutes les nouvelles esclaves dont j’ai la responsabilité ! Or, celle-ci, je ne la connais pas : laisse-moi donc la palper de mes mains et la voir de mes yeux ! » Mais la vieille se récria, disant : « Que dis-tu là, ô chef du palais ! Ne sais-tu… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète selon son habitude, ne prolongea pas davantage le récit celle nuit-là.
LA CENT TRENTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« Que dis-tu là, ô chef du palais ! Ne sais-tu que cette esclave, c’est Sett-Donia elle-même qui l’envoie chercher pour utiliser son talent de brodeuse sur étoffe ? Et ne sais-tu donc que c’est une de celles qui exécutent, sur la soie, les dessins admirables de la princesse ? » Mais l’eunuque se renfrogna et dit : « Il n’y a pas de broderies qui tiennent ! Il me faut absolument palper partout la nouvelle venue et l’examiner de face, de dos, de flanc, de haut et de bas ! »
À ces paroles, la vieille nourrice montra les signes d’une fureur extrême et se planta devant l’eunuque et lui dit : « Et moi qui t’avais toujours pris pour le modèle de la politesse et des bonnes manières ! Que t’arrive-t-il donc soudain ? Voudrais-tu m’obliger à te faire chasser du palais ? » Puis elle se tourna vers Diadème déguisé et lui cria : « Ma fille, excuse notre chef ! C’est une plaisanterie de sa part ! Passe donc sans crainte ! » Alors Diadème franchit la porte en mouvant ses hanches et en jetant un sourire, sous la voilette, au chef eunuque immobilisé par sa beauté que laissait transparaître l’étoffe douce. Et, guidé par la vieille, il entra dans un corridor, puis dans une galerie, puis dans d’autres corridors et d’autres galeries, jusqu’à ce qu’il arrivât, au bout de la septième galerie, à une salle qui donnait sur une grande cour par six portes aux rideaux abaissés. Et la vieille lui dit : « Compte les portes l’une après l’autre et entre par la septième : et tu trouveras, ô jeune marchand, ce qui est au-dessus de toutes les richesses de la terre, la fleur vierge, la jeune chair et la douceur qu’on nomme Sett-Donia ! »
Alors le prince Diadème, sous ses habits de femme, compta les portes et entra par la septième. Et, laissant retomber les rideaux, il releva la voilette qui lui cachait les traits. Or, Sett-Donia, en ce moment, était endormie sur le divan. Et elle n’était vêtue que de la transparence seulement de sa peau de jasmin. Et d’elle toute se dégageait l’appel aux caresses inconnues. Alors, d’un mouvement, Diadème se dégagea des vêtements qui l’encombraient et, svelte, bondit vers le divan et prit dans ses bras la princesse endormie. Et le cri d’effarement de la jeune fille, soudain réveillée, fut étouffé par les lèvres qui la dévoraient. Et c’est ainsi qu’eut lieu la rencontre première du beau prince Diadème et de la princesse Donia, au milieu des cuisses qui s’enlaçaient et des jambes qui trépidaient. Et cela dura de la sorte l’espace d’un mois, sans que de part ou d’autre on discontinuât les baisers éclatants ou les rires qui bénissaient l’Ordonnateur de toutes choses belles. Or, voilà pour eux !
Mais, pour ce qui est du vizir et d’Aziz, ils restèrent jusqu’à la nuit à attendre, avec anxiété, le retour de Diadème. Et quand ils virent qu’il n’arrivait pas, ils commencèrent à sérieusement s’inquiéter ; quand le matin vint, sans nouvelles de l’imprudent, ils ne doutèrent plus de sa perte et furent complètement décontenancés ; et, dans leur douleur et leur perplexité, ils ne surent plus à quel parti s’arrêter. El Aziz dit, d’une voix étranglée : « Les portes du palais ne se rouvriront jamais plus sur notre maître ! Oh ! que devons-nous faire maintenant ? » Le vizir dit : « Attendre encore ici, sans bouger ! » Et ils restèrent ainsi durant tout le mois, ne mangeant ni ne dormant plus, et se lamentant sur ce malheur sans recours. Aussi comme, au bout du mois, ils n’avaient toujours pas signe de l’existence de Diadème, le vizir dit : « Mon enfant, quelle situation lamentable et difficile ! Je crois que le meilleur parti à prendre est encore de nous en retourner dans notre pays, mettre le roi au courant de ce malheur : sinon il nous reprocherait d’avoir négligé de l’en avertir. » Et, à l’heure même, ils firent tous leurs préparatifs de voyage, et partirent pour la Ville-Verte qui était la capitale du roi Soleïmân-Schah.
À peine furent-ils arrivés, qu’ils se hâtèrent de monter au palais et de mettre le roi au courant de toute l’histoire et de la fin malheureuse de l’aventure. Et ils se turent pour éclater en sanglots.
À cette nouvelle terrible, le roi Soleïmân-Schah sentit le monde entier s’écrouler sous lui et s’effondra lui-même sans connaissance. Mais à quoi désormais pouvaient servir les larmes et les pleurs du regret ? Aussi le roi Soleïmân-Schah, comprimant la douleur qui lui rongeait le foie et lui noircissait l’âme et la terre entière devant les yeux, jura qu’il allait venger la perte de son fils Diadème par une vengeance sans précédent. Et aussitôt il fit appeler, par les crieurs publics, tous les hommes capables de tenir la lance ou l’épée, et toute l’armée avec ses chefs ; et il fit sortir tous ses engins de guerre, ses tentes et ses éléphants ; et, suivi ainsi de tout son peuple, qui l’aimait extrêmement pour son équité et sa générosité, il se mit en route pour les Îles du Camphre et du Cristal.
Pendant ce temps, dans le palais qu’illuminait le bonheur, les deux amants, Diadème et Donia, ne cessaient de s’aimer de plus en plus et ne se levaient des tapis que pour boire ensemble et chanter. Et cela dura de la sorte l’espace de six mois. Or, un jour que l’amour de son amie le ravissait à la limite de tout, Diadème dit à Donia : « Ô l’adorée de mes entrailles, il y a encore une chose qui nous manque pour que notre amour soit admirable ! » Elle lui dit, étonnée : « Ô Diadème, lumière de mes yeux, que peux-tu encore souhaiter ? N’as-tu point mes lèvres et mes seins, mes cuisses et toute ma chair, et mes bras qui t’enlacent et mon âme qui te désire ? Si tu souhaites encore d’autres gestes d’amour que je ne connaisse pas, pourquoi différer de m’en parler ? Et sur l’heure tu verras si je sais les exécuter ! » Diadème dit : « Mon agneau, il ne s’agit pas du tout de cela. Laisse-moi donc te révéler qui je suis ! Sache, ô princesse, que moi-même je suis un fils de roi, et non un marchand du souk. Et le nom de mon père est le roi Soleïmân-Schah, maître de la Ville-Verte et des montagnes d’Ispahân. Et c’est lui-même qui, dans le temps, avait envoyé son vizir au roi Schahramân, ton père, pour te demander comme mon épouse ! Te rappelles-tu qu’alors tu avais refusé cette union et menacé de ta masse d’armes le chef eunuque qui t’en parlait ? Eh bien, réalisons aujourd’hui ce que nous a refusé le passé, et allons ensuite ensemble vers la verte Ispahân ! »
À ces paroles la princesse Donia s’enlaça plus joyeusement au cou du beau Diadème, et par des signes guère équivoques lui répondit par l’ouïe et l’obéissance. Puis tous deux, cette nuit-là, purent pour la première fois se laisser gagner par le sommeil, alors que durant les dix mois écoulés la blancheur du matin les surprenait en accolades, baisers et diverses semblables choses.
Or, pendant que dormaient ainsi les deux amants, alors que le soleil était déjà levé et que tout le palais était en mouvement, le roi Schahramân, père de la princesse, était assis sur les coussins de son trône et était entouré par les émirs et les grands de son royaume, et recevait, ce jour-là, les membres de la corporation des bijoutiers avec leur chef en tête. Et le chef des bijoutiers offrit en hommage au roi un écrin merveilleux qui contenait pour plus de cent mille dinars de diamants, de rubis et d’émeraudes. Aussi le roi Schahramân fût-il extrêmement satisfait de l’hommage et il appela le chef eunuque et lui dit : « Tiens, Kâfour, va porter cela à ta maîtresse Sett-Donia ! Et tu reviendras me dire si ce cadeau est selon son gré. » Et aussitôt l’eunuque Kâfour se dirigea vers le pavillon réservé où habitait seule la princesse Donia.
Or, en arrivant, l’eunuque Kâfour vit, étendue sur un tapis, gardant la porte de sa maîtresse, la nourrice Doudou ; et les portes du pavillon étaient toutes fermées et les rideaux abaissés. Et l’eunuque pensa : « Comment se fait-il qu’elles dorment jusqu’à cette heure avancée, alors que ce n’est guère dans leurs habitudes ! » Puis, comme il ne voulait pas, sans résultat, retourner auprès du roi, il franchit le corps de la vieille étendu en travers de la porte, poussa la porte et entra dans la salle. Et quel ne fut pas son ébahissement et sa stupeur en voyant Sett-Donia endormie toute nue dans les bras du jeune homme, avec un tas de signes péremptoires d’une fornication extraordinaire !
À cette vue, l’eunuque Kâfour se remémora le mauvais traitement dont l’avait menacé Sett-Donia, et il pensa en son âme d’eunuque : « C’est donc ainsi qu’elle abomine le genre masculin ? À mon tour maintenant, si Allah veut, de me venger de mon humiliation ! » Et il ressortit doucement en refermant la porte, et se présenta entre les mains du roi Schahramân. Et le roi lui demanda : « Et qu’a dit ta maîtresse ? » l’eunuque dit : « Voici la boîte. » Et le roi, étonné, demanda : « Ma fille ne veut donc pas plus des pierreries que des maris ? » Mais le nègre dit : « Dispense-moi, ô roi, de cette réponse devant toute cette assemblée ! » Alors le roi fit évacuer la salle du trône, gardant seulement auprès de lui son vizir ; et l’eunuque dit : « Ma maîtresse Donia est dans telle et telle position ! Mais, en vérité, le jeune homme est fort beau ! » À ces paroles, le roi Schahramân frappa ses mains l’une contre l’autre, ouvrit de grands yeux et s’écria : « La chose est énorme ! » Puis il ajouta : « Tu les as vus, ô Kâfour ? » L’eunuque dit : « Avec cet œil-ci et cet œil-là ! » Alors le roi dit : « C’est tout à fait énorme ! » Et il ordonna à l’eunuque de faire venir devant le trône les deux coupables. Et l’eunuque aussitôt exécuta l’ordre.
Lorsque les deux amants furent entre les mains du roi, il leur dit, suffoqué : « C’est donc vrai ! » Mais il ne put en dire davantage et il saisit à pleines mains son grand sabre et voulut se jeter sur Diadème. Mais Sett-Donia entoura son amant de ses bras, et colla ses lèvres contre les siennes, puis elle cria à son père : « Puisque c’est ainsi, tue-nous tous les deux ! » Alors le roi regagna son trône et ordonna à l’eunuque de ramener Sett-Donia à son appartement ; puis il dit à Diadème : « Misérable corrupteur ! qui es-tu ? et qui est ton père ? et comment as-tu osé arriver jusqu’à ma fille ? » Alors Diadème dit : « Sache, ô roi, que si c’est ma mort que tu désires, la tienne suivra aussitôt, et ton royaume sera dans l’anéantissement ! » Et le roi, hors de lui, s’écria : « Et comment cela ? » Il dit : « Je suis le fils du roi Soleïmân-Schah ! Et j’ai pris, selon ce qui était écrit, ce que l’on m’avait refusé ! Ouvre donc les yeux, ô roi, avant d’ordonner ma perte ! »
À ces paroles, le roi fut dans la perplexité et consulta son vizir sur ce qu’il leur restait à faire. Mais le vizir dit : « Ne crois point, ô roi, aux paroles de cet imposteur. La mort seule peut punir la forfaiture d’un pareil fils de pute ! qu’Allah le confonde et le maudisse ! » Alors le roi dit au porte-glaive : « Coupe-lui le cou. »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète selon son habitude, se tut.
LA CENT TRENTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
Alors le roi dit au porte-glaive : « Coupe-lui le cou. » Et c’en était fait de Diadème, si, au moment où le porte-glaive se disposait à exécuter l’ordre, on n’eût annoncé au roi l’arrivée de deux envoyés du roi Soleïmân-Schah, qui sollicitaient l’entrée. Or, justement, les deux envoyés précédaient l’arrivée du roi Soleïmân-Schah, en personne, avec toute son armée. Et ces deux envoyés n’étaient autres que le vizir et le jeune Aziz. Aussi, quand l’entrée leur fut accordée et qu’ils eurent reconnu le fils de leur roi, le prince Diadème, ils faillirent s’évanouir de joie et se jetèrent à ses pieds et les lui embrassèrent ; et Diadème les obligea à se relever et les embrassa et, en quelques mots, leur exposa la situation ; et eux également le mirent au courant de ce qui s’était passé et annoncèrent au roi Schahramân la venue prochaine du roi Soleïmân-Schah et de toutes ses forces.
Lorsque le roi Schahramân comprit le danger qu’il avait couru quand il avait ordonné la mort du jeune Diadème, dont l’identité était maintenant évidente, il leva les bras et bénit Allah qui avait arrêté la main du porte-glaive. Puis il dit à Diadème : « Mon fils, excuse un vieillard comme moi, qui n’a su ce qu’il allait faire. Mais la faute est à mon vizir de malheur, que je vais faire empaler sur le champ ! » Alors le prince Diadème lui baissa la main et lui dit : « Tu es, ô roi, comme mon père, et c’est moi plutôt qui devrais te demander pardon de l’émotion que je t’ai donnée ! » Le roi dit : « La faute est à cet eunuque de malédiction que je vais faire crucifier sur une planche pourrie qui ne vaille pas deux drachmes ! » Alors Diadème dit : « Pour ce qui est de l’eunuque, il le mérite bien ! Mais pour le vizir, ce sera la prochaine fois, s’il recommence ! » Alors Aziz et le vizir intercédèrent auprès du roi pour obtenir également le pardon de l’eunuque, que la terreur avait fait pisser dans ses vêtements. Et le roi, par égards pour le vizir, pardonna à l’eunuque Kâfour. Alors Diadème dit : « La chose la plus importante à faire est encore de calmer au plus vite la crainte où doit être ta fille Sett-Donia qui est toute mon âme ! » Le roi dit : « De ce pas, je vais chez elle, moi-même ! » Mais auparavant il ordonna à son vizir, à ses émirs et à ses chambellans d’escorter le prince Diadème jusqu’au hammam et de lui faire prendre eux-mêmes un bain qui le disposât agréablement. Puis il courut au pavillon réservé de Sett-Donia, qu’il trouva sur le point de s’enfoncer dans le cœur la pointe d’un glaive dont la poignée reposait à terre. À cette vue, le roi sentit sa raison s’envoler et cria à sa fille : « Il est en sécurité ! Aie pitié de ton père, ma fille ! » À ces paroles, Sett-Donia rejeta l’épée loin d’elle et baisa la main de son père, et son père la mit au courant de la situation. Alors elle lui dit : « Je ne serai tranquille que lorsque je verrai mon amoureux ! » Alors le roi se hâta, une fois Diadème revenu du hammam, de le mener chez la princesse Donia, qui se jeta à son cou ; et pendant que les deux amants s’embrassaient, le roi ferma discrètement la porte sur eux. Puis il rentra dans son palais donner les ordres nécessaires pour la réception du roi Soleïmân-Schah, à qui il se hâta de dépêcher le vizir et Aziz pour lui annoncer l’heureux état des choses, en même temps qu’il prit soin de lui envoyer, comme cadeau, cent chevaux magnifiques, cent dromadaires de course, cent jeunes garçons, cent adolescentes, cent nègres et cent négresses.
Et c’est alors seulement que le roi Schahramân, une fois ces préliminaires accomplis, sortit lui-même à la rencontre du roi Soleïmân-Schah, en prenant soin de se faire accompagner par le prince Diadème ; et, suivis d’une suite nombreuse, ils sortirent tous deux de la ville. Et, en les voyant s’approcher, le roi Soleïmân-Schah vint également au-devant d’eux et s’écria : « Louange à Allah qui a fait parvenir mon fils à ses fins ! » Puis les deux rois s’embrassèrent affectueusement ; et Diadème se jeta au cou de son père en pleurant de joie, et son père également. Puis on se mit à manger, à boire et à causer dans le bonheur le plus parfait. Et, cela fait, on fit venir les kâdis et les témoins et, séance tenante, on écrivit le contrat de mariage de Diadème et de Sett-Donia. Puis on fit, à cette occasion, de grandes largesses aux soldats et au peuple, et, pendant quarante jours et quarante nuits, la ville fut décorée et illuminée. Et c’est au milieu de toute la joie et de toutes les fêtes que Diadème et Donia purent désormais s’entr’aimer tout à leur aise, à la limite extrême de l’amour !
Mais aussi Diadème se garda-t-il bien d’oublier les bons services de son ami Aziz ; car, après avoir envoyé tout un convoi avec Aziz pour chercher la mère d’Aziz, qui le pleurait depuis longtemps, il ne voulut plus se séparer de lui. Et après la mort du roi Soleïmân-Schah, comme Diadème était devenu, à son tour, roi de la Ville-Verte et des montagnes d’Ispahân, il nomma Aziz grand-vizir ; et puis il nomma le vieux gardien intendant général du royaume, et le cheikh du souk, chef général de toutes les corporations. Et ils vécurent tous dans le bonheur, jusqu’à la mort, seule calamité sans remède !
Lorsqu’il eut fini de raconter cette histoire d’Aziz et Aziza et celle de Diadème et Donia, le vizir Dandân demanda la permission au roi Daoul’makân de boire un verre de sirop à la rose. Et le roi Daoul’makân s’écria : « Ô mon vizir, y a-t-il quelqu’un sur terre aussi digne que toi de tenir compagnie aux princes et aux rois ! En vérité, cette histoire m’a ravi extrêmement, tant elle est délicieuse et agréable à écouter ! » Et le roi Daoul’makân donna à son vizir la plus belle robe d’honneur du trésor royal.
Mais pour ce qui est du siège de Constantinia…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et se tut discrètement.
DES ENFANTS DU ROI OMAR AL-NEMÂN.
LA CENT TRENTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Mais pour ce qui est du siège de Constantinia, il y avait déjà quatre ans qu’il traînait en longueur, sans résultat décisif ; et les soldats et les chefs commençaient à souffrir vivement d’être loin de leurs parents et de leurs amis ; et la rébellion était imminente.
Aussi le roi Daoul’makân fut prompt à prendre ses résolutions, et il appela les trois grands chefs Bahramân, Rustem et Turkash, et en présence du vizir Dandân, leur dit : « Vous êtes témoins de ce qui a lieu, et de la fatigue qui pèse sur nous tous par suite de ce siège de malheur, et des fléaux irrémédiables que la vieille Mère-des-Calamités a fait tomber sur nos têtes, ne serait-ce seulement que la mort de mon frère, l’héroïque Scharkân. Réfléchissez donc sur ce qui nous reste à faire, et répondez-moi comme il faut que vous répondiez ! » Alors les trois chefs de l’armée baissèrent la tête et réfléchirent longuement ; puis ils dirent : « Ô roi, le vizir Dandân est plus expérimenté que nous tous, et il a vieilli dans la sagesse ! » Et le roi Daoul’makân se tourna vers le vizir Dandân et lui dit : « Nous sommes tous ici dans l’attente de tes paroles ! »
Alors le vizir Dandân s’avança entre les mains du roi et dit : « Sache, ô roi du temps, qu’il nous est, en effet, désormais nuisible de demeurer plus longtemps sous les murs de Constantinia. D’abord tu dois toi-même, ô roi, être pris du désir de revoir ton jeune fils Kanmakân et aussi ta nièce Force-du-Destin, fille de notre défunt prince Scharkân, laquelle est à Damas, dans le palais, avec les femmes. Et puis tous ici nous sentons vivement la douleur d’être si loin de notre pays et de nos maisons. Mon idée est donc que nous retournions à Baghdad, quitte à revenir ici, plus tard, pour ne laisser de cette ville mécréante que juste de quoi faire nicher les corbeaux et les vautours ! » Et le roi dit : « En vérité, ô mon vizir, tu as répondu selon mes vues ! » Et aussitôt il fit annoncer à tout le camp, par les crieurs publics, que dans trois jours devait avoir lieu le départ.
Et, en effet, le troisième jour, bannières au vent et trompettes sonnantes, l’armée leva le campement et reprit le chemin de Baghdad. Et après des jours et des nuits elle arriva dans la Ville-de-Paix, où elle fut reçue avec de grands transports de joie par tous les habitants.
Mais pour ce qui est du roi Daoul’makân, la première chose qu’il fit fut d’aller voir et d’embrasser son fils Kanmakân qui venait d’atteindre sa septième année d’âge ; et la seconde chose qu’il fit fut d’appeler à lui son ancien ami, le vieux chauffeur du hammam. Et lorsqu’il le vit, il se leva du trône en son honneur, et l’embrassa et le fit s’asseoir à ses côtés, et le loua énormément devant tous ses émirs et tous les assistants. Or, pendant tout cet espace de temps, le chauffeur du hammam était devenu méconnaissable, à force de manger, de boire et de se reposer ; il avait grossi à la limite de l’embonpoint ; son cou était devenu comme le cou d’un éléphant, son ventre comme le ventre d’une baleine, et sa figure aussi luisante qu’un pain arrondi sortant du four.
Donc il avait commencé par se défendre d’accepter l’invitation que lui faisait le roi de s’asseoir à côté de lui, et lui avait dit : « Ô mon maître, qu’Allah me préserve de commettre pareil abus ! Il y a longtemps qu’ils sont passés, les jours où il m’était permis d’oser m’asseoir en ta présence ! » Mais le roi Daoul’makân lui avait dit : « Ces jours ne peuvent maintenant, pour toi, que recommencer, ô mon père ! Car c’est toi qui m’as sauvé la vie ! » Et il avait obligé le chauffeur à s’asseoir avec lui sur la grand lit du trône.
Alors le roi dit au chauffeur : « Je veux te voir me demander une faveur, car je suis prêt à t’accorder tout ce que tu désires, fût-ce même le partage de mon royaume ! Parle donc, et Allah t’écoutera ! » Alors le vieux chauffeur dit : « Je voudrais bien te demander quelque chose que je souhaite depuis longtemps, mais j’aurais si peur de paraître indiscret ! » Et le roi fut très affligé et dit : « Il faut absolument que tu m’en parles ! » Le chauffeur dit : « Tes ordres sont sur ma tête ! Voici : je souhaite, ô roi, avoir, de ta main, un brevet par lequel je sois nommé président général des chauffeurs de tous les hammams de la Ville-Sainte, ma ville ! » À ces paroles le roi et tous les assistants rirent extrêmement ; et le chauffeur crut que sa demande était exorbitante ; et il en fut à la limite de la désolation. Mais le roi lui dit : « Par Allah ! demande-moi autre chose ! » Et le vizir Dandân, également, s’approcha doucement du chauffeur et lui pinça la jambe et lui cligna de l’œil pour lui dire : « Demande donc autre chose ! » Et le chauffeur dit : « Alors, ô roi du temps, je souhaiterais fort être nommé cheikh principal de toute la corporation des balayeurs d’ordures, dans la Ville-Sainte, ma ville ! » À ces paroles le roi et les assistants furent pris d’un tel rire qu’ils lancèrent leurs jambes en l’air. Puis le roi dit au chauffeur : « Voyons, mon frère, il te faut absolument me demander quelque chose qui soit digne de toi et qui vaille vraiment la peine ! » Le chauffeur dit : « J’ai peur que tu ne puisses me l’accorder ! » Le roi dit : « Rien n’est impossible à Allah ! » Et le chauffeur dit : « Nomme-moi alors sultan de Damas, à la place du défunt prince Scharkân ! » Et le roi Daoul’makân répondit : « Sur mes yeux ! » Et à l’heure même il fit écrire la nomination du chauffeur comme sultan de Damas et lui donna, en tant que nouveau roi, le nom de Zablakân El-Moujahed. Puis il chargea le vizir Dandân d’accompagner le nouveau roi, avec un cortège magnifique, jusqu’à Damas, puis de revenir en ramenant de là-bas la fille du défunt prince Scharkân, Force-du-Destin. Et, avant le départ, il fit ses adieux au chauffeur et l’embrassa et lui recommanda d’être bon et juste envers ses nouveaux sujets ; puis il dit à tous les assistants : « Que tous ceux qui ont pour moi de l’affection et des égards, témoignent leur joie au sultan El-Zablakân par des cadeaux ! » Et aussitôt les présents affluèrent autour du nouveau roi que Daoul’makân revêtit lui-même de la robe royale ; et quand tous les préparatifs furent faits, le roi Daoul’makân lui donna, pour sa garde particulière, cinq mille jeunes mamalik et des porteurs chargés d’un palanquin royal rouge et or. Et c’est ainsi que le chauffeur du hammam, devenu le sultan El-Moujahed El-Zablakân, suivi de toute sa garde, du vizir Dandân, des émirs Rustem, Turkash et Bahramân, sortit de Baghdad et arriva à Damas, son royaume.
Or, le premier soin du nouveau roi fut de commander aussitôt un cortège splendide pour accompagner à Baghdad la jeune princesse de huit ans, Force-du-Destin, fille du défunt prince Scharkân ; et il mit à son service dix jeunes filles et dix jeunes nègres, et lui remit beaucoup de cadeaux et notamment de la pure essence de roses et des confitures d’abricots dans de grandes boîtes bien scellées contre l’humidité, sans oublier non plus les entrelacs délicieux, mais si fragiles qu’ils ne pourraient probablement arriver intacts jusqu’à Baghdad ; et il lui donna aussi vingt grands pots remplis de dattes cristallisées, liées par un sirop parfumé aux clous de girofle et vingt caisses de pâtisseries en feuilleté et vingt caisses de douceurs variées, commandées spécialement chez les meilleurs marchands de douceurs de Damas. Et le tout fit la charge de quarante chameaux, sans compter les grands ballots de soieries et d’étoffes d’or tissées par les plus habiles tisserands du pays de Scham, et les armes précieuses et les vases de cuivre et d’or repoussé et les broderies.
Puis, ces préparatifs étant terminés, le sultan El-Zablakân voulut également faire un riche cadeau en argent au vizir Dandân ; mais le vizir ne voulut point l’accepter, disant : « Ô roi, tu es encore nouveau dans ce royaume, et tu auras besoin de faire de cet argent meilleur usage qu’en me le donnant ! » Puis le convoi se mit en marche, par petites étapes ; et, au bout d’un mois, Allah leur écrivit la sécurité, et ils arrivèrent tous en bonne santé à Baghdad. Alors le roi Daoul’makân reçut la jeune Force-du-Destin avec des transports de joie et la remit aux mains de sa mère Nôzhatou et de l’époux de Nôzhatou, le grand-chambellan. Et il lui fit donner les mêmes maîtres qu’à Kanmakân ; et ces deux enfants devinrent ainsi inséparables et furent pris l’un pour l’autre d’une affection qui ne fit qu’augmenter avec l’âge. Et cet état de choses dura de la sorte l’espace de huit ans, pendant lesquels le roi Daoul’makân ne perdait pas de vue les armements et les préparatifs pour la guerre contre les Roum mécréants.
Mais, à la suite de toutes les fatigues et peines endurées pendent sa jeunesse perdue, le roi Daoul’makàn baissait tous les jours en forces et en santé. Et, son état ne faisant qu’empirer sensiblement, il fit appeler un jour le vizir Dandân et lui dit : « Ô mon vizir, je te fais venir pour te soumettre un projet que je désire réaliser. Réponds-moi donc en toute droiture ! » Le vizir dit : « Quoi donc, ô roi du temps ? » Il dit : « J’ai résolu d’abdiquer le pouvoir, de mon vivant, et de mettre à ma place, sur le trône, mon fils Kanmakân, et de me réjouir ainsi de le voir régner avec gloire, avant ma mort ! Qu’en penses-tu ? dis-le moi, ô mon vizir à l’âme saturée de sagesse ! »
À ces paroles, le vizir Dandân baisa la terre entre les mains du roi, et, la voix très émue, il lui dit : « Le projet que tu me soumets, ô roi fortuné, ô doué de prudence et d’équité, n’est point réalisable ni opportun, — pour deux motifs : le premier est que ton fils, le prince Kanmakân, est encore très jeune ; et le second est que c’est une chose certaine que le roi qui fait régner son fils de son vivant, a dès lors ses jours comptés sur le livre de l’ange ! » Mais le roi dit : « Pour ce qui est de ma vie, en vérité, je sens qu’elle est finie ; mais pour ce qui est de mon fils Kanmakân, puisqu’il est encore si jeune, je vais nommer comme son tuteur pour le règne le grand-chambellan, époux de ma sœur Nôzhatou ! »
Et aussitôt le roi fit assembler ses émirs, ses vizirs et tous les grands du royaume et nomma le grand-chambellan tuteur de son fils Kanmakân, et lui recommanda, comme recommandation suprême, de marier ensemble, à leur majorité, Force-du-Destin et Kanmakân. Et le grand-chambellan répondit : « Je suis l’accablé de tes bienfaits, et le plongé dans l’immensité de ta bonté ! « Alors le roi Daoul’makân se tourna vers son fils Kanmakân et lui dit, des larmes pleins les yeux : « Ô mon fils, sache qu’après ma mort le grand-chambellan sera ton tuteur et ton conseil, mais le grand-vizir Dandân sera ton père à ma place. Car voici que moi-même je me sens m’en aller de ce monde périssable vers la demeure éternelle. Mais je veux auparavant, ô mon fils, te dire qu’il me reste une seule chose à souhaiter sur la terre, avant de mourir : c’est la vengeance à tirer de celle qui fut la cause de la mort de ton grand-père le roi Omar Al-Némân et de ton oncle le prince Scharkân, la vieille de malheur et de malédiction qui a nom Mère-des-Calamités ! » Et le jeune Kanmakân répondit : « Aie l’âme en paix, ô père, Allah vous vengera tous par mon entremise ! » Alors le roi Daoul’makân sentit une grande sérénité lui rafraîchir l’âme, et il s’étendit plein de quiétude sur la couche d’où il ne devait plus se relever.
En effet, quelque temps après, le roi Daoul’makân, comme toute créature sous la main qui la créa, redevint ce qu’il avait été dans l’au-delà insondable : et il fut de lui comme s’il n’avait jamais été. Car le temps fauche tout et ne se souvient pas !
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, n’en dit pas davantage cette nuit-là.
LA CENT TRENTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… et il fut de lui comme s’il n’avait jamais été. Car le temps fauche tout et ne se souvient pas ! Et cela est pour que celui qui veut savoir la destinée de son nom dans le futur apprenne à regarder la destinée de ceux qui l’ont précédé dans la mort !
Et telle est l’histoire du roi Daoul’makân, fils du roi Omar Al-Némân et frère du prince Scharkân — qu’Allah les ait tous en sa miséricorde infinie !
Mais aussi c’est à partir de ce jour, et pour ne point démentir le proverbe qui dit : « Celui qui laisse une postérité, ne meurt pas ! » que commencèrent les Aventures du jeune Kanmakân, fils de Daoul’makân.
En effet, pour ce qui est du jeune Kanmakân et de sa cousine Force-du-Destin, ya Allah ! qu’ils étaient devenus beaux ! En grandissant, l’harmonie de leurs traits se fit plus exquise, et leurs perfections germèrent dans leur plénitude ; et on ne pouvait, en vérité, les comparer qu’à deux rameaux chargés de leurs fruits ou à deux lunes de splendeur. Et, pour parler de chacun d’eux en particulier, il faut dire que Force-du-Destin avait en elle tout ce qu’il fallait pour rendre fou : dans sa royale solitude, loin de tous les regards, la blancheur de son teint s’était faite sublime, sa taille était devenue mince, juste comme il fallait, et aussi droite que la lettre aleph ; ses hanches, absolument adorables dans leur massive lourdeur ; quant au goût de sa salive, ô lait ! ô vins ! ô douceurs ! qu’êtes-vous ? Et pour dire un mot de ses lèvres, de la couleur des grenades, vous, délices des fruits mûrs, parlez ! Mais quant à ses joues, ses joues ! les roses elles-mêmes avaient reconnu leur suprématie. Aussi qu’elles sont vraies ces paroles du poète à son égard :
Enivre-toi, mon cœur ! Dansez de joie dans vos orbites, ô mes yeux ! La voici ! Elle fait les délices de Celui même qui l’a créée !
Ses paupières défient le kohl de les rendre plus brunes. Aïe ! aïe ! je sens leurs regards me transpercer le cœur aussi sûrement que si c’était le glaive de l’émir des Croyants.
Ah ! ah ! quand je goûte ses lèvres ! Ô jus qui coules des raisins mûrs avant qu’on ne les presse ! Et toi, sirop qui filtres sous le pressoir de ses perles !…
Quant à vous, palmiers qui secouez sous la brise les grappes pendantes de vos cheveux, voici sa chevelure !
Telle était la jeune princesse Force-du-Destin, fille de Nôzhatou. Mais, pour ce qui est de son cousin le jeune Kanmakân, c’était encore bien autre chose. Les exercices et la chasse, l’équitation et les joutes à la lance et au javelot, le tir à l’arc et les courses de chevaux avaient assoupli son corps et aguerri son âme ; et il était devenu le plus beau cavalier des pays musulmans, et le plus courageux d’entre les guerriers des villes et des tribus. Et, avec tout cela, son teint était resté aussi frais que celui d’une vierge, et sa figure plus jolie à voir que les roses et les narcisses ; comme dit le poète à son sujet :
À peine circoncis, la soie légère amoureusement duveta la douceur de son menton, pour, avec l’âge, ombrager ses joues d’un velours noir au tissu très serré.
Aux yeux réjouis de ceux qui le regardaient, il était tel le faon qui esquisse une danse derrière les pas de sa mère.
Aux âmes attentives qui le suivaient, ses joues s’offraient dispensatrices de l’ivresse, ses joues où tendrement circulait la rougeur d’un sang aussi délicat que le miel naturel de sa salive.
Mais moi, qui consacrais ma vie à l’adoration de ses charmes, ce qui me ravissait l’âme, c’était surtout la couleur verte de son caleçon.
Mais il faut savoir que, depuis déjà un certain temps, le grand-chambellan, tuteur de Kanmakân, malgré toutes les remontrances de son épouse Nôzhatou, et tous les bienfaits dont il était redevable au père de Kanmakân, avait fini par s’emparer complètement du pouvoir et s’était même fait proclamer successeur de Daoul’makân par une partie du peuple et de l’armée. Quant à l’autre partie du peuple et de l’armée, elle était restée fidèle au nom et au descendant d’Omar Al-Némân, et était dirigée dans son devoir par le vieux vizir Dandân. Mais le vizir Dandân, devant les menaces du grand-chambellan, avait fini par s’éloigner de Baghdad, et s’était retiré dans une ville du voisinage, attendant que la destinée se tournât du côté de l’orphelin frustré de ses droits.
Aussi le grand-chambellan, n’ayant plus rien à craindre de personne, avait forcé Kanmakân et sa mère à s’enfermer dans leurs appartements, et avait même défendu à sa fille Force-du-Destin d’avoir désormais des relations avec le fils de Daoul’makân. Et de la sorte la mère et le fils vivaient dans la retraite, attendant qu’Allah voulût bien rendre son droit à qui de droit.
Mais tout de même, malgré la surveillance du grand-chambellan, Kanmakân pouvait des fois voir sa cousine Force-du-Destin, et lui parler, mais en cachette seulement. Or, un jour qu’il ne pouvait la voir, et que l’amour lui torturait le cœur plus que de coutume, il prit une feuille de papier et écrivit à
son amie ces vers passionnés :« Tu marchais, ô bien-aimée, au milieu de tes femmes, toute baignée dans ta beauté ! Les roses, à ton passage, séchaient d’envie sur leurs tiges, en se comparant à leurs sœurs sur tes joues ;
« Les lis clignaient de l’œil devant le grain de ta blancheur ; et les camomilles en fleurs souriaient du sourire de tes dents.
« Ah ! quand verrai-je mon exil finir et mon cœur guérir des douleurs de l’absence, pour que mes lèvres heureuses se rapprochent enfin de celles de ma bien-aimée ?
« Ah ! pourrai-je enfin connaître si l’union nous est possible, ne fût-ce qu’une nuit, et voir si tu peux éprouver un peu des sensations dont déborde tout mon être ?
« Et qu’Allah me fasse patienter sur mon mal, comme le malade supporte le cautère, en vue de la guérison ! »
Et, ayant cacheté la lettre, il la remit à l’eunuque de service, dont le premier soin fut de la donner en mains propres au grand-chambellan. Aussi à la lecture de cette déclaration, le grand-chambellan écuma et tempêta et jura qu’il allait châtier le jeune insolent. Mais bientôt il songea qu’il valait mieux, pour ne point ébruiter l’affaire, n’en parler seulement qu’à son épouse Nôzhatou. Il alla donc trouver Nôzhatou dans son appartement et, après avoir congédié la jeune Force-du-Destin, en lui disant d’aller respirer l’air dans le jardin, il dit à son épouse…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT TRENTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Le grand-chambellan dit à son épouse Nôzhatou : « Tu dois savoir que le jeune Kanmakân a depuis longtemps atteint l’âge de la puberté, et qu’il se sent porté à s’essayer sur ta fille Force-du-Destin. Il faut donc les séparer désormais sans espoir de rencontre, car il est fort dangereux d’approcher le bois de la flamme. Désormais il ne faut plus que ta fille puisse sortir de l’appartement des femmes ou se découvrir le visage : car elle n’est plus dans l’âge où les filles peuvent sortir découvertes ! Et surtout prends bien garde de leur permettre à tous deux de communiquer, car je suis disposé, au moindre motif, à empêcher à jamais le jeune homme de se laisser aller aux instincts de sa perversité ! »
À ces paroles, Nôzhatou ne put s’empêcher de pleurer et, une fois son époux parti, elle alla trouver son neveu Kanmakân et le mit au courant de la colère du grand-chambellan. Puis elle lui dit : « Sache pourtant, ô fils de mon frère, que je pourrai quelquefois te ménager des rencontres secrètes avec Force-du-Destin, mais à travers la porte seulement ! Sois donc patient jusqu’à ce qu’Allah te prenne en compassion ! » Mais Kanmakân sentit toute son âme se bouleverser à cette nouvelle et s’écria : « Je ne vivrai point un moment de plus dans un palais où je devrais seul commander ! Et je ne souffrirai plus désormais que les pierres de la maison abritent mes humiliations ! Puis sur-le-champ il se dévêtit de ses habits, se couvrit la tête d’un bonnet de saâlouk, jeta sur ses épaules un vieux manteau de nomade et, sans prendre le temps de faire ses adieux à sa mère et à sa tante, il se dirigea en toute hâte vers les portes de la ville, n’ayant dans son sac, pour toute provision de route, qu’un seul pain, vieux de trois jours. Et lorsque les portes de la ville furent ouvertes, il fut le premier à les franchir ; et il s’éloigna à grands pas en se récitant ces strophes en guise d’adieu à tout ce qu’il venait de quitter :
« Je ne te crains plus, ô mon cœur ; tu peux battre et te rompre même dans ma poitrine, mes yeux ne sauront plus s’attendrir, et en mon âme la pitié ne saura trouver de place.
Cœur alourdi par l’amour, ma volonté, malgré toi, ne fléchira pas et n’acceptera plus d’humiliation, mon corps dût-il fondre en entier de ma sévérité.
Excuse-moi ! à prendre pitié de toi, mon cœur, que deviendrait mon énergie ? Celui qui se laisse détourner par les yeux ardents n’a point ensuite à se plaindre de tomber blessé à mort.
Je veux parcourir par bonds sauvages la terre sans bornes, la bonne terre large et maternelle à qui vagabonde, pour sauver mon âme unique de tout ce qui pourrait abolir sa vigueur !
Je combattrai les héros et les tribus ; je m’enrichirai du butin fait sur tous mes vaincus ; et, puissant désormais de ma gloire et de ma vigueur, je reviendrai ; et toutes les portes s’ouvriront seules !
Car sache-le bien, cœur naïf, pour avoir les cornes précieuses de la bête, il faudra d’abord dompter la bête ou la tuer ! »
Or, pendant que le jeune Kanmakân fuyait ainsi sa ville et ses parents, sa mère, ne l’ayant plus vu de la journée, le chercha partout sans résultat. Alors elle s’assit à pleurer et attendit son retour en proie aux pensées les plus torturantes. Mais le second, puis le troisième et le quatrième jour passèrent, sans que personne eût des nouvelles de Kanmakân. Alors sa mère s’enferma dans son appartement, à pleurer, à se lamenter et à dire du plus profond de sa douleur : « Ô mon enfant, de quel côté t’appeler ? Vers quel pays courir te chercher ? Et que peuvent maintenant ces larmes que je verse sur toi, mon enfant ? Où es-tu ? Où es-tu, ô Kanmakân ? » Puis la pauvre mère ne voulut plus ni boire ni manger ; et son deuil fut connu de toute la ville et partagé par tous les habitants, qui aimaient le jeune homme et aimaient son défunt père. Et tous s’écriaient : « Où es-tu, ô pauvre Daoul’makân, ô roi qui avais été si juste et si bon pour ton peuple ? Voici que ton fils est perdu, et nul de ceux que tu as comblés de tes bienfaits ne sait retrouver ses traces ! Ah ! pauvre postérité d’Omar Al-Némân, qu’es-tu devenue ? »
Mais pour ce qui est de Kanmakân, il se mit à marcher tout le long du jour, et ne se reposa qu’à la nuit noire. Et le lendemain et les jours suivants il continua à voyager, en se nourrissant des plantes qu’il ramassait et en buvant l’eau des sources et des ruisseaux. Et au bout de quatre jours il arriva dans une vallée couverte de forêts, et où couraient des eaux vives et où chantaient les oiseaux et les ramiers. Alors il s’arrêta, fit ses ablutions selon le rite, puis sa prière ; et, ayant ainsi accompli les devoirs prescrits, comme la nuit venait, il s’étendit sous un grand arbre et s’endormit. Et il resta ainsi endormi jusqu’à minuit. Alors, au milieu du silence de la vallée, une voix fusa, sortant des rochers d’alentour, qui le réveilla. Elle chantait :
« Vie de l’homme ! que vaudrais-tu sans l’éclair du sourire sur les lèvres de l’aimée, sans le baume de son visage tranquille ?
Ô mort ! tu serais désirable si mes jours devaient s’écouler toujours loin de l’amie que ne sauraient me faire oublier ni les menaces ni l’exil !
Ô joie des amis réunis sur la prairie à boire les vins exquis des mains de l’échanson ! ô leur joie si les brûle la passion quand ils prennent la coupe des mains de l’échanson.
Printemps ! tes fleurs, aux côtés de la bien-aimée, me guérissent l’âme des duretés passées du sort aveugle ! Ô printemps, tes fleurs sur la prairie…
Et toi, ami, qui bois la liqueur rousse et parfumée, regarde ! sous ta main s’étend une terre joyeuse de ses eaux, de ses couleurs et de sa fécondité ! »
À ce chant admirable qui montait ainsi dans la nuit, Kanmakân se leva, transporté, et essaya de percer les ténèbres du côté d’où lui arrivait la voix ; mais il ne put distinguer d’autres formes que les troncs vagues des arbres au-dessus de la rivière qui coulait au fond de la vallée. Alors il marcha un peu dans la même direction et descendit ainsi jusque sur les bords mêmes de la rivière. Et la voix devint plus distincte et plus émue en chantant ce poème dans la nuit :
« Entre elle et moi il y a des serments d’amour. Et c’est pourquoi j’ai pu la laisser dans la tribu !
Ma tribu dans le désert est la plus riche en chevaux parfaits et en filles aux yeux noirs. C’est la tribu de Taïm.
Brise ! ton souffle m’arrive de chez les Bani-Taïm ! Elle pacifie mon foie et m’enivre à l’extrême.
Dis-moi, esclave Saâd, celle dont la cheville est cerclée du grelot sonore se souvient-elle parfois de nos serments d’amour, et que dit-elle ?
Ah ! pulpe de mon cœur, un scorpion t’a piquée. Viens, amie ! Je guérirai, de l’antidote de tes lèvres, en humant leur salive et ta fraîcheur ! »
Lorsque Kanmakân eut entendu pour la seconde fois ce chant de l’invisible, il essaya encore de voir dans les ténèbres ; mais comme il ne put y réussir, il monta sur le sommet d’un rocher et, de toute sa voix, il clama…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT QUARANTIÈME NUIT
Elle dit :
… il monta sur le sommet d’un rocher et, de toute sa voix, il clama : « Ô passant dans les ténèbres de la nuit, de grâce ! rapproche-toi d’ici que j’entende ton histoire qui doit ressembler à mon histoire. Et nous essaierons de nous distraire mutuellement ! » Puis il se tut.
Au bout de quelques instants, la voix qui avait chanté répondit : « Ô toi qui m’appelles, qui donc es-tu ? Es-tu homme de la terre ou génie souterrain ? Si tu es un génie, continue ton chemin ! Mais, si tu es un homme, attends ici l’apparition de la lumière ! Car la nuit est pleine d’embûches et de trahisons ! »
À ces paroles, Kanmakân se dit en lui-même : « Sûrement, le propriétaire de la voix est un homme dont l’aventure ressemble étrangement à la mienne ! » Puis il resta sans plus bouger jusqu’à l’apparition du matin.
Or, il vit s’avancer vers lui, à travers les arbres de la forêt, un homme vêtu comme les Bédouins du désert, grand et armé d’un glaive et d’un bouclier ; et il se leva et le salua ; et le Bédouin lui rendit son salut, et, après les formules d’usage, le Bédouin lui demanda, étonné de son jeune âge : « Ô jeune homme que je ne connais pas, qui donc es-tu ? À quelle tribu appartiens-tu ? Et quels sont tes parents chez les Arabes ? En vérité tu es d’un âge où l’on ne voyage pas seul dans la nuit et dans les contrées où l’on ne voit que troupes armées. Raconte-moi donc ton histoire. » Kanmakân dit : « Mon grand-père était le roi Omar Al-Némân ; mon père, le roi Daoul’makân, et je suis moi-même Kanmakân qui brûle d’amour pour sa cousine la princesse Force-du-Destin ! » Alors le Bédouin lui dit : « Mais comment se fait-il qu’étant roi fils de rois, tu sois habillé comme un saâlouk et voyages sans une escorte digne de ton rang ? » Il répondit : « Je me ferai désormais mon escorte moi-même, et je commencerai par te prier d’être le premier à en faire partie ! » À ces paroles, le Bédouin se mit à rire et lui dit : « Tu parles, ô jeune garçon, comme si tu étais déjà un guerrier accompli ou un héros illustré dans vingt combats ! Or, pour te démontrer ton insuffisance, je vais à l’instant m’emparer de toi pour que tu me serves comme esclave ! Et alors, si vraiment tes parents sont des rois, ils seront assez riches pour payer ta rançon ! » Et Kanmakân sentit la fureur lui jaillir des paupières et il dit au Bédouin : « Par Allah ! nul ne paiera ma rançon que moi-même ! Garde à toi, ô Bédouin ! À entendre tes vers, je t’avais cru doué de manières exquises… »
Et Kanmakân s’élança sur le Bédouin qui, pensant ne faire qu’un jeu de cet enfant, l’attendait en souriant. Mais comme il le pensait à tort ! En effet, Kanmakân, dans un corps-à-corps avec le Bédouin, se campa solidement en terre, sur des jambes plus solides que des montagnes et plus d’aplomb que des minarets. Puis, s’étant bien consolidé en s’appuyant, il serra contre lui le Bédouin à lui faire craquer les ossements et à lui vider les entrailles ! Et soudain il le souleva de terre dans ses bras, et, ainsi chargé, il courut à grands pas vers la rivière. Alors le Bédouin, qui n’avait pas encore eu le temps de revenir de l’effarement de voir tout à coup se révéler une telle force chez cet enfant, s’écria : « Que vas-tu faire ainsi, me transportant vers l’eau du courant ? » Et Kanmakân répondit : « Je vais te précipiter dans ce courant qui te portera jusqu’au Tigre ; le Tigre te portera jusqu’au Nahr-Issa ; le Nahr-Issa te portera jusqu’à l’Euphrate ; et l’Euphrate alors te conduira jusque vers ta tribu ! Et alors ceux de la tribu jugeront de ta vaillance et de ton héroïsme, ô Bédouin ! » Et le Bédouin, devant le danger pressant, au moment où Kanmakân le soulevait plus en l’air pour le jeter dans la rivière, s’écria : « Ô jeune héros, je t’adjure par les yeux de ton amoureuse Force-du-Destin de m’accorder la vie sauve ! Et désormais je serai le plus soumis de tes esclaves ! » Et aussitôt Kanmakân recula vivement et le déposa à terre doucement en lui disant : « Tu m’as désarmé par ce serment ! » Et ils s’assirent tous deux sur le bord du courant et le Bédouin tira de sa besace un pain d’orge qu’il rompit et dont il donna la moitié à Kanmakân avec aussi un peu de sel : et leur amitié désormais se consolida sincèrement. Alors Kanmakân lui demanda : « Compagnon, maintenant que tu sais qui je suis, veux-tu me dire toi-même ton nom et celui de tes parents ? » Et le Bédouin dit :
« Je suis Sabah ben-Remah ben-Hemam de la tribu de Taïm, dans le désert de Scham. Et voici, en peu de mots, mon histoire :
« J’étais encore en très bas âge quand mon père mourut. Et je fus recueilli par mon oncle et élevé dans sa maison en même temps que sa fille Nejma. Or, j’ai aimé Nejma, et Nejma également m’aima. Et lorsque je fus en âge de me marier, je la voulus pour épouse ; mais son père, me voyant pauvre et sans ressources, ne voulut point consentir à notre mariage. Pourtant, devant les remontrances des principaux cheikhs de la tribu, mon oncle voulut bien me promettre Nejma comme épouse, mais à condition de lui constituer une dot composée de cinquante chevaux, cinquante chamelles de race, dix esclaves femmes, cinquante charges de blé et cinquante charges d’orge, et plutôt plus que moins. Alors, moi je jugeai que la seule façon de constituer cette dot de Nejma était de sortir de ma tribu et d’aller au loin attaquer les marchands et piller les caravanes. Et telle est la cause de mon séjour, cette nuit, dans l’endroit où tu m’as entendu chanter. Mais, ô compagnon, qu’est ce chant si tu le comparais à la beauté de Nejma ! Car, qui voit seulement Nejma une fois dans la vie, se sent l’âme pleine de bénédiction et de bonheur pour le restant de ses jours ! » Et, ayant dit ces paroles, le Bédouin se tut.
Alors Kanmakân lui dit : « Je savais bien, compagnon, que ton histoire devait ressembler à la mienne ! Aussi désormais nous allons combattre côte à côte et gagner nos amantes avec le fruit de nos exploits ! »
Et, comme il venait de terminer ces mots, une poussière s’éleva dans le loin pour se rapprocher rapidement ; et, une fois dissipée, devant eux apparut un cavalier dont le visage était jaune comme celui d’un mourant, et dont les habits étaient imprégnés de sang, et il s’écria : « Ô Croyants, un peu d’eau pour laver ma blessure ! Et soutenez-moi, car je vais rendre l’âme ! Secourez-moi et, si je meurs, mon cheval vous appartient ! » Et, en effet, le cheval que montait le cavalier n’avait pas son égal parmi tous les chevaux des tribus, et sa beauté rendait perplexes tous ceux qui le regardaient, car il atteignait à la perfection des qualités requises d’un cheval du désert. Et le Bédouin, qui se connaissait en chevaux comme tous ceux de sa race, s’écria : « En vérité, ô cavalier, ton cheval est un de ceux qu’on ne voit plus en ce temps ! » Et Kanmakân lui dit : « Mais, ô cavalier, tends-moi le bras que je t’aide à descendre ! » Et il prit le cavalier, qui se sentait s’en aller, et le déposa doucement sur le gazon, et lui dit : « Mais qu’as-tu donc, frère, et quelle est cette blessure ? » Et le Bédouin entr’ouvrit son vêtement et montra son dos qui n’était plus qu’une plaie énorme d’où le sang s’échappait à flots. Alors Kanmakân s’accroupit près du blessé et lui lava attentivement ses blessures, et les recouvrit doucement d’herbe fraîche ; puis il donna à boire au mourant et lui dit : « Mais qui donc t’a mis en cet état, ô frère d’infortune ? » Et l’homme dit :
« Sache, ô toi à la main secourable, que le cheval que tu vois là dans sa beauté est la cause qui m’a mis dans cet état. Ce cheval était la propriété du roi Aphridonios lui-même, maître de Constantinia ; et sa réputation nous était connue à tous, nous les Arabes du désert. Or, un cheval de cette sorte ne doit pas rester dans les écuries d’un roi mécréant ; et, pour l’enlever au milieu des gardes qui le soignaient et le veillaient jour et nuit, je fus désigné par ceux de ma tribu. Et je partis aussitôt et j’arrivai de nuit sous la tente où était gardé le cheval, et je liai connaissance avec ses gardiens ; puis je profitai du moment où ils me demandaient mon avis sur ses perfections et me priaient de l’essayer, pour l’enfourcher d’un bond et, d’un coup de fouet, l’enlever au galop. Alors les gardes, leur surprise passée, me poursuivirent sur leurs chevaux en me lançant des flèches et des javelots, dont plusieurs, comme tu le vois, m’ont atteint dans le dos. Mais le cheval m’emportait toujours plus rapide que l’étoile filante, et il finit par me mettre totalement hors de leur portée. Et voici trois jours que je suis sur son dos, sans arrêt ! Mais mon sang s’est écoulé, et mes forces se sont en allées ; et je sens la mort me fermer les paupières !
« Aussi, puisque tu m’as secouru, le cheval, à ma mort, doit te revenir. Il est connu sous le nom d’El-Kâtoul El-Majnoun, et c’est le plus beau spécimen de la race d’El-Ajouz !
« Mais auparavant, ô jeune homme dont les habits sont si pauvres et le visage si noble, rends-moi le service de me prendre derrière toi sur le cheval et de me transporter au milieu de ma tribu, pour que je meure sous la tente où je suis né ! »
À ces paroles, Kanmakân lui dit : « Ô frère du désert, j’appartiens, moi aussi, à une lignée où la noblesse et la bonté sont coutumes. Or, je suis prêt, même si le cheval ne devait pas me revenir, à te rendre le service demandé ! » Et il s’approcha de l’Arabe pour le soulever ; mais l’Arabe poussa un grand soupir et dit : « Attends encore un peu ! Peut-être que mon âme va sortir sur l’heure ! Je vais témoigner de ma foi ! » Alors il ferma les yeux à demi, étendit la main, en tournant la paume vers le ciel, et dit :
« Je témoigne qu’il n’y a d’autre Dieu qu’Allah. Et je témoigne que notre seigneur Mohammad est l’Envoyé d’Allah ! »
Puis, s’étant ainsi préparé à la mort, il entonna ce chant, qui fut ses dernières paroles :
« J’ai parcouru le monde au galop de mon cheval, semant sur ma route la terreur et le carnage. Torrents et montagnes, je les ai franchis pour le vol, le meurtre et la débauche.
Je meurs comme j’ai vécu, errant le long des routes, blessé par ceux-là mêmes que j’ai vaincus ! Et le fruit de mes peines, je l’abandonne, sur le bord d’un torrent, si loin du ciel natal !
Et pourtant sache, ô toi, étranger qui hérites du seul trésor du Bédouin, que mon regret avec mon âme s’envolerait si j’étais sûr que Kâtoul, mon coursier, ait en toi un cavalier digne de sa beauté ! »
Et à peine l’Arabe eut-il fini ce chant qu’il ouvrit convulsivement la bouche, poussa un râle profond et ferma les yeux pour toujours.
Alors Kanmakân et son compagnon, après avoir creusé une fosse où ils enterrèrent le mort, après les prières d’usage, partirent ensemble voir leur destinée sur le chemin d’Allah.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et remit au lendemain la suite de son récit.
LA CENT QUARANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… voir leur destinée sur le chemin d’Allah. Et Kanmakân avait enfourché son nouveau cheval Kâtoul, et le Bédouin Sabah s’était contenté de le suivre fidèlement à pied, car il lui avait juré amitié et soumission et l’avait reconnu à jamais pour son maître en faisant le serment sur le temple saint de la Kaâba, la maison d’Allah !
Alors commença pour eux une vie pleine d’exploits et d’aventures, de luttes contre les bêtes et de combats contre les brigands, de chasses et de voyages, de nuits passées à l’affût des animaux sauvages et de jours à guerroyer contre les tribus et à amasser du butin. Et ils amassèrent de la sorte, au prix de bien des périls, une quantité incalculable de bestiaux avec leurs gardiens, de chevaux avec les esclaves et de tentes avec leurs tapis. Et Kanmakân avait chargé son compagnon Sabah de la surveillance générale de toutes leurs acquisitions, qu’ils poussaient partout devant eux dans leurs incursions continuelles. Et, quand ils s’asseyaient tous deux pour le repos, ils ne manquaient pas de se raconter mutuellement leurs peines et leurs espoirs d’amour, en parlant l’un de sa cousine Force-du-Destin et l’autre de sa cousine Nejma. Et cette vie dura de la sorte l’espace de deux ans. Et voici, entre mille, l’un des exploits du jeune Kanmakân.
Un jour, Kanmakân, sur son cheval Kâtoul, marchait à l’aventure, précédé par son fidèle Sabah. Celui-ci ouvrait la marche, une épée nue à la main, et poussait de temps en temps des cris terribles en ouvrant des yeux comme des cavernes et en hurlant, bien que la solitude fût absolue dans le désert : « Hoh ! ouvrez la route ! Droite ! Gauche ! » Et ils venaient de terminer un repas où ils avaient mangé, à eux deux, une gazelle à la broche et bu d’une eau de source fraîche et légère. Au bout d’un certain temps, ils arrivèrent à une éminence au pied de laquelle s’étendait un pâtis couvert de chamelles et de chameaux, de moutons, de vaches et de chevaux ; et, plus loin, sous une tente, des esclaves armés étaient accroupis tranquillement. À cette vue, Kanmakân dit à Sabah : « Reste là ! Je vais à moi seul m’emparer de tout le troupeau, ainsi que des esclaves. » Et, ayant dit ces paroles, il fondit au galop de son coursier du haut de la colline, comme le tonnerre soudain d’un nuage qui crève, et se précipita sur les gens et les bêtes en entonnant cet hymne guerrier :
« Nous sommes de la race d’Omar Al-Némân, des hommes aux grands desseins, des héros.
Nous sommes les seigneurs qui frappons au cœur les tribus hostiles, quand se lève le jour du combat.
Nous protégeons les faibles contre les puissants, et nous nous servons de la tête des vaincus pour l’ornement de nos lances.
Gare à vos têtes, ô vous tous, voici les héros ! ceux aux grands desseins, ceux de la race d’Omar Al-Némân ! »
À cette vue, les esclaves terrifiés se mirent à lancer de grands cris, en appelant au secours, croyant que tous les Arabes du désert les attaquaient à l’improviste. Alors sortirent des tentes trois guerriers qui étaient les maîtres des troupeaux ; ils sautèrent sur leurs chevaux et se précipitèrent à la rencontre de Kanmakân, en s’écriant : « C’est le voleur du cheval Kâtoul ! Nous le tenons enfin ! Sus au voleur ! » À ces paroles, Kanmakân leur cria : « C’est, en effet, Kâtoul lui-même, mais les voleurs c’est vous, ô fils de putains ! » Et il se pencha près des oreilles de Kâtoul en lui parlant pour l’encourager ; et Kâtoul bondit comme un ogre sur une proie ; et Kanmakân, de sa lance, ne se fit qu’un jeu de la victoire ; car, dès la première passe, il enfonça la pointe de son arme dans le ventre du premier qui se présenta, et la fit sortir de l’autre côté avec un rognon au bout. Puis il fit subir le même sort aux deux autres cavaliers : et, de l’autre côté de leur dos, un rognon ornait la perforante lance. Puis il se tourna du côté des esclaves. Mais lorsque ceux-ci eurent vu le sort subi par leurs maîtres, ils se précipitèrent la face contre terre, demandant la vie sauve. Et Kanmakân leur dit : « Allez ! et, sans perdre de temps, poussez devant moi ces troupeaux et conduisez-les à tel endroit où se trouvent ma tente et mes esclaves ! » Et, poussant devant lui bêtes et esclaves, il continua sa route, rejoint bientôt par son compagnon Sabah qui, suivant les ordres reçus, n’avait pas bougé de son poste durant le combat.
Or, pendant qu’ils cheminaient de la sorte avec, au-devant d’eux, les esclaves et le troupeau, ils virent soudain s’élever une poussière qui, dissipée, laissa apparaître cent cavaliers armés selon le mode des Roum de Constantinia. Alors Kanmakân dit à Sabah : « Surveille les troupeaux et les esclaves et laisse-moi agir seul contre ces mécréants ! » Et le Bédouin aussitôt se retira plus loin, derrière une colline, ne s’occupant que de la garde ordonnée. Et seul Kanmakân s’élança au-devant des cavaliers Roum, qui aussitôt l’enveloppèrent de toutes parts ; alors leur chef, s’étant avancé vers lui, dit : « Qui donc es-tu, ô jeune fille charmante qui sais si bien tenir les rênes d’un cheval de bataille, alors que tes yeux sont si tendres et tes joues si lisses et fleuries ? Approche-toi que je te baise sur les lèvres ; et nous verrons ensuite. Viens ! Et je te ferai reine de toutes les terres où se promènent les tribus ! »
À ces paroles Kanmakân sentit une grande honte lui monter au visage et s’écria : « À qui donc penses-tu parler, ô chien, fils de chien ? Si mes joues n’ont point de poils, mon bras, que tu vas sentir, te prouvera l’erreur de ta grossièreté, ô Roumi aveugle et qui ne sais distinguer les guerriers d’avec les jeunes filles ! » Alors le chef des cent s’avança plus près de Kanmakân et constata, en effet, que, malgré la douceur et la blancheur de son teint et le velouté de ses joues vierges de poils rugueux, c’était, à en juger par la flamme de ses yeux, un guerrier point facile à dompter.
Alors le chef des cent cria à Kanmakân : « À qui donc appartient ce troupeau ? Et où vas-tu toi-même ainsi, plein d’insolence et de bravade ? Livre-toi à discrétion, ou tu es mort ! » Puis il ordonna à l’un de ses cavaliers de s’approcher du jeune homme et de le faire prisonnier. Mais à peine le cavalier était-il arrivé près de Kanmakân, que, d’un seul coup de son glaive, Kanmakân lui coupa en deux le turban, la tête, le corps, ainsi que la selle et le ventre du cheval. Puis le deuxième cavalier qui s’avança et le troisième et le quatrième subirent exactement le même sort.
À cette vue, le chef des cent ordonna à ses cavaliers de se retirer et s’avança plus près de Kanmakân et lui cria : « Ta jeunesse est très belle, ô guerrier, et ta vaillance l’égale ! Or, moi, Kahroudash, dont l’héroïsme est réputé dans tous les pays des Roum, je veux, à cause même de ton courage, t’accorder la vie sauve ! Retire-toi donc en paix, car je te pardonne la mort de mes hommes, pour ta beauté ! » Mais Kanmakân lui cria : « Que tu sois Kahroudash, cela ne peut m’intéresser ! Ce qui importe, c’est que tu laisses de côté toutes ces paroles et que tu viennes éprouver la pointe de ma lance. Et sache aussi, puisque tu t’appelles Kahroudash, que, moi, je suis Kanmakân ben-Daoul’makân ben-Omar Al-Némân ! » Alors le chrétien lui dit : « Ô fils de Daoul’makân, j’ai connu dans les batailles la vaillance de ton père ! Or, toi, tu as su unir la force de ton père à une élégance parfaite ! Retire-toi donc, en emportant tout ton butin. C’est mon plaisir ! » Mais Kanmakân lui cria : « Ce n’est point ma coutume, ô chrétien, de faire tourner bride à mon cheval ! Garde à toi ! » Il dit, et caressa son cheval Kâtoul qui comprit le désir de son maître et, baissant les oreilles et relevant la queue, s’élança. Et alors luttèrent les deux guerriers, et les chevaux s’entrechoquèrent comme deux béliers s’entrecornant ou deux taureaux s’entr’éventrant. Et plusieurs passes terribles restèrent sans résultat. Puis soudain Kahroudash, de toute sa force, poussa sa lance contre la poitrine de Kanmakân ; mais celui-ci, d’une volte rapide de son cheval, sut l’éviter à temps et, se tournant brusquement, détendit son bras, la lance en avant. Et du coup il perfora le ventre du chrétien en faisant sortir par son dos le fer reluisant. Et Kahroudash cessa à jamais de compter au nombre des guerriers mécréants !
À cette vue, les cavaliers de Kahroudash se confièrent à la rapidité de leurs chevaux et disparurent au loin dans la poussière, qui les masqua.
Alors Kanmakân, essuyant sa lance sur les corps étendus, continua sa route en faisant signe à Sabah de pousser en avant les troupeaux et les esclaves.
Or, c’est justement après cet exploit que Kanmakân rencontra la négresse errante du désert, qui racontait, de tribu en tribu, des histoires sous la tente et des contes sous les étoiles. Et Kanmakân, qui en avait si souvent entendu parler, la pria de s’arrêter se reposer sous sa tente et de lui raconter quelque chose qui lui fit passer le temps et lui réjouit l’esprit en lui dilatant le cœur. Et la vieille errante répondit : « Avec amitié et respect ! » Puis elle s’assit à côté de lui, sur la natte, et lui raconta cette Histoire du Mangeur de haschisch :
« Sache que la chose la plus délicieuse dont mon oreille se soit réjouie, ô mon jeune seigneur, est cette histoire qui m’est parvenue d’un haschasch d’entre les haschaschîn !
« Il y avait un homme qui adorait la chair des vierges…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT QUARANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« Il y avait un homme qui adorait la chair des vierges et dont c’était le seul souci. Aussi, comme cette chair est d’un prix très élevé, surtout quand elle est choisie et sur commande, et comme nulle fortune ne peut résister indéfiniment quand les goûts de son propriétaire sont si coûteux, l’homme en question, qui ne prenait jamais de repos à ce sujet et se laissait ainsi aller à l’intempérance de ses désirs, — car en toute chose il n’y a que l’excès qui soit répréhensible — finit par se ruiner complètement.
« Or, un jour que, vêtu d’habits sordides et pieds nus, il marchait dans le souk en mendiant son pain pour s’en nourrir, un clou lui entra dans la plante du pied et fit couler son sang avec abondance. Alors il s’assit par terre, essaya d’étancher le sang et finit par bander son pied avec un morceau de chiffon. Mais, comme le sang continuait à couler, il se dit : « Allons au hammam nous laver le pied et le plonger dans l’eau : cela lui fera du bien. » Et il alla au hammam et entra dans la salle commune où vont les pauvres gens, mais qui tout de même était exquise de propreté et reluisait à charmer, et il s’accroupit sur le bassin central et se mit à se laver le pied.
« Or, à côté de lui, un homme était assis qui avait fini de prendre son bain et qui mâchait quelque chose entre les dents. Et notre blessé fut très excité par la mastication de l’autre, et l’envie le prit ardemment de mastiquer aussi de ce quelque chose. Alors il demanda à l’autre : « Que mâches-tu ainsi, mon voisin ? » Il répondit à voix basse, pour que personne ne l’entendit : « Tais-toi ! C’est du haschisch ! Si tu veux, je vais t’en donner un morceau. » Il dit : « Certes ! j’en voudrais goûter, depuis le temps que je le souhaite ! » Alors l’homme qui mastiquait, retira un morceau de sa bouche et le donna au blessé en lui disant : « Puisses-tu t’alléger de tous tes soucis ! » Et notre homme prit le morceau et le mâcha et l’avala en entier. Et, comme il n’était pas habitué au haschisch, bientôt, quand l’effet se fut produit dans son cerveau par la circulation de la drogue, il entra d’abord dans une hilarité extraordinaire et lança dans toute la salle des éclats énormes de rire ! Puis il s’affaissa, un instant après, sur le marbre nu et fut la proie d’hallucinations diverses dont voici l’une des plus délicieuses :
« Il crut d’abord être tout nu sous la domination des mains d’un terrible masseur et de deux nègres vigoureux qui s’étaient complètement emparés de son individu ; et il se voyait comme un jouet entre leurs mains ; ils le tournaient et le manipulaient dans tous les sens en lui enfonçant dans les chairs leurs doigts noueux, mais experts infiniment ; et il geignait sous le poids de leurs genoux quand ils s’appuyaient sur son ventre pour le lui masser avec art. Après cela ils le lavèrent à grand renfort de bassins de cuivre et de frottements avec des fibres végétales ; puis le grand masseur voulut lui laver lui-même certaines parties délicates de son individu, mais, comme ça le chatouillait fort, il dit : « Je ferai la chose moi-même ! » Puis, le bain terminé, le grand masseur lui entoura la tête, les épaules et les reins de trois foulards aussi blancs que le jasmin et lui dit : « Maintenant, seigneur, c’est le moment d’entrer chez ton épouse qui t’attend : » Mais il s’écria : « Quelle épouse, ô masseur ? Je suis célibataire ! Aurais-tu par hasard mangé du haschisch pour ainsi radoter ? » Mais le masseur lui dit. « Ne plaisante donc pas de la sorte ! Allons chez ton épouse qui est dans l’impatience ! » Et il lui jeta sur les épaules un grand voile de soie noire, et il ouvrit la marche, tandis que les deux nègres le soutenaient par les épaules en lui chatouillant de temps en temps le derrière, pour plaisanter seulement. Et lui, riait extrêmement.
« Ils arrivèrent ainsi, avec lui, dans une salle à demi obscure et chaude et parfumée à l’encens ; et, en son milieu, il y avait un grand plateau chargé de fruits, de pâtisseries, de sorbets, et des vases remplis de fleurs ; et, après l’avoir fait s’asseoir sur un escabeau d’ébène, le masseur et les deux nègres lui demandèrent la permission de se retirer et disparurent.
« Alors entra un jeune garçon qui se tint debout, attendant ses ordres, et qui lui dit : « Ô roi du temps, je suis ton esclave ! » Mais, sans faire attention à la gentillesse du jeune garçon, il partit d’un éclat de rire qui fit retentir toute la salle, et s’écria : « Par Allah ! quel endroit rempli de mangeurs de haschisch ! Voici que maintenant ils m’appellent roi ! » Puis il dit au petit garçon : « Toi, avance ici, et coupe-moi la moitié d’une pastèque bien rouge et bien fondante ! C’est ce que j’aime le mieux. Il n’y a rien qui vaille la pastèque pour me rafraîchir le cœur. » Et le jeune garçon lui apporta la pastèque coupée en tranches admirables. Alors il lui dit : « Toi, va-t’en ! Tu ne fais pas l’affaire ! Cours vite me chercher ce que j’aime le plus, avec une bonne pastèque, de la chair vierge de première qualité ! » Et le garçon disparut.
« Et bientôt entra dans la salle une adolescente toute jeune qui s’avança vers lui en mouvant ses hanches qui se dessinaient à peine, tant elles étaient encore enfantines. Et lui, à cette vue, se mit à renifler avec joie ; et il prit la petite dans ses bras et la mit entre ses cuisses et l’embrassa avec chaleur ; et il la fit glisser sous lui ; et il sortit son mâle et le lui mit dans la main ; et il allait qui sait quoi faire, quand soudain, sous la sensation d’un froid intense, il se réveilla de son rêve.
« Or, à ce moment-là, et une fois qu’il eut réfléchi que tout cela n’était que l’effet du haschisch sur son cerveau, il se vit entouré par tous les baigneurs du hammam qui le regardaient en riant de tout leur gosier et en ouvrant des bouches comme des fours ; et ils se montraient du doigt, mutuellement, son zebb nu qui se raidissait en l’air à la limite de la raideur et apparaissait aussi énorme que celui d’un âne ou d’un éléphant ; et ils jetaient dessus de grands seaux remplis d’eau froide en lui décochant des plaisanteries, comme celles que l’on fait d’ordinaire dans le hammam, par point de comparaison, entre baigneurs.
« Alors il devint bien confus et il ramena sur ses jambes la serviette et dit lamentablement à ceux qui riaient : « Pourquoi alors avez-vous enlevé la fillette, ô bonnes gens, au moment même où j’allais placer les choses à leur place ? » À ces paroles, ils trépignèrent de joie et se mirent à battre des mains et lui crièrent : « N’as-tu pas honte, ô mangeur de haschisch, de tenir de pareils propos après avoir, sous l’effet de l’herbe que tu as avalée, si bien joui de l’air du temps ? »
À ces paroles de la négresse, Kanmakân ne put se retenir plus longtemps, et se mit à rire tellement qu’il se convulsa de joie. Puis il dit à la négresse : « Quelle histoire délicieuse ! De grâce, hâte-toi de m’en dire la suite qui doit être admirable aux oreilles et exquise à l’esprit ! » Et la négresse dit : « Certes, ô mon maître, la suite est tellement merveilleuse que tu en oublieras, en vérité, tout ce que tu viens d’entendre ; et elle est tellement pure et savoureuse et étrange que même les sourds s’en trémousseraient de plaisir ! » Et Kanmakân dit : « Ah ! continue alors ! Je suis dans un ravissement extrême ! »
Or, comme la négresse se disposait à narrer la suite de son histoire, Kanmakân vit arriver et s’arrêter devant sa tente un courrier à cheval qui, ayant mis pied à terre, lui souhaita la paix ; et Kanmakân lui rendit son salam. Alors le courrier lui dit : « Seigneur, je suis un des cent courriers que le grand-vizir Dandân a envoyés dans toutes les directions pour essayer de trouver les traces du jeune prince Kanmakân, qui depuis trois années est parti de Baghdad. Car le grand-vizir Dandân a réussi à soulever toute l’armée et tout le peuple contre l’usurpateur du trône d’Omar Al-Némân ; et il a fait prisonnier l’usurpateur et l’a enfermé dans le cachot le plus souterrain. Aussi, à l’heure actuelle, la faim, la soif et la honte ont dû lui enlever l’âme ! Voudrais-tu me dire, ô seigneur, si, par hasard, tu n’aurais pas rencontré, un jour, le prince Kanmakân, à qui revient de droit le trône de son père ? »
Lorsque le prince Kanmakân…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT QUARANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
Lorsque le prince Kanmakân eut entendu cette nouvelle si inattendue, il se tourna vers son fidèle Sabah et, d’une voix très calme, il lui dit : « Tu vois, ô Sabah, que toute chose arrive au temps qui lui est fixé. Lève-toi donc. Et allons à Baghdad ! »
À ces paroles, le courrier comprit qu’il se trouvait en présence de son nouveau roi, et aussitôt il se prosterna et baisa la terre entre ses mains, comme firent aussi Sabah et la négresse. Et Kanmakân dit à la négresse : « Tu viendras aussi avec moi à Baghdad, où tu achèveras pour moi cette histoire du désert ! » Et Sabah dit : « Permets-moi alors, ô roi, de courir te précéder pour annoncer ton arrivée au vizir Dandân et aux habitants de Baghdad ! » Et Kanmakân le lui permit. Puis, pour récompenser le courrier de sa bonne nouvelle, il lui céda, comme cadeau, toutes les tentes, tous les bestiaux et tous les esclaves qu’il avait conquis dans ses luttes de trois ans. Puis, précédé par le Bédouin Sabah et suivi par la négresse juchée sur un chameau, il partit pour Baghdad au grand trot de son cheval Kâtoul.
Or, comme le prince Kanmakân avait pris soin de se laisser distancer d’une journée par son fidèle Sabah, celui-ci avait mis en quelques heures toute la ville de Baghdad en émoi. Et tous les habitants et toute l’armée, avec le vizir Dandân en tête et les trois chefs Rustem, Turkash et Bahramân, étaient sortis hors des portes attendant l’arrivée de ce Kanmakân qu’ils aimaient et qu’ils n’espéraient plus revoir ; et ils faisaient des vœux pour la prospérité et la gloire de la race d’Omar Al-Némân.
Aussi à peine le prince Kanmakân eut-il paru, arrivant au grand galop de son cheval Kâtoul, que les cris de joie et les invocations s’élevèrent de tout l’espace, poussés par des milliers de voix d’hommes et de femmes qui l’acclamaient comme leur roi. Et le vizir Dandân, malgré son grand âge, sauta lestement à terre et vint souhaiter la bienvenue et jurer fidélité au descendant de tant de rois. Puis tous ensemble entrèrent à Baghdad, cependant que la négresse, sur le chameau qu’entourait une foule considérable, racontait une histoire d’entre les histoires.
Or, la première chose que Kanmakân fit, en arrivant au palais, fut d’embrasser le grand-vizir Dandân, le plus fidèle à la mémoire de ses rois, puis les chefs Rustem, Turkash et Bahramân ; et la seconde chose que fit Kanmakân fut d’aller baiser les mains de sa mère qui sanglotait de joie ; et la troisième chose fut de dire à sa mère : « Ô ma mère, dis-moi, de grâce, comment va ma bien-aimée cousine Force-du-Destin ! » Et sa mère lui répondit : « Ô mon enfant, je ne puis te répondre à ce sujet, car depuis que je t’ai perdu je n’ai plus pensé à autre chose qu’à la douleur de ton absence ! » Et Kanmakân lui dit : « Je te supplie, ô mère, d’aller toi-même prendre de ses nouvelles et des nouvelles de ma tante Nôzhatou ! » Alors la mère sortit et alla dans l’appartement où se trouvaient maintenant Nôzhatou et sa fille Force-du-Destin, et revint avec elles dans la salle où les attendait Kanmakân. Et c’est alors qu’eut lieu la vraie joie et que furent dits les plus beaux vers, dont ceux-ci entre mille :
Ô sourire de perles sur les lèvres de l’aimée, sourire bu sur les perles mêmes !
Joues des amants ! Que de baisers ne connûtes-vous, que de caresses sur la soie !
Caresses des cheveux épars au matin, caresses des doigts qui fourmillent nombreux !
Et toi, glaive brillant tel l’acier hors du fourreau, glaive sans repos, glaive de la nuit…
Or, comme leur félicité fut à sa limite, avec la grâce d’Allah, il n’y a rien à dire là-dessus. Et d’ailleurs, c’est depuis lors que les malheurs s’éloignèrent de la demeure où vivait la postérité d’Omar Al-Némân, pour s’abattre à jamais sur tous ceux qui avaient été ses ennemis !
En effet, une fois que le roi Kanmakân eut passé de longs mois de bonheur dans les bras de la jeune Force-du-Destin, devenue son épouse, il réunit un jour, en présence du grand-vizir Dandân, tous ses émirs, ses chefs de troupes et les principaux de son empire et leur dit : « Le sang de mes pères n’est pas encore vengé, et les temps sont venus ! Or, voici qu’il m’est parvenu qu’Aphridonios est mort, et mort aussi Hardobios de Kaïssaria. Mais la vieille Mère-des-Calamités est encore en vie, et c’est elle qui, au dire de nos courriers, gouverne et règle les affaires dans tous les pays des Roum. Et à Kaïssaria le nouveau roi s’appelle Roumzân, et on ne lui connaît ni père ni mère.
« Donc, ô vous tous, mes guerriers, dès demain la guerre recommence contre les mécréants ! Et je jure sur la vie de Mohammad (sur lui la paix et la prière !) de ne retourner dans notre ville Baghdad qu’après avoir arraché la vie à la vieille de malheur et vengé tous nos frères morts dans les combats ! »
Et tous les assistants répondirent par l’assentiment. Et dès le lendemain l’armée était en marche sur Kaïssaria.
Or, comme ils étaient arrivés sous les murs de l’ennemi et qu’ils se disposaient à l’assaut pour mettre tout à feu et à sang dans cette ville mécréante, ils virent s’avancer vers la tente du roi un jeune homme si beau qu’il ne pouvait être qu’un fils de roi et une femme, le visage découvert et l’air respectable, qui marchait derrière lui. Et, à ce moment, sous la tente du roi, étaient réunis le vizir Dandân et la princesse Nôzhatou, tante de Kanmakân, qui avait voulu accompagner l’armée des Croyants, habituée qu’elle était aux fatigues des voyages.
Et le jeune homme et la femme demandèrent l’audience, qui aussitôt leur fut accordée. Mais à peine étaient-ils entrés que Nôzhatou poussa un grand cri et tomba évanouie, et la femme aussi poussa un grand cri et tomba évanouie. Et, quand elles furent revenues de leur évanouissement, elles se jetèrent dans les bras l’une de l’autre en s’embrassant : car la femme n’était autre que l’ancienne esclave de la princesse Abriza, la fidèle Grain-de-Corail !
Puis Grain-de-Corail se tourna vers le roi Kanmakân et lui dit : « Ô roi, je vois que tu portes au cou une gemme précieuse blanche et arrondie ; et la princesse Nôzhatou en porte également une au cou. Or, tu sais que la reine Abriza avait la troisième. Et cette troisième la voici ! » Et la fidèle Grain-de-Corail, se tournant vers le jeune homme qui était entré avec elle, montra, attachée à son cou, la troisième gemme ; puis, les yeux éclairés de joie, elle s’écria : « Ô roi, et toi, ma maîtresse Nôzhatou, ce jeune homme est le fils de ma pauvre maîtresse Abriza. Et c’est moi-même qui l’ai élevé depuis sa naissance. Et c’est lui-même, ô vous tous qui m’écoutez, qui est à l’heure présente le roi de Kaïssaria, Roumzân fils d’Omar Al-Némân. C’est donc ton frère, ô ma maîtresse Nôzhatou, et ton oncle à toi, ô roi Kanmakân ! »
À ces paroles de Grain-de-Corail, le roi Kanmakân et Nôzhatou se levèrent et embrassèrent le jeune roi Roumzân en pleurant de joie ; et le vizir Dandân également embrassa le fils de son maître le roi Omar Al-Némân (qu’Allah l’ait en sa miséricorde infinie !) Puis le roi Kanmakân demanda au roi Roumzân, maître de Kaïssaria : « Dis-moi, ô frère de mon père, tu es le roi d’un pays chrétien et tu vis au milieu des chrétiens ! Serais-tu aussi Nousrani ? » Mais le roi Roumzân étendit la main et, levant son index, il s’écria : « La ilah ill’Allah, oua Mohammad rassoul Allah ![6] »
Alors la joie de Kanmakân, de Nôzhatou et du vizir Dandân fut à sa limite extrême, et ils s’écrièrent : « Louange à Allah qui choisit les siens et les réunit ! » Puis Nôzhatou demanda : « Mais comment as-tu pu être guidé dans la voie droite, ô mon frère, au milieu de tous ces mécréants qui ignorent Allah et ne connaissent point son Envoyé ? » Il répondit : « C’est la bonne Grain-de-Corail qui m’a inculqué les principes simples et admirables de notre foi ! Car elle était elle-même devenue musulmane, en même temps que ma mère Abriza, lors de leur séjour à Baghdad, dans le palais de mon père le roi Omar Al-Némân. Aussi Grain-de-Corail a été pour moi non seulement celle qui m’a recueilli à ma naissance et m’a élevé et m’a tenu lieu de mère en toute chose, mais celle également qui a fait de moi un vrai Croyant dont la destinée est entre les mains d’Allah le Maître des rois ! »
À ces paroles, Nôzhatou fit asseoir Grain-de-Corail à côté d’elle sur le tapis et la voulut considérer désormais comme sa sœur.
Quant à Kanmakân, il dit à son oncle Roumzân : « Ô mon oncle, c’est à toi que revient, par droit d’aînesse, le trône de l’empire des musulmans. Et dès cette minute je me considère comme ton fidèle sujet. » Mais le roi de Kaïssaria dit : « Ô mon neveu, ce qu’Allah a fait est bien fait ! Comment oserais-je songer à troubler l’ordre établi par l’Ordonnateur ! » À ce moment, intervint le grand-vizir Dandân qui leur dit : « Ô rois, la plus juste idée est que vous régniez à tour de rôle chacun un jour, restant rois tous deux ! » Et ils répondirent : « Ton idée est admirable, ô vénérable vizir de notre père ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT QUARANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ils répondirent : « Ton idée est admirable, ô vénérable vizir de notre père ! » Et ils convinrent entre eux de la chose. Alors, pour fêter cet heureux événement, le roi Roumzân revint sur ses pas et rentra dans la ville, dont il fit ouvrir les portes à l’armée des musulmans. Puis il fit crier, par les crieurs publics, que désormais l’Islam était la religion des habitants, mais que tous les chrétiens étaient libres de rester dans leur erreur. Pourtant aucun des habitants ne voulut continuer à être mécréant ; et en un seul jour, l’acte de foi fut prononcé par mille mille nouveaux Croyants ! Ainsi ! Glorifié soit à jamais Celui qui a envoyé son Prophète pour être un symbole de paix parmi toutes les créatures de l’Orient et de l’occident !
À cette occasion, les deux rois donnèrent de grandes réjouissances et de grands festins, tout en régnant à tour de rôle, chacun son jour. Et ils restèrent ainsi à Kaïssaria un certain temps, à la limite de la joie et de l’épanouissement.
Et c’est alors qu’ils songèrent à se venger enfin de la vieille Mère-des-Calamités. À cet effet, le roi Roumzân, du consentement du roi Kanmakân, se hâta d’envoyer un courrier à Constantinia, porteur d’une lettre pour Mère-des-Calamités, qui ignorait le nouvel état de choses et s’imaginait toujours que le roi de Kaïssaria était chrétien comme son grand-père maternel, le défunt roi Hardobios, père d’Abriza. Et cette lettre était ainsi conçue :
« À la glorieuse et vénérable dame Schaouahi Omm El-Daouahi, la redoutable, la terrible, le fléau pesant de calamités sur les têtes ennemies, l’œil qui veille sur la cité chrétienne, la parfumée de vertus et de sagesse, l’odorante du saint encens suprême et véridique du grand Patriarche, la colonne de Christ au milieu de Constantinia.
« De la part du maître de Kaïssaria, Roumzân, de la postérité de Hardobios le Grand à la renommée étendue sur l’univers.
« Voici, ô notre mère à tous, que le Maître du ciel et de la terre a fait triompher nos armes sur les musulmans, et nous avons anéanti leur armée et fait prisonnier leur roi dans Kaïssaria, et réduit également en captivité le vizir Dandân et la princesse Nôzhatou, fille d’Omar Al-Némân et de la reine Safîa, fille du défunt roi Aphridonios de Constantinia.
« Nous attendons donc ta venue au milieu de nous pour fêter ensemble notre victoire et faire couper, devant tes yeux, la tête au roi Kanmakân, au vizir Dandân et à tous les chefs musulmans.
« Et tu peux venir à Kaïssaria sans escorte nombreuse, car désormais toutes les routes sont sûres et toutes les provinces pacifiées depuis l’Irak jusqu’au Soudan et depuis Mossoul et Damas jusqu’aux extrêmes limites de l’orient et de l’occident.
« Et ne manque pas d’emmener avec toi de Constantinia la reine Safîa, mère de Nôzhatou, pour lui donner la joie de revoir sa fille qui est honorée, en tant que femme, dans notre palais.
« Et que le Christ, fils de Mariam, te garde et te conserve comme une essence pure contenue précieusement dans l’or inaltérable ! »
Puis il signa la lettre de son nom, Roumzân, et la cacheta de son cachet royal, et la remit à un courrier qui partit aussitôt pour Constantinia.
Or, jusqu’au moment où arriva la vieille de malheur, pour sa perdition sans recours, il se passa quelques jours durant lesquels les deux rois eurent la joie de régler des comptes arriérés à qui de droit. Voici en effet ce qui se passa :
Un jour que les deux rois, le vizir Dandân et la douce Nôzhatou, qui ne se voilait jamais la figure en présence du vizir Dandân qu’elle considérait comme un père, étaient assis à causer des probabilités d’arrivée de la vieille calamiteuse et du sort qu’on lui réservait, l’un des chambellans entra et annonça aux rois qu’il y avait dehors un vieux marchand qui avait été assailli par des brigands, et qu’il y avait aussi les brigands enchaînés. Et le chambellan dit : « Ô rois, ce marchand sollicite une audience de votre magnanimité, car il a deux lettres à vous remettre. » Et les deux rois dirent : « Fais-le entrer ! »
Alors entra un vieillard dont la figure portait l’empreinte de la bénédiction et qui pleurait ; il baisa la terre entre les mains des rois et dit : « Ô rois du temps, est-il possible qu’un musulman soit respecté chez les mécréants et dépouillé et malmené chez les vrais Croyants, dans les pays où règne la concorde et la justice ? » Et les rois lui dirent : « Mais que t’est-il donc arrivé, ô respectable marchand ? » Il répondit : « Ô mes maîtres, sachez que j’ai sur moi deux lettres qui m’ont toujours fait respecter dans tous les pays musulmans ; car elles me servent de sauf-conduit et me dispensent de payer les dîmes et les droits d’entrée sur mes marchandises. Et l’une de ces lettres, ô mes maîtres, outre cette vertu précieuse, me sert également de consolation dans la solitude et me tient compagnie dans mes voyages ; car elle est écrite en vers admirables, et si beaux, en vérité, que je préférerais perdre mon âme que de m’en séparer ! » Alors les deux rois lui dirent : « Mais, ô marchand, tu peux au moins nous faire voir cette lettre ou seulement nous en lire le contenu ! » Et le vieux marchand, tout tremblant, tendit les deux lettres aux rois, qui les remirent à Nôzhatou en lui disant : « Toi qui sais lire les écritures les plus compliquées et si bien donner aux vers l’intonation qui sied, de grâce ! hâte-toi de nous en délecter ! »
Or, à peine Nôzhatou eut-elle défait le rouleau et jeté un regard sur les deux lettres qu’elle poussa un grand cri, devint plus jaune que le safran, et tomba évanouie. Alors on se hâta de l’asperger avec de l’eau de roses ; et lorsqu’elle fut revenue de son évanouissement, elle se leva vivement, les yeux tout en larmes, et courut au marchand, et, lui prenant la main, elle la baisa. Alors tous les assistants furent à l’extrême limite de l’ahurissement, devant une action aussi contraire à toutes les coutumes des rois et des musulmans ; et le vieux marchand, dans son émotion, chancela et faillit tomber à la renverse. Mais la reine Nôzhatou le soutint et, le conduisant, elle le fit s’asseoir sur le tapis même où elle était assise et lui dit : « Ne me reconnais-tu donc plus, ô mon père ? Suis-je donc si vieillie depuis le temps ? »
À ces paroles, le vieux marchand crut rêver et s’écria : « Je reconnais la voix ! Mais, ô ma maîtresse, mes yeux sont vieux et ne peuvent plus rien distinguer ! » Et la reine dit : « Ô mon père, je suis celle-là même qui t’a écrit la lettre en vers, je suis Nôzhatou’zamân ! » Et le vieux marchand, cette fois, s’évanouit complètement. Alors, pendant que le vizir Dandân jetait de l’eau de roses sur la figure du vieux marchand, Nôzhatou, se tournant vers son frère Roumzân et son neveu Kanmakân, leur dit : « C’est lui, le bon marchand qui m’a délivrée quand j’étais l’esclave du Bédouin brutal qui m’avait volée dans les rues de la Ville-Sainte ! »
Aussi, lorsque le marchand fut revenu de son évanouissement, les deux rois se levèrent en son honneur et l’embrassèrent ; et à son tour il baisa les mains de la reine Nôzhatou et du vieux vizir Dandan ; et tous se félicitèrent mutuellement de cet événement et rendirent grâces à Allah qui les avait tous réunis ; et le marchand leva les bras et s’écria : « Béni soit et glorifié Celui qui modèle des cœurs inoublieux et les parfume de l’admirable encens de gratitude ! »
Après quoi, les deux rois nommèrent le vieux marchand. cheikh général de tous les khâns et de tous les souks de Kaïssaria et de Baghdad, et lui donnèrent libre accès au palais, de jour comme de nuit. Puis ils lui dirent : « Mais comment as-tu été attaqué avec ta caravane ? » Il répondit : « C’est dans le désert ! Des brigands, des Arabes de la mauvaise qualité, de ceux qui dépouillent les marchands non armés, m’ont assailli soudain. Ils étaient plus de cent ! Mais leurs chefs sont trois : l’un est un nègre effroyable, l’autre un Kurde épouvantable et le troisième un Bédouin extraordinairement fort ! Ils m’avaient lié sur un chameau et me traînaient derrière eux, quand Allah voulut qu’un jour ils fussent assaillis par les guerriers réguliers qui les capturèrent, et moi avec eux. »
À ces paroles, les rois dirent à l’un des chambellans : « Fais d’abord entrer le nègre ! » Et le nègre entra. Or, il était plus laid que le derrière d’un vieux singe, et ses yeux plus méchants que ceux du tigre. Et le vizir Dandân lui demanda : « Comment t’appelles-tu et pourquoi es-tu brigand ? » Mais avant que le nègre eût le temps de répondre, Grain-de-Corail, l’ancienne suivante de la reine Abriza, était entrée pour appeler sa maîtresse Nôzhatou ; et ses yeux rencontrèrent par hasard les yeux du nègre ; et aussitôt elle poussa un cri terrible et s’élança comme une lionne sur le nègre et lui enfonça ses doigts dans les yeux et les lui arracha en une seule fois, en criant : « C’est lui, l’horrible Morose qui a tué ma pauvre maîtresse Abriza ! » Puis, lançant à terre les deux yeux sanglants qu’elle venait de faire sauter comme des noyaux hors des orbites du nègre, elle ajouta : « Loué soit le Juste, le Très-Haut, qui me permet enfin de venger ma maîtresse de ma main ! » Alors le roi Roumzân fit un seul signe ; et aussitôt le porte-glaive s’avança et d’un seul coup fit deux nègres d’un seul ! Puis les eunuques traînèrent le corps par les pieds et allèrent le jeter aux chiens, sur les décombres, hors de la ville.
Après quoi les rois dirent : « Qu’on fasse entrer le Kurde ! » Et le Kurde entra. Or, il était plus jaune qu’un citron et plus galeux qu’un âne de moulin et certainement plus pouilleux qu’un buffle resté un an sans se plonger dans l’eau. Et le vizir Dandân lui demanda : « Comment t’appelles-tu ? Et pourquoi es-tu brigand ? » Il répondit : « Moi, de mon métier j’étais chamelier dans la Ville-Sainte. Or, un jour, on me donna à transporter à l’hôpital de Damas un jeune homme malade… » À ces paroles, le roi Kanmakân et Nôzhatou et le vizir Dandân, sans lui laisser le temps de continuer, s’écrièrent : « C’est le chamelier traître qui abandonna le roi Daoul’makân sur le tas de fumier à la porte du hammam ! » Et soudain le roi Kanmakân se leva et dit : « On doit rendre le mal par le mal, et doublement ! Sinon le nombre augmenterait des malfaiteurs et des impies qui méconnaissent les lois ! Et nulle pitié en faveur des méchants, dans la vengeance, car la pitié comme l’entendent les chrétiens est la vertu des eunuques, des malades et des impuissants ! » Et de sa propre main le roi Kanmakân, d’un seul coup de son glaive, fit deux chameliers d’un seul ! Mais ensuite il ordonna aux esclaves de faire enterrer le corps, selon les rites religieux.
Alors les deux rois dirent au chambellan : « Fais maintenant entrer le Bédouin ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT QUARANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
Alors les deux rois dirent au chambellan : « Fais maintenant entrer le Bédouin ! » Et le Bédouin fut introduit. Mais à peine sa tête de brigand eut-elle paru dans l’ouverture de la porte que la reine Nôzhatou s’écria : « C’est lui le Bédouin qui m’a vendue à ce bon marchand ! » À ces paroles, le Bédouin dit : « Je suis Hamad ! Et je ne te connais pas ! » Alors Nôzhatou se mit à rire et s’écria : « C’est vraiment lui ! Car jamais on ne verra un fou semblable à lui ! Regarde-moi donc, ô Bédouin Hamad ! Je suis celle que tu as volée dans les rues de la Ville-Sainte et que tu as tant maltraitée ! »
Lorsque le Bédouin eut entendu ces paroles, il s’écria : « Par Allah ! c’est elle-même ! Ma tête va tout de suite s’envoler de mon cou, certainement ! » Et Nôzhatou se tourna vers le marchand, qui était assis, et lui demanda : « Le reconnais-tu maintenant, mon bon père ? » Le marchand dit : « C’est lui-même, le maudit ! Et il est plus fou à lui seul que tous les fous de la terre ! » Alors Nôzhatou dit : « Mais ce Bédouin, malgré toutes ses brutalités, avait une qualité : il aimait les beaux vers et les belles histoires. » Alors le Bédouin s’écria : « Ô ma maîtresse, c’est la vérité, par Allah ! Et je connais d’ailleurs une histoire tout à fait étrange qui m’est arrivée à moi-même. Or, si je la raconte et qu’elle plaise à tous ceux ici présents, tu me pardonneras et m’accorderas la grâce de mon sang ! » Et la douce Nôzhatou sourit et dit : « Soit ! raconte-nous ton histoire, ô Bédouin ! »
Alors le Bédouin Hamad dit :
« En vérité je suis un grand brigand, et la couronne sur la tête de tous les brigands ! Mais la chose la plus surprenante de toute ma vie dans les villes et le désert est la suivante :
« Une nuit que j’étais seul, étendu sur le sable près de mon cheval, je me sentis l’âme haletante sous le poids des incantations maléfiques des sorcières, mes ennemies. Et ce fut pour moi une nuit terrible d’entre toutes les nuits ; car tantôt j’aboyais comme un chacal et tantôt je rugissais comme un lion et tantôt je me plaignais sourdement, en bavant, comme un chameau ! Quelle nuit ! Et avec quels tremblements n’attendais-je pas sa fin et l’apparition du matin ! Enfin le ciel s’éclaira et mon âme se calma ; et alors, pour chasser les dernières fumées de ces rêves obsédants, je me levai vivement, et je ceignis mon épée et saisis ma lance et sautai sur mon coursier que je lançai au galop, plus rapide que la gazelle.
« Or, pendant que je galopais de la sorte, je vis soudain, droit devant moi, une autruche qui me regardait. Et elle était plantée juste en face de moi et semblait pourtant ne me voir pas. Et moi j’allais être sur elle. Mais, au moment précis où j’allais la toucher de ma lance, elle rua terriblement, tourna le dos, étendit toutes larges ses grandes ailes touffues et fila comme un trait dans le désert. Alors moi je la poursuivis sans arrêt et continuai de la sorte jusqu’à ce qu’elle m’eût entraîné dans une solitude pleine d’effroi où il n’y avait que la présence d’Allah et des pierres nues, et où l’on n’entendait que les sifflements des vipères, les appels retentissants des génies de l’air et de la terre et les hurlements des goules en quête de proies ! Et l’autruche disparut comme dans un trou invisible à mes yeux ou dans quelque espace que voir je ne pouvais pas ! Et je frissonnai dans toute ma chair ; et mon cheval se cabra et recula en soufflant !
« Alors je fus dans une perplexité et une terreur considérables, et je voulus tourner bride et revenir sur mes pas. Mais, où aller maintenant que la sueur coulait des flancs de mon cheval et que la chaleur de midi se faisait inexorable ? Et, de plus, une soif torturante me saisit à la gorge et fit haleter mon cheval dont le ventre s’ouvrait et se fermait comme un soufflet de forgeron. Et je pensai en mon âme : « Ô Hamad ! c’est ici que tu mourras ! et ta chair servira à nourrir les petits des goules et les bêtes de l’épouvante ! Ici la mort, ô Bédouin ! »
« Or, au moment où je me disposais à faire mon acte de foi et à mourir, je vis dans le loin se dessiner horizontale une ligne de fraîcheur, avec des palmiers épars ; et mon cheval hennit et secoua la tête et, tirant la bride en avant, s’élança ! Et en un temps de galop je me vis transporté hors de l’horreur nue et brûlante du désert de pierres. Et devant moi, près d’une source qui coulait sous les pieds des palmiers, une tente magnifique était dressée, près de laquelle deux juments superbes, les jambes réunies, paissaient l’herbe humide et glorieuse.
« Alors je me hâtai de mettre pied à terre et d’abreuver mon cheval, dont les naseaux jetaient le feu, et de boire moi-même de cette eau de source limpide et douce à mourir. Puis je pris une longue corde dans ma besace et j’attachai mon cheval pour qu’il pût librement se rafraîchir au vert de cette prairie. Après quoi une curiosité m’invita à me diriger vers la tente pour voir ce que pouvait être l’affaire. Et voici ce que je vis.
« Sur une natte blanche était assis à son aise un adolescent aux joues vierges de poil ; et il était aussi beau que le croissant de la nouvelle lune ; et à sa droite une jeune fille délicieuse, nonchalante, de taille mince, délicate et souple tel le rameau jeune du saule, était étendue dans la splendeur de sa beauté.
« Alors moi, à l’heure même et au moment, je devins amoureux à l’extrême limite de la passion, mais je ne sus exactement si c’était de l’adolescente ou de l’adolescent ! Car, par Allah ! la lune est-elle plus belle, ou le croissant ?
« À cette vue, je fis entendre ma voix et je leur dis : « La paix sur vous ! » Et aussitôt la jeune fille se couvrit le visage et le jeune homme se tourna vers moi et se leva et répondit : « Et sur toi la paix ! » Je dis : « Je suis Hamad ben-El-Fezari de la principale tribu de l’Euphrate ! Je suis l’illustre, le guerrier réputé, le cavalier redoutable, celui qui compte, par son courage et sa témérité, parmi les Arabes, à l’égal de la valeur réunie de cinq cents cavaliers ! Comme je poursuivais une autruche, le sort me conduisit jusqu’ici ; et je viens te demander une gorgée d’eau ! » Alors le jeune homme se tourna vers la jeune fille et lui dit : « Porte-lui à boire et à manger. » Et la jeune fille se leva ! Et elle marcha ! Et chacun de ses pas était marqué par le bruit harmonieux des grelots d’or de ses chevilles ; et derrière elle sa chevelure éployée la couvrait entière et lourdement se balançait et tellement ! que l’adolescente en trébuchait. Alors moi, malgré les regards du jeune homme, je regardai fixement l’adolescente pour n’en plus détacher mes yeux. Et elle revint en portant sur la paume de sa main droite un vase rempli d’eau fraîche, et sur la paume de sa main gauche un plateau couvert de dattes, de porcelaines de lait caillé et de plats de viande de gazelle.
« Mais moi je ne pus, tant la passion m’anéantissait, ni tendre la main ni toucher à rien de toutes ces choses. Je ne sus que regarder l’adolescente et réciter ces vers que je construisis à l’instant même :
« La neige de ta peau, ô jeune fille, ah ! Et la teinture de henné est fraîche et noire encore sur tes doigts et sur la paume de tes mains !
Et je crois voir, devant mes yeux émerveillés, se dessiner sur la blancheur de tes mains la figure de quelque brillant oiseau au noir plumage !
« Lorsque le jeune homme eut entendu ces vers et remarqué le feu de mes regards, il se mit à rire et tellement qu’il faillit s’évanouir. Puis il me dit : « En vérité, je vois que tu es un guerrier hors de pair, et un cavalier extraordinaire ! » Je répondis : « Je passe pour tel ! Mais toi, qui donc es-tu ? » Et je grossis ma voix pour lui faire peur et me faire respecter. Et le jeune homme me dit : « Je suis Ebad ben-Tamim ben-Thâlaba, de la tribu des Bani-Thâlaba. Et cette jeune fille est ma sœur. » Alors moi je m’écriai : « Hâte-toi donc de me donner ta sœur comme épouse, car je l’aime passionnément et je suis de noble filiation ! » Mais il me répondit : « Sache que ni ma sœur ni moi nous ne nous marierons jamais. Car nous avons choisi cette terre fertile au milieu du désert pour y vivre notre vie en toute tranquillité, loin de tous les soucis ! » Je dis : « Il me faut ta sœur comme épouse, ou à l’instant même tu vas compter au nombre des morts, par le tranchant de ce glaive ! »
« À ces paroles, le jeune homme bondit vers l’extrémité de sa tente et me dit : « Arrière, ô scélérat qui méconnais l’hospitalité ! La lutte entre nous livrera le vaincu à discrétion ! » Et il détacha du poteau où ils pendaient son glaive et son bouclier, tandis que je m’élançais du côté où paissait mon cheval et que je sautais en selle et me tenais en garde. Et le jeune homme, s’étant armé, sortit également et enfourcha son cheval et il se disposait déjà à le lancer, quand la jeune fille, sa sœur, sortit, les yeux pleins de larmes, et s’attacha à ses genoux qu’elle embrassa en récitant ces vers :
« Ô mon frère, voici que pour défendre ta sœur fragile, tu t’exposes au sort de la lutte et aux coups d’un ennemi que tu ne connais pas !
Que puis-je, sinon faire des vœux au Donateur de la victoire pour ton triomphe, et pour que je me garde intacte de toute souillure et conserve pour toi seul le sang de mon cœur ?
Mais si la destinée farouche te ravissait à mon âme, ne crois point qu’un pays puisse me voir vivante, fût-il le plus beau de tous les pays, et débordant des produits de toute la terre.
Et ne crois point que je te survive un instant ; car la tombe recèlera nos corps unis dans le trépas comme dans la vie ! »
« Lorsque le jeune homme eut entendu ces vers désolés de sa sœur, ses yeux se remplirent de larmes, et il se pencha vers la jeune fille et souleva légèrement le voile qui lui cachait le visage et l’embrassa entre les yeux ; et cela me permit de voir pour la première fois les traits de la jeune fille : elle était exactement aussi belle que le soleil qui apparaît soudain sortant d’un nuage ! Puis le jeune homme tint un instant la tête du cheval du côté de la jeune fille et récita ces vers :
« Arrête-toi, ô sœur, et regarde les prodiges que mon bras accomplira.
Si pour toi, ô ma sœur, je ne combats pas, pourquoi donc mes armes et mon cheval ?
Et si pour te défendre je ne lutte pas, pourquoi donc la vie ?
Et si je recule quand il s’agit de ta beauté, n’est-ce point un signe pour les oiseaux de proie de se jeter sur un corps sans âme désormais ?
Quant à celui-là, qui se dit redoutable et nous vante la fermeté de son courage, je vais, sous tes yeux, lui faire sentir un coup qui le perforera du cœur au talon ! »
« Puis il se tourna vers moi et me cria :
« Et toi qui souhaites la jouissance après ma mort, à tes dépens va s’accomplir un exploit qui remplira les livres à venir !
Car, moi qui construis ces vers au rythme guerrier, je suis celui qui enlèvera ton âme avant que tu puisses seulement t’en douter ! »
« Et il lança son cheval contre le mien et, d’un coup, il envoya mon épée voler au loin et, sans me laisser le temps de piquer des deux et de filer dans le désert, il me saisit dans sa main et m’enleva de ma selle comme on enlève un sac vide, et me lança comme une balle en l’air, et me rattrapa au vol sur sa main gauche, et me soutint ainsi, le bras tendu, comme s’il eût tenu sur le doigt un oiseau apprivoisé. Quant à moi, je ne savais plus si tout cela n’était point un songe noir ou si ce jeune homme, aux joues soyeuses et rosées, n’était pas un genni qui habitait sous cette tente avec une houria ! Et d’ailleurs ce qui se passa après me fit supposer qu’il devait plutôt en être ainsi.
« En effet, lorsque la jeune fille vit le triomphe de son frère, elle s’élança vers lui et l’embrassa sur le front et se suspendit joyeuse au cou de son cheval, qu’elle conduisit elle-même jusqu’à la tente. Là le jeune homme descendit en me tenant sous le bras, comme un paquet, me posa à terre, me fit mettre debout et, me prenant la main, il me fit entrer sous la tente, au lieu de m’écraser la tête sous ses pieds ; et il dit à sa sœur : « Il est désormais l’hôte qui est entré sous notre protection ; traitons-le donc avec égards et avec douceur. » Et il me fit asseoir sur la natte ; et la jeune fille mit derrière moi un coussin pour mieux me faire reposer ; puis elle s’occupa de remettre en place les armes de son frère, et de lui apporter l’eau parfumée et de lui laver le visage et les mains ; puis elle le vêtit d’une robe blanche en lui disant : « Qu’Allah, ô mon frère, fasse parvenir ton honneur à l’extrême limite de la blancheur, et qu’il te mette comme un grain de beauté sur la face glorieuse de nos tribus ! » Et l’adolescent lui répondit par ces vers :
« Ô ma sœur, au sang limpide, de la race des Bani-Thâlaba ! tu m’as vu sur le terrain de la lutte, combattant pour tes yeux ! »
« Elle répondit :
« Les éclairs de ta chevelure éparse sur ton front s’auréolaient de leur lueur, ô mon frère ! »
« Il reprit :
« Voici les lions des solitudes infinies ! Ô ma sœur, conseille-leur de retourner sur leurs pas ! Je ne voudrais point que la honte les tînt à jamais dans la poussière mordue par leurs dents ! »
« Elle répondit :
« Ô vous tous ! c’est mon frère Ebad ! Tous ceux du désert le connaissent par sa vaillance, ses exploits et la noblesse de ses ancêtres ! Reculez ! »
Et toi, Bédouin Hamad ! tu as voulu lutter contre un héros qui t’a fait voir la mort ramper vers toi comme un serpent prêt à fondre sur sa proie ! »
« Or, moi, en voyant tout cela et en entendant ces vers, je fus dans une grande perplexité ; et je fis un retour sur moi-même et je constatai combien j’étais devenu petit à mes propres yeux ; et combien ma laideur était grande en comparaison de la beauté de ces deux adolescents ! Mais bientôt je vis la jeune fille apporter à son frère un plateau couvert de mets et de fruits, sans qu’elle me jetât un seul regard, fût-il même méprisant, comme si j’étais quelque chien dont la présence dût passer inaperçue. Et pourtant, malgré tout, je continuais à la trouver plus merveilleuse encore, surtout quand elle se mit à offrir à manger à son frère, en le servant elle-même et en se négligeant elle-même pour qu’il ne manquât de rien. Mais le jeune homme finit par se tourner de mon côté et m’invita à partager le repas avec lui : alors je poussai un soupir de soulagement, car je me sentais désormais certain d’avoir la vie sauve. Et il me tendit lui-même une porcelaine de lait caillé et une soucoupe pleine d’une décoction de dattes dans l’eau aromatisée. Et je mangeai et je bus en tenant la tête basse, et je lui jurai mille et cinq cents serments que j’étais désormais le plus fidèle de ses esclaves et le plus acquis à sa dévotion. Mais il sourit et fit un signe à sa sœur qui se leva aussitôt et ouvrit une grande caisse et en tira une à une dix robes admirables, plus belles les unes que les autres ; elle en mit neuf dans un paquet et m’obligea à l’accepter ; puis elle me força à me vêtir de la dixième. Et c’est cette dixième, si somptueuse, dont vous me voyez, ô vous tous, en ce moment habillé !
« Après quoi, le jeune homme fit un second signe, et l’adolescente sortit un instant pour revenir aussitôt ; et je fus invité par eux deux à aller prendre possession d’une chamelle chargée de toutes sortes de vivres et aussi de cadeaux que j’ai conservés précieusement jusqu’aujourd’hui. Et m’ayant ainsi comblé de toutes sortes d’égards et de présents, sans que j’eusse fait quoi que ce soit pour les mériter, au contraire ! ils m’invitèrent à user de leur hospitalité autant de temps qu’il me plairait. Mais, ne voulant plus abuser de rien, je pris congé d’eux en embrassant sept fois la terre entre leurs mains et, ayant enfourché mon alezan, je pris la chamelle par le licou et je me hâtai de retourner sur le chemin du désert, d’où j’étais venu.
« Et c’est alors que, devenu le plus riche de ma tribu, je me fis chef d’une bande de brigands coupeurs de routes. Et il arriva ce qui arriva !
« Et telle est l’histoire que je vous ai promise et qui mérite, sans aucun doute, la rémission de tous mes crimes lesquels, à la vérité, ne sont pas d’un poids minime ! »
Lorsque le Bédouin Hamad eut fini son histoire,
Nôzhatou dit aux deux rois et au vizir Dandân : « On
doit respecter les fous, mais les mettre hors de portée
de nuire. Or, ce Bédouin a le crâne irrémédiablement
disloqué ; il faut donc lui pardonner ses
méfaits à cause de sa sensibilité aux beaux vers et de
sa mémoire étonnante ! » À ces paroles, le Bédouin se
sentit soulagé si considérablement qu’il s’affala sur
les tapis. Et les eunuques vinrent et le ramassèrent.
Or, à peine le Bédouin venait-il de disparaître qu’un courrier entra en haletant et, ayant embrassé la terre entre les mains des rois, dit : « La Mère-des-Calamités est aux portes de la ville, car elle n’en est plus distante que d’un seul parasange ! »
À cette nouvelle si longtemps attendue, les deux rois et le vizir se convulsèrent de joie et demandèrent des détails au courrier, qui leur dit : « Lorsque la Mère-des-Calamités eut ouvert la lettre de notre roi et vu sa signature au bas de la feuille, elle se réjouit extrêmement ; et à l’heure même et à l’instant elle fit ses préparatifs de départ et invita la reine Safîa à venir avec elle ainsi que cent des principaux guerriers des Roum de Constantinia. Puis elle me dit de prendre les devants pour venir vous annoncer son arrivée. »
Alors le vizir Dandân se leva et dit aux rois : « Il est plus prudent, pour déjouer les perfidies et les embûches dont pourrait encore se servir la vieille mécréante, que nous allions à sa rencontre, après nous être déguisés sous des vêtements de chrétiens occidentaux, et avoir pris avec nous mille guerriers choisis, habillés également selon l’ancienne mode de Kaïssaria. » Et les deux rois répondirent par l’ouïe et l’obéissance et firent ce que leur conseillait le grand-vizir. Aussi, quand elle les vit dans cet accoutrement, Nôzhatou leur dit : « Vraiment, si je ne vous connaissais pas, je vous croirais tout à fait des Afrangi ! » Alors ils sortirent du palais et, s’étant mis à la tête de mille guerriers, ils allèrent au-devant de Mère-des-Calamités.
Et bientôt elle apparut. Alors Roumzân et Kanmakân dirent au vizir Dandân de développer les guerriers sur un grand cercle et de les faire avancer lentement de façon à ne laisser échapper aucun des guerriers de Constantinia. Puis le roi Roumzân dit à Kanmakân : « Laisse-moi d’abord m’avancer le premier au-devant de la vieille maudite : car elle me connaît déjà et ne se méfiera pas. » Et il poussa son cheval. Et en quelques instants il fut aux côtés de Mère-des-Calamités.
Alors Roumzân mit vivement pied à terre et la vieille, l’ayant reconnu, descendit également et se jeta à son cou. Alors le roi Roumzân la prit dans ses bras, la fixa les yeux dans les yeux, et la serra et la comprima si fort et si longtemps qu’elle lança un pet retentissant qui fit se cabrer tous les chevaux et sauter les cailloux du chemin à la tête des cavaliers !
Or, au même moment les mille guerriers, au grand galop, resserrèrent leur cercle et crièrent aux cent chrétiens de mettre bas les armes ; et en un clin d’œil ils les capturèrent jusqu’au dernier, tandis que le vizir Dandân s’avançait vers la reine Safîa et, ayant baisé la terre entre ses mains, la mettait en quelques mots au courant de la situation, cependant que la vieille Mère-des-Calamités, garrottée solidement, comprenait enfin sa perdition et urinait longuement dans ses vêtements.
Puis tout le monde rentra à Kaïssaria ; et, de là, immédiatement on se mit en route pour Baghdad, où l’on arriva sans incident et en toute hâte.
Alors les rois firent illuminer et décorer toute la ville et invitèrent tous les habitants, par les crieurs publics, à se masser devant le palais. Et lorsque toute la place et toutes les rues furent remplies par la foule des habitants, hommes, femmes et enfants, un âne galeux sortit de la grande porte et sur son dos, à rebours, était attachée Mère-des-Calamités, la tête couverte d’un tiare rouge et couronnée de crottin. Et devant elle lentement marchait un grand crieur qui racontait à haute voix les principaux méfaits de la vieille maudite, cause première de tant de calamités sur l’Orient et l’occident.
Et lorsque toutes les femmes et tous les enfants lui eurent craché au visage, on la pendit par les pieds à la grande porte de Baghdad !
Et c’est ainsi que périt, en rendant à Éblis son âme fétide, par l’anus, la pétante calamiteuse, la vieille aux fabuleuses vesses, la rouée, la politique, la perverse mécréante, Schaouahi Omm El-Daouahi. Le sort la trahissait comme elle avait trahi, et cela afin que sa mort pût servir de présage de la prise de Constantinia par les Croyants et du définitif triomphe en Orient, dans le futur, de l’Islam pacifique sur la terre d’Allah en large et en long !
Aussi les cent guerriers chrétiens ne voulurent plus retourner dans leur pays et préférèrent embrasser librement la foi si simple des musulmans.
Et les rois et le vizir Dandân ordonnèrent aux scribes les plus habiles de noter soigneusement dans les annales tous ces détails et ces événements, afin qu’ils pussent servir d’exemple salutaire aux générations de l’avenir.
— Et telle est, ô Roi fortuné, continua Schahrazade en s’adressant au roi Schahriar, l’histoire splendide du roi Omar Al-Némân et de ses fils merveilleux Scharkân et Daoul’makân ; de la reine Abriza, de la reine Force-du-Destin et de la reine Nôzhatou ; du grand-vizir Dandân et des rois Roumzân et Kanmakân !
Puis Schahrazade se tut.
Alors, pour la première fois, le roi Schahriar regarda tendrement la diserte Schahrazade, et il lui dit :
« Ô Schahrazade ! par Allah ! que ta sœur, cette petite qui écoute, a raison quand elle te dit que tes paroles sont délicieuses au goût et savoureuses en leur fraîcheur ! En vérité tu commences à me faire regretter le massacre de tant d’adolescentes, et peut-être que tu finiras par me faire oublier complétement le serment que je fis de te tuer comme les autres ! »
Et la petite Doniazade se souleva du tapis où elle était blottie et s’écria : « Ô ma sœur ! que cette histoire est admirable ! Et comme j’aime Nôzhatou et les paroles qu’elle disait et les paroles des jeunes filles ! Et combien je suis contente de la mort de Mère-des-Calamités ! Et que tout cela est merveilleux ! »
Alors Schahrazade regarda sa sœur et lui sourit. Puis elle lui dit : « Mais que dirais-tu alors si tu entendais les paroles des animaux et des oiseaux ? » Et Doniazade s’écria : « Ah ! ma sœur, je t’en prie, dis-nous quelques paroles des animaux et des oiseaux ! Car elles doivent être délicieuses, surtout répétées par ta bouche ! » Mais Schahrazade dit : « De tout cœur amical ! mais certainement pas avant que ne me le permette notre maître le Roi, si toutefois il souffre encore de ses insomnies ! » Et le roi Schahriar fut extrêmement perplexe et dit : « Mais que peuvent bien dire les animaux et les oiseaux ? Et dans quelle langue parlent-ils ? » Et Schahrazade dit : « En prose et en vers, dans le pur arabe ! » Alors le roi Schahriar s’écria : « En vérité, ô Schahrazade, je ne veux rien décider encore concernant ton sort, avant que tu ne m’aies raconté ces choses que je ne connais pas. Car jusqu’ici je n’ai entendu que les paroles humaines ; et je ne serais pas fâché de savoir ce que pensent les êtres qui ne sont pas compris par la plupart des hommes ! »
Alors, comme elle voyait la nuit s’écouler, Schahrazade pria le roi d’attendre jusqu’au lendemain. El Schahriar, malgré l’impatience où il était, voulut bien y consentir. Il prit dans ses bras la belle Schahrazade, et ils s’enlacèrent jusqu’au matin.
LA CENT QUARANTE-SIXIÈME NUIT
Schahrazade dit :
HISTOIRE CHARMANTE DES ANIMAUX
ET DES OISEAUX
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait, en l’antiquité du temps et le passé de l’âge et du moment, un paon qui aimait, en compagnie de son épouse, à fréquenter les bords de la mer et à se promener dans une forêt qui s’étendait jusque là et qui était pleine d’eaux courantes et habitée par le chant des oiseaux. Durant le jour, le couple cherchait tranquillement sa nourriture et, la nuit venue, il se perchait sur un arbre touffu pour ne point s’exposer à tenter l’envie de quelque voisin peu scrupuleux dans son admiration pour la beauté de la jeune paonne. Et ils continuèrent à vivre de la sorte, en bénissant le Bienfaiteur, dans la paix et la douceur.
Or, un jour, le paon décida son épouse à aller, pour changer d’air et de vue, faire une excursion du côté d’une île que l’on voyait du rivage. Et la paonne lui ayant répondu par l’ouïe et l’obéissance, ils s’envolèrent tous deux et arrivèrent dans l’île.
Et c’était une île couverte de beaux arbres fruitiers et nourrie par une multitude de ruisseaux. Et le paon et son épouse furent extrêmement charmés de leur promenade au milieu de cette fraîcheur, et s’arrêtèrent quelque temps à manger de tous les fruits et à boire de cette eau si douce et si légère.
Or, comme ils se disposaient à s’en retourner chez eux, ils virent arriver vers eux, les ailes battantes et pleine d’effroi, une oie. Et elle vint, en tremblant de toutes ses plumes, leur demander abri et protection ; et le paon et son épouse ne manquèrent pas de la recevoir en toute cordialité ; et la paonne se mit à lui parler avec beaucoup de gentillesse et lui dit : « Sois la bienvenue au milieu de nous ! Tu trouveras ici famille et facilité ! » Alors l’oie commença à se tranquilliser ; et le paon, ne doutant pas un instant que cette oie n’eût une histoire étonnante, lui demanda avec bonté : « Que t’est-il donc arrivé et pourquoi cet effroi ? » Et l’oie répondit : « Je suis encore toute malade de ce qui vient de m’arriver, et de la terreur terrible que m’inspire Ibn-Adam ! Ah ! qu’Allah nous garde ! qu’Allah nous préserve d’Ibn-Adam ! » Et le paon, bien peiné, lui dit : « Calme-toi, ma bonne oie, Calme-toi ! » Et la paonne lui dit : « Comment veux-tu qu’Ibn-Adam puisse arriver jusqu’à cette île située au milieu de la mer ? Du rivage, il ne pourra sauter jusqu’ici ; et de la mer, comment fera-t-il pour traverser tant d’espace et d’eau ? » Alors l’oie leur dit : « Béni soit celui qui vous a mis sur ma route pour me faire oublier mes terreurs et me rendre la paix du cœur ! » Et la paonne lui dit : « Ô ma sœur, raconte-nous alors le motif de la terreur que t’inspire Ibn-Adam et l’histoire qui a dû t’arriver certainement ! » Et l’oie raconta :
« Sache, ô paon plein de gloire, et toi paonne douce
et hospitalière, que j’habite cette île depuis mon enfance,
et y ai toujours vécu sans désagrément ni soucis,
et sans rien qui pût me troubler l’âme ou m’offusquer
la vue. Mais, l’avant-dernière nuit, comme
j’étais endormie, la tête sous mon aile, je vis m’apparaître
en songe un Ibn-Adam qui voulut lier conversation
avec moi ; et j’allais répondre à ses avances,
quand j’entendis une voix qui me criait : « Prends
garde, ô oie, prends garde ! Méfie-toi d’Ibn-Adam et de
la douceur de son langage et de la perfidie de ses manières !
Et n’oublie pas ce qu’a dit le poète à son sujet :
« Il te fait goûter une douceur qu’il a sur le bout de la langue ; mais c’est pour te surprendre à l’improviste, comme le renard, en tapinois ! »
« Car sache bien, pauvre oie, qu’Ibn-Adam a atteint dans la rouerie un tel degré qu’il sait, quand il veut, attirer à lui les habitants du sein des eaux et les monstres les plus farouches de la mer ; il peut du haut des airs faire dégringoler comme une masse les aigles qui planent tranquilles, rien qu’en leur lançant une balle fabriquée avec la boue desséchée ; il est enfin si perfide que, tout faible qu’il est, il peut vaincre l’éléphant et s’en servir comme domestique ou lui arracher les défenses pour s’en faire des ustensiles. Ah ! oie, fuis ! fuis ! »
« Alors moi je sursautai dans mon sommeil et, sans regarder derrière moi, épouvantée, je m’enfuis en allongeant le col et déployant mes ailes. Et je me mis ainsi à vagabonder de-ci et de-là jusqu’à ce que j’eusse senti mes forces m’abandonner ; alors, comme j’étais arrivée au bas d’une montagne, je m’arrêtai un instant derrière un rocher, et mon cœur battait de peur et de fatigue, et ma poitrine était resserrée de toute l’appréhension que m’inspirait Ibn-Adam ! Et, avec tout cela, je n’avais ni mangé ni bu, et la faim me torturait et la soif autant ! Et je ne savais plus comment faire et je n’osais plus bouger, quand je vis en face de moi, à l’entrée d’une caverne, un jeune lion roux, au regard bon et doux, qui m’inspira aussitôt confiance et sympathie. Et de son côté le jeune lion m’avait déjà remarquée ; et il montrait tous les signes d’une grande joie, tant j’avais en moi de timidité et tant mon aspect l’avait séduit. Aussi il m’appela en me disant : « Ô gentille petite, approche, viens causer un peu avec moi. » Et moi je fus très sensible à son invitation, et je m’avançai vers lui très modestement ; et il me dit : « Comment t’appelles-tu ? Et de quelle race es-tu ? » Je lui répondis : « Je m’appelle Oie ! Et je suis de la race des oiseaux ! » Il me dit : « Je te vois tremblante et terrifiée, et j’en ignore la cause ! » Alors je lui racontai ce que j’avais vu et entendu en rêve. Et quel ne fut pas mon étonnement quand il me répondit : « Mais moi aussi j’ai eu un songe semblable et je l’ai raconté à mon père le lion qui m’a aussitôt mis en garde contre Ibn-Adam et m’a dit de me méfier extrêmement de ses ruses et perfidies ! Mais jusqu’à présent je n’ai guère eu l’occasion de faire la rencontre de cet Ibn-Adam-là ! »
« À ces paroles du jeune lion, mon effroi ne fit qu’augmenter et je m’écriai : « Il n’y a plus à hésiter sur le parti à prendre ! C’est le moment de nous débarrasser de ce fléau, et c’est à toi seul, ô fils du sultan des animaux, que doit revenir la gloire de tuer Ibn-Adam ! Et, ce faisant, ta renommée haussera aux yeux de toutes les créatures du ciel, de l’eau et de la terre ! » Et je continuai à encourager de la sorte et à flatter le jeune lion jusqu’à ce que je l’eusse décidé à se mettre à la recherche de notre ennemi commun.
« Le jeune lion sortit donc de la caverne et me dit de le suivre ; et moi je marchai derrière lui, tandis qu’il s’avançait fièrement en faisant claquer sa queue sur son dos. Et nous marchâmes ainsi de compagnie, moi toujours derrière lui et pouvant à peine suivre son pas ; enfin nous vîmes s’élever une poussière qui, dissipée, laissa apparaître, tout nu, sans bât ni licou, un âne fugitif qui tantôt gambadait et ruait, et tantôt se jetait à terre et se roulait dans la poussière, les quatre jambes en l’air.
« À cette vue, mon ami le jeune lion fut assez étonné, car ses parents ne l’avaient guère laissé jusqu’ici sortir de la caverne ; et il héla l’âne en question en lui criant : « Hé toi ! viens par ici ! » Et l’autre se hâta d’obéir ; et mon ami lui dit : « Animal de peu de raison, pourquoi agis-tu de la sorte ? Et d’abord de quelle espèce es-tu d’entre les animaux ? » Il répondit : « Ô mon maître, je suis ton esclave l’âne de l’espèce des ânes ! » Il lui demanda : « Et pourquoi viens-tu par ici ? » Il répondit : « Ô fils du sultan, pour fuir Ibn-Adam ! » Alors le jeune lion se mit à rire et lui dit : « Comment, avec ta taille et ta largeur, peux-tu craindre Ibn-Adam ! » L’âne dit, en agitant la tête d’un air pénétré : « Ô fils du sultan, je vois que tu ne connais guère cet être malfaisant ! Si j’ai peur de lui, ce n’est point qu’il veuille ma mort : il veut pis que cela, et ma terreur provient du traitement qu’il me ferait subir ! Sache en effet que je lui sers de monture, tant que je suis jeune et solide ; et, dans ce but, il me met sur le dos quelque chose qu’il appelle le bât ; puis il me serre le ventre avec quelque chose qu’il appelle la sangle ; et sous la queue il me met un anneau dont j’ai oublié le nom, mais qui blesse cruellement mes parties délicates ; enfin il me fourre dans la bouche un morceau de fer qui me met en sang la langue et le palais et qu’il appelle le mors. Et c’est alors qu’il me monte et que, pour me faire aller plus vite que je ne peux, il me pique le cou et le derrière avec un aiguillon. Et si, fourbu, je fais mine d’aller moins vite, il me lance d’effroyables malédictions et des jurons qui me font frissonner, tout âne que je suis, car devant tout le monde il m’appelle : « Entremetteur ! fils de putain ! fils d’enculé ! le cul de ta sœur ! coureur de femmes ! » — que sais-je encore ! Et si, par malheur, je viens, voulant me soulager un peu la poitrine, à péter, alors sa fureur ne connaît plus de bornes ; et il vaut mieux, par égard pour toi, ô fils du sultan, que je ne te répète pas tout ce qu’il me fait et tout ce qu’il me dit, en pareille circonstance ! Aussi je ne me laisse aller à de pareils soulagements que lorsque je sais qu’il est très loin derrière moi, ou lorsque je suis sûr d’être seul ! Mais ce n’est pas tout ! Lorsque je me ferai vieux, il me vendra à quelque porteur d’eau qui, me mettant sur le dos un bât en bois, me chargera d’outres pesantes et d’énormes cruches d’eau de chaque côté, et cela jusqu’à ce que, n’en pouvant plus de mauvais traitements et de privations, je crève misérablement. Et alors on jettera ma carcasse aux chiens errants sur les décombres ! Et tel est, ô fils du sultan, le sort calamiteux que me réserve Ibn-Adam ! Ah ! y a-t-il parmi les créatures une infortune comparable à la mienne ? réponds, toi, ô bonne et tendre oie ! »
« Alors moi, ô mes maîtres, je sentis un frisson me traverser d’horreur et de pitié et je m’écriai, à la limite de l’émotion et du tremblement : « Ô seigneur lion, vraiment l’âne est excusable ! Car, rien qu’à l’entendre, je meurs ! » Et le jeune lion, voyant l’âne en train de déguerpir, lui cria : « Mais pourquoi es-tu si pressé, compagnon ! Reste encore un peu, car vraiment tu m’intéresses ! Et je serais heureux de te voir me servir de guide pour aller vers Ibn-Adam ! « Mais l’âne répondit : « Je regrette, seigneur ! mais je préfère mettre entre moi et lui l’espace d’une journée ; car je l’ai quitté hier alors qu’il se dirigeait vers cet endroit. Et je suis en train de chercher quelque lieu sûr où m’abriter contre ses perfidies et son astuce. Et puis, avec ta permission, je veux, maintenant que je suis sûr qu’il ne m’entendra pas, me soulager tout à mon aise et jouir de l’air du temps ! » Et, ayant dit ces paroles, l’âne se mit à braire longuement et fit suivre cela de trois cents magnifiques pets, en ruant. Puis il se roula sur l’herbe pendant un bon moment et se releva et, voyant une poussière vers le loin, il tendit une oreille, puis l’autre oreille, regarda fixement et, nous tournant le dos vivement, il déguerpit et disparut.
« Or, la poussière s’étant dissipée, apparut un cheval noir, au front étoilé d’une tache blanche comme une drachme d’argent, beau, proportionné, fier, luisant, et les pieds entourés, à l’endroit qui sied, d’une couronne de poils blancs ; et il arrivait vers nous en hennissant d’une voix fort agréable. Et lorsqu’il vit mon ami le jeune lion, il s’arrêta en son honneur et voulut se retirer par discrétion. Mais le lion, extrêmement charmé de son élégance et séduit par son aspect, lui dit : « Qui donc es-tu, ô bel animal ? Et pourquoi cours-tu de la sorte dans cette immense solitude, et as-tu l’air si inquiet ? » Il répondit : « Ô roi des animaux, je suis un cheval d’entre les chevaux ! Et je suis en fuite pour éviter l’approche d’Ibn-Adam ! »
« À ces paroles, le lion fut à la limite de l’étonnement et dit au cheval : « Ne parle donc pas ainsi, ô cheval, car c’est vraiment honteux pour toi d’avoir peur d’Ibn-Adam, fort comme tu es et doué de cette carrure et de cette taille, et alors que tu peux d’un seul coup de pied le faire passer de vie à trépas ! Regarde-moi ! je ne suis pas si grand que toi, et pourtant j’ai promis à cette gentille oie qui tremble, de la débarrasser à jamais de ses terreurs en attaquant et tuant Ibn-Adam et en le mangeant entièrement. Et alors je me ferai un plaisir de réintégrer cette pauvre oie dans sa maison au milieu de sa famille ! »
« Lorsque le cheval eut entendu ces paroles de mon ami, il le regarda avec un sourire triste et lui dit : « Rejette loin de toi de telles pensées, ô fils du sultan, et ne t’illusionne pas de la sorte sur ma force et ma taille et ma vitesse, car tout cela est vain devant l’astuce d’Ibn-Adam. Et sache bien que lorsque je suis entre ses mains, il trouve le moyen de me dompter à sa guise. À cet effet, il me met aux pieds des entraves de chanvre et de crin, et m’attache par la tête à un poteau planté plus haut que moi dans le mur ; et de la sorte je ne puis ni bouger, ni m’asseoir ni me coucher. Mais ce n’est pas tout ! Lorsqu’il veut me monter, il me met sur le dos quelque chose qu’il appelle une selle, et me comprime le ventre avec deux larges sangles fort dures qui me meurtrissent ; dans la bouche il me met un morceau d’acier qu’il tire au moyen de courroies pour me diriger où il lui plaît ; et, une fois sur mon dos, il me pique et me perfore les flancs avec les pointes de ce qu’il appelle les étriers, et me met ainsi tout le corps en sang ! mais ce n’est pas fini ! Lorsque je suis vieux, et que mon dos n’est plus assez souple ni assez résistant et que mes muscles ne peuvent me lancer aussi vite qu’il le voudrait, il me vend à quelque meunier qui me fait tourner nuit et jour la meule du moulin jusqu’à ma complète décrépitude. Alors il me vend à l’équarisseur qui m’égorge et m’écorche et vend ma peau aux tanneurs et mes crins aux fabricants de cribles, de tamis et de blutoirs ! Et tel est mon sort avec Ibn-Adam ! »
« Alors le jeune lion fut très affecté de ce qu’il venait d’entendre et demanda au cheval : « Je vois qu’il me faut absolument débarrasser la création de cet être de malheur que vous appelez tous Ibn-Adam. Dis-moi donc, ô cheval, où et quand as-tu aperçu Ibn-Adam ? » Le cheval dit : « Je l’ai quitté vers midi. Et il est maintenant à ma poursuite, courant de ce côté ! »
« Or, à peine le cheval venait-il d’achever ces paroles qu’une poussière s’éleva qui lui donna une telle terreur que, sans prendre le temps de s’excuser, il nous quitta au grand galop. Et nous vîmes du côté de la poussière apparaître et s’avancer vers nous à grandes enjambées, effaré et le cou tendu et mugissant éperdument, un chameau.
« À l’aspect de ce grand animal, démesurément colossal, le lion fut persuadé que ce devait être Ibn-Adam et, sans me consulter, il s’élança sur lui et allait bondir et l’étrangler quand je lui criai de toute ma voix : « Ô fils du sultan, arrête ! ce n’est point un Ibn-Adam, mais un brave chameau, le plus inoffensif des animaux ! Et sûrement il fuit l’approche d’Ibn-Adam ! » Alors le jeune lion s’arrêta à temps et, tout interloqué, demanda au chameau : « Vraiment, toi aussi, ô prodigieux animal, tu as peur de cet être-là ? Que fais-tu donc de tes énormes pieds si tu ne peux lui en écraser la face ? » Et le chameau haussa lentement la tête et, les yeux perdus comme dans un cauchemar, répondit tristement : « Ô fils du sultan, regarde mes narines ! Elles sont encore trouées et fendues de l’anneau en crin qu’Ibn-Adam m’y avait passé pour me dompter et me diriger ; et à cet anneau était fixée une corde qu’lbn-Adam confiait au plus petit des enfants, lequel pouvait ainsi, monté sur un tout petit âne, me conduire à sa guise, moi et toute une bande d’autres chameaux à la file les uns des autres ! Regarde mon dos ! il est encore bossué de tous les fardeaux dont depuis des siècles on ne cesse de le charger ! Regarde mes jambes ! Elles sont calleuses et fourbues des longues courses et des voyages forcés à travers les sables et les pierres ! Mais ce n’est pas tout ! Sache que lorsque je me fais vieux, après tant de nuits sans sommeil et tant de jours sans repos, loin d’avoir des égards pour ma vieillesse et ma patience, il sait encore tirer parti de ma vieille peau et de mes vieux os, en me vendant au boucher qui vend ma chair aux pauvres et mon cuir aux tanneurs et mon poil aux fileurs et aux tisserands ! Et voilà le traitement régulier que me fait subir Ibn-Adam ! »
« À ces paroles du chameau, le jeune lion fut pris d’une indignation sans bornes ; et il rugit et agita ses mâchoires et frappa le sol de ses pattes ; puis il dit au chameau : « Hâte-toi de me dire où tu as laissé Ibn-Adam ! » Et le chameau dit : « Il est à ma recherche et ne va pas tarder à apparaître. Aussi, de grâce, ô fils du sultan, laisse-moi émigrer et m’enfuir vers d’autres pays que mon pays natal ! Car ni les solitudes du désert ni les terres les plus inconnues ne sauraient assez me cacher à ses investigations ! » Alors le lion lui dit : « Ô chameau, crois-moi ! attends encore un peu et tu verras comment je vais assaillir Ibn-Adam et le jeter à terre et lui broyer les os et boire son sang et faire nourriture de sa chair ! » Mais le chameau répondit, tandis que des frissons lui agitaient par nappes toute la peau : « Permets ! ô fils du sultan, je préfère encore m’en aller, car le poète a dit :
« Si sous la tente même qui t’abrite, et dans le pays même qui t’appartient, vient habiter un visage désagréable,
Un seul parti te reste à prendre : laisse-lui ta tente et ton pays et hâte-toi de décamper ! »
« Et, ayant récité cette strophe si juste, le bon chameau baisa la terre entre les mains du lion et se releva ; et bientôt nous le vîmes tanguer vers le loin.
« Or, à peine avait-il disparu que soudain, sortant de je ne sais où, un petit vieux, à l’aspect d’homme chétif, l’air rusé, la peau ratatinée, apparut, portant sur les épaules un panier où se trouvaient des ustensiles de menuisier, et sur la tête huit grandes planches de bois.
« À sa vue, ô mes maîtres, je n’eus pas la force seulement de jeter un cri ou d’avertir mon jeune ami, et je tombai paralysée sur le sol. Quant au jeune lion, très amusé par l’aspect de ce petit être drôle, il s’avança vers lui pour l’examiner de plus près ; et le menuisier s’aplatit à terre devant lui et lui dit en souriant et d’une voix très humble : « Ô roi puissant et plein de gloire, ô toi qui occupes le plus haut rang dans la création, je te souhaite le bonsoir et demande à Allah de te hausser encore dans le respect de l’univers et d’augmenter tes forces et tes vertus ! Or, moi je suis un opprimé qui viens te demander aide et protection dans les malheurs qui me poursuivent de la part de mon ennemi ! » Et il se mit à pleurer, à gémir et à soupirer.
« Alors le jeune lion, fort touché de ses larmes et de son aspect malheureux, adoucit sa voix et lui demanda : « Qui donc t’a opprimé ? Et qui donc es-tu, ô toi le plus éloquent de tous les animaux que je connaisse, et le plus poli, bien que tu sois de beaucoup le plus laid d’entre eux tous ? » L’autre répondit : « Ô seigneur des animaux, pour ce qui est de mon espèce, j’appartiens à l’espèce des menuisiers ; mais pour ce qui est de mon oppresseur, c’est Ibn-Adam ! Ah ! seigneur lion, qu’Allah te préserve des perfidies d’Ibn-Adam ! Tous les jours, dès l’aube, il me fait travailler pour son bien-être ; et jamais il ne me paie ; aussi, crevant de faim, j’ai renoncé à travailler pour son compte, et j’ai pris la fuite loin des villes où il habite ! »
« À ces paroles, le jeune lion entra dans une fureur considérable ; il rugit, il bondit, il souffla et il écuma ; et ses yeux lancèrent des étincelles ; et il s’écria : « Mais où est-il enfin cet Ibn-Adam calamiteux, que je le broie entre mes dents et que je venge toutes ses victimes ? » L’homme répondit : « Tu vas le voir poindre tout à l’heure ; car il est à ma poursuite, furieux de n’avoir plus personne qui lui charpente ses maisons ! » Le lion lui demanda : « Mais toi-même, animal menuisier, qui marches d’un pas si petit et si mal assuré sur tes deux pattes, de quel côté te diriges-tu ? » L’homme répondit : « Je vais directement trouver le vizir du roi ton père, le seigneur léopard qui m’a envoyé chercher par un animal de ses émissaires, pour lui construire une cabane solide où s’abriter et se défendre contre les assauts d’Ibn-Adam, depuis que le bruit s’est répandu de l’arrivée prochaine d’Ibn-Adam dans ces parages ! Et c’est pour cela que tu me vois porteur de ces planches de bois et de ces ustensiles ! »
« Lorsque le jeune lion eut entendu ces paroles, il fut très jaloux du léopard, et dit au menuisier : « Par ma vie ! ce serait une audace extrême de la part du vizir de mon père que de prétendre à faire exécuter ses commandes avant les nôtres ! Tu vas sur l’heure t’arrêter ici, et commencer par me construire, à moi d’abord, cette cabane ! Quant au seigneur vizir, il peut attendre ! » Mais le menuisier fit mine de s’en aller et dit au jeune lion : « Ô fils du sultan, je te promets de revenir sitôt fini le travail commandé par le léopard ; car j’ai bien peur de sa colère ! Et je te bâtirai alors non point une cabane, mais un palais ! » Mais le lion ne voulut rien entendre, et entra même en colère, et se jeta sur le menuisier, pour lui faire peur seulement, et, en manière de plaisanterie, il lui appliqua la patte sur la poitrine. Et, rien que de cette simple caresse, le petit homme perdit l’équilibre, et roula à terre avec ses planches et ses ustensiles. Et le lion éclata de rire en voyant la terreur et la mine déconfite du misérable bonhomme. Et celui-ci, bien qu’intérieurement mortifié à l’extrême, n’en fit rien voir, et même se mit à sourire d’un sourire flagorneur, et lâchement se mit à l’œuvre. Or, c’était là le but qu’il souhaitait et pour lequel il était venu !
« Il prit donc soigneusement la mesure du lion dans tous les sens, et en quelques instants il construisit une caisse solidement charpentée, à laquelle il ne laissa qu’une étroite ouverture ; et il cloua à l’intérieur de grands clous dont la pointe était tournée vers le dedans et d’avant en arrière ; et il ménagea par-ci par-là quelques trous pas bien grands ; et, cela fait, il invita respectueusement le lion à prendre possession de son bien. Mais le lion hésita d’abord et dit à l’homme : « En vérité cela me parait bien étroit, et je ne vois point comment je puis y pénétrer ! » L’homme dit : « Baisse-toi et entre en rampant ; car une fois là-dedans, tu t’y trouveras fort à l’aise ! » Alors le lion se baissa, et son corps souple glissa à l’intérieur ne laissant au dehors que la queue. Mais le menuisier se hâta d’entortiller cette queue et de la fourrer vivement avec le reste et, en un clin d’œil, il boucha l’ouverture et la cloua solidement !
« Alors le lion essaya d’abord de bouger et de reculer, mais les pointes acérées des clous lui pénétrèrent dans la peau et l’embrochèrent de tous côtés ; et il se mit à rugir de douleur ; et il cria : « Ô menuisier, qu’est-ce donc que cette maison étroite que tu as construite et ces pointes qui me pénètrent cruellement ? »
« À ces paroles, l’homme jeta un cri de triomphe et se mit à sauter et à ricaner et dit au lion : « Ce sont là les pointes d’Ibn-Adam ! Ô chien du désert, tu apprendras à tes dépens que moi, Ibn-Adam, malgré ma laideur, ma lâcheté et ma faiblesse, je puis triompher du courage, de la force et de la beauté ! »
« Et, ayant dit ces paroles effroyables, le misérable alluma une torche, amassa des fagots autour de la caisse et fit tout flamber. Et moi, plus paralysée que jamais de terreur et d’épouvante, je vis mon pauvre ami brûler vif et mourir ainsi de la plus cruelle mort. Et Ibn-Adam, sans m’avoir aperçue, vu que j’étais étendue sur le sol, s’éloigna triomphant.
« Alors moi, longtemps après, je pus me relever et je m’éloignai, l’âme pleine d’effroi, dans une direction opposée. Et c’est ainsi que je pus arriver jusqu’ici, et que le destin me fit vous rencontrer, ô mes maîtres à l’âme compatissante ! »
Lorsque le paon et son épouse eurent entendu ce
récit de l’oie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT QUARANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Lorsque le paon et son épouse eurent entendu ce récit de l’oie, ils furent émus à la limite de l’émotion, et la paonne dit à l’oie : « Ma sœur, nous sommes ici en sûreté ; reste donc avec nous, tant qu’il te plaira, et jusqu’à ce qu’Allah te rende la paix du cœur, le seul bien estimable après la santé ! Reste donc, et tu partageras notre sort bon ou mauvais ! » Mais l’oie dit : « J’ai bien peur, bien peur ! » La paonne reprit : « Il ne faut pas, vraiment ! En voulant à tout prix échapper au sort qui t’a été écrit, tu tentes la destinée ! Or, elle est la plus forte ! Et ce qui est écrit sur notre front doit courir ! Et toute échéance doit être payée ! Si donc notre terme a été fixé, nulle force ne saurait l’annuler ! Mais ce qui doit surtout te tranquilliser et te consoler, c’est la conviction que toute âme ne peut mourir avant d’avoir épuisé les biens qui lui sont dus par le Juste Rétributeur ! »
Or, pendant qu’ils s’entretenaient de la sorte, les branches autour d’eux craquèrent et un bruit de pas se fit entendre qui troubla tellement la tremblante oie qu’elle étendit éperdument ses ailes et se jeta à la mer en criant : « Garde à vous ! garde à vous ! bien que toute destinée doive s’accomplir ! »
Mais ce n’était qu’une fausse alerte, car, entre les branches écartées, apparut la tête d’un joli chevreuil aux yeux humides. Et la paonne cria à l’oie : « Ma sœur, ne t’effraie donc pas ainsi ! Reviens vite ! Nous avons un hôte nouveau ! c’est un gentil chevreuil, de la race des animaux, comme tu es de la race des oiseaux ; et il ne mange guère de viande saignante, mais de l’herbe et des plantes de la terre ! Viens ! et ne te mets plus dans un pareil état, car rien n’exténue le corps et n’épuise l’âme autant que l’appréhension et les soucis ! »
Alors l’oie revint en mouvant ses hanches ; et le chevreuil, après les salams d’usage, leur dit : « C’est la première fois que je viens de ce côté ; et je n’ai jamais vu terre plus fertile ni plantes et herbes plus fraîches et plus tentantes ! Permettez-moi donc de vous tenir compagnie et de jouir avec vous des bienfaits du Créateur ! » Et tous les trois lui répondirent : « Sur nos têtes et sur nos yeux, ô chevreuil plein de savoir-vivre ! tu trouveras ici aisance, famille et facilité ! » Et tous se mirent à manger, à boire et à respirer ensemble le bon air, pendant un long espace de temps. Mais ils ne négligèrent jamais de faire leurs prières matin et soir ; excepté l’oie qui, assurée désormais de la paix, oubliait ses devoirs envers le Distributeur de la sécurité !
Or, elle paya bientôt de la vie cette ingratitude envers Allah !
En effet, un matin, un navire désemparé fut jeté à la côte ; et les hommes abordèrent dans l’île et, ayant aperçu le groupe formé par le paon, son épouse, l’oie et le chevreuil, s’en approchèrent vivement. Alors les deux paons s’envolèrent au loin sur la cime des arbres, le chevreuil s’élança et en quelques bonds fut hors de portée, et seule l’oie resta embrouillée de sa personne et essaya de courir de tous côtés ; mais on eut bientôt fait de la cerner et de la capturer pour la manger comme premier repas dans l’île.
Quant au paon et à son épouse, avant de quitter l’île pour regagner leur forêt natale, ils vinrent en cachette se rendre compte du sort de l’oie et la virent au moment où on l’égorgeait. Alors ils cherchèrent un peu partout leur ami le chevreuil et, après les salams et les félicitations mutuelles pour le danger auquel ils venaient d’échapper, ils mirent le chevreuil au courant de l’infortune finale de la pauvre oie. Et tous trois pleurèrent beaucoup à son souvenir et la paonne dit : » Elle était bien douce et modeste et si gentille ! » Et le chevreuil dit : « C’est vrai ! mais dans les derniers temps elle négligeait les devoirs envers Allah, oubliant de le remercier pour ses bienfaits ! » Alors le paon dit : « Ô fille de mon oncle, et toi, chevreuil pieux, prions ! » Et tous les trois baisèrent la terre entre les mains d’Allah et s’écrièrent :
« Béni soit le Juste, le Rétributeur, le Maître Souverain de la Puissance, l’Omniscient, le Très-Haut !
Gloire au Créateur de tous les êtres, au Veilleur sur chacun de tous les êtres, au Rétributeur à chacun selon ses mérites et sa capacité !
Loué soit Celui qui a déployé les cieux et les a arrondis et les a illuminés ; Celui qui a étendu la terre et la robe de la terre de chaque côté des mers, et l’a ornée de toute sa beauté ! »
— Alors, ayant raconté cette histoire, Schahrazade s’arrêta un instant. Et le roi Schahriar s’écria : « Que cette prière est admirable et que ces animaux sont bien doués ! Mais, ô Schahrazade, est-ce là tout ce que tu connais sur les animaux ? » Et Schahrazade dit : « Cela n’est rien, ô Roi, en comparaison de que je pourrais t’en raconter ! » Et Schahriar dit : « Mais qu’attends-tu donc pour continuer ? » Schahrazade dit : « Avant de continuer l’Histoire des animaux, je veux te raconter, ô Roi, une histoire qui confirmera la conclusion de la précédente, à savoir combien la prière est agréable au Seigneur ! » Et le roi Schahriar dit : « Mais certainement ! »
Alors Schahrazade dit :
LE BERGER ET L’ADOLESCENTE
On raconte qu’il y avait, dans une montagne d’entre les montagnes des pays musulmans, un berger doué d’une grande sagesse et d’une foi ardente ; et ce berger menait une vie paisible et retirée, se contentant de son sort et vivant du produit, en lait et en laine, de son troupeau. Et ce berger avait en lui tant de douceur et sur lui tant de bénédictions que les bêtes sauvages n’attaquaient jamais son troupeau, et le respectaient lui-même tellement que lorsqu’elles le voyaient de loin elles le saluaient de leurs cris et de leurs hurlements. Et ce berger continua à vivre ainsi un long temps, ne se souciant guère, pour son plus grand bonheur et sa tranquillité, de ce qui se passait dans les villes de l’univers.
Or, un jour, Allah Très-Haut voulut éprouver le degré de sa sagesse et la valeur réelle de ses vertus, et ne trouva guère d’autre tentation plus forte, pour l’éprouver, que de lui envoyer la beauté de la femme. Il chargea donc l’un de ses anges de se déguiser en femme et de ne rien épargner des artifices de cette créature pour faire fauter le saint berger.
Aussi, un jour que le berger, malade depuis un certain temps, était étendu dans sa grotte et glorifiait en son âme le Créateur, il vit soudain entrer chez lui, souriante et fine, une adolescente aux yeux noirs qui pouvait bien passer aussi pour un adolescent. Et du coup la grotte en fut parfumée, et le berger sentit sa vieille chair frissonner. Mais il fronça les sourcils et se renfrogna dans son coin et dit à l’intruse : « Que viens-tu faire ici, ô femme que je ne connais pas ? Je ne t’ai point appelée et n’ai besoin nullement de toi ! » L’adolescente alors s’approcha et s’assit tout près du vieillard et lui dit : « Homme, regarde-moi ! Je ne suis point femme, mais vierge encore, et je viens m’offrir à toi pour mon plaisir simplement, et pour ce que j’ai appris de ta vertu ancienne déjà ! » Mais le vieillard s’écria : « Ô tentatrice de l’enfer, éloigne-toi ! Et laisse-moi m’anéantir dans l’adoration de Celui qui ne meurt pas ! » Mais l’adolescente fit mouvoir lentement la souplesse de sa taille et regarda le vieillard qui essayait de reculer, et soupira : « Dis ! pourquoi ne veux-tu pas de moi ! Je t’apporte une âme soumise et un corps sur le point de fondre de désir ! Vois si ma gorge n’est pas plus blanche que le lait de tes brebis ! si ma nudité n’est pas plus fraîche que l’eau du rocher ! Touche ma chevelure, ô berger ! Elle est plus soyeuse à tes doigts que le duvet de l’agneau dans le ventre de sa mère ! Mes hanches sont tièdes et glissantes et se dessinent à peine, dans ma floraison première. Et mes petits seins qui se gonflent déjà, si seulement d’un doigt rapide tu les frôlais, ils frémiraient ! Viens !… mes lèvres que je sens vibrer te fondront dans ta bouche. Viens !… Viens !… j’ai des dents dont les morsures infusent la vie aux vieillards mourants, et du miel prêt à tomber goutte à goutte de tous les pores de ma chair ! Viens ! »
Mais le vieillard s’écria, bien que sa barbe tremblât de tous ses poils : « Recule, ô démon ! ou je vais te chasser avec ce bâton noueux ! »
Alors l’adolescente du ciel, d’un geste éperdu, lui jeta les bras autour du cou, et dans l’oreille lui murmura : « Je suis un fruit acide, doux à peine : mange-le et tu guériras ! Connais-tu l’odeur du jasmin ? … Elle te serait odeur grossière, si tu sentais ma virginité ! »
Mais le vieillard s’écria : « Le parfum de la prière est le seul qui ne s’en aille pas ! Hors d’ici, ô séductrice ! » Et il la repoussa de ses deux bras !
Alors la jeune fille se leva et, légère, se dévêtit entièrement et se tint droite et nue, blanche et baignée dans les flots de ses cheveux ! Et l’appel de son silence, dans cette solitude de grotte, était plus terrible que tous les cris du délire. Et le vieillard ne put s’empêcher de gémir et, pour ne plus voir ce lys vivant, il se couvrit la tête de son manteau et s’écria : « Va-t’en ! Va-t’en ! ô femme aux yeux de trahison ! Depuis la naissance du monde tu es la cause de nos calamités ! Tu as perdu les hommes des premiers âges, et tu jettes la discorde entre les enfants de la terre ! Celui qui te cultive renonce pour toujours aux joies infinies que seuls pourront goûter ceux qui te rejettent de leur vie ! » Et le vieillard enfonça davantage sa tête dans les plis du manteau.
Mais l’adolescente reprit : « Que parles-tu des anciens ? Les plus sages d’entre eux m’ont adorée, et les plus sévères m’ont chantée ! Et ma beauté ne les a point fait dévier de la voie droite, mais les a éclairés dans le chemin et a fait les délices de leur vie. La vraie sagesse, ô berger, est de tout oublier dans mon sein ! Reviens à la sagesse ! Je suis toute prête à m’ouvrir à toi et à t’abreuver de la vraie sagesse ! »
Alors le vieillard se tourna entièrement du côté du mur et s’écria : « Arrière, ô pleine de malice ! Je t’abomine et je te vomis ! Que d’hommes admirables tu as trahis et que de méchants tu as sauvegardés ! Ta beauté est menteuse ! Car à celui qui sait prier apparaît une beauté invisible à ceux qui te regardent ! Arrière ! »
À ces paroles, l’adolescente s’écria : « Ô saint berger ! bois le lait de tes brebis et habille-toi de leur laine, et prie ton Seigneur dans la solitude et dans la paix de ton cœur ! » Et la vision disparut.
Alors, de tous les points de la montagne, vers le berger accoururent les animaux sauvages, qui baisèrent la terre entre ses mains pour lui demander sa bénédiction !
— À ce moment de sa narration, Schahrazade s’arrêta, et le roi Schahriar, devenu triste soudain, lui dit : « Ô Schahrazade, en vérité, l’exemple du berger me donne à réfléchir ! Et je ne sais s’il ne vaut pas mieux pour moi me retirer dans une grotte et fuir à tout jamais les soucis de mon royaume, et pour toute occupation mener paître des brebis ! Mais je veux d’abord entendre la suite de l’Histoire des Animaux et des Oiseaux ! »
LA CENT QUARANTE-HUITIÈME NUIT
Schahrazade dit :
CONTE DE LA TORTUE ET DE L’OISEAU-PÊCHEUR
Dans un de mes livres anciens il est raconté, ô Roi
fortuné, qu’un oiseau-pêcheur se tenait un jour sur
la berge d’un fleuve et observait attentivement, le
cou tendu, le fil de l’eau. Car tel était le métier qui
lui permettait de gagner sa vie et de nourrir ses enfants,
et il l’exerçait sans paresse, en s’acquittant
fort honnêtement des charges de son état.
Or, pendant qu’il surveillait de la sorte le moindre remous et la plus légère ondulation, il vit passer devant lui, et s’arrêter contre la roche où il était en observation, un grand corps mort de race humaine. Alors il l’examina et remarqua des blessures considérables sur toutes ses parties, et des traces de coups de sabre et de coups de lance ; et il pensa en son âme : « Ce doit être quelque brigand à qui l’on a fait expier ses méfaits ! » Puis il leva ses ailes et bénit le Rétributeur, disant : « Béni soit Celui qui fait servir les méchants après leur mort au bien-être de ses bons serviteurs ! » Et il se disposa à fondre sur le corps et à en enlever des lambeaux pour les apporter à ses petits et les manger avec eux. Mais il vit bientôt au-dessus de lui le ciel s’obscurcir d’un nuage de grands oiseaux de proie, tels que vautours et éperviers, qui se mirent à tournoyer par grands cercles se rapprochant de plus en plus.
À cette vue, l’oiseau-pêcheur fut saisi de la crainte d’être dévoré lui-même par ces loups de l’air et se hâta de déguerpir à tire-d’aile vers le loin. Et au bout de plusieurs heures il s’arrêta sur la cime d’un arbre qui se trouvait au milieu du fleuve, tout à fait vers son embouchure, et attendit là que le courant eût entraîné jusqu’à cet endroit le corps flottant. Et, tout triste, il se mit à songer aux vicissitudes du sort et à son inconstance ; et il se disait : « Voici que je suis obligé de m’éloigner de mon pays et de la berge qui m’a vu naître et où sont mes enfants et mon épouse. Ah ! que ce monde est vain ! Et combien plus vain celui qui se laisse tromper par ses dehors et qui, confiant dans la chance, vit au jour le jour sans se soucier du lendemain ! Si j’avais été plus sage, j’eusse amassé des provisions pour les jours de disette comme celui-ci ; et les loups de l’air eussent pu venir me disputer mon gain, sans me donner trop d’inquiétude ! Mais le sage nous conseille la patience dans l’épreuve. Patientons ! »
Or, pendant qu’il réfléchissait de la sorte, il vit s’avancer vers l’arbre où il était perché, sortant de l’eau et nageant lentement, une tortue. Et cette tortue leva la tête et l’aperçut sur l’arbre et aussitôt lui souhaita la paix et lui dit : « Comment se fait-il, ô pêcheur, que tu aies déserté la berge où d’ordinaire je te rencontrais ? » Il répondit :
« Si sous la tente même qui t’abrite, et dans le pays même qui t’appartient, vient habiter un visage désagréable,
Un seul parti te reste à prendre : laisse-lui ta tente et ton pays et hâte-toi de décamper !
« Et moi, ô bonne tortue, j’ai vu ma berge prête à être envahie par les loups de l’air, et pour ne pas être affecté par leur visage désagréable, j’ai préféré tout quitter et m’en aller, jusqu’à ce qu’Allah veuille bien compatir à mon sort ! »
Lorsque la tortue eut entendu ces paroles, elle dit à l’oiseau-pêcheur : « Du moment que cela est ainsi, me voici entre tes mains prête à te servir de tout mon dévouement, et à te tenir compagnie dans ton abandon et ton dénuement, car je sais combien l’étranger est malheureux loin de son pays et des siens et combien il lui est doux de trouver une chaleur d’affection et de la sollicitude chez les inconnus. Or, moi qui ne te connais que de vue seulement, je serai pour toi une compagne attentive et cordiale ! »
Alors l’oiseau-pêcheur lui dit : « Ô tortue pleine de cœur, ô dure à la surface et si douce au dedans ! je sens que je vais pleurer d’émotion devant la spontanéité de ton offre ! Comme je te remercie ! Et combien tu as raison dans tes paroles sur l’hospitalité à accorder aux étrangers et sur l’amitié à accorder aux personnes dans l’infortune, pourvu que ces personnes ne soient pas dénuées d’intérêt ! Car, en vérité, que serait la vie sans les amis et sans les causeries avec les amis et sans le rire et le chant avec les amis ? Le sage est celui qui sait trouver des amis conformes à son tempérament, et l’on ne peut tenir pour amis les êtres qu’on est obligé de fréquenter du fait de son métier, comme moi je fréquentais les oiseaux-pêcheurs de mon espèce, qui me jalousaient et m’enviaient pour mes pêches et mes trouvailles ! Aussi comme maintenant ils doivent être heureux de mon éloignement, ces camarades mesquins, stupides et qui ne savent parler que de leurs pêches et causer que de leurs petits intérêts, mais qui jamais ne pensent à élever leurs âmes vers le Donateur ! Ils ont ainsi toujours le bec tourné vers la terre. Et s’ils ont des ailes, c’est pour ne point s’en servir ! Aussi la plupart d’entre eux ne pourraient même plus voler, s’ils le voulaient : ils ne peuvent que plonger, et souvent ils restent au fond de l’eau ! »
À ces paroles, la tortue, qui écoutait en silence, s’écria : « Ô pêcheur, descends que je t’embrasse ! » Et l’oiseau-pêcheur descendit de l’arbre, et la tortue l’embrassa entre les deux yeux et lui dit : « En vérité, ô mon frère, tu n’es pas fait pour vivre en commun avec les oiseaux de ta race, qui sont tout à fait dénués de finesse et n’ont rien d’exquis dans les manières. Reste donc avec moi, et la vie nous sera légère sur ce coin de terre perdu au milieu de l’eau, à l’ombre de cet arbre et au bruit que font les flots ! » Mais l’oiseau-pêcheur lui dit : « Que je te remercie, ô tortue, ma sœur ! mais, et les enfants ? et l’épouse ? » Elle répondit : « Allah est grand et miséricordieux ! Il nous aidera à les transporter jusqu’ici ! Et nous passerons encore des jours tranquilles et à l’abri de tout souci ! » À ces paroles l’oiseau-pêcheur dit : « Ô tortue, remercions ensemble le Très-Bon qui a permis notre réunion ! » Et tous deux s’écrièrent :
« Louange à Notre Maître ! À l’un il donne la richesse et à l’autre il jette la pauvreté. Ses desseins sont sages et calculés.
Louange à Notre Maître ! Que de pauvres, riches de sourire ! et que de riches, pauvres de gaieté ! »
— À ce moment de sa narration Schahrazade vit apparaître
le matin et, discrète, se tut. Alors le roi Schahriar
lui dit : « Ô Schahrazade, tes paroles ne font que me confirmer
dans le retour vers des pensers moins farouches.
Aussi je voudrais bien savoir si tu ne connais point d’histoires
de loups, par exemple, ou d’autres animaux aussi
sauvages ! » Et Schahrazade dit : « Ce sont justement les
histoires que je connais le mieux ! » Alors le roi Schahriar
lui dit : « Hâte-toi donc de me les narrer ! » Et
Schahrazade les lui promit pour la nuit prochaine.
LA CENT QUARANTE-NEUVIÈME NUIT
Schahrazade dit :
CONTE DU LOUP ET DU RENARD
Sache, ô Roi fortuné, que le renard, fatigué, à la
fin, des colères continues de son seigneur le loup,
et de sa férocité à tout propos, et de ses empiétements
sur les derniers droits qui lui restaient à lui
renard, s’assit un jour sur un tronc d’arbre et se mit
à réfléchir. Puis il bondit soudain, plein de joie, à
une pensée qui lui passa et lui parut être la solution.
Et il se mit aussitôt à la recherche du loup qu’il finit
par rencontrer, et qu’il trouva les poils hérissés, la
face contractée et de fort méchante humeur. Alors
du plus loin qu’il l’eut aperçu, il embrassa la terre
et arriva devant lui humblement, les yeux baissés, et
attendit qu’on l’interrogeât. Et le loup lui cria :
« Qu’as-tu, fils de chien ? » Le renard dit : « Seigneur,
excuse ma hardiesse, mais j’ai une idée à t’exposer
et une prière à te faire, si tu veux bien m’accorder
une audience ! » Et le loup lui cria : « Sois peu prolixe
en paroles, puis tourne le dos au plus vite, ou
sinon je te casse les os ! » Alors le renard dit : « J’ai
remarqué, seigneur, que depuis un certain temps
Ibn-Adam nous faisait une guerre sans relâche ; par
toute la forêt on ne voit plus que trappes, embûches,
pièges de toutes sortes ! Un peu plus de ce
train-là et la forêt nous deviendrait inhabitable.
Aussi que dirais-tu d’une alliance entre tous les loups et tous les renards pour s’opposer en masse
aux attaques d’Ibn-Adam et lui défendre l’approche
de notre territoire ? »
À ces paroles, le loup cria au renard : « Je dis que tu es bien osé de prétendre à mon alliance et à mon amitié, misérable renard, fourbe et chétif ! Tiens ! attrape ça pour ton insolence ! » Et le loup allongea au renard un coup de patte qui l’aplatit sur le sol, à demi mort.
Alors le renard se ramassa en clopinant, mais se garda bien de montrer du ressentiment ; au contraire ! il prit son air le plus souriant et le plus contrit et dit au loup : « Seigneur, pardonne à ton esclave son manque de savoir-vivre et son peu de tact ! Il reconnaît ses torts qui sont grands ! Et si même il les eût ignorés, le coup terrible et mérité dont tu viens de le gratifier et qui aurait suffi à tuer un éléphant, les lui eût appris aisément ! » Et le loup, calmé un peu par l’attitude du renard, lui dit : « Soit ! mais cela t’apprendra pour une autre fois à ne point te mêler de ce qui ne te concerne pas ! » Le renard dit : « Que cela est juste ! En effet, le sage a dit : « Ne parle pas et ne raconte jamais rien avant que l’on ne t’en prie, et ne réponds jamais avant que l’on ne t’interroge ! Et n’oublie point de donner toute ton attention aux seules choses qui peuvent t’importer. Mais surtout garde-toi bien de prodiguer tes conseils à ceux qui ne les comprendraient pas, comme aussi aux méchants qui t’en voudraient pour le bien que tu leur aurais fait. »
Or, telles étaient les paroles que le renard disait au loup ; mais en lui-même il pensait : « Mon temps à moi viendra à son tour, et ce loup me paiera ses dettes jusqu’à la dernière obole ; car la morgue, la provocation, l’insolence et le sot orgueil appellent tôt ou tard le châtiment ! Humilions-nous donc jusqu’à ce que nous soyons puissant ! » Puis le renard dit au loup : « Ô mon maître, tu n’ignores pas que l’équité est la vertu des puissants et la bonté et la douceur des manières les dons des forts et leur ornement ! Et Allah lui-même pardonne au coupable repentant. Or, moi, mon crime est énorme, je le sais, mais mon repentir ne l’est pas moins ; car ce coup douloureux dont, dans ta bonté, tu as bien voulu me gratifier, m’a, il est vrai, abîmé le corps, mais il a été un remède pour mon âme et une cause de jubilation ; comme nous l’enseigne le sage : « Le goût premier du châtiment que t’impose la main de ton éducateur est d’abord teinté d’une légère amertume, mais son arrière-goût est plus délicieux que le miel clarifié et sa douceur ! »
Alors le loup dit au renard : « J’accepte tes excuses et te pardonne ton faux pas et le dérangement que tu m’as causé en m’obligeant à t’asséner un coup ! Mais encore te faut-il te mettre à genoux la tête dans la poussière ! » Et le renard, sans hésiter, se mit à genoux et adora le loup en lui disant : « Qu’Allah te fasse toujours triompher et qu’il consolide ta domination ! » Alors le loup lui dit : « C’est bon ! Maintenant marche devant moi et sers-moi d’éclaireur. Et si tu vois quelque gibier, reviens vite m’en avertir ! » Et le renard répondit par l’ouïe et l’obéissance et se hâta de prendre les devants.
Or, il arriva à un terrain planté de vignes, où il ne fut pas long à remarquer, sur son passage, un endroit louche qui avait tout l’air d’être un piège ; et il fit un grand détour pour l’éviter, en se disant : « Celui qui marche sans regarder les trous qui sont sous ses pas est appelé à y glisser ! D’ailleurs mon expérience de tous les pièges qu’Ibn-Adam me dresse depuis le temps, doit me mettre sur mes gardes. Ainsi, par exemple, si je voyais une sorte d’effigie de renard dans une vigne, au lieu de m’en approcher, je m’enfuirais à toutes jambes, car ce serait sûrement un appât placé là par la perfidie d’Ibn-Adam ! Or, maintenant je vois, au milieu de ce vignoble, un endroit qui ne m’a pas l’air de bon aloi ! Attention ! retournons voir ce que c’est, mais avec prudence, car la prudence est la moitié de la bravoure ! » Et, ayant ainsi raisonné, le renard se mit à avancer peu à peu, mais en reculant de temps en temps, et en reniflant à chaque pas ; et il rampait et dressait l’oreille, puis avançait pour reculer ; et il finit par arriver de la sorte, sans encombre, jusqu’à la limite même de cet endroit si louche. Et bien lui en prit, car il put voir que c’était une fosse profonde recouverte à sa surface de légers branchages saupoudrés de terre. À cette vue, il s’écria : « Louange à Allah qui m’a doué de l’admirable vertu de la prudence et de bons yeux clairvoyants ! » Puis, à la pensée de voir bientôt le loup y donner tête baissée, il se mit à danser dans sa joie comme s’il était déjà grisé de tous les raisins de la vigne, et il entonna ce chant :
« Loup ! féroce loup ! ta fosse est creusée, et la terre toute prête à la combler.
Loup ! maudit, coureur de filles, mangeur de garçons, désormais tu mangeras les excréments que mon cul dans ta fosse fera pleuvoir sur ta gueule ! »
Et aussitôt il rebroussa chemin et alla retrouver le loup auquel il dit : « Je t’annonce la bonne nouvelle ! Ta fortune est grande et les bonheurs pleuvent sur toi, sans fatigue ! Que la joie soit continuelle dans ta maison et la jouissance également ! » Le loup lui dit : « Et que m’annonces-tu ? dis-le sans toutes ces longueurs ! » Le renard dit : « La vigne est belle aujourd’hui, et tout est dans la joie, car le propriétaire du vignoble est mort, et il est étendu au milieu de son champ sous des branches qui le recouvrent ! » Et le loup lui cria : « Qu’attends-tu alors, vil entremetteur, pour m’y conduire ! marche donc ! » Et le renard se hâta de le conduire au milieu du vignoble et, lui montrant l’endroit en question, lui dit : « C’est là ! » Alors le loup poussa un hurlement et d’un bond sauta sur les branches, qui cédèrent sous son poids. Et il roula au fond du trou. Lorsque le renard vit la chute de son ennemi, il fut dans une telle joie qu’avant de courir à la fosse se délecter de son triomphe, il se mit à bondir et, à la limite de la jubilation, il se récita ces strophes :
« Jubile, mon âme ! Tous mes désirs sont comblés, et la destinée m’apparaît souriante.
À moi les fiertés, la préséance dans les forêts et toutes les gloires de l’autorité !
À moi les vignes belles et les chasses fructueuses ; la bonne graisse des oies, les cuisses élastiques des canards, le derrière suave des poules et la tête rouge des coqs ! »
Et là-dessus, il fut en quelques sauts sur le rebord de la fosse, le cœur battant. Et quel ne fut pas son plaisir de voir le loup geindre et pleurer de sa chute et se désespérer en se lamentant sur sa perte certaine. Alors le renard se mit aussi notoirement à pleurer et à gémir ; et le loup leva la tête et le vit ainsi pleurer et lui dit : « Ô compagnon renard, que tu es bon de pleurer ainsi avec moi ! Aussi je vois que j’ai été parfois dur à ton égard ; mais, de grâce ! laisse pour le moment les larmes de côté et cours avertir mon épouse et mes enfants du danger où je suis et de la mort qui me menace ! » Alors le renard lui dit : « Ah ! chenapan, alors tu es assez stupide pour croire que c’est sur toi que je verse ces larmes ? Détrompe-toi, ô maudit ! Si je pleure, c’est parce que tu as vécu jusqu’aujourd’hui en sécurité, c’est parce que je regrette amèrement que cette calamité ne t’ait pas atteint avant aujourd’hui ! Meurs donc, loup de malheur ! Que j’aille enfin pisser sur ta tombe, et danser avec tous les renards sur la terre qui t’enfouira ! »
À ces paroles, le loup se dit en lui-même : « Il ne s’agit plus maintenant de le menacer ; lui seul peut encore me tirer de là ! » Alors il lui dit : « Ô compagnon, il n’y a encore qu’un moment, tu me jurais fidélité et tu me donnais mille marques de ta soumission ! Pourquoi donc ce changement ? Il est vrai que je t’ai un peu brusqué ! mais ne me garde pas rancune, et rappelle-toi ce qu’a dit le poète :
« Sème généreusement les grains de ta bonté, même sur les terrains qui te semblent stériles. Tôt ou tard le semeur récoltera les fruits de son grain multiplié au-delà de ses espérances. »
Mais le renard lui dit en ricanant : « Ô le plus insensé de tous les loups et de toutes les bêtes sauvages, oublies-tu donc toute l’horreur de ta conduite ? Et pourquoi ne connais-tu point ce conseil si sage du poète :
« N’opprimez point, car toute oppression appelle la vengeance, et toute injustice le contre-coup.
Car, si vous vous endormez une fois votre acte commis, l’opprimé ne dort que d’un œil, cependant que son autre œil vous guette sans cesse ; et l’œil d’Allah ne se ferme jamais !
« Or, tu m’as opprimé assez longtemps pour que maintenant à bon droit je me réjouisse de tes malheurs et me délecte de ton humiliation ! » Alors le loup dit : « Ô renard sage aux idées fertiles, à l’esprit inventif, tu es au-dessus de ces paroles, et sûrement tu ne les penses pas ; mais tu les dis seulement pour plaisanter. Or, en vérité, ce n’est point le moment ! Prends, je t’en prie, une corde quelconque et tâche d’en attacher un bout à un arbre pour me tendre l’autre bout ; et moi je grimperai par ce moyen et sortirai de ce fossé ! » Mais le renard se mit à rire et lui dit : « Tout doux, ô loup, tout doux ! Ton âme sortira d’abord la première, et ton corps le second ! Et les pierres et les cailloux dont on va te lapider feront fort bien cette séparation ! Ô grossier animal, aux idées lourdes et à l’esprit si peu perspicace, je compare volontiers ton sort à celui du faucon et de la perdrix ! »
À ces paroles, le loup s’exclama : « Je ne comprends guère ce que tu veux me dire par là ! » Alors le renard dit au loup :
« Sache, ô toi le loup, qu’un jour j’étais allé manger quelques grains de raisin dans une vigne. Pendant que j’étais là, à l’ombre du feuillage, je vis soudain fondre du haut des airs un grand faucon sur une petite perdrix. Mais la perdrix réussit à s’échapper des griffes du faucon et elle courut au plus vite se réfugier dans son gîte. Alors le faucon, qui l’avait poursuivie et n’avait pu la rattraper, s’arrêta devant le petit trou qui servait d’entrée au gîte et cria à la perdrix : « Petite folle qui me fuis ! Ignores-tu donc ma vigilance à ton égard et le bien que je te voulais ! Le seul motif pour lequel je t’avais attrapée, c’était que je te savais affamée depuis longtemps et que je voulais te donner du grain par moi amassé à ton intention. Viens donc, ma petite perdrix, ma gentille petite perdrix, sors de ton gîte sans crainte et viens manger ce grain ! Et que cela te soit agréable et de délicieuse digestion sur ton cœur, perdrix, mon œil, mon âme ! » Lorsque la perdrix eut entendu ce langage, confiante elle sortit de sa cachette ; mais aussitôt le faucon fondit sur elle et lui enfonça ses griffes terribles dans les chairs et d’un coup de bec l’éventra. Alors la perdrix, avant d’expirer lui dit : « Ô traître maudit, fasse Allah que ma chair se change en poison dans ton ventre ! » et elle mourut. Quant au faucon, il la dévora en un clin d’œil ; mais ce fut aussitôt sa punition par la volonté d’Allah ; car à peine la perdrix était-elle dans le ventre du traître que celui-ci vit tomber toutes ses plumes comme sous l’effet d’une flamme intérieure, et il roula lui-même inanimé sur le sol !
« Et toi, ô loup, continua le renard, tu es tombé dans la fosse, pour m’avoir rendu la vie bien dure et avoir humilié mon âme à la limite de l’humiliation ! »
Alors le loup dit au renard : « Ô compagnon, de grâce ! laisse de côté tous ces exemples que tu me cites et oublions le passé. Je suis bien assez puni comme ça, puisque me voilà dans ce trou, où je suis tombé au risque de me casser une jambe ou de me pocher un œil ou deux ! Cherchons à me tirer de ce mauvais pas, car tu n’ignores pas que l’amitié la plus solide est celle qui naît après un malheur secouru, et que l’ami vrai est plus près du cœur que le frère ! Aide-moi donc à me tirer de là et je serai pour toi le meilleur des amis et le plus sage des conseillers ! »
Mais le renard se mit à rire de plus belle et dit au loup : « Je vois que tu ignores les paroles des sages ! » Et le loup étonné lui demanda : « Quelles paroles et quels sages ? » Et le renard dit :
« Les sages, ô loup d’infection, nous enseignent que les gens comme toi, les gens au masque de laideur, à l’aspect grossier et au corps mal bâti, ont également une âme grossière et totalement dénuée de finesse ! » Or, que cela est vrai en ce qui te concerne ! Ce que tu m’as dit sur l’amitié est bien juste et ne supporte pas de contradiction, mais comme tu te leurres en voulant appliquer à ton âme de traître des paroles si belles ! Car, ô loup stupide, si vraiment tu étais si fertile en conseils judicieux, pourquoi ne trouverais-tu pas à toi seul le moyen de sortir de là-dedans ? Et si vraiment tu es aussi puissant que tu le dis, essaie donc de sauver ton âme d’une mort certaine ! Ah ! comme tu me rappelles l’histoire du médecin ! » — « Quel médecin encore ? » s’écria le loup. Et le renard dit :
« Il y avait un paysan qui était atteint d’une grosse tumeur à la main droite ; et cela l’empêchait de travailler. Aussi, à bout de moyens, il fit appeler un homme qu’on disait versé dans les sciences médicales. Et cet homme savant vint chez le malade, et il avait un bandeau sur un œil. Et le malade lui demanda : « Qu’as-tu à ton œil, ô médecin ? » Il répondit : « Une tumeur qui m’empêche de voir. » Alors le malade lui cria : « Tu as cette tumeur, et tu ne la guéris pas ? Et tu viens maintenant pour guérir ma tumeur à moi ? Tourne le dos et fais-moi voir la largeur de tes épaules ! »
« Et toi, ô loup de malédiction, avant de songer à me donner des conseils et à m’enseigner la finesse, sois donc assez fin pour te sauver de la fosse et te garder de ce qui va pleuvoir sur ta tête ! Sinon, reste à jamais là où tu es ! »
Alors le loup se mit à pleurer et, avant de se désespérer tout à fait, dit au renard : « Ô compagnon, je t’en prie, tire-moi de là, en l’approchant, par exemple, du rebord de la fosse et en me tendant le bout de la queue ! Et moi je m’y accrocherai et je sortirai de ce trou ! Et alors je te promets devant Allah de me repentir de toutes mes férocités passées, et je limerai mes griffes et je casserai mes grosses dents, pour ne même plus être tenté d’attaquer mes voisins ; après quoi je vêtirai la robe dure d’ascète et je me retirerai dans la solitude faire pénitence en ne mangeant plus que de l’herbe et en ne buvant plus que de l’eau ! » Mais le renard, loin de se laisser attendrir, dit au loup : « Et depuis quand peut-on si aisément changer sa nature ? Tu es loup et tu resteras loup, et ce n’est pas à moi que tu réussiras à faire croire à ton repentir ! Et d’ailleurs il faudrait que je fusse bien naïf pour te confier ma queue ! Je veux donc te voir mourir, car les sages ont dit : « La mort du méchant est un bien pour l’humanité, car elle purifie la terre !… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT CINQUANTIÈME NUIT
Elle dit :
« La mort du méchant est un bien pour l’humanité, car elle purifie la terre ! »
À ces paroles le loup se mordit la patte de désespoir et de rage contenue ; mais il adoucit encore davantage sa voix et dit au renard : « Ô renard, la race à laquelle tu appartiens est réputée chez tous les animaux de toute la terre pour ses manières exquises, sa finesse, son éloquence et la douceur de son tempérament. Cesse donc ce jeu qui ne peut être sérieux de ta part, et souviens-toi des traditions de ta famille ! » Mais le renard, à ces paroles, se mit à rire tellement qu’il s’évanouit. Mais il ne tarda pas à revenir à lui et dit au loup : « Je vois, ô brute merveilleuse, que ton éducation est entièrement à faire. Mais je n’ai guère le temps d’assumer une telle besogne, et veux seulement, avant que tu ne crèves, faire entrer dans tes oreilles quelques-unes des paroles des sages. Sache donc qu’il y a remède à tout, excepté à la mort ; qu’on peut tout corrompre, excepté le diamant ; et enfin qu’on peut échapper à tout, excepté à sa destinée !
« Quant à toi, tu m’as parlé tout à l’heure, je crois, de me récompenser au sortir de la fosse et de m’accorder ton amitié. Or, je te soupçonne fort semblable à ce serpent dont, sans doute, dans ton ignorance, tu ne connais guère l’histoire ! » Et, le loup ayant reconnu son ignorance à ce sujet, le renard dit :
« Oui, ô loup, il y avait une fois un serpent qui avait réussi à s’échapper d’entre les mains du jongleur. Et ce serpent, déshabitué du mouvement pour être resté si longtemps roulé dans le sac du jongleur, se traînait péniblement sur le sol, et il aurait certainement été repris par le jongleur ou écrasé, quand un passant charitable se trouva qui l’aperçut, le crut malade et, par pitié, le ramassa et le réchauffa. Or, le premier soin qu’eut le serpent en recouvrant sa vivacité fut de chercher l’endroit le plus délicat du corps de son sauveur et d’y enfoncer sa dent chargée de venin. Et l’homme tomba aussitôt mort sur le sol ! — Et d’ailleurs le poète avait déjà dit :
« Méfie-toi, joueur ! Quand la vipère adoucit son attouchement et se love câlinement, recule ! Elle va se détendre et son venin est dans ta chair avec la mort !
« Et puis, ô loup, il y a également ce vers admirable qui s’applique si bien à mon cas :
« Quand un jeune garçon a été si gentil avec toi et que tu le brusques, ne t’étonne pas s’il te garde rancune au fond de son foie, et s’il t’estropie un jour quand son bras s’est fait poilu !
« Or, moi, ô maudit, pour commencer ton châtiment et te donner un avant-goût des douceurs qui t’attendent et des belles pierres lisses qui vont te caresser la tête, au fond du trou, et en attendant que j’aille arroser ta tombe sans parcimonie, voici ce que je t’offre ! Lève donc la tête et regarde ! »
Et, ayant dit ces paroles, le renard tourna le dos, s’appuya de ses deux jambes de derrière sur le rebord de la fosse, et fit pleuvoir sur le visage du loup de quoi l’oindre et l’embaumer jusqu’à ses derniers instants.
Puis, cela fait, le renard monta sur le haut du talus, et il se mit à glapir avec rage pour appeler les maîtres et les gardions, qui ne tardèrent pas à accourir ; à leur approche, le renard se hâta de déguerpir et de se cacher, mais assez près pour voir les pierres énormes que lançaient dans la fosse les propriétaires contents, et pour entendre les hurlements d’agonie du loup, son ennemi ! »
— Ici Schahrazade se tut un moment pour boire un verre de sorbet que lui tendait la petite Doniazade, et le roi Schahriar s’écria : « Ah ! je brûlais d’impatience de voir la mort du loup ! Maintenant que c’est fait, je voudrais t’entendre me dire quelque chose sur la confiance naïve et irréfléchie et ses conséquences ! » Et Schahrazade dit : « J’écoute et j’obéis ! »
CONTE DE LA SOURIS ET DE LA BELETTE
Il y avait une femme dont le métier était de décortiquer
le sésame. Or, un jour, on lui apporta une
mesure de sésame de la meilleure qualité, en lui
disant : « Le médecin a prescrit à un malade de se
mettre exclusivement au régime du sésame ! El nous
t’en apportons pour qu’avec soin tu le nettoies et l’écosses ! » Et la femme le prit et se mit aussitôt à
l’œuvre et, au bout de la journée, elle l’avait nettoyé
et décortiqué. Et c’était plaisir de voir ce sésame
blanc, écossé, suggestif ! Aussi une belette qui rôdait
par là ne manqua pas d’être tentée considérablement
et, la nuit venue, elle se mit en devoir de le transporter
du plateau où il était à sa cachette. Et elle fit
si bien qu’au matin il ne restait plus sur le plateau
qu’une quantité infime de sésame.
Aussi la belette put juger, cachée dans son trou, de la surprise et de la colère de la décortiqueuse à l’aspect de ce plateau presque nettoyé de son contenu. Et elle l’entendit qui s’écriait : « Ah ! si je pouvais voir le voleur ! Ce ne peut être encore que ces maudites souris qui infestent ma maison, depuis la mort du chat ! Si j’en voyais une seulement, je lui ferais expier les méfaits de toutes ses semblables ! »
Lorsque la belette eut entendu ces paroles, elle se dit : « Il me faut absolument, pour me mettre complètement à l’abri du ressentiment de cette femme, la confirmer dans ses soupçons en ce qui concerne la souris. Sinon elle pourrait fort bien s’en prendre à moi et me casser le dos ! » Et aussitôt elle alla trouver la souris et lui dit : « Ô ma sœur, tout voisin se doit à son voisin ! Et il n’y a rien de plus repoussant qu’un voisin égoïste qui n’a aucune attention pour ceux qui habitent à côté de lui et qui, dans les occasions de joie, ne leur envoie rien des plats exquis que les femmes de la maison lui ont cuisinés, ni des douceurs et des pâtisseries préparées aux grandes fêtes ! » Et la souris répondit : « Que cela est vrai, ma bonne amie ! Aussi combien n’ai-je pas à me louer de ton voisinage, bien que tu ne sois ici que depuis quelques jours, et des bonnes intentions que tu me manifestes ! Fasse Allah que toutes les voisines soient aussi honnêtes et aussi avenantes que toi ! Mais qu’as-tu à m’annoncer ? » La belette dit : « La bonne femme qui est là, dans la maison, a reçu une mesure de sésame frais et appétissant au possible. Aussi elle et ses enfants en ont mangé tout leur plein, n’en laissant qu’une poignée ou deux. Je viens donc t’avertir de la chose, car j’aime mille fois mieux que ce soit toi qui en profites que ses goinfres d’enfants ! »
À ces paroles, la souris fut dans une telle allégresse qu’elle se mit à frétiller et à agiter la queue. Sans prendre le temps de la réflexion, sans remarquer l’air hypocrite de la belette, sans faire attention à la femme qui, silencieuse, guettait, et sans même se demander quel pouvait être le mobile qui poussait la belette à un tel acte de générosité, elle courut de toute sa vitesse et se précipita au milieu du plateau où brillait, éclatant et décortiqué, le sésame ! Et gloutonnement elle s’en emplit la bouche. Mais au même moment la femme sortit de derrière la porte et d’un coup de baguette fendit la tête à la souris !
Et c’est ainsi que la pauvre souris, par sa confiance imprudente, paya de sa vie le méfait d’autrui !
— À ces paroles, le roi Schahriar dit : « Ô Schahrazade, quelle leçon de prudence ce conte ne me donne-t-il pas Si je l’avais connu anciennement, il m’aurait gardé d’une confiance sans limites dans mon épouse, la débauchée que j’ai tuée de ma main, et dans les eunuques noirs, ces perfides qui ont aidé à la trahison !… Mais n’aurais-tu pas à me raconter quelque histoire sur l’amitié fidèle ? »
Et Schahrazade dit :
CONTE DU CORBEAU ET DE LA CIVETTE
Il m’est parvenu qu’un corbeau et une civette
s’étaient pris d’une solide amitié l’un pour l’autre
et passaient leurs heures de loisir en ébats et en
jeux divers. Or, un jour qu’ils causaient de choses
certainement intéressantes, car ils ne prêtaient
guère attention à ce qui se passait autour d’eux,
ils furent soudain rappelés à la réalité par le cri
effroyable du tigre, qui retentit dans la forêt.
Aussitôt le corbeau qui était en bas, perché sur le tronc de l’arbre à côté de son amie, se hâta de gagner les hautes branches ; quant à la civette, effarée, elle savait d’autant moins où se cacher, qu’elle n’était guère certaine de l’endroit d’où était parti le miaulement de la bête de proie. Dans cette perplexité elle dit au corbeau : « Mon ami, que faire ? Dis-moi, as-tu quelque moyen à m’indiquer ou quelque secours efficace à me donner ? » Le corbeau répondit : « Mais que ne ferais-je pas pour toi, ma bonne amie ? Me voici tout prêt à tout affronter pour te tirer d’embarras ; mais, avant de voler te porter secours, laisse-moi te dire ce qu’a dit le poète à ce sujet :
« La véritable amitié est celle qui vous pousse à vous jeter dans le péril pour, au risque de succombe, sauver l’objet aimé ;
C’est celle qui vous fait quitter biens, parents, famille, pour retrouver le frère de votre choix ! »
Puis, ayant récité ces vers, le corbeau se hâta de voler à tire d’aile vers un troupeau qui passait par là, gardé par de gros chiens plus imposants que des lions. Et il alla tout droit à l’un des chiens et s’abattit sur sa tête et lui donna un coup de bec d’importance. Puis il s’abattit sur un autre chien et fit de même ; et, ayant de la sorte excité tous les chiens, il se mit à voleter à une distance juste suffisante pour les attirer et se faire poursuivre par eux, sans toutefois être atteint par leurs dents. Et il croassait de toute sa voix, comme pour les narguer. Aussi les chiens, de plus en plus furieux, se mirent à le chasser, jusqu’à ce qu’il les eût attirés au milieu de la forêt. Alors, comme leurs aboiements avaient rempli toute la forêt, le corbeau jugea que le tigre, effrayé, avait dû s’enfuir ; et il vola pour de bon, laissant très loin derrière lui les chiens qui s’en retournèrent bredouille vers leur troupeau. Puis il vint retrouver son amie la civette qu’il avait sauvée ainsi d’un danger pressant, et il vécut avec elle en toute paix et en toute sécurité !
Mais j’ai hâte, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, de te raconter l’histoire du corbeau et du renard.
CONTE DU CORBEAU ET DU RENARD
Il est raconté qu’un vieux renard, dont la conscience
était chargée de maints méfaits et maintes
déprédations, s’était retiré au fond d’une gorge
giboyeuse, en emmenant avec lui son épouse. Et là
il continua à faire tant de ravages parmi le petit
gibier, qu’il dépeupla complètement toute la montagne
et finit, pour ne pas mourir de faim, par
manger d’abord ses propres enfants, qui étaient gras
à point, et, une nuit, par étrangler traîtreusement
son épouse, qu’il dévora en un instant ! Cela fait, il
ne lui resta plus rien à se mettre sous la dent.
Or, il était devenu trop vieux pour changer encore de place et il n’était plus assez agile pour chasser le lièvre et attraper au vol la perdrix. Pendant qu’il était absorbé par ces idées qui lui noircissaient le monde devant le visage, il vit se poser sur la cime d’un arbre un corbeau fatigué. Et aussitôt il pensa en son âme : « Si je pouvais décider ce corbeau à lier amitié avec moi, quelle bonne aubaine ce serait ! Il a de bonnes ailes qui lui permettent de faire la besogne à laquelle mes vieilles jambes percluses se refusent désormais ! Il m’apporterait ainsi ma nourriture et, de plus, il me tiendrait compagnie dans cette solitude qui commence à me peser ! « Et sitôt pensé, sitôt fait : il s’avança jusqu’au pied de l’arbre où se tenait le corbeau, pour pouvoir se faire mieux entendre, et après les salams les plus profondément sentis, il lui dit : « Ô mon voisin, tu n’ignores pas que tout bon musulman a deux mérites auprès de son voisin musulman : le mérite d’être musulman et le mérite d’être le voisin ! Or, je te reconnais sans hésitation ces deux mérites vis-à-vis de moi et, de plus, je me sens là, en pleine poitrine, saisi par l’attraction invincible de ta gentillesse, et je me découvre des dispositions spontanées de fraternelle amitié à ton égard ! Et toi, ô corbeau, que sens-tu à mon égard ? »
À ces paroles, le corbeau éclata de rire et tellement qu’il faillit dégringoler de l’arbre. Puis il dit au renard : « En vérité, ma surprise est extrême ! Et depuis quand, ô renard, cette amitié insolite ? Et depuis quand la sincérité est-elle entrée dans ton cœur, alors qu’elle n’avait jamais été que sur le bout de la langue ? Et depuis quand des races aussi différentes que les nôtres peuvent-elles fusionner si parfaitement, — toi, de la race des animaux, et moi, de la race des oiseaux ! Et surtout, ô renard, pourrais-tu, puisque tu es si éloquent, me dire depuis quand ceux de ta race ont cessé d’être les mangeurs, et ceux de ma race les mangés ?… Ça t’étonne ? Il n’y a vraiment pas de quoi ! Allons ! renard, vieux malin, remets toutes tes belles sentences dans ta besace, et dispense-moi de cette amitié qui n’a pas fait ses preuves ! »
Alors le renard lui dit : « Ô judicieux corbeau, tu raisonnes parfaitement ! mais sache bien que rien n’est impossible à Celui qui a formé les cœurs de ses créatures, et qui a soudain suscité dans le mien ce sentiment à ton égard. Or pour te démontrer que des individus de race différente peuvent merveilleusement s’accorder, et pour te fournir les preuves qu’à juste titre tu me réclames, je ne trouve rien de mieux que de te raconter l’histoire qui m’est parvenue de la puce et de la souris, si toutefois tu veux bien l’écouter ! »
Et le corbeau dit : « Du moment que tu parles de preuves, je suis tout prêt à entendre cette histoire de la puce et de la souris, que je n’ai jamais entendue ! » Et le renard dit :
« Ô gentil ami, les savants versés dans les livres anciens et modernes nous racontent qu’une puce et une souris avaient élu domicile dans la maison d’un riche marchand, chacune à l’endroit qui lui convenait le mieux.
« Or, une nuit, la puce, dégoûtée de toujours sucer le sang âcre du chat de la maison, sauta sur le lit où était étendue l’épouse du marchand et se faufila entre ses robes, et de là glissa sous sa chemise pour gagner sa cuisse et de là le pli de l’aine, juste à l’endroit le plus délicat. Or, vraiment elle trouva que cet endroit était fort délicat, et doux, et blanc, et lisse à souhait : aucune rugosité, aucun poil indiscret, au contraire, ô corbeau, au contraire ! Bref la puce se consolida là-dessus et se mit à sucer le sang délicieux de l’épouse jusqu’à satiété ! Mais elle avait apporté à son repas si peu de discrétion que, sous la cuisance de la piqûre, la jeune femme se réveilla et porta vivement la main à l’endroit piqué et elle aurait infailliblement écrasé la puce si celle-ci ne s’était adroitement esquivée du caleçon, à travers les plis innombrables de ce vêtement spécial aux femmes, et de là n’avait sauté à terre et couru se réfugier dans le premier trou qui se présenta devant elle ! Voilà pour la puce !
« Mais pour ce qui est de la jeune femme, elle poussa un hurlement de douleur qui fit accourir toutes les esclaves, lesquelles, ayant compris le motif de la douleur de leur maîtresse, se hâtèrent de relever leurs manches et de se mettre aussitôt à l’œuvre pour trouver la puce dans les vêtements : deux se chargèrent des robes, une autre de la chemise et deux autres de l’ample caleçon dont elles se mirent à déplier soigneusement tous les plis l’un après l’autre, pendant que la jeune femme, toute nue, à la clarté des flambeaux, s’examinait elle-même le devant du corps et que son esclave favorite lui inspectait minutieusement le derrière. Mais tu juges bien, ô corbeau, que l’on ne trouva absolument rien ! Et voilà pour la femme ! »
Et le corbeau s’écria : « Mais, en tout cela, où sont les preuves dont tu me parlais ? » Et le renard dit : « Justement nous y arrivons ! » Et il continua :
« En effet, le trou dans lequel s’était réfugiée la puce était le gîte même de la souris…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT CINQUANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« En effet, le trou dans lequel s’était réfugiée la puce était le gîte même de la souris. Aussi lorsque la souris vit ainsi entrer la puce chez elle avec ce sans-gêne, elle fut extrêmement offusquée et lui cria : « Que viens-tu faire chez moi, ô puce, toi qui n’es ni de mon espèce ni de mon essence, et dont on ne peut attendre que du désagrément, parasite que tu es ! » Mais la puce répondit : « Ô souris hospitalière, sache que si j’ai envahi si indiscrètement ton domicile, c’est malgré moi et pour échapper à la mort dont je suis menacée par la maîtresse de la maison ! Et tout cela pour un peu de sang que je lui ai soutiré ! Il est vrai que ce sang était de première qualité, et moelleux et tiède à ravir et d’une digestion merveilleuse ! Je viens donc recourir à toi, confiante dans ta bonté, et te prier de m’accepter chez toi jusqu’à ce que le danger soit passé. Aussi, loin de te tourmenter et t’obliger à fuir ton domicile, je t’aurai une gratitude si marquée que tu remercieras Allah qui a permis notre réunion ! » Alors la souris, convaincue par la sincérité d’accent de la puce, lui dit : « S’il en est vraiment ainsi, ô puce, tu peux sans crainte partager mon gîte et vivre ici dans la tranquillité ; et tu seras ma compagne dans la bonne et mauvaise fortune ! Mais pour ce qui est du sang bu sur la cuisse de l’épouse, va ! ne t’en inquiète pas ! Et digère-le dans la paix de ton cœur avec délices ! car chacun trouve sa nourriture où il peut et il n’y a là rien de répréhensible, et si Allah nous a donné la vie, ce n’est point pour que nous nous laissions mourir de faim ou de soif ! Et d’ailleurs, voici à ce sujet les vers que j’ai entendus un jour réciter par un santon dans les rues :
« Je n’ai rien sur la terre qui me pèse ou qui m’attache ; je n’ai ni meubles, ni épouse revêche, ni maison ! Ô mon cœur, tu es léger !
Un morceau de pain, une gorgée d’eau et une pincée de gros sel suffisent à me nourrir, car je suis seul ! Une robe tout usée me sert de vêtement, et c’est déjà trop !
Le pain, je le prends où je le trouve, et la destinée comme elle vient ! On ne peut rien m’enlever ! Et ce que je prends aux autres, pour vivre, c’est leur surplus ! Mon cœur, tu es léger ! »
« Lorsque la puce eut entendu ce discours de la souris, elle fut extrêmement touchée et lui dit : « Ô souris, ma sœur, quelle vie délicieuse n’allons-nous pas désormais couler ensemble ! Qu’Allah hâte le moment où je pourrai reconnaître tes bontés ! »
« Or, ce moment ne tarda pas à arriver. En effet, le soir même, la souris, qui était allée rôder dans la chambre du marchand, entendit un tintement métallique et finit par voir le marchand compter un à un des dinars nombreux qui étaient dans un petit sac ; et, lorsqu’il les eut tous vérifiés, il les cacha sous son oreiller et s’étendit sur le lit et s’endormit.
« Alors la souris courut trouver la puce et lui raconta ce qu’elle venait de voir et lui dit : « Voilà enfin pour toi l’occasion de me venir en aide, et cela en transportant avec moi ces dinars d’or du lit du marchand à mon gîte ! » À ces paroles, la puce faillit s’évanouir d’émotion, tant la chose lui parut exorbitante, et elle dit tristement à la souris : « Mais tu n’y penses pas, ô souris ! ne vois-tu pas ma taille ? Comment pourrais-je transporter sur mon dos un dinar, alors que mille puces réunies ne sauraient le faire bouger seulement ? Pourtant je puis certes t’être ici d’une grande utilité, car je me charge, moi puce, telle que je suis, de transporter le marchand lui-même hors de sa chambre et même de sa maison ; et alors tu deviens la maîtresse de la place, et tu peux tout à ton aise, et sans te presser, transporter les dinars dans ton gîte ! » Alors la souris s’écria : « C’est juste, brave puce, et vraiment je n’y pensais pas ! Et pour ce qui est de mon gîte, il est assez vaste pour contenir tout cet or ; et, de plus, j’y ai ménagé soixante-dix portes de sortie pour le cas où l’on voudrait m’y enfermer et m’y murer ! Hâte-toi donc de combiner ce que tu m’as promis ! »
« Alors la puce, en quelques sauts, fut sur le lit où dormait le marchand et se dirigea droit à son cul et là le piqua comme jamais puce n’avait piqué un cul d’homme. À cette piqûre et à la douleur lancinante qui s’en suivit, le marchand se réveilla en portant vivement la main à son endroit honorable, d’où la puce s’était hâtée de s’éloigner, et se mit à lancer mille malédictions qui retentirent à vide dans la maison silencieuse. Puis, après s’être tourné et retourné, il essaya de se rendormir. Mais il comptait sans l’ennemi ! En effet, la puce, à la vue du marchand qui s’entêtait dans son lit, revint à la charge, furieuse à l’extrême, et cette fois alla le piquer de toute sa force à cet endroit si sensible qu’on nomme le périnée.
« Alors là le marchand sursauta en hurlant et rejeta loin de lui couvertures et vêtements et courut jusqu’au bas de sa maison, près du puits, où il s’imbiba d’eau froide, et il ne voulut plus réintégrer sa chambre, mais s’étendit sur le banc de la cour pour y passer le reste de la nuit.
« Aussi la souris put en toute facilité transporter dans son gîte tout l’or du marchand ; et quand vint le matin il ne restait plus un seul dinar dans le sac.
« Et c’est ainsi que la puce sut reconnaître l’hospitalité de la souris et l’en dédommagea dans une mesure au centuple !
» Et toi, ô corbeau, continua le renard, j’espère
que tu verras bientôt la mesure de mon dévouement
à ton égard, en retour du pacte d’amitié que je te
demande de sceller entre nous ! »
Mais le corbeau lui dit : « En vérité, seigneur renard, ton histoire est loin de me convaincre. Et puis, après tout, on est libre de faire ou de ne pas faire le bien, surtout quand ce bien doit vous être une cause de calamités. Or, c’est bien le cas ici. En effet, tu es réputé depuis longtemps pour tes perfidies et tes manquements à la parole donnée ; comment donc pourrais-je avoir confiance dans quelqu’un d’une si insigne mauvaise foi, et qui a trouvé moyen, tout dernièrement encore, de trahir et de faire périr son cousin le loup ? Car, ô traître, je suis au courant de ce méfait dont le bruit a fait le tour de toute la gent animale ! Si donc tu n’as pas hésité à sacrifier quelqu’un qui est de ta race, si ce n’est de ton espèce, après l’avoir longtemps fréquenté et flagorné de toutes façons, il est bien probable que tu ne te feras qu’un jeu de la perdition de celui qui est d’une race hostile et si différente de la tienne ! Aussi cela me rappelle fort à propos une histoire qui s’applique, vois-tu, à merveille à notre cas présent ! » Le renard s’écria : « Quelle histoire ? » Le corbeau dit : « C’est celle du vautour ! » Mais le renard dit : « Je ne connais pas du tout cette histoire du vautour. Montre un peu ce que c’est ! » Et le corbeau dit :
« Il y avait un vautour qui était d’une tyrannie, dépassant toutes les limites connues ; nul oiseau, grand ou petit, n’avait été indemne de ses vexations ; et il avait semé la terreur chez tous les loups de l’air et tous les loups de la terre, si bien qu’à son approche les bêtes de proie les plus féroces lâchaient là tout ce qu’elles tenaient et s’évadaient épouvantées de son bec effroyable et de ses plumes hérissées. Mais bientôt le temps vint où les années accumulées sur sa tête la déplumèrent entièrement et usèrent ses griffes et firent tomber en morceaux ses mandibules menaçantes et, jointes aux intempéries, rendirent son corps perclus et ses ailes sans vertu ! Alors il devint un tel objet de pitié que ses anciens ennemis dédaignèrent même de lui rendre la mesure de ses tyrannies, et ne le traitèrent que par le mépris. Et il était obligé, pour se nourrir, de se contenter des restes de repas que laissaient les oiseaux et les animaux !
« Et toi, ô renard, si tu as perdu tes forces, je vois
que tu n’as encore rien perdu de tes traîtrises ! Car tu
veux, toi l’impuissant, t’allier avec moi qui, par l’effet
de la bonté du Donateur, conserve encore intacte la
vigueur de mon aile, l’acuité de ma vue et le poli de
mon bec. Crois-moi, n’essaie pas de faire comme
le moineau ! » Et le renard, tout à fait étonné, lui
demanda : « De quel moineau parles-tu ? » Le corbeau
dit : « Écoute !
« Il m’est parvenu qu’un moineau se trouvait dans
un pré où paissait un troupeau de moutons ; et il s’occupait
à fouiller la terre de son bec, en suivant les
moutons, quand il vit soudain un aigle énorme fondre
sur un petit agneau et l’emporter dans ses griffes et
disparaître avec lui vers le loin. À cette vue, le moineau
se regarda avec une extrême fierté et étendit
ses ailes avec suffisance et se dit en lui-même : « Mais
moi aussi je sais voler, et je puis même emporter un
gros mouton ! » Et là-dessus, il choisit le mouton le
plus gros qu’il pût trouver, celui qui avait une laine
si fournie et si vieille que sous le ventre elle n’était
plus, tant l’urine de la nuit l’imbibait, qu’une masse collante et putréfiée ! Et le moineau fondit sur le dos
de ce mouton et voulut l’enlever, sans plus. Mais,
dès son premier mouvement, ses pattes furent emprisonnées
dans les flocons de laine, et il resta lui-même
le prisonnier du mouton. Alors le berger accourut et
s’empara de lui et lui arracha les plumes des ailes et,
l’ayant attaché par le pied avec une ficelle, le donna
comme jouet à ses petits enfants, et leur dit : « Regardez
bien cet oiseau ! C’est un qui a voulu, pour son
malheur, se comparer à plus fort que lui ! Aussi il est
châtié par l’esclavage ! »
« Et toi, ô renard perclus, tu veux maintenant te
comparer à moi, puisque tu as l’audace de me proposer
ton alliance ! Allons ! vieux rusé, crois-moi, tourne
ton dos au plus vite ! » Alors le renard comprit qu’il
était désormais inutile d’essayer de duper un individu
aussi averti que l’était le corbeau. Et, dans sa
rage, il se mit à grincer si fort des mâchoires qu’il se
cassa une grosse dent. Et le corbeau, narquois, lui
dit : « En vérité, je suis peiné que tu te sois cassé
une dent à cause de mon refus ! » Mais le renard le
regarda avec un respect sans bornes et lui dit : « Ce
n’est point à cause de ton refus que je me suis cassé
cette dent, mais bien de honte d’avoir trouvé plus
malin que moi ! »
Et, ayant dit ces paroles, le renard se hâta de déguerpir pour aller se cacher.
— Et telle est, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, l’histoire du corbeau et du renard ! Elle a été un peu longue, peut-être ; mais aussi je me propose, si Allah m’accorde vie jusqu’à demain, et si c’est ton bon plaisir, de le raconter l’histoire de la belle schamsennahar avec le prince ali ben-bekar. »
Mais le roi Schahriar s’écria : « Ô Schahrazade, ne crois point que les histoires des animaux et des oiseaux ne m’aient pas charmé ou qu’elles m’aient paru longues, au contraire ! Si même tu en connaissais d’autres, je ne serais point fâché de les entendre, ne serait-ce que pour le profit que je pourrais en tirer ! Mais du moment que tu m’annonces une histoire qui, au seul titre, me paraît déjà parfaitement admirable, je suis prêt à t’écouter ! »
Mais Schahrazade vit apparaître le matin et pria le Roi d’attendre jusqu’au lendemain.
LA CENT CINQUANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
HISTOIRE D’ALI BEN-BEKAR ET
DE LA BELLE SCHAMSENNAHAR
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait à
Baghdad, sous le règne qui se présenta et s’écoula
du khalifat Haroun Al-Rachid, un jeune marchand
fort bien fait et fort riche qui s’appelait Abalhassan
ben-Tâher. Il était certainement le plus beau et le
plus affable et le plus richement habillé de tous les
marchands du Grand Souk. Aussi avait-il été choisi
par le chef eunuque du palais pour fournir aux
favorites toutes les choses, étoffes ou pierreries, dont
elles pouvaient avoir besoin ; et ces dames s’en
rapportaient aveuglément à son bon goût et surtout
à sa discrétion, bien des fois mise à l’épreuve, pour
les commissions dont elles le chargeaient de temps
en temps. Et il ne manquait jamais de servir toutes
sortes de rafraîchissements aux eunuques qui
venaient lui faire les commandes, et de leur donner
chaque fois un cadeau approprié au rang qu’ils
occupaient près de leurs maîtresses. Aussi le jeune
Abalhassan était-il adoré de toutes les femmes et de
tous les esclaves du palais, et tellement que le khalifat lui-même finit par le remarquer ; et, dès
qu’il le vit, il l’aima pour ses bonnes manières et
sa jolie figure si avenante et son teint si tranquille ;
et il lui donna libre accès au palais, à toute heure
du jour ou de la nuit ; et comme le jeune Abalhassan
joignait à toutes ses qualités le don du chant
et de la poésie, le khalifat, qui ne mettait rien au-dessus
d’une belle voix et d’une jolie diction, le
faisait souvent venir lui tenir compagnie à table
et lui improviser des vers aux rythmes parfaits.
Aussi la boutique d’Abalhassan était-elle la plus connue par tout ce que Baghdad contenait de beaux jeunes gens d’entre les fils des émirs et des notables, et de femmes des nobles dignitaires et des chambellans.
Or, l’un des habitués les plus fervents de la boutique d’Abalhassan était un jeune seigneur qui était devenu l’ami tout à fait particulier d’Abalhassan, tant il était beau et attirant. Il s’appelait Ali ben-Bekar, et descendait des anciens rois de Perse. Il avait une taille charmante, un visage aux joues fraîches et rosées, des sourcils d’une ligne parfaite, des dents souriantes et un parler délicieux.
Un jour donc que le jeune prince Ali ben-Bekar était assis dans la boutique à côté de son ami Abalhassan ben-Tâher et que tous deux causaient et riaient, ils virent arriver dix adolescentes, belles comme des lunes, qui en entouraient une onzième montée sur une mule harnachée de brocart avec des étriers d’or. Et cette onzième était couverte d’un izar de soie rose, que serrait à la taille une ceinture brodée d’or, large de cinq doigts et incrustée de grosses perles et de pierreries. Son visage était voilé d’une voilette transparente, et ses yeux apparaissaient splendides à travers ! La peau de ses mains était à la vue aussi douce que la soie même et reposante dans sa blancheur, et ses doigts, lourds de diamants, n’en paraissaient que plus fuselés. Quant à sa taille et à ses formes, on pouvait les deviner merveilleuses à en juger par le peu que l’on pouvait voir.
Lorsque le convoi fut à la porte de la boutique, la jeune femme, s’appuyant sur les épaules de ses esclaves, mit pied à terre et entra dans la boutique en souhaitant la paix à Abalhassan, qui lui rendit son souhait avec les marques du plus profond respect et se hâta d’arranger les coussins et le divan pour l’inviter à y prendre place, et se retira aussitôt, un peu plus loin, pour attendre ses ordres. Et la jeune femme se mit à choisir négligemment quelques étoffes à fond d’or, quelques orfèvreries et quelques flacons d’essence de roses ; et, comme elle n’avait pas à se gêner chez Abalhassan, elle releva un instant son petit voile de visage et fit ainsi briller, sans artifices, sa beauté.
Or, à peine le jeune prince Ali ben-Bekar eut-il aperçu ce visage si beau qu’il en fut frappé d’admiration, et une passion s’alluma au fond de son foie ; puis comme, par discrétion, il faisait mine de s’éloigner, la belle adolescente, qui l’avait remarqué, elle aussi, et avait également été secrètement remuée, dit à Abalhassan de sa voix admirable : « Je ne veux pas être cause du départ de tes clients. Invite donc ce jeune homme à rester ! » Et elle sourit adorablement.
À ces paroles, le prince Ali ben-Bekar fut au comble de ses vœux et, ne voulant pas être en reste de galanterie, dit à l’adolescente : « Par Allah ! ô ma maîtresse, si je voulais m’en aller ce n’était pas seulement par crainte d’être importun, mais parce qu’en te voyant, j’avais pensé à ces vers du poète :
« Ô toi qui regardes le soleil ! vois-tu pas qu’il habite des hauteurs que nul œil humain ne saurait mesurer ?
Penses-tu donc pouvoir l’atteindre sans ailes, ou crois-tu, ô naïf, le voir descendre jusqu’à toi ? »
Lorsque l’adolescente eut entendu ces vers récités avec un accent désespéré, elle fut charmée du sentiment délicat qui les inspirait, et elle fut plus vivement subjuguée par l’air charmant de son amoureux. Aussi elle lui jeta un long regard souriant, puis elle fit signe au jeune marchand de s’approcher, et lui demanda à mi-voix :. « Abalhassan, qui est donc ce jeune homme, et d’où est-il ? » Il répondit : « C’est le prince Ali ben-Bekar, descendant des rois de Perse. Il est aussi noble qu’il est beau. Et c’est mon meilleur ami. » — « Il est gentil ! reprit la jeune femme. Ne t’étonne donc pas, Abalhassan, si tout à l’heure, après mon départ, tu vois arriver une de mes esclaves pour vous inviter, toi et lui, à me venir voir. Car je voudrais lui prouver qu’il y a à Baghdad de plus beaux palais, de plus belles femmes et de plus expertes almées qu’à la cour des rois de Perse ! » Et Abalhassan, à qui il n’en fallait pas plus long pour comprendre, s’inclina et répondit : « Sur ma tête et sur mes yeux ! »
Alors la jeune femme ramena son petit voile sur son visage, et sortit en laissant derrière elle un parfum subtil de robes conservées dans le santal et le jasmin.
Quant à Ali ben-Bekar, une fois l’adolescente partie, il resta pendant un bon moment à ne savoir plus ce qu’il disait, et tellement qu’Abalhassan fut obligé de l’avertir que les clients remarquaient son agitation et commençaient à s’en étonner. Et Ali ben-Bekar répondit : « Ô Ben-Tâher, comment ne serais-je pas agité et, moi-même, étonné de voir mon âme chercher à s’échapper de mon corps pour aller rejoindre cette lune qui oblige mon cœur à se donner sans consulter mon esprit ? » Puis il ajouta : « Ô Ben-Tâher, de grâce ! qui est cette adolescente que tu sembles connaître ? Hâte-toi de me le dire ! » Et Abalhassan répondit : « C’est la favorite de choix de l’émir des Croyants ! Son nom est Schamsennahar ![7] Elle est traitée par le khalifat avec des égards qui sont à peine rendus à Sett-Zobéida elle-même, l’épouse légitime. Elle a un palais à elle seule où elle commande en maîtresse absolue, sans être l’objet de la surveillance des eunuques ; car le khalifat a en elle une confiance sans limites, et, à juste titre, car de toutes les femmes du palais c’est celle qui, bien que la plus belle, fait le moins parler d’elle, avec des clignements d’œil, par les esclaves et les eunuques. »
Or, Abalhassan venait à peine de donner ces explications à son ami Ali ben-Bekar, qu’une petite esclave entra qui s’approcha tout près d’Abalhassan et lui dit à l’oreille : « Ma maîtresse Schamsennahar vous demande, toi et ton compagnon ! » Et aussitôt Abalhassan se leva, fit signe à Ali ben-Bekar, et, ayant fermé la porte de sa boutique, il suivit, accompagné d’Ali, la petite esclave qui marchait devant eux et qui les conduisit de la sorte au palais même du khalifat Haroun Al-Rachid.
Et du coup le prince Ali se crut transporté dans la demeure même des génies, où toutes choses sont si belles que la langue de l’homme deviendrait poilue avant de pouvoir les décrire. Mais la petite esclave, sans leur donner le temps d’exprimer leur enchantement, frappa ses mains l’une contre l’autre, et aussitôt apparut une négresse chargée d’un grand plateau couvert de mets et de fruits qu’elle déposa sur un tabouret ; et l’odeur seule qui s’en dégageait était déjà un baume admirable aux narines et au cœur. Aussi la petite esclave ne manqua pas de les servir avec des égards extrêmes, et, lorsqu’ils se furent bien rassasiés, elle leur présenta le bassin et le vase d’or plein d’eau de senteur pour leurs mains ; puis elle leur présenta une aiguière merveilleuse enrichie de rubis et de diamants et pleine d’eau de roses, et leur en versa dans l’une et dans l’autre mains pour la barbe et le visage ; après quoi elle leur apporta du parfum d’aloès dans une petite cassolette d’or, et leur en parfuma les vêtements, selon la coutume. Et, cela fait, elle ouvrit une porte de la salle où ils se trouvaient, et les pria de la suivre. Et elle les introduisit dans une grande salle d’une architecture ravissante.
C’était, en effet, une salle surmontée d’un dôme soutenu par quatre-vingts colonnes transparentes de l’albâtre le plus pur, dont les bases et les chapiteaux étaient sculptés avec un art subtil et ornés d’oiseaux d’or et d’animaux à quatre pieds. Et ce dôme était entièrement peint, sur fond d’or, de lignes colorées et vivantes à l’œil, qui représentaient les mêmes dessins que ceux du grand tapis dont la salle était couverte. Et, dans les espaces laissés entre les colonnes, il y avait de grands vases de fleurs admirables ou simplement de grandes coupes vides, mais belles de leur propre beauté et de leur chair de jaspe, d’agate ou de cristal. Et cette salle donnait de plain-pied sur un jardin dont l’entrée représentait, en petits cailloux colorés, les mêmes dessins que le tapis : ce qui faisait que le dôme, la salle et le jardin se continuaient sous le ciel nu et le bleu tranquille.
Or, pendant que le prince Ali ben-Bekar et Abalhassan admiraient cet arrangement délicat, ils aperçurent, assises en rond, les seins rebondissants, les yeux noirs et les joues roses, dix jeunes femmes qui tenaient chacune à la main un instrument à cordes.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT CINQUANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… et les joues roses, dix jeunes femmes qui tenaient chacune à la main un instrument à cordes. Et, à un signe de la petite esclave favorite, elles jouèrent toutes ensemble un prélude d’une grande douceur, et tel que le prince Ali, dont le cœur était rempli du souvenir de la belle Schamsennahar, sentit les larmes lui remplir les paupières. Et il dit à son ami Abalhassan : « Ah ! mon frère, je sens que mon âme s’émeut ! Et ces accords me parlent un langage qui fait pleurer mon âme, sans qu’au juste je sache pourquoi ! » Abalhassan lui dit : « Mon jeune seigneur, que ton âme soit tranquille, et qu’elle prête toute son attention à ce concert qui promet d’être admirable, grâce à la belle Schamsennahar qui probablement va bientôt arriver ! »
En effet, à peine Abalhassan avait-il achevé ces mots que les dix jeunes femmes se levèrent toutes ensemble et, les unes pinçant les cordes et les autres agitant rythmiquement leurs petits tambours à grelots, entonnèrent ce chant annonciateur :
« Azur, tu nous regardes soudain avec un sourire content. Ô lune, voici que tu relèves tes robes de nuages et tu te voiles confuse ! Et toi, soleil, ô soleil vainqueur, tu fuis et tu ne brilles plus ! »
Et le chœur s’arrêta, attendant la réponse que chanta l’une des dix :
« Ô mes yeux ! voici notre Lune qui s’avance. Car le Soleil nous visite, un jeune Soleil princier, qui vient rendre hommage à Schamsennahar ! »
Alors le prince Ali, qui figurait ce soleil, regarda du côté opposé et vit, en effet, s’approcher douze jeunes négresses qui portaient sur leurs épaules un trône d’argent massif, recouvert d’un dais de velours, et où était assise une femme qu’on ne pouvait encore voir, voilée qu’elle était par un grand voile de soie légère qui flottait sur le devant du trône. Et ces négresses avaient les seins nus et les jambes nues ; et un foulard de soie et d’or, ajusté à la taille, faisait saillir les riches fesses des porteuses. Et lorsqu’elles furent arrivées au milieu des chanteuses elles déposèrent doucement le trône d’argent et reculèrent sous les arbres.
Alors une main écarta les draperies et des yeux brillèrent sur un visage de lune ; c’était Schamsennahar. Elle était vêtue d’un grand manteau en étoffe légère, bleu sur or, constellé de perles, de diamants et de rubis, non point en quantité prodigieuse, mais en petit nombre, — seulement le tout était d’un choix et d’un prix inestimables. Alors, les draperies écartées, Schamsennahar releva complètement son petit voile et regarda en souriant le prince Ali et inclina la tête légèrement. Et le prince Ali la regarda en soupirant et ils se parlèrent tous deux un langage muet, par lequel, en quelques instants, ils se dirent bien plus de choses qu’ils n’en auraient pu se dire en un long espace de temps.
Mais Schamsennahar put enfin détacher ses regards des yeux d’Ali ben-Bekar, pour ordonner à ses femmes de chanter. Alors l’une d’elles se hâta de mettre son luth d’accord et chanta :
« Ô destinée ! quand deux amants, l’un vers l’autre attirés, se trouvent aimables et s’unissent dans un baiser, à qui la faute, sinon à toi ?
Ô mon cœur, dit l’amante, par ma vie ! donne encore un baiser ! Je te le rendrai, tel qu’il est, égal en chaleur ! Et si tu veux encore plus, que cela me serait facile ! »
Alors Schamsennahar et Ali ben-Bekar poussèrent un soupir ; et une seconde chanteuse, sur un rythme différent, à un signe de la belle favorite, dit :
« Ô bien-aimé ! lumière qui illumines l’espace où sont les fleurs, yeux du bien-aimé !
Ô chair poreuse qui filtres la boisson de mes lèvres, ô chair poreuse si douce à mes lèvres !
Ô bien-aimé ! quand je t’ai trouvé, la Beauté m’a arrêtée pour me chuchoter :
« Le voici ! Il a été modelé par des doigts divins ! Il est une caresse, telle une riche broderie ! »
À ces vers, le prince Ali ben-Bekar et la belle Schamsennahar se regardèrent longuement ; mais déjà une troisième chanteuse disait :
« Les heures heureuses, ô jeunes gens, s’écoulent comme l’eau, rapides comme l’eau. Croyez-moi, amoureux, n’attendez pas.
Profitez du bonheur lui-même. Ses promesses sont vaines ! Usez de la beauté de vos années et du moment qui vous unit. »
Lorsque la chanteuse eut fini ce chant, le prince Ali poussa un long soupir et, ne pouvant davantage contenir son émotion, il laissa couler ses larmes en sanglotant. À cette vue, Schamsennahar, qui n’était pas moins émue, se prit également à pleurer et, ne pouvant résister à sa passion, se leva de son trône et s’avança vivement vers la porte de la salle. Et aussitôt Ali ben-Bekar courut dans la même direction et, parvenu derrière le grand rideau de la porte, il se rencontra avec son amoureuse ; et leur émotion fut si grande en s’embrassant et leur délire si intense qu’ils s’évanouirent dans les bras l’un de l’autre ; et ils seraient certainement tombés s’ils n’avaient été soutenus par les femmes qui avaient suivi à distance leur maîtresse, et qui se hâtèrent de les transporter tous deux sur un divan où elles leur firent reprendre leurs esprits à force de les asperger avec l’eau de fleurs et de leur faire sentir des odeurs vivifiantes.
Or, la première chose que fit Schamsennahar en revenant à elle fut de regarder autour d’elle ; et elle eut un sourire heureux en revoyant son ami Ali ben-Bekar ; mais, comme elle ne voyait pas Abalhassan ben-Tâher, elle demanda anxieusement de ses nouvelles. Or, Abalhassan, par discrétion, s’était retiré plus loin, et n’était d’ailleurs pas sans appréhension sur la suite fâcheuse que pouvait avoir cette aventure, si elle venait à s’ébruiter dans le palais. Mais, dès qu’il se fut aperçu que la favorite s’informait de sa présence, il s’avança avec respect et s’inclina devant elle. Et Schamsennahar lui dit : « Ô Abalhassan, comment estimerai-je jamais à leur mesure tes bons offices. C’est grâce à toi que je dois de connaître ce que le monde possède de plus aimable parmi les créatures et ces instants incomparables où mon âme s’épuise par l’intensité de son bonheur ! Sois bien persuadé, ô Ben-Tâher, que Schamsennahar ne sera point une ingrate ! » Et Abalhassan s’inclina profondément devant la favorite en demandant pour elle à Allah l’accomplissement de tous les vœux que pouvait souhaiter son âme.
Alors Schamsennahar se tourna vers son ami Ali ben-Bekar et lui dit : « Ô mon maître, je ne doute plus de ton amitié, bien que la mienne dépasse en violence tous les sentiments que tu pourras éprouver pour moi. Mais, hélas ! quelle destinée est la mienne d’être attachée à ce palais et de ne pouvoir donner libre cours à ma tendresse ! » Et Ali ben-Bekar répondit : « Ô ma maîtresse, en vérité ton amour m’a tellement pénétré qu’il s’est combiné à mon âme et en a fait partie si complètement que, même après ma mort, mon âme le conservera essentiellement à elle uni ! Ah ! que nous sommes malheureux de ne pouvoir nous librement aimer ! » Et, ces paroles achevées, les larmes inondèrent comme une pluie les joues du prince Ali et, par sympathie, celles de Schamsennahar. Mais Abalhassan s’approcha d’eux discrètement et leur dit : « Par Allah ! je ne comprends rien à vos pleurs, alors que vous êtes ensemble ! Que serait-ce donc si vous étiez séparés ? Vraiment ce n’est point le moment de vous attrister, mais de vous épanouir, et de passer le temps dans l’agrément et la joie ! »
À ces paroles d’Abalhassan, dont elle avait appris à estimer les conseils, la belle Schamsennahar sécha ses larmes et fit signe à l’une de ses esclaves qui aussitôt sortit un moment pour revenir suivie de plusieurs suivantes qui portaient sur leurs têtes de grands plateaux d’argent chargés de toutes sortes de mets à l’aspect réjouissant. Et, ces plateaux une fois déposés sur les tapis entre Ali ben-Bekar et Schamsennahar, les suivantes reculèrent tout contre le mur et s’y immobilisèrent.
Alors Schamsennahar invita Abalhassan à s’asseoir en face d’eux, devant les plats d’or ciselé, où s’arrondissaient les fruits et mûrissaient les pâtisseries. Et de ses propres doigts la favorite se mit à confectionner des bouchées de chaque plat, et elle les mettait elle-même entre les lèvres de son ami Ali ben-Bekar. Et elle n’oubliait pas non plus Abalhassan ben-Tâher. Et lorsqu’ils eurent mangé, on enleva les plateaux d’or et on apporta une fine aiguière d’or dans un bassin d’argent ciselé ; et ils se lavèrent les mains avec l’eau parfumée qu’on leur en versait. Après quoi, ils s’assirent de nouveau et les jeunes négresses leur présentèrent des coupes d’agate colorée, posées sur des soucoupes de vermeil et pleines d’un vin exquis, dont le seul aspect réjouissait les yeux et dilatait l’âme. Et ils en burent lentement en se regardant longuement ; et, une fois les coupes vides, Schamsennahar renvoya toutes ses esclaves, ne gardant auprès d’elle que les chanteuses et les joueuses d’instruments.
Alors, comme elle se sentait tout à fait disposée à chanter, Schamsennahar commanda à l’une des chanteuses de préluder d’abord, pour donner le ton ; et la chanteuse accorda aussitôt son luth et chanta doucement :
« Mon âme, tu t’épuises ! Les mains de l’amour t’ont retournée en tous sens et ont jeté à tous les vents ton mystère.
Mon âme ! Je te gardais délicatement sous la tiédeur de mes côtes, et tu t’échappes pour courir à celui qui cause mes souffrances !
Coulez, mes larmes ! Ah ! vous vous échappez de mes paupières vers le cruel ! Larmes passionnées, vous aussi vous êtes amoureuses de mon bien-aimé ! »
Alors Schamsennahar tendit le bras et remplit une coupe et la but à moitié et l’offrit au prince Ali qui la prit et qui but, les lèvres posées à l’endroit même qu’avaient touché les lèvres de son amie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT CINQUANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… et qui but, les lèvres posées à l’endroit même qu’avaient touché les lèvres de son amie, tandis que les cordes des instruments frémissaient amoureusement sous les doigts des joueuses. Et Schamsennahar fit encore un signe à l’une d’elles pour demander que quelque chose fût chanté sur un ton un peu plus bas. Et la jeune esclave, en sourdine, murmura
« Si… mes joues sans cesse sont arrosées par la liqueur de mes yeux,
Si… la coupe où trempent mes lèvres est remplie de mes larmes plus encore que du vin de l’échanson,
Par Allah, ô mon cœur, abreuve-toi quand même à cette liqueur mélangée ! Elle fera rentrer en toi le surplus de mon âme qui s’échappe de mes yeux ! »
À ce moment, Schamsennahar se sentit complètement grisée par les notes émues des chansons et, prenant un luth des mains de l’une des femmes assises derrière elle, elle ferma les yeux à demi et de toute son âme elle chanta ces strophes admirables :
« Ô lumière de ses yeux ! ô beauté d’une gazelle adolescente ! Si tu t’éloignes, je meurs ; si tu t’approches, je me grise ! Ainsi je vis en brûlant et je m’éteins en jouissant.
Du souffle de ton haleine l’odorante brise est née ; et les soirs du désert en sont encore embaumés, les soirs tièdes sous les palmes joyeuses !
Attention ! ô brise amoureuse de son contact aimé ! je jalouse le baiser que tu prends sur le sourire de son menton et les fossettes de ses joues. Car ta caresse est un délice tel que toute sa chair en frissonne.
Jasmins de son ventre aromatique sous le vêtement très léger, jasmins de sa peau douce et lactée comme une pierre de lune !
Salive, ô ! salive que j’aime de sa bouche, boutons en fleurs de ses lèvres roses ! Ah ! les joues moites et les yeux clos après les étreintes d’amour !
Ô mon cœur ! tu t’égares dans les replis délicieux d’une chair de pierreries ! Prends garde ! l’amour te guette et ses flèches sont prêtes ! »
Lorsque Ali ben-Bekar et Abalhassan ben-Tâher eurent entendu ce chant de Schamsennahar ils faillirent s’envoler d’extase ; puis ils se trémoussèrent de plaisir et poussèrent des « Allah ! » d’une profondeur inaccoutumée ; puis ils rirent et pleurèrent ; et le prince Ali, à la limite de l’émotion, saisit un luth et le donna à Abalhassan en le priant de l’accompagner dans ce qu’il allait chanter. Alors il ferma les yeux et, la tête penchée et appuyée sur la main, à mi-voix il chanta ce chant de son pays :
« Écoute, ô échanson !
Il est si beau l’objet que j’aime que si j’étais le maître de toutes les cités je lui en ferais don sur l’heure pour seulement une fois toucher de mes lèvres la goutte de beauté sur sa joue ennemie !
Son visage est si beau qu’en vérité le grain de beauté est lui-même de trop ! Car ce visage est déjà si beau de sa propre beauté que ni roses ni velours d’un jeune duvet n’y ajouteraient un charme nouveau ! »
Et cela fut dit par le prince Ali ben-Bekar d’une voix tout à fait admirable ! Or, juste au moment où s’éteignait ce chant, la jeune esclave favorite de Schamsennahar accourut tremblante et effarée et dit à Schamsennahar : « Ô ma maîtresse, Massrour et Afif et d’autres eunuques du palais sont à la porte et demandent à te parler ! »
À ces paroles, le prince Ali et Abalhassan et toutes les esclaves furent extrêmement émus et tremblèrent même pour leur vie. Mais Schamsennahar, qui seule était restée calme, eut un sourire tranquille et leur dit à tous : « Rassurez-vous ! Et laissez-moi faire ! » Puis elle dit à sa confidente : « Va entretenir Massrour et Afif et les autres en leur disant de nous donner le temps de les recevoir selon leur rang ! » Alors elle ordonna à ses esclaves de fermer toutes les portes de la salle et de clore soigneusement les grands rideaux. Cela fait, elle invita le prince Ali et Abalhassan à ne plus bouger de la salle et à n’avoir aucune crainte ; puis, suivie de toutes les chanteuses, elle sortit de la salle, par la porte qui donnait sur le jardin et qu’elle fit refermer derrière elle ; et elle alla sous les arbres, s’asseoir sur son trône qu’elle avait pris soin d’y faire transporter. Là elle prit une pose langoureuse, ordonna à l’une des jeunes filles de lui masser les jambes et aux autres de se retirer plus loin, tandis qu’elle dépêchait une jeune négresse pour aller ouvrir la porte d’entrée à Massrour et aux autres.
Alors Massrour et Afif et vingt eunuques, l’épée nue à la main et la taille entourée du large ceinturon, s’avancèrent et, du plus loin qu’ils purent, se courbèrent jusqu’à terre et saluèrent la favorite avec les plus grandes marques de respect. Et Schamsennahar dit : « Ô Massrour, fasse Allah que tu sois porteur de bonnes nouvelles ! » Et Massrour répondit : « Inschallah ! ô ma maîtresse ! » Puis il s’approcha du trône de la favorite et lui dit : « L’émir des Croyants t’envoie ses souhaits de paix et te dit qu’il désire ardemment ta vue ! Et il te fait savoir que cette journée s’est annoncée pour lui pleine de joie et bénie entre toutes ; et il veut la terminer près de toi pour qu’elle soit complètement admirable. Mais il voudrait d’abord connaître ton sentiment à ce sujet et si tu aimes mieux aller toi-même au palais ou le recevoir plutôt chez toi, ici même ! »
À ces paroles, la belle Schamsennahar se leva et se prosterna et embrassa la terre pour marquer qu’elle considérait le désir du khalifat comme un ordre, et répondit : « Je suis l’esclave soumise et heureuse de l’émir des Croyants. Je te prie donc, ô Massrour, de dire à notre maître combien je suis dans la félicité de le recevoir et combien ce palais sera illuminé de sa venue ! »
Alors le chef des eunuques et sa suite se hâtèrent de se retirer, et Schamsennahar aussitôt courut à la salle où se trouvait son amoureux et, les larmes aux yeux, elle le serra contre sa poitrine et l’embrassa tendrement, et lui également ; puis elle lui exprima combien elle était malheureuse de lui dire adieu plus tôt qu’elle ne s’y était attendue. Et tous deux se mirent à pleurer dans les bras l’un de l’autre. Et le prince Ali put enfin dire à son amante : « Ô ma maîtresse, de grâce ! laisse-moi, ah ! laisse-moi te serrer, te sentir tout contre moi, jouir de ton contact adorable, puisque le moment de la séparation fatale est proche ! Je garderai dans ma chair ce contact aimé, et dans mon âme son souvenir ! Ce me sera une consolation dans l’éloignement et une douceur dans ma tristesse ! » Elle répondit : « Ô Ali ! par Allah ! c’est moi seule qu’atteindra la tristesse, moi qui reste dans ce palais avec seulement ton souvenir ! Toi, ô Ali, tu auras les souks pour te distraire et toutes les petites filles et les autres de la rue ; leurs grâces et leurs yeux allongés te feront oublier la désolée Schamsennahar, ton amante ; et le cliquetis de cristal de leurs bracelets dissipera peut-être jusqu’aux traces de mon image à tes yeux ! Ô Ali ! comment désormais pourrai-je résister aux éclats de ma douleur ou comprimer les cris dans ma gorge et les remplacer par les chants que me demandera le commandeur des Croyants ? Comment ma langue pourra-t-elle articuler les notes d’harmonie, et de quel sourire saurai-je l’accueillir lui-même, alors que toi seul peux me faire l’âme épanouie ? Ah ! de quels regards ne fixerai-je pas irrésistiblement la place que tu as occupée près de moi, ô Ali ! Et surtout comment, sans mourir, pourrai-je porter à mes lèvres la coupe partagée que me tendra l’émir des Croyants ? Sûrement, en la buvant, un poison sans pitié circulera dans mes veines ! Et alors, que la mort me sera légère, ô Ali ! »
À ce moment, comme Abalhassan ben-Tâher se disposait à les consoler en les exhortant à la patience, l’esclave confidente accourut prévenir sa maîtresse de l’approche du khalifat. Alors Schamsennahar, les yeux pleins de larmes, n’eut que le temps d’embrasser une dernière fois son amant et dit à la confidente : « Conduis-les au plus vite à la galerie qui donne sur le Tigre d’un côté et sur le jardin de l’autre ; et, quand la nuit sera bien noire, tu les en feras sortir adroitement du côté du fleuve ! » Et, ayant dit ces paroles, Schamsennahar comprima les sanglots qui l’étouffaient pour courir au-devant du khalifat qui s’avançait du côté opposé.
De son côté, la jeune esclave conduisit le prince Ali et Abalhassan à la galerie en question et se retira après les avoir rassurés et avoir fermé soigneusement la porte derrière elle. Alors ils se trouvèrent dans la plus grande obscurité ; mais au bout de quelques instants, à travers les fenêtres ajourées, ils virent une grande clarté qui, se rapprochant, leur fit apercevoir un cortège formé par cent jeunes eunuques noirs qui portaient à la main des flambeaux allumés ; et ces cent jeunes eunuques étaient suivis de cent vieux eunuques de la garde ordinaire des femmes du palais, et qui tenaient chacun à la main un glaive nu ; et derrière eux, enfin, à vingt pas, magnifique, s’avançait, précédé du chef des eunuques et entouré de vingt jeunes esclaves blanches comme la lune, le khalifat Haroun Al-Rachid.
Le khalifat s’avança donc, précédé de Massrour ; et il avait à sa droite son second chef des eunuques Afif et à sa gauche son second chef des eunuques Wassif. Et, en vérité, il était majestueux extrêmement et beau par lui-même et par tout l’éclat que vers lui projetaient les flambeaux des esclaves et les pierreries des courtisanes ! Et il s’avança de la sorte, au son des instruments dont soudain s’étaient mis à jouer les esclaves, jusqu’à Schamsennahar qui s’était prosternée à ses pieds. Et il se hâta de l’aider à se relever en lui tendant une main qu’elle porta à ses lèvres ; puis, tout heureux de la revoir, il lui dit : « Ô Schamsennahar, les soucis de mon royaume m’empêchaient depuis si longtemps de reposer mes yeux sur ton visage ! Mais Allah m’a accordé ce soir béni pour réjouir pleinement mes yeux de tes charmes ! » Puis il alla s’asseoir sur le trône d’argent, alors que la favorite s’asseyait devant lui et que les vingt autres femmes formaient un cercle autour d’eux sur des sièges situés à égale distance les uns des autres. Quant aux joueuses d’instruments et aux chanteuses, elles formèrent un autre groupe tout près de la favorite, tandis que les eunuques, jeunes et vieux, s’éloignaient, selon la coutume, sous les arbres, en tenant toujours les flambeaux allumés, au loin, pour ainsi laisser le khalifat se délecter commodément du frais de la soirée.
Lorsqu’il se fut assis et que tout le monde fut à sa place, le khalifat fit signe aux chanteuses, et aussitôt l’une d’elles, accompagnée par les autres, dit cette ode fameuse que le khalifat préférait à toutes celles qu’on lui chantait, pour la beauté de ses rythmes et la riche mélodie de ses finales :
« Enfant, l’amoureuse rosée du matin mouille les fleurs entrouvertes, et la brise édénique balance leurs tiges ! Mais tes yeux…
Tes yeux, petit ami, c’est la source limpide où désaltérer longuement le calice de mes lèvres ! Et ta bouche…
Ta bouche, ô jeune ami, est la ruche de perles où boire une salive enviée des abeilles ! »
Et, ces merveilleuses strophes ainsi chantées d’une voix passionnée, la chanteuse se tut. Alors Schamsennahar fit signe à sa favorite qui comprenait son amour pour le prince Ali ; et celle-ci, sur un mode différent, chanta ces vers qui s’appliquaient si bien aux intimes sentiments de la favorite pour Ali ben-Bekar :
« Quand la jeune Bédouine rencontre en chemin un beau cavalier, ses joues rougissent à l’égal de la fleur du laurier qui croît en Arabie.
Ô Bédouine aventureuse, éteins le feu qui te colore ! Sauvegarde ton âme d’une passion naissante qui la consumerait ! Reste insouciante dans ton désert, car la souffrance d’amour est le don des beaux cavaliers. »
Lorsque la belle Schamsennahar eut entendu ces vers, elle fut pénétrée d’une émotion si vive qu’elle se renversa sur son siège et tomba évanouie entre les bras de ses femmes qui avaient volé à son secours.
À cette vue, le prince Ali, qui, dissimulé derrière la fenêtre, regardait cette scène, avec son ami Ben-Tâher, fut tellement saisi de douleur sympathique…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT CINQUANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… fut tellement saisi de douleur sympathique qu’il tomba également tout de son long évanoui dans les bras de son ami Abalhassan ben-Tâher. Alors Abalhassan fut extrêmement perplexe à cause de l’endroit où ils se trouvaient ; et comme il cherchait inutilement de l’eau, dans cette obscurité, pour en asperger le visage de son ami, il vit soudain s’ouvrir une des portes de la galerie et entrer, hors d’haleine, la jeune esclave confidente de Schamsennahar, qui lui dit d’une voix effrayée : « Ô Abalhassan, lève-toi vite, toi et ton compagnon ; je vais tout de suite vous faire tous deux évader d’ici ; car tout est dans une confusion qui ne présage rien de bon pour nous, et je crois bien que c’est notre jour fatal ! Suivez-moi donc tous deux, ou nous sommes tous morts ! » Mais Abalhassan lui dit : « Ô secourable jeune fille, ne vois-tu donc pas l’état de mon ami ? Approche-toi et regarde ! »
Lorsque l’esclave vit le prince Ali évanoui sur le tapis, elle courut à une table où se trouvaient divers flacons qu’elle connaissait, et choisit un aspersoir d’eau de fleurs et vint en rafraîchir le visage du jeune homme qui reprit bientôt ses sens. Alors Abalhassan le souleva par les épaules et la jeune fille par les jambes et, à eux deux, ils le transportèrent hors de la galerie et le descendirent jusqu’au bas du palais, sur la rive du Tigre. Alors ils le déposèrent doucement sur un banc qui se trouvait là ; et la jeune fille se frappa dans les mains, et aussitôt apparut sur le fleuve une barque où il n’y avait qu’un seul rameur, qui se hâta d’accoster et de venir à eux. Puis, sans prononcer une parole, sur un simple signe de la confidente, il prit le prince Ali dans ses bras et le déposa dans l’embarcation, où ne tarda pas à entrer Abalhassan. Quant à la jeune esclave, elle s’excusa de ne pouvoir les accompagner plus loin et leur souhaita la paix d’une voix extrêmement triste, pour rentrer en hâte au palais.
Lorsque la barque fut arrivée à la rive opposée, Ali ben-Bekar, qui était complètement revenu à lui grâce à la fraîcheur de la brise et de l’eau, put, cette fois, soutenu par son ami, mettre pied à terre. Mais il fut obligé bientôt de s’asseoir sur une borne, tant il sentait son âme s’en aller. Et Abalhassan, ne sachant plus comment sortir d’embarras, lui dit : « Ô mon ami, prends courage et raffermis ton âme ; car, en vérité, cet endroit est loin d’être sûr, et ces bords sont infestés de bandits et de malfaiteurs. Un peu de courage seulement et nous serons en sûreté, non loin de là, dans la maison d’un de mes amis qui habite tout près de cette lumière que tu vois ! » Puis il dit : « Au nom d’Allah ! » Et il aida son ami à se lever et lentement il prit avec lui le chemin de la maison en question, à la porte de laquelle il ne tarda pas à arriver. Alors il frappa à cette porte, malgré l’heure avancée, et aussitôt quelqu’un vint ouvrir ; et Abalhassan, s’étant fait reconnaître, fut aussitôt introduit avec beaucoup de cordialité, ainsi que son ami. Et il ne manqua pas d’inventer un motif quelconque pour expliquer leur présence et leur arrivée en cet état à une heure si irrégulière. Et dans cette maison, où l’hospitalité fut exercée envers eux selon ses préceptes les plus admirables, ils passèrent le reste de la nuit, sans être importunés de questions déplacées. Et tous deux passèrent une bien mauvaise nuit : Abalhassan parce qu’il n’avait guère l’habitude de coucher hors de sa maison et qu’il se préoccupait des inquiétudes des siens à son égard, et le prince Ali parce qu’il revoyait toujours devant ses yeux l’image de Schamsennahar pâle et évanouie de douleur dans les bras de ses femmes, aux pieds du khalifat.
Aussi, dès qu’il fut matin, ils prirent congé de leur hôte et se dirigèrent vers la ville et ne tardèrent pas, malgré la grande difficulté qu’avait à marcher Ali ben-Bekar, à arriver à la rue où se trouvaient leurs maisons. Mais comme la première porte à laquelle ils arrivèrent était celle d’Abalhassan, celui-ci invita son ami avec beaucoup d’insistance à entrer d’abord se reposer chez lui, ne voulant pas le laisser seul en un état si fâcheux. Et il dit à ses gens de lui préparer la meilleure chambre de la maison et d’étendre par terre les matelas neufs que l’on conservait enroulés dans les grands placards pour des occasions comme celle-ci. Et le prince Ali, aussi fatigué que s’il avait marché des journées entières, n’eut que la force de se laisser tomber sur les matelas, où il put enfin fermer l’œil quelques heures. À son réveil, il fit ses ablutions et remplit son devoir de la prière et s’habilla pour sortir ; mais Abalhassan le retint en lui disant : « Ô mon maître, il est préférable de passer encore la journée et la nuit dans ma maison, pour que je puisse te tenir compagnie et te distraire de tes peines ! » Et il l’obligea à rester. Et, en effet, le soir venu, Abalhassan, après avoir passé toute la journée à causer avec son ami, fit venir les chanteuses les plus renommées de Baghdad ; mais rien ne put distraire Ali ben-Bekar de ses pensées affligeantes ; au contraire les chanteuses ne firent qu’exaspérer son mal et sa douleur ; et il passa une nuit encore plus troublée que la précédente ; et le matin son état avait empiré de si grave façon que son ami Abalhassan ne voulut pas le retenir davantage. Il se décida donc à l’accompagner jusqu’à chez lui, après l’avoir aidé à monter sur une mule que les esclaves du prince avaient amenée de l’écurie. Et lorsqu’il l’eut remis à ses gens, et qu’il se fut bien assuré qu’il n’avait plus besoin, pour le moment, de sa présence, il prit congé de lui en lui disant encore des paroles d’encouragement et en lui promettant de revenir le plus tôt possible prendre de ses nouvelles. Puis il sortit de la maison et se dirigea vers le souk où il rouvrit sa boutique qu’il avait tenue fermée pendant tout ce temps.
Or, à peine avait-il fini de mettre en ordre sa boutique et s’était-il assis pour attendre les clients, qu’il vit arriver…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT CINQUANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… et s’était-il assis pour attendre les clients, qu’il vit arriver la jeune esclave confidente de Schamsennahar. Elle lui souhaita la paix, et Abalhassan lui rendit son salut et remarqua combien son air était triste et préoccupé, et il constata que son cœur devait battre bien plus vite que d’habitude. Et il lui dit : « Combien ta venue m’est précieuse, ô secourable jeune fille ! Ah ! de grâce, hâte-toi de me mettre au courant de l’état de ta maîtresse ! » Elle lui répondit : « Mais, je t’en supplie, commence d’abord par me donner des nouvelles du prince Ali que j’ai été obligée de laisser dans l’état où il était ! » Et Abalhassan lui raconta tout ce qu’il avait vu de la douleur et de l’irrémédiable langueur de son ami. Et lorsqu’il eut achevé, la confidente devint encore plus triste qu’elle n’était et poussa plusieurs soupirs et, d’une voix émue, dit à Abalhassan : « Quel malheur est le nôtre ! Sache, ô Ben-Tâher, que l’état de ma pauvre maîtresse est encore plus lamentable ! Mais je vais te narrer exactement ce qui s’est passé depuis le moment où tu es sorti de la salle avec ton ami, alors que ma maîtresse était tombée évanouie aux pieds du khalifat qui, tout affligé, ne sut à quoi attribuer ce malaise soudain. Voici !
« Lorsque je vous eus laissés tous deux sous la garde du batelier, je retournai au plus vite, bien inquiète, auprès de Schamsennahar, que je trouvai encore évanouie et étendue toute pâle, et des larmes coulaient goutte à goutte dans ses cheveux défaits. Et l’émir des Croyants, à la limite de l’affliction, était assis tout près d’elle et, malgré tous les soins qu’il lui prodiguait lui-même, il ne parvenait pas à lui faire reprendre ses sens. Et nous toutes nous étions dans une désolation que tu ne saurais imaginer ; et aux questions que le khalifat nous posait anxieusement, pour savoir la cause de ce mal subit, nous ne répondions que par des pleurs et en nous jetant la face contre terre entre ses mains, mais nous nous gardions de lui révéler un secret qu’il ignorait. Et cet état d’inexprimable angoisse dura de la sorte jusqu’à minuit. Alors, à force de lui rafraîchir les tempes avec l’eau de roses et l’eau de fleurs et de lui faire de l’air avec nos éventails, nous eûmes enfin la joie de la voir revenir peu à peu de son évanouissement. Mais aussitôt elle se mit à répandre un torrent de larmes, à la stupéfaction absolue du khalifat, qui finit lui-même par pleurer également. Or, tout cela était triste et extraordinaire !
« Lorsque le khalifat vit qu’il pouvait enfin adresser la parole à sa favorite, il lui dit : « Schamsennahar, lumière de mes yeux, parle-moi, dis-moi la cause de ton mal pour que je puisse au moins t’être de quelque utilité ! Vois ! je souffre moi-même de mon inaction ! » Alors Schamsennahar fit effort pour embrasser les pieds du khalifat qui ne lui en laissa pas le temps ; il lui prit les mains et doucement continua à l’interroger. Alors, d’une voix brisée, elle lui dit : « Ô émir des Croyants, le mal dont je souffre est passager ! Il est causé par certaines choses que j’ai mangées dans la journée et qui ont dû se contrarier au dedans de moi ! » Et le khalifat lui demanda : « Qu’as-tu donc mangé, ô Schamsennahar ? » Elle répondit : « Deux citrons acides, six pommes aigres, une porcelaine de lait caillé, un gros morceau de kenafa avec, par là-dessus, tant la fringale me tenait, une ocke de pistaches salées et de grains de courge, avec pas mal de pois chiches confits au sucre et encore tout chauds sortant du fourneau ! » Alors le khalifat s’écria : « Ô imprudente petite amie, en vérité tu m’étonnes ! Je ne doute point que ces choses ne soient infiniment délicieuses et appétissantes, mais encore faut-il te ménager un peu et empêcher ton âme de se jeter inconsidérément sur ce qu’elle aime ! Par Allah ! ne te remets plus dans de pareils états ! » Et le khalifat qui, d’ordinaire, est si peu prodigue de paroles et de caresses pour les autres femmes, continua à parler à sa favorite avec beaucoup de ménagements, et il la veilla de la sorte jusqu’au matin. Mais comme il voyait que son état ne s’améliorait pas beaucoup, il fit mander tous les médecins du palais et de la ville, qui, comme de raison, se gardèrent bien de deviner la vraie cause du mal dont souffrait ma maîtresse et dont l’aggravation n’était due qu’à la contrainte où la mettait la présence du khalifat. Ces savants lui prescrivirent une recette si compliquée que, malgré la meilleure volonté, ô Ben-Tâher, je ne saurais t’en répéter un seul mot.
« Enfin le khalifat, suivi de tous les médecins et des autres, finit par se retirer ; et je pus alors approcher librement de ma maîtresse ; et je lui couvris les mains de baisers et lui dis de telles paroles d’encouragement, en l’assurant que je prenais sur moi de lui faire de nouveau revoir le prince Ali ben-Bekar, qu’elle finit par se laisser soigner par moi. Et aussitôt je lui donnai à boire un verre d’eau fraîche, avec de l’eau de fleurs dedans, qui lui fit le plus grand bien.
Et c’est alors que, s’oubliant elle-même, elle m’a ordonné de la laisser pour le moment et de courir chez toi prendre des nouvelles de son amant, dont je lui avais raconté, par le menu, le chagrin extrême. »
À ces paroles de la confidente, Abalhassan ben-Tâher lui dit : « Ô jeune fille, maintenant que je n’ai plus rien à t’apprendre sur l’état de notre ami, hâte-toi de retourner auprès de ta maîtresse, et de lui transmettre mes souhaits de paix ; et dis-lui combien, en apprenant ce qui lui était arrivé, j’ai éprouvé de chagrin ; et dis-lui bien que je n’ai pas manqué de trouver que c’était une bien dure épreuve, mais que je l’exhorte beaucoup à la patience et surtout à la plus stricte réserve dans ses paroles, de peur que la chose ne finisse par parvenir aux oreilles du khalifat ! Et demain tu reviendras à ma boutique et, si Allah veut ! les nouvelles que nous nous donnerons mutuellement seront plus consolantes ! »
Alors la jeune fille le remercia beaucoup pour ses paroles et pour tous ses bons offices, et le quitta. Et Abalhassan passa le reste de la journée dans sa boutique, qu’il ferma pourtant de meilleure heure que de coutume pour voler à la maison de son ami Ben-Bekar…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT CINQUANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… pour voler à la maison de son ami Ben-Bekar. Et il frappa à la porte, que le portier vint ouvrir, et il entra et trouva son ami entouré d’un cercle nombreux de médecins de toute espèce et de parents et d’amis ; et les uns lui tâtaient le pouls, et les autres lui prescrivaient chacun un remède différent et absolument contraire, et les vieilles femmes renchérissaient encore là-dessus et jetaient sur les médecins des regards de travers, si bien que le jeune homme sentait son âme devenir toute petite à force de se rétracter d’impatience ; et, à bout de forces, pour ne plus rien voir et rien entendre, il enfonça sa tête sous les couvertures en se tamponnant les oreilles de ses deux mains.
Mais à ce moment Abalhassan s’avança à son chevet et l’appela en le tirant doucement, et lui dit en souriant d’un air de bon augure : « La paix sur toi, ya Ali ! » Il répondit : « Et sur toi la paix et les bienfaits d’Allah et ses bénédictions, ya Abalhassan ! Fasse Allah que tu sois porteur de nouvelles aussi blanches que ton visage, ô mon ami ! » Alors Abalhassan, ne voulant point parler devant tous ces visiteurs, se contenta de cligner seulement de l’œil à Ben-Bekar ; et lorsque tout ce monde-là fut parti, il l’embrassa et lui raconta tout ce que lui avait dit la confidente et ajouta : « Tu peux être toujours sûr, ô mon frère, que je suis à ta dévotion absolue, et que mon âme t’appartient tout entière. Et je n’aurai de repos que lorsque je t’aurai rendu la tranquillité du cœur ! » Et Ben-Bekar fut tellement touché des bons procédés de son ami qu’il en pleura de tout son cœur et dit : « Je t’en prie, complète tes bontés en passant cette nuit avec moi, pour que je puisse m’entretenir avec toi et distraire ma pensée torturante ! » Et Ben-Bekar ne manqua pas d’acquiescer à son désir, et il resta près de lui à lui réciter des poèmes et à lui chanter des odes d’amour d’une voix atténuée, tout près de l’oreille. Et tantôt c’étaient des vers que le poète adressait à l’ami, et tantôt c’étaient des vers sur la bien-aimée. Or, voici d’abord, entre mille, les vers en l’honneur de la bien-aimée :
Elle perça du glaive de son regard la visière de mon casque, et pour toujours attacha mon âme à la souplesse de sa taille.
Toute blanche à mes yeux elle apparaît, avec le seul grain de musc qui orne le camphre de son menton !
Si, effrayée soudain, elle tremble, les cornalines de ses joues se muent en la pure pâleur des perles ou la matité du sucre candi !
Si, chagrinée, elle soupire en appuyant la main sur sa poitrine nue, ô mes yeux ! racontez le spectacle que vous voyez !
« Nous voyons, disent mes yeux, une nappe candide où se posent cinq roseaux ornés chacun au bout de rose corail ! »
Ô guerrier, ne crois point que ton glaive bien trempé puisse te sauvegarder de ses paupières alanguies !
Elle n’a point, il est vrai, de lance pour te percer ; mais crains sa taille droite ! Elle ferait de toi, en un clin d’œil, le plus humble des captifs !
Et encore :
Son corps est un rameau d’or et ses seins sont deux coupes rondes et transparentes qui reposent, renversées ! Et ses lèvres de grenade sont parfumées de son haleine.
Mais c’est alors qu’Abalhassan, voyant son ami excessivement ému par ces vers, dit : « Ô Ali, je vais te chanter maintenant cette ode que tu aimais tant à soupirer, à côté de moi, au souk, dans ma boutique ! Puisse-t-elle mettre un baume sur ton âme blessée, ya Ali ! Écoute donc, mon ami, ces paroles merveilleuses du poète :
« Ô ! viens ! L’or léger de la coupe est admirable sous le rubis de ce vin, ô échanson !
Éparpille vers le loin tous les chagrins du passé et, sans songer à demain, prends cette coupe où boire l’oubli et, de ta main, ah ! grise-moi complètement.
Toi seul, parmi tous ceux-là qui pèsent sur ma vue, es fait pour comprendre ! Viens ! À toi je révélerai les secrets d’un cœur qui se garde jalousement !…
Mais hâte-toi ! Verse-moi la cause d’allégresse, cette liqueur d’oubli, enfant aux joues plus douces que le baiser sur la bouche des vierges ! »
À ce chant, le prince Ali, déjà si faible, fut dans un tel état d’anéantissement, causé par les souvenirs intenses qui lui revenaient à la mémoire, qu’il se mit à pleurer de nouveau ; et Abalhassan ne sut plus que lui dire pour le calmer, et passa encore toute cette nuit-là à son chevet, à le veiller, sans fermer l’œil un instant. Puis, vers le matin, il se décida tout de même à aller ouvrir sa boutique qu’il négligeait fort depuis un certain temps. Et il y resta jusqu’au soir. Mais au moment où, ayant fini de vendre et d’acheter, il venait de faire rentrer les étoffes à l’intérieur et se disposait à s’en aller, il vit arriver, voilée, la jeune confidente de Schamsennahar qui, après les salams d’usage, lui dit : « Ma maîtresse vous envoie à toi et à Ben-Bekar ses souhaits de paix et me charge, comme il était convenu, de venir prendre des nouvelles de sa santé ! Comment va-t-il ? dis-le moi ! » Il répondit : « Ô gentille, ne m’interroge point ! Car vraiment ma réponse serait trop triste ! Car l’état de notre ami est loin d’être brillant ! Il ne dort plus ! Il ne mange plus ! Il ne boit plus ! Et il n’y a plus que les vers qui le tirent un peu de sa langueur ! Ah ! si tu voyais la pâleur de son teint ! » Elle dit : « Quelle calamité sur nous ! Enfin, voici : ma maîtresse, qui n’est guère mieux, au contraire ! m’a chargée de porter à son amoureux cette lettre que j’ai là, dans les cheveux. Et elle m’a bien recommandé de ne point retourner sans la réponse. Veux tu donc m’accompagner chez notre ami, dont je ne connais guère la maison ? » Abalhassan dit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il se hâta de fermer la boutique et de marcher à dix pas en avant de la confidente qui le suivait…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, ne voulut pas prolonger le récit.
LA CENT CINQUANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… à dix pas en avant de la confidente qui le suivait. Et lorsqu’il fut arrivé à la maison de Ben-Bekar, il dit à la jeune fille, en l’invitant à s’asseoir sur le tapis de l’entrée : « Attends-moi ici quelques instants. Je vais d’abord m’assurer s’il n’y a point d’étrangers ! » Et il entra chez Ben-Bekar et lui cligna de l’œil. Et Ben-Bekar comprit le signe et dit à ceux qui l’entouraient : « Avec votre permission ! J’ai mal au ventre ! » Alors ils comprirent et, après les salams, se retirèrent en le laissant seul avec Abalhassan. Or, sitôt qu’ils furent partis, Abalhassan courut chercher la confidente, qu’il introduisit. Et, à sa seule vue qui lui rappelait Schamsennahar, Ben-Bekar se sentit déjà considérablement ragaillardi, et lui dit : « Ô venue délicieuse ! Oh ! sois bénie ! » Et la jeune fille s’inclina en le remerciant et lui remit tout de suite la lettre de Schamsennahar. Et Ben-Bekar la prit et la porta à ses lèvres, puis à son front et, comme il était trop faible pour la lire, il la tendit à Abalhassan, qui y trouva, écrits de la main de la favorite, des vers où toutes ses peines d’amour étaient contées dans les termes les plus touchants. Et comme Abalhassan jugeait que cette lecture mettrait son ami dans les pires états, il se contenta de lui en résumer le contenu en quelques mots fort jolis, et lui dit : « Je vais tout de suite, ô Ali, me charger de la réponse, que tu signeras ! » Et cela fut fait d’une façon parfaite, et Ben-Bekar voulut que le sens général de cette lettre fût ceci : « Si la douleur était absente des amours, les amants n’éprouveraient guère de délices à s’écrire ! » Et il recommanda à la confidente, avant qu’elle n’eût pris congé, de raconter à sa maîtresse tout ce qu’elle avait vu de sa douleur. Après quoi il lui remit sa réponse en l’arrosant de ses larmes ; et la confidente fut tellement touchée qu’elle aussi se mit notoirement à pleurer, et se retira enfin en lui souhaitant la paix du cœur. Et Abalhassan sortit également pour accompagner la confidente dans la rue ; et il ne la quitta que devant sa boutique où il lui fit ses adieux, et il retourna dans sa maison.
Or, Abalhassan, en arrivant à sa maison, se mit pour la première fois à réfléchir sur la situation, et se parla de la sorte à lui-même, en s’asseyant sur le divan :
« Ô Abalhassan, tu vois bien que la chose commence à devenir fort grave ! Qu’adviendrait-il si l’affaire venait à être connue du khalifat ? Ya Allah ! qu’adviendrait-il ? Certes, j’aime tant Ben-Bekar que je suis prêt à enlever un de mes yeux pour le lui donner ! Mais, Abalhassan ! tu as une famille, une mère, des sœurs et des petits frères ! Dans quelles infortunes ne seront-ils pas par ton imprudence ? En vérité, cela ne peut longtemps durer de la sorte ! Dès demain j’irai retrouver Ben-Bekar et je tâcherai de l’arracher à cet amour aux conséquences déplorables ! S’il ne m’écoute pas, Allah m’inspirera la conduite à tenir ! » Et Abalhassan, la poitrine rétrécie de ses pensées, ne manqua pas, dès le matin, d’aller retrouver son ami Ben-Bekar. Il lui souhaita la paix et lui demanda : « Ya Ali, comment vas-tu ? » Il répondit : « Plus mal que jamais ! » Et Abalhassan lui dit : « Vraiment, de ma vie je n’ai encore vu ni entendu parler d’une aventure pareille à la tienne, ni connu un amoureux aussi étrange que toi ! Tu sais que Schamsennahar t’aime autant que tu l’aimes, et, malgré cette assurance, tu souffres et ton état s’aggrave de jour en jour ! Que serait-ce alors si celle que tu aimes tant ne partageait pas ton affection et si, au lieu d’être sincère dans son amour, elle était comme la plupart des femmes amoureuses qui aiment avant tout le mensonge et les ruses de l’intrigue ? Mais surtout, ô Ali, songe aux malheurs qui s’abattraient sur nos têtes si cette intrigue venait à être connue du khalifat ? Or, il n’y aurait vraiment rien d’improbable à ce que cela arrivât, car les allées et venues de la confidente vont éveiller l’attention des eunuques et la curiosité des esclaves : et alors Allah seul pourra savoir l’étendue de notre calamité à tous ! Crois-moi, ô Ali, en persistant dans cet amour sans porte de sortie, tu t’exposes à te perdre, toi d’abord, et Schamsennahar avec toi ! Je ne parle pas de moi, qui sûrement serais effacé, en un clin d’œil, du nombre des vivants, ainsi que toute ma famille ! »
Mais Ben-Bekar, tout en remerciant son ami de ce conseil, lui déclara que sa volonté n’était plus sous sa dépendance, et que d’ailleurs, en dépit de tous les malheurs qui pourraient lui arriver, jamais il ne se résoudrait à se ménager alors que Schamsennahar ne craignait pas d’exposer sa vie par amour pour lui !
Alors Abalhassan, voyant que toutes les paroles seraient vaines désormais, prit congé de son ami et reprit le chemin de sa maison, en proie à ses préoccupations pour l’avenir.
Or, Abalhassan avait, parmi les amis qui le venaient voir le plus souvent, un jeune joaillier fort gentil, nommé Amin, et dont il avait pu souvent apprécier la discrétion. Et justement ce jeune joaillier vint en visite au moment même où, accoudé sur les coussins, Abalhassan était plongé dans la perplexité. Aussi, après les salams, il s’assit à côté de lui sur le divan et, comme il était le seul à être un peu au courant de cette intrigue amoureuse, il lui demanda : « Ô Abalhassan, où en sont les amours d’Ali ben-Bekar et de Schamsennahar ? » Abalhassan répondit : « Ô Amin, qu’Allah nous ait en sa miséricorde ! J’ai des pressentiments qui ne me présagent rien de bon !…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT CINQUANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … des pressentiments qui ne me présagent rien de bon. Aussi, te sachant homme sûr et ami fidèle, je veux te révéler le projet auquel je pense me résoudre pour me tirer, moi et ma famille, de ce pas dangereux ! » Et le jeune joaillier lui dit : « Tu peux parler en toute confiance, ô Abalhassan ! Tu trouveras en moi un frère prêt à se dévouer pour te rendre service ! » Et Abalhassan lui dit : « J’ai idée, ô Amin, de me défaire de toutes mes attaches à Baghdad, d’encaisser mes créances, de payer mes dettes, de vendre au rabais mes marchandises, de réaliser tout ce que je pourrai réaliser, et de m’en aller au loin, à Bassra, par exemple, où j’attendrai tranquillement les événements. Car, ô Amin, cet état de choses me devient intolérable, et la vie ne m’est plus possible ici, depuis que je suis hanté par la terreur d’être signalé au khalifat comme ayant été pour quelque chose dans l’intrigue amoureuse. Car il est fort probable que cette intrigue finira par être connue du khalifat ! »
À ces paroles, le jeune joaillier lui dit : « En vérité, ô Abalhassan, ta résolution est une résolution fort sage, et ton projet le seul qu’un homme avisé puisse vraiment prendre, à la réflexion. Qu’Allah t’éclaire et te montre la meilleure de ses voies pour sortir de ce mauvais pas ! Et si mon assistance peut te décider à partir sans remords, me voici prêt à agir à ta place comme si tu étais là, et à servir ton ami Ben-Bekar avec mes yeux ! » Et Abalhassan lui dit : « Mais comment feras-tu puisque tu ne connais point Ali Ben-Bekar et que tu n’es point non plus en relations avec le palais et avec Schamsennahar ? » Amin répondit : « Pour ce qui est du palais, j’ai déjà eu l’occasion d’y vendre des bijoux par l’intermédiaire même de la jeune confidente de Schamsennahar ; mais pour ce qui est de Ben-Bekar, rien ne me sera plus facile que de le connaître et de lui inspirer confiance. Aie donc l’âme tranquille, et si tu veux partir ne te préoccupe point du reste, car Allah est le portier qui sait, quand il lui plaît, ouvrir toutes les entrées ! » Et sur ces paroles, le joaillier Amin prit congé d’Abalhassan et s’en alla en son chemin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT SOIXANTIÈME NUIT
Elle dit :
… prit congé d’Abalhassan et s’en alla en son chemin.
Mais, au bout de trois jours, il revint prendre de ses nouvelles et trouva la maison absolument vide. Alors il s’informa de la chose auprès des voisins, qui lui répondirent : « Abalhassan est allé à Bassra pour un voyage d’affaires, et il nous a dit à tous que son absence ne serait pas de longue durée et qu’à peine rentré dans l’argent que lui doivent ses clients lointains il ne manquerait pas de revenir à Baghdad. » Alors Amin comprit qu’Abalhassan avait fini par céder à ses terreurs et qu’il avait jugé plus prudent de disparaître pour le cas où l’aventure amoureuse parviendrait aux oreilles du khalifat. Mais il ne sut d’abord lui-même quel parti prendre ; enfin, il se dirigea du côté du logis de Ben-Bekar. Là, il pria l’un des esclaves de l’introduire auprès de son maître ; et l’esclave le fit entrer dans la salle de réunion où le jeune joaillier trouva Ben-Bekar étendu sur les coussins, bien pâle. Il lui souhaita la paix et Ben-Bekar lui rendit son souhait. Alors il lui dit : « Ô mon maître, bien que mes yeux n’aient pas eu la joie de te connaître avant ce jour, je viens m’excuser d’abord auprès de toi d’avoir tant différé à venir demander des nouvelles de ta santé. Ensuite je viens t’annoncer une chose qui certainement te causera quelque désagrément, mais je suis également porteur du remède qui te fera tout oublier ! » Et Ben-Bekar, tremblant d’émotion, lui demanda : « Par Allah ! que peut-il m’arriver encore en fait de désagréments ? » Et le jeune joaillier lui dit : « Sache, ô mon maître, que j’ai toujours été le confident du ton ami Abalhassan et que jamais il ne me cachait rien de ce qui lui arrivait. Or, voici trois jours qu’Abalhassan, qui d’ordinaire venait me voir tous les soirs, a disparu ; et, comme je sais, par les confidences qu’il m’a faites, que tu es également son ami, je viens te demander si tu sais où il est et pourquoi il est parti et a disparu sans rien dire à ses amis ! »
À ces paroles, le pauvre Ben-Bekar fut à la limite extrême de la pâleur et tellement qu’il faillit perdre toute connaissance. Enfin il put articuler : « C’est pour moi également la première nouvelle ! Et je ne savais plus en effet à quoi attribuer cette absence de trois jours de Ben-Tâher ! Mais si j’envoyais un de mes esclaves prendre de ses nouvelles, peut-être saurions-nous la vérité du fait ! » Alors il dit à l’un des esclaves : « Va vite à la maison d’Abalhassan ben-Tâher et demande s’il est toujours ici ou s’il est en voyage. Si l’on te répond qu’il est en voyage, ne manque pas de demander de quel côté il est parti. » Et aussitôt l’esclave sortit pour aller aux nouvelles et revint au bout d’un certain temps et dit à son maître : « Les voisins d’Abalhassan m’ont raconté qu’Abalhassan est parti pour Bassra. Mais j’ai également trouvé une jeune fille qui s’informait elle aussi d’Abalhassan et qui m’a demandé : « Tu es sans doute des gens du prince Ben-Bekar ? » Et comme je répondais par l’affirmative, elle ajouta qu’elle avait une communication à te faire et elle m’accompagna jusqu’ici. Et elle est dans l’attente d’une audience. » Et Ben-Bekar répondit : « Introduis-la tout de suite ! »
Or, quelques instants après, la jeune fille entra et Ben-Bekar reconnut la confidente de Schamsennahar. Elle s’approcha et, après les salams, lui dit à l’oreille quelques paroles qui lui éclairèrent le visage et l’assombrirent, tour à tour.
Alors le jeune joaillier trouva qu’il était à propos de placer son mot et dit : « Ô mon maître et toi, ô jeune fille, sachez qu’Abalhassan, avant de partir, m’a révélé tout ce qu’il savait et m’a exprimé toute la terreur qu’il ressentait rien qu’à l’idée que l’affaire qui vous intéresse pouvait parvenir à la connaissance du khalifat. Mais moi, qui n’ai ni épouse ni enfants ni famille, je suis disposé de toute mon âme à le remplacer auprès de vous, car j’ai été touché profondément des détails que m’a donnés Ben-Tâher sur vos malheureuses amours. Si vous voulez bien ne point repousser mes services, je vous jure par notre saint Prophète (sur lui la prière et la paix !) de vous être aussi fidèle que mon ami Ben-Tâher, mais plus ferme et plus constant. Et même, au cas où mon offre ne vous agréerait pas, ne croyez point que je n’aurais pas l’âme assez élevée pour taire un secret qui m’a été confié…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT SOIXANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
»… un secret qui m’a été confié ! Au contraire, si mes paroles ont pu vous persuader tous deux, il n’est pas de sacrifice auquel je ne sois prêt à souscrire pour vous être agréable ; car je suis disposé à user de tous les moyens qui sont en mon pouvoir pour vous procurer la satisfaction que vous désirez, et même je ferai de ma maison le lieu de tes rencontres, ô mon maître, avec la belle Schamsennahar ! »
Lorsque le jeune joaillier eut achevé ces paroles, le prince Ali fut dans un tel transport de joie qu’il sentit soudain les forces lui ranimer l’âme et il se leva sur son séant et embrassa le joaillier Amin et lui dit : « C’est Allah qui t’envoie, ô Amin ! Aussi je me confie entièrement à toi et n’attends mon salut que d’entre tes mains ! » Puis il le remercia encore longuement et lui dit adieu en pleurant de joie.
Alors le joaillier se retira en emmenant la jeune fille ; il la conduisit à sa maison, et lui apprit que là désormais auraient lieu les entrevues entre elle et lui, comme aussi l’entrevue qu’il projetait entre le prince Ali et Schamsennahar ! Et la jeune fille, ayant ainsi appris le chemin de la maison, ne voulut pas différer plus longtemps de mettre sa maîtresse au courant de la situation. Elle promit donc au joaillier de revenir le lendemain avec la réponse de Schamsennahar.
Et, en effet, le lendemain elle arriva à la maison d’Amin et lui dit : « Ô Amin, ma maîtresse Schamsennahar a été à la limite de la joie lorsqu’elle eut appris les bonnes dispositions où tu es à notre égard ! Et elle me charge de venir te prendre pour te mener chez elle, au palais, où elle veut elle-même te remercier, de sa bouche, pour ta générosité spontanée et l’intérêt que tu portes à des personnes dont rien ne t’obligeait à servir les desseins ! »
À ces paroles, le jeune joaillier, au lieu de montrer de l’empressement à se rendre à ce désir de la favorite, fut au contraire pris d’un tremblement de tout le corps et devint bien pâle et finit par dire à la jeune fille : « Ô ma sœur, je vois bien que Schamsennahar et toi n’avez guère réfléchi à la démarche que vous me demandez de faire. Vous oubliez que je suis un homme du commun et que je n’ai ni la notoriété d’Abalhassan ni les intelligences qu’il s’était ménagées parmi les eunuques du palais, où il pouvait circuler à sa guise pour toutes les commissions dont on le chargeait ; et je n’ai ni son assurance ni son admirable pratique des coutumes des gens qu’il allait voir. Comment oserais-je donc me rendre au palais, moi qui frémissais déjà rien qu’en entendant Abalhassan me raconter ses visites à la favorite ? En vérité, le courage me fait défaut pour affronter un tel danger ! Mais tu peux dire à ta maîtresse que ma maison est certainement l’endroit le plus propice aux entrevues ; et, si elle consentait à y venir, nous pourrions causer tout à notre aise, sans être sous l’appréhension d’un danger quelconque ! » Et comme la jeune fille essayait tout de même de l’encourager à la suivre et qu’elle avait même fini par le décider à se lever, il fut pris soudain d’un tel tremblement qu’il flageola sur ses jambes et que la jeune fille fut obligée de le soutenir et de l’aider à se rasseoir en lui donnant à boire un verre d’eau fraîche pour calmer ses esprits.
Alors, comme elle voyait qu’il était désormais imprudent d’insister, la jeune fille dit à Amin : « Tu as raison ! Il vaut beaucoup mieux, dans notre intérêt à tous, décider Schamsennahar à venir plutôt ici elle-même. Je vais donc m’y employer, et je l’amènerai sûrement. Attends-nous donc sans bouger un instant ! »
Et, en effet, exactement comme elle l’avait prévu, sitôt que la confidente eut appris à sa maîtresse l’impossibilité où se trouvait le jeune joaillier de se rendre au palais, Schamsennahar, sans hésiter un instant, se leva et, s’enveloppant de son grand voile de soie, suivit sa confidente, en oubliant la faiblesse qui l’avait jusque là immobilisée sur les coussins. La confidente entra la première dans la maison pour s’assurer d’abord si sa maîtresse ne s’exposait pas à être vue par des esclaves ou des étrangers, et demanda à Amin : « As-tu au moins congédié les gens de la maison ? » Il répondit : « J’habite seul ici, avec la vieille négresse qui fait mon ménage. » Elle dit : « Il faut tout de même l’empêcher d’entrer ici ! » Et elle alla elle-même fermer toutes les portes en dedans, et courut alors chercher sa maîtresse.
Schamsennahar entra et, sur son passage, du parfum de ses robes les salles et les couloirs s’emplissaient miraculeusement. Et sans prononcer une parole, et sans regarder autour d’elle, elle alla s’asseoir sur le divan et s’appuya sur les coussins que le jeune joaillier s’empressait de disposer derrière elle. Et elle resta ainsi immobile, pendant un bon moment, prise de faiblesse et respirant à peine. Elle put enfin, une fois reposée de cette course si inaccoutumée, relever sa voilette et se débarrasser de son grand voile. Et le jeune joaillier, ébloui, crut voir le soleil lui-même dans son logis. Et Schamsennahar le considéra un instant, tandis qu’il se tenait respectueusement à quelques pas, et demanda à l’oreille de sa confidente : « C’est bien celui dont tu m’as parlé ? » Et, la jeune fille ayant répondu : « Oui, maîtresse ! » elle dit au jeune homme : « Comment vas-tu, ya Amin ? » Il répondit : « La louange à Allah ! en bonne santé ! Puisse Allah te garder et te conserver comme le parfum dans l’or ! » Elle lui dit : Es-tu marié ou célibataire ? » Il répondit : « Par Allah ! célibataire, ô ma maîtresse ! Et je n’ai plus ni père ni mère, ni aucun parent. Aussi, pour toute occupation, je n’aurai qu’à me dévouer à ton service ; et tes moindres désirs seront sur ma tête et sur mes yeux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT SOIXANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … et tes moindres désirs seront sur ma tête et sur mes yeux ! Sache, en outre, que je mets entièrement à ta disposition, pour les rencontres avec Ben-Bekar, une maison qui m’appartient, où personne n’habite, et qui est située juste en face de celle-ci que j’habite. Je vais la meubler tout de suite pour vous y recevoir dignement, et pour que vous n’y manquiez de rien ! » Alors Schamsennahar le remercia beaucoup et lui dit : « Ya Amin, quelle destinée heureuse est la mienne d’avoir eu la chance de rencontrer un ami aussi dévoué que tu l’es ! Ah ! je sens bien à présent combien l’aide d’un ami désintéressé est efficace, et combien surtout il est délicieux de rencontrer l’oasis du repos après le désert des tourmentes et des souffrances ! Crois bien aussi que Schamsennahar saura te prouver un jour qu’elle connaît le prix de l’amitié. Regarde ma confidente, ô Amin ! Elle est jeune, douce et exquise ; tu peux être sûr que bientôt, malgré toute la peine que j’aurai à m’en séparer, je t’en ferai cadeau pour te faire passer des nuits de lumière et des jours de fraîcheur ! » Et Amin regarda la jeune fille et trouva qu’en effet elle était fort attrayante et qu’elle avait, outre des yeux parfaitement beaux, des fesses absolument merveilleuses.
Mais Schamsennahar continua : « En elle j’ai une confiance illimitée ; ne crains donc pas de lui confier tout ce que te dira le prince Ali ! Et aime-la, car elle a en elle des qualités de sympathie qui rafraîchissent le cœur ! » Et Schamsennahar dit encore plusieurs choses gentilles au joaillier et se retira suivie de sa confidente qui, de ses yeux souriants, dit adieu à son nouvel ami.
Lorsqu’elles furent parties, le joaillier Amin courut à sa boutique et en retira tous les vases précieux et toutes les coupes ciselées et les tasses d’argent, et les porta dans la maison où il comptait recevoir amants. Puis il alla chez toutes ses connaissances, et emprunta aux uns des tapis, aux autres des coussins de soie et à d’autres des porcelaines, des plateaux et des aiguières. Et il finit de la sorte par meubler magnifiquement la maison.
Alors, comme il avait fini de mettre tout en ordre et qu’il s’était assis un moment pour jeter un coup d’œil général sur toutes choses, il vit entrer doucement son amie, la jeune confidente de Schamsennahar. Elle s’approcha en se balançant gentiment sur les hanches, et lui dit après les salams : « Ô Amin, ma maîtresse t’envoie son souhait de paix et ses remercîments, et te dit que grâce à toi elle est maintenant bien consolée du départ d’Abalhassan. Et ensuite elle me charge de te dire d’aviser son amoureux que le khalifat s’est absenté du palais et que ce soir elle pourra se rendre ici. Il te faut donc avertir tout de suite le prince Ali ; et cette nouvelle, je n’en doute pas, achèvera de le rétablir et de lui rendre les forces et la santé ! » Et, ayant dit ces paroles, la jeune fille tira de son sein une bourse remplie de dinars et la tendit à Amin en lui disant : « Ma maîtresse te prie de faire toutes les dépenses sans compter ! » Mais Amin repoussa la bourse en s’écriant : « Ma valeur est-elle donc si petite à ses yeux, que ta maîtresse, ô jeune fille, me donne cet or en récompense ? Dis-lui qu’Amin est payé, et au-delà, par l’or de ses paroles et les regards de ses yeux ! » Alors la jeune fille remporta la bourse et, tout à fait heureuse du désintéressement d’Amin, courut raconter la chose à Schamsennahar et la prévenir que tout était déjà prêt dans la maison. Puis elle se mit à l’aider à prendre son bain, à se peigner, à se parfumer et à s’habiller de ses plus belles robes.
De son côté, le joaillier Amin se hâta de se rendre chez le prince Ali ben-Bekar, après avoir toutefois placé des fleurs fraîches dans les vases, rangé les plateaux remplis de mets de toutes sortes, de pâtisseries, de confitures et de boissons, et rangé en bon ordre, contre le mur, les luths, les guitares et les autres instruments d’harmonie. Et il entra chez le prince Ali, qu’il trouva déjà un peu ragaillardi par l’espoir qu’il lui avait mis la veille dans le cœur. Aussi la jubilation du jeune homme fut considérarable lorsqu’il apprit que dans quelques instants il allait enfin revoir l’amante, cause de ses larmes et de son bonheur ! Du coup, il oublia tous ses chagrins et toutes ses souffrances, et son teint aussitôt s’en ressentit, car il s’éclaira tout à fait et devint bien plus beau que par le passé avec, en plus, plus de douceur sympatique.
Alors, aidé de son ami Amin, il revêtit ses habits les plus magnifiques et, aussi solide que s’il n’avait jamais été près des portes du tombeau, il prit, avec le joaillier, le chemin de sa maison. Et, lorsqu’ils furent entrés, Amin s’empressa d’inviter le prince à s’asseoir, et lui disposa derrière le dos de tendres coussins, et plaça à côté de lui, à droite et à gauche, un beau vase de cristal rempli de fleurs, et lui mit entre les doigts une rose. Et tous deux, en causant doucement, attendirent l’arrivée de la favorite.
Or, à peine quelques instants s’étaient-ils écoulés que l’on frappa à la porte, et Amin courut ouvrir et rentra bientôt suivi de deux femmes, dont l’une était complètement enveloppée d’un izar épais de soie noire…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT SOIXANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… deux femmes dont l’une était complètement enveloppée d’un izar épais de soie noire. Et c’était l’heure même de l’appel à la prière, sur les minarets, au coucher du soleil. Et comme au dehors, limpide, la voix extatique du muezzin appelait les bénédictions d’Allah sur la terre, Schamsennahar releva son voile, aux yeux de Ben-Bekar.
Et les deux amants, à la vue l’un de l’autre, tombèrent évanouis, et restèrent une heure de temps avant de pouvoir recouvrer le sentiment. Quand enfin ils ouvrirent les yeux, ils se regardèrent en silence longuement, n’arrivant pas encore à exprimer autrement leur passion. Et quand ils furent assez maîtres d’eux-mêmes pour pouvoir parler, ils se dirent des paroles si douces que la confidente et le jeune Amin ne purent s’empêcher de pleurer, dans leur coin.
Mais bientôt le joaillier Amin pensa qu’il était temps de servir ses hôtes, et il s’empressa, aidé de la jeune fille, de leur apporter d’abord les parfums agréables qui les disposèrent à toucher aux mets, aux fruits et aux boissons qui étaient en abondance et de première qualité tout à fait. Après quoi, Amin leur versa l’eau de l’aiguière sur les mains et leur tendit les serviettes aux franges de soie. Et c’est alors que, complètement ranimés et remis de leur émoi, ils purent commencer à vraiment goûter les délices de leur réunion. Aussi Schamsennahar, sans davantage différer, dit à la jeune fille : « Donne-moi ce luth, que j’essaie de lui faire dire la passion considérable qui crie en mon âme ! » Et la confidente lui présenta le luth, qu’elle prit et posa sur ses genoux, et, après en avoir rapidement harmonisé les cordes, elle préluda d’abord par un chant sans paroles. Et l’instrument, sous ses doigts, sanglotait ou riait et son âme s’exhalait toute en fusées mélodiques qui les tinrent tous haletants. Alors commença leur extase. Et alors seulement, les yeux perdus dans les yeux de son ami, elle chanta :
« Ô mon corps d’amoureuse, tu t’es fait diaphane à attendre en vain le bien-aimé ! Mais le voici ! Et la brûlure de mes joues, sous les larmes versées, s’adoucit de la brise de sa venue !
Ô nuit bénie aux côtés de mon ami, tu donnes à mon cœur plus de douceur que toutes les nuits de mon destin !
Ô nuit que j’attendais, que j’espérais ! Mon bien-aimé m’enlace de son bras droit, et de mon bras gauche je l’enveloppe joyeuse !
Je l’enveloppe et de mes lèvres je hume le vin de sa bouche, tandis que ses lèvres me vident entièrement ! Ainsi je m’assure la ruche même et tout le miel ! »
Lorsqu’ils entendirent ce chant, ils furent tous les trois dans une jouissance si considérable, qu’ils s’écrièrent du fond de leurs poitrines : « Ya leil ! ya salam ! Voilà ! ah ! voilà des paroles de délice ! »
Puis le joaillier Amin, jugeant que sa présence n’était plus nécessaire et au comble du plaisir en voyant les deux amants dans les bras l’un de l’autre, se retira discrètement et, pour ne point s’exposer à les troubler, se décida à les laisser seuls dans cette maison. Il prit le chemin du logis où d’ordinaire il habitait et, l’esprit tranquille désormais, il ne tarda pas à s’étendre sur son lit, en pensant au bonheur de ses amis. Et il s’endormit jusqu’au matin.
Or, en se réveillant, il vit devant lui, la figure convulsée d’épouvante, sa vieille négresse qui se frappait les joues de ses mains, en se lamentant. Et, comme il ouvrait la bouche pour s’informer de ce qui avait bien pu lui arriver, l’effarée négresse lui montra d’un geste silencieux un voisin qui était à la porte attendant son réveil.
À la prière d’Amin, le voisin s’approcha et, après les salams, lui dit : « Ô mon voisin, je viens te consoler dans l’épouvantable malheur qui s’est abattu cette nuit sur ta maison ! » Et le joaillier s’écria : « De quel malheur parles-tu, par Allah ? » L’homme dit : « Puisque tu ne le sais pas encore, sache que cette nuit, à peine étais-tu rentré chez toi, des voleurs qui n’en sont pas à leur premier exploit, et qui t’avaient probablement vu, la veille, au moment où tu transportais dans ta seconde maison des choses précieuses, ont attendu ta sortie pour se précipiter à l’intérieur de cette maison où ils ne croyaient rencontrer personne. Mais ils virent des hôtes que tu y avais logés cette nuit, et ils ont dû probablement les tuer et les faire disparaître, car on n’a pu en retrouver les traces. Quant à ta maison, les voleurs l’ont pillée entièrement, sans y laisser une natte ou un coussin. Et elle est maintenant nettoyée et vide comme elle ne l’a jamais été ! »
À cette nouvelle, le jeune joaillier s’écria, en levant ses bras de désespoir : « Ya Allah ! quelle calamité ! Mes biens à moi et les objets que des amis m’ont prêtés sont perdus irrémédiablement, mais cela n’est rien en comparaison de la perte de mes hôtes ! » Et, affolé, il courut, pieds nus et en chemise, jusqu’à sa seconde maison, suivi de près par le voisin qui compatissait à son malheur. Et il constata, en effet, que les salles résonnaient de toute leur vacuité ! Alors il s’effondra en pleurant et en poussant beaucoup de soupirs, puis il s’écria : « Ah ! que faire maintenant ô mon voisin ? » Le voisin répondit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT SOIXANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
Le voisin répondit : « Je crois, ô Amin, que le meilleur parti est encore de prendre ton malheur en patience et d’attendre la capture des voleurs qui tôt ou tard ne manqueront pas d’être pris ; car les gardes du gouverneur sont à leur recherche, non seulement pour ce vol, mais pour bien d’autres méfaits qu’ils ont commis ces temps derniers ! » Et le pauvre joaillier s’écria : « Ô Abalhassan ben-Tâher, homme sage ! comme tu as été bien inspiré de te retirer tranquillement à Bassra ! Mais… ce qui a été écrit doit courir ! » Et Amin, tristement, reprit le chemin de son logis, au milieu d’une foule de gens qui avaient appris toute l’histoire et qui le plaignaient, en le voyant passer.
Or, en arrivant à la porte de sa maison, le joaillier Amin aperçut dans le vestibule un homme qu’il ne connaissait pas et qui l’attendait. Et l’homme, en le voyant, se leva et lui souhaita la paix, et Amin lui rendit son souhait. Alors l’homme lui dit : « J’ai des paroles secrètes à te dire, entre nous deux seulement ! » Et Amin voulut l’introduire dans la maison, mais l’homme lui dit : « Il vaut mieux que nous soyons tout à fait seuls ; allons donc plutôt à ta seconde maison ! » Et Amin, étonné, lui demanda : « Mais je ne te connais pas, et toi tu me connais, moi et toutes mes maisons ? » L’inconnu sourit et dit : « Je t’expliquerai tout cela ! Et, si Allah veut, je serai pour quelque chose dans ton soulagement ! » Alors Amin sortit avec l’inconnu et arriva à la seconde maison ; mais là, l’inconnu fit remarquer à Amin que la porte de la maison avait été défoncée par les voleurs et que, par conséquent, ils n’y seraient pas à l’abri des indiscrets. Puis il lui dit : « Suis-moi ! je te conduirai à un endroit sûr que je connais ! »
Alors l’homme se mit à marcher et Amin à marcher derrière lui, d’une rue à une autre rue, d’un souk à un autre souk et d’une porte à une autre porte, jusqu’à la tombée de la nuit. Alors, comme ils étaient arrivés de la sorte jusqu’au Tigre, l’homme dit à Amin : « Nous serons sûrement plus à l’abri sur l’autre rive ! » Et aussitôt, sortant d’on ne sait où, un batelier s’approcha d’eux et, avant qu’Amin pût même penser à refuser, il était déjà avec l’inconnu dans la barque qui, en quelques vigoureux coups de rames, les porta sur le rivage opposé. Alors l’homme aida Amin à sauter à terre et, le prenant par la main, le conduisit à travers des rues étroites et enchevêtrées. Et Amin, qui n’était plus rassuré du tout, pensait à part lui : « De ma vie je n’ai mis les pieds par ici ! Quelle aventure est la mienne ! »
Mais l’homme finit par arriver à une porte basse, tout en fer, et, tirant de sa ceinture une énorme clef rouillée, il l’introduisit dans la serrure, qui grinça terriblement et laissa s’ouvrir la porte. L’homme entra et fit entrer Amin. Puis il referma la porte. Et il enfila aussitôt un corridor où l’on devait marcher sur les pieds et les mains. Et, au bout de ce corridor, ils se trouvèrent soudain dans une salle éclairée par un seul flambeau qui s’y trouvait juste au milieu. Et autour de ce flambeau Amin vit assis, immobiles, dix hommes de même habillement et de figures tellement ressemblantes et si absolument identiques qu’il s’imagina voir une seule et même figure répétée dix fois par des miroirs.
À cette vue, Amin, qui était déjà épuisé par la marche qu’il avait faite depuis le matin, fut pris d’une faiblesse totale et tomba sur le sol. Alors l’homme qui l’avait amené l’aspergea avec un peu d’eau et de la sorte le ranima. Puis, comme le repas était déjà servi, les dix hommes jumeaux se disposèrent à manger après avoir toutefois, d’une seule et semblable voix, invité Amin à partager leur nourriture. Et Amin, voyant que les dix mangeaient de tous les plats, se dit : « S’il y avait du poison là-dedans, ils n’en mangeraient pas ! » Et, malgré sa terreur, il s’approcha et mangea son plein, affamé qu’il était depuis le matin.
Lorsque le repas fut terminé, la même voix une et décuple lui demanda : « Nous connais-tu ? » Il répondit : « Non, par Allah ! » Les dix lui dirent : « C’est nous les voleurs, qui, la nuit dernière, avons pillé ta maison et enlevé tes hôtes, le jeune homme et la jeune femme qui chantait. Mais malheureusement il y a la servante qui a réussi à s’échapper par la terrasse ! » Alors Amin s’écria : « Par Allah sur vous tous, mes seigneurs ! de grâce, indiquez-moi l’endroit où se trouvent mes deux hôtes ! Et restaurez mon âme tourmentée, hommes généreux qui venez d’assouvir ma faim ! Et qu’Allah vous fasse jouir en paix de tout ce que vous m’avez ravi ! Montrez-moi seulement mes amis ! » Alors les voleurs étendirent le bras, tous en même temps, vers une porte fermée et lui dirent : « Sois désormais sans crainte sur leur sort ; ils sont chez nous plus en sûreté que dans la maison du gouverneur, et, d’ailleurs, toi également ! Sache, en effet, que nous ne t’avons fait venir que pour apprendre de toi la vérité sur ces deux adolescents dont la belle mine et la noblesse d’attitude nous ont tellement frappés que nous n’avons même pas osé les interroger, une fois que nous eûmes constaté à qui nous avions affaire ! »
Alors le joaillier Amin fut considérablement soulagé et ne pensa plus qu’à gagner tout à fait les voleurs à sa cause et leur dit : « Ô mes maîtres, je vois à présent bien clairement que si l’humanité et la politesse venaient à disparaître de la terre, on les retrouverait intactes dans votre maison. Et je vois non moins clairement que lorsqu’on a affaire à des personnes aussi sûres et aussi généreuses que vous, le meilleur moyen à employer pour gagner leur confiance est de ne leur rien cacher de la vérité ! Écoutez donc mon histoire et la leur, car elle est étonnante à l’extrême limite de tous les étonnements ! »
Et le joaillier Amin raconta aux voleurs toute l’histoire de Schamsennahar et d’Ali ben-Bekar et ses rapports avec eux, sans oublier un détail, depuis le commencement jusqu’à la fin. Mais il n’y a vraiment pas d’utilité à la répéter !
Lorsque les voleurs eurent entendu cette étrange histoire, ils furent, en effet, extrêmement étonnés et ils s’écrièrent : « En vérité, quel honneur pour notre maison d’abriter en ce moment la belle Schamsennahar et le prince Ali ben-Bekar ! Mais, ô joaillier, vraiment tu ne te joues pas de nous ? Et est-ce vraiment eux ? » Et Amin s’écria : « Par Allah ! ô mes maîtres, eux-mêmes absolument de leurs propres yeux ! » Alors les voleurs, comme un seul homme, se levèrent et ouvrirent la porte en question et firent sortir le prince Ali et Schamsennahar en leur faisant mille excuses et en leur disant : « Nous vous supplions de nous pardonner l’inconvenance de notre conduite, car nous ne pouvions vraiment point nous douter que nous capturions des personnes de votre rang dans la maison du joaillier ! » Puis ils se tournèrent vers Amin et lui dirent : « Quant à toi, nous allons tout de suite te rendre les objets précieux que nous t’avons enlevés, et nous regrettons beaucoup de ne pouvoir te faire également rentrer dans tes meubles que nous avons éparpillés en les faisant vendre un peu partout aux enchères publiques ! »
« Et de fait ils se hâtèrent de me rendre les objets précieux, enroulés dans un grand paquet ; et moi, oubliant tout le reste, je ne manquai pas de les remercier beaucoup pour leur acte de générosité[8]. Alors ils nous dirent à nous trois : « Maintenant, nous ne voulons pas vous garder plus longtemps ici, à moins qu’il ne vous agrée de nous faire le considérable honneur de rester au milieu de nous ! » Et ils se mirent aussitôt à notre service, en nous faisant promettre seulement de ne point les déceler et d’oublier les instants désagréables passés.
« Ils nous conduisirent donc au bord du fleuve ; et nous ne pensions pas encore à nous communiquer nos inquiétudes tant l’appréhension nous tenait encore haletants et tant nous étions enclins à croire que tous ces événements se passaient en rêve. Puis, avec de grandes marques de respect, les dix nous aidèrent à descendre dans leur barque et se mirent tous à ramer si vigoureusement qu’en un clin d’œil nous étions sur l’autre rive. Mais à peine étions-nous débarqués, quelle fut notre terreur de nous voir soudain cernés de tous côtés par les gardes du gouverneur, et capturés immédiatement ! Quant aux voleurs, comme ils étaient restés dans la barque, ils eurent le temps, en quelques coups de rames, de se mettre hors de toute portée.
« Alors le chef des gardes s’approcha de nous et, d’une voix menaçante, nous demanda : « Qui êtes-vous et d’où venez-vous ? » Et nous, saisis de frayeur, nous demeurâmes interdits : ce qui augmenta encore la méfiance du chef des gardes, qui nous dit : « Vous allez me répondre exactement, ou, sur l’heure, je vais vous lier les pieds et les mains et vous faire emmener par mes hommes ! Dites-moi donc où vous demeurez, dans quelle rue et dans quel quartier ! » Alors moi, voulant à tout prix sauver la situation, je jugeai qu’il fallait parler et je répondis : « Ô seigneur, nous sommes des joueurs d’instruments et cette femme est une chanteuse de profession. Nous étions, ce soir, à une fête qui réclamait notre présence dans la maison de ces personnes qui nous ont conduits jusqu’ici. Quant à vous dire le nom de ces personnes, nous ne le pourrions, puisque d’habitude, dans notre profession, nous ne nous informons guère de ces détails et qu’il nous suffit simplement d’être bien rétribués ! » Mais le chef des gardes me regarda sévèrement et me dit : « Vous n’avez guère l’air de chanteurs ; vous me semblez plutôt bien terrifiés et bien inquiets, pour des personnes qui viennent de sortir d’une fête ! Et votre compagne, qui a de si beaux bijoux, n’a guère l’air d’une almée ! Holà ! gardes, enlevez-moi ces gens et conduisez-les tout de suite à la prison ! »
« À ces paroles, Schamsennahar se décida à intervenir de sa personne et, s’avançant vers le chef des gardes, elle le tira à part et lui dit à l’oreille quelques paroles qui produisirent sur lui un effet tel qu’il recula de quelques pas et s’inclina jusqu’à terre en balbutiant des formules très respectueuses d’hommages. Et aussitôt il donna l’ordre à ses gens de faire approcher deux bateaux, et dans l’un il aida Schamsennahar à s’embarquer, tandis qu’il me faisait descendre dans l’autre avec le prince Ben-Bekar. Puis il commanda aux bateliers de nous conduire là où nous leur dirions d’aller. Et aussitôt les barques prirent chacune une direction différente : Schamsennahar vers son palais, et nous deux vers notre quartier.
« Pour ce qui est d’abord de nous, à peine étions-nous arrivés dans la maison du prince, que je le vis, à bout de forces et exténué par ces émotions continues, s’effondrer sans connaissance dans les bras de ses serviteurs et des femmes de la maison…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT SOIXANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … sans connaissance dans les bras de ses serviteurs et des femmes de la maison. Car, d’après ce qu’il avait pu me faire comprendre en chemin, il perdait désormais, après ce qui était arrivé, tout espoir d’une autre entrevue avec son amie Schamsennahar.
« Alors, pendant que les femmes et les serviteurs étaient occupés à faire revenir le prince de son évanouissement, ses parents s’imaginèrent que je devais être la cause de tous ces malheurs qu’ils ne comprenaient pas et voulurent m’obliger à leur donner toutes sortes de détails. Mais je me gardai bien de leur expliquer quoi que ce fût, et je leur dis : « Bonnes gens, ce qui arrive au prince est si extraordinaire que lui seul pourra vous le raconter ! » Et, heureusement pour moi, le prince revint à lui à ce moment ; et ses parents n’osèrent plus, devant lui, insister dans leur interrogatoire. Et moi, craignant de nouvelles questions et rassuré un peu sur l’état de Ben-Bekar, je pris mon paquet et me dirigeai en toute hâte vers ma maison.
« En y arrivant, je trouvai ma négresse qui jetait les cris les plus perçants et les plus désespérés en se frappant la figure, et tous les voisins l’entouraient pour la consoler de ma perte que l’on croyait certaine. Aussi, à ma vue, ma négresse courut se jeter à mes pieds et voulut, elle aussi, me faire subir un nouvel interrogatoire. Mais je coupai court à ses velléités en lui disant que pour le moment je n’avais envie que de dormir ; je me laissai tomber, exténué, sur les matelas et, le visage dans les oreillers, je dormis pesamment jusqu’au matin.
« Alors ma négresse vint à moi et me questionna ; et moi je lui dis : « Donne-moi vite une porcelaine remplie ! » Elle me l’apporta et je la bus d’un trait ; et, comme ma négresse insistait, je lui dis : « Il est arrivé ce qui est arrivé ! » Alors elle s’en alla. Et moi, je retombai aussitôt dans mon sommeil, et je ne me réveillai, cette fois, qu’au bout de deux jours et de deux nuits !
« Je pus alors me mettre sur mon séant, et je me dis : « Il me faut vraiment aller prendre un bain au hammam ! » Et j’y allai aussitôt, bien que je fusse toujours extrêmement préoccupé de l’état de Ben-Bekar et de Schamsennahar, dont personne n’était venu m’apporter des nouvelles. J’allai donc au hammam où je pris mon bain et me dirigeai aussitôt vers ma boutique ; et, comme je relirais ma clef de la poche pour ouvrir la porte, une petite main derrière moi me toucha à l’épaule et une voix me dit : « Ya Amin ! » Alors moi je me retournai et je reconnus ma jeune amie, la confidente de Schamsennahar.
« Mais moi, au lieu de me réjouir à sa vue, je fus soudain pris d’une frayeur atroce d’être aperçu par mes voisins en conversation avec elle, vu que tous savaient qu’elle était la confidente chargée des commissions de la favorite du khalifat. Aussi je me hâtai de remettre vivement la clef dans ma poche et, sans me retourner, je filai droit devant moi, tout à fait affolé, et, malgré les appels de la jeune fille qui courait derrière moi en me priant de m’arrêter, je continuai ma course de ci et de là, toujours serré de près par la confidente, jusqu’à ce que je fusse arrivé à la porte d’une mosquée peu fréquentée. Alors je me précipitai à l’intérieur, après avoir promptement laissé à la porte mes babouches, et je me dirigeai vers le coin le plus obscur où je me mis aussitôt dans l’attitude de la prière. Et c’est alors, plus que jamais, que je songeai combien grande avait été la sagesse de mon ancien ami Abalhassan ben-Tâher qui avait fui toutes ces complications désolantes en se retirant tranquillement à Bassra. Et je pensai en mon âme : « Sûr ! pourvu qu’Allah me tire sans encombre de cette aventure, je fais vœu de ne jamais plus me jeter dans de pareilles aventures et de ne jamais plus remplir de tels rôles ! »
« À peine étais-je donc en ce coin obscur que je fus rejoint…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT SOIXANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« À peine étais-je donc en ce coin obscur que je fus rejoint par la confidente avec laquelle, cette fois, je pus me décider à m’entretenir en liberté, du moment qu’il n’y avait point de témoins. Elle commença d’abord par me demander : « Comment vas-tu ? » Je lui répondis : « En parfaite santé ! Mais que la mort me semble préférable à ces continuelles alarmes où nous vivons tous ! »
« Elle me répondit : « Hélas ! que dirais-tu alors si tu savais l’état de ma pauvre maîtresse ? Ah ! ya rabbi ! je me sens moi-même faiblir rien qu’en me rappelant le moment où je la vis revenir au palais, où déjà j’avais pu me rendre la première, en fuyant de ta maison, de terrasse en terrasse, et en me jetant ensuite sur le sol du haut de la dernière maison ! Ya Amin ! si tu l’avais vue ! Qui aurait pu reconnaître en ce visage pâle comme celui d’une personne qui sortirait de la tombe, le visage de la lumineuse Schamsennahar ? Aussi, en la voyant, je ne pus m’empêcher de fondre en sanglots en me jetant à ses pieds et en les lui embrassant. Mais elle s’oubliait elle-même pour songer d’abord au batelier auquel elle me dit de remettre tout de suite mille dinars d’or pour sa peine ! Puis, cela fait, les forces l’abandonnèrent, et elle tomba évanouie dans nos bras ; et alors nous la portâmes en hâte à son lit, où je me mis à lui asperger le visage avec l’eau de fleurs ; et je lui essuyai les yeux et lui lavai les pieds et les mains et lui changeai les vêtements de dessus et de dessous. Alors j’eus la joie de la voir revenir à elle et respirer un peu ; et aussitôt je lui donnai à boire du sorbet à la rose et lui fis sentir du jasmin et lui dis : « Ô maîtresse, par Allah sur toi ! ménage-toi, ménage-toi ! où irons-nous si nous continuons de la sorte ? » Mais elle me répondit : « Ô ma fidèle confidente, je n’ai plus rien sur la terre qui me retienne encore attachée ! Mais, avant de mourir, je veux avoir des nouvelles de mon amant. Va donc trouver le joaillier Amin et porte-lui ces bourses remplies d’or et prie-le de les accepter en réparation du dommage que notre présence lui a causé ! »
« Et la confidente me tendit un paquet fort lourd qu’elle tenait et qui devait contenir plus de cinq mille dinars d’or : ce dont, en effet, je pus m’assurer plus tard. Puis elle continua : « Schamsennahar me chargea ensuite de te demander, comme prière dernière, de nous donner des nouvelles, bonnes fussent-elles ou lamentables, du prince Ali ben-Bekar ! »
« Alors moi je ne pus vraiment lui refuser cette chose qu’elle me demandait comme une grâce et, malgré ma résolution bien arrêtée de ne plus me mêler de cette dangereuse histoire-là, je lui dis de venir le soir à ma maison où je ne manquerais pas de l’aller retrouver avec les détails nécessaires. Et je sortis de la mosquée après avoir prié la jeune fille de passer d’abord chez moi déposer le paquet qu’elle portait ; et je me rendis chez Ben-Bekar.
« Or, je trouvai que tous, femmes et serviteurs, étaient dans mon attente depuis trois jours et ne savaient comment faire pour tranquilliser le prince Ali, qui me réclamait sans cesse en poussant de profonds soupirs. Et je le trouvai lui-même, les yeux presque éteints, et ayant l’air plutôt d’un mort que d’un vivant. Alors moi je m’approchai de lui, les yeux en larmes, et le pressai contre ma poitrine…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT SOIXANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … et le pressai contre ma poitrine, et lui dis beaucoup de choses gentilles pour le consoler un peu, sans pouvoir cette fois réussir, car il me dit : « Ô Amin, comme je sens bien que mon âme va s’échapper, je veux te laisser du moins, avant de mourir, une marque de ma gratitude pour ton amitié. » Et il dit à ses esclaves : « Apportez-moi telle et telle chose ! » Et aussitôt les esclaves s’empressèrent d’apporter et de ranger devant moi, dans des paniers, toutes sortes d’objets précieux, des vases d’or et d’argent et des bijoux de haute valeur. Et il me dit : « Je te prie d’accepter cela, en remplacement des objets qui ont été volés dans ta maison ! » Puis il ordonna aux serviteurs de tout transporter chez moi. Il me dit ensuite : « Ô Amin, sache qu’en ce monde toute chose a un but ! Malheur à qui manque son but en amour : il ne lui reste que la mort. Aussi, n’était mon respect de la loi de notre Prophète (sur lui la paix soit-elle !) j’aurais déjà hâté le moment de cette mort que je sens prochaine ! Ah ! si tu savais, Amin, ce que mes côtes recèlent sous elles de souffrances accumulées ! Je ne crois pas qu’homme ait jamais éprouvé les douleurs dont mon cœur est saturé ! »
« Alors moi je lui dis, pour faire un peu diversion, que j’allais d’abord donner de ses nouvelles à la confidente qui m’attendait chez moi et que Schamsennahar avait envoyée dans ce but. Et je le quittai pour me rendre auprès de la jeune fille et lui raconter le désespoir du prince, qui pressentait sa fin et qui quitterait la terre avec le seul regret d’être séparé de son amante.
« Et, en effet, quelques instants après mon arrivée, je vis entrer chez moi la jeune fille, mais dans un état inimaginable d’émotion et de bouleversement ; et ses yeux laissaient abondamment couler les larmes. Et moi, de plus en plus alarmé, je lui demandai : « Par Allah ! qu’y a-t-il encore de pire que tout ce qui est arrivé ? » Elle me répondit, en tremblant : « Ce que nous redoutions tant est tombé sur nous ! Nous sommes irrémédiablement perdus jusqu’au dernier ! Le khalifat a tout appris ! Écoute plutôt : À la suite d’une indiscrétion de l’une de nos esclaves, le chef des eunuques eut des soupçons et se mit à interroger toutes les femmes de Schamsennahar, chacune à part. Et, malgré leurs dénégations, il fut mis sur la voie par les contradictions des renseignements recueillis. Et il porta toute l’affaire à la connaissance du khalifat qui aussitôt envoya mander auprès de lui Schamsennahar en la faisant accompagner, contre ses habitudes, par vingt eunuques du palais ! Aussi nous voilà toutes anxieuses et à la limite de l’épouvante ! Et moi je pus trouver un moment pour me dérober et courir t’aviser du malheur final qui nous menace ! Va donc prévenir le prince Ali, pour qu’il prenne les précautions nécessaires en pareil cas ! »
« Et, ayant dit ces paroles, la jeune fille repartit au plus vite dans la direction du palais.
« Alors moi je vis le monde entier noircir devant mon visage et je m’écriai : « Il n’y a de recours et de force qu’en Allah le Très-Haut, le Tout Puissant ! » Mais que pouvais-je dire de plus en face de la destinée ? Je me décidai donc à retourner chez Ali ben-Bekar, bien que je l’eusse quitté depuis à peine quelques instants, et, sans lui donner le temps de me demander la moindre explication, je lui criai : « Ô Ali, il te faut absolument me suivre sur l’heure, ou la mort t’attend de la plus ignominieuse façon ! Le khalifat, qui a tout appris, doit, à l’heure qu’il est, envoyer te faire saisir ! Partons, sans perdre un instant, et allons hors des frontières de notre pays, hors de la portée de ceux qui te recherchent ! » Et aussitôt, au nom du prince, j’ordonnai aux esclaves de faire charger trois chameaux des objets les plus précieux et de vivres pour la route, et j’aidai le prince à monter sur un autre chameau sur lequel, moi également, je m’assis derrière lui. Et, sans perdre de temps, à peine les adieux du prince à sa mère furent-ils faits, que nous nous mîmes en route et prîmes le chemin du désert…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et s’arrêta dans les paroles permises.
LA CENT SOIXANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … nous nous mimes en route et prîmes le chemin du désert.
« Or, toute chose écrite doit courir, et les destinées, sous n’importe quel ciel, ne peuvent que s’accomplir ! En effet, nos malheurs ne pouvaient que continuer, et la fuite d’un danger nous jetait dans un danger pire encore !
« En effet, comme nous marchions dans le désert, vers le soir, et que nous étions en vue d’une oasis dont on voyait le minaret au milieu des palmiers, nous vîmes surgir soudain à notre gauche une troupe de brigands qui eurent bientôt fait de nous cerner. Et comme nous savions fort bien que le seul moyen pour avoir la vie sauve était de ne tenter aucune résistance, nous nous laissâmes désarmer et dépouiller. Et les brigands nous prirent nos bêtes avec toutes leurs charges et nous enlevèrent même les vêtements que nous portions sur nous, ne nous laissant sur le corps que la chemise ! Et alors ils s’éloignèrent sans plus s’inquiéter de notre sort.
« Quant à mon pauvre ami, il n’était plus qu’une chose entre mes mains, tant ces émotions répétées l’avaient anéanti ! Je pus tout de même l’aider à se traîner peu à peu jusqu’à la mosquée que nous apercevions dans l’oasis ; et nous y entrâmes pour passer la nuit. Là le prince Ali tomba sur le sol et me dit : « C’est ici que je vais enfin mourir, puisque Schamsennahar ne doit plus être en vie à l’heure qu’il est ! »
« Or, dans la mosquée en ce moment un homme faisait sa prière. Lorsqu’il eut fini il se retourna vers nous et nous regarda un instant, puis s’approcha de nous, et nous dit avec bonté : « Ô jeunes gens, vous êtes sans doute des étrangers et vous venez ici pour y passer la nuit ? » Je lui répondis : « Ô cheikh, nous sommes en effet des étrangers que les brigands du désert viennent de dépouiller complètement, ne nous laissant pour tout bien que la chemise que nous portons sur nous ! »
« À ces paroles, le vieillard eut pour nous beaucoup de compassion et nous dit : « Ô pauvres jeunes gens, attendez-moi ici quelques instants, et je reviens à vous ! » Et il nous quitta pour revenir peu après suivi d’un enfant qui portait un paquet, et le vieillard tira des vêtements de ce paquet et nous pria de nous en vêtir ; puis il nous dit : « Venez avec moi à ma maison où vous serez mieux que dans cette mosquée, car vous devez avoir faim et soif ! » Et il nous obligea à l’accompagner à sa maison, où le prince Ali n’arriva que pour s’étendre sans souffle sur les tapis ! Et alors, du loin, venant avec la brise qui soufflait dans l’oasis à travers les palmiers, une voix de quelque pauvresse se fit entendre qui chantait plaintivement ces vers tristes :
« Je pleurais en voyant s’approcher la fin de ma jeunesse ! Mais j’étanchai bientôt ces larmes pour ne pleurer plus que la séparation de l’ami !
Si le moment de la mort est amer à mon âme, ce n’est point qu’il soit dur de quitter une vie d’alarmes, mais c’est de m’en aller loin des yeux de l’ami !
Ah ! si j’avais su que le moment des adieux fût si proche et que je serais pour toujours privé de mon ami, j’aurais emporté avec moi, comme provision du chemin, un peu du contact de ses yeux adorés ! »
« Or, à peine Ali ben-Bekar avait-il commencé à entendre ce chant qu’il releva la tête et se mit à écouter, hors de lui. Et quand la voix se fut éteinte, nous le vîmes soudain retomber en poussant un grand soupir : il avait expiré…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade, voyant apparaître le matin, se tut discrètement.
LA CENT SOIXANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … nous le vîmes soudain retomber en poussant un grand soupir : il avait expiré.
« À cette vue, le vieillard et moi nous éclatâmes en sanglots et nous restâmes ainsi toute la nuit ; et je racontai, à travers mes larmes, cette triste histoire au vieillard. Puis, au matin, je le priai de vouloir bien garder le corps en dépôt jusqu’à ce que les parents, avertis par moi, vinssent le chercher. Et je pris congé de cet homme bon et me rendis en toute rapidité à Baghdad, en profitant du départ d’une caravane qui s’y dirigeait. Et j’allai directement, sans prendre le temps de changer d’habits, à la maison de Ben-Bekar, où je me présentai devant sa mère à qui je souhaitai la paix tristement.
« Lorsque la mère de Ben-Bekar me vit arriver seul, sans son fils, et qu’elle remarqua mon air attristé, elle se mit à trembler de pressentiment. Et je lui dis : « Allah, ô vénérable mère d’Ali, commande et la créature ne peut que se soumettre ! Et quand la lettre d’appel a été écrite à une âme, cette âme doit, sans différer, se présenter devant son maître ! »
« À ces paroles, la mère d’Ali poussa un cri d’une douleur déchirante et me dit, en tombant le visage contre terre : « Ô calamité ! mon fils serait-il mort ? »
« Alors moi, je baissai les yeux et ne pus prononcer un mot. Et je vis la pauvre mère, étouffée par les sanglots, s’évanouir complètement. Et moi, je me mis à pleurer toutes les larmes de mon cœur, tandis que les femmes remplissaient la maison de cris épouvantables !
« Lorsque la mère d’Ali put enfin m’entendre, je lui racontai les détails de la mort et je lui dis : « Qu’Allah reconnaisse l’étendue de tes mérites, ô mère d’Ali, et t’en rémunère par ses bienfaits et sa miséricorde ! » Alors elle me demanda : « Mais ne t’a-t-il pas fait quelques recommandations à transmettre à sa mère ? » Je répondis : « Mais certainement ! Il m’a chargé de te dire que son seul souhait était que tu fisses transporter son corps à Baghdad ! » Alors elle se remit à fondre en larmes, en se déchirant les vêtements, et me répondit qu’elle allait tout de suite se rendre dans l’oasis avec une caravane pour ramener le corps de son fils.
« Et de fait, quelques instants après, je les laissai tous à leurs préparatifs de départ et je regagnai mon domicile en pensant en mon âme : « Ô Ali ben-Bekar, malheureux amant, quel dommage que ta jeunesse ait été fauchée dans sa floraison si belle ! »
« Et j’arrivai chez moi de la sorte et je mis la main à ma poche pour en retirer la clef de la porte, quand je me sentis doucement toucher le bras, et je me retournai et j’aperçus, vêtue d’habits de deuil, et le visage bien triste, la jeune confidente de Schamsennahar. Alors je voulus m’enfuir ; mais elle m’arrêta et me força à entrer avec elle dans ma maison. Alors moi, malgré tout, je me mis, sans savoir encore rien, à pleurer avec elle énormément. Puis je lui dis : « As-tu alors appris la triste nouvelle ? » Elle me répondit : « Laquelle, ya Amin ? » Je lui dis : « La mort d’Ali ben-Bekar ! » Et, comme je la voyais pleurer davantage, je compris qu’elle n’en savait encore rien, et je la mis au courant, tout en poussant, de concert avec elle, de gros soupirs.
« Lorsque j’eus fini, elle me dit à son tour : « Et toi, ya Amin, je vois bien que tu ne connais guère mon malheur ! » Et je m’écriai : « Schamsennahar aurait-elle été mise à mort par ordre du khalifat ? » Elle répondit : « Schamsennahar est morte, mais non point comme tu pourrais le supposer ! Ô ma maîtresse ! » Puis elle s’interrompit pour pleurer encore un peu, et me dit enfin : « Écoute donc, Amin !
« Lorsque Schamsennahar, accompagnée par les vingt eunuques, fut arrivée en présence du khalifat, le khalifat d’un signe renvoya tous ceux-là, puis s’approcha lui-même de Schamsennahar et la fit s’asseoir à côté de lui et, d’une voix empreinte d’une bonté admirable, lui dit : « Ô Schamsennahar, je sais que tu as des ennemis dans mon palais, et ces ennemis ont essayé de te nuire dans mon esprit en déformant tes actes et en me les présentant sous un aspect indigne de moi et de toi ! Sache bien que je t’aime plus que jamais, et, pour le mieux prouver à tout le palais, j’ai donné des ordres pour faire augmenter ton train de maison et le nombre de tes esclaves et tes dépenses ! Je te prie donc de ne plus garder cet air affligé qui m’afflige moi-même ! Et pour t’aider à te distraire, je vais tout de suite faire venir les chanteuses de mon palais et les plateaux chargés de fruits et de boissons ! »
« Et aussitôt entrèrent les joueuses d’instruments et les chanteuses ; et les esclaves arrivèrent chargés des grands plateaux pesants de tout ce qu’ils contenaient. Et lorsque tout fut prêt, le khalifat, assis à côté de Schamsennahar, qui se sentait de plus en faible malgré tant de bonté, ordonna aux chanteuses de préluder. Alors l’une d’elles, au son des luths maniés par les doigts de ses compagnes, commença ce chant :
« Ô larmes, vous trahissez les secrets de mon âme, et m’empêchez de garder pour moi seule une douleur cultivée en silence !
J’ai perdu l’ami qu’aimait mon cœur… »
« Mais tout d’un coup, avant que la strophe chantée n’eût pris fin, Schamsennahar poussa un faible soupir et tomba à la renverse. Et le khalifat, affecté à l’extrême, se pencha vivement vers elle, la croyant seulement évanouie ; mais il la releva morte !
« Alors il jeta loin de lui la coupe qu’il tenait et renversa les plateaux et, comme nous poussions des cris effroyables, il nous fit toutes partir, après nous avoir ordonné de briser les luths et les guitares du festin ; et il ne garda que moi seule dans la salle. Il prit alors Schamsennahar sur ses genoux et se mit à pleurer sur elle toute la nuit, en m’ordonnant de ne laisser entrer personne dans la salle.
« Le lendemain matin, le khalifat confia le corps aux pleureuses et aux laveuses, et donna l’ordre de faire à sa favorite des funérailles de femme légitime, et plus belles. Après quoi, il alla s’enfermer dans ses appartements. Et depuis nul ne le revit dans la salle de justice ! »
« Alors moi, après avoir encore pleuré, avec la jeune fille, la mort des deux amants, je me mis d’accord avec elle en vue de faire enterrer Ali ben-Bekar à côté de Schamsennahar. Et nous attendîmes le retour du corps que la mère était allée chercher dans l’oasis, et nous lui fîmes de belles funérailles, et nous réussîmes à le faire mettre en terre à côté du tombeau de Schamsennahar !
« Et depuis lors ni moi ni la jeune fille, qui devint mon épouse, nous ne cessâmes d’aller visiter les deux tombeaux pour pleurer sur les amants dont nous avions été les amis ! »
— Et telle est, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, l’histoire touchante de Schamsennahar, la favorite du khalifat Haroun Al-Rachid !
À ce moment, la petite Doniazade ne put se tenir
plus longtemps et éclata en sanglots, en enfouissant sa
tête dans les tapis. Et le roi Schahriar dit : « Ô Schahrazade,
cette histoire m’a bien attristé ! »
Alors Schahrazade dit : « Oui, ô Roi ! Aussi t’ai-je raconté cette histoire, qui n’est pas de la même espèce que les autres, à cause surtout des vers admirables qu’elle contient et principalement pour te mieux disposer à toute la joie que ne manquera pas de te procurer celle dont je me dispose à te faire le récit, si tu veux bien me le permettre ! » Et le roi Schahriar s’écria : « Oui, ô Schahrazade, fais-moi oublier ma tristesse, et dis-moi vite le titre de l’histoire que tu me promets ! ». Et Schahrazade dit : « C’est l’histoire féerique de la princesse boudour, la plus belle lune d’entre toutes les lunes. »
Et la petite Doniazade s’écria, en relevant la tête : « Ô ma sœur Schahrazade, que tu serais gentille de nous la commencer tout de suite ! » Mais Schahrazade dit : « De tout cœur amical, et comme hommages dûs à ce Roi bien élevé et doué de bonnes manières ! Mais ce ne sera que pour la nuit prochaine seulement ! » Et, comme elle voyait apparaître le matin, Schahrazade, discrète comme elle était, se tut.
À CHÂTEAUROUX, INDRE
- ↑ Entremets à base d’amidon, de lait et de riz concassé.
- ↑ C’est la pâtisserie nationale de tout l’orient. Sorte de feuilleté farci de pistaches et d’amandes.
- ↑ Petits pâtés, en rondelles, farcis de noix, etc., etc.
- ↑ Le Job biblique. Personnage fort estimé des musulmans.
- ↑ Grand voile.
- ↑ L’acte de foi musulman. Il suffit de le dire une fois pour prouver que l’on est musulman. Et personne ne songera à demander d’autres preuves. Quant à la circoncision, elle est recommandée, mais n’est pas du tout nécessaire pour devenir musulman.
- ↑ Soleil d’un beau jour.
- ↑ On remarquera qu’à partir de ce moment le récit est fait par le joaillier lui-même, sans transition.
