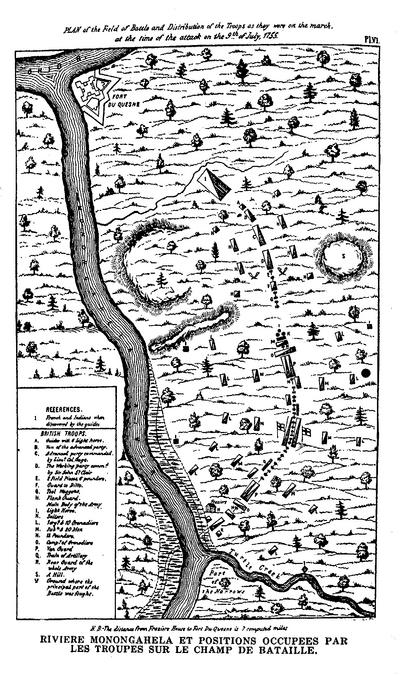Jean-Daniel Dumas, le héros de la Monongahéla/Texte entier
AVERTISSEMENT
Écrire la biographie de M. Dumas n’est pas une entreprise facile. L’esquisse que nous livrons à l’appréciation des amateurs de notre Histoire n’apporte sur sa carrière qu’une documentation fort incomplète. Bien qu’il occupât, durant la guerre de Sept Ans, c’est-à-dire à l’époque la plus critique de notre histoire, un rang relativement modeste dans l’armée, le personnage a su pourtant soutenir un rôle très actif et assez important qu’il convient, à notre sentiment, de mettre en relief. D’autant plus que les services qu’il rendit alors dans la Nouvelle-France furent reconnus par le roi et qu’il atteignit par la suite un rang élevé dans l’armée française.
Jean-Daniel Dumas n’a laissé au Canada aucun descendant. Ainsi nul parent, nul ami qui se soit soucié de préserver sa mémoire de l’oubli où elle est restée ensevelie jusqu’à nos jours. Nous avons pensé l’en tirer et combler cette lacune de notre Histoire. Dans ce dessein, nous avons rassemblé les renseignements épars qui le feront mieux connaître, et mis en lumière les inestimables services qu’il rendit à la Nouvelle-France, principalement durant les dernières années de son séjour qui furent celles de l’agonie de la domination française sur ce continent.
Nous osons espérer que cette monographie recevra un accueil favorable de ceux qu’intéressent les annales militaires de notre pays. Il serait superflu d’ajouter que le motif qui nous meut n’est autre que le désir de rendre justice à la mémoire d’un homme qui a noblement dépensé une bonne partie de sa carrière au service de la patrie canadienne.
BIBLIOGRAPHIE
- Série B. — Lettres du ministre de la Marine.
- Série C-ii, — Correspondance générale : lettres des gouverneurs et des intendants du Canada.
- Série D-2. — Officiers civils et militaires.
- Série F. — Collection Moreau Saint-Méry.
- Registres des baptêmes, mariages et sépultures faites au fort Duquesne, 1753-1756. — Série M., vol. 200.
- Lettres du marquis de Montcalm. — Série M., vols 129 et 216.
- Lettres de M. de Vaudreuil. — Série F., vols 309 et 312.
- Lettres de Montcalm à Vaudreuil. — Série F., vol. 303.
- Lettres de Vaudreuil et de Lévis à M. Dumas, 1760. — Série F., vol. 312.
- Cahier de lettres écrites à M. le général (Vaudreuil) pendant mon commandement à Jacques-Cartier. (Dumas) 1760.
- Papiers du chevalier de la Pause. — Propriété de M. A.-G. Doughty.
- Manuscrits relatifs à l’Histoire de la Nouvelle-France, première série. — Copiés aux Archives de la Secrétairerie provinciale, Québec.Imprimés examinés
- Archives canadiennes. — Rapports annuels du Bureau des Archives, Ottawa.
- Archives de France relatives à l’Histoire du Canada. — Rapport par M. J.-Edmond Roy. Ottawa, 1911.
- Azémas, Georges — Histoire de l’Ile Bourbon. Paris, 1862.
- Beaujeu, Monongahéla de. — Le héros de la Monongahéla. Esquisse historique. Montréal, Desaulniers & Cie, 1892.
- Beaumont, Gaston du Boscq de. — Les derniers Jours de l’Acadie. Paris, 1899.
- Ribaud, Maximilien. — Le Panthéon Canadien. Montréal. 1891.
- Bouillet, N. — Dictionnaire Universel d’Histoire et de Géographie. Paris, 1852.
- Casgrain, l’abbé H.-R. — Montcalm et Lévis. 2 vols. Québec, Demers, 1891.
- Century Dictionary and Cyclopedia, 1896.
- Chapais, l’hon. Thomas. — Montcalm.
- Colonial Office List. — London, 1883.
- Daniel, l’abbé. — Histoire des Grandes Familles françaises du Canada.
- Documents relating to the Colonial History of the State of New York. Paris documents, vol. X.
- Doughty, A.-G. — The Siege of Quebec. 6 vols. Québec, 1904.
- Ferland, l’abbé J.-B.-A. — Cours d’Histoire du Canada, 2e vol. Québec, Hardy, 1882.
- Gagnon, Philéas. — Essai de Bibliographie Canadienne, vol. 2.
- Garneau, F.-X. — Histoire du Canada, 4e éd., 4 vols. Montréal, Beauchemin, 1882.
- Grant, Charles, Viscount de Vaux. — The History of Mauritius or the Isle of France and the neighbouring Islands. London. 1801.
- Guérin, Mgr Paul. — Nouveau Dictionnaire Universel. — Édition Canadienne.
- Hoefer. — Nouvelle biographie générale.
- Kérallain, René de. — La Jeunesse de Bougainville.
- Knox’s Historical Journal. — Edited by A. G. Doughty.
- La Roncière, M. de. — Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France. Bibliothèque de la Marine. Paris, 1907.
- Larousse. Grande Encyclopédie. Aussi Petit Larousse. Supplément pour le Canada. Montréal, Beauchemin, 1889.
- Leclercq, Jules. — Au pays de Paul et Virginie. Paris, 1895.
- Le Jeune, le R. P. — Tableaux synoptiques de l’Histoire du Canada.
- Lévis. — Collection des manuscrits du maréchal de Lévis, publiés par l’abbé Casgrain, 12 vols. Québec, Demers, 1895.
- Mazas. — Histoire de l’Ordre de Saint-Louis, II, p. 69.
- Michaud. — Biographie Universelle.
- Parkman, Francis. — Montcalm and Wolfe. 2 vols. Boston, 1888.
- Pridham, Charles. — An Historical, Political and Statistical Account of Mauritius and its dependencies. London, 1849.
- Saint-Yves, G. — La Perte du Canada et les Papiers de Dumas (1760). Extraits du Bulletin de Géographie historique et descriptive, No 2, 1901. Paris, Imprimerie Nationale, 1901.
- Sargent, Winthrop. — The History of an Expédition against Fort Duquesne in 1755, under Major General Braddock. Philadelphia, 1855.
- Shea, J. D. Gilmary. — Relations diverses sur la bataille de la Malanguelé. Nouvelle-York, 1860.
- Sulte, Benjamin. — Histoire des Canadiens-français, 8 vols., grand quarto. Montréal, Wilson, 1882-1884.
- Susane, Louis. — Histoire de l’Ancienne Infanterie française. Paris, 1853.
- Tanguay, l’abbé. — Dictionnaire généalogique des familles canadiennes.
- Villiers du Terrage, Marc. — Les dernières années de la Louisiane française.
N. B. — Nous devons à l’obligeance de M. Ægidius Fauteux, bibliothécaire de la Bibliothèque Saint-Sulpice, Montréal, de pouvoir reproduire l’autographe de M. Dumas, et à celle de M. Montarville B. de la Bruère, bibliothécaire honoraire de la Société d’Archéologie et de Numismatique de Montréal, le portrait de M. Dumas, qui est conservé au Château Ramezay.
JEAN-DANIEL DUMAS
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Parmi les divers changements et bouleversements opérés par la Révolution française, il y en eut de bons, comme il y en eut de mauvais.
Celui qui eut pour effet de niveler toutes les classes de la société au point de vue militaire, fut certainement utile à la France : il permit à de nombreux sujets, issus des rangs du peuple, de faire leur chemin sans entraves et d’illustrer leur pays en se distinguant eux-mêmes.
Le Consulat, et l’Empire surtout, ont produit un grand nombre d’hommes distingués. La troisième République vient de montrer au monde entier que la France d’aujourd’hui n’a pas dérogé, qu’elle n’est pas moins féconde en hommes de talent, et même de génie. Les maréchaux Joffre et Foch en sont d’incomparables exemples. Voilà deux noms — pour ne citer que les plus illustres chefs — qui, dès maintenant, ont pris le premier rang dans l’Histoire. Et quelle place admirable ! Ces héros ont atteint l’apogée de la fortune et de la gloire en défendant leur patrie menacée de destruction par l’invasion des barbares, et non en combattant pour opprimer les nations et anéantir les peuples. Leur gloire est désormais immortelle.
Il est peu d’exemples, sous l’ancien régime, de plébéiens qui aient réussi à s’élever aux grades suprêmes de l’armée française. Il fallait une combinaison rare de talents, d’énergie et d’ambition, secondée d’extraordinaires conjonctures. En général, les hauts commandements étaient réservés aux membres de l’aristocratie toute puissante qui faisaient leur carrière des armes.
Était soldat qui voulait, et souvent même, qui ne voulait pas. Les sergents recruteurs n’étaient pas toujours guidés par l’honneur dans leurs modes de recrutement. Tous les moyens leur servaient, les recrues étant payées par tête. Mais parvenir au grade d’officier était pour un roturier chose excessivement difficile, à moins d’être protégé par quelque personnage bien en Cour. À cette époque le simple soldat ne portait pas encore le bâton de maréchal dans son sac.
L’on a vu ainsi, un Chevert, né de parents pauvres et obscurs, entré au service comme simple soldat, gravir tous les degrés de l’échelle militaire jusqu’à celui de lieutenant-général des armées du roi, après avoir fourni une carrière des mieux remplies et des plus honorables. C’était l’exception rare qui confirmait la règle presque absolue.
Or, Jean-Daniel Dumas fut l’un de ces hommes qui, partis du dernier échelon, lentement, patiemment, à force de travail, d’honnêteté et de bravoure, réussirent à atteindre un sommet élevé dans la hiérarchie militaire française du xviiie siècle. La victoire retentissante de la Monongahéla, la bravoure et l’habileté dont il fit preuve à la tête de l’aile droite à la bataille des Plaines d’Abraham, puis, sa belle retraite de Jacques-Cartier à Montréal, constituent les brillants faits d’armes de sa carrière au Canada. En vertu de ces exploits signalés, il eut accès aux hauts commandements.
Les noms des parents, la date et le lieu même de la naissance de M. Dumas nous sont demeurés inconnus. En dépit des plus actives recherches, il a été impossible d’éclaircir le problème.
Est-il originaire de France ou du Canada ? Personne encore ne semble le savoir ; personne, du moins à notre connaissance, n’en a jusqu’ici fait mention. Mgr Tanguay lui-même garde le silence. Dans une note il affirme seulement que M. Dumas remplaça M. de Beaujeu comme commandant à la bataille de la Monongahéla, qu’il commanda les troupes de la Marine sous M. Rigaud de Vaudreuil dans l’expédition contre le fort George en 1757, qu’en 1759, il fut fait major général et inspecteur des troupes de la colonie, qu’il subit un échec à la Pointe-Lévis, et enfin qu’il était à Montréal lors de la capitulation de cette ville. Le renseignement historique est pauvre ; le généalogique, nul.
M. Bibaud a écrit dans le Panthéon Canadien :
« Dumas (C.), un des plus illustres guerriers qu’ait produits le Canada, acheva la victoire de la Monongahéla après la mort de Beaujeu, et lui succéda dans le gouvernement de l’Ohio. Il fit, du fort Duquesne, des incursions dans la vallée, et jusque dans la Pennsylvanie, enlevant le fort Grenville, à 20 lieues de Philadelphie. Créé major général des troupes de la marine, il brûla la flottille anglaise, de 300 bateaux, sous le fort George, dont il assura ainsi la chute. Sa gloire ne fit qu’augmenter dans la funeste campagne de 1759, malgré son échec à la Pointe-Lévis. Après la victoire de Sainte-Foye, Québec assiégé, ayant été secouru par les vaisseaux anglais, Dumas fut laissé dans le gouvernement de Québec avec un camp volant, y fit une campagne ou guerre de postes, puis retraita pied à pied devant Murray allant donner la main à l’armée d’Amherst devant Montréal. Ayant émigré après la capitulation générale qui eut lieu, il devint participant des victoires du fameux bailli de Suffren, puis gouverneur des îles de France et de Bourdon. On a de lui : Mémoires sur les limites de la Nouvelle-France, et il paraît avoir laissé un fils qui s’est distingué dans la géographie et l’hydrographie. »
Que désigne, dans ce texte, la capitale (C) entre parenthèse ? M. Bibaud le sait-il ? Il ajoute : « Un des plus illustres guerriers qu’ait produits le Canada. » Ne fait-il pas du héros un Canadien d’origine ? « lequel émigra après la capitulation.» C’est une double erreur. Mais si cet historien a voulu simplement laisser entendre que M. Dumas, originaire de France, est une de nos gloires nationales, puisqu’il s’est illustré au pays, nous ne lui chercherons pas querelle. Bien au contraire, nous lui en saurons gré. Ne regardons-nous pas, précisément, et avec raison, Champlain, Frontenac et Montcalm comme nôtres ?
M. Francis Parkman dans son étude sur Montcalm and Wolfe, a recueilli quelques renseignements additionnels sur les services du vainqueur de la Monongahéla, au fort Duquesne, dans la vallée de la Belle-Rivière (l’Ohio), et à Québec, avant, durant et après le siège de 1759. Cet auteur semble avoir mieux connu et mieux apprécié M. Dumas que ne l’avaient fait ses prédécesseurs.
M. Garneau et l’abbé Ferland ne présentent rien de neuf en ce qui concerne le personnage.
L’abbé Daniel, dans son Histoire des Grandes Familles françaises du Canada, en fait si peu de cas, qu’il ne place même pas dans la liste des « noms mentionnés dans cet ouvrage » celui de Dumas, quoiqu’il apparaisse dans six pages différentes du livre. Cet auteur est partial envers M. de Beaujeu qu’il exalte à l’excès, aux dépens de MM. de Contrecœur et Dumas.
Le Nouveau Dictionnaire historique, géographique et biographique publié en appendice du Petit Larousse (5e édition, Montréal, Beauchemin, 1889), ainsi que le Nouveau Dictionnaire Universel Illustré de Mgr Guérin, ne reproduisent que les médiocres données déjà connues. Il en est de même des Tableaux synoptiques de l’Histoire du Canada du R. P. Le Jeune. Enfin, le Siege of Quebec, par M. A. G. Doughty, et une note du même auteur dans Knox’s Historical Journal, ajoutent encore quelque chose à nos connaissances sur M. Dumas.
En résumé, il y a une place honorable dans l’Histoire du Canada, que l’on doit réserver à la biographie de ce personnage. N’est-il pas surprenant qu’un homme de la valeur de M. Dumas soit resté si longtemps à peu près inconnu de nos historiens !
Sources manuscrites
La correspondance de M. Dumas avec le ministre de la Marine, M. de Vaudreuil et le chevalier de Lévis,[1] nous procure des détails nouveaux sur son inlassable activité militaire durant la guerre de Sept Ans en Amérique, mais elle ne jette malheureusement que très peu de jour sur son origine et point du tout sur sa famille.
Un examen approfondi des manuscrits relatifs à notre héros nous permet cependant de découvrir quelques vestiges de renseignements très intéressants.
Grâce à un acte de baptême fait au fort Duquesne en l’an 1755, on apprend enfin les prénoms de M. Dumas. Il y est désigné : Jean-Daniel, Escuyer, sieur Dumas. Voici l’acte dont il s’agit :
« L’an mil sept cent cinquante-cinq, le dix-huit de septembre a esté baptisé avec les cérémonies ordinaires de nostre mère la Sainte Église, Jean Daniel Norment, né du mesme jour, fils de Jean Gaspard Norment et de Marie-Joseph Chainier, ses père et mère en légitime mariage. Le parrain a esté M. Jean Daniel, Escuyer, sieur Dumas, capitaine d’infanterie, commandant en chef des forts de la Presquille, de la Rivière aux Bœufs et de celuy de Duquesne, à la Belle Rivière. La maraine a estée Thérèse Norment, laquelle a déclaré ne scavoir signer, le parain seul a signé avec nous.
Voilà un premier résultat acquis à l’Histoire. Mais encore, quel est son pays natal ?
Dans une lettre de remerciements datée : « Au fort Duquesne le 24 juillet 1756, » et adressée au ministre de la Marine qui lui avait obtenu du roi la croix de Saint-Louis, il parle de sa commission au régiment Dagénois. Il paraît donc être venu de l’Agenais (ou Agenois), pays de l’ancienne province de Guyenne, situé entre le Périgord, le Quercy, le Condomoit, la Lomagne et le Bazadais ; mesurant 80 kilomètres de long sur 40 de large. L’Agenais fait aujourd’hui partie du département de Lot-et-Garonne. Le chef-lieu, Agen, situé sur la Garonne, est à environ 75 kilomètres sud-est de Bordeaux et à 651 de Paris.
Cette lettre, encore inédite, croyons-nous, a été découverte par M. Francis Parkman qui en cite un court extrait dans le texte de Montcalm and Wolfe. C’est pour nous une pièce de grande valeur. Elle met d’abord en vive lumière le rôle important joué par M. Dumas au mémorable combat de la Monongahéla, et ensuite, dans toute l’étendue de son commandement de la vallée de l’Ohio. Elle révèle aussi l’ascendant qu’il sut prendre sur les sauvages qu’il rattacha fermement à la cause de la France, et lança ensuite sur les frontières des provinces anglaises qu’ils mirent à feu et à sang. Il assurait ainsi au Canada la libre communication avec l’Illinois et la Louisiane, et empêchait l’ennemi de reprendre l’offensive. Cette lettre fait voir également les ennuis et les tracasseries qu’il eut à endurer dans le cours de sa carrière à laquelle il avait voué toutes ses énergies. C’est pourquoi il nous paraît opportun de la reproduire tout entière, quelle qu’en soit la longueur, sans en modifier l’ancienne orthographe.
« Monseigneur,
« J’ay receu avec le respect qui est du aux graces du Roy celle dont il a plu à vôtre grandeur que je fusse honnoré cette année. Je ne suis plus jaloux, Monseigneur, d’avoir vû pendant trois ans donner à mes camarades moins anciens capitaines que moy une préférance que ma Commission au Régiment Dagénois me métoit en lieu de prétendre en vertu de l’ordonnance du Roy qui a réglé le rang que je devois prendre dans les trouppes de la Colonie dont je n’ay pu jouir jusques ici. L’on porte glorieusement la Croix de Saint-Louis, Monseigneur, quand on l’a obtenue par une action qui a plus d’unne fois fait des maréchaux de france, et dont le succès a été le salut d’unne colonie entière : Car personne ne peut douter que celle cy n’eut été totallement ébranlée si j’eusse été batû le 9 de juillet.
« La fortune qui me tendit la main dans le combat me la retira après la victoire ; si elle eut daigné me présenter à vous, Monseigneur, je serois sorti du grade de Capitaine dans lequel l’envie et la basse jalousie m’ont fait servir désaggréablement depuis que je suis en Canada. Un autre plus heureux que moy auroit peut-être rempli le Gouvernement vacquant après unne action de cet éclat : un Capitaine d’infanterie peut-il jamais trouver unne plus belle occasion de faire fortune, et j’ose dire en mieux profiter.
« J’ay lieu de pencer, Monseigneur, que Vôtre Grandeur a été mal informée des circonstances de cette journée ; Monsieur le Marquis de Vaudreuil peut luy même en avoir été mal instruit. Comme ma gloire est intéressée à cela, joze vous en addresser unne relation fidelle. Je crus lannée dernière pouvoir négliger ce soin et m’en reposer sur la renommée, mais sa trompete a été muète à mon égard, la modestie est unne vertû ruineuse en Canada.
« Messieurs De Contrecœur et de Beaujeu étoient moins anciens capitaines que moy ; mais monsr Duquesne n’ayant jamais voulu me faire servir à mon rang, je demanday à marcher sous mes cadets plutôt que de rester dans un inaction honteuse pour un officier dans un tems de trouble.
« Je fus donc employé en second dans ce poste sous monsr De Contrecœur ; et monsr De Beaujeu ayant été nommé pour le relever, je me trouvay en troisième à son arrivée.
« Quand nous apprimes que l’ennemi marchoit sur nous avec des forces très suppérieures aux nôtres et un train d’artillerie formidable pour unne place comme celle cy, ce fut ma seule représentation qui engagea monsr De Contrecœur à nous envoyer le combattre en chemin ; il n’y eut que monsr De Courtemanche qui s’étant trouvé présent avec beaucoup d’autres appuya ma remontrance, monsr De Beaujeu prit la dessus sa détermination par unne espèce de délicatesse personnelle et pour éviter le reproche si faute de cette démarche le fort venoit à être pris comme inévitablement il devoit l’être.
« Monsr De Beaujeu marcha donc et sous ses ordres monsr Desligneris et moy, il attaqua avec beaucoup d’audace, mais sans nulle disposition. Nôtre première décharge fut faite hors de portée ; lennemi fit la sienne de plus près ; et, dans ce premier instant du combat, cent miliciens qui faisoient la moitié de nos français lâchèrent honteusement le pied en criant sauve qui peut ; deux cadets qui depuis ont été faits officiers, et dont l’un enseigne en second de l’année dernière vient d’être fait enseigne en pied autorisèrent cette fuite par leur exemple.
« Ce mouvement en arrière ayant encouragé l’ennemi il fit retentir ses cris de vive le Roy, et avança sur nous à grand pas. Son artillerie s’étant préparée pendant ce temps là commença à faire feu, ce qui épouvanta tellement les sauvages que tout prit la fuite ; l’ennemi faisoit sa troisième décharge de mousqueterie quand monsr De Beaujeu fut tué.
« Notre déroute se présenta à mes yeux sous le plus désagréable point de vû ; et pour n’être point chargé de la mauvaise manœuvre d’autruy, je ne songeay plus qu’à me faire tuer.
« Ce fut alors, Monseigneur, qu’exitant de la voix et du geste le peu de soldats qui restoit, je m’avançay avec la contenance que donne le désespoir, mon peloton fit un feu si vif que l’ennemi en parut étonné ; il grossit insensiblement et les Sauvages voyant que mon attaque faisoit cesser les cris de l’ennemi revinrent à moy. Dans ce moment j’envoyay monsr le chevalier Le Borgne et monsr de Rocheblave dire aux officiers qui étoient à la tête des Sauvages, de prendre l’ennemi en flanc ; le canon qui batoit en tête donna favœur à mes ordres ; l’ennemi pris de touts côtés combatît avec la fermeté la plus opiniâtre. Les rangs entiers tomboient à la fois ; presque touts les officiers périrent ; et le désordre s’étant mis par là dans cette colonne tout prit la fuite.
« Le pillage fut horrible de la part des Français et des sauvages. Les officiers blessés qui touts l’avoient été dans ce dernier choc restoient sans secours. J’envoyay Messieurs De Normanville et Saint-Simon ramasser les soldats ; tout revint. Messrs de Carqueville Lapérade, Le Borgne, Mommidy et Hertel furent enlevés, les deux premiers expirent en arrivant au fort : il ne me resta plus de monde pour faire enlever le corps de monsieur De Beaujeu, je le fis cacher dans un ravin un peu écarté du chemin.
« Cependant touts les sergents étoient occupés à répandre les poudres des ennemis et à démonter leur artillerie. Je dépéchay un courier à mons De Contrecœur pour luy demander cent hommes avec des doux d’acier pour enclouer le canon, ce détachement étant parti trop tard s’égara dans le bois pendant la nuit la plus obscure et n’arriva que le lendemain.
« Touts les sauvages chargés de butin et de chevelures prenoient le chemin du fort à la réserve d’un certain nombre qui ayant trouvé de l’eau de vie dans les chariots ne purent se résoudre à l’abandonner et qui passèrent la nuit à se saouler.
« Nous étions dans cet état lorsque monsr Deslignerie vint à moy et me représenta qu’il n’y avoit pas moyen de garder la place ; qu’il ne nous restoit plus personne ; et que l’ennemi étoit en état de revenir avec huit cents hommes fraix qu’il avoit fort près de nous. Nous nous consultâmes et nous prîmes le parti de nous retirer en vûe de rallier notre petite armée qui avoit peu souffert et qui n’étoit que dispersée pour nous mettre en scituation de remarcher le lendemain si l’ennemi se trouvoit en état de faire de nouveaux mouvements avec sa réserve, par l’événement la chose n’eut pas été facille, touts les Sauvages étant partis sur le champ sans prendre congé pour retourner dans leurs villages.
« Le lendemain matin les Sauvages qui avoit passé la nuit à boire sur le champ de bataille revinrent avec quelques officiers qui y étoient restés avec eux, il est inutille de dire par quel motif, ils rapportèrent que l’ennemi marchoit à nous et qu’ils avoient entendû les caisses.
« Je partis par terre avec monsr De Léry et cent hommes pour aller chercher l’artillerie sur le champ de bataille, monsr de Céloron conduisit par la rivière des pirogues pour la transporter. Cela s’exécuta non sans allerte, chaque Sauvage qui venoit à nous nous annonceant l’ennemi : mais nous la conduisîmes au bord de la rivière, ou ayant été embarqués elle fut bientôt rendue au fort. Deux découvertes que je fis faire pendant cette opération nous tranquillisèrent sur le prétendu mouvement des ennemis.
« Ainsi s’est passé, Monseigneur, la journée du 9 de juillet dans laquelle je me flate de m’être montré soldat et officier : il s’est trouvé des gens qui ont voulû blâmer ma retraite. Mais ils ne sçavoient, sans doute, pas que l’on ne garde pas un champ de bataille quand on n’est plus en état de le disputer, à plus forte raison quand il ne reste plus de quoy l’oser en avant unne garde de dix hommes.
« S’il se trouvait quelqu’un, Monseigneur, entre ceux qui étoient à cette action qui osât nier un seul point de ce que j’avance, et qui le put prouver, je mérite d’être cassé pour avoir eu l’audace d’en imposer à Votre Grandeur.
« J’ose vous supplier très humblement, Monseigneur, de mettre cette lettre sous les yeux du Roy. Je suis extrêmement jaloux des grâces de Sa Majesté, mais je le suis encore plus que mon maître soit informé que je le sers en brave officier, en bon et fidelle sujet, et que je ne mange point indignement le pain que Sa Majesté me donne.
« Cette relation, Monseigneur, n’étant qu’unne appologie de ma manœuvre et que ma délicatesse exigeoit, je ne parle pas de plusieurs officiers qui m’ont parfaitement bien secondé. La pluspart ayant été recompencê j’ay lieu de penser que la Cour leur a rendû la justice qu’ils méritent.
« Depuis l’année dernière, Monseigneur, j’ay eu l’honneur de commander ici avec infiniment plus de succès que je ne devois naturellement l’espérer. J’ay réussi à mettre contre les Anglais touttes les nations de cette partie qui étoient leurs plus fidelles alliés. Ces sauvages dont partie étoient leurs domiciliés leur font maintenant une guerre cruelle et qui durera longtems : Car de la manière que les esprits sont tournés il ne faut pas penser qu’en faisant nôtre paix ces barbares si conforment.
« Les loups et les chavanons, nations formidables par leur nombre et leur audace et nos plus proches voisins ici ne sont pas les seuls ennemis que j’ay sçû susciter aux nôtres, j’ay profité de l’ascendant de ceux cy sur les autres nations plus éloignées et portant par ce moyen mes pratiques de village en village j’ay porté la guerre jusques dans la Carolline du Sud et aux bords de la mer. Les têtes plates au nombre de soixante et quatre villages ont reçeu mes colliers et accepté ma hache, pour me servir de leurs termes ; les Charakis et Chicachias sont maintenant en conseil pour suivre la détermination généralle ; en un mot, Monseigneur, nos ennemis sont frappés de tout côtés et nous les entourons à l’heure qu’il est par nos alliés comme leurs établissements entourent les nôtres dans ce continent. Voilà, Monseigneur, le fruit de la victoire de l’année dernière : car Vôtre Grandeur n’ignore pas sans doutte qu’avant cela les loups et les Chavanons refusèrent hautement la parolle de monsr De Contrecœur dans un Conseil Général tenû dans le tems que l’ennemi étoit en marche. En présence de touts nos domiciliés du détroit et de Micillimakinak qu’ils luy répondirent que les Anglais étoient leurs frères comme le Français étoit le père des autres nations qui étoient présentes ; qu’ils ne se mêleraient point de nôtre querelle et qu’ils vouloient rester neutres. Deux mois après je sçus les déterminer, en proffitant des moindres circonstances : car tout est moyen, tout est ressort avec ces gens là ; et l’habileté consiste à n’en négliger aucun.
« Il est vray, Monseigneur, que j’ay trouvé plus de facilité que tout autre à les manier à mon gré ; quelque réputation acquise parmi les Sauvages dans le combat de l’année dernière eut bientôt courû de village en village et rendit tout docille à mes invitations.
« Vôtre Grandeur sçaura peut être aussi, Monseigneur, quand cette lettre luy parviendra, que cette année les colliers de monsr Demuy avoient été rejetés par les Sauvages de son poste, et que touts nos domiciliers du détroit étoient résolus à rester tranquilles, si je n’eusse engagé les loups et les Chavanons à leur envoyer des parolles pour les inviter à venir faire la guerre avec eux.
« Vous dirai-je aussi, Monseigneur, que je me flatte d’avoir beaucoup contribué à la détermination des Cinq nations en mettant celles de cette rivière en méfiance et en arrêtant les partis des cinq villages qui passoient ici pour aller frapper sur des nations éloignées, j’ay réussy à les faire presque touts frapper sur l’anglais et s’il s’en est trouvé quelqu’un qui m’ayt résisté, j’ay toujours sçu le démembrer, par là j’ay mis les Iroquoix dans le cas de craindre les loups et les chavanons s’ils ne suivaient pas leur exemple ; et les partis que j’ay arrêté ici ayant porté dans leurs villages des chevelures et des prisoniers, ils se sont trouvés engagés à la guerre pour ainsy dire malgré eux.
« C’est par de tels ressorts, Monseigneur, variés de touttes façons que j’ay réussi à ruiner les trois provinces limitrophes de cette partie, Pensylvanie, Marillande et Virginie ; que j’ay fait abbandonner, et détruit de fond en comble les habitations à trente lieues de profondeur à compter de la ligne du fort Cumberlan. Je n’ay pas été huit jours de tems depuis le départ de monsr De Contrecœur sans avoir à la fois six ou sept différents partis en campagne dans lesquels j’ay toujours mêlé des Français. Jusques ici il nous en a coûté deux officiers et peu de soldats, mais les villages sont pleins de prisoniers de tout âge et de tout sexe ; l’ennemi a beaucoup plus perdu depuis la bataille qu’il ne fit le jour de sa défaite. L’on compte plus de deux mil cinq cent chevaux pris dans ces incurtions : les gazettes étrangères fairont foy, Monseigneur, de ce que j’ay l’honneur d’avancer à Vôtre Grandeur.
« Monsieur De Vaudreuil aura eu l’honneur de vous rendre compte, Monseigneur, que c’est par mes soins que s’est ouverte la communication de la Louisiane avec ces établissements. Cette rivière non pratiquée jusques à ce jour en remontant étoit réputée impraticable. Les connoissances que j’en pris l’automne dernier par les Sauvages d’en bas et le besoin pressant me firent prendre sur moy d’envoyer à la nouvelle chartre demander un secours en vivres. Je fis choix pour cela d’un homme capable de juger en descendant des facilités et des inconvénients ; et enfin ce secours parti le 27 février est arrivé ici le 21 may quoyque cette fourniture n’ayt pas été aussi ample que je l’avoix demandée elle nous a sauvés ce printems en nous donnant moyen d’attendre les secours de Montréal qui ne peuvent jamais arriver ici que fort tard.
« Nous sçavons maintenant, Monseigneur, que cette route est la plus belle du monde, monsr le chevalier Devilliers qui a commandé l’escorte du convoy étant arrivé ici dans un bateau de dix-huit milliers qui tout chargé a remonté la chûte. Je me flate, Monseigneur, d’avoir rendû en cela un service considérable par les secours que la nouvelle chartre peut fournir touts les ans à ces postes dont ils auront longtems besoin.
« J’ay lieu d’être satisfait de ma besogne, Monseigneur, elle est sans doute flateuse pour moy et profitable au service ; mais elle l’eut été bien d’avantage si l’on m’eut envoyé de Montréal les matières propres à l’artifice que j’ay demandées depuis l’automne dernier et pendant l’hiver. Monsieur le Général m’a fait l’honneur de me marquer qu’il avoit donné ses ordres à ce sujet à monsr Lemercier et que je recevrois tout ce que je demandois mais rien n’est arrivé. Monsr Lemercier a supprimé l’article des artifices dans ses envois, il ne m’est pas parvenû un once de souphre ny de salpêtre ; et ce retranchement laisse encore subsister le fort Cumberlan car touttes mes dispositions étoient faites pour le brûler, sa construction et les dispositions des sauvages me répondoient pour ainsy dire du succès.
« L’ennemi a fait quelques mouvemens depuis un mois dont j’ignore le but, mais nos partis ayant frappé chaque jour sur les trouppes qui arrivoient au fort Cumberlan leur quartier d’assemblée, j’ay sçu par des prisoniers nouvellement arrivés et par trois déserteurs que le général Wachinston avoit changé de dessein jugeant qu’il n’avoit pas assés de monde pour rien entreprendre.
« Vôtre Grandeur en lisant cette letre trouvera peut-être, Monseigneur, que je me fais trop valoir et je m’apperçois moy-même que mon stille sent un peu les bords de la Garonne où j’ay été élevé ; mais, Monseigneur, je sçay trop par l’expérience de l’année dernière que personne ne s’appliquera à donner du relief à mes services. Un bon officier est à plaindre, Monseigneur, dans un pais comme celuy cy où il se trouve isolé, dans un corps composé pour ainsi dire d’une seule famille. S’il a quelque talent l’envie s’attache a luy ; et s’il fait quelque chose digne de louange, la crainte de l’en voir recompancé fait que chaqu’un s’applique à en diminuer le prix.
« J’auray l’honneur de rendre compte à Vôtre Grandeur à la fin d’automne de la suitte de la campagne dans cette partie. Daignés Monseigneur, lire cette letre avec bonté ; elle est d’un homme qui ne demande qu’à verser son sang pour le service du Roy et qui mourroit satisfait si Sa Majesté avoit unne foix prononcé qu’elle est contente de ses services.
« Je suis avec un très profond respect, Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur
Au fort Duquesne, le 24 juillet 1756. »
Pour appuyer cette lettre, et pour prouver que les plaintes du capitaine Dumas étaient loin d’être mal fondées, citons l’extrait suivant d’une liste d’officiers que recommandait M. de Vaudreuil à Monseigneur le Garde des Sceaux.[4] Ce serait aussi une preuve de plus — s’il en était besoin — qu’il est né en France, car il n’est pas probable qu’il eût servi pendant des années en Europe, comme capitaine, avant de venir au Canada, s’il eût été Canadien. Pour quelle raison aurait-il choisi ce régiment d’Agenais s’il n’eût été originaire de ce pays ? D’ailleurs, la lecture attentive du document qui précède prouve amplement sa nationalité française. Ses remarques sur son service dans le régiment d’Agenais, ainsi que celles relatives au Canada et à ses habitants, ne laissent subsister aucun doute à ce sujet.
« M. Dumas.
« Il s’est trouvé Commandant du détachement après la mort de M. de Beaujeu, il a ranimé les Canadiens et les Sauvages, et par sa bonne manœuvre et intrépidité a eu le succès dont j’ay eu l’honneur de vous rendre compte par mes lettres concernant cette affaire. D’ailleurs il a servi longtemps en France en qualité de capitaine d’infanterie et mal à propos lui a-t-on fait perdre son ancienneté depuis qu’il est dans la Colonie. C’est un excellent officier. Fait à Montréal, le 30 octobre 1755.
Son caractère
Une bravoure à toute épreuve, une scrupuleuse probité dans ces temps de rapine, l’attachement au devoir, l’obéissance passive, même quand les ordres des supérieurs sont ou paraissent impérieux, injustes, ou inopportuns, des sentiments d’humanité qu’on ne trouve malheureusement pas toujours chez les militaires de profession, endurcis par le métier ; une grande sagesse dans le commandement, telles étaient les éminentes qualités qui distinguaient son beau caractère. Aussi bien, il était aimé de ses soldats et apprécié de ses chefs.
Le chevalier de Lévis le portait en haute estime ; il lui témoignait une véritable affection, comme il se plaisait à le lui répéter dans ses lettres.
M. de Vaudreuil le tenait pour un excellent officier à qui, disait-il, on avait fort mal à propos fait perdre son droit d’ancienneté depuis qu’il était dans la colonie.
Le marquis de Montcalm prisait fort l’habileté dont il avait fait preuve dans la direction des Sauvages durant son séjour au fort Duquesne.[6]
Toutes les mesures prises ou proposées par M. Dumas, durant son commandement à Jacques-Cartier et à Deschambault pendant l’hiver de 1759-1760, furent pleinement approuvées par le chevalier de Lévis et M. de Vaudreuil, qui ne cessaient de lui en témoigner leur satisfaction.[7] La lettre suivante en est une preuve convaincante. Nous la prenons au hasard dans le grand nombre.
« J’ai reçu mon cher Dumas votre lettre du premier de ce mois ; rien de mieux que toutes les dispositions que vous avez fait pour vos vivres et toutes les précautions militaires que vous prenés. J’en ai rendu compte à M. le général qui a tout aprouvé et dans toutes les circonstances n’est pas en peine des événemens, il est aussi persuadé que moi que la besogne ne saurait être en meilleures mains…
« Vous connaissez mon cher Dumas les sentiments de sincère attachement avec lesquels j’ai l’honneur d’être votre très humble et très obéissant serviteur,
Ces compliments ne sont ni vulgaires ni communs, bien qu’ils se présentent souvent sous la plume du chevalier de Lévis.
M. Parkman, de son côté, dit de lui, en parlant des incursions qu’il dirigeait du fort Duquesne sur les frontières de la Pennsylvanie en 1756 : « Dumas, required by the orders of his superiors to wage a detestable warfare against helpless settlers and their families, did what he could to temper its horrors ; and enjoined the officers who went with the Indians to spare no efforts to prevent them from torturing prisoners. » Il ajoute : « The attempt should be set down to his honor ; but it did not avail much ».[8]
Les Mémoires de Famille de l’abbé Casgrain, ajoute M. Parkman, contiennent un ordre de M. Dumas à M. Baby, officier canadien, à cet effet, et des ordres semblables de MM. de Contrecœur et de Ligneris. Un de ces ordres, signé de Dumas, fut trouvé dans les poches du sieur Douville qui fut tué sur la frontière.
Dans des Remarks upon the present situation of Canada datées novembre 1759, et adressées au général Amherst, le major Grant dit : « The command at Jacques Cartier is given to Mr. Dumas, the best Officer in the Colony — he is a Frenchman, but is much esteemed by the Canadians »…
« Captain Dumas », dit à son tour M. A. G. Doughty,[9] « was one of the bravest and most experienced of the officers of the Colonial Troops… »
À toutes ces précieuses qualités on peut encore, sans exagération, croyons-nous, ajouter l’esprit gaulois, et la faculté de sentir et de s’exprimer vivement, propre au méridional, qui se font jour dans ses lettres. Témoin, entre autres, sa lettre du 24 juillet 1756, dans laquelle il plaide si chaleureusement sa propre cause, et qu’il termine en disant que son style « sent un peu les bords de la Garonne où j’ai été élevé ».
Sa carrière
EN FRANCE
Comme tous les officiers de son temps, M. Dumas a dû entrer dans l’armée de bonne heure. On sait que, au XVIIIe siècle, les jeunes gens se destinant à la carrière militaire obtenaient vers l’âge de quatorze ans la commission d’enseigne. C’était là le premier pas. Or nous ne savons ni en quelle année il est né, ni dans quel régiment il débuta.
Né dans l’Agenais et « élevé sur les bords de la Garonne », il n’est pas improbable que ce soit dans le régiment du pays natal qu’il fit ses premières armes.
Nous savons toutefois que, avant de venir au Canada, il avait servi longtemps comme capitaine au régiment d’Agenais et que, arrivé dans la colonie, il réclama le droit d’ancienneté sur MM. de Contrecœur et de Beaujeu ;[10] le marquis Duquesne ne semble pas avoir agréé sa requête. Nous n’avons pu trouver la raison de ce refus. Le fier marquis le trouvait-il de trop petite naissance, ou trop peu courtisan ? On ne peut que conjecturer sur ce point. On voit cependant par les lettres de M. Duquesne au Ministre, que ce gouverneur, dès le début de son administration, se montra prévenu contre la plupart des officiers de la colonie, en commençant par le baron de Longueuil, qui avait gouverné le pays depuis la mort du marquis de La Jonquière. Il accorda ses préférences à trois officiers, MM. Marin, Péan et Le Mercier, qu’il ne cessa de prôner et en faveur desquels il importunait constamment le Ministre de ses instances de grâces et d’honneurs.
« Le départ de Duquesne », dit M. Garneau, « ne causa aucun regret en Canada. Son caractère hautain l’avait empêché de devenir populaire. »
Nous ne pouvons résister à la tentation de reproduire ici la lettre qu’adressait le marquis Duquesne au Ministre, à la date du 15 juillet 1755. L’on y découvre un personnage gonflé d’orgueilleuses prétentions, se complaisant à faire la leçon à M. de Vaudreuil, son successeur, et à lui tracer une ligne de conduite administrative.
« Monseigneur,
« J’ai l’honneur de vous informer que Monsieur de Vaudreuil est monté à Montréal le 12 du courant pour accélérer les mouvemens qu’il doit faire du côté de Choeguen, qui deviennent toujours plus pressés par les forces que les Anglois envoient de ce côté là et les barques qu’ils construisent en toute hâte pour croiser dans le lac Ontario. Je ne mets point en doute que Monsieur le Baron Dieskaw qui est chargé de cette opération ne réussisse.
« Personne de la Colonie n’ignore que j’ai offert mes services à Monsieur de Vaudreuil pour une opération aussi importante et que je ne lui aie fait observer que tout Canadien qu’il était il n’auroit pas mes mêmes facilités soit pour rassembler promptement sa milice, soit encore pour la célérité du départ. Je n’ai eu d’autre réponse de lui ; qu’il alloit monter à Montréal. À ce refus je lui ai communiqué Monseigneur, la lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire du premier avril, il m’a encore répondu qu’il monteroit à Montréal. Je lui ai cependant dressé le projet de cette expédition en présence de Monsieur le Baron Dieskaw et l’ai déterminé à se servir des Sieurs Péan et Le Mercier pour l’arrangement et la prompte exécution de cette entreprise, ces deux officiers m’aiant donné des fortes preuves de capacité dans mes mouvemens.
« J’ai remis à ce nouveau Gouverneur des mémoires de ce que j’ai fait dans cette Colonie et sur tous les objets les plus intéressants qui exigent beaucoup d’attention pour entretenir l’ordre, la règle et l’épargne que j’y ai établi dans tout ce qui a été de mon ressort.
« Je lui ai donné de plus un mémoire sur ce que j’aurois fait si la Colonie avoit roulé sur moi dans la circonstance présente.
« Je ne puis m’empêcher Monseigneur, de vous témoigner ma sensibilité sur ce que vous n’avés pas eu agréable de faire rouler sur moi jusques en automne les opérations du Canada. Je m’attendois cependant à cet agrément, vu mon travail et les connoissances que j’ai acquis ; j’en ai été si vivement touché qu’après avoir rempli tout ce que je devois à mon successeur et me voiant inutile, j’ai demandé à Monsieur le Comte Dubois de la Motte, la frégate la Diane pour passer à Rochefort où il me convient d’aller par préférence.
Je suis avec un profond respect Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur
Québec, le 15 juillet 1755.
Inutile d’insister : l’insolence du marquis de fraîche date perce à chaque mot.
La ligne de démarcation entre Canadiens et Français était déjà bien dessinée à cette époque. Ceux-ci regardaient ceux-là comme des inférieurs et les Canadiens payaient leurs cousins de France en même monnaie. La même mentalité, du reste, existait dans les colonies anglaises où l’antagonisme était peut-être encore plus prononcé. Des faits nombreux et variés, qu’il serait superflu de rappeler ici, prouvent amplement cette disposition d’esprit des deux peuples, laquelle alla toujours croissant et atteignit son point culminant dans les dernières années du régime français. La conduite de M. Duquesne, du baron de Dieskau et de M. de Montcalm envers M. de Vaudreuil et les Canadiens en général, et que ceux-ci ressentaient vivement, est une preuve frappante de cet état, d’esprit regrettable dont nous parlons. Il est juste d’ajouter que le chevalier de Lévis fut une des rares exceptions à cette règle ; il fut toujours l’ami et le protecteur des Canadiens qui, en retour, l’aimaient et l’estimaient. Il en était de même pour M. Dumas.
Mais laissons cette digression. M. de Contrecœur avait été fait capitaine en 1748, après dix-neuf ans de service. Le sieur Dumas était plus ancien dans le grade, ayant « longtemps servi en France en qualité de capitaine d’infanterie », il avait suivi le régiment d’Agenais dans ses différentes campagnes, en Allemagne, en Corse, en Bavière et sur les Alpes, théâtres où il trouva maintes occasions de se distinguer et de gagner ses promotions.
On sait que le marquis de Montcalm fit, lui aussi, ces différentes campagnes, à partir du siège de Philipsbourg (1734), jusqu’à la paix de 1748. Ces deux hommes servant dans des régiments différents n’avaient probablement pas eu l’occasion de se rencontrer avant de venir au Canada. Néanmoins, lors du désarmement qui suivit le traité de paix d’Aix-la-Chapelle, le régiment d’Agénais, après de nombreux et brillants états de service, fut démembré et incorporé, le 10 février 1749, partie dans les Grenadiers de France, partie dans le régiment de Berry. Le capitaine Dumas paraît alors avoir été destiné au service des colonies et attaché aux troupes de la Marine.
Nous extrayons de l’Histoire de l’Ancienne Infanterie française de M. Louis Susane (Paris), 1853, vol. 8, p. 271, la liste suivante des services et des campagnes de ce beau régiment d’Agenais, qui eut en tout temps comme colonels commandants des officiers de distinction et de mérite.
« Agenois. — Créé sous ce titre, 4 octobre 1692, et donné à Antoine Clériadus, comte de Choiseul-Beaupré. Armée d’Allemagne jusqu’en 1694. Campagnes de 1695, 1696 et 1697 en Flandre ; siège d’Ath. Armée de Flandre en 1701. Combat de Nimègue en 1702. Passe à l’armée du Rhin, bataille de Friedlingen. Siège de Kehl. Campagnes de Bavière en 1703. Bataille d’Hochstedt en 1703 ; le 1er bataillon y est pris. Donné le 2 mars 1705 à Henri-Louis de Choiseul, marquis de Meuse. Armée de Flandre, bataille de Ramilies en 1706. Bataille d’Audenaerde en 1708. Bataille de Malplaquet en 1709. Bataille de Denain en 1712 ; le colonel y est très grièvement blessé. Donné le 17 octobre 1717 à Gilles de Carné, marquis de Trécesson, 1er février 1719 à Louis-Auguste, comte de Bourbon-Malauze, et 1er août 1731 à Armand, comte de Bourbon-Malauze, frère du précédent. Armée du Rhin, siège de Philipsbourg en 1734. Combat de Klausen en 1735. Campagnes en 1739 et 1740 en Corse. Armée de Bavière en 1742, secours de Braunau, défense de Deckendorf. En garnison à Bitche en 1743. Armée des Alpes en 1744 ; le colonel est tué à l’attaque des retranchements de Montalban. Donné 15 mai 1744 à Louis-François, marquis de Monteynard. Sert sur les Alpes jusqu’à la paix. Incorporé 10 février 1749, les Grenadiers dans les Grenadiers de France, et le reste dans le Berry. Les deux drapeaux d’ordonnance d’Agénois étaient jaune et violet, dans chaque carré, ces couleurs séparées par une diagonale festonnée. Habit complet gris-blanc, parements rouges, boutons et galon d’argent. »
Sa carrière
au canada
M. Dumas fut nommé capitaine dans les troupes de la Marine au Canada vers le 20 avril 1750.[11] Quelques jours plus tard il s’embarquait à Bordeaux pour le Canada. Nous ignorons la date précise de son arrivée à Québec. Dès l’automne de la même année il commande au fort Gaspareaux, en Acadie, où il avait dû se rendre en même temps que M. Saint-Ours des Chaillons, chargé de relever M. de La Corne à Beauséjour (novembre 1750). Il y exerça ses fonctions l’espace d’un an environ, et se vit remplacé par le chevalier Poilvillain de la Houssaye.[12]
Le marquis de la Jonquière, alors gouverneur général de la Nouvelle-France, fut remplacé au mois de juillet 1752 par le marquis Duquesne de Menneville, arrière-petit-neveu du célèbre marin Abraham Duquesne. Il avait servi dans la marine et avait atteint le rang de capitaine de vaisseau. Louis XV le fit marquis en même temps que gouverneur général du Canada.
Avant de raconter les exploits du sieur Dumas dans la vallée de l’Ohio où il devait s’illustrer, jetons un rapide coup d’œil sur ce qui s’était passé dans ces régions lointaines de la Nouvelle-France.
La paix de 1748 se maintenait difficilement entre la France et l’Angleterre ; ce n’était guère qu’une trêve qui ne pouvait être de longue durée. En Amérique, en effet, la question des limites de l’Acadie d’un côté, celle des territoires au sud des Grands Lacs, de l’autre, restaient en litige.
La Virginie qui se sentait à l’étroit dans ses limites, resserrée entre l’Atlantique, à l’est, et la chaîne des Alléghanys, à l’ouest, et dont la population augmentait rapidement, avait senti naître de nouvelles ambitions. Ne pouvant accroître son territoire ni au nord ni au sud, à cause des chartes royales qui délimitaient les territoires des provinces limitrophes, elle jeta, avec une désinvolture tout américaine, son dévolu chez le voisin de l’ouest, c’est-à-dire, sur la vallée de l’Ohio, à laquelle elle n’avait pourtant aucun droit. Passant du dessein à l’action, elle avait même déjà envahi ce territoire et en avait cédé une grande partie à la Compagnie de l’Ohio qui y faisait la traite et y concédait des terres.
De son côté la France repoussait les prétentions de cette province ; elle revendiquait cette région par droit de découverte et de premier occupant, L’Ohio, précisément, avait été découverte en 1673 par Louis Jolliet et le P. Marquette, les intrépides découvreurs du Mississipi, et M. Céloron de Blainville avait pris possession solennelle de cette vallée au nom du roi de France, en 1749, après avoir parcouru la rivière dans la plus grande partie de son cours.
Ce vaste territoire, au delà des Alleghanys, que se disputaient les deux nations rivales, était d’une haute importance. La vallée de l’Ohio s’étend sur une longueur de plus de six cents milles. Étant bien arrosé, ce pays est très fertile. C’était aussi alors, un territoire de chasse fréquenté par de nombreuses tribus sauvages. Cette région ne représentait toutefois qu’une faible partie de l’immense étendue de territoire en litige, lequel s’étendait vers l’ouest jusqu’au Mississipi, dont l’Ohio est tributaire. L’enjeu de ce duel colossal était donc d’une valeur considérable.
En 1753, M. Duquesne, ayant reçu ordre de la Cour d’empêcher les Anglais de s’établir dans la vallée de la Belle-Rivière prit des mesures énergiques. Il envoya le sieur Marin à la tête d’un détachement d’environ mille hommes à l’endroit appelé la Presqu’île,[13] au sud-est du lac Érié, avec ordre de faire respecter les droits de la France dans cette région. M. Marin y construisit un fort, puis un second[14] fut élevé à la rivière aux Bœufs. Un troisième fort, bâti l’année suivante,[15] fut nommé Machault, en l’honneur du nouveau ministre de la Marine.
En novembre de la même année, M. de la Chauvignerie fut envoyé de ce dernier poste à Chipengué,[16] village des Chaouanons, pour y établir un autre fort.
M. de Contrecœur, ayant remplacé M. Marin, chassa, le 17 avril 1754, des miliciens anglais occupés, sous la direction de l’enseigne Ward, en l’absence du capitaine Trent, à la construction d’un fort au confluent de la Monongahéla et de l’Alléghany, à vingt lieues à peu près des Appalaches, et éleva le fort Duquesne à cet endroit.[17]
Le mois suivant, le sieur de Jumonville fut envoyé par M. de Contrecœur, avec une petite escorte, destinée à le protéger contre les Sauvages, pour sommer le colonel Washington de se retirer de la vallée de l’Ohio. On sait comment le parlementaire canadien fut surpris et assassiné par les miliciens du colonel Washington le 28 mai. M. Coulon de Villiers, frère de la victime, reçut l’ordre d’aller venger sa mort. Il attaqua le colonel Washington enfermé dans le fort Nécessité ; après un violent combat qui dura dix heures, celui-ci dut capituler. Ce fait d’armes se passait le 3 juillet 1754.
L’année suivante le général Braddock arrivait en Virginie au mois de janvier et convoquait aussitôt en conférence les gouverneurs de province. « Il fut arrêté, » dit M. Garneau[18] « qu’il irait en personne avec les troupes réglées s’emparer du fort Duquesne et de toute la vallée de l’Ohio ».
On sait comment ce général tint sa promesse. Il avait vendu la peau de l’ours avant de l’avoir pris.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la France et l’Angleterre étaient encore officiellement en paix, malgré les combats de l’année précédente dans ces régions, et que les négociations pour le règlement des limites se poursuivaient mollement entre les deux Cours qui se préparaient sous main à la guerre devenue inévitable. Le voile d’hypocrisie qui couvrait les pourparlers des agents diplomatiques — lesquels ne trompaient cependant personne — fut enfin brusquement déchiré par l’Angleterre, qui déclara la guerre à la France le 18 mai 1756. Celle-ci répondit par une contre-déclaration, le 9 juin. C’était là pures formalités puisqu’on se battait depuis plus de deux ans en Amérique.
Combat de la Monongahéla
Ayant passé sommairement en revue les faits les plus saillants de l’histoire de la vallée de l’Ohio, antérieurs au plus brillant en même temps qu’au plus important fait d’armes qui ait eu lieu dans cette région lointaine de la Nouvelle-France, il s’agit maintenant d’éclaircir un point essentiel, malheureusement resté jusqu’ici quelque peu embrouillé. Deux historiens, dont nous parlerons bientôt, sont la cause principale de ce manque de clarté. Ce point c’est le suivant.
À qui appartient l’honneur de la brillante victoire remportée le 9 juillet 1755 sur les bords de la Monongahéla ?
Nous avons sous les yeux tous les documents qu’il a été possible de recueillir concernant cet engagement. Voici ce qui résulte d’un mûr examen de ces diverses pièces.
Tout en reconnaissant les mérites éminents de MM. de Contrecœur et de Beaujeu, et sans vouloir en aucune façon déprécier les services de ces deux officiers, nous croyons devoir répondre sans aucune hésitation, que le succès de la bataille revient de droit à l’indomptable énergie que déploya en cette circonstance le capitaine Dumas, et à l’empire qu’il exerçait sur ses hommes. Vaincre ou mourir ! Telle fut sa détermination ; tel, le gage de l’heureuse issue, presque inespérée, qui vint couronner ses valeureux efforts.
Il faut examiner les incidents tels qu’ils apparaissent à la lumière des documents de l’époque.
Le général Braddock, secondé par le colonel Washington, s’avance à la tête de 2200 soldats contre le fort Duquesne. M. de Contrecœur, commandant du poste,[19] apprend par ses éclaireurs que l’ennemi n’est plus qu’à une faible distance du fort.
Le 7 juillet il réunit en conseil ses officiers pour délibérer sur ce qu’il convient de faire. Devant l’impossibilité de défendre le fort, qui n’a que peu de canons, contre un ennemi qui en possède plusieurs, et dont la force numérique est bien supérieure à la sienne ; constatant qu’on a tout à perdre et rien à gagner si on reste sur la défensive, mais qu’il vaut mieux payer d’audace, il est décidé, sur la proposition de M. Dumas,[20] appuyé par M. de Courtemanche, et à laquelle les autres officiers se rallient, de se porter au-devant de l’ennemi et de se mettre en embuscade sur la route par où il approche.
Le lendemain soir, M. de Contrecœur, qui avait pris ses mesures dans le courant de la journée, va lui-même examiner le terrain.
Le 9, il envoie un détachement sous les ordres de MM. de Beaujeu, Dumas et de Ligneris. Ce détachement, composé de cent soldats, cent Canadiens et six cents Sauvages environ, ne peut atteindre l’endroit choisi, mais se trouve inopinément en face de l’ennemi, à trois lieues du fort. Les Anglais s’avancent dans un ordre parfait. M. de Beaujeu commence immédiatement l’attaque, « avec beaucoup d’audace, »[21] dit M. Dumas, « mais sans nulle disposition, notre première décharge fut faite hors de portée ; l’ennemi fit la sienne de plus près ; et dans ce premier instant du combat, cent miliciens qui faisoient la moitié de nos français lâchèrent honteusement le pied en criant Sauve qui peut »…
« Ce mouvement en arrière ayant encouragé l’ennemi il fit retentir ses cris de vive le Roy, et avança sur nous à grands pas. Son artillerie s’étant préparée pendant ce tems là commença à faire feu, ce qui épouvanta tellement les Sauvages que tout prit la fuite. L’ennemi faisoit sa troisième décharge de mousqueterie quand monsr de Beaujeu fut tué. »
« Notre déroute se présenta à mes yeux sous le plus désagréable point de vue ; et pour n’être point chargé de la mauvaise manœuvre d’autruy e ne songeay plus qu’à me faire tuer. »
La bataille était donc loin d’être gagnée lorsque M. de Beaujeu tomba. Les choses allaient mal et semblaient vouloir plus mal tourner encore, quand M. Dumas, du geste et de la voix, ranimant les hommes qui lui restaient, se porta hardiment de l’avant. Ses soldats ouvrirent un feu si vif, si meurtrier, que l’ennemi en resta étonné, hésita, et cessa ses cris. Les Sauvages s’en étant aperçus revinrent prendre part au combat. M. Dumas envoya aussitôt[22] le chevalier Le Borgne et M. de Rocheblave dire aux officiers qui étaient à leur tête de prendre l’ennemi en flanc.
Les tuniques rouges des troupes régulières anglaises, se détachant nettement sur le fond vert de la forêt, offraient un point de mire superbe à nos gens tous habiles tireurs. Aussi point de balles perdues : tous les coups portaient, et l’on choisissait de préférence les officiers afin de priver les soldats de leurs chefs. Les rangs de l’ennemi s’éclaircissaient à vue d’œil, des lignes entières tombaient à la fois, fauchés comme des épis mûrs.
Les Anglais attaqués de tous côtés offraient cependant une résistance opiniâtre, et ne faisaient point mentir la réputation de bravoure et de ténacité de leur race. What we have we hold semblait d’ores et déjà être leur fière devise. Mais la seconde colonne arrivant sur ces entrefaites, juste au moment où les premiers rangs commençaient à fléchir sous la pluie de balles qui s’abattait sur eux de tous côtés, détermina un désordre qui devint bientôt indescriptible. Les rangs s’entremêlèrent, les canons anglais entourés par leurs propres troupes ne pouvaient plus servir. Le général Braddock était devenu impuissant : il s’efforçât en vain de reformer ses colonnes. Lui-même fut mortellement frappé après avoir eu trois chevaux tués sous lui. Le colonel Washington n’échappa que par miracle au massacre. Il fut entraîné par la déroute de ses gens et ne réussit qu’avec peine à traverser la rivière.
N’étant plus dirigés et soutenus par leurs officiers, se voyant décimés par ce terrible feu de mousqueterie, et ne pouvant riposter à un ennemi invisible, les Anglais finalement lâchèrent pied. Ce fut la déroute complète. M. Dumas lança alors ses gens à la poursuite, baïonnette au bout du fusil, et les Sauvages sortirent du bois en poussant d’horribles hurlements, la terrible tomahawk au poing. Ce fut un horrible carnage.
Pour échapper à cette affreuse boucherie, un grand nombre de soldats se jetèrent dans la Monongahéla, essayant de la traverser à la nage ou à gué, mais ils furent presque tous engloutis dans ses flots, et la rivière charria leurs cadavres.
Toutes les troupes du général Braddock n’avaient pas donné. Environ 1200 hommes avaient pris part au combat. Le colonel Dunbar, commandant l’arrière-garde en avait encore 1000 avec lui. Ceux-ci furent pris de panique en voyant la déroute du corps principal. Tous s’enfuirent et ne s’arrêtèrent qu’au fort Cumberland, après avoir détruit l’artillerie, les munitions et les bagages.
Ne connaissant pas encore toute l’étendue de sa victoire, et craignant que l’ennemi ne se ralliât et revint à la charge, M. Dumas prit des mesures en conséquence. Il fit arrêter la poursuite, rassembla ses troupes et décida de retourner au fort pour s’y reposer et s’y refaire. Un grand nombre de Sauvages étaient déjà partis pour leurs cantons, emmenant des prisonniers et rapportant des chevelures et du butin.
Nous extrayons ce qui suit d’une Relation de l’affaire de la Belle-Rivière, datée du fort Duquesne.[23] « Le 10 juillet… quelques sauvages, craignant que les Français ne leur fissent tort dans leur pillage, firent courir le bruit que les Anglais s’étaient ralliés et qu’ils marchaient pour gagner leur artillerie. On envoya aussitôt ordre à M. de Céloron d’arrêter la marche, et d’envoyer à la découverte. Après une longue délibération, il fut décidé que l’artillerie était l’objet principal pour empêcher l’anglais d’entreprendre une seconde attaque pour cette année, il fallait nécessairement s’en emparer. M. Dumas capitaine qui proposa de se mettre à la tête de cette expédition eut M. de Léry pour second, lequel M. de Contrecœur n’avait pas voulu laisser aller au feu le jour précédent parce qu’il était chargé de l’artillerie et des travaux. Il fut donc donné à M. Dumas avec un détachement de 100 Français et quelques sauvages pour aller à la découverte, M. Dumas ayant rejoint M. de Céloron envoya à la découverte des sauvages et Français qui rapportèrent que l’anglais s’était retiré n’ayant trouvé que des morts à plus de 6 lieues du champ de bataille, ce qui fit passer la nuit plus tranquillement à nos détachements…
« Le 11 juillet, il arriva sur les onze heures du matin une pièce de canon de fonte du calibre de 11’ que MM. Dumas et Léry avaient fait charger dans une pirogue dès le soir précédent. Ces messieurs arrivèrent sur les 3 heures après-midi et emmenèrent 3 pièces de canon de fonte du même calibre, 2 autres pièces de canon de fonte aussi du calibre de 5’½ de balle, 4 mortiers ou obusiers aussi de fonte de 7 pouces ½ de diamètre, 3 autres mortiers pour grenades de 4 pouces 3 lignes de diamètre ; on fit entrer le même jour les pièces d’artillerie dans le fort… Il fut emmené environ 80 bêtes à corne auxquelles les sauvages firent la guerre comme ils l’avaient faite aux Anglais… »
« Les pertes de l’ennemi furent énormes. Le carnage avait été presque sans exemple dans les annales de la guerre moderne, » dit M. Garneau.[24] Près de huit cents hommes avaient été tués ou blessés, sur les douze cents qui marchaient à la suite du général Braddock ; et de quatre-vingt-six officiers, vingt-six avaient été tués et trente-sept blessés… Les troupes en déroute rejoignirent le colonel Dunbar et communiquèrent leur panique à ses soldats. En un moment toute l’armée se débanda. L’artillerie fut détruite ; les munitions et les gros bagages furent brûlés, sans que personne sut par l’ordre de qui. La discipline et le calme ne se rétablirent que lorsque les fuyards, harassés, éperdus, arrivèrent au fort Cumberland dans les Appalaches. Le colonel Washington écrivit : « Nous avons été battus, honteusement battus par une poignée de Français qui ne songeaient qu’à inquiéter notre marche. Quelques instants avant l’action, nous croyions nos forces presqu’égales à toutes celles du Canada ; et cependant, contre toute probabilité, nous avons été complètement défaits, et nous avons tout perdu, »
Du côté des Canadiens les pertes furent légères, soit une quarantaine d’hommes dont trois officiers tués et quatre blessés.
Le sieur de Beaujeu fut fort regretté des Canadiens et des Sauvages qui l’aimaient beaucoup.
Cette fois la bataille était bien gagnée, la victoire avait enfin couronné d’une façon éclatante les efforts presque surhumains de la valeureuse petite troupe. « Superbe fait d’arme d’une poignée de héros ! » s’écrie avec raison le P. Le Jeune.[25]
La défaite du général Braddock eut un immense retentissement dans les colonies anglaises et jusqu’en Angleterre.
Cette victoire de M. Dumas non seulement ferma à l’ennemi l’une des trois routes par lesquelles il voulait pénétrer jusqu’au cœur du pays, c’est-à-dire Montréal et Québec, mais produisit chez lui le désarroi et le découragement.
La colonie était sauvée. En récompense de cette glorieuse journée, l’une des plus mémorables de l’Histoire américaine, dit M. Garneau, M. Dumas fut fait chevalier de Saint-Louis l’année suivante (17 mars). Il avait magnifiquement
mérité la croix d’honneur.Qui était commandant au fort
Duquesne en juillet 1755 ?
Deux auteurs, M. John Dawson Gilmary Shea et M. l’abbé Daniel, ont soutenu que M. Daniel Liénard de Beaujeu commandait au fort Duquesne en juillet 1755, et lui attribuent non seulement la victoire de la Monongahéla, mais aussi l’honneur d’avoir été l’auteur du projet d’embuscade dressée contre les troupes du général Braddock, c’est-à-dire qu’ils lui décernent tout le mérite de cette belle victoire.
Il sera pénible à certains esprits de voir disparaître la légende accréditée jusqu’à nos jours à ce sujet, mais la vérité historique a des droits imprescriptibles que l’on ne peut, que l’on ne doit pas méconnaître.
M. Shea, à qui l’Histoire du Canada est redevable de tant de travaux et de réimpressions de vieux ouvrages, a publié, en 1860, une brochure intitulée : Relations diverses sur La Bataille de la Malangueulé, gagnée le 9 juillet 1755 par les François sous M. de Beaujeu, commandant du fort Duquesne sur les Anglois sous M. Braddock, général en chef des troupes angloises. Recueillies par Jean-Marie Shea, Nouvelle-York. De La Presse Cramoisy, MDCCCLX.
M. Shea ne paraît pas avoir poussé bien loin ses recherches au sujet de l’erreur dans laquelle plusieurs historiens sont tombés, suivant lui, en disant que M. de Contrecœur et non M. de Beaujeu, était le commandant du fort Duquesne lors de la bataille de la Monongahéla.
Voyons sur quoi il fonde son assertion.
Voici la liste des pièces recueillies et publiées par cet historien :
1. Relation de l’action par M. de Godefroy, avec état de l’artillerie, etc.
2. Relation depuis le départ des troupes de Québec jusqu’au 30 du mois de septembre 1756.
3. Relation de l’action par M. Pouchot
4. Relation du combat tirée des archives du Dépôt général de la guerre.
5. Relation officielle, imprimée au Louvre.
6. Relation des divers mouvements qui se sont passés entre les François et les Anglois.
7. État de l’artillerie, munitions de guerre, etc.
8. Lettre de monsieur Lotbinière à monsieur le comte d’Argenson.
9. Extraits du registre du fort Duquesne.
Nous acceptons volontiers la Relation de M. de Godefroi, puisqu’il paraît avoir été témoin oculaire de l’affaire. En examinant attentivement cette pièce nous verrons que M. de Beaujeu y est qualifié de commandant de la petite troupe et non du fort. « Le 9, jour de l’action, M. de Beaujeu en partit avec environ 150 François tant officiers que cadets, soldats et miliciens, tout compris et environ 500 sauvages à huit heures du matin. De ce nombre de sauvages 300 prirent une autre route que le commandant ; ils passèrent la rivière Malangueulée, de sorte que le détachement se trouua près de l’ennemy bien foible, mais comme on étoit près de donner, les 300 sauvages rejoignirent le parti et on avança tout de suite pour frapper, environ à 3 lieues et demy du fort Duquesne où les ennemys étoient à dîner. On fit le cri et on donna dessus dans un endroit fort désavantageux pour nous, mais ils ne firent reculer notre monde que d’une dizaine de pas et cela à trois fois différentes. Ils avoient leurs canons chargés à raizins.[26] M. de Beaujeu fut tué à la troisième décharge. M. Dumas resta commandant ».
Deux pages plus loin, la liste des officiers tués dans le combat contient les noms suivants : « M. de Beaujeu, commandant, le chevalier de la Pérade et M. de Carqueville. Les blessés furent MM. Le Borgne, de Bailleul, Hertel et de Mont-midi.
Le mot Commandant apparaît trois fois dans cette relation, et M. de Beaujeu n’y est nulle part qualifié de commandant du fort.
La deuxième pièce intitulée : « Relation depuis le départ des trouppes de Québec, jusqu’au 30 du mois de septembre 1755 », n’est qu’un ouï-dire. L’auteur anonyme reconnaît lui-même n’avoir pas été présent à l’action ni au fort Duquesne. « Les regimans partagés par division de quatre ou cinq compagnies étoient partis pour se rendre en partie au fort Frontenac où nous devions former un camp et de là aller faire le siège de Choyen ; ce projet n’a pu avoir son exécution, ayant été obligé de les faire marcher pour empêcher les ennemis de faire celui du fort Saint-Frédéric, et on fut dans l’obligation de faire redescendre le régiment de la Reyne et notre première division qui étoit fort avancée ».
Les troisième, quatrième, et cinquième relations reconnaissent explicitement que M. de Contrecœur commandait au fort Duquesne. La sixième est encore un ouï-dire ; il n’y est d’ailleurs nullement question du commandant du fort. On voit tout simplement parmi les morts, « Monsieur de Beaujeu, Capitaine, Commandant. » Le document suivant est un État de l’artillerie, Munitions de guerre, etc., où il n’est pas non plus question du commandant. La lettre suivante est de M. de Lotbinière, elle est adressée, du Camp de Carillon, le 24 octobre 1755, à Monsieur le Comte d’Argenson. Il n’est aucunement question du commandant dans cette lettre.
M. Shea donne ensuite neuf extraits de sépultures faites au fort Duquesne. Parmi elles se trouve celle de M. de Beaujeu, capitaine d’infanterie, commandant du fort Duquesne et de l’armée. « On ne voit guère, dit M. Shea, la possibilité d’une erreur de la part de l’aumônier du fort quant à la personne du commandant. » Ceci paraît inattaquable. C’est le seul document sérieux qu’apporte M. Shea pour étayer son assertion. Disons tout de suite que M. de Beaujeu avait, en effet, été désigné au printemps de l’année 1755, par le gouverneur pour commander au fort Duquesne. Mais ajoutons que cet officier ne devait remplacer M. de Contrecœur qu’au départ de celui-ci. Or, comme en font foi la lettre de M. de Contrecœur à M. de Vaudreuil, en date du 14 juillet 1755, et celle du même officier au Ministre, du 20 du même mois, M. de Contrecœur n’était pas encore parti du fort à cette date. La lettre de M. Dumas, en date du 24 juillet 1756, confirme les deux lettres de son supérieur. Entre le certificat de l’aumônier et l’affirmation de M. de Contrecœur, il n’y a pas à hésiter. Les deux lettres officielles de ce dernier font foi. Du reste, l’erreur dans laquelle est tombé le Père Baron s’explique facilement par la commission de M. de Beaujeu.
M. Shea ignorait évidemment l’existence des lettres de MM. de Contrecœur et Dumas. Ses renseignements provenaient, d’ailleurs, comme il l’avoue lui-même ingénuement, d’une personne intéressée, c’est, en effet, à l’obligeance de l’honorable M. G. Saveuse de Beaujeu, de Montréal, qu’il les devait. Il procédait pour ainsi dire ex parte. L’on aperçoit bien le peu de solidité que présente son plaidoyer.
Quant aux preuves qu’apporte l’abbé Daniel à l’appui de sa thèse sur le même sujet, elles ne valent pas davantage. Il a, lui aussi, puisé ses arguments à la même source intéressée.
Voici ce que dit cet écrivain : « Quoiqu’on en ait dit et pensé jusqu’à présent, c’était M. de Beaujeu, et non M. de Contrecœur, qui commandait au fort Duquesne en 1755. C’est donc à lui, et à lui seul, que revient la gloire d’avoir triomphé de l’armée anglaise. Nous tenons à constater ce double point, afin de rectifier ce que nous avons avancé plus haut, sur la foi des autres.
« 1o M. de Beaujeu commandait seul au fort Duquesne. M. de Contrecœur ayant demandé, dans l’hiver précédent, son rappel, écrit une pieuse contemporaine, M. le marquis Duquesne avait envoyé M. de Beaujeu, capitaine, pour le relever, avec ordre toutefois à M. de Contrecœur de ne revenir qu’après l’expédition, supposé qu’on fut attaqué, comme on avait lieu de le croire. » « M. de Beaujeu qui commandait dans ce fort, lit-on dans un mémoire déposé aux Archives de la Marine, prévenu de la marche des ennemis et fort embarrassé, avec le peu de monde qu’il avait, de pouvoir empêcher ce siège, se détermina à aller au-devant. » — « Monseigneur, écrivait à son tour, au ministre des Colonies, Madame de Beaujeu, après la mort de son mari, j’espère que vous voudrez bien faire attention au malheur que je viens d’avoir de perdre mon mari. Il s’est sacrifié à la rivière de l’Ohio, dont M. le marquis Duquesne lui avait donné le commandement ce printemps ? Enfin, son acte de sépulture le déclare « Commandant au fort Duquesne. » Ce point nous paraît donc bien établi. Le second qui en découle, ne l’est pas moins ».
« II° C’est à M. de Beaujeu que revient la gloire d’avoir triomphé de l’armée anglaise, 1o C’est lui seul qui conçoit et exécute le dessein d’aller attaquer l’ennemi : « Il se détermina à aller au-devant, dit le Mémoire déjà cité ; il le proposa aux Sauvages qui étaient avec lui. » Parlant de son beau dévouement, sa tante, la Mère de la Nativité, écrit : « Le Seigneur nous a enlevé le cher de Beaujeu qui s’est exposé et a sacrifié sa vie pour le salut de la patrie. » 2o Lui seul commandait en chef : « Il avait sous lui, rapporte la pieuse Annaliste déjà mentionnée, « MM. Dumas et de Ligneris, et quelques officiers subalternes. » Elle ne dit pas un mot de M. de Contrecœur. 3 ° Enfin, lui seul décide du succès de la bataille, comme le prouve 1o son plan d’attaque si hardi et si habile, 2o sa bravoure à la tête des troupes, et 3o la vengeance que tirèrent les Sauvages de sa mort, en achevant la victoire.
« Suivant deux mémoires, il fut frappé à mort à la première décharge de l’ennemi ; d’après d’autres ce ne fut qu’à la troisième, lorsque l’action était déjà bien engagée ; « s’avançant au milieu des foudres et des feux, dit encore la même Annaliste, sa contemporaine, il tomba mort à la troisième décharge de l’ennemi. » De son côté, M. de Vaudreuil certifie que le chevalier de Beaujeu, capitaine d’infanterie du détachement de la Marine, a été tué le 9 juillet 1755, d’un coup de canon chargé à cartouche à la troisième décharge qu’il fit donner par les troupes et les Sauvages de la Colonie qu’il commandait. » Nous nous en sommes rapportés à ce dernier témoignage » dit en terminant l’abbé Daniel.
Examinons maintenant ces preuves. Quelle est cette pieuse contemporaine dont le dire a tant de poids auprès de l’abbé Daniel ? Nul ne le sait. Comment a-t-elle su ce qu’elle raconte ? Par ouï-dire, évidemment, car elle n’était certainement pas présente au fort lorsque fut décidée l’attaque et encore moins au combat. Ce témoignage n’a donc aucune valeur. On ne peut l’opposer à celui de MM. de Contrecœur et Dumas. Remarquons en passant que M. Daniel ne semble guère prêter d’attention aux mots suivants : avec ordre toutefois à M. de Contrecœur de ne revenir qu’après l’expédition. Que M. de Beaujeu ait été nommé pour relever M. de Contrecœur, c’est certain. Mais qu’il l’ait de fait relevé, rien ne le prouve ; au contraire, M. de Contrecœur avait l’ordre de ne quitter son poste qu’après l’attaque que l’on appréhendait. Est-il croyable qu’un officier de la trempe de M. de Contrecœur eût forfait à l’honneur en désobéissant à un ordre formel du gouverneur ? Non. Et n’est-ce pas ce qu’il faudrait conclure s’il eût cédé sa place avant la bataille ? Évidemment. Or rien n’autorise l’abbé Daniel à ternir ainsi la réputation de cet officier. Les documents cités au chapitre précédent prouvent le contraire, et toute la carrière de M. de Contrecœur donne un énergique démenti à l’imputation de l’abbé Daniel, voilée sans doute, mais explicite néanmoins. L’échafaudage si péniblement construit par cet historien tombe en pièces.
Madame de Beaujeu, sachant que son mari avait été désigné pour remplacer M. de Contrecœur » était de bonne foi. Mais sa lettre ne prouve tout au plus que M. de Beaujeu commandait la troupe envoyée pour rencontrer l’ennemi en chemin.
Quant au mémoire déposé aux archives de la Marine, c’est le document numéro 2 cité par M. Shea. Nous l’avons analysé plus haut.
La Mère de la Nativité ne fait que répéter ce qu’elle avait entendu dire, probablement par des membres de sa famille. Elle ne parle d’ailleurs aucunement du commandement du fort.
Enfin, l’abbé Daniel n’apporte aucune preuve que le plan d’attaque si hardi et si habile fût de M. de Beaujeu, plutôt que d’un autre.
Quant à la bravoure déployée par M. de Beaujeu, personne, que nous sachions, ne l’a jamais mise en doute. Elle demeure incontestée. Il ne s’agit nullement d’enlever la moindre parcelle du mérite de cet excellent officier qui avait d’ailleurs fait ses preuves auparavant, mais tout simplement de rétablir la vérité historique faussée, inconsciemment, nous en sommes convaincu, par ces deux historiens.
La lettre de M. de Vaudreuil, disant que M. de Beaujeu est tombé à la troisième décharge des ennemis, contient la vérité. Les Sauvages ont pu tirer vengeance de la mort de leur commandant, car ils l’aimaient, mais cela ne prouve rien au sujet du commandement du fort Duquesne.
Il ne faut pas oublier non plus que les pièces, produites par l’abbé Daniel, proviennent des papiers de M. G. Saveuse de Beaujeu, lequel était tout naturellement porté à se magnifier lui-même en exaltant un de ses parents.
En résumé, disons que les assertions de ces deux historiens ne sont pas justifiées par les faits, et qu’ils auraient été mieux inspirés en n’essayant pas de corriger l’erreur de leurs devanciers, sans se garantir une connaissance plus étendue et un examen plus approfondi des documents relatifs à cet important point d’histoire.
Nous ne leur en garderons toutefois pas rancune. Ils nous ont fourni l’occasion de rétablir les faits et de proclamer bien haut la gloire impérissable de M. Dumas, le véritable héros de la Monongahéla.
« La postérité, » dit Chateaubriand dans ses Mémoires d’Outre-tombe, « n’est pas aussi équitable dans ses arrêts qu’on le dit ; il y a des passions, des engouements, des erreurs de distance comme il y a des passions, des erreurs de proximité. » Cette assertion a été, jusqu’ici, applicable à l’histoire de notre héros. Elle ne devra plus l’être à l’avenir.
Après la victoire
Après le triomphe de la Monongahéla, M. Dumas, qui avait remplacé M. de Contrecœur dans le commendement du fort Duquesne, voulut poursuivre ses avantages. Ses premiers soins furent d’organiser des partis de Sauvages à la tête de plusieurs desquels il mit des officiers canadiens, et les lança sur les frontières ennemies qu’ils mirent à feu et à sang.
Depuis son arrivée au fort Duquesne, M. Dumas avait pris un grand ascendant sur les Sauvages de cette région, qu’il maniait à sa guise, et son prestige augmentait toujours ; il s’affermit surtout au lendemain de l’éclatant succès du 9 juillet qui avait frappé ces peuples d’admiration.
Les Loups (Delaware) et les Chaouanons (Shawanoes), anciens amis et alliés des Anglais, déterrèrent aussi la hache et se jetèrent dans une lutte à outrance contre leurs anciens amis. Les Mingoes ou Cinq Nations de l’Ohio, ainsi que nombre de tribus éloignées organisèrent des partis et tombèrent sur les malheureux colons de la Pennsylvanie, de la Virginie, du Maryland et de la Caroline. « The West rose like a nest of hornets, and swarmed in fury against the English frontier » dit M. Parkman ; et il ajoute : « Such was the consequence of the defeat of Braddock aided by the skilful devices of the French commander ».[27]
« Je n’ai pas été huit jours de temps » écrivait M. Dumas, « depuis le départ de monsr de Contrecœur, sans avoir à la fois six ou sept différents partis en campagne dans lesquels j’ai toujours mêlé des Français. Jusques ici, il nous en a coûté deux officiers et peu de soldats, mais les villages sont pleins de prisonniers de tout âge et de tout sexe ; l’ennemi a beaucoup plus perdu depuis la bataille qu’il ne fit le jour de sa défaite… »[28]
Au mois d’avril 1756, M. Douville attaque un fort en Virginie ; il est tué et ses gens sont repoussés. Plus heureux que lui, le 2 août suivant, le chevalier de Villiers, envoyé par M. Dumas, brûle le fort Granville,[29] situé sur la rive nord de la rivière Juanita, à soixante milles de Philadelphie.
Voici l’intéressant récit que fit M. le chevalier de Kerlérec, gouverneur de la Louisiane, de cette heureuse expédition.[30]
Monseigneur,
« J’ay l’honneur de vous rendre compte que le chevalier de Villiers, capitaine d’infanterie au service de cette colonie, détaché au poste des Illinois, et que j’avois commandé pour convoyer les secours de vivres que M. de Makarty a envoyé le printemps dernier à M. Dumas, commandant au fort Duquesne, s’est acquitté de cette mission avec toute la prudence et distinction possible.
« À peine cet officier eut-il remis à M. Dumas, en très bon ordre, les vivres dont il étoit chargé, qu’il désira aller en party sur les Anglois (la saison s’opposant qu’il se rendit aux Illinois), guidé, premièrement, par le désir de concourir à la gloire des armes du Roy, il fut en même temps charmé de profiter de toutes les occasions qui se présenteroient de venger la mort du sieur Jumonville, son frère, qui a été assassiné par les Anglois.
« Il partit donc du fort Duquesne avec un détachement de soixante hommes, François et Sauvages, avec des instructions du sieur Dumas, commandant de ce fort, pour aller en party du costé de celuy de Cumberland pour s’opposer aux communications qu’il pourrait y avoir d’un fort à l’autre.
« Après avoir parcouru soixante lieues du païs le plus ingrat, manquant de vivres et la maladie l’ayant attaqué, ainsi que la plus grande partie de son monde, sans exception de son guide, il a été obligé de relâcher au fort Duquesne après vingt-cinq jours de route.
« Il ne tarda pas à se rétablir et trouvant des forces dans un zèle ranimé par les obstacles, il pria M. Dumas de vouloir bien le renvoyer de nouveau en party, ce qui lui fut accordé.
« Le chevalier de Villiers repartit donc le 13 juillet avec vingt-deux François, pour aller au village d’Attiguer,[31] distant de quinze lieues du fort Duquesne) où il leva un party de trente-deux sauvages des nations Loups Chaouanons et Illinois, qui lui formèrent en total un détachement de cinquante-cinq hommes, avec lequel il partit de ce village le 17 du même mois, dans le dessein de se rendre au fort anglois George de Craon,[32] mais son guide s’étant trompé de route, il se trouva, le 30 à midy, à vue de celuy de Grandville, il découvrit trois hommes qu’il voulut cerner, mais en ayant été aperçu, ils s’enfuirent dans le fort malgré quelques coups de fusils qui furent tirés.
« Cet officier se campa à la portée du fusil du fort, qui fit sur sa troupe un feu très vif de mousqueterie et de deux pièces de canon, auquel il répondit de son mieux. Ce feu dura de part et d’autre jusqu’à la nuit, que le sieur de Villiers se rapprochant le fit investir par la majeure partie de son monde et occupa l’autre pendant une grande partie de la nuit à faire des amas de bois sec qu’il fit transporter par le moyen d’une coulée qui le conduisoit à vingt pieds dudit fort Grandville et d’amas en amas, ils placèrent la valeur de quatre cordes de ce bois jusqu’au pied d’un bastion qui les mettaient à couvert du feu de l’ennemy, ils y mirent le feu et favorisé par le vent, ce bastion fut aussitôt incendié, malgré tous les efforts que firent les assiégés pour l’éteindre, efforts qui ne pouvoient guère avoir du succès par la prudence avec laquelle le chevalier de Villiers avoit placé son monde pour soutenir les siens et faire cesser la mousqueterie de l’ennemy.
« Cet incendie ayant fait brèche, le sieur de Villiers se préparoit au jour à foncer la bayonnette au bout du fusil, mais le commandant de ce fort, deux officiers et six soldats ayant été tués, le reste de la garnison a ouvert les portes et s’est rendue à discrétion du vainqueur qui en a usé avec toute la modération praticable avec des auxiliaires sauvages, qui vouloient en brûler quelques-uns, mais ses harangues ont été si pathétiques qu’il a sauvé la vie à trente soldats, trois femmes et sept enfants, qui se sont trouvés dans le fort et qu’il a conduit le 12 aoust au fort Duquesne aux ordres de M. Dumas, après avoir incendié le fort et tout ce qui en dépend, ainsi que beaucoup de farine, encloué deux pièces de canons et partagé la poudre, qui s’est trouvée en petite quantité, à ses sauvages et à sa troupe.
« Voilà Monseigneur, le détail circonstancié de cette affaire et je crois devoir vous représenter qu’il est de l’intérest essentiel du service que cet officier reçoive quelque marque de satisfaction du Roy. Je vous supplie donc, Monseigneur, de luy procurer la croix de Saint-Louis ; cette grâce fera un effet sensible dans le militaire qui est confié à mes ordres, j’ose même vous dire qu’elle est nécessaire, surtout dans la dépendance des Illinois, où le service est on ne peut pas plus dur, et il est bon que ces Messieurs apprennent par épreuve que si le travail est grand, la récompense du monarque est toujours proportionnée… »
Des lettres du fort Duquesne rapportaient que la Pennsylvanie levait 2000 hommes, et la Virginie et le Maryland, 3000, pour aider aux cultivateurs à rentrer la récolte. On ajoutait que M. Dumas, ayant formé le dessein d’aller détruire le fort Cumberland, avait envoyé un parti pour en faire la reconnaissance.[33] Il avait, en effet, résolu de brûler ce poste. Mais M. Le Mercier ne lui ayant envoyé ni soufre ni salpêtre, malgré les ordres formels du gouverneur, l’entreprise dut être abandonnée. Ce fort était situé au pied des montagnes à environ 70 lieues de la côte et à 80 du fort Duquesne.
Le 9 septembre suivant, M. Dumas écrivant à M. de Vaudreuil, rapporte que Attigué (Kittaning des Anglais) fut attaqué par le colonel Washington à la tête de 300 ou 400 hommes. Cette attaque fut repoussée, dit-il. D’après M. Parkman, les choses se passèrent différemment. L’expédition contre Attigué était sous les ordres du colonel John Armstrong, un colon de Cumberland, et elle obtint un succès complet, détruisant le fort et ramenant plusieurs prisonniers.[34] Puis, ayant donné la version de M. Dumas, il ajoute : « Like other officers of the day, he would admit nothing but successes in the department under his command ».
Vers la fin de l’année 1756, M. Dumas, exténué par ces rudes labeurs, demanda d’être relevé de son commandement afin de prendre un repos si bien mérité. Ce repos lui fut accordé et il descendit à Montréal où on le retrouve le 13 décembre, assistant à une grande conférence que tenait M. de Vaudreuil avec les Sauvages.[35]
Année 1757
Son repos ne fut cependant pas de longue durée. De bonne heure en 1757, il prenait part à l’expédition de M. Rigaud de Vaudreuil contre le fort William-Henry.
Parti du fort Saint-Jean le 23 février, le détachement arrivait à Carillon au commencement du mois de mars et s’y reposait huit jours. Ayant reçu du renfort, la colonne, forte maintenant d’environ 1500 hommes, traversa le lac Saint-Sacrement et, après une marche de soixante lieues, arriva en vue du fort ennemi le 18 au soir. M. Dumas fut chargé de reconnaître les forces de la place. La garnison étant sur ses gardes, on se contenta de brûler tout ce qui entourait le fort, y compris trois cent cinquante petits bateaux, quatre brigantins de dix à quatorze canons, les moulins, les magasins et les maisons ; puis, ayant jugé qu’il était impossible d’enlever le fort d’emblée, et n’ayant point d’artillerie pour en faire le siège, M. Rigaud donna l’ordre du retour.[36] Il avait préparé les voies et facilité la tâche du marquis de Montcalm qui devait s’emparer de ce fort l’été suivant.
Le 1er mai, le capitaine Dumas était promu major de Québec. La lettre suivante du ministre de la Marine accompagnait sa commission. On remarquera que le ministre a toujours présent à la mémoire le combat de la Monongahéla :
À M. Dumas,
« M. le Mis de Vaudreuil ayant proposé, Monsieur, de vous destiner pour la majorité de Québec, le Roy s’est d’autant plus volontiers déterminé à vous donner cette destination, qu’elle est une nouvelle preuve de la satisfaction que Sa Majesté ressent des services que vous lui avés rendus, particulièrement dans le combat contre le général Braddock et dans le commandement du fort Duquesne. Je suis persuadé que vous remplirés les détails de la majorité de manière à mériter d’autres grâces. Et je serai toujours bien aise de pouvoir vous en procurer. »
M. Dumas organisa et disciplina les milices canadiennes qu’il mit sur un pied effectif, comme l’atteste la lettre du chevalier de Lévis[37].
Il ne devait pas toutefois jouir longtemps de ce demi-repos. Le 19 juillet de cette année, il était de nouveau adjoint à M. Rigaud de Vaudreuil qui avait mission d’organiser au portage le bataillon de la Marine, ce bataillon devait être formé de huit compagnies de 60 hommes chacune, de la compagnie indépendante de Villiers forte de 300 hommes, et de six brigades de milice, composées de 450 Canadiens : le marquis de Montcalm préparait son attaque sur le fort William-Henry dont il s’empara le 9 du mois suivant.
Jusque-là, les Canadiens, habitués à se battre à la manière des Sauvages, c’est-à-dire, en se tenant à couvert, ne prisaient guère la discipline européenne, laquelle d’ailleurs, ne convenait pas toujours aux combats qu’on se livrait dans le pays. C’est ce que les commandants français ne semblent pas avoir toujours compris. Ils affectaient même de dédaigner les milices qui combattaient de cette manière, laquelle a pourtant valu de nombreux succès aux Canadiens. M. Dumas n’en eut donc que plus de mérite d’avoir réussi à les façonner à l’image des troupes régulières.
Dès que cet officier eut instruit et exercé les milices canadiennes, qu’il les eut initiées à la discipline européenne et les eut formées en compagnies et en brigades, elles combattirent comme les Français et se montrèrent tout aussi braves, tout aussi fermes dans le combat. De fait, ce furent les milices canadiennes conduites par M. Dumas qui furent les dernières à quitter le terrain lors de la bataille des Plaines d’Abraham.
Dans une lettre écrite à M. de Moras, le 10 octobre 1757, le chevalier de Lévis recommandait chaudement M. Dumas, en raison de ses états de services, tant en Canada que sur l’Ohio.
« À Monsieur de Moras,
« Permettez-moi de vous supplier de vouloir bien accorder vos bontés et votre protection à M. Dumas, capitaine des troupes de cette colonie. Il a fait la dernière campagne sous mes ordres et sous ceux de M. de Rigaud de Vaudreuil, il a fait les fonctions de major et a eu le détail de toutes les milices qui ont été mises pour la première fois par brigades. C’est lui qui en a fait l’arrangement, qui lui a donné beaucoup de peines et de travail assidu. Les milices, qui jusqu’alors ne connoissoient pas l’ordre et la discipline ont servi comme les troupes réglées. Nous nous sommes si bien trouvés de cette formation qu’à l’avenir on en usera toujours de même ; mais il seroit à souhaiter pour le bien du service que M. Dumas en eût continuellement le détail. Ayant servi en France, il connoit mieux qu’un autre l’ordre et la police qui est absolument nécessaire parmi les gens de guerre. C’est un officier de distinction, qui a toutes les qualités qu’on peut désirer. J’ose vous assurer qu’il est très capable de se bien acquitter de tous les emplois dont vous voudrez bien le charger. Je ne puis vous en rendre d’assez bons témoignages. M. le marquis de Vaudreuil ne vous laissera pas ignorer ce qu’il mérite, et ce qu’il pense sur son compte. Ses services doivent d’ailleurs vous être connus assez, puisque c’est lui qui commandoit à l’affaire de la Belle-Rivière à la défaite du général Braddock ; c’est cette heureuse journée qui a mis le Canada à l’abri des premières incursions des Anglois. Je ne sais quelle grâce vous demandera M. le marquis de Vaudreuil pour M. Dumas ; toutes celles que vous voudrez bien lui accorder seront bien placées. En mon particulier, je serois bien flatté si la recommendation que j’ay l’honneur de vous en faire et les témoignages que je me crois obligé devoir vous rendre de ses services de la campagne dernière, pouvoient les lui procurer ; je vous en aurois une grande obligation. »
On ne saurait être à la fois plus gracieux et plus juste. L’estime et l’amitié du chevalier de Lévis étaient faveurs précieuses qu’il faisait bon mériter.
Année 1758
L’année 1758 s’ouvrait au Canada sous des auspices à la fois heureux et inquiétants. L’avantage de la campagne de l’année précédente était, certes, demeuré aux Français ; mais l’avenir s’annonçait sombre à cause de la famine qui sévissait dans le pays. Les récoltes n’avaient presque rien produit, et les secours en vivres attendus de France n’arrivaient pas. On savait de plus que l’Angleterre organisait des préparatifs formidables en vue de la prochaine campagne, et qu’elle disposerait de forces bien supérieures en nombre à celles de l’année précédente.
De plus, des lettres du fort Duquesne indiquaient que l’ennemi faisait de grands efforts pour détacher les Sauvages des Français. « Le commandant actuel du fort Duquesne ne paraît pas réussir aussi bien avec eux que son prédécesseur » (M. Dumas), écrivait le marquis de Montcalm.[38] Il y avait donc lieu d’être inquiet et de craindre l’avenir qui s’annonçait sous de sombres pronostics.
M. Dumas, à qui on avait demandé son avis sur la défense du fort Duquesne, avait répondu que ce poste ne pouvait que déshonorer l’officier qui serait chargé de la défendre.[39] Aussi M. de Ligneris, qui avait succédé à M. Dumas comme commandant de ce fort, ayant appris, le 23 novembre, que le brigadier général Forbes marchait contre lui à la tête de 2500 hommes, et en ayant à peine 400 à lui opposer, fit sauter le fort et se retira à celui de Machault.[40]
M. de Vaudreuil n’avait pu donner suite à son projet de reconstruire le fort Duquesne, quoique son plan eût reçu l’approbation du Ministre. Le 14 février 1758, celui-ci lui avait, en effet, écrit ce qui suit : « Il est fâcheux que lorsqu’on a construit le fort Duquesne on ne l’ait pas mieux placé, qu’on l’ait fait trop petit, et qu’on ne l’ait pas tout d’un coup mis en état de défense. Je sens combien il est important d’avoir là un fort qui puisse arrêter les Anglois, j’approuverai donc que vous suiviez votre idée, et que vous fassiez exécuter les ouvrages que vous jugerez nécessaires pour la défense de cette partie. Je vous recommande seulement de le faire avec toute l’économie possible, et de manière cependant que ces ouvrages ne deviennent pas inutiles par la suite, et que les dépenses qu’ils occasionneront ne soient pas perdues, comme cela est arrivé plusieurs fois, depuis qu’on a multiplié les forts dans la Colonie ».
M. Dumas ne prit point une part active à la campagne de cette année. Il continua de s’occuper avec un soin attentif et persévérant de l’organisation et de l’instruction des milices, dont le concours devenait de plus en plus important et précieux, dans la lutte acharnée que se livraient les deux nations rivales pour la possession du continent américain. Le chevalier de Lévis fut si content de lui qu’il proposa au Ministre d’étendre ses pouvoirs et de lui confier l’entière direction des milices de toute la colonie.
Cette vie de garnison, toujours uniforme, n’offre aucun fait digne de mention. La routine du service remplissait la plus grande partie de son temps. Un événement, religieux ou social, venait de temps à autre en rompre un peu la monotonie.
La campagne de 1758 avait été désastreuse pour les armes françaises, malgré le brillant exploit de Montcalm à Carillon, lequel n’avait été, pour ainsi dire, qu’une immense lueur éclairant un moment, d’un jour sinistre, les ténèbres de l’adversité qui avait poursuivi les armes de la France dans le cours de cette année en Amérique, et qui devait atteindre son apogée deux ans plus tard par la perte de plus des trois quarts d’un vaste continent.
Année 1759
L’année 1759 s’annonçait donc terrible. Malgré les pressantes sollicitations de MM. de Bougainville et Doreil, les ministres ne firent presque rien,[41] et la colonie pressurée par l’infâme Bigot et son abominable clique, était aux abois. Il est vrai que les ministres voulurent tenter une diversion en organisant une descente en Angleterre, en Écosse et en Irlande ; mais elle échoua misérablement grâce à l’espionnage, au début même de son exécution. Le Havre bombardé, l’amiral Laclue défait par l’amiral Boscawen et la destruction de la flotte du comte de Conflans fuyant devant celle de l’amiral Hawke, mirent à néant le projet audacieux des ministres.
Le chevalier de Lévis cependant, ne semblait pas avoir perdu tout espoir. « Quoiqu’il paroisse que nous allons être vivement attaqués, » écrivait-il, « je ne crains pas que les ennemis puissent nous réduire dans une seule campagne. Nous devons tout attendre de la valeur des troupes, de la bonne volonté des Canadiens et de la bonne disposition où les sauvages sont à notre égard. »[42] Il était bon prophète. L’entreprise exigea deux campagnes.
Voulant concilier les esprits et rétablir la concorde dans la colonie, le roi avait distribué quelques croix de Saint-Louis et fait des promotions dans l’armée, ainsi que dans les troupes de la Marine. Parmi ces dernières, une des mieux méritées était certainement celle qui fut accordée à M. Dumas. Le 1er janvier le roi l’avait, en effet, nommé major général inspecteur des troupes de la Marine en Canada,[43] ce qui lui donnait le rang, sinon le titre, de colonel.[44]
La lettre suivante, adressée au marquis de Vaudreuil par le Président du Conseil de Marine, accompagnait le brevet officiel :
« Monsieur,
« Vous avez été informé l’année dernière, que le Roi n’avoit suspendu de remplir les places
vacantes dans le militaire de Canada que parce que, d’un côté, elles étoient en petit nombre et que de l’autre il convenoit d’en réserver quelqu’une pour récompenser les actions d’éclat qui pourraient mériter des grâces extraordinaires. Les actions de détail, et surtout la journée du 8 juillet ont confirmé Sa Majesté dans la bonne opinion qu’Elle avoit conçue et des troupes qu’Elle a fait passer de France et de celles qu’Elle entretient dans la Colonie. Sa Majesté a vu avec plaisir le fort que les compagnies de Canada ont eue à cette affaire. Vous verrés par la promotion que je joins ici des marques certaines de la satisfaction et de la confiance qu’Elle a dans les propositions que vous avés faites pour les officiers.
Sa Majesté a bien voulu, sur les représentations que vous avés faites, créer un major général inspecteur des troupes et trois aide majors pour en placer un dans chacune des trois villes de la Colonie. La majorité a été accordée au sieur Dumas et les aide majorités aux sieurs de Meloise avec le grade de capitaine à Québec, de Charly à Montréal avec le grade de lieutenant, et aux Trois-Rivières le sieur de Longueuil le fils avec le même grade de lieutenant. »
Comme on le voit, les mérites de M. Dumas étaient hautement reconnus par le roi qui avait créé expressément pour lui un grade nouveau : le plus haut que pût atteindre un officier dans les troupes de la colonie. Les recommandations de MM. de Vaudreuil et de Lévis avaient porté leurs fruits. Aussi M. Dumas devait-il reconnaître leur bienveillance à son égard, et se rendre digne de nouvelles faveurs, en remplissant avec zèle et habileté les nouvelles fonctions dont le roi venait de l’honorer. Les événements lui en fournirent bientôt l’occasion.
Défense de Québec
L’année 1759 s’annonçait redoutable ; elle fut plus que cela ; elle fut fatale. La chute de la capitale de la Nouvelle-France termina une série de défaites inévitables : l’ennemi était partout beaucoup plus considérable en nombre, mieux armé et mieux nourri.
L’Angleterre a toujours pratiqué la maxime qui veut que la victoire aille aux gros bataillons.
M. Dumas prit une part très active à la défense de Québec. Durant cette campagne et la suivante, il sut encore se distinguer et reçut à maintes reprises, comme on l’a vu plus haut, des témoignages bien mérités de satisfaction de la part de ses chefs.
Le 28 juin M. Dumas recevait ordre du marquis de Montcalm d’organiser en compagnies tous les miliciens en état de porter les armes et de mettre à leur tête des officiers de milice ou des bourgeois notables, en attendant qu’on pût les remplacer par des officiers plus expérimentés. M. Dumas s’acquitta consciencieusement de cette tâche ardue.
M. de Vaudreuil ayant décidé, à la demande des marchands de la basse-ville de Québec, d’envoyer un détachement à la Pointe-Lévis pour tâcher de réduire au silence les batteries ennemies qui menaçaient de détruire cette partie de la ville, chargea M. Dumas de ce service. Le détachement qu’il commandait était composé de 150 soldats, de quelques hommes des troupes de la colonie, d’environ 300 Canadiens du camp de Beauport, d’un bon nombre de miliciens de la ville, et d’un groupe de trente élèves du Séminaire que l’on avait en badinant baptisé le Royal Syntaxe. Tous s’étaient offerts volontairement. M. Dumas conduisit cette troupe hétérogène au Cap-Rouge, d’où il traversa le fleuve durant la nuit du 12 au 13, afin de surprendre l’ennemi à la pointe du jour. Ayant divisé sa troupe en deux colonnes, la première prit les devants. S’étant égarée dans un petit bois, elle rebroussa chemin sans s’en apercevoir, et, dans la demi-obscurité, elle rencontra la seconde colonne dont faisaient partie les élèves du Séminaire. Celle-ci se croyant en face de l’ennemi, fit feu sur la première qui riposta aussitôt. Cette méprise rendit ces troupes nerveuses et la panique s’étant emparée d’elles, ce fut un sauve-qui-peut général vers les chaloupes. M. Dumas, malgré toute son expérience et son énergie, n’y put rien et dut se rembarquer, ramenant à Québec le détachement tout piteux de cette mésaventure.
Après cette malheureuse affaire de la Pointe-Lévis, M. Dumas fut mis à la tête d’un camp volant destiné à suivre les mouvements que pourrait faire l’ennemi au-dessus de Québec et à s’opposer à toute descente qu’il pourrait y tenter. Allant, venant, contre-marchant avec ses miliciens, il couvrait tous les points à la fois, et fut d’un grand secours à l’armée de défense.
Durant la nuit du 18 au 19 juillet, des vaisseaux anglais ayant remonté le fleuve, M. Dumas fut envoyé à Sillery avec 600 hommes d’infanterie et de la cavalerie pour les observer.
« Le 21, vingt berges débarquèrent à la pointe aux Trembles, au petit jour ; quelqu’actif que fut M. Dumas, il ne put y arriver assés tôt. Les Anglois enlevèrent environ 200 femmes, filles ou enfants qu’ils me renvoyèrent le lendemain… » [45]
Le 25, M. de Vaudreuil ayant été informé que les Anglais avaient opéré un débarquement à l’anse Saint-Michel, avertit M. Dumas qui laissa M. de Saint-Martin au Cap-Rouge avec 180 hommes et en mena mille jusqu’à Jacques-Cartier pour empêcher l’ennemi de s’y retrancher ; mais celui-ci s’était rembarqué.
Le 3 août, l’ennemi continuant de renforcer son artillerie au camp de la chute Montmorency, M. Dumas y amena la plus grande partie des troupes qu’il avait à Jacques-Cartier, ne laissant que 200 hommes à cet endroit. M. de Bougainville prit alors en mains le commandement des forces au-dessus de la ville, et M. Dumas resta à Québec, et prit part à la bataille des Plaines d’Abraham où il commanda l’aile droite.
Les jours et les semaines se passaient et le siège n’avançait guère. Le plan de défense du marquis de Montcalm consistait, non pas à risquer une grande bataille, mais à gagner du temps. La fin de l’été approchait ; s’il pouvait tenir jusqu’à l’automne, Québec était sauvé — pour cette année du moins — et au printemps suivant il pourrait recevoir des renforts en hommes et en vivres dont il avait un urgent besoin.
Il ne s’agit point ici de raconter ce siège célèbre, non plus que les péripéties de la bataille des Plaines d’Abraham. Ce récit a été fait et bien fait.[46] Nous nous contenterons tout simplement de dire que le marquis de Vaudreuil, après la retraite des troupes du marquis de Montcalm, rassembla de 1 000 à 1 200 hommes, « qui revinrent sur la hauteur, où ils fusillèrent longtemps. Il ne fallut rien moins pour favoriser la retraite de la droite de notre armée commandée par M. Dumas, qui étoit encore aux prises et qui avoit fait plier jusqu’à trois fois la gauche des ennemis ».[47]
Après la bataille
Après la bataille, M. de Vaudreuil tint un conseil de guerre dont M. Dumas fit partie. Le marquis de Montcalm, mourant, avait suggéré trois expédients : un nouveau combat, la retraite sur Jacques-Cartier, ou la reddition de Québec. Le conseil décida en faveur de la retraite que l’on commença immédiatement.[48]
Un fort érigé à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier, dix lieues en haut de Québec, servit de retraite et de point d’appui aux troupes de la Pointe-aux-Trembles, et protégea la colonie contre les tentatives de la garnison de Québec. M. Dumas fut désigné par le marquis de Vaudreuil pour commander ce poste et pour garder toute cette frontière durant l’hiver.[49]
On voit par la correspondance assez volumineuse échangée entre MM. de Vaudreuil, de Lévis et Dumas, que ce dernier s’acquitta avec zèle et intelligence de ses fonctions qui consistaient à préparer ce qu’il fallait pour faire le siège de Québec le printemps suivant, tout en surveillant de près les moindres mouvements de la garnison anglaise de la ville. Il écrivait presque tous les jours, soit au marquis de Vaudreuil, soit au chevalier de Lévis, et rendait un compte détaillé de tout ce qui se passait à son camp et sur toute la frontière confiée à ses soins. Il entretenait des rapports suivis avec les habitants de la ville de Québec, avec ceux de l’île d’Orléans, et se tenait aussi au courant de ce qui se faisait sur la rive sud du fleuve. En un mot, il veillait à tout ; rien n’échappait à sa prévoyance. Nous croyons devoir répéter ici que toutes les mesures prises ou proposées par M. Dumas, durant l’hiver de 1759-1760, furent pleinement approuvées par MM. de Lévis et de Vaudreuil.
Au mois de mars le général James Murray parut sortir de sa torpeur, et commença d’envoyer des partis à droite et à gauche, afin d’obtenir des renseignements sur ce que faisaient les Français et tâcher de découvrir leurs desseins. Il y eut plusieurs escarmouches. Le 23 de ce mois, M. Dumas avertissait M. de Vaudreuil que l’ennemi marchait par les bois pour le tourner. Il redoubla de surveillance et n’eut de repos, ni le jour ni la nuit. Cependant le froid devint très vif vers la fin du mois et força le général anglais à retirer ses troupes. M. Dumas craignait le dégel et la réouverture de la navigation « qui fournira bientôt, disait-il, de nouveaux moyens à l’ennemi ».
Le mois d’avril était commencé. M. Dumas poussa activement les travaux qui avaient été plus ou moins retardés par les fréquentes alertes venant des mouvements de l’ennemi. Enfin il apprit que le chevalier de Lévis allait bientôt quitter Montréal pour marcher sur Québec. Celui-ci, en effet, se mit en route le 17 avril, et après dix jours de marche, il arrivait à Sainte-Foy, où il livrait le lendemain combat au général Murray, sorti de Québec pour le rencontrer. Ayant remporté une brillante victoire sur son adversaire qui se réfugia derrière les remparts de la capitale, le chevalier de Lévis commença aussitôt les travaux du siège. Mais on sait que l’arrivée de la flotte anglaise le força bientôt à battre en retraite. Il se retira alors et s’en retourna à Montréal, laissant à M. Dumas, qui avait été légèrement blessé au combat du 28,[50] le soin de diriger la retraite vers cette ville. Celui-ci alla se poster à la Pointe-aux-Trembles pour surveiller le fleuve et empêcher le général Murray de le remonter. Il était encore à cet endroit au commencement de juillet.
Cependant l’armée anglaise forte de 2 200 hommes avait quitté Québec et montait le long des deux rives et par le fleuve. M. Dumas reculait pas à pas vers le Cap-Santé, puis Deschambault, Batiscan et Trois-Rivières. Au commencement du mois d’août, l’ennemi était rendu à Sorel où M. de Bourlamaque s’était retranché. M. Dumas était toujours sur la rive nord. Tous deux avaient ordre de se tenir constamment à la hauteur de la flotte. Enfin, le 28, l’avant-garde de cette dernière jetait l’ancre devant la Pointe-aux-Trembles de Montréal. À deux heures de l’après-midi on apercevait le détachement de M. Dumas sur l’île de Montréal, en face des Anglais ; il ne les avait point perdus de vue un moment : il avait suivi ses instructions à la lettre.
Peu après le général Amherst, commandant en chef des forces anglaises en Amérique, arrivait à Montréal où s’étaient concentrées ses armées. Le 8 septembre M. de Vaudreuil capitulait, et la Nouvelle-France passait aux mains des Anglais.
M. Dumas s’embarquait quelques jours plus tard pour la France.
« Et notre vieux drapeau, trempé de pleurs amers,
Ferma son aile blanche… et repassa les mers. »
Sa carrière
après son départ du canada
De retour dans sa patrie, M. Dumas dut respirer avec délices l’air de Paris. Quelle joie ! quelle sensation de bien-être et de repos il dut éprouver après dix ans de campagnes au Canada, la plus grande partie du temps passée dans les bois, aux confins de la civilisation !
Cette joie dût être néanmoins tempérée par la pensée du sort malheureux de la colonie à la défense de laquelle il avait si vaillamment contribué et par l’abaissement auquel fut réduite sa patrie par le funeste traité de 1763.
M. Dumas, toutefois, n’était pas homme à rester longtemps inactif. Peu de temps après son arrivée, il fut invité par l’administration à exposer ses vues sur la question des limites du Canada. Il prépara un mémoire — qui paraît avoir été écrit à Paris — pour l’instruction, croit-on, du plénipotentiaire français désigné pour conduire les négociations en vue d’un traité de paix prochain.[51] Ce manuscrit porte la date du 5 avril 1761.
Cette même année M. Dumas était promu colonel d’infanterie dans l’armée de terre. Voici le magnifique éloge que lui décernait le ministre de la Marine en le proposant à M. le duc de Choiseul, pour une promotion qu’il n’était pas au pouvoir du premier de faire.
« M. Dumas, Monsieur, major général inspecteur des troupes de la marine au Canada après avoir rempli avec distinction toutes les fonctions de cette place et avoir commandé en cette qualité une brigade, m’a demandé un avancement que je suis hors d’état de lui procurer. Il a obtenu dans les différens grades subalternes par où il a passé les grâces dont son état étoit susceptible ; mais parvenu au point où il pourrait obtenir les grades de colonel et de brigadier dans le service de terre, il n’y en a aucun d’équivalent dans les troupes au service de la Marine que je puisse lui procurer. Dans cette situation il m’a prié de vous le recommander pour lui obtenir un grade qui ne peut dépendre que de votre ministère. Je souhaite, Monsieur, que les bons témoignages que j’ai à vous rendre de ses services au Canada puissent y contribuer : ils sont tels qu’on peut les désirer d’un officier rempli de bravoure, de talens et d’expérience et qui a par devers lui des actions remarquables dont M. le chevalier de Lévis pourra vous rendre un compte particulier.
J’ai l’honneur d’être, etc. »
À peine de retour en France, M. Dumas était devenu un personnage en vue. Sa réputation l’y avait précédé. Dès le mois de décembre 1760, le ministre de la Marine s’adressait à lui pour avoir des renseignements sur certains officiers et sur certains soldats qui avaient servi dans la colonie. En mars et en avril 1762, le même ministre avait de nouveau recours à ses lumières au sujet de quelques officiers qui sollicitaient des grâces du roi.
Si M. Dumas se berçait alors de l’espoir de retourner au Canada, il dut être profondément déçu, lorsque fut signé le traité de Paris, le 10 février 1763. Toutefois, la louable ambition qu’il nourrissait depuis longtemps, d’être utile à son pays dans une position plus élevée, devait se réaliser quelques années plus tard dans une autre partie du globe.
Le 6 mai 1765, le ministre de la Marine écrivait que, vu le zèle et l’intelligence avec lesquels il avait servi au Canada, le roi avait jugé à propos de le nommer commandant en second à Saint-Domingue, en remplacement de M. le comte de Choranc repassé en France, avec les mêmes appointements dont jouissait ce dernier. Sa nomination datait du 1er avril de cette année. Il lui ferait passer incessamment, ajoutait-il, les ordres de Sa Majesté sur le temps où il devrait être rendu à sa nouvelle destination.
Le colonel Dumas habitait à cette époque chez Madame la comtesse de Saint-Jean, rue des Moulins, Butte Saint-Roch, à Paris.
Le 4 août 1767, le ministre de la Marine envoyait à M. de Fontanieu la lettre suivante au sujet du papier monnaie du Canada de M. Dumas et, incidemment, de sa promotion.
« Le sieur Dumas, colonel d’infanterie est, Monsieur, un officier qui a bien mérité du gouvernement par la manière distinguée dont il a servi dans la guerre du Canada et par l’honnêteté de sa conduite au milieu des abus et des déprédations, il paroit que ses affaires ont été très dérangées par l’arrêt qui a réduit les papiers de cette Colonie, et il a réclamé la faveur de l’exception ouverte par l’article 7 par un mémoire qu’il a présenté à la Commission. Si Mrs les Commissaires trouvent ces représentations justes, je l’apprendrai avec plaisir vu la circonstance particulière où se trouve Mr Dumas que le Roy a nommé pour commander aux Isles de France et de Bourbon et qui doit partir incessamment pour se rendre à sa destination.
J’ai l’honneur d’être, etc. »
Nous aimons à croire que la recommandation bienveillante du Ministre valut à M. Dumas quelques égards de la part du président de la commission chargée du règlement de l’affaire épineuse du papier-monnaie du Canada.
L’île de France, ou l’île Maurice, aujourd’hui possession anglaise, étant passée le 14 juillet 1767 des mains de la Compagnie des Indes Orientales, qui la détenait depuis 1715, dans celles du roi, celui-ci, comme on vient de le voir, avait nommé dès le 17 juillet, le colonel Dumas gouverneur général de cette colonie ainsi que de l’île Bourbon et de leurs dépendances. Le nouveau gouverneur et M. Pierre Poivre, nommé intendant de ces îles, prirent possession de leur gouvernement le 5 novembre suivant.[53]
L’île de France appartient au groupe des Mascareignes. Elle est coupée par le degré de latitude 20° 15 sud, et le 57° 30 de longitude est (méridien de Greenwich). Port-Louis en est la capitale. Sa surface est accidentée. Le sucre est le principal article d’exportation. L’île Maurice, avec ses dépendances, Rodrigues, Seychelles, et Diégo Gracia, est une colonie anglaise. Les habitants sont des Hindous, des races mixtes et des Européens d’origines française et anglaise. Elle fut découverte par les Portugais en 1505. De 1598 à 1710, elle appartint aux Hollandais. Les Français en prirent possession en 1715. Elle fut conquise par les Anglais en 1810. Cette île a été le théâtre d’épidémies, et de violents ouragans l’ont à diverses reprises dévastée. Sa superficie est de 705 milles carrés, et sa population était en 1891, de 371,655.[54]
« Bien petite cette île Maurice, » dit M. Jules Leclercq,[55] « auprès de sa grande voisine Madagascar, qui la contiendrait trois cents fois. Mais c’est la reine de l’Océan Indien. C’est la perle dépeinte par le pinceau divin de Bernardin de Saint-Pierre. C’est l’île qui fut l’île de France, la colonie autrefois la plus française par le cœur comme par le nom qu’elle portait, par la bravoure de ses habitants comme par la langue qu’elle parle encore après quatre-vingts ans de domination anglaise. »
Ne dirait-on pas vraiment que les dernières remarques de M. Leclercq s’adressent au Canada, qui fut autrefois la Nouvelle-France, où plus de deux millions et demi d’habitants ont conservé avec un soin jaloux le parler des ancêtres — encore mieux qu’à l’île Maurice, car il n’y a pas de patois au Canada — malgré une séparation de plus de cent cinquante ans !
« Sous la Couronne de France, ajoute M. Leclercq, un changement radical s’opère dans le gouvernement de l’île. Dumas est envoyé, en 1767, comme gouverneur et Poivre comme intendant et commissaire-général de la Marine. La législation est codifiée, le conseil supérieur est réformé et devient un corps législatif et judiciaire, les fonctions publiques sont attribuées de préférence aux colons nés dans le pays. »
On voit par ce qui précède que le mode de gouvernement de l’île de France était sensiblement le même qu’en la Nouvelle-France.
Quelle part le colonel Dumas prit-il à l’établissement du gouvernement royal à l’île de France ? C’est ce que nous ne pouvons préciser en l’absence de la correspondance qu’il échangeait avec le ministre de la Marine.
Il n’eut cependant guère le temps de faire valoir ses qualités administratives. Ce qui était plus d’une fois arrivé au Canada devait se produire à l’île de France. Il y eut conflit d’autorité entre le gouverneur et le conseil. M. Dumas paraît avoir suivi l’exemple de Frontenac en congédiant, et même en déportant un des conseillers à l’île Rodriguez. Le conseil supérieur ne manqua pas de protester contre cet acte de rigueur. Le gouverneur fut blâmé par le roi et rappelé en France. Ses successeurs n’eurent presque plus rien à faire dans la conduite des affaires des deux colonies ; il ne leur resta guère que le commandement militaire. L’intendant eut la gérance des finances, l’imposition des taxes, la direction de l’agriculture, du commerce, de la justice et de la police.
Le 29 novembre 1768, M. Steinauer, brigadier des armées du roi, remplaçait M. Dumas, en qualité de commandant général des deux îles ; c’est-à-dire qu’il gouvernait par intérim. Le nouveau gouverneur général de ces colonies, M. le chevalier Des Roches, chef d’escadre, n’entra en fonctions que le 7 juin 1769.[56]
Lors de son retour du Canada en 1760, le roi avait accordé à M. Dumas un traitement de 1200 livres.[57] Devenu gouverneur des îles de France et de Bourbon, son traitement fut porté à 2000 livres.[58] Le 12 décembre 1774, le ministre de la Marine lui écrivait que le roi avait bien voulu consentir au rétablissement du traitement de 1200 livres. Il y avait même ajouté une gratification extraordinaire de 6000 livres, pour lui témoigner qu’il n’avait gardé aucune mauvaise impression de son rappel de l’île de France.
Comme nous l’avons vu en commençant, M. Bibaud prétend que : « Ayant émigré après la capitulation générale qui eut lieu, il devint participant des victoires du fameux bailli de Suffren. » Nous ne savons où cet historien a puisé ce renseignement.
Le bailli de Suffren était marin, M. Dumas ne l’était pas. De plus, les victoires célèbres du bailli eurent lieu, en Amérique, durant la Révolution américaine, et aux Indes, de 1782 à 1784, alors que M. Dumas devait être trop âgé, ce nous semble, pour prendre part aux victoires de l’illustre marin.
Il nous a été également impossible de trouver quoi que ce soit au sujet du fils dont parle M. Bibaud.
M. Dumas fut promu le 29 février 1768 au rang de brigadier général.[59] Il obtint ce grade, comme en fait foi le Traité de la défense des Colonies, par M. Dumas, brigadier général des armées du Roy, ancien commandant général des Isles de France et de Bourbon. Ce traité est dédié « à Monsieur, frère du Roy ; »[60] il est déposé à la bibliothèque des Cartes et Plans de la Marine, à Paris.[61]
Enfin, le 1er mars 1780, M. Dumas devenait maréchal de camp.[62]
La correspondance originale des administrateurs des îles de France et de Bourbon avec le ministre de la Marine (1767-1816), se trouve parmi les manuscrits de la Bibliothèque du port de Brest.[63] La Bibliothèque du port de Toulon[64] possède aussi un recueil de la correspondance des gouverneurs et des intendants de ces deux îles avec le ministre de la Marine (1753-1816).
Naturellement, les chercheurs ne peuvent avoir accès aux archives de ces ports durant la guerre actuelle. Il nous est donc impossible de suivre plus loin la carrière du général Dumas ; nous sommes à regret forcé de conclure ici notre travail.
CONCLUSION
En terminant cette rapide esquisse biographique du général Dumas, nous répéterons ce que nous disions en commençant ; c’est que, malgré le rang plutôt modeste qu’il occupa au Canada pendant les dix années qu’il y servit, il ne fut pas l’un des moindres facteurs qui aidèrent à retarder l’inévitable chute de la domination française sur ce continent d’Amérique. Inévitable, disons-nous ; en effet, avec le régime vacillant et corrompu que subissait alors la mère-patrie, un autre dénouement était impossible. Ce même régime ne venait-il pas de faire perdre à la France l’immense et riche empire des Indes ?
Ce fut la suprématie des mers qui donna à l’Angleterre le Canada et les Indes, c’est elle qui a fait de ce pays le plus puissant empire mondial qui ait jamais existé.
« Ce fut la fatuité de Louis XV et celle de la Pompadour, » dit M. Parkman dans l’introduction de Montcalm and Wolfe, « qui rendirent la conquête du Canada possible. S’ils n’eussent pas renversé la politique traditionnelle de la France envers l’Autriche, son ennemie séculaire, et s’ils ne se fussent pas plongés dans une guerre européenne inutile, toute la force du royaume eût été dès le début employée à humilier l’Angleterre et à défendre les colonies françaises. Les soldats français honteusement sacrifiés sur les champs de bataille du continent auraient pu sauver le Canada, et peut-être auraient-ils assuré les prétentions de la France sur les vastes territoires de l’Ouest. »
Ottawa, ce 24 octobre 1918.
APPENDICE
Mémoire sur les limites du Canada
(Par M. DUMAS)
On suppose que les plénipotentiaires nommés pour le futur congrès sont incapables d’adopter les frivoles idées qu’on s’est faites en France de nos possessions en Canada, des hommes d’État ont des notions que n’a pas le simple vulgaire.
Le Français volage est trop superficiel pour s’affecter de l’avenir, mais des ministres que la sagesse a choisis et que l’habileté dirige observeront d’eux-mêmes que l’intérêt du commerce, les progrès de la navigation, le bien de l’État et la gloire du Roy, exigent nécessairement qu’on pose pour préliminaire dans le traité de paix la restitution entière du Canada.
Dans des conjonctures plus heureuses nous serions fondés à demander aux Anglais des dédommagements relatifs à la déprédation énorme de notre marine tant marchande que militaire, mais les circonstances où, l’on se trouvera à la conclusion de la paix décideront des sacrifices que nous serons obligés de faire, ou des avantages qui pourront en résulter.
Le commerce a changé la face de l’Europe. Il est évident aujourd’hui, qu’à la longue, la nation la plus commerçante deviendra la plus puissante.
Nous ne pouvons plus nous passer de l’Amérique sans déchoir sensiblement de notre état de splendeur.
De la restitution du Canada dépend le sort du reste de nos colonies.
Ces principes plus clairs que le jour, une fois admis, cette restitution doit faire la base et le fondement du traité de paix.
Mais l’ouvrage de nos ministres sera-t-il durable ? Faute d’avoir des connaissances locales, seront-ils en état de bien ménager les intérêts du Roi et de la nation à cet égard ? Préviendront-ils les subterfuges dans lesquels la souplesse anglaise ne manquera pas de l’envelopper ? Si les Anglais veulent la paix, la veulent-ils pour longtemps ? Renonceront-ils à ce système de despotisme maritime qui fait l’unique objet de leur politique ? Ne conserveront-ils pas une disposition constante de se rendre maîtres de l’Amérique entière ? Et ne la feront-ils point éclater lorsque nous y penserons le moins ? Hors d’état d’effectuer ce projet aujourd’hui par l’épuisement de leurs finances, ne le renouvelleront-ils pas dans d’autre temps ? Vis-à-vis d’un ennemi si actif, si ambitieux, si entreprenant, les conjectures valent des démonstrations : le passé ne saurait nous rendre trop précautionnés pour l’avenir.
Par une fatalité qui ne se peut comprendre les Anglais connaissaient mieux que nous-mêmes avant la guerre, la carte topographique de nos possessions. Aidés d’un pareil secours, quel avantage n’ont-ils pas pour nous faire prendre le change. C’est donc relativement à cet objet que doivent se déployer toute la prudence et la sagacité de nos plénipotentiaires.
Je borne leur travail sur le Canada à quatre objets généraux :
1o La propriété entière des deux rives du fleuve et Golfe Saint-Laurent.
2o La propriété des lacs et rivières qui font la communication naturelle du Canada avec la Louisianne qui consiste dans le Lac Ontario, le Lac Érié et l’Ohio.
3o Qu’aucune des deux nations ne puisse faire des établissements sur les rivières qui arrosent les possessions de l’autre.
4o Que les deux colonies subsistent et s’accroissent par la population, sans couvrir leurs frontières par des postes avancés, principe de jalousie, de soupçon et de méfiance, occasion toujours prochaine ou prétexte souvent spécieux de rupture entre deux nations.
Quant au premier article, céder aux Anglais, ainsi qu’ils le prétendent, toute la péninsule de l’Acadie, c’est se réduire évidemment à une possession précaire. Cette péninsule est susceptible d’une population immense, sa position est des plus avantageuses, tant pour y élever des fortifications que pour y construire des ports.
On peut y former des établissements solides en tous genres, l’agriculture peut y être mise en valeur avec le plus grand succès. Vainement la France se flatterait-elle de conserver en paix la possession de l’embouchure du fleuve, si les Anglais obtenaient la cession entière de cette presqu’île. Déjà maîtres de Terre-Neuve ils nous accorderaient la propriété d’un pays dont ils garderaient l’entrée.
À peine la paix sera-t-elle signée qu’on verra l’activité de ce peuple ambitieux se réveiller. Bientôt on le verrait s’establir sur la côte Septentrionale de cette péninsule, négliger le reste s’il le faut, pour porter dans cette partie toute son industrie pour les plantations.
Quel service les plénipotentiaires ne rendraient-ils pas à l’État, si par leur habileté ils fesaient consentir les Anglais au partage de cette presqu’île ; de manière que la France conservât la propriété de la partie Septentrionale depuis le Cap Anseau[65] jusqu’aux mines.
Mais si leur zèle devient inutile, si la fermeté anglaise ne laisse aucune espérance à ce sujet ils doivent être prêts à rompre plutôt toute conférence que de lâcher un pouce de terrain sur le continent.
Il est évident que notre colonie perdrait par là toute communication avec la métropole ; nous n’aurions plus l’entrée du fleuve libre, qu’en autant que les Anglais le jugeraient à propos.
Les lignes de démarcations qui séparent les possessions respectives sur la carte qui suit ce mémoire sont tirées selon les plus grands sacrifices qu’il soit possible à la France de faire. C’est aux plénipotentiaires à tirer avantage des événements heureux pour obtenir de meilleures conditions, mais dans tous les revers possibles, il sera plus avantageux au Roi et à l’État de renoncer au Canada et conséquemment à la Louisianne, qui ne peut subsister sans lui, que de céder un pouce de terrain au delà de cette division.
La couleur bleue marque les possessions françaises.
La rouge marque les possessions Britanniques.
La jaune les terres qu’on peut laisser neutres.
La verte ce qu’on pourrait céder du côté de la Baie d’Hudson, si les événements exigeaient que la France fît encore de nouveaux sacrifices.
Je l’ai dit et le répète, la Louisianne ne peut subsister pour nous sans le Canada.
Mais il est plus avantageux pour la France de céder promptement aux Anglais ces deux colonies que d’accepter des conditions pires que celles qu’on indique par les lignes tirées sur cette carte.
Dans cette hypothèse que la rivière de Pentagouet soit la borne des possessions des Anglais sur le continent au nord-est et qu’ils ne puissent établir que la rive droite.
Que la rivière Saint-Jean borne les établissemens des Français et qu’ils ne puissent établir que la rive gauche.
L’espace de terrain qui est entre ces deux rivières restera neutre et indivis entre les deux nations à perpétuité ainsi qu’il est marqué sur la carte par la couleur Jaune.
Le second objet du travail de nos plénipotentiaires relativement au Canada, regarde la communication de cette colonie avec la Louisianne. Les projets des Anglais seraient remplis au delà de leurs espérances si la liberté de cette communication n’était pas stipulée et solidement établie par le traité de paix ; ce serait deux colonies qui ne peuvent se soutenir que par leur rapport immédiat.
Or cette communication ne peut avoir lieu que par l’Ohio ; toute autre route la rend très difficile souvent même impracticable.
Il est donc essentiel d’insister fortement sur l’entière possession de l’Ohio.
Cette rivière navigable dans tout son cours pour de très grosses voitures menace de loin la Louisiane et réunit l’avantage de l’éloignement pour cacher les préparatifs à celui de l’extrême rapidité des eaux pour la promptitude de l’exécution.
Faire de l’Ohio les limites respectives, c’est la céder toute entière aux Anglais. En effet déjà la population Anglaise s’avance vers cette rivière, elle n’a qu’un pas à faire pour franchir les Apalaches, et ce pas se ferait le lendemain de la signature du traité.
La rive gauche de l’Ohio serait en culture pour les Anglais en moins de quatre ans, tandis que dans l’espace d’un siècle, notre population ne saurait atteindre jusque là. Qui ne voit dans cette courte explication la chute prochaine et inévitable de la Louisiane.
On ne peut donc trop insister pour l’entière possession de l’Ohio, les apalaches fesant les limites, mais si les événemens étaient tels que nous fussions forcés à nous relâcher sur cet article important, l’unique tempérament à prendre est marqué sur la carte par la couleur Jaune, c’est de laisser le cours de cette rivière neutre sans établissemens, sans propriété, liberté aux deux nations d’y porter leurs marchandises de traite ambulante et réserve expresse pour la France pour la communication de ces deux colonies.
La possession des lacs Ontario et Érié qui est la suite de cette communication est la chose du monde la plus intéressante pour nous, d’autant mieux qu’au défaut de celle-ci, ces lacs en assurant un autre par les rivières des Miamis et celle d’ouaback plus difficile, plus incertaine mais qui fournit pourtant une ressource dans les temps malheureux.
Je conviens qu’il faudrait des événemens bien favorables pour réduire les Anglais à abandonner la côte méridionale du lac Ontario dont ils sont en possession depuis longtems par le fort de Chouaguen, possession usurpée mais constante et pour ainsi dire sans opposition, une vaine protestation faite par le gouvernement français, lorsqu’ils jettèrent les premiers fondemens de cet établissement est la seule contradiction qu’ils y aient éprouvée.
Si à la conclusion de la paix les circonstances étaient telles que la France eut à faire valoir ses avantages, ce serait le moment de réclamer contre cette usurpation. Cet objet important mérite a plus grande attention de nos plénipotentiaires. Il suffit de considérer le cours des eaux pour voir que ce lac commande tout le Canada.
Le Général Amherst n’a pas trouvé de route plus sûre pour l’invasion, l’événement n’a que trop justifié ses principes et les miens.
Si au contraire nous sommes réduits à reprendre le Canada sur le pied que nous le possédions avant la guerre, la France pourrait consentir à borner ses établissemens en culture à la rive Septentrionale du Lac Ontario laissant la côte méridionale libre depuis la baie de Niaouré jusqu’à la rivière de Niagara.
Les Anglais conserveraient la liberté de porter des marchandises de traite ambulante à l’embouchure de la rivière de Choueguen et ne pourraient s’étendre que jusqu’à la rivière à la Famine de l’autre.
Mais rien ne doit faire relâcher la France sur la propriété du terrain de manière que la liberté de la traite accordée aux Anglais ne puisse en aucun temps leur faire un titre.
Que leurs possessions soient toujours bornées à la source des rivières qui les arrosent et que la hauteur des terres soient constamment les limites entre les deux nations.
La possession entière du lac Érié doit appartenir à la France incontestablement jusqu’à la source des eaux qui se déchargent dans ce lac par la rive méridionale, les eaux pendantes du côté de l’Ohio entrant dans la neutralité proposée pour cette rivière.
Le troisième objet proposé à la tête de ce mémoire s’éclaircira par une courte réflexion.
Les Anglais sont dix contre un en Amérique relativement à nous. Mais si franchissant la hauteur des terres, nous poussions nos établissemens jusqu’à la source des eaux qui arrosent les colonies anglaises, toute leur supériorité en nombre, en moyens et en ressources ne la garantirait pas d’une invasion quand il nous plairait de la tenter.
Celui qui médite une expédition la prépare sourdement et quand il est tenu de l’exécuter s’il a pour lui le courant des eaux qui le porte avec rapidité, il surprend son ennemi et réussit infailliblement, il n’en est pas de même quand l’agresseur a des rivières à monter, des portages à faire, des lacs à traverser, des montagnes à franchir, les préparatifs immenses qu’il faut faire pour cela font apercevoir le mouvement et la lenteur de l’exécution, donne le temps à la Province menacée de se mettre en état de défense.
Les Colonies Anglaises sont dans le dernier cas par rapport au Canada ; et le Canada serait dans le premier relativement aux Colonies Anglaises, si les Anglais poussaient leurs établissemens sur le Lac Champlain, sur le Lac Ontario ou sur l’Ohio.
Je suis pleinement convaincu (et tout homme sensé qui connaît la manière dont on peut faire la guerre dans ce pays la sentira comme moi) que toutes les ressources de l’État ne réussiront jamais à conserver le Canada si les Anglais sont une fois établis à la source de nos rivières.
C’est encore une des conditions auxquelles il ne faut jamais consentir. Si la paix se concluait dans des circonstances fâcheuses pour la France, j’indique l’unique tempérament à prendre qui est la neutralité de certains cantons, ainsi pourrait être le Lac St-Sacrement sans grand préjudice pour nous, pourvu que les Anglais bornassent leurs établissemens à la source des eaux qui se déchargent dans la rivière d’orange.
Venons à mon quatrième principe.
Je ne connais rien de plus inutile dans ce pays là que des forts pour couvrir les frontières, ils sont également à charge aux deux nations, elles ont même intérest à les démolir ; c’est en temps de paix une source de dépenses inutiles et l’expérience a fait voir qu’en temps de guerre ils ne servaient à rien. Ces postes avancés ne sont propres qu’à faire naître des difficultés, qu’à donner des ombrages et fournir quelques fois des prétextes de rupture.
Ils favoriseraient celle des deux nations qui conserverait le désir de s’emparer des possessions de l’autre, par les secours de ces points d’appui, on peut fondre sur son ennemi lorsqu’il s’y attend le moins, au lieu que ne subsistant plus, toute entreprise considérable devient plus difficile, plus lente. Il faut établir des entrepôts et, le pas en avant, crier aux armes. (?)
Les plénipotentiaires français travailleront utilement pour cette Colonie et plus utilement encore pour le Trésor Royal s’ils conviennent avec les ministres Britaniques qu’il ne sera conservé aucun poste avancé sur les frontières de part ni d’autre, ainsi Choueguen et Niagara seront démolis.
Cela n’exclut pas les établissemens utiles dans l’intérieur des possessions soit relativement à la traite ou autrement que chaque nation aura la liberté de diriger selon ses intérêts, mais seulement ce que l’on appelle frontière, passage, débouché, qui peut tendre à se procurer moyen d’invasion.
Pour mettre les choses au pis, si le sort des combats était funeste à la France cette campagne, et que la paix se conclut dans un moment fâcheux pour nous.
Si pour obtenir les conditions que je propose, nous étions dans la nécessité de faire de nouveaux sacrifices dans quelque partie du Canada, le moins dangereux pour nous serait de donner plus d’étendue aux possessions des Anglais du côté de la Baie d’Hudson. Cédons-leur tout le Lac Supérieur plutôt qu’un pouce de terrain dans la partie méridionale en deçà de la hauteur des terres ou des Appalaches ; ce sacrifice à faire dans le moment le plus critique pour la France est marqué sur la Carte par la couleur verte.
Hors de ces lignes de démarcation la France doit renoncer au Canada, puisqu’il est évident qu’elle ne saurait le conserver : encore faut-il pour s’y maintenir dans cet état que le Ministère s’en occupe essentiellement et constamment, mais surtout que l’on choisisse bien les hommes à qui l’on confiera le Gouvernement, la police et les finances.
Sans cela nous travaillons pour nos ennemis. Le Canada arrosé du sang de nos infortunés Colons sera bientôt l’apanage des Anglais. Nos défrichemens, nos établissemens, nos peuplades seront autant de fruits qu’ils recueilleront lorsqu’ils seront parvenus à leur maturité.
Que la hauteur des terres et les apalaches soient les limites entre ces deux peuples, la nature semble les avoir marquées exprès.
Le caprice des hommes ne peut changer cette barrière toujours permanente et toujours prête à réclamer contre l’usurpateur. On aspire à une paix factice lorsqu’on cherche à l’établir sur des lignes arbitraires que les révolutions des tems ou les intérêts des hommes peuvent détruire ; c’est peut-être une faute dans laquelle sont tombés nos plus habiles négociateurs ; c’est pourtant l’objet le plus important d’un traité de paix puisqu’il détruit ou forme le germe fatal qui occasionne la plupart des guerres.
La hauteur des terres et les Appalaches une fois déterminées pour la séparation des deux Colonies, les modifications, les tempéramens que je propose par la neutralité de certains cantons peuvent être admis selon que les circonstances seront plus ou moins heureuses pour la France lorsque la paix se conclura.
Il me reste qu’une réflexion à mettre en avant qui quoiqu’elle ne regarde pas directement les limites a pourtant avec elles un rapport très prochain.
En considérant les dépenses énormes où nous engage le service des Sauvages à la guerre j’ai toujours pensé qu’à bien moins de frais le Roi entretiendrait en Canada un corps de troupes toujours subsistant capable de le défendre en tout tems et quand j’ai balancé avec réflexion l’utilité de leurs secours, je ne l’ai trouvé que d’opinion et de préjugé. Mais ce préjugé est fondé sur la terreur qu’inspire leur cruauté et leur barbarie dans leurs usages, conséquemment il conservera son empire.
Cette terreur sera toujours très utile à la nation qui saura le mieux ménager l’alliance et l’attachement de ces peuples. Nous avons sur les Anglais un avantage réel de ce côté là, évitons avec soin de lui donner la moindre atteinte, par quelque convention avec nos ennemis qui put rendre aux Sauvages notre alliance et notre bonne foi suspectes. Quelque simple et naturel que pût être un tel accord, les Anglais ne manqueraient pas de le présenter aux Sauvages sous un point de vue qui le leur rendrait odieux.
Ces peuples sont orgueilleux, jaloux, soupçonneux, vindicatifs, un air de défection de notre part après tout le sang qu’ils ont versé pour notre défense nous les rendrait irréconciliables de génération en génération et ce serait le plus grand des malheurs pour nos deux Colonies. Nos plénipotentiaires doivent être en méfiance à cet égard. Je suis pleinement convaincu que les ministres Britanniques leur tendront des pièges relatifs à cet objet plus important pour eux en Amérique que le gain de plusieurs combats.
Au surplus un Gouverneur Général, instruit et attentif saura maintenir l’alliance de tous les peuples de ce continent dans la paix comme dans la guerre, sans ces dépenses énormes que la friponnerie conduit et que l’impéritie tolère.
TABLE DES MATIÈRES
- ↑ Cette correspondance est publiée en partie dans le Rapport sur les Archives du Canada pour l’année 1905. Vol. I. Elle avait paru précédemment à Paris. Voir Saint-Yves dans notre bibliographie.
- ↑ L’extrait ci-dessus a été découvert par M. Placide Gaudet, dans les registres de l’état civil tenus au fort Duquesne par le Père récollet Denys Baron, aumônier de ce fort, dont la copie est conservée aux Archives publiques du Canada à
Ottawa (série M., Vol. 200, p. 9 de l’année 1755).
De la lecture de ce document il ne faudrait pas conclure que son nom de famille fut Daniel et celui de Dumas un surnom. Il se nommait en réalité Jean-Daniel Dumas. Les mots écuyer et sieur placés tel qu’ils le sont pourraient d’abord faire croire le contraire ; mais un peu plus loin dans le même registre, nous trouvons l’acte de sépulture de M. de Beaujeu. Il y est désigné : M. Liénard Daniel, Escuyer, sieur de Beaujeu, et cet acte est signé par le même P. Baron.
M. Philéas Gagnon, collectionneur et bibliographe distingué, connaissait, lui aussi, les prénoms de M. Dumas. Voir Essai de bibliographie, Vol. ii.
- ↑ Archives publiques du Canada. Correspondance générale, 1756. Série F, Vol. 101, p. 391.
- ↑ M. Machault d’Arnouville. Il était aussi secrétaire d’État pour la Marine.
- ↑ Archives publiques du Canada, série D2, vol. 49-2, p. 425.
- ↑ Lettre à M. de Paulmy, 10 avril 1758.
- ↑ Correspondance de MM. Vaudreuil, Lévis et Dumas dans Rapport sur les Archives du Canada pour l’année 1905, vol. I.
- ↑ Montcalm and Wolfe, 1888, vol. I, p. 330.
- ↑ Siege of Quebec, vol. III, p. 188.
- ↑ Voir sa lettre du 24 juillet 1756, ainsi que la recommandation de M. de Vaudreuil, déjà citées.
- ↑ Knox’s Historical Journal, vol. I. Deuxième note de l’éditeur, p. 418. Aussi Archives publiques du Canada, séries B., vol. 91, et D-2, vol. 4.
- ↑ Les derniers Jours de l’Acadie, par M. Gaston du Boscq de Beaumont, pp. 30-31.
- ↑ Ces forts sont devenus : La ville d’Érié.
- ↑ Le village de Lebœuf ;
- ↑ La ville de Venango ;
- ↑ Le village de Shenango ;
- ↑ La ville de Pittsburg ; en Pennsylvanie. La rivière aux Bœufs est devenue French Creek.
- ↑ Histoire du Canada, 4ème éd., 1882, vol. II, p. 211.
- ↑ Voir sa lettre à M. de Vaudreuil, du 14 juillet 1755, Aussi celle qu’il adressa au ministre, le 20 du même mois.
- ↑ Lettre de M. Dumas au ministre, 24 juillet 1756.
- ↑ Lettre de M. Dumas au ministre, 24 juillet 1756.
Aussi la lettre de M. de Contrecœur au ministre, du 20 juillet 1755 : « M. de Beaujeu, qui étoit nommé pour me succéder dans le commandement de ce poste, commandoit le party ayant pour second Messieurs Dumas et de Ligneris, il eut le malheur d’être tué à la troisième décharge des ennemis, dans le tems que nos français et sauvages commençoient de balancer… »
Aussi la recommendation de M. de Vaudreuil, du 30 octobre 1755 citée plus haut.
La lettre du ministre de la Marine à M. Dumas, du 1er avril 1756 : « Le Roi a été très content de la conduite que vous avez tenue dans le commandement dont vous vous êtes trouvé chargé aprez la mort du Sieur de Beaujeu au combat que vous avez soutenu contre les Anglois ; Et Sa Majesté pour vous en marquer Sa Satisfaction a bien voulu vous accorder la croix de Saint Louis que j’adresse à M. de Vaudreuil. Peut-être aurez-vous de nouvelles occasions de vous distinguer dans le poste où vous vous trouvez. Je suis persuadé que vous en profiterez avec les précautions que les circonstances pourront exiger ou permettre, et en vous conformant aux ordres et aux instructions que M. de Vaudreuil doit vous avoir
donné. Je serai toujours fort aise d’avoir à faire valoir vos services auprez du Roi. — Archives des Colonies, série B., vol. 103, p. 114.Lettre du même personnage à M. le comte d’Hérouville, du 13 décembre de la même année : « J’ai reçu, M., la lettre que le sieur Dumas cape en Canada vous avoit addressée pour moy. Je n’ai point oublié les témoignages avantageux que vous m’aviés déjà rendu de lui. Et vous devés bien juger que je n’oublirai pas son combat de l’année dernière. Je lui ai envoyé le printemps dernier la croix de Saint-Louis ; Et je suis d’autant plus disposé à lui procurer d’autres grâces, dans toutes les occasions qui s’en présenteront, que M. de Vaudreuil, gouverneur général de Canada me paroit toujours content de la conduite qu’il tient dans le commandement dont il l’a chargé. » — Serie B., vol. 104, p, 503.
Voir aussi le Journal de Lévis, et Knox’s Historical Journal, vol. I, p. 418. Note by the editor. " Dumas… took command in the fight after Beaujeu fell, and by rallying the Canadians and Indians, was largely instrumental in winning the victory".
- ↑ M. Dumas au ministre, 24 juillet 1756.
- ↑ Papiers du chevalier de la Pause, obligeamment mis à notre disposition par M. A. G. Doughty.
- ↑ Histoire du Canada, vol. II, p. 233.
- ↑ Tableaux synoptiques de l’Histoire du Canada.
- ↑ À mitraille.
- ↑ Montcalm and Wolfe, 1888. Vol. I, pp. 329, 330.
- ↑ Lettre au ministre, 24 juillet 1756.
- ↑ Le fort Granville fut probablement ainsi nommé en l’honneur de George Granville, vicomte de Lansdowne, célèbre homme d’État anglais et auteur de comédies, de tragédies, et de dissertations historiques. Il fut l’un des protecteurs de Pope.
- ↑ Cette lettre est reproduite dans Les Dernières Années de la Louisiane Française, par M. Marc Villiers du Terrage, pp. 85-87, où nous la prenons. La date de 1757 nous paraît être une erreur d’impression. Ce devrait être 1756.
- ↑ Le village d’Attigué, le Kittanning des Anglais, se trouvait situé sur l’Alleghany vis-à-vis de la rivière Kiskomitas.
- ↑ Le fort que Kerlérec appelle George de Craon devait être un des entrepôts du fameux traitant George Croghan, l’adversaire acharné des Français, dont plusieurs comptoirs
furent pillés en 1756.
Ces deux notes sont de M. Villiers du Terrage.
- ↑ Documents relating to the Colonial History of the State of New York. Paris documents. Vol. X, p. 466.
- ↑ Montcalm and Wolfe, 1888. Vol. I, pp. 423-427.
- ↑ Documents relating to the Colonial History of the State of New York. Paris Documents. Vol. X, p. 500.
- ↑ Documents relating to the Colonial History of New York. Paris Documents. Vol. X, p. 571. F.-X. Garneau. Histoire du Canada, vol. II, p. 267.
- ↑ Le chevalier de Lévis à M. de Moras, 10 octobre 1757.
- ↑ Lettre à M. de Paulmy, 10 avril 1758.
- ↑ M. Doreil à M. de Crémille, 28 juillet 1758, dans Documents relating to the Colonial History of the State of New York, Paris Documents, vol. x, p. 762.
- ↑ Le chevalier de Lévis au maréchal de Belle-Isle, 15 avril 1759.
- ↑ Voici ce que dit M. Thomas Chapais, parlant de Bougainville,
dans Montcalm, page 513 et seq. : « Après trois
mois d’instances, de sollicitations, d’allées et venues, d’entrevues
avec M. Berryer, le maréchal de Belle-Isle et madame
de Pompadour, qui « était alors premier ministre » (Journal
de Bougainville), il écrivait en chiffres à Montcalm et à
Vaudreuil : « Pour toutes troupes trois cents hommes de
recrue, quatre ingénieurs, vingt-quatre canonniers ou ouvriers.
Munitions de guerre, vivres dans deux vaisseaux
marchands partis de Bayonne le 16 février, Vingt autres partis
de Bordeaux, quatre frégates de Brest et de Rochefort,
commandées par capitaines corsaires, quelques autres parties
d’autre part, nul vaisseaux de guerre… »
« Mais si les secours obtenus étaient misérables, les faveurs accordées étaient brillantes.
«…Mais la Cour ne s’en tint pas là ; et, se voyant incapable de secourir efficacement la colonie agonisante, elle sembla vouloir dédommager ses défenseurs en les comblant de récompenses. »
- ↑ Le chevalier de Lévis au maréchal de Belle-Isle, 17 mai 1759.
- ↑ Brevet de major général inspecteur des troupes en Canada.
Aujourd’hui premier janvier 1759, Le Roy étant à Versailles et voulant donner au Sieur Dumas, major de Québec en Canada, de nouvelles marques de sa satisfaction en le mettant à portée d’en donner lui-même, de son zèle, de sa capacité et de son expérience, Sa Majesté l’a retenu, ordonné et établi, retient, ordonne et établit major général inspecteur des troupes qu’Elle entretient en ladite colonie de Canada pour en ladite qualité faire l’inspection desdites troupes, les discipliner, prendre soin qu’elles soient bien entretenues, leur faire faire l’exercice militaire, faire vivre les soldats qui les composent en union et concorde, et généralement remplir tous les autres détails relatifs auxdites troupes et indépendants des fonctions des majors des places de ladite colonie, voulant Sa Majesté qu’en ladite qualité il ait le rang, les honneurs, les prérogatives et l’autorité de lieutenant pour Elle, pendant le temps seulement qu’il sera en campagne, et qu’il jouisse au surplus des apointemens qui lui seront ordonnés par les états qui seront expédiés à cet effet, le tout sous l’autorité du gouverneur son lieutenant général de la Nouvelle-France, auquel mande Sa Majesté de faire reconnoitre ledit Sieur Dumas en ladite qualité de major général inspecteur desdittes troupes et de le faire obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il appartiendra et choses concernant ladite charge. Et pour témoignage de sa volonté Sa Majesté m’a commandé d’expédier le présent brevet, qu’Elle a voulu signer de sa main et être contresigné par moy son Conseiller Secrétaire d’État et de ses commandemens et finances. Archives du Canada. Série F., vol. 257, p. 72)
- ↑ Si l’on en excepte les majors de places, officiers supérieurs chargés du détail et de la surveillance du service, il n’existait pas, avant la nomination de M. Dumas au poste de major général inspecteur des troupes de la Marine au Canada, de grade supérieur à celui de capitaine, dans ces troupes. Voir la lettre du ministre de la Marine au duc de Choiseul, ministre de la Guerre, en date du 6 mars 1761 (p. 95). Mais, dans la liste des officiers devant être transportés en France, après la capitulation de Montréal, le marquis de Vaudreuil mettait M. Dumas au rang d’un colonel dans l’armée de terre. Voir Rapport sur les Archives canadiennes pour l’année 1886, p. clxxiii.
- ↑ M. de Vaudreuil au ministre, 5 octobre 1759. Archives du Canada, série F, vol. 309.
- ↑ Voir Siege of Quebec, by A. G. Doughty, Québec, 1901.
- ↑ Lettre du marquis de Vaudreuil du 5 octobre 1759, Voir aussi Siege of Quebec, by M. A. G. Doughty, vol. IV. p. 243.
- ↑ Journal tenu à l’Armée, p. 69, cité dans Knox’s Journal.
- ↑ Documents relating to the Colonial History of the State of New York. Paris documents. Vol. X, p. 1078.
- ↑ Lettre du chevalier de Lévis à M. Berryer, du 28 juin 1760. « Parmi les officiers de la Marine, je crois devoir avoir l’honneur de vous informer particulièrement de ceux qui se sont distingués le plus et méritent de préférence les grâces du Roi.
Le Sieur Dumas, commandant le corps de la Marine, et le chevalier de la Corne, premier commandant d’un bataillon de ce corps, ont été blessés ; ce sont deux officiers de distinction et très en état d’être chargés de commissions importantes. Ils méritent depuis longtemps un grade distingué ou une pension ».
- ↑ Copie de ce manuscrit est déposée aux archives de la Secrétairerie provinciale à Québec. Voir Manuscrits relatifs à l’Histoire de la Nouvelle-France, 1ère série, vol. XVII, p. 173, dans le Catalogue de la Bibliothèque du Parlement. Nous la reproduisons en appendice.
- ↑ Ceci doit être une erreur de copiste. C’est évidemment 1767 qu’il faut lire puisque le roi ne prit possession du gouvernement de ces îles qu’en 1767.
- ↑ Histoire de l’île Bourbon, par M. Georges Azémas, Paris, 1862.
- ↑ Century Dictionary and Cyclopedia.
- ↑ Au Pays de Paul et Virginie. Paris, 1895.
- ↑ Colonial Office List, 1883, p. 124.
- ↑ Knox’s Historical Journal. Note by the editor.
- ↑ Liste des officiers civils et militaires. Archives publiques du Canada, série D-2, vol. 59.
- ↑ Mazas. — Histoire de l’Ordre de Saint-Louis. Ce grade tenait le milieu entre ceux de colonel et de maréchal de camp.
- ↑ M. le comte de Provence, plus tard Louis XVIII. Ce traité est donc postérieur à l’avènement au trône de Louis XVI (1774).
- ↑ Voir Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèques publiques de France. Bibliothèque de la Marine, par M. de la Roncière. Paris, 1907.
- ↑ Mazas. — Histoire de l’Ordre de Saint-Louis. II, p. 169. Ce grade était l’équivalent de celui de général de brigade de nos jours.
- ↑ M. de la Roncière. — Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèques publiques de France. Bibliothèque de la Marine. Paris, 1907.
- ↑ Idem.
- ↑ Canso