PORTE, s. f. Baie servant d’issue, au niveau d’un sol. Toute porte se compose de deux jambages, d’un linteau ou d’un cintre. Les jambages possèdent un tableau et une feuillure destinée à recevoir les vantaux. Nous diviserons cet article en portes fortifiées de villes et châteaux ; en portes de donjons et tours ; en poternes ; en portes d’abbayes ; en portes d’églises, extérieures et intérieures ; en portes de palais et maisons, extérieures et intérieures.
Portes fortifiées tenant aux enceintes de villes, châteaux, manoirs. — Il existe encore en France quelques portes romaines et gallo-romaines qui présentent les caractères d’une issue percée dans une enceinte et protégée par des défenses. Telles sont les portes de Nîmes, d’Arles, de Langres, d’Autun : les premières antérieures à l’établissement du christianisme ; celles d’Autun datant du IVe ou Ve siècle. Ces portes sont toutes dressées à peu près sur un même plan. Elles consistent en deux issues, l’une pour l’entrée, l’autre pour la sortie des chariots, et en deux passages pour les piétons ; elles sont flanquées extérieurement de deux tours semi-circulaires formant une saillie prononcée. Les portes d’Arroux et de Saint-André, à Autun, sont surmontées, au-dessus des deux arcs donnant passage à travers l’enceinte, d’un chemin de ronde à claire-voie, qui pouvait servir au besoin de défense. Les baies, s’ouvrant sur la voie publique, n’étaient fermées que par des vantaux de menuiserie, sans herses ni ponts mobiles[1].
La porte de Saint-André, à Autun, est l’une des plus complètes de toutes celles que nous possédons en France, et se rapproche de l’époque du moyen âge[2].

Ces tours possédaient encore au-dessus deux autres étages, réservés à la défense, l’un couvert par une voûte, et le dernier à ciel ouvert. On y arrivait par les escaliers à double rampe indiqués sur le plan.
Nous nous sommes souvent demandé, en voyant les portes des villes de Pompéi, de Nîmes, d’Autun, de Trèves, toutes si bien disposées pour l’entrée des chariots et des piétons, pourquoi, depuis qu’on a prétendu revenir aux formes de l’antiquité grecque et romaine, on n’avait jamais adopté ce parti si naturel des issues jumelles ? La réponse à cette question, c’est que l’on s’est fait une sorte d’antiquité de convention, lorsqu’on a prétendu en prescrire l’imitation. Placer un pilier dans le milieu d’une voie paraîtrait, aux yeux des personnes qui ont ainsi faussé l’esprit de l’antiquité, se permettre une énormité. Beaucoup d’honnêtes gens considèrent les portes Saint-Denis et Saint-Martin à Paris, si peu faites pour le passage des charrois, comme étant ce qu’on est convenu d’appeler une heureuse inspiration d’après les données de l’antiquité. Mais pour l’honneur de l’art antique, jamais les Romains, ni les Grecs byzantins, ni les Gallo-romains, n’ont élevé des portes de ville aussi mal disposées. Leurs portes sont larges, doubles, et n’ont jamais, sous clef, une hauteur supérieure à celle d’un chariot très-chargé. Elles sont accompagnées de poternes, ou portes plus petites pour les piétons, profondes ; c’est-à-dire formant un passage assez long, plus long que celui des baies charretières, afin de permettre au besoin un stationnement nécessaire. Quelquefois même ces poternes sont accompagnées de bancs et d’arcades donnant sur le passage des chariots. Telle est, par exemple, la disposition de la porte dite d’Auguste, à Nîmes.
Les tours et remparts touchant à la porte de Saint-André d’Autun sont construits en blocages revêtus extérieurement et intérieurement d’un parement de petits moellons cubiques, suivant la méthode gallo-romaine. Bien que les détails de cette porte soient médiocrement tracés et exécutés, l’ensemble de cette construction, ses proportions, produisent l’effet le plus heureux.
Mais on conçoit que ces portes n’étaient pas suffisamment couvertes, fermées et défendues pour résister à une attaque régulière. Il est vrai, qu’en temps de siège, on établissait, en avant de ces entrées, des ouvrages de terre et bois, sortes de barbacanes qui protégeaient ces larges issues. Ces ouvrages de terre, avec fossés et palissades, s’étendaient même parfois très-loin dans la campagne, formaient un vaste triangle dont le rempart de la ville était la base et dont le sommet était protégé par une tour ou poste en maçonnerie. À Autun même, on voit encore, de l’autre côté de la rivière d’Arroux, un de ces grands ouvrages triangulaires de terre, dont les deux côtés aboutissaient à deux ponts et dont le sommet était protégé par un gros ouvrage carré en maçonnerie, connu aujourd’hui sous le nom de temple de Janus, et qui n’était en réalité qu’un poste important tenant l’angle saillant d’une tête de pont. Ce qui reste de cette tour carrée fait assez voir qu’elle était dépourvue de portes au niveau du rez-de-chaussée, et qu’on ne pouvait y entrer que par une ouverture pratiquée au premier étage et au moyen d’une échelle ou d’un escalier de bois mobile.
Quand le sol gallo-romain fut envahi par les hordes venues du nord-est, beaucoup de villes ouvertes furent fortifiées à la hâte. On détruisit les grands monuments, les temples, les arènes, les théâtres, pour faire des remparts percés de portes flanquées de tours. On voit encore à Vesone (Périgueux), près de l’ancienne cathédrale du Xe siècle, une de ces portes. Il n’y a pas longtemps qu’il en existait encore à Sens, à Bourges, et dans la plupart des villes de l’est et du sud-est du sol gaulois. Beaucoup de ces ouvrages furent même construits en bois, comme à Paris, par exemple.
Quand plus tard les Normands se jetèrent sur les pays placés sous la domination des Carlovingiens, les villes durent de nouveau établir à la hâte des défenses extérieures, afin de résister aux envahisseurs. Ces ouvrages ne devaient pas avoir une grande importance, car il ne paraît pas qu’ils aient opposé des obstacles bien sérieux aux assaillants ; les récits contemporains les présentent aussi généralement comme ayant été élevés en bois ; et d’ailleurs l’art de la défense des places n’avait pas eu l’occasion de se développer sous les premiers Carlovingiens.
Ce n’est qu’avec l’établissement régulier du régime féodal que cet art s’élève assez rapidement au point où nous le voyons arrivé pendant le XIIe siècle. Les restes des portes d’enceintes de villes ou de châteaux antérieures à cette époque, toujours modifiées postérieurement, indiquent cependant déjà des dispositions défensives bien entendues. Ces portes consistent alors en des ouvertures cintrées permettant exactement à un char de passer : c’est dire qu’elles ont à peine 3 mètres d’ouverture sur 3 à 4 mètres de hauteur sous clef. Il n’était plus alors question, comme dans les cités élevées pendant l’époque gallo-romaine, d’ouvrir de larges ouvertures au commerce, aux allants et venants, mais au contraire de rendre les issues aussi étroites que possible, afin d’éviter les surprises et de pouvoir se garder facilement. De grosses tours très-saillantes protégeaient ces portes.
Nous ne trouvons pas d’exemple complet de portes de villes ou châteaux avant le commencement du XIIe siècle. Un de ces exemples, parvenu jusqu’à nous sans altération aucune, se voit au château de Carcassonne, et il remonte à 1120 environ.

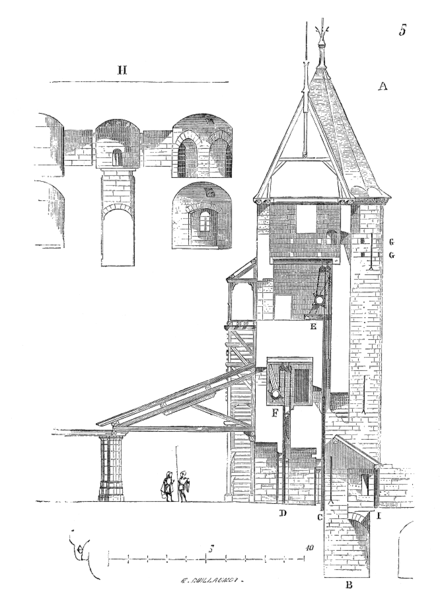

Les surprises des places par les portes étaient si fréquentes, que non-seulement on multipliait les obstacles, les fermetures dans la longueur de leur percée, mais qu’on plaçait, au dehors, des barbacanes, des ouvrages avancés qui en rendaient l’approche difficile, qui obligeaient les entrants à des détours et les faisaient passer à travers plusieurs postes.
Aujourd’hui, lorsqu’on assiège régulièrement une place, on établit la première parallèle à 600 ou 800 mètres, et en cheminant peu à peu vers le point d’attaque par des tranchées, on établit les batteries de brèche le plus près possible de la contrescarpe du fossé ; les assiégeants, avec l’artillerie à feu, ne se préoccupent guère des portes que pour empêcher les assiégés de s’en servir pour faire des sorties. Mais lorsque l’attaque d’une place ne pouvait être sérieuse qu’au moment où l’on attachait les mineurs aux remparts, on conçoit que les portes devenaient un point faible. L’attaque définitive étant extrêmement rapprochée, toute ouverture, toute issue devait provoquer les efforts de l’assiégeant.
En étudiant les portes fortifiées des places du moyen âge, il est donc très-important de reconnaître les dehors et de chercher les traces des ouvrages avancés qui les protégeaient ; car la porte elle-même, si bien munie qu’elle soit, n’est toujours qu’une dernière défense précédée de beaucoup d’autres.
La porte de Laon à Coucy-le-Château est, à ce point de vue, l’une des plus belles conceptions d’architecture militaire du commencement du moyen âge. Bâtie, ainsi que les remparts de la ville et le château lui-même, tout au commencement du XIIIe siècle par Enguerrand III, sire de Coucy[7], elle donne entrée dans la ville en face du plateau qui s’étend du côté de Laon. Cette porte, placée en face de la langue de terre qui réunit le plateau à la ville de Coucy, donnait une entrée presque de niveau dans la cité ; mais à cause de cette situation même, elle demandait à être bien défendue, puisque cette langue de terre est le seul point par lequel on pouvait tenter d’attaquer les remparts, dominant, sur tout le reste de leur périmètre, des escarpements considérables. Au commencement du XIIIe siècle, voici quel était le système défensif des abords de cette porte (fig. 7).



Ce passage est voûté en berceau tiers-point en A, en B et en C; il est couvert par un plancher en D. En E, est un large mâchicoulis entre deux herses. L’entrée F se fermait par le pont G relevé, et en I était une porte à deux vantaux avec barres. Du couloir D, vers la ville, on entrait par deux portes détournées dans deux salles J, servant de corps de garde. On observera que les deux entrées dans ces salles sont disposées de telle façon que, du passage, on ne puisse voir l’intérieur des postes, ni reconnaître, par conséquent, le nombre d’hommes qu’ils contiennent. Ces postes sont chauffés par deux cheminées K, et éclairés par deux fenêtres L placées au-dessus des deux descentes de caves marquées A sur le plan souterrain. De ces deux postes J, on passe dans les salles circulaires M, percées chacune de trois meurtrières, deux sur le fossé, une sur le passage.
En N, est une des trappes donnant dans une trémie qui correspond à l’étage en sous-sol. Deux escaliers, pris dans l’épaisseur des murs des tours, permettent de monter au premier étage, dont le plan (fig. 10) présente une disposition peut-être unique dans l’art de fortifier les portes au moyen âge.



Cette figure indique les principales dispositions de cet ouvrage. A est le sol de la ville. On observera que le sol du passage est très-incliné vers l’entrée, afin de donner plus de puissance à une colonne de défenseurs s’opposant à des assaillants qui auraient pu franchir le pont et soulever les herses. En B, on voit, en coupe, le couloir souterrain aboutissant à la poterne de sortie C, laquelle est mise en communication avec les passages pratiqués à travers les piles du pont. Un pont à bascule, pivotant en C et muni de contre-poids, permettait, une fois abaissé, de descendre les degrés D. De ce point il fallait faire manœuvrer un second pont à bascule, pour franchir les intervalles E, F entre les piles D, G, H. Et ainsi, soit par des ponts à bascule, soit par des passerelles de planches, que l’on pouvait enlever facilement, arrivait-on, à travers la tour G du plan général (fig. 7), jusqu’à la grande barbacane D. Le tablier I du pont (fig. 13) était interrompu en J et remplacé par un pont-levis, non point combiné comme ceux de la fin du XIIIe siècle et des siècles suivants, mais composé d’un tablier pivotant en K, de deux arbres L pivotants, et de deux chaînes passant à travers les mâchicoulis du hourd M ; là ces chaînes se divisaient chacune en deux parties, dont l’une s’enroulait sur un treuil et l’autre était terminée par des poids. C’était donc du niveau des hourds N que l’on manœuvrait le pont-levis, c’est-à-dire au-dessus des mâchicoulis du hourd M. Quant aux deux herses, on les manœuvrait par un treuil unique ; les chaînes enroulées en sens inverse sur ce treuil permettaient, au moyen d’un mécanisme très-simple, de lever l’une des deux herses avant l’autre, mais jamais ensemble. Il suffisait pour cela, quand les herses étaient abaissées, et ne tiraient plus sur le treuil par conséquent, de décrocher les chaînes de la herse qu’on ne voulait pas lever, et de manœuvrer le treuil, soit dans un sens, soit dans l’autre. L’une des herses levée, on la calait, on décrochait ses chaînes, on rattachait celles de la seconde, et l’on manœuvrait le treuil dans l’autre sens. Il n’est pas besoin de dire que des contre-poids facilitaient comme toujours le levage. Pour baisser les herses, on raccrochait les chaînes, et on laissait aller doucement sur le treuil l’une des herses, puis l’autre. L’obligation absolue de ne lever qu’une des deux herses à la fois était une sécurité de plus, et nous n’avons vu ce système adopté que dans cet ouvrage.
Mais il est nécessaire d’examiner en détail le mécanisme des ponts et des herses.

Il n’y a rien, dans ce mécanisme, qui ne soit très-primitif ; mais ce qu’il est important de remarquer ici, ce sont les dispositions si parfaitement appropriées au besoin, et conservant par cela même un aspect monumental, qui certes n’a point été cherché. Il est évident que les architectes auteurs de pareils ouvrages étaient des gens subtils et réfléchissant mûrement à ce qu’ils avaient à faire. Sur tous les points, les passages, les issues, sont disposés exactement en vue du service de la défense, n’ont que les largeurs et hauteurs nécessaires, et l’architecture n’est bien ici que l’expression exacte du programme. Cependant, à l’extérieur, l’aspect de cette défense est imposant, et rappelle sous une autre forme ces belles constructions antiques des populations primitives.

Toute la maçonnerie est élevée en assises de pierres calcaires du bassin de l’Aisne, d’une excellente qualité. Parementées grossièrement, ces assises sont séparées par des joints de mortier épais, et l’aspect rude de ces parements ajoute encore à l’effet de cette structure grandiose. Quand on compare ces ouvrages de Coucy, le donjon, le château, la porte de Laon, les remparts et les tours, aux travaux analogues élevés vers la même époque en Italie, en Allemagne et en Angleterre, c’est alors qu’on peut reconnaître chez nous la main d’un peuple puissant, doué d’une sève et d’une énergie rares, et qu’on se demande, non sans quelque tristesse, comment il se fait que ces belles et nobles qualités soient méconnues, et qu’un esprit étroit et exclusif ait pu parvenir à répudier de pareilles œuvres en les rejetant dans les limbes de la barbarie ?
Une coupe transversale, faite sur l’axe des tours, sur les passages ouverts sur le mâchicoulis et sur la chambre du levage des herses (fig. 16), montre l’intérieur des salles circulaires de ces tours, les passages A sur le chemin de ronde des courtines, la coupe B des hourds et tout le système de la défense à l’intérieur.


Cette façade, crénelée à son sommet, fait assez voir que les portes des places bien défendues pouvaient à la rigueur tenir lieu de petites citadelles et se défendre au besoin contre les citoyens qui eussent voulu capituler malgré la garnison. Alors la porte est toujours un poste isolé, commandé par un chef sûr, et pouvant encore résister en cas de trahison ou d’escalade du rempart. Nous faisons ressortir, à l’article Architecture Militaire, l’importance de ces postes isolés dans le système défensif du moyen âge, et il ne paraît pas nécessaire de revenir ici sur ce sujet.
Laissant de côté, pour le moment, des ouvrages d’une moindre importance, mais de la même époque, c’est-à-dire du commencement du XIIIe siècle, nous allons examiner comment, dans l’espace d’un siècle, ces dispositions avaient pu être modifiées dans la construction de portes d’une force semblable.
Sur le flanc oriental de la cité de Carcassonne, il existe une porte défendue d’une manière formidable, et désignée sous le nom de porte Narbonnaise[13]. Cette porte et tout l’ouvrage qui s’y rattache avaient été bâtis par Philippe le Hardi, vers 1285, lorsque ce prince était en guerre avec le roi d’Aragon.
Nous présentons (fig. 18) le plan général de cette entrée, avec sa barbacane et ses défenses environnantes[14].
Des salles F, on prenait deux escaliers à vis qui montaient au premier étage, d’où se faisait la manœuvre des herses. Sous ces salles sont pratiqués de beaux caveaux pour les provisions.
Des palissades de bois P empêchaient le libre parcours des lices entre les remparts extérieur et intérieur, et ne permettaient pas d’approcher du pied des courtines intérieures en M et en K. Les rondes seules pouvaient passer par les barrières N, afin de faire leur service de nuit. Une énorme tour, indiquée au bas de notre figure, et dite tour du Trésau[17], commandait ces lices, et servait encore d’appui à la porte Narbonnaise en battant les dehors par-dessus l’enceinte extérieure. La figure 19 donne le plan du premier étage de la porte Narbonnaise.




Avant de quitter cet édifice si remarquable à tous égards, il est nécessaire de rendre compte du jeu des herses, parfaitement visible encore.
Nous prenons pour exemple la seconde herse, celle qui est manœuvrée extérieurement sur le chemin de ronde du côté de la ville (fig. 23).
Il ne paraît pas que cet ouvrage ait jamais été attaqué, et depuis l’époque de sa construction, l’histoire ne signale aucun siège en règle de la cité de Carcassonne, bien qu’à plusieurs reprises le pays ait été envahi, soit par les troupes du prince Noir, soit par les troupes de l’Aragon, soit dans des temps de guerres civiles. C’est qu’en effet, avec les moyens d’attaque dont on disposait au moyen âge, la cité était une place imprenable, et la porte Narbonnaise, la seule accessible aux charrois, eût pu défier toutes les attaques.
Lorsqu’on visite cette porte dans tous ses détails, outre la beauté de la construction, la grandeur des dispositions intérieures, on est émerveillé du soin apporté par l’architecte dans chaque partie de la défense. Rien de superflu, aucune forme qui ne soit prescrite par les besoins ; tout est raisonné, étudié, appliqué à l’objet, Nous ne connaissons aucun édifice qui ait un aspect plus grandiose que cette large façade plate donnant du côté de la ville. Ce n’est qu’un mur percé de fenêtres et de meurtrières ; mais cela est si bien construit, cela prend un si grand air, qu’on ne peut se lasser d’admirer, et qu’on se demande si la scrupuleuse observation des nécessités en architecture n’est pas un des moyens les plus puissants de produire de l’effet.
Le mode d’attaque des places devait nécessairement influer sur les dispositions données aux portes fortifiées. Lorsque les armées assiégeantes n’avaient pas encore adopté des moyens réguliers, méthodiques, pour s’emparer des places, il est clair que leurs efforts devaient se porter sur les issues. La première idée qui venait au commandant d’une armée assiégeante, dans des temps où l’on ne possédait pas des moyens destructifs organisés, était naturellement d’entrer dans la place assiégée par les portes, et de concentrer tous ses moyens d’attaque sur ces points faibles ; aussi, par contre, les assiégés apportaient-ils alors à la défense de ces portes un soin minutieux, accumulaient-ils sur ces points tous les obstacles, toutes les ressources que leur suggérait leur esprit subtil. Cependant, déjà vers la fin du XIIe siècle, Philippe-Auguste avait su faire des sièges réguliers, conduits avec méthode et à l’instar de ce que faisaient les Romains en pareil cas. Pendant le XIIIe siècle, quelques sièges bien conduits indiquent que l’art d’attaquer les places se maintenait au point où Philippe-Auguste l’avait amené[22] ; mais les progrès sont peu sensibles, tandis que l’art de la défense se perfectionne d’une manière remarquable. À la fin du XIIIe siècle, la défense des places avait acquis une supériorité évidente sur l’attaque, et lorsque les places sont bien munies, bien fortifiées, elles ne peuvent être réduites que par un blocus étroit. Mais dès le commencement du XIVe siècle, les engins s’étant très-perfectionnés, les armées agissant avec plus de méthode et d’ensemble, on voit apparaître dans l’art de la fortification des modifications importantes. D’abord les ouvrages de bois, qui occupent une si large place dans les forteresses jusqu’alors, disparaissent ; et en effet, à l’aide d’engins puissants, surtout après l’expérience acquise en Orient pendant les dernières croisades, on mettait le feu à ces hourds, si bien garnis qu’ils fussent de peaux fraîches ou de feutres mouillés. On renonça donc d’abord aux hourds de bois mobiles, établis seulement en temps de guerre, et on les remplaça par des hourds de pierre, des mâchicoulis[23]. Puis les perfectionnements apportés dans l’attaque étaient assez notables pour qu’on ne s’attachât plus à forcer les portes ; on pratiquait des galeries de mine, on affouillait les fondations des tours, on les étançonnait avec du bois, et en mettant le feu à ces soutiens, on faisait tomber des ouvrages entiers. On possédait des engins destructifs assez puissants pour battre en brèche des points saillants, ou pour jeter dans une place une si grande quantité de projectiles de toutes sortes, des matières enflammées, infectantes, qu’on la rendait inhabitable. Dès lors la défense des portes prenait moins d’importance. Il ne s’agissait plus que de les mettre à l’abri d’un coup de main, de les bien flanquer et de leur donner assez de largeur pour qu’une troupe pût rentrer facilement après, une sortie, ou prendre l’offensive en cas d’un échec essuyé par l’assiégeant.
Ces portes étroites et basses des XIIe et XIIIe siècles, si prodigieusement garnies d’obstacles, prennent de l’ampleur ; les petites chicanes accumulées sous leurs passages disparaissent, mais en revanche les flanquements et les ouvrages avancés sont mieux et plus largement conçus ; les défenses extérieures deviennent parfois ce qu’on appelait alors des bastilles, c’est-à-dire de véritables forteresses à cheval sur un passage.
Philippe le Bel fit élever, pendant les dernières années du XIIIe siècle, en face d’Avignon, une citadelle importante[24], ouverte par une seule porte, du côté accessible, c’est-à-dire au midi, en face de la petite ville de Villeneuve-lez-Avignon. Cette porte est flanquée de deux grosses tours couronnées de mâchicoulis. Son ouverture, au point le plus étroit, est de 4m,20, largeur inusitée pour les portes des XIIe et XIIIe siècles. Nous en donnons le plan à rez-de-chaussée (fig. 24).


Mais la place de Villeneuve-lez-Avignon est située sur une colline de roches abruptes, et sa porte s’ouvre en face d’un contre-fort descendant vers la plaine. Dans une pareille situation, il n’est besoin ni de fossés, ni d’ouvrages avancés très-forts, car l’assiette du lieu offre déjà un obstacle difficile à vaincre. La circulation des allants et venants se borne à des sorties et à des rentrées d’une garnison. La porte que nous venons de présenter ci-dessus est donc plutôt l’entrée d’un château que d’une ville populeuse et dont les issues doivent être laissées libres tout le jour. Les portes de la ville d’Avignon étaient bien, au XIVe siècle, des ouvrages disposés pour une cité fortifiée, mais contenant une population nombreuse et active.
Les remparts d’Avignon furent élevés de 1348 à 1364. Ils étaient percés, soit du côté du Rhône, soit du côté de la plaine, de plusieurs portes, parmi lesquelles nous choisirons la porte Saint-Lazare, l’une des mieux conservées et sur laquelle nous possédons des documents complets[26]. La porte Saint-Lazare d’Avignon fut détruite, ou du moins fort endommagée par une inondation formidable de la Durance en 1358. Elle fut reconstruite sous Urbain V, vers 1364, avec toute la partie des remparts qui s’étend de cette porte au rocher des Doms, par l’un des architectes du palais des Papes, Pierre Obreri, si l’on en croit la tradition.
Voici (fig. 27) le plan général de cette porte, avec le châtelet qui la couvrait.
Les arrivants se présentaient par une voie B sur le flanc du châtelet ; ils devaient franchir un premier pont-levis C, traverser l’esplanade du châtelet diagonalement, se faire ouvrir une barrière D ; passer sur un second pont-levis E, entrer dans un ouvrage avancé F fermé par le pont-levis et défendu par deux échauguettes avec mâchicoulis ; se présenter devant la porte protégée par une ligne de mâchicoulis supérieurs, par une herse et par un second mâchicoulis percé devant les vantaux. Le châtelet était complétement entouré par un fossé G rempli d’eau, de même que le grand fossé H protégeait les remparts. Ces fossés étaient alimentés par les cours d’eau naturels qui cernent la ville sur toute l’étendue des murailles ne faisant pas face au Rhône.
Trois tours peu élevées flanquaient le châtelet. On montait à l’étage supérieur de ces tours et aux crénelages des courtines par les escaliers K. Une vue cavalière (fig. 28), prise du point X de notre plan, fera saisir l’ensemble de cette porte avec ses défenses antérieures. Les trois tours du châtelet étaient voûtées et couvertes par des plates-formes dallées à la hauteur du crénelage.



La porte Saint-Lazare d’Avignon est remarquable déjà par la simplicité des constructions. Ici on ne voit plus cette accumulation d’obstacles dont la disposition compliquée devait souvent embarrasser les défenseurs. Les portes d’Avignon ne sont pas, il est vrai, très-fortes, mais elles ont bien le caractère qui convient à l’enceinte d’une grande ville. La porte Saint-Lazare, avec son boulevard ou barbacane extérieure, protégeait efficacement un corps de troupes voulant tenter une sortie ou étant obligé de battre en retraite. On pouvait, sur l’esplanade du boulevard, masser facilement cinq cents hommes, protéger leur sortie au moyen des flanquements que fournissaient les tours ; et eussent-ils été repoussés, ils trouvaient dans cette enceinte un refuge assuré, sans que le désordre d’une retraite précipitée pût compromettre la défense principale, celle de la porte tenant aux courtines. Enfin, le boulevard fût-il tombé aux mains de l’assiégeant, les défenses étant ouvertes complétement du côté de la ville, les assiégés, au moyen surtout de l’avant-porte crénelée, pouvaient contraindre l’assaillant à se renfermer dans les trois tours rondes et à laisser l’esplanade et les courtines libres, ce qui facilitait un retour agressif.
La disposition des portes ouvertes à travers une simple tour carrée, sans flanquements, appartient plus particulièrement à la Provence. Il existait à Orange, à Marseille, et il existe encore à Carpentras, à Aigues-Mortes, des portes de la fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, percées à travers des tours carrées sans échauguettes ou tourelles flanquantes ; tandis que les ouvrages de ce genre qui appartiennent au domaine royal sont, sauf de très-rares exceptions, munis de tours rondes ou de flanquements prononcés.
La petite ville de Villeneuve-sur-Yonne possède encore une très-jolie porte du commencement du XIVe siècle, qui, par la disposition de ses flanquements, mérite d’être signalée entre beaucoup d’autres.
Cette porte, modifiée au XVIe siècle, dans sa partie supérieure, par de nouvelles toitures, laisse cependant voir toutes ses dispositions primitives. La figure 31 en donne le plan.

En A, était un pont-levis flanqué par deux tourelles angulaires formant éperons et pleines dans leur partie inférieure. En B, était un large mâchicoulis, bouché aujourd’hui, qui protégeait la première herse C. Des vantaux de bois fermaient le passage en E. En G, est la seconde herse précédée d’un second mâchicoulis, et en I une seconde paire de vantaux. On montait aux étages supérieurs de la porte et aux courtines par les deux escaliers extérieurs H. En P, se présentaient obliquement, à l’extérieur, deux grands mâchicoulis qui battaient le pont-levis et à travers lesquels passaient les chaînes servant à enlever le tablier. Le tracé M donne le plan de la partie supérieure de la porte. On voit les deux échauguettes flanquantes crénelées qui commandent le pont et les dehors ; en N, les deux mâchicoulis obliques à travers lesquels passent les chaînes O du pont-levis ; en S, le treuil servant à manœuvrer les chaînes ; en T, la défense supérieure dominant tout l’ouvrage.


On comprend qu’un pareil ouvrage, si peu étendu qu’il soit, devait être très-fort. D’ailleurs les courtines avaient un grand relief, et étaient renforcées sur le front opposé à la rivière par un gros donjon cylindrique qui existe encore. Toute l’enceinte de cette petite ville, si gracieusement plantée sur les bords de l’Yonne, n’était percée que de quatre portes semblables, deux sur les fronts d’amont et d’aval, et deux autres, l’une près du donjon, l’autre en face du pont jeté sur l’Yonne. Six tours cylindriques plantées aux angles formés par les courtines complétaient les défenses. Quant au donjon, il est séparé de la courtine, qui s’infléchit en demi-cercle pour lui faire place, par un fossé. Il ne se reliait au chemin de ronde que par un pont volant et était percé, vers les dehors, d’une poterne au niveau de la contrescarpe du fossé.
En 1374, le roi Charles V fit refaire l’enceinte de Paris sur la rive gauche, en reculant les murs fort au delà des limites établies sous Philippe-Auguste. Cette nouvelle enceinte suivait à peu près la ligne actuelle des boulevards intérieurs et était percée de six portes, qui étaient, en partant d’amont, les portes Saint-Antoine, du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, Montmartre, Saint-Honoré. La plupart de ces portes étaient établies sur plan carré ou barlong avec tourelles flanquantes. L’une des plus importantes, et dont il nous reste des gravures, était la porte Saint-Denis[28]. « Nos roys, dit Du Breul[29], faisans leurs premières entrées dans Paris, entrent par cette porte, qui est ornée d’un riche avant-portail, où se voyent par admiration diverses statues et figures qui sont faictes et dressées exprès, avec plusieurs vers et sentences pour explications d’icelles… C’est aussi par cette porte que les corps des défuncts rois sortent pour être portez en pompes funèbres à Saint-Denys en France… » La porte Saint-Denis de Paris était bâtie fort en saillie sur les courtines et formait un véritable châtelet, dans lequel on pouvait faire loger un corps de troupes. En 1413, le duc de Bourgogne se présenta devant Paris vers Saint-Denis, dans l’intention, disait-il, de parler au roi ; mais, dit le Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de Charles VI[30], « on lui ferma les portes, et furent murées, comme autreffois avoit esté, avecques ce très grant foison de gens d’armes les gardoient jour et nuyt… »
Et en effet, la plupart de ces portes furent murées plusieurs fois pendant les guerres des Armagnacs et Bourguignons. Ainsi, à cette époque encore, au commencement du XVe siècle, on ne se fiait pas tellement aux fermetures ordinaires des portes de villes qu’on ne se crût obligé de les murer en cas de siège. Il faut dire que ce moyen était particulièrement adopté lorsqu’on craignait quelque trahison de la part des habitants. Alors les portes devenaient des bastilles, des forts, permettant de réunir des postes nombreux sur l’étendue des remparts.
Les portes bâties à Paris sous Charles V se prêtaient parfaitement à ce service, ainsi qu’on peut le reconnaître en examinant la vue cavalière que nous donnons de la porte de Saint-Denis (fig. 34).
Cette porte fut restaurée ou plutôt modifiée au XVIe siècle. Les crénelages supérieurs furent remplacés par des parapets destinés à recevoir de l’artillerie. Elle fut démolie sous Louis XIV, pour être remplacée par l’arc triomphal qui existe encore aujourd’hui et qui se reliait à un système de courtines et de bastions non revêtus.
Notre vue cavalière fait voir la petite cour intérieure, qui était nécessairement entourée de meurtrières au premier étage, de façon à couvrir de projectiles les assaillants qui auraient pu forcer le pont-levis. Le premier étage contenait ainsi des salles sur les quatre côtés de la cour, pouvant renfermer une assez nombreuse garnison. Deux escaliers pratiqués dans les tourelles en arrière-corps desservaient ces salles et l’étage supérieur crénelé, couvert en terrasse. Probablement les arcades latérales étaient percées de larges mâchicoulis, et dans leurs murs de fond donnant sur la cour s’ouvraient des meurtrières enfilant l’intervalle entre la fausse braie et la courtine.
En dehors, des barrières et palissades défendaient les approches du ponceau[32], protégé lui-même par un crénelage et deux échauguettes.
Comme tous les ouvrages élevés à Paris pendant le moyen âge, ces portes étaient bien exécutées en maçonnerie revêtue de pierres de taille, et possédaient ce caractère grandiose, monumental, qui indiquait la grande ville.
Cette enceinte, percée de belles portes, s’appuyait à l’est sur la Bastille, construite en même temps, mais achevée seulement au commencement du règne de Charles VI[33].
Vers le commencement du XVe siècle, l’art de la fortification des places tendait à se modifier. Du Guesclin avait pris de vive force un si grand nombre de places sans recourir à la méthode régulière des sièges, que l’on devait chercher dorénavant à éloigner les assaillants par des ouvrages avancés étendus, particulièrement en dehors des portes ; ouvrages qui formaient de larges boulevards quelquefois reliés entre eux par des caponnières en terre ou de simples palissades. On reconnaissait, au moment où l’artillerie à feu commençait à jouer un rôle dans les sièges, qu’il était important de couvrir les approches des portes par des terrassements ou des murs épais, peu élevés, commandés par les courtines et les tours.

Il existe encore à Nevers une belle porte de la fin du XIVe siècle ou des premières années du XVe, qui possède les restes très-apparents du grand ouvrage avancé qui la protégeait. La porte du Croux (c’est ainsi qu’on la nomme) se compose (fig. 35) d’un boulevard A, avec épaisse muraille basse B sur les chemins de ronde, de laquelle on montait par un escalier C, pris dans l’épaisseur d’un mur de contre-garde D, qui flanque la porte extérieure E, protégée par un fossé F et fermée par un pont-levis. Cette première entrée était enfilée par la courtine D′. Un corps de troupes pouvait être massé dans l’espace A, qui avait à peu près la forme d’un bastion et qui n’était mis en communication directe avec le chemin G que par la poterne H. Si l’assaillant parvenait à forcer la première porte E, il se trouvait pris en flanc par les défenseurs logés en A. Peut-être existait-il autrefois un pont volant mettant le boulevard A en communication avec les remparts de la ville. L’espace I n’était qu’une berge, et en K était creusé le fossé entourant les murs de la place. La porte L, peu étendue, flanquait les épaisses courtines M. Elle était fermée par des ponts-levis et des vantaux en P. Outre l’issue destinée aux chariots, cette défense possède une poterne latérale, avec petit pont-levis particulier, suivant un usage généralement admis depuis le XIVe siècle. Le couloir de cette poterne, détourné, bien que permettant le jeu du bras du petit pont-levis, était mis en communication avec la ville par la porte R, et avec le grand passage charretier par la porte S. Des barres étaient encore placées en T, de sorte que si l’on voulait faire entrer des piétons ou une ronde dans la ville, on abaissait seulement le pont-levis de la poterne, et ces gens devaient se faire reconnaître par la garde postée en L avant de pouvoir pénétrer dans la cité. Le couloir de la poterne, par sa configuration irrégulière, rendait le passage des piétons plus difficile, et faisait que, toutes les petites portes étant ouvertes, un homme placé sur le pont-levis ne pouvait voir ce qui se passait au delà de la défense, dans l’intérieur de la ville. On arrivait au premier étage de la porte par l’escalier O, et de ce premier étage aux crénelages et mâchicoulis supérieurs par un escalier intérieur de bois.


En L, nous montrons l’un des tourillons des bras, et en M l’entaille ferrée dans la pierre, destinée à recevoir ces tourillons.
On a de nos jours rendu la manœuvre des ponts-levis plus facile et plus sûre, au moyen de treuils, de poulies avec chaînes à la Vaucanson, mais le principe est resté le même.
Les ponts-levis des poternes se relevaient au moyen d’un seul bras, à l’extrémité extérieure duquel était suspendue une fourche de fer recevant les deux chaînes. Mais nous aurons l’occasion de parler de ces ponts-levis en nous occupant spécialement des poternes[34].
L’emploi de l’artillerie à feu contre les places fortes obligea de modifier quelques-unes des dispositions défensives des portes dès le XVe siècle : mais alors l’artillerie de siège était difficilement transportable[35], et le plus souvent les armées assiégeantes n’avaient que des pièces de petit calibre ; ou bien si elles parvenaient à mettre en batterie des bombardes d’un calibre très-fort, ces sortes de pièces n’envoyaient que des boulets de pierre en bombe, comme les engins à contre-poids. Si ces gros projectiles, en passant par-dessus les murailles d’une place assiégée, pouvaient causer des dommages, ils ne faisaient pas brèche et rebondissaient sur les parements des tours et courtines, pour peu que les maçonneries fussent épaisses et bien faites. Les ingénieurs militaires ne se préoccupaient donc que médiocrement de modifier l’ancien système défensif, quant aux dispositions d’ensemble, et n’avaient guère apporté de changements que dans les crénelages, afin de pouvoir y poster des arquebusiers. Nous avons un exemple de ces changements dans une des portes antérieures de la petite ville de Flavigny (Côte-d’Or).

Olivier de Clisson, le frère d’armes de du Guesclin, qui fit aux Anglais une guerre si désastreuse, était un général d’un rare mérite, et qui fortifia un assez grand nombre de châteaux en Poitou, sur les frontières de la Bretagne et de la Guienne. Il adopta, pour les défenses des portes, un système qui paraît lui appartenir. Il élevait une tour ronde sur un pont, et la perçait d’un passage fermé par des herses et des vantaux. Sur le pont de Saintes, il existait une porte de ce genre[36], et l’on en voit encore quelques-unes dans les provinces de l’Ouest. Une des portes de l’enceinte du château de Montargis présentait cette disposition, et le vide central de cette tour, à ciel ouvert, permettait d’écraser, du sommet de l’ouvrage, les assaillants qui se seraient introduits entre les deux portes percées dans les parois opposées du cylindre[37]. Les tours rondes servant de portes, qui paraissent appartenir à l’initiative du connétable Olivier de Clisson, sont habituellement très-hautes, c’est-à-dire donnant un commandement considérable sur les alentours. Elles sont isolées et ne se relient pas aux courtines des enceintes. Ce sont de petites bastilles à cheval sur un pont, de sorte que les assiégés enfermés dans ces postes, n’ayant que des moyens de retraite très-peu sûrs, étaient plus disposés à se défendre à outrance. Il arrivait assez fréquemment, en effet, que les portes se reliant aux courtines, si bien munies qu’elles fussent, devenant l’objet d’une attaque très-vive et tenace, étaient abandonnées peu à peu par les défenseurs, qui trouvaient, par les chemins des courtines voisines, un moyen de quitter facilement la partie, sous le prétexte d’étendre le champ de la défense. Enfermée dans une tour isolée servant de porte, la garnison n’avait d’autre ressource que de lutter jusqu’à la dernière extrémité. La disposition qui semble avoir été systématiquement adoptée par le connétable Olivier de Clisson est, d’ailleurs, conforme au caractère énergique jusqu’à la férocité de cet homme de guerre[38]. C’est ainsi que beaucoup des ouvrages militaires du moyen âge prennent une physionomie individuelle, et qu’il est bien difficile, par quelques exemples, de donner un aperçu de toutes les ressources trouvées par les constructeurs. Aussi ne prétendons-nous ici que présenter quelques-unes des dispositions les plus généralement admises ou les plus remarquables. Il n’est pas douteux, d’ailleurs, que dans les constructions militaires du moyen âge, les idées personnelles des seigneurs qui les faisaient élever n’eussent une influence particulière considérable sur les dispositions adoptées, et que ces seigneurs, en bien des circonstances, fournissent eux-mêmes les plans mis à exécution, tant est grande la variété de ces plans. Il est bon d’observer encore que si, pendant le moyen âge, les constructions des églises et des monastères sont souvent négligées ; que s’il est évident, dans ces constructions, que la surveillance a fait défaut, on ne saurait faire le même reproche aux travaux militaires. Ceux-ci, bien que très-simples, ou élevés à l’aide de moyens bornés parfois, sont toujours faits avec un soin extrême, indiquant la surveillance la plus assidue, la direction du maître. C’est grâce à cette bonne exécution que nous avons conservé en France un aussi grand nombre de ces ouvrages, malgré les destructions entreprises d’abord par la monarchie, à dater du XVIe siècle, pendant la révolution du dernier siècle, et enfin par les communes, depuis cette époque.
Avant de passer à l’examen des poternes, nous devons dire quelques mots des portes de barbacanes, c’est-à-dire appartenant à de grands ouvrages avancés, portes qui présentent des dispositions particulières.
Ce ne fut guère qu’au XIIIe siècle que l’on se mit à élever des barbacanes en maçonnerie. Jusqu’alors ces ouvrages avancés, destinés à faciliter les sorties de troupes nombreuses, ou à pratiquer des retraites, étaient généralement élevés en bois, et ne consistaient qu’en des terrassements avec fossés et palissades. Mais les assiégeants, mettant le feu à ces ouvrages, rendaient leur défense impossible ; on prit le parti, en dehors des places importantes, de construire des barbacanes en maçonnerie, et de les appuyer par des tours, au besoin. Toutefois on cherchait toujours à ouvrir ces défenses du côté opposé aux remparts formant le corps de la place, afin d’empêcher les assiégeants qui s’y seraient logés de pouvoir s’y maintenir. Les portes des barbacanes sont conçues suivant ces principes, et les défenses qui les composent sont ouvertes à la gorge.
Vers la fin de son règne, le roi Louis IX fit relever l’enceinte extérieure et réparer le château de la cité de Carcassonne. Du côté de la ville, il fit construire une barbacane sur plan semi-circulaire, qui défendait l’approche de la porte du château, porte que nous avons donnée figures 3, 4, 5 et 6[39]. La barbacane du château de Carcassonne, en forme de demi-lune, s’ouvre, sur les rues de la cité, par une porte d’une construction aussi simple que bien entendue ; et cette porte, ne débordant pas le nu du mur circulaire composant la barbacane, est ouverte entièrement du côté de l’intérieur, de sorte que les défenseurs de l’entrée du château pouvaient voir complétement ceux de la porte de la barbacane et même leur donner des ordres. Si les assiégeants s’emparaient de cette première entrée, il était facile de les couvrir de projectiles.

Voici, figure 40, en A, le plan de cette porte au niveau du sol, l’extérieur de la barbacane étant en B. Un mâchicoulis C défend les vantaux se fermant en D. En E, est l’entrée de l’escalier à ciel ouvert qui monte à l’étage supérieur ; en F, une armoire destinée à renfermer les falots et autres ustensiles nécessaires au service. Le plan G est pris à l’étage supérieur crénelé, auquel on arrive par l’escalier I et le degré J. Les chemins de ronde K de la courtine circulaire sont placés à un mètre en contre-bas du sol L. On voit en M l’ouverture du mâchicoulis qui protège les vantaux. Des créneaux latéraux enfilent les chemins de ronde, qui sont isolés de l’étage défensif de l’ouvrage par deux portes O. Cet étage supérieur, comme l’entrée à rez-de-chaussée, est commandé par les défenses de la porte du château.



Assez généralement, cependant, les portes des barbacanes s’ouvraient latéralement dans des rentrants, afin d’être bien couvertes par les saillants, et alors elles n’étaient que des issues ne se défendant pas par elles-mêmes[40]. Ces barbacanes, vers le commencement du XIVe siècle, prirent une importance plus considérable au point de vue de la défense ; elles se munirent de tours, ainsi que nous l’avons montré plus haut en nous occupant de la porte Saint-Lazare d’Avignon ; elles prirent le nom de châtelets, de bastilles, de boulevards, et leurs portes, tout en étant commandées par les ouvrages intérieurs, furent souvent flanquées de tourelles ou d’échauguettes. Telles étaient défendues la porte des deux moulins, à la Rochelle, située derrière la tour du phare[41] ; celles de Saint-Jean-d’Angély, de Saint-Jacques, à Paris ; d’Orléans, etc.
Parmi ces portes précédées de bastilles, une des plus remarquables, était celle du château de Marcoussis, qui datait de la fin du XIVe siècle, et dont la destruction est si regrettable. Là le système défensif était complet. L’avant-porte s’ouvrait sur le côté d’un châtelet carré, défendu par deux tours. Du châtelet on communiquait à l’entrée de la forteresse par un pont fixe, de bois, jeté sur un large fossé plein d’eau, et un pont-levis. Cette entrée était flanquée de deux grosses tours, puis s’élevait au delà la tour du coin, surmontée d’une guette très-élevée qui permettait de voir tout ce qui se passait dans le châtelet et au dehors. La porte du château et ses ouvrages de défense commandaient absolument le châtelet à très-petite portée[42].
Portes de donjons. Poternes. — Les donjons possédaient des portes défendues d’une façon toute spéciale. Ces portes étaient souvent relevées au-dessus du niveau du sol extérieur, afin de les mettre à l’abri d’une attaque directe ; des échelles de bois étaient alors disposées par la garnison pour pouvoir entrer dans ces réduits ou en sortir. Mais on comprend que cette disposition présentait de graves inconvénients. Si les défenseurs du château ou de la ville étaient obligés de se réfugier précipitamment dans le donjon, ce moyen d’accès était insuffisant, et il advenait (comme cela s’est présenté pendant la dernière phase du siége du château Gaillard par Philippe-Auguste[43]) que les défenseurs, pris de court, n’avaient pas le temps de rentrer dans le réduit. Aussi chercha-t-on à rendre les portes de donjons aussi difficiles à forcer que possible, en laissant aux assiégés les moyens de se réfugier en masse serrée dans la défense extrême, s’ils étaient pressés de trop près. Beaucoup de donjons possédaient deux poternes, l’une apparente, l’autre souterraine, qui communiquait avec les dehors, de telle sorte que si une garnison pensait ne pouvoir plus tenir dans la place, soit par suite de la vigueur de l’attaque, soit par défaut de vivres, elle pouvait se dérober et ne laisser aux assaillants qu’une forteresse vide. Les gros donjons normands sur plan-carré étaient habituellement ainsi disposés[44]. Mais cependant, une fois les garnisons enfermées dans leurs murs, il leur devenait bien difficile de les franchir devant un ennemi avisé, soit pour s’échapper, soit pour tenter des sorties offensives, car les poternes souterraines n’étaient pas tellement secrètes que l’assiégeant ne pût en avoir connaissance, et les portes relevées au-dessus du sol extérieur étaient difficiles à franchir en présence de l’assiégeant. Ces problèmes paraissent avoir préoccupé le constructeur de l’admirable donjon de Coucy. Ce donjon possède une porte percée au niveau de la contrescarpe du fossé creusé entre la tour et sa chemise, et une petite poterne relevée au niveau du chemin de ronde de cette chemise, chemin de ronde qui est mis en communication, par un escalier, avec une poterne aboutissant aux dehors de la place[45]. La porte du donjon de Coucy, percée à rez-de-chaussée, est combinée avec un soin minutieux ; elle permet à la garnison, soit de franchir rapidement ce fossé, soit de descendre sur le sol dallé qui en forme le fond, et de joindre la poterne extérieure, soit de protéger un corps de troupes pressé de très-près par des assaillants ; de plus, cette porte est, contrairement aux habitudes du temps, très-richement décorée de sculptures d’un beau style.


Le tympan de la porte est décoré d’un bas-relief représentant le sire de Coucy combattant un lion, conformément à la légende. Des personnages en costumes civils ornent la première voussure, des crochets feuillus la seconde. On observera que des deux barres d’appui f′, la barre f′ seule est placée à l’aplomb de la longrine isolée du tablier et laissait un mâchicoulis ouvert : c’est que cette barre d’appui, étant placée du côté attaquable, se trouvait réunie, comme nous l’avons dit, à la longrine par un mantelet en bois percé d’archères. Par la même raison, de ce côté, l’épaulement d était destiné à empêcher les traits qui auraient pu être lancés par les assiégeants obliquement, de frapper, en ricochant, les défenseurs descendant par l’échelle au fond du fossé.
Tout est donc prévu avec une subtilité rare dans cet ouvrage ; mais il faut reconnaître que le donjon de Coucy est une œuvre incomparable, conçue et exécutée par des hommes qui semblent appartenir à une race supérieure. Dans cette forteresse, l’art le plus délicat, la plus belle sculpture, se trouvent unis à la puissance prévoyante de l’homme de guerre, comme pour nous démontrer que l’expression de l’utile ne perd rien à tenir compte de la beauté de la forme, et qu’un ouvrage militaire n’en est pas moins fort parce que l’ingénieur qui l’élève est un artiste et un homme de goût. À côté de cette œuvre vraiment magistrale, la plupart des portes de donjons ne sont que des issues peu importantes. Leurs fermetures consistent en des herses ou des ponts à bascule, ou de simples vantaux protégés par un mâchicoulis. Nous devons mentionner cependant les portes étroites munies d’un pont-levis à un seul bras, et qui se voient dans les ouvrages militaires des XIVe et XVe siècles.
Voici (fig. 46) quelle est la disposition la plus générale de ces portes.

Elles se composent d’une baie d’un mètre de largeur au plus et de 2 mètres à 2m,50 de hauteur, surmontée d’une rainure destinée à loger le bras unique supportant une passerelle mobile. En A, est présentée la face de la porte extérieurement ; en B, sa coupe ; en C, son plan. L’unique bras D, suspendant la passerelle, pivote sur les tourillons a, et vient, étant relevé, se loger dans la rainure E. Alors le tablier G entre dans la feuillure g et ferme hermétiquement l’entrée. Ce tablier est suspendu au moyen d’une chaîne à laquelle est attaché un arc de fer K, qui reçoit deux autres chaînes L, lesquelles portent le bout de la passerelle M. Le bras relevé, l’arc de fer vient se loger en l, et les chaînes, étant inclinées en retraite, forcent le tablier à entrer en feuillure ; presque toujours une herse ferme l’extrémité postérieure du passage de la porte, comme l’indique notre figure. Nous avons donné quelques exemples de portes de villes qui possèdent, à côté de la porte charretière, une de ces poternes à pont-levis, mue par un seul bras (voy. fig. 34 et 35). Lorsqu’il s’agissait de faire sortir ou rentrer une ronde ou une seule personne la nuit, on abaissait la passerelle de la poterne ; on évitait ainsi de manœuvrer le grand pont-levis, et l’on n’avait pas à craindre les surprises. Quelquefois, pour les entrées des donjons, la passerelle consistait en une échelle qui s’abattait jusqu’au sol, alors la chaîne était mue par un treuil et un bras.
Mais il est une série de poternes de places fortes qui présentent une disposition toute spéciale. Il fallait, lorsque ces places contenaient une garnison nombreuse, pouvoir les approvisionner rapidement, non-seulement de projectiles, d’armes et d’engins, mais aussi de vivres. Or, si l’on considère que la plupart de ces places sont situées sur des escarpements ; que leur accès était difficile pour des chariots ; que les entrées en étaient étroites et rares ; qu’en temps de guerre, l’affluence des charrois et des personnes du dehors devenait un danger ; que les gardes des portes devaient alors surveiller avec attention les arrivants ; que parfois on s’était emparé de villes et de châteaux en cachant dans des charrettes des hommes armés et en obstruant les passages des portes, on comprendra pourquoi les approvisionnements se faisaient du dehors sans que la garnison fût obligée d’abaisser les ponts et de relever les herses. Alors ces approvisionnements étaient amenés à la base d’une courtine, en face d’une poterne très-relevée au-dessus du sol extérieur, dans un endroit spécial, bien masqué et flanqué ; ils étaient hissés dans la forteresse au moyen d’un plan incliné, disposé en face de cette poterne. Il y avait au Mont-Saint-Michel-en-mer une longue trémie ainsi pratiquée sur l’un des flancs de la forteresse supérieure, en face de la porte de mer. Cette trémie, en maçonnerie, aboutissait à une poterne munie d’un treuil, et ainsi les vivres et tous les fardeaux étaient introduits dans la place, sans qu’il fût nécessaire d’ouvrir la porte principale. Cette trémie fonctionne encore, et les approvisionnements de la forteresse ne se font que par cette voie. Le château de Pierrefonds possédait aussi sa poterne de ravitaillement. Nous avons indiqué sa position dans le plan de ce château (voy. Château, fig. 24, et Donjon, fig. 41 et 44). Le château de Pierrefonds pouvait facilement contenir une garnison de 1 200 hommes ; il fallait donc trouver les moyens de la munir d’une quantité considérable de vivres et d’objets de toutes sortes, d’armes et de projectiles, en un court espace de temps, si comme il arrivait souvent pendant le moyen âge, on se trouvait tout à coup dans la nécessité de se mettre en défense. Eût-il fallu introduire les chariots, les bêtes de somme et les gens du dehors dans la cour du château, pour compléter le ravitaillement, que l’encombrement eût été extrême, que la place eût été ouverte à tout ce monde, et qu’il eût été impossible à l’intérieur, pendant ce temps, de préparer la défense et d’adopter les mesures d’ordre nécessaires en pareil cas. La cour, embarrassée par tous ces chariots, ces ballots, ces bêtes et ces gens, n’eût présenté que confusion ; impossible alors de faire entrer et sortir des gens d’armes, de disposer des postes, et surtout de cacher ses moyens de défense. On conçoit alors pourquoi l’architecte du château avait combiné une poterne permettant l’introduction de ces approvisionnements, sans que les gens du dedans fussent gênés ni ralentis dans leurs dispositions, et sans qu’il fût nécessaire de faire entrer ni un chariot, ni un homme étranger à la garnison dans la place. Non-seulement la poterne de ravitaillement du château de Pierrefonds est élevée de 10 mètres au-dessus du chemin extérieur qui pourtourne la forteresse ; mais elle donne dans une cour spéciale, séparée elle-même de la cour principale du château par une porte fermée par une herse, par des vantaux, et protégée par les mâchicoulis (voy. Château, fig. 24, et Donjon, fig. 41). Cette poterne de ravitaillement est percée à travers une haute courtine ayant 3 mètres d’épaisseur. Son seuil, comme nous venons de le dire, est placé à 10 mètres au-dessus du niveau du sol extérieur. Un plan incliné, en maçonnerie et charpente, s’élevait du chemin jusqu’à un niveau en contre-bas de 2 mètres du seuil et à 4 mètres de distance de la courtine. Il restait ainsi, entre le sommet du plan incliné et la poterne, une coupure qui était franchie par le pont-levis lorsqu’on l’abattait.
La poterne de ravitaillement du château de Pierrefonds est peut-être une des plus complètes et des plus intéressantes parmi ces ouvrages de défense. La simplicité de la manœuvre, la rapidité des moyens de fermeture, la beauté de la construction, ne laissent rien à désirer. Le même château possède une poterne basse, du côté du nord, qui était destinée à la sortie et à la rentrée des rondes. Cette poterne, qui s’ouvre dans un souterrain, et n’était fermée que par des vantaux, possède un porte-voix pris dans la maçonnerie, à côté du jambage de gauche et qui correspondait à deux corps de garde, l’un situé à rez-de-chaussée, l’autre au premier étage (voy. la description du château de Pierrefonds). On voit aussi parfois des poternes qui s’ouvrent sur un passage détourné, et dont l’issue est commandée par des meurtrières (voy. le plan du château de Bonaguil, à l’article Château, fig. 28).
Mais nous ne pouvons donner dans cet article tous les exemples si variés de poternes. Il en était de ce détail de la fortification comme de toutes les autres parties des places fortes ; chaque seigneur prétendait posséder des moyens de défense particuliers, afin d’opposer à l’assaillant des chicanes imprévues, et il est à croire que, dans les longues heures de loisir de la vie des châtelains, ceux-ci songeaient souvent à doter leur résidence de dispositions neuves, subtilement combinées, qui n’avaient point encore été adoptées.
Portes d’abbayes, de monastères. — Il est rare que les portes d’établissements religieux, pendant le moyen âge, aient l’importance, au point de vue de la défense, des portes de châteaux. Il paraît que les moines, sans négliger entièrement les précautions adoptées dans les résidences féodales (car ils étaient seigneurs féodaux), voulaient conserver à leurs établissements le caractère pacifique qui convenait à l’institution. Excepté dans quelques abbayes, qui, comme celle du Mont-Saint-Michel-en-mer, étaient des forteresses du premier ordre, les entrées, tout en présentant quelques signes de défense, n’accumulent pas les obstacles formidables qui font, de la plupart des portes de châteaux, des ouvrages compliqués et étendus. Ces portes de monastères ne sont pas précédées d’ouvrages avancés, de barbacanes, de boulevards ; elles s’ouvrent directement sur la campagne, quelquefois même sans fossés ni pont-levis, et leurs défenses sont plutôt un signe féodal qu’un obstacle sérieux. La porte de l’abbaye de Saint-Leu d’Esserent, qui date XIVe siècle, est construite d’après ces données mixtes : c’est autant une porte de ferme qu’une porte fortifiée. Nous en présentons (fig. 48) la face du dehors.


Nous craindrions de fatiguer nos lecteurs en ajoutant d’autres exemples à ceux déjà fort nombreux que nous avons donnés touchant les portes fortifiées ; mais ce détail de l’architecture militaire du moyen âge est d’une si grande importance, que nous devions réunir au moins les types les plus remarquables. Nous sommes loin d’avoir épuisé ce sujet, et il y aurait à faire sur les portes fortifiées du XIe au XVe siècle un ouvrage tout entier. Nous n’avons pas parlé des portes détruites aujourd’hui entièrement, mais sur les dispositions desquelles il reste des documents précieux. Telles sont, par exemple, les portes de Troyes, de Sens, de Paris. Parmi les portes de villes encore debout et qui méritent d’être étudiées, nous citerons celles de Provins, de Moret, de Chartres, de Gallardon, de Dinan, de Vézelay, qui, bien que d’une médiocre importance, ne sont pas moins des ouvrages remarquables. Les ruines de nos châteaux féodaux présentent aussi de beaux spécimens de portes[49], et jusque vers la fin du XVIe siècle, les dispositions adoptées pendant le moyen âge sont conservées dans ces sortes d’ouvrages.
Portes extérieures d’églises. — Il faut distinguer les portes principales des églises des portes secondaires. Les portes principales, placées généralement sur l’axe de la nef centrale, sont larges, décorées relativement avec recherche, et présentent souvent, par la sculpture qui couvre leurs tympans, leurs voussures et leurs pieds-droits, une réunion de scènes religieuses qui sont comme la préface du monument. Nous ne possédons pas de portes d’églises ayant quelque importance, au point de vue de la sculpture, avant le commencement du XIIe siècle. Celles qui existent encore, et qui datent d’une époque plus reculée, sont d’une forme très-simple et ne paraissent avoir été décorées que par des moulures, des tympans imbriqués ou couverts de peinture. Nous aurons l’occasion de parler de ces portes du XIe siècle, remarquables plutôt par leur structure que par leur ornementation. Quand il s’agit d’architecture religieuse, il faut toujours recourir à l’ordre de Cluny, si l’on veut trouver les éléments d’un art complet, formé, affranchi des tâtonnements, étranger aux imitations grossières de l’architecture antique romaine.
La porte principale de la grande église abbatiale de Cluny, dont il ne reste que des gravures, ne datait guère que du milieu du XIIe siècle, tandis que celle de l’église abbatiale de Vézelay fut élevée dès les premières années de ce siècle. Comme composition, c’est certainement une des œuvres les plus remarquables et des plus étranges du moyen âge, au moment où les artistes abandonnent les traditions antiques gallo-romaines, mêlées d’influences byzantines, pour chercher de nouveaux éléments. Nous croyons donc devoir présenter cette œuvre en première ligne, car elle a servi de type, évidemment, à un assez grand nombre de compositions du XIIe siècle, en Bourgogne, dans la haute Champagne et une partie du Lyonnais.
Que signifient ces bas-reliefs ? Il faut d’abord observer qu’ils tiennent la place occupée dans des tympans de la même époque, ou peu s’en faut (comme celui de la cathédrale d’Autun, par exemple), par les scènes du jugement dernier, de la séparation des élus des damnés. Alors les élus occupent le linteau de gauche (celui qui est à la droite du Christ), et les damnés le linteau de droite. Si l’on se reporte au temps où fut sculptée la porte principale de l’église de la Madeleine, on observera que les moines de Vézelay avaient atteint un degré de puissance et d’influence tel, qu’il fallut près d’un siècle de luttes sanglantes entre ces religieux, les comtes de Nevers et les habitants de la commune de Vézelay, pour amoindrir ce pouvoir exorbitant. Pour les abbés de Vézelay, l’action la plus louable, celle qui devait faire gagner le ciel, était certainement le payement régulier des redevances dues à l’abbaye, l’apport de dons ; et, jusqu’au milieu du dernier siècle, bien que l’abbaye de Vézelay fût sécularisée depuis le XVIe, il y avait encore, à Vézelay, une fête dite de l’Apport, et qui consistait à remettre à l’abbé des produits du sol, des bestiaux et des volailles.
Pour nous, le linteau de gauche représente les élus, c’est-à-dire ceux qui apportent à l’abbaye les produits de leur chasse, de leur pêche, de leurs champs. Le linteau de droite représente les damnés, ou plutôt les damnables. On remarquera d’abord, de ce côté, la figure de saint Pierre qui garde les portes du Paradis, et probablement celle de sainte Madeleine, qui intercède pour les pécheurs[52]. Les personnages qui remplissent ce linteau représenteraient donc les vices ou les péchés. Les guerriers combattants personnifieraient la discorde, la guerre ; le petit homme montant à cheval à l’aide d’une échelle, l’orgueil[53] ; la famille qui semble se quereller, la colère ; et enfin, la famille aux grandes oreilles, peut-être la calomnie. Nous ne prétendons donner cette explication autrement que comme une hypothèse, déduite d’ailleurs de beaucoup d’autres exemples tirés de l’église de Vézelay elle-même. Plusieurs chapiteaux représentent également des vices personnifiés. Et, d’ailleurs nul archéologue n’ignore que, sur les portails de nos cathédrales, sont figurés fréquemment les vices et les vertus en regard. Nous y reviendrons. Au-dessus de ces deux linteaux, si étrangement composés, se développe la grande scène du Christ dans sa gloire, entouré des douze apôtres, tous nimbés, tous tenant des livres ouverts ou fermés, hormis saint Pierre, qui porte deux clefs. Des mains du Christ s’échappent douze rayons qui aboutissent aux têtes des apôtres.
Mais la difficulté de l’interprétation se présente encore pour les sujets de la première voussure. En partant du compartiment de gauche, par le bas, on voit deux personnages assis, tenant chacun un scriptional sur leurs genoux[54]. Dans le compartiment suivant, au-dessus, est un homme richement vêtu, et une femme coiffée d’un bonnet conique. Dans le troisième compartiment, des hommes qui paraissent discuter, l’un d’eux est échevelé ; et dans le dernier compartiment on remarque deux hommes à tête de chien. De l’autre côté du Christ, le compartiment supérieur contient des personnages dont les nez sont faits en façon de groin de porc. Les trois autres cases sont remplies de figures parmi lesquelles on distingue un groupe de guerriers.
S’il faut donner une explication à ces sujets, nous serions portés à croire qu’ils représentent les divers peuples de la terre. On sait la créance qu’on donnait, pendant le moyen âge, aux fables recueillies par Pline, et corrompues encore après lui, touchant les peuplades de l’Afrique et des contrées hyperboréennes.
Ainsi, sur le tympan de Vézelay, le Christ serait placé au milieu du monde, entouré des peuples de la terre[55]. Les médaillons qui remplissent la deuxième voussure, et qui sont au nombre de vingt-neuf, représentent le zodiaque et diverses occupations ou travaux de l’année. Un ornement court sur la dernière voussure.
La sculpture de la porte principale de l’église de Vézelay est traitée de manière à fixer l’attention. Très-découpée, ayant un haut relief, les détails sont exécutés avec une grande finesse. On ne peut méconnaître le style grandiose de ces figures, l’énergie du geste, et souvent même la belle entente des draperies. Mais, à l’article Statuaire, nous aurons l’occasion de faire ressortir les qualités singulières de cette école clunisienne. Les profils sont beaux, et la sculpture d’ornement d’une hardiesse et d’une largeur de composition qui produisent un effet saisissant[56]. Il faut reconnaître que toutes les portes romanes pâlissent à côté de cette page, conçue d’une façon tout à fait magistrale.
Toutes les figures et les ornements de la porte principale de la Madeleine de Vézelay étaient rehaussés de traits noirs sur un ton monochrome blanchâtre. Nous n’avons pu découvrir, sur ces sculptures, d’autres traces de coloration.
À Autun, la porte principale de la cathédrale présente une disposition analogue à celle de Vézelay, mais sa sculpture, bien que d’une époque un peu plus récente, n’a pas un caractère aussi puissant. La composition manque d’ampleur et d’originalité. À Autun, cette double ordonnance des pieds-droits et du trumeau n’existe plus ; les colonnettes s’élèvent jusqu’au niveau du linteau. Les profils sont maigres, la statuaire plate et sans effet. Cependant la porte de la cathédrale d’Autun est encore une œuvre remarquable. On peut en saisir l’ensemble sur la figure 13 de l’article Porche.
Parmi les portes d’églises du XIIe siècle, les plus remarquables, il faut citer aussi celle de Moissac. Cette porte s’ouvre latéralement sur le grand porche dont nous avons donné le plan figure 24, à l’article Porche. Elle est élevée sous un large berceau qui forme lui-même avant-porche et qui est richement décoré de sculptures en marbre gris. Son trumeau est couvert de lions entrelacés qui forment une ornementation des plus originales et d’un grand effet. Les pieds-droits se découpent en larges dentelures sur le vide des baies, et le linteau présente une suite de rosaces circulaires d’un excellent style[57]. Dans le tympan, est assise une grande figure du Christ bénissant, couronné ; autour de lui sont les quatre signes des évangélistes, deux anges colossals, et les vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse. Les voussures ne sont remplies que par des ornements. Mais, sur les jambages du berceau formant porche, sont sculptés, à la droite du Christ, les vices punis ; à la gauche, l’annonciation, la visitation, l’adoration des mages et la fuite en Égypte.
Il nous serait difficile de présenter les exemples les plus remarquables des portes d’églises du moyen âge. Une pareille collection nous entraînerait bien au delà des limites de cet ouvrage. Nous devons chercher au contraire à circonscrire notre sujet, à donner quelques types principaux, et surtout à étudier les progrès successifs des écoles diverses qui ont abouti aux œuvres magistrales du XIIIe siècle. Il n’est pas besoin d’être fort versé dans l’étude de nos anciens monuments, pour reconnaître que les portes principales des églises en France présentent une variété extraordinaire dans leur disposition et leur ornementation, tout en se conformant, par leur structure, à un principe invariable. Ainsi, les portes principales, c’est-à-dire qui possèdent de larges baies, se composent toujours d’un arc de décharge sous lequel est posé le linteau, et un remplissage, qui est le tympan. Si ces portes doivent donner accès à la foule, dès le XIIe siècle, elles se divisent en deux ouvertures séparées par un trumeau. Ce trumeau reçoit le battement des deux vantaux et soulage le linteau au milieu de sa portée. C’est là une disposition qui appartient à notre architecture du moyen âge, et qui ne trouve pas d’analogues dans l’antiquité. La porte principale de l’église abbatiale de Vézelay, que nous avons donnée (fig. 51), est certainement une des premières constructions de ce genre et l’une des plus remarquables par l’ordonnance double des pieds-droits et du trumeau, qui a permis de diminuer la portée des linteaux en laissant le plus large passage possible à la foule. En allant chercher les exemples d’architecture byzantine qui ont si puissamment influé au XIIe siècle sur notre art national, nous ne trouvons pas un exemple de portes avec trumeaux et rangées d’arcs de décharge. L’influence de l’art byzantin se fait seulement sentir dans le système d’un arc soulageant un linteau, dans les profils et quelques ornements. On ne saurait donc méconnaître que les portes de Vézelay, d’Autun, de Moissac, appartiennent à l’art français, sinon par tous les détails, au moins par la disposition générale. Une fois admise, cette disposition dut paraître bonne, car elle ne cessa d’être adoptée jusqu’à la fin du XVe siècle. Pendant la seconde période du moyen âge, on ne trouve que bien peu de portes principales qui n’aient leur trumeau central servant de battement aux vantaux et offrant ainsi à la foule, comme les portes de villes de l’antiquité, deux issues, l’une pour les arrivants, l’autre pour les sortants. Ces trumeaux furent souvent enlevés, il est vrai, pendant le dernier siècle, pour donner passage à ces dais de menuiserie recouverts d’étoffe, qui servent lors des processions ; mais ces actes de vandalisme furent heureusement assez rarement commis.
Le principe admis, les architectes en surent tirer promptement tout le parti possible. Les arcs de décharge nécessaires pour soulager le linteau furent décorés de moulures, d’ornements, et bientôt de figures qui participaient à la scène représentée sur le tympan. Comme il s’agissait de percer ces portes sous des pignons très-élevés et lourds, on augmenta le nombre des arcs à mesure que les monuments devenaient plus grands. De là ces voussures à quatre, cinq, six et huit rangs de claveaux que l’on voit se courber au-dessus des tympans de nos cathédrales. Les portes formaient alors de profonds ébrasements très-favorables à l’écoulement de la foule, car on remarquera que ces arcs de décharge, ces voussures, se superposent en encorbellement, et que les pieds-droits qui les portent s’élargissent d’autant de l’intérieur à l’extérieur. Il y a encore, dans cette disposition, une innovation sur l’architecture antique de la Grèce et de Rome.
C’est aussi à Vézelay où nous voyons adopter la statuaire dans les voussures. Sur la porte principale de cette église, la tentative est encore timide. Le premier rang de claveaux décoré de sujets fait corps, pour ainsi dire, avec le tympan. Mais déjà à Avallon, l’église Saint-Lazare, qui date du milieu du XIIe siècle, présente des voussures dont chaque claveau est décoré d’une figure sculptée. Dès cette époque, ce système d’ornementation est admis, comme on peut le reconnaître en examinant les portes de l’église abbatiale de Saint-Denis, celles occidentales de la cathédrale de Chartres, et enfin la porte Saint-Marcel de la cathédrale de Paris, dont les fragments furent soigneusement réemployés au commencement du XIIIe siècle, lors de la construction de la façade actuelle. À ce propos, il est bon de signaler ce fait assez fréquent du réemploi des fragments de portes du XIIe siècle pendant le XIIIe. C’est qu’en effet, le XIIe siècle, dont l’art est si élevé, si puissant, avait su composer des portes d’une grande beauté, soit comme entente des proportions, soit comme détails de sculpture. Les architectes du XIIIe siècle, si hardis novateurs qu’ils fussent, si peu soucieux habituellement des œuvres de leurs devanciers, paraissent avoir été saisis de scrupules lorsqu’il s’agissait de faire disparaître certaines portes élevées pendant le siècle précédent. Ainsi, non-seulement sur la façade occidentale de la cathédrale de Paris, l’architecte replaça habilement le tympan, un linteau, la plus grande partie des voussures et les statues des pieds-droits d’une porte appartenant très-probablement à l’église refaite par Étienne de Garlande, au XIIe siècle ; mais, à la cathédrale de Chartres, nous voyons qu’on replace, sous la façade du XIIIe siècle, les trois portes qui autrefois s’ouvraient en arrière des deux clochers, sous un porche ; qu’à Bourges, l’architecte réemploie des fragments importants, sous les porches nord et sud, des deux portes du transsept de l’église du XIIe siècle ; qu’à la cathédrale de Rouen, on conserve, sur la façade occidentale, au XVIe siècle, deux portes du XIIe.
Ces œuvres d’art avaient donc acquis une célébrité assez bien établie pour qu’on n’osât pas les détruire dans des temps où cependant on ne se faisait aucun scrupule de jeter bas des constructions antérieures, surtout lorsqu’il s’agissait de cathédrales. Plus tard, on peut signaler le même esprit de conservation, le même respect, lorsqu’il s’agit de portes du XIIIe siècle. Quelques-unes de ces œuvres paraissaient assez belles pour qu’on les laissât subsister au milieu de constructions plus récentes. Sous le porche de Saint-Germain l’Auxerrois, à Paris, on voit que les architectes ont conservé une porte du XIIIe siècle, bien qu’ils aient entièrement rebâti la façade au XVe. À Saint-Thibaut (Côte-d’Or), une porte fort belle, du XIIIe siècle, reste enclavée au milieu de constructions du XIVe. À la cathédrale de Sens, les constructeurs qui relèvent la façade au commencement du XIVe siècle, conservent la porte principale datant de la fin du XIIe. À l’abbaye de Saint-Denis, la porte nord du transsept de Suger est laissée au milieu des reconstructions du XIIIe. À Auxerre, des portes datant du milieu du XIIIe siècle restent engagées dans les constructions refaites sur la façade au XVe. Et en effet, jamais les architectes des XIVe et XVe siècles, malgré leur savoir, malgré la profusion de leur ornementation, leur recherche des effets, ne purent atteindre à cette largeur de composition, à cette belle entente de la statuaire mêlée à l’architecture, qui étaient les qualités dominantes des artistes des XIIe et XIIIe siècles. Ils se rendaient justice en conservant ces débris qui, très-probablement, passaient avec raison pour des chefs-d’œuvre.
En nous occupant, avant toute autre, de la porte de l’église abbatiale de Vézelay, nous avons voulu donner un de ces exemples qui servent de point de départ, qui sont une innovation et prennent une influence considérable ; mais les principales écoles de la France, dès le commencement du XIIe siècle, avaient adopté, pour les portes des églises comme pour les autres parties de l’architecture, des types assez différents les uns des autres, bien que soumis au principe commun d’arcs et de linteaux indiqués plus haut. L’Auvergne, le Nivernais et une partie du Berry ; l’Île-de-France, la Champagne, la Picardie, la Normandie, le Poitou et la Saintonge, le Languedoc, la Bourgogne, présentaient alors huit types distincts qui se confondirent au XIIIe siècle dans l’unité gothique. Nous ne prétendons pas établir que ces provinces élevassent chacune de leur côté des portes d’églises suivant un modèle admis, invariable ; nous constatons seulement que l’on trouve, dans chacune de ces écoles, des similitudes, soit dans les proportions, soit dans les décorations, soit dans la construction ; qu’il est impossible, par exemple, de confondre une porte romane de la Champagne avec une porte de la même époque appartenant à un monument religieux de l’Auvergne ou du Poitou. C’est en Auvergne et dans le Nivernais, dans cette école romane si avancée dès le commencement du XIIe siècle, que nous trouvons les exemples de portes les plus remarquables par la façon dont elles sont composées et appareillées.
La porte principale de l’église Saint-Étienne de Nevers est un des exemples les plus francs de l’école des provinces du centre, et des plus anciens. Cette porte date des dernières années du XIe siècle. Elle était entièrement peinte. Les chapiteaux de ses colonnes n’étaient ornés que par de la peinture. Les claveaux, appareillés d’une façon remarquable, étaient également couverts de peintures représentant des oiseaux affrontés et des ornements sur fond noir. Nous donnons (fig. 52) le plan et l’élévation de cette porte.

L’ogive est tracée, les centres étant très-relevés et posés sur les points divisant le diamètre de la première archivolte en trois parties égales. Cette disposition a donné une proportion très-heureuse et des courbes complétement satisfaisantes. Il y a évidemment là des combinaisons étudiées, cherchées. On observera encore que comme construction, cette porte est sagement conçue ; le linteau et les tympans étant laissés indépendants des archivoltes et soutenus seulement par les saillies des deux corbeaux des pieds-droits. L’un de ces corbeaux, celui de droite, est décoré d’un ornement feuillu, celui de gauche est simplement mouluré.
Il est bon de faire ressortir par plusieurs exemples le caractère propre à quelques-unes de ces écoles dont nous parlions tout à l’heure. Les portes étant, dans les édifices religieux et civils du moyen âge, la partie traitée avec une attention toute spéciale, sont particulièrement empreintes du style admis par chacune de ces écoles. Si nous nous transportons en Picardie, province dans laquelle les monuments de l’époque romane sont devenus rares à cause de la qualité inférieure des matériaux, nous trouverons encore cependant quelques portes du commencement du XIIe siècle qui sont élevées sur un modèle très-différent de ceux de l’Île-de-France, de la Normandie et des provinces du Centre ou de l’Ouest.


Le style de cette porte se rapproche davantage du style adopté en Normandie et en Poitou que de tout autre, mais il est cependant plus lourd, plus massif. Les profils sont moins étudiés, la taille plus grossière. Il est évident que les architectes auteurs de ces œuvres appartenant à des édifices si voisins de Paris avaient été soustraits aux influences qui avaient agi si puissamment sur les artistes de Picardie, de l’Auvergne, du Berry, de la Bourgogne et du Midi. Les influences directes orientales n’avaient pas pénétré dans l’Île-de-France, le Beauvoisis et la Normandie. Les artistes de ces contrées restaient sous l’empire des traditions gallo-romaines et des objets envoyés de Constantinople ou de Venise, tels que certains meubles et bijoux, des ustensiles et des étoffes. C’est cependant au milieu de cette école de l’Île-de-France et des bords de l’Oise, que l’architecture appelée gothique prend naissance dès le milieu du XIIe siècle et se développe avec une rapidité prodigieuse. Ce qui tendrait à prouver une fois de plus que les croisades n’ont été pour rien dans cet essor de l’art propre à l’école laïque française, vers le milieu du XIIe siècle, et qu’au contraire, si les croisades ont eu une influence sur l’art de l’architecture chez nous, ce n’a été que sur certaines écoles romanes, et particulièrement sur celles de la Bourgogne, du Berry, du Lyonnais, des provinces méridionales et occidentales.
L’exemple que nous avons donné, figure 52, pris sur la porte principale de l’église de Saint-Étienne de Nevers, bien qu’il appartienne aux provinces du Centre et nullement à la Bourgogne, diffère cependant de la plupart des types adoptés à la même époque en Auvergne. Une porte latérale de l’église de Notre-Dame du Port, à Clermont (Puy-de-Dôme), nous fournit un spécimen bien caractérisé de ces baies d’églises auvergnates.
Sur l’un des flancs de la cathédrale du Puy en Velay, il existe une porte semblable à celle-ci comme structure, mais dont l’arc de décharge est déjà brisé. Ces portes datent des premières années du XIIe siècle, peut-être de la fin du XIe.
Pendant la première moitié du XIIe siècle, on élevait dans la Saintonge et l’Angoumois un nombre prodigieux d’églises remarquables par leur style et la beauté de leur structure. Les portes principales de ces églises sont toutes conçues, à peu près d’après un type uniforme. Elles sont basses, habituellement dépourvues de linteau et de tympan, et leurs archivoltes plein cintre sont très-richement décorées d’ornements empruntés, la plupart, au style oriental de la Syrie. Voici l’une de ces portes s’ouvrant sur la nef de l’église de Château-Neuf (Charente) (fig. 57).
Les portes des églises de Sainte-Croix à Bordeaux, de la grande église des Dames à Saintes, ont, avec celle donnée ci-dessous (fig. 57), la plus parfaite analogie. L’influence de ce style se répand jusque dans le Poitou, ainsi qu’on peut le reconnaître en examinant les portes de Notre-Dame la Grande, à Poitiers. Mais dans cette province, comme dans la Haute-Marne, apparaissent parfois, dès le commencement du XIIe siècle, les archivoltes à claveaux présentant chacun un bossage arrondi pareil à celles qui se voient sur le portail méridional de l’église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Ceci serait encore une preuve de la reconstruction d’une grande partie de l’église du Saint-Sépulcre par les croisés, si M. le comte de Vogué n’avait suffisamment indiqué les dates de cette reconstruction[62].
Bien que très-ornées de sculptures, les portes de la Saintonge, de l’Angoumois et du Poitou sont d’une proportion lourde, et n’ont pas l’élégance des portes des provinces du Centre. Leur ornementation est confuse et ne présente jamais cette large entente de l’effet, si bien exprimée dans la composition des portes de la Bourgogne, de la haute Champagne et du Lyonnais. Cependant, vers le milieu du XIIe siècle, on voit, dans une partie des provinces de l’Ouest, une étude délicate des proportions et de l’effet se développer, lorsqu’il s’agit de la composition des façades, et notamment des portes. L’église de Saint-Pierre de Melle (Deux-Sèvres) nous fournit un excellent exemple du progrès obtenu par les derniers architectes romans.


Les exemples que nous venons de donner des portes d’églises appartenant à quelques-unes des principales écoles romanes de France, qu’elles soient ou non pourvues de linteaux, partent tous d’un même principe de structure, simple, rationnel et qui demande à être expliqué.
Une épaisseur de mur étant donnée, lorsque les architectes du XIIe siècle voulaient y percer une porte principale, l’ébrasement intérieur et l’épaisseur du tableau étant réservés, il restait une certaine épaisseur de mur dont on profitait pour placer une, deux, trois, quatre colonnes et archivoltes, et même plus ; ces colonnes variant de 0m, 33 (un pied) de diamètre à 0m, 16 (six pouces), on procédait de cette façon (fig. 60).
Cette succession de carrés donnait la trace des sommiers des archivoltes, tracés en P ; ces archivoltes se recouvrant pour former un arc plus ou moins profond en décharge. Les colonnettes étaient posées en délit et monolithes, indépendantes de la bâtisse. Ainsi les nus des tailloirs des chapiteaux et les plinthes des bases, suivaient exactement les nus de la maçonnerie pleine, et chaque rangée de claveaux venait reposer sur les colonnettes. Les charges étant reportées sur les parties maçonnées BCB′EF, etc., il n’y avait alors aucune rupture à craindre. Plus tard, vers la fin du XIIe siècle, lorsque les archivoltes furent allégies et décorées de figures, on procéda d’après le même principe. Seulement, les colonnettes s’amaigrirent, les tailloirs s’obliquèrent souvent, suivant l’ébrasement, et les intervalles de ces colonnettes furent évidés, ainsi que l’indique le tracé T. À ces colonnettes s’adossèrent parfois des statues surmontées de dais dans la hauteur de l’assise des chapiteaux ou dans l’assise au-dessus, dais figurés en g sur le tracé T, et alors les claveaux des archivoltes furent appareillés et moulurés, comme le fait voir le tracé M, les épannelages h étant réservés pour les figures et les petits dais qui les séparent. Le principe roman était conservé, mais avec un perfectionnement et un allégissement ; les colonnes restaient habituellement indépendantes, c’est-à-dire monolithes. Cette règle présente plutôt des variétés dans l’application du principe, que des exceptions, comme nous le verrons.
Pour peu que l’on ait étudié les divers styles d’architecture antérieurs à cette période et étrangers à ceux de la France, on reconnaîtra qu’il y avait, dans ce principe de composition et de structure des portes, un élément nouveau, sans précédents, et qui se prête singulièrement à la décoration. En effet, lorsqu’il s’agissait d’ouvrir dans des grands murs de façade, épais, des baies assez larges pour faciliter l’entrée et la sortie de la foule, il fallait combiner ces baies de telle sorte, qu’elles pussent sans danger crever ces constructions massives et hautes, et en même temps s’ouvrir largement par des ébrasements. Le système d’archivoltes superposées, et formant comme une succession de cerceaux concentriques allant toujours en s’évasant du dedans au dehors, était très-bien trouvé au point de vue de la solidité et de l’effet. Ces archivoltes ébrasées formaient comme un large cadre autour du tympan, et il était naturel, celui-ci étant orné de bas-reliefs, de couvrir ces archivoltes de figures formant comme le complément de la scène principale, une assemblée de personnages participant à cette scène. Nous avons vu qu’à Vézelay déjà, ce parti est adopté. Nous le voyons développé aux portes occidentales de l’église de Saint-Lazare d’Avallon, au portail royal de la cathédrale de Chartres, et dans beaucoup d’autres églises élevées de 1150 à 1180. Maintenant nous allons examiner comme ce principe roman du XIIe siècle se modifie pour tomber dans la donnée gothique par plusieurs voies.
Évidemment, vers la seconde moitié du XIIe siècle, les architectes cherchaient dans la composition des portes, considérées comme une partie très-importante des édifices religieux, sinon de nouveaux principes, tout au moins des applications variées. La monotonie de composition des portes romanes dans chaque école fatiguait ; on voulait tenter du neuf, sans cependant abandonner la donnée première, qui paraissait excellente et qui l’est en effet. C’est ainsi, par exemple, que sur la façade de l’église de la Souterraine (Creuse), surmontée d’un gros clocher, on perçait une porte d’un aspect très-original, bien que son plan soit tracé conformément au mode d’ébrasement admis définitivement. Cette porte (fig. 61), comme la plupart de celles du Poitou et de la Saintonge, ne possède pas de linteau ni de tympan.

Or, on reconnaît aisément que dans cette province l’art s’est dégagé plus rapidement qu’ailleurs de la tradition romane. La porte de Villers-Saint-Paul est d’un style roman lourd, barbare même, si on le compare à celui des provinces du Centre, de l’Ouest et du Midi ; et tandis que dans ces dernières contrées, la transition du roman au gothique se fait péniblement, ou ne se fait pas du tout, nous voyons s’épanouir tout à coup, dans l’Île-de-France, en quelques années, un style délicat, sobre, rompant avec les traditions des âges précédents, tenant compte des proportions, en évitant les bizarreries si fréquentes au moment de la formation d’un art.
À Nesle, les colonnettes sont monostyles, indépendantes de la bâtisse ; le tracé du plan est, sauf plus de légèreté, tout roman ; mais les archivoltes se profilent de la façon la plus heureuse et la plus logique (voy. en A). La sculpture, rare, tandis qu’elle est prodiguée dans les portes romanes de la même contrée, est répartie par un artiste de goût sur les cordons, sur les pieds-droits, entre les colonnettes, comme pour faire ressortir celles-ci. Il y a évidemment ici réaction contre le style roman. Ce n’est pas une modification, c’est une rupture complète, qui devait amener rapidement les plus beaux résultats, puisque les portes occidentales de la cathédrale de Paris sont à peu près contemporaines de celle-ci, et que les portes des cathédrales d’Amiens et de Reims s’élèvent trente ou quarante ans plus tard[66].
Avant de nous occuper des portes si remarquables de quelques-unes de nos cathédrales françaises, nous croyons nécessaire de faire connaître encore certaines tentatives faites dans les provinces au moment où l’art s’affranchit des traditions romanes.
Pendant qu’on élevait les portes que nous avons figurées dans ces deux derniers exemples, c’est-à-dire de 1190 à 1200, on bâtissait en Bourgogne, près d’Avallon, un très-remarquable monument religieux, dont nous avons souvent l’occasion de parler, la petite église de Montréal (Yonne). Sa façade occidentale, entièrement lisse, n’est décorée que par une porte basse, large, et par une rose. La porte se distingue par la singularité de sa composition et par sa sculpture, qui est du plus beau style. Afin de pouvoir mieux faire apprécier cet ouvrage à nos lecteurs, nous adoptons une échelle qui permettra de prendre une idée plus exacte de son caractère, et nous ne donnons ainsi que la moitié de l’ensemble (fig. 63).
Bien que les murs de l’église de Montréal soient élevés en moellon smillé, les piles intérieures, les contre-forts et la façade sont construits en bel appareil de pierre de Coutarnoux (Champ-Rotard) ; les joints et lits étant fins et parfaitement dressés. Quant aux ravalements, ils sont faits avec un soin et une précision de taille tout à fait remarquables, et le charme de ce petit édifice consiste principalement dans la manière dont sont traités les profils et les tailles. Tous les parements droits ou unis sont layés à la laye ou au taillant droit, tandis que les moulures fines, comme les bases, les tailloirs, sont polies. Le contraste entre ces tailles donne quelque chose de précieux aux profils et arrête le regard.
Notre figure indique l’appareil, et permet de reconnaître qu’il est entièrement d’accord avec les formes adoptées. Les lits coïncident avec les membres de moulures, la hauteur des chapiteaux, des bandeaux, la division des redents décorant les pieds-droits et la disposition des membres des archivoltes. Les détails de l’architecture sont, de plus, traités avec un soin rare et par un artiste consommé ; les colonnettes des ébrasements sont monolithes, et entre elles, les angles des pieds-droits retraités sont ornés de fleurettes, deux dans chaque assise. À l’article Congé (fig. 3), nous avons donné la partie inférieure du trumeau, dont la composition est des plus originales. Mais, suivant l’habitude des architectes de la Bourgogne, vers la fin du XIIe siècle (car cette porte date de 1200 au plus tard), les moulures d’archivoltes, au-dessus du lit inférieur des sommiers, naissent au milieu d’ornements ou de demi-cylindres pris aux dépens de l’équarrissement du profil, ainsi que nous l’avons indiqué en A. Les moulures d’archivoltes ne reposent donc pas brusquement sur les tailloirs des chapiteaux et conservent de la force à leur souche. En B, est tracé le profil des archivoltes à l’échelle de 0m, 04 pour mètre. Chaque claveau étant profilé dans un épannelage rectangulaire tracé en a, c’est aux dépens des évidements b que sont taillées les souches feuillues ou composées de demi-cylindres horizontaux. Les vantaux de la porte de l’église de Montréal ont conservé leurs pentures de fer forgé, qui sont d’un dessin très-délicat.
La figure 64 donne en A le plan de cette porte.
L’architecture de Bourgogne, pendant les XIIe et XIIIe siècles, se recommande par l’ampleur et la hardiesse. Les profils, la sculpture, sont traités largement ; de plus, les compositions présentent un caractère d’originalité que l’on ne trouve pas développé au même degré dans les autres provinces françaises. La porte principale de l’église de la Madeleine de Vézelay, celle de l’église de Montréal, donnent la mesure de ces qualités particulières, et qui appartiennent au génie de la population établie sur cette contrée. En Bourgogne, l’architecture des XIIe et XIIIe siècles ne s’arrête pas à des types consacrés, elle cherche au contraire la variété, des voies nouvelles et hardies ; elle sait profiter des matériaux que fournit le sol, et son école de sculpteurs est puissante. Il existe encore, sous le porche de l’église de Saint-Père, ou plutôt de Saint-Pierre-sous-Vézelay (Yonne), une porte fort dégradée aujourd’hui, mais dont la composition est empreinte à un degré remarquable des qualités que nous venons de signaler.

Nous sommes obligés de nous borner et de laisser de côté quantité d’exemples de portes remarquables par la variété de leur composition et la beauté de leurs détails. Les exemples que nous venons de donner en dernier lieu, et qui appartiennent à la belle époque du moyen âge, font assez connaître que cette architecture gothique se développait, dans les diverses provinces françaises, avec une liberté d’allures bien éloignée de cet hiératisme dont on a parfois accusé les maîtres de cet art. Il arriva certainement un moment où l’architecture gothique admit des formules et tomba dans la monotonie ; mais même alors il se trouva des artistes qui surent conserver leur individualité, tout en profitant des données admises et des types consacrés, ainsi que nous le verrons bientôt. Pendant la période de formation, c’est toutefois par la liberté dans la composition et l’exécution que se recommande l’art gothique, bien qu’alors il restât soumis à des principes définis. C’est en cela que l’étude de cette architecture peut être profitable.
Nous avons vu comme l’école de Toulouse avait su concilier les traditions de l’architecture gallo-romaine avec les données byzantines recueillies en Orient. Une autre école voisine, celle de la Provence, s’était initiée plus intimement encore aux derniers vestiges de l’art gréco-romain, réfugié en Syrie. En examinant les portes de Saint-Gilles et de Saint-Trophime d’Arles, qui datent de la fin du XIIe siècle, on croirait voir les restes de ces monuments semés en si grand nombre sur la route d’Antioche à Alep. En effet, cette contrée fut conquise par les croisés en 1098, sous le commandement de Bohémond Ier, fils de Robert Guiscard ; et jusqu’en 1268, la principauté d’Antioche resta aux mains des Occidentaux. Les Provençaux étaient les intermédiaires naturels entre la France et les croisés établis en Syrie ; il n’est donc pas surprenant qu’ils aient rapporté, de ces contrées si riches en monuments romano-grecs, les éléments des arts qu’ils pratiquèrent en Occident pendant le XIIe siècle.
Mais les Provençaux possédaient chez eux de nombreux monuments de l’époque romaine ; et en s’inspirant du style rapporté d’Orient, ils y mêlaient, à une forte dose, les éléments romains épars sur leur sol. Ainsi, bien que les dispositions générales, les proportions, les profils, l’ornementation, soient presque entièrement empruntés à la Syrie, la statuaire est dérivée du style gallo-romain, avec quelques influences byzantines. Il n’en pouvait être autrement, puisque les édifices des environs d’Antioche sont totalement dépourvus de statuaire. Les belles portes des églises de Saint-Trophime d’Arles et de Saint-Gilles sont couvertes de figures fortement empreintes des traditions gallo-romaines. L’imagerie, abandonnée par les chrétiens d’Orient des Ve et VIe siècles, qui élevèrent les monuments dont nous venons de parler, resta toujours en honneur chez les Occidentaux. Ceux-ci suppléèrent à ce qu’il manquait aux modèles recueillies en Orient, par l’imitation des débris gallo-romains et des nombreuses sculptures que l’on rapportait sans cesse de Constantinople, et qui ornaient des meubles, des coffrets, des diptyques, des couvertures de manuscrits de bois, d’ivoire ou d’orfèvrerie. Byzance entretenait un commerce considérable avec tout l’Occident pendant les XIe et XIIe siècles, et la sculpture, malgré les iconoclastes, y avait toujours été pratiquée pour satisfaire au goût des Français, des Italiens et des Allemands. Il faut donc distinguer, dans nos monuments de Provence du XIIe siècle, ces deux éléments : l’un dérivé des formes architectoniques provenant de la principauté d’Antioche, l’autre issu des traditions gallo-romaines et des exportations d’objets fabriqués à Constantinople. Ces éléments connus et appréciés, cette architecture provençale du XIIe siècle s’explique naturellement. Si l’on ne tient compte de ces origines diverses, cette architecture est inexplicable, en ce qu’elle semble surgir tout à coup du milieu de la barbarie, en présentant les caractères d’un art très-avancé et plus près de la décadence que du berceau. On peut apprécier ces caractères en jetant les yeux sur la figure 66,

qui donne une partie de la porte de Saint-Trophime d’Arles. Comme structure, comme profils et ornementation, cette porte est toute romano-grecque syriaque ; comme statuaire, elle est gallo-romaine avec une influence byzantine prononcée. Son iconographie mérite d’être étudiée. Au centre du tympan, est le Christ couronné dans sa gloire, tenant le livre des Évangiles et bénissant ; autour de lui sont les quatre signes des évangélistes ; sous la première voussure, deux rangs d’anges adorateurs à mi-corps. Dans le linteau, sont sculptés les douze apôtres assis ; puis à la droite du Christ, sur le pied-droit, Abraham recevant les élus dans son giron. De ce même côté sont figurés, sur une haute frise, les élus vêtus, les femmes étant placées à la suite des hommes ; à la tête de cette théorie, sont deux évêques. Dans la frise, en pendant, à la gauche du Christ, sont les damnés, nus, reliés par une chaîne et marchant en sens inverse, conduits par un démon au milieu des flammes. Sur le chapiteau du trumeau est sculpté l’archange saint Michel, appuyé sur une lance. Entre les colonnes des larges pieds-droits de la porte, sont quatre apôtres, et en retour, des saints de la primitive Église. Un évêque, saint Trophime probablement, est sculpté dans un de ces compartiments. En regard, les âmes sortent de terre et sont enlevées par un ange et un diable. Si remarquable que soit l’architecture provençale du XIIe siècle, elle était frappée d’impuissance et ne savait produire autre chose que ces curieux mélanges d’imitations diverses. De ces mélanges il ne pouvait sortir un art nouveau, et en effet il ne sortit rien ; dès le commencement du XIIIe siècle, l’architecture provençale était tombée dans une complète décadence, il en fut tout autrement des écoles du Nord, de l’Île-de-France, de la Picardie, de la Bourgogne et de la Champagne. Ces écoles, qui s’étaient moins attachées à l’imitation des arts recueillis en Orient, qui n’en avaient reçu qu’un reflet assez vague, cherchèrent dans leur propre fonds les éléments d’un art ; et l’école laïque de la fin du XIIe siècle, s’appuyant sur une structure raisonnée et l’étude de la nature, dépassa rapidement ses aînées de la Provence et du Languedoc. La porte de Saint-Trophime d’Arles, malgré ses mérites au point de vue de la composition, des proportions et de la belle entente des détails, est évidemment un monument tout voisin de la décadence ; tandis que la porte de la Vierge du portail occidental de la cathédrale de Paris, qui ne lui est postérieure que de quelques années, est un monument empreint d’une verdeur juvénile, d’un style neuf, puissant, et qui promet une longue suite d’ouvrages du premier ordre. C’est que la porte de Saint-Trophime n’est qu’une œuvre provenant de sources diverses, qu’une habile imitation, tandis que la porte de la Vierge de Notre-Dame de Paris, tout en respectant des principes admis, est une œuvre originale qui n’emprunte aux arts antérieurs qu’une forme générale consacrée.
Parmi tant de jugements aventurés qui ont été pendant trop longtemps prononcés sur l’art de l’école laïque française du XIIe siècle, ou, si on l’aime mieux, sur l’art gothique, le plus étrange est certainement celui qui prétendait faire dériver cette architecture gothique des croisades. Les croisades ont eu sur l’art du moyen âge, au commencement du XIIe siècle, une influence incontestable, rapide, parfaitement appréciable, lorsque l’on compare les monuments gréco-romains de Syrie avec ceux élevés en France dans les provinces du Midi, du Centre et de l’Ouest. Mais l’architecture gothique, celle que l’école laïque du Nord élève vers la fin du XIIe siècle, est au contraire la réaction la plus manifeste contre cette influence venue d’Orient. Soit qu’on envisage l’architecture gothique au point de vue de la structure, du système des proportions ou des ordonnances, de l’emploi des matériaux, du tracé des profils, de la disposition des plans, de l’ornementation et de la statuaire, elle se sépare entièrement des principes rapportés d’Orient par les derniers architectes romans. Mais il est si facile d’admettre des jugements tout faits et de les accepter sans contrôle, que nous entendrons répéter longtemps encore que l’architecture gothique a été rapportée en France par les croisés qui ont suivi Louis le Jeune en Palestine, bien qu’il soit démontré aujourd’hui que les restes d’architecture rappelant les formes gothiques, et existant en Palestine, sont dus précisément aux croisés devenus maîtres de Jérusalem. Le petit nombre de Français qui revinrent en Occident après l’expédition de Louis le Jeune avaient certes bien autre chose à penser qu’à rapporter des formules architectoniques. Pour qu’un art, à de si grandes distances, passe d’un peuple chez un autre, il faut que des établissements permanents aient pu se constituer, que des relations se forment, que le commerce prenne un cours régulier. Ce ne sont pas des soldats qui rapportent un art dans leur bagage, surtout s’ils ont tout perdu en chemin. La principauté d’Antioche, fortement établie dès la fin du XIe siècle en Syrie, au milieu d’une contrée couverte littéralement d’édifices encore intacts aujourd’hui, a pu servir de centre d’études pour les artistes occidentaux ; mais il est en vérité assez puéril de croire que les croisés des XIIe et XIIIe siècles, qui n’ont pu s’établir nulle part, et n’ont tenté que des expéditions malheureuses, aient rapporté en France un art aussi complet et aussi profondément logique que l’est l’architecture dite gothique.
Il nous reste à étudier les portes d’églises dues incontestablement à l’art français du commencement du XIIIe siècle, en dehors de toute influence étrangère. Déjà celles que nous avons données dans cet article, provenant des églises de Nesle, de Montréal, de Saint-Père, sont franchement gothiques, bien qu’elles se rattachent par quelques points aux traditions romanes, ou qu’elles présentent des singularités. Maintenant nous entrons dans le domaine royal, nous ouvrons le XIIIe siècle, et la marche de l’architecture est suivie sans déviations, aussi bien dans l’exécution de ces vastes portails de nos églises que dans les autres parties de ces édifices. Nous prendrons d’abord la porte de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris, percée sur le collatéral nord, et qui est connue sous le nom de porte de la Vierge. La porte opposée à celle-ci, s’ouvrant sur le collatéral sud, est composée en grande partie avec des fragments provenant d’une porte du XIIe siècle, ainsi que nous l’avons expliqué plus haut. La porte centrale, élevée en même temps que celle de la Vierge, fut remaniée peu après, nous ne savons pour quelle raison, car nous avons découvert dans les fouilles des fragments d’un tympan primitif provenant du Christ et des figures qui l’entouraient. En effet, cette porte centrale paraît, par son style, être postérieure de quelques années à la porte de gauche. Celle-ci, dite de la Vierge, appartient aux premières constructions de la grande façade, et fut élevée par conséquent de 1205 à 1210. C’est une des plus belles conceptions de l’art du moyen âge, soit comme architecture, soit comme ornementation, soit comme statuaire. Elle est construite entièrement en matériaux de choix, liais-cliquart de la butte Saint-Jacques.
Si l’on jette les yeux sur le plan de la cathédrale de Paris (voy. Cathédrale, fig. 1), on observera que cette porte de gauche s’ouvre sous la tour, comme celle de droite, dans une salle voûtée au moyen d’arcs ogives croisés d’arcs-doubleaux, de sorte que l’un de ces arcs-doubleaux repose sur le trumeau de la baie double, et que les deux vantaux étant ouverts, ces deux baies donnent en face des deux bas côtés.
Le plan de la porte de la Vierge, (fig. 67) présente donc une disposition particulière, très-largement conçue.

Le second linteau représente l’ensevelissement de la Vierge. Deux anges tiennent le suaire et descendent le corps dans un riche sarcophage. Derrière le cercueil est le Christ bénissant le corps de sa mère ; autour de lui les douze apôtres, dont les physionomies expriment la douleur. Dans le tympan supérieur, la Vierge est assise à la droite de son fils, qui lui pose sur la tête une couronne apportée par un ange. Deux autres anges agenouillés des deux côtés du trône portent des flambeaux. Dans les quatre rangées de claveaux qui entourent ces bas-reliefs, sont sculptés des anges, les patriarches, les rois aïeux de la Vierge, et les prophètes. Un cordon couvert de magnifiques ornements termine les voussures. Mais comme pour donner plus d’ampleur à la courbe finale, une large moulure l’encadre en forme de gâble renfoncé. Cet encadrement repose sur deux colonnettes.
Huit statues garnissent les ébrasements, ainsi que l’indique notre plan (fig. 61). Voici comment se disposent ces figures. En commençant par le jambage à la droite de la Vierge, est placé saint Denis portant sa tête et accompagné de deux anges, puis Constantin. Contre l’ébrasement opposé, en face de Constantin, est le pape saint Sylvestre ; à la suite, sainte Geneviève, saint Étienne et saint Jean-Baptiste. Les statues étant posées sur les colonnettes de l’arcature inférieure, les tympans réservés entre les arcs qui surmontent ces colonnettes sont par conséquent sous les pieds des figures. Chacun de ces tympans porte une sculpture qui se rapporte au personnage supérieur. Sous Constantin, deux animaux, un chien et un oiseau, pour signifier le triomphe du christianisme sur le démon ; sous saint Denis, le bourreau tenant la hache ; sous les deux anges, un lion et un oiseau monstrueux, symboles des puissances que les anges foulent aux pieds ; sous saint Sylvestre, la ville de Byzance ; sous sainte Geneviève, un démon ; sous saint Étienne, un juif tenant une pierre ; sous saint Jean-Baptiste, le roi Hérode. Dans le fond de l’arcature, sous les petites ogives, sont sculptées en relief très-plat des scènes se rapportant également aux statues supérieures. Ainsi, sous Constantin, on voit un roi agenouillé, tenant une banderole, aux pieds d’une femme assise voilée, couronnée, nimbée, et tenant un sceptre. Cette femme, c’est l’Église ; à laquelle l’empereur rend hommage. Sous les anges, on voit les combats de ces esprits supérieurs contre les esprits rebelles. Sous saint Denis, son martyre ; sous saint Sylvestre, un pape conversant avec un personnage couronné ; sous sainte Geneviève, une femme bénie par une main sortant d’une nuée, et recevant l’assistance d’un ange ; sous saint Étienne, la représentation de son martyre ; sous saint Jean-Baptiste, le bourreau donnant la tête du précurseur à la fille d’Hérodiade. À la même hauteur, sur les jambages, sont sculptés, en e (voy. le plan), la Terre, représentée par une femme tenant des plantes entre ses mains ; en f, la Mer, figurée de même par une femme assise sur un poisson et tenant une barque. Les pieds-droits extérieurs de la porte, en h, sont couverts de végétaux sculptés avec une rare délicatesse ; les arbres et arbustes sont évidemment symboliques : on reconnaît parfaitement un chêne, un hêtre, un poirier, un châtaignier, un églantier.
Trente-sept bas-reliefs, sculptés sur les deux faces de chacun des pieds-droits de la porte en m, composent un almanach de pierre au-dessus des bas-reliefs de la Mer et de la Terre. Ce sont les figures du zodiaque et les divers travaux et occupations de l’année[69].
L’ensemble de cette composition, dont notre gravure ne peut rendre la grandeur et le caractère, forme ainsi un tout complet. D’abord la Vierge, dans son rôle de femme, élue pour détruire le règne du démon. Sa généalogie, les prophètes qui ont annoncé sa naissance ; sa mort, son couronnement dans le ciel. Puis les personnages qui ont inauguré l’ère chrétienne, saint Jean-Baptiste, saint Étienne, premier martyr, le pape saint Sylvestre et l’empereur Constantin ; et comme pour rattacher ce résumé au diocèse de Paris, saint Denis et sainte Geneviève. La Terre, la Mer, la révolution annuelle, assistent à cette épopée divine, et paraissent lui rendre un éternel hommage.
C’est ainsi que les artistes du commencement du XIIIe siècle savaient composer une porte de cathédrale. Et cependant que croyait-on voir dans tout cela il y a deux siècles ? Un symbole du grand œuvre, des figures cachant la découverte de la pierre philosophale ? Des ouvrages entiers ont été sérieusement écrits sur ces rêveries.
L’exécution répond en tout à la grandeur de la conception, et la statuaire de cette porte peut être mise au rang des plus belles œuvres dues aux artistes de l’Occident (voy. Statuaire).
La porte de la Vierge de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris est certainement une des premières compositions en ce genre. Supérieure aux œuvres analogues du XIIIe siècle, elle atteint du premier coup l’apogée de l’art. Si l’on étudie cette porte en dehors des influences qui prétendent classer tous les ouvrages du moyen âge au-dessous de ceux de l’antiquité, on reconnaît bientôt que jamais l’alliance de l’architecture et de la statuaire n’a été plus intime. L’échelle des figures est observée avec une délicatesse rare : qualité qui manque presque toujours aux œuvres postérieures, et trop souvent à celles de l’antiquité. S’il y a des différences entre les dimensions de ces figures, elles ne sont pas assez sensibles pour que leur réunion ne forme pas un ensemble complet. Les statues qui garnissent les voussures sont en effet à mi-corps, afin de leur donner une échelle en rapport avec celles qui garnissent les tympans.
Autrefois cet ensemble était couvert de peintures et de dorures, dont les traces sont encore visibles.
La porte centrale de la même église, bien que très-belle, le cède à la porte de la Vierge, soit comme composition, soit comme perfection d’exécution.
Ce grand parti est suivi dans toutes nos cathédrales du XIIIe siècle. Cependant, parfois, les tympans des portes furent percés de claires-voies, de véritables fenêtres vitrées. Telles sont disposées, par exemple, les trois portes de la façade occidentale de la cathédrale de Reims. C’est là une particularité qui semble appartenir à l’école champenoise, à dater du milieu du XIIIe siècle, mais qui demeure à l’état d’exception. Les tympans sculptés donnaient aux imagiers de trop belles pages à remplir pour que ceux-ci n’en profitassent pas ; et de fait, on n’a jamais su trouver de meilleures places pour développer des scènes sculptées. Aux deux portes de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris, celle centrale et celle de la Vierge, les figures qui décorent la partie supérieure des tympans sont des statues rapportées sur un fond, comme le sont les statues qui garnissaient les deux tympans des frontons du Parthénon, tandis que les linteaux sont des bas-reliefs en ronde bosse. Quant aux figures des voussures, elles sont sculptées, chacune, dans un claveau et avant la pose. On a lieu de s’étonner que cette époque ait pu fournir un nombre d’imagiers assez considérable pour permettre d’élever des portes aussi richement décorées en très-peu de temps, d’autant que les différences de faire sont peu sensibles, que toutes ces figures sont sculptées dans de la pierre dure comme du marbre, et toutes d’un style et d’une exécution remarquables. La porte de la Vierge contient neuf grandes statues ; vingt-huit figures, dont quelques-unes sont plus fortes que nature dans les linteaux et le tympan ; soixante-deux figures, dans les voussures, en pied ou à mi-corps, presque de grandeur naturelle ; de plus, vingt-neuf bas-reliefs, sans compter l’ornementation. La porte centrale, celle du Jugement dernier, contient treize statues de plus de deux mètres ; cinq figures colossales dans le tympan, cinquante figures petite nature dans les linteaux, cent vingt-six figures ou sujets petite nature dans les voussures, et quarante-deux bas-reliefs. Cela donne bien un peu à réfléchir sur la puissance de cette école de statuaire du commencement du XIIIe siècle ; toutes ces figures ayant dû être sculptées avant la pose, c’est-à-dire assez rapidement pour ne pas ralentir le travail du constructeur. Si l’on ajoute à ce nombre les sculptures de la porte Sainte-Anne, les vingt-huit statues colossales des rois de Juda, les quatre statues également colossales qui décorent les contre-forts, et que l’on se rappelle que ce portail, jusqu’à la hauteur de la galerie de la Vierge, dut être élevé en cinq années au plus, on peut bien se demander s’il serait possible aujourd’hui d’obtenir un pareil résultat. Et cette fécondité, cependant, n’est pas obtenue au détriment de l’exécution ou de l’unité dans le style ; on peut, certes, constater le travail de mains différentes, sans qu’il en résulte un défaut d’harmonie dans l’ensemble. Si les grandes portes du XIIIe siècle, appartenant aux cathédrales de Chartres, de Reims, d’Amiens, de Bourges, présentent des exemples admirables, on ne saurait cependant les considérer comme pouvant rivaliser avec les deux portes que nous venons de citer, et notamment avec celle de la Vierge de Notre-Dame de Paris. Cependant, à la base du transsept méridional de cette église, il existe une porte fort belle, datée de 1257, et qui peut être classée parmi les meilleures compositions en ce genre. Le tympan représente la légende de saint Étienne, et les voussures, des martyrs, des docteurs et des anges. Sur le trumeau est dressée la statue du saint, et dans les ébrasements sont placés des apôtres. Il est à croire que cette porte passa, au moment où elle fut bâtie, pour un chef-d’œuvre, car on la retrouve exactement copiée, sauf quelques détails, à la base du pignon méridional de la cathédrale de Meaux, mais par des mains moins habiles.
Il nous faut citer encore, parmi les portes du milieu du XIIIe siècle, remarquables par leur exécution et leur composition, celles de la sainte Chapelle de Paris, celle méridionale du transsept de l’église abbatiale de Saint-Denis, découverte depuis peu, et qui fut malheureusement mutilée pendant le dernier siècle pour construire un couloir entre l’église et la maison des religieux. Cette porte est, comme sculpture, une œuvre incomparable, et jamais la pierre ne fut traitée avec plus d’habileté.
La fin du XIIIe siècle et le XIVe siècle nous fournissent des exemples de portes bien composées et d’une exécution excellente ; mais, cependant, ces ouvrages sont tous empreints d’une maigreur de style qui fait regretter les conceptions incomparables du commencement du XIIIe siècle. Les détails d’ornements ne sont plus à l’échelle, les figures sont petites et les sujets confus. Les formes géométriques l’emportent sur la statuaire, l’enveloppent et la réduisent à un rôle infime. Les profils se multiplient, et à force de rechercher la variété, les artistes tombent dans la monotonie. Cependant nous serions injustes si nous ne constations les qualités qui distinguent quelques-unes de ces compositions. Bien des fois, dans cet ouvrage, nous avons l’occasion de citer l’église de Saint-Urbain de Troyes, monument des dernières années du XIIIe siècle, et dont la structure comme les détails ont une grande valeur. Cette église possède une porte centrale à l’occident, dont la composition est originale et gracieuse. La porte principale de l’église de Saint-Urbain s’ouvrait sous un porche qui ne fut pas achevé. Elle est dépourvue de voussures, le formeret de la voûte du porche lui en tenant lieu. Sur le trumeau central (voyez figure 69), s’élevait, croyons-nous, la statue de saint Urbain, pape[70].
En B, nous avons tracé le plan du trumeau.
C’est cependant sur ces compositions gracieusement agencées, mais qui manquent de style et de grandeur, que l’on juge habituellement l’art dit gothique. C’est comme si l’on prétendait apprécier l’art grec sur les compositions maigres et souvent maniérées du temps d’Adrien, au lieu de le juger sur les monuments du temps de Périclès.
On ne saurait nier toutefois qu’il y ait dans cette œuvre de la fin du XIIIe siècle, sinon beaucoup d’imagination, au moins une conception très-gracieuse, une étude fine des proportions et une perfection prodigieuse dans l’exécution des détails ; mais l’architecture l’emporte sur la statuaire, réduite à la fonction d’une simple ornementation. L’imagier n’est plus un artiste, c’est un ouvrier habile.
Ce qu’on ne saurait trop étudier dans les compositions du commencement du XIIIe siècle, c’est l’ampleur, les belles dispositions de la statuaire. Celle-ci, quoique soumise aux formes architectoniques, prend ses aises, se développe largement. On peut constater la vérité de cette observation, en examinant notre figure 68. Dans cette page, la statuaire remplit évidemment le rôle important, mais sans qu’il en résulte un dérangement dans les lignes de l’architecture. En comparant cette œuvre (la porte de la Vierge de la façade de Notre-Dame de Paris) avec les meilleures productions de l’antiquité, chacun peut constater qu’ici la statuaire est conçue d’après des données singulièrement favorables à son complet épanouissement. La pensée de former autour du tympan un encadrement de figures, une assemblée de personnages assistant à la scène principale, est certainement très-heureuse et neuve. Rien de pareil ni dans les monuments de la Grèce, ni dans les monuments de la Rome antique.
En appréciant les choses d’art avec les yeux d’un critique impartial, et en ne tenant pas compte des admirations toutes faites ou imposées par un esprit exclusif, il faudra bien reconnaître que dans la plupart des conceptions de l’école laïque du commencement du XIIIe siècle, la statuaire est répartie d’après des données plus vraies qu’elle ne l’a été dans les monuments de l’antiquité. Si nous prenons le chef-d’œuvre de l’art grec, le Parthénon, par exemple, nous voyons que la statuaire est placée dans le tympan du fronton, dans des métopes et sur des frises toujours plongées dans l’ombre, sous un portique dont le peu de largeur ne donnait pas une reculée suffisante pour apprécier la valeur de la sculpture. Les sujets posés entre les triglyphes, sous le larmier de la corniche, étaient, pendant une partie du jour, coupés par l’ombre de ce larmier. Ils sont trop petits d’échelle pour la place qu’ils occupent, surtout si on les compare aux statues des tympans.
Éloignée de l’œil, cette admirable statuaire de Phidias, qui, dans un musée, peut être étudiée et appréciée, perdait naturellement beaucoup. Mérite d’exécution à part, il n’est pas nécessaire de raisonner longuement pour prouver que la statuaire des portails de nos grandes cathédrales est plus favorablement disposée, et que, par conséquent, l’effet d’ensemble qu’elle produit sur le spectateur est plus complet et plus saisissant. Placer autour des portes, c’est-à-dire autour des parties d’un monument dont on peut le plus souvent et le plus aisément apprécier la richesse, ces myriades de figures qui participent à un sujet, c’est là certainement une idée féconde pour les artistes appelés à décorer ces vastes portails. Alors la statuaire peut être appréciée dans son ensemble comme composition, dans ses détails comme exécution. Elle n’est pas trop distante du spectateur pour que celui-ci ne puisse l’examiner à l’aise. Les rapports d’échelle, entre les figures, sont établis de façon à ne point présenter de ces contrastes qui choquent dans les monuments de l’antiquité. On ne trouve pas, ainsi que cela se voit trop souvent dans les édifices de la Rome impériale, par exemple, des figures en ronde bosse à côté de figures en bas-relief, sur une même échelle. À la porte de la Vierge de Notre-Dame, les sujets traités en bas-relief sont très-rapprochés de l’œil et d’une échelle très-réduite. Ils ne forment plus, pour ainsi dire, qu’une ornementation de tapisserie qui ne peut lutter avec la statuaire ronde bosse.
Il y a donc, dans ces compositions du moyen âge, de l’art, beaucoup d’art, et si, comme à Notre-Dame de Paris, ces compositions sont soutenues par une exécution et un style remarquables, nous ne comprenons guère comment et pourquoi ces œuvres ont été longtemps dédaignées, sinon dénoncées comme barbares. Convenons-en, les barbares sont ceux qui ne veulent pas voir ces ouvrages placés sous leurs yeux, et qui, sur la foi d’un enseignement étroit, vont étudier au loin des monuments d’un ordre très-inférieur à ceux-ci sous tous les rapports.
Les trois portes de la façade de la cathédrale de Paris, comme la plupart de celles élevées à cette époque (de 1200 à 1220), ont cela de particulier, qu’elles présentent une masse très-riche au milieu de surfaces unies, simples. Cette disposition contribue encore à donner plus d’éclat et d’importance à ces entrées. Elles ne sont reliées que par les niches décorant la face des contre-forts qui les séparent, niches qui abritent les quatre statues colossales de saint Étienne, de l’Église, de la Synagogue et de saint Marcel. Mais bientôt ce parti architectonique, d’un effet toujours sûr, parut trop pauvre. Les portes furent reliées à tout un ensemble d’architecture de plus en plus orné ; elles ne formèrent plus une partie distincte dans les façades, mais furent reliées, soit par des portails avancés, comme à Amiens, soit par un système décoratif général, comme à Reims, à Bourges, à Notre-Dame de Paris même, aux extrémités du transsept ; comme aux portails des Libraires et de la Calende à la cathédrale de Rouen. Cependant elles conservèrent leurs profondes voussures, leurs tympans, leurs trumeaux ; mais les archivoltes de ces voussures furent surmontées de gâbles presque pleins d’abord, comme aux portails nord et sud de Notre-Dame de Paris, comme à la porte principale de la cathédrale de Bourges, puis ajourées entièrement, comme à la cathédrale de Rouen et dans tant d’autres églises du XIVe siècle[71]. Ainsi que nous le disions tout à l’heure, à propos de la porte principale de Saint-Urbain de Troyes, la statuaire perdit l’ampleur que les artistes du commencement du XIIIe siècle avaient su lui donner ; les sujets des tympans se divisèrent en zones de plus en plus nombreuses ; les figures des voussures, en buste parfois, pour leur conserver une échelle en rapport avec celles des tympans, furent sculptées assises, ou même en pied, réduites de dimension par conséquent ; les dais séparant les statuettes des voussures prirent plus d’importance, ainsi que les moulures des archivoltes ; les statues des ébrasements entrèrent dans des niches séparées et ne posèrent plus sur une saillie prononcée, comme celles de la porte de la Vierge de Notre-Dame de Paris : des colonnettes s’interposèrent entre elles. Ces statues se perdent ainsi dans l’ensemble. À la fin du XIVe siècle, les formes de l’architecture et l’ornementation paraissent étouffer la statuaire. La grande école s’égare au milieu d’une profusion de détails trop petits d’échelle ; les formes s’allongent et les lignes horizontales tendent à disparaître presque entièrement. L’exécution cependant est parfaite ; l’appareil, le tracé des profils sont combinés avec une étude et un soin merveilleux.
On a pu remarquer dans les exemples de portes de la fin du XIIe siècle et du commencement du XIIIe précédemment donné, que les statues qui garnissent les ébrasements sont le plus souvent accolées à des colonnes portant un chapiteau surmonté d’un dais. Chaque statue faisait ainsi partie de l’architecture ; elle était comme une sorte de caryatide qu’il fallait poser en construisant l’édifice ; mais alors le mouvement, l’échelle de ces figures étaient ainsi associés intimement à l’ensemble. Plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle, on laissa, dans les ébrasements des portes, des rentrants qui permettaient de poser les statues après coup et lorsque la bâtisse était élevée. Cette méthode était certes plus commode pour les statuaires, en ce qu’elle ne les obligeait pas à hâter leur travail et à suivre celui des constructeurs, mais l’art s’en ressentit. Les figures, dorénavant faites à l’atelier, peut-être à intervalles assez longs, n’eurent plus l’unité monumentale si remarquable dans les édifices de la première période gothique. La statuaire, sujette de l’architecture pour les bas-reliefs et pour toutes les parties qu’il fallait poser en bâtissant, s’amoindrissant même pour mieux laisser dominer les formes architectoniques, s’émancipait lorsqu’il s’agissait de faire de grandes figures posées après coup. L’artiste perdait de vue l’œuvre commune, et tout entier à son travail isolé, comme cela n’a que trop souvent lieu aujourd’hui, il apportait de son atelier des figures qui sentaient le travail individuel et ne formaient plus, réunies, cet ensemble complet qui seul peut produire une vive impression sur le spectateur.
La finesse d’exécution, l’observation très-délicate d’ailleurs de la nature, la recherche dans les détails, une certaine coquetterie dans le faire, remplacent le style grandiose et sévère des artistes tailleurs d’images du XIIe siècle et du commencement du XIIIe. Il suffit d’examiner les portails du XIVe siècle pour être convaincu de la vérité de cette observation.
Parmi les grandes portes d’églises élevées vers le commencement du XIVe siècle, il faut noter entre les plus belles celles de la cathédrale de Rouen, les deux portes de la Calende et des Libraires, ou plutôt de la Librairie[72]. Malgré la profusion des détails, la ténuité des moulures et de l’ornementation, ces portes conservent cependant encore de masses bien accusées, et leurs proportions sont étudiées par un artiste consommé.
Bien que le format de cet ouvrage ne se prête guère à rendre par la gravure des œuvres aussi remplies de détails, cependant nous donnons ici l’une de ces deux portes de la cathédrale de Rouen, celle de la Calende. Cette porte (fig. 70) comprend de grandes lignes principales fortement accentuées ; elle se détache avec art entre les gros contre-forts qui l’épaulent.
Sur le trumeau était placée la statue du Christ, détruite aujourd’hui. Dans les ébrasements, dix apôtres, trois de chaque côté ; quatre statues se voient sur la même ligne, sur la face des gros contre-forts et sur les deux retours d’équerre. Les deux linteaux et le tympan représentent la Passion. Dans les voussures, sont sculptés des martyrs. Dans le lobe inférieur du grand gâble, le pèsement des âmes[73].
Malgré la belle entente des lignes et le choix heureux des proportions, on observera combien, dans cette porte, la statuaire est réduite, comme elle est devenue sujette des lignes géométriques. Dans les piédestaux qui supportent les statues sont sculptés des myriades de petits bas-reliefs représentant des scènes de l’Ancien Testament et des prophéties. Tout cela est d’ailleurs exécuté avec une rare perfection, et les statues, qui ne dépassent pas la dimension humaine, sont de véritables chefs-d’œuvre pleins de grâce et d’élégance.
Le gâble qui surmonte cette porte, plein dans sa partie inférieure jusqu’au niveau A de la corniche de la galerie, est complétement ajouré au-dessus de celle-ci, et laisse voir la claire-voie vitrée supportant la rose.
En B, est tracé le plan des ébrasements avec les contre-forts, et en C, le plan de ces contre-forts au niveau D. Examinons un instant le tracé des ébrasements et voussures, indiqué en E à une échelle plus grande. Les colonnettes a montent de fond, reposent sur un glacis avec socle inférieur, et forment les boudins principaux des voussures. Entre elles sont tracés les piédestaux portant les statues, et l’angle saillant sort de la ligne du socle en b. La projection horizontale des dais surmontant les grandes figures est un demi-hexagone c d e f ; le fond de la niche est la portion d’arc cd.
Au-dessus des dais couvrant les grandes figures viennent les voussoirs des archivoltes avec leurs dais i, l, m, n, donnant aussi l’épannelage des figurines. L’extrados de ces voussoirs est en p. On remarquera avec quelle méthode géométrique sont tracés, et les plans horizontaux, et les élévations de cette porte. La section inférieure B procède par pénétrations à 45º, formant toujours des angles droits, par conséquent un appareil facile, malgré la complication apparente des formes.
Mais, à l’article Trait, nous entrons dans de plus amples détails sur les procédés des maîtres du moyen âge, et notamment du commencement du XIVe siècle, lorsqu’il s’agit d’établir des plans superposés procédant tous d’un principe générateur admis dès la base de l’édifice.
On voit, par cet exemple, que les portes principales des églises ne sont plus des œuvres pouvant être isolées, qu’elles forment un tout avec le monument et entrent dans le système général de décoration. Plus on pénètre dans le XIVe siècle, plus ce principe est suivi avec rigueur. Il devient dès lors difficile de présenter ces portes sans les accompagner des façades elles-mêmes au milieu desquelles on les a percées. Déjà la porte de la Calende de Notre-Dame de Rouen se lie si étroitement avec les contre-forts du transsept et avec la rose, que nous avons été obligé, pour en faire comprendre la composition, d’indiquer ces parties du monument.
Cette observation ne saurait d’ailleurs s’appliquer aux portes seulement. L’architecture religieuse des XIVe et XVe siècles ne présente plus des membres séparés, c’est un tout combiné géométriquement, une sorte d’organisme savant ; et ces prismes, ces enchevêtrements de courbes, ces plans superposés qui paraissent à l’œil former un ensemble si compliqué, sont tracés suivant des lois très-rigoureuses et une méthode parfaitement logique. Nous faisons aujourd’hui intervenir si rarement le raisonnement géométrique et l’art du trait dans nos compositions architectoniques, que nous sommes facilement rebutés lorsqu’il s’agit d’étudier à fond les œuvres des maîtres des XIVe et XVe siècles, et que nous trouvons plus simple de les condamner comme des conceptions surchargées de détails sans motifs. Mais si l’on pénètre dans les intentions de ces artistes, et si l’on prend le temps d’analyser soigneusement leurs ouvrages, on est bien vite émerveillé de la simplicité et de l’ordre qui règnent dans les méthodes, de la rigoureuse logique des lois admises, et de la science avec laquelle ces artistes ont su employer la matière en présentant les apparences les plus légères, tout en élevant des constructions éminemment solides. Car il ne faut pas conclure de ce que, dans ces monuments, les parties purement décoratives se dégradent plus ou moins rapidement, que l’œuvre n’est pas durable. La parure est combinée de telle façon qu’elle peut être facilement remplacée sans entamer en rien la bâtisse. Celle-ci, au contraire, indépendante, sagement conçue, est à l’abri des dégradations. Il faut bien qu’il en soit ainsi pour que ces monuments, d’un aspect si léger, aient pu résister aux mutilations et aux injures du temps, et qu’à l’aide de quelques réparations de surfaces, on puisse leur rendre tout leur premier lustre[74].
Les grandes portes de nos églises du XIVe siècle présentent un système de structure et d’ornementation analogue à celui que développe si bien la porte de la Calende. Pendant les deux premiers tiers du XVe siècle, on construisit en France peu d’édifices religieux. Les malheurs du temps, l’épuisement des ressources, ne le permirent pas, et ce ne fut que sous le règne de Louis XI que l’on commença quelques travaux, Toutefois les données générales admises pour les grandes portes des églises ne furent pas changées, et ce n’est que par les détails et le style que ces derniers ouvrages diffèrent de ceux du XIVe siècle. Les gâbles prirent encore plus d’importance, les moulures des pieds-droits et des voussures se multiplièrent ; la statuaire fut de plus en plus étouffée sous la profusion des lignes de l’architecture et de l’ornementation ; les tympans disparurent souvent pour faire place à des claires-voies vitrées ; les linteaux se courbèrent en arcs surbaissés ; les profils prismatiques prirent de l’ampleur et de fortes saillies. Au commencement du XVIe siècle, rien n’était encore changé aux données principales de ces grandes baies, ainsi qu’on peut le reconnaître en examinant les portes des églises de Saint-Wulfrand d’Abbeville et de Saint Riquier (Somme) ; mais dans ces deux derniers monuments on peut constater que les portes des façades sont tellement liées à celles-ci, soit comme lignes d’architecture, soit comme ornementation et système iconographique, qu’il est impossible de les en distraire.
La porte principale de l’église abbatiale de Saint-Riquier présente dans son tympan un arbre de Jessé formant claire-voie vitrée. L’idée est ingénieuse, mais rendue avec une recherche exagérée de détails et un pauvre style.
Parmi les portes de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe, nous mentionnerons celles des cathédrales de Tours, de Beauvais, de Troyes, de Sens (transsept côté nord), de Senlis (idem), ces deux dernières fort remarquables.
Les portes nord et sud de l’église Saint-Eustache de Paris datent également du commencement du XVIe siècle, et s’affranchissent quelque peu de la donnée gothique[75]. Il faut citer aussi, comme appartenant à la première période de la renaissance, les portes principales des églises de Saint-Michel de Dijon, de Vétheuil près Mantes[76], de Saint-Nizier à Lyon, de Belloy (Seine-et-Oise), de Villeneuve-sur-Yonne. Ces portes conservent presque entièrement la donnée gothique dans leurs dispositions générales : ébrasements, voussures, trumeau, tympan ; l’élément nouveau n’apparaît guère que dans l’exécution des détails de la sculpture et dans les profils.
Portes de second ordre, dépendant d’églises. — Outre les grandes portes percées au centre des façades principales et de transsept, les églises en possèdent d’un ordre inférieur, s’ouvrant, soit sur les collatéraux, soit sur des dépendances, telles que cloîtres, sacristies, salles capitulaires, etc. Ces portes, de petite dimension, sont quelquefois assez richement décorées, ou étant très-simples, sont cependant empreintes d’un caractère monumental remarquable. Elles sont fermées par un vantail ou par deux vantaux, mais sont dépourvues de trumeau central.
Nous placerons en première ligne ici l’une des portes des bas côtés de la nef de l’église abbatiale de Vézelay, comme appartenant à cette belle architecture romane de l’ordre de Cluny, à la fin du XIe siècle et au commencement du XIIe.

La hauteur des chapiteaux, la largeur inusitée des ornements, donnent à cette porte un aspect grandiose et d’une sévérité sauvage, qui produit un grand effet. La sculpture est d’ailleurs d’un très-beau caractère. En A, est donné le plan de la porte ; en B, la coupe de l’archivolte ; en C, la section de l’un des pilastres cannelés. Cette porte ne possède qu’un seul vantail.
Antérieurement à cette époque, c’est-à-dire pendant le XIe siècle, les portes latérales ou secondaires des églises sont d’une extrême simplicité. Le plus souvent elles se composent, particulièrement dans les provinces du Centre, de deux jambages sans moulures, avec linteau renforcé au milieu et arc de décharge au-dessus (fig. 72).


Les exemples que nous venons de tracer indiquent déjà que les architectes du moyen âge changeaient les dispositions des portes quand ils en changeaient l’échelle. Ainsi ces portes romanes, indépendamment de leur dimension, ont un tout autre caractère que les portes principales. Les portes secondaires ne sont pas un diminutif de celles-ci, et, en admettant que leur dimension ne fût pas indiquée, on ne saurait les confondre avec les larges issues pratiquées sur les façades des grandes églises. Il y a là un enseignement qui n’est pas à dédaigner ; car la qualité principale que doit posséder tout membre d’architecture, est de paraître remplir la fonction à laquelle il est destiné. Nous ne trouvons pas cependant cette apparence en conformité parfaite avec la fonction dans les monuments modernes. Beaucoup de portes secondaires de nos édifices ne sont que des copies réduites des grandes portes, possédant les mêmes membres, les mêmes proportions, les mêmes ornements diminués d’échelle. À coup sûr, cela n’est point un progrès, puisque ce n’est pas conforme à la raison. On peut constater également que dans certains monuments de la Rome impériale, il y a inobservance de ces règles du bon sens et du bon goût, lorsqu’il s’agit de portes, et que des baies de second ordre sont composées comme les baies majeures, sans qu’on ait tenu compte de la réduction de l’échelle.
Les trois premiers exemples de portes romanes que nous venons de donner, appartiennent aux écoles bourguignonne et du centre. Celles de Vézelay et de Beaune (Côte-d’Or) se distinguent par la force des profils et la largeur de l’ornementation, parce que ces baies dépendent d’édifices où ces membres de l’architecture ont une puissance que l’on ne trouve point dans les monuments des autres provinces. Mais si nous pénétrons dans l’Île-de-France, dans le Valois et le Beauvaisis, nous voyons au contraire que les portes d’un ordre secondaire, à dater de la seconde moitié du XIIe siècle, se distinguent par la finesse des profils, un goût très-délicat et une absence d’exagération dans les proportions.


Nous pourrions accumuler les exemples propres à faire ressortir les variétés des écoles romanes de l’ancienne Gaule dans l’expression d’un même principe, mais nous craindrions de fatiguer nos lecteurs et d’étendre démesurément cet article déjà bien long. Les provinces diverses de ce territoire qu’on appelle aujourd’hui la France s’appuient, dans la formation de leur architecture comme du langage, pendant les XIe et XIIe siècles, sur les mêmes éléments. La basse latinité est le point de départ, mais ces provinces possèdent chacune un caractère particulier ; elles subissent des influences, soit locales, soit étrangères ; puis il arrive un moment où le domaine royal, en politique, en littérature, comme dans l’art de l’architecture, acquiert une prépondérance marquée. Les arts des provinces passent, pour ainsi dire, alors, à l’état de patois, et l’art qui se développe au sein du domaine royal devient le seul officiellement reconnu, celui que chacun s’empresse d’imiter avec plus ou moins d’adresse et d’aptitudes, et qui finit par étouffer tous les autres. C’est ce fait considérable dans notre histoire, que des esprits distingués cependant ont prétendu n’envisager que comme une bizarrerie, une étrangeté, une lacune. Mais, pourquoi nous étonner de l’existence de ce préjugé, quand nous pouvons constater qu’avant les travaux de M. Littré sur la langue française, on ne voyait dans nos poésies du moyen âge que les échos d’un langage grossier et barbare, et qu’il a fallu toute la délicatesse d’analyse du savant académicien pour démontrer à ceux qui prennent la peine de le lire, que ce langage du XIIe siècle est complet, éminemment logique et souvent rempli de beautés du premier ordre. Ce sont là aujourd’hui des faits acquis, et il paraîtrait équitable de donner l’épithète de barbares à ceux qui les ignorent chez nous, quand l’Europe entière s’associe à nos travaux, et considère notre littérature, nos arts du moyen âge, comme le réveil de l’intelligence au sein des bouleversements qui ont suivi la chute de l’empire romain.
Revenons aux portes. Les deux exemples de la figure 75, qui appartiennent à la même époque, affectent des caractères tranchés, dérivés d’écoles différentes ; en voici un troisième (fig. 76) qui se distingue des deux premiers.

Cette porte s’ouvre sur la chapelle funéraire de Sainte-Claire, au Puy en Velay, joli monument bâti vers le milieu du XIIe siècle, sur plan octogonal, avec absidiole semi-circulaire. Son archivolte est composée de claveaux noirs et blancs, et son tympan présente une mosaïque bicolore. Le linteau est décoré d’une croix nimbée et de quatre patères sur un champ légèrement creusé. On trouve ici l’expression la plus délicate de l’art roman d’Auvergne arrivé à son apogée ; il est difficile de produire plus d’effet à moins de frais[77]. Cet art de l’Auvergne était arrivé alors à un degré très-élevé, soit comme structure, soit comme entente des proportions, soit comme, tracé des profils, et cependant il dut s’effacer bientôt sous l’influence de l’architecture du domaine royal.
En 1212, on posait la première pierre de la cathédrale de Reims. L’œuvre fut commencée par le chœur et les deux bras de croix ; et en effet, à la base des pignons qui ferment ceux-ci, on signale la présence de fenêtres plein cintre qui rappellent encore les dispositions des églises romanes. Du côté nord, s’ouvre sur le transsept, à la droite de la porte principale, une baie secondaire qui autrefois donnait sur le cloître, et qui aujourd’hui est murée.

Cette porte (fig. 77) appartient certainement, par le caractère de sa sculpture, comme par sa composition, aux reconstructions de la cathédrale de 1212, et on la croirait plutôt de la fin du XIIe siècle que des premières années du XIIIe.
Un porche d’une époque un peu plus récente, couvert en berceau, protège cette porte, qui a conservé toutes ses peintures. Sa décoration consiste en une statue de la sainte Vierge assise dans le tympan, sous un dais très-riche et garni de courtines. L’archivolte plein cintre est ornée de statuettes d’anges. À la clef, la Vierge, sous la figure d’un petit personnage nu, est enlevée dans un voile par deux anges. Deux autres anges de plus grande dimension remplissent les écoinsons : l’un tient une croix bourdonnée, l’autre semble bénir. L’extrémité du tympan ogival est couvert par une peinture représentant le Christ dans sa gloire, accompagné de deux anges adorateurs. Les petits pieds-droits représentent, de face, des rinceaux très-délicats, et latéralement, des clercs occupés à des fonctions religieuses. La sculpture est entièrement couverte d’une coloration brillante, mais les sujets qui couvraient le tympan, derrière la Vierge, ont disparu. Deux fortes consoles portent le linteau (voy. la coupe A).
En examinant cette figure, on reconnaît que les architectes champenois du commencement du XIIIe siècle cherchaient des dispositions neuves, ou du moins qu’ils savaient profiter des traditions romanes pour les appliquer d’une façon originale[78]. La sculpture de figures et d’ornements de cette porte est très-bonne et encore empreinte du style du XIIe siècle, comme si elle eût été confiée à quelque vieux maître. Ce fait se présente parfois au commencement du XIIIe siècle. Il y avait alors évidemment une jeune école, tendant vers le naturalisme, et une école archaïque à son déclin ; mais nous avons l’occasion de constater l’influence et l’antagonisme de ces deux écoles à l’article Statuaire.
La cathédrale d’Amiens était commencée en 1220, quelques années après celle de Reims. Les constructions premières comprirent la nef et les deux bras de croix, et il est probable que Robert de Luzarches, l’architecte de ce beau monument, ne put voir élever que les soubassements de son projet. On peut reconnaître facilement les parties de l’édifice à la construction desquelles il présida. Ce sont : les contre-forts et piliers de la nef jusqu’à la hauteur des chapiteaux des bas côtés, les parties inférieures de la grande porte occidentale, et la base du pignon sud du transsept. Dans le plan primitif, la nef ne comportait pas de chapelles ; de belles fenêtres éclairaient directement les collatéraux[79] ; mais sous la première fenêtre de la nef, au sud, proche la façade occidentale, s’ouvrait une porte secondaire qui donnait dans le cloître établi de ce côté. Cette porte, aujourd’hui masquée par un porche du XIVe siècle, ne rappelle en aucune façon, par son style, la porte latérale de la cathédrale de Reims que nous avons donnée (fig. 77). C’est qu’en effet, entre l’architecture de la Champagne et celle de Picardie, les différences sont notables au commencement du XIIIe siècle, et cependant les architectes de ces monuments étaient tous deux sortis du domaine royal ; mais il est évident (et cela est à leur louange) que ces maîtres savaient plier leur talent aux traditions locales, à la qualité des matériaux mis à leur disposition et au génie des populations qui les appelaient. La porte latérale de la nef de Notre-Dame d’Amiens est encore, dans les détails de la sculpture, quelque peu empreinte du style du XIIe siècle, mais la composition est entièrement nouvelle. D’abord elle est accompagnée de deux arcades aveugles comprises entre les contre-forts ; les trois arcs (celui central étant presque plein cintre) sont surmontés de gâbles figurés par un simple bizeau ; son ensemble est large et trapu ; la statuaire en est exclue. En effet, autant l’architecture gothique champenoise, à son origine, est prodigue de statuaire, autant celle de Picardie en est avare. Mais, en revanche, la sculpture d’ornement est riche et largement développée ; les chapiteaux de cette porte (fig. 78) sont beaux ; les tailloirs et même les astragales sont décorés ; le tympan est couvert d’une tapisserie de rosaces d’un grand caractère. Déjà les arcs sont accompagnés de redents et les profils sont fins et multipliés.

Si nous abandonnons cet art gothique primitif, et si nous pénétrons dans ses dérivés, vers la seconde moitié du XIIIe siècle, nous pourrons trouver encore bien des exemples de portes à recueillir.
Nous avons vu que certaines provinces, comme le Poitou, la Saintonge, le Limousin, avaient, à l’époque romane, admis les portes sans linteaux ni tympans ; cette tradition est conservée pendant la période gothique dans les mêmes provinces et dans les contrées qui subissent l’influence de ces écoles. C’est ainsi que nous voyons, à l’abbaye de Beaulieu ( Tarn-et-Garonne), une église de la seconde moitié du XIIIe siècle, dont les portes sont encore dépourvues de linteaux et de tympans, comme l’est celle de la Souterraine que nous avons tracée (fig. 61). L’une des portes secondaires de l’église de Beaulieu se fait remarquer en outre par la belle et large ordonnance de son archivolte et la pureté de ses proportions (fig. 80).

La coupe A de cette porte fait voir que l’archivolte à grands claveaux est bandée sur le tableau seulement, et que les vantaux s’ouvrent sous une arrière-voussure a, formée d’un arc surbaissé. La moulure b de l’archivolte est destinée à relier les claveaux de face à la construction. Cette moulure n’est donc pas seulement un ornement, c’est une nécessité de construction dont l’architecte a su tirer parti. En effet, il faut considérer ces moulures saillantes qui circonscrivent parfois les claveaux des archivoltes des portes pendant les XIIe et XIIIe siècles, comme un moyen d’éviter les déliaisonnements. Les arcs n’ayant souvent, ainsi que les parements qui les surmontent, qu’une assez faible épaisseur, il était utile de relier ces placages de pierre à la bâtisse ; la moulure saillante d’archivolte remplissait cet office, comme les assises de tailloirs le faisaient pour les chapiteaux. Ce parti était d’autant plus nécessaire ici, que les vantaux, devant s’ouvrir jusqu’au sommet du tiers-point, se développaient sous une arrière-voussure qui ne pouvait être concentrique à l’arc de face. Les constructeurs n’auraient jamais évidé cette arrière-voussure dans les claveaux de tête, car ils évitaient soigneusement les appareils défectueux. Ils faisaient donc deux arcs juxtaposés : celui de tête fermant la baie au droit des tableaux, et celui d’ébrasement intérieur formant arrière-voussure ; alors la moulure externe reliait ces deux arcs en les rendant solidaires. Dans la structure des portes percées, comme celles des églises, sous des murs épais et haut, les architectes ont grand soin d’éviter les ruptures en extradossant les arcs et en ne les liant pas aux parements. Pour que ces arcs ne tendent pas, sous une pression considérable, à s’écarter de leur plan, ils les sertissent souvent par un rang de claveaux peu épais, mais ayant une forte queue.
C’est en analysant ainsi les membres de cette architecture qui semblent purement décoratifs, qu’on reconnaît le sens droit et pratique des architectes du moyen âge. Il n’est pas une forme dont on ne puisse rendre compte, pas un détail qui ne soit justifié par une nécessité de la structure. Ces architectes peuvent donc nous apprendre quelque chose, ne fût-ce qu’à raisonner un peu lorsque nous bâtissons. Comment dès lors serions-nous surpris si certaines écoles modernes, que l’habitude de raisonner gênerait dans l’emploi de formes injustifiables qu’elles préconisent, prétendent que cet art du moyen âge est barbare, et que son étude n’est bonne qu’à corrompre le goût, qu’à étouffer ce qu’elles veulent considérer comme les saines doctrines ?
Pour ces écoles, l’art de l’architecture semble n’être qu’une affaire de foi, et elles diraient volontiers comme saint Augustin : « Je crois parce que je ne comprends pas. » Nous dirions plus volontiers, s’il s’agit d’architecture : « Ne croyez que si vous comprenez. » Mais, pour comprendre, il faut analyser, raisonner, recueillir et comparer : c’est un travail long et pénible parfois ; plutôt que de s’y livrer, on préfère, en certains cas, condamner sans voir, juger sans connaître, et continuer à empiler des matériaux avec excès, sans économie comme sans raison.
Si dans les plus grandes portes, comme dans celles d’une dimension médiocre, que nous avons présentées à nos lecteurs dans le cours de cet article, on suppute le cube des matériaux employés pour résister à des charges énormes, on constatera que ce cube est très-réduit relativement aux pressions qu’il subit : cela est à considérer.
Il se présentait des conditions telles parfois, que les architectes pouvaient éviter les arcs de décharge plein cintre ou en tiers-point constituant le couronnement de la baie, mais n’osaient pas se fier à un simple linteau, lorsque, par exemple, les portes s’ouvraient dans un mur peu épais et d’une élévation médiocre ; alors ils se contentaient d’un arc de cercle pour fermer le tableau, où ils composaient une courbe surbaissée. Il existe une jolie porte établie dans ces conditions et s’ouvrant dans le mur de l’ancienne sacristie de la cathédrale de Clermont (Puy-de-Dôme)[80].

Cette porte date des dernières années du XIIIe siècle ; son arc donne une ogive surbaissée (fig. 81), dont les centres sont placés en a et b. Son profil, tracé en A au dixième, est décoré de deux cordons sculptés avec beaucoup de délicatesse dans de la lave de Volvic. L’embase des pieds-droits détaillée en B est très-heureusement composée. Cette porte est intérieure (il ne faut pas l’oublier) ; elle s’ouvre sur le bas côté du chœur, et elle affecte, en effet, des formes d’ensemble et de détails qui conviennent à cette place. On signale rarement en France ce genre d’arcs en ogive surbaissée. Cet exemple, toutefois, tend à démontrer combien les artistes de ce temps conservaient une indépendance complète dans l’emploi des formes qu’ils croyaient devoir adopter, combien peu ils se soumettaient à la routine.

Dans la composition de ces portes d’églises surmontées de claires-voies, les architectes champenois semblent avoir voulu non-seulement percer des jours partout où cela était praticable, mais surtout décorer intérieurement les tympans de portes dont la nudité, au revers des bas-reliefs, contraste avec la richesse extérieure. C’était, s’il ne s’agissait que de portes secondaires, un moyen d’éclairer les voûtes des collatéraux sous les tours des façades, d’obtenir un effet analogue à celui que produisent les grandes claires-voies avec roses, percées au-dessus des portes principales des hautes nefs.
À la cathédrale de Chartres, par exemple, les portes du transsept, au nord et au midi, sont merveilleusement sculptées à l’extérieur ; leurs tympans, leurs voussures, leurs pieds-droits, sont couverts de statues, de bas-reliefs et d’ornements ; mais à l’intérieur elles ne présentent à la base des pignons que des surfaces unies, à peine rehaussées de cordons indiquant les arcs : ce ne sont que des revers qui semblent attendre une décoration. Peut-être les architectes de ces grands édifices devaient-ils orner ces revers par des tambours de menuiserie et par des peintures, mais il ne reste pas trace aujourd’hui de ces dispositions. Ce qui nous porterait à supposer que des tambours devaient être adossés à ces revers de portes, c’est que souvent les pieds-droits ou les trumeaux présentent des saillies, comme des pilastres en attente. En Champagne, des tambours devaient certainement fermer les ébrasements intérieurs des grandes et moyennes portes d’églises. L’épaisseur de ces ébrasements, calculée pour permettre de développer les vantaux sans affleurer le parement intérieur, suffirait pour le démontrer, si le plan de l’église Saint-Nicaise de Reims ne prouvait pas de la manière la plus positive que les portes de la façade et du transsept étaient garnies de tambours[82]. Alors les claires-voies vitrées au-dessus des portes (comme à la cathédrale de Reims) éclairaient le vaisseau au-dessus de ces tambours et contribuaient à la décoration générale. L’architecte de la façade occidentale de cette cathédrale fit plus encore, il occupa tous les parements intérieurs latéraux et supérieurs des portes par des statues disposées dans des arcatures superposées.
Les tambours devant affleurer le parement, on conçoit dès lors que le revers de la façade était, à l’intérieur, digne de l’extérieur. Dans l’Île-de-France, en Picardie, et en général dans toutes les églises du moyen âge de la période dite gothique, on doit signaler les tâtonnements, ou tout au moins le défaut d’achèvement dans la composition de ces revers des portes principales et moyennes. Nous disons défaut d’achèvement, parce qu’en effet, outre les traces d’attentes qui subsistent fréquemment, on voit quelques portes secondaires dont les revers sont très-habilement composés. Sur le flanc septentrional du chœur de Notre-Dame de Paris, il existe une petite porte qui autrefois s’ouvrait sur le cloître. Cette issue, connue sous le nom de la porte Rouge, est un chef-d’œuvre de la seconde moitié du XIIIe siècle[83]. Sa sculpture, ses profils, sont d’un goût irréprochable. Or, à l’intérieur, cette porte présente une décoration sobre, bien entendue, et combinée évidemment pour recevoir un tambour de menuiserie. S’ouvrant au fond d’une chapelle, elle est surmontée d’une fenêtre que son gâble voile en partie.
À la cathédrale de Meaux, les architectes des XIIIe et XIVe siècles ont aussi décoré très-richement les revers des portes du transsept, au moyen de tout un système de pilettes, d’arcatures et de gâbles en placages. À la cathédrale de Paris même, le revers de la porte méridionale est occupé par des arcatures avec gâbles, et par deux niches ornées de dais et destinées à recevoir des statues. Mais ce pignon tout entier date de 1257. Il semblerait qu’avant cette époque, les architectes évitaient au contraire de composer des décorations de pierre au revers des grandes portes. Déjà, cependant, au commencement du XIIIe siècle, comme à la cathédrale de Chartres par exemple, les pignons au-dessus des grandes portes étaient percés de roses et de galeries à jour garnies de brillants vitraux ; il ne paraît guère probable qu’au-dessous d’une décoration aussi importante et aussi riche, on eût voulu laisser apparaître des murs nus et des revers de vantaux de bois. Remarquons que dans ces grandes églises, par suite du système d’architecture adopté, il ne restait nulle part un parement de mur, tout étant occupé par des verrières, des piles et des arcs ; par conséquent, aucune surface pour développer des sujets peints. Or, il y a tout lieu de croire que ces larges espaces sous les roses et les galeries, au-dessus et à côté des portes, à l’intérieur, étaient destinés à recevoir des peintures ; nulle place n’était plus favorable, et l’on imagine alors quel effet auraient produit ces pages énormes, toutes resplendissantes de vitraux dans leur partie supérieure, remplies de peintures dans leur partie inférieure. Que l’on suppose encore au-dessous de ces peintures, derrière les vantaux des portes, de beaux tambours de menuiserie, et l’on complétera par la pensée le système décoratif de ces immenses surfaces, dont la nudité aujourd’hui paraît inexplicable. Mais vers la seconde moitié du XIIIe siècle, il semble qu’on ait renoncé à placer des sujets peints autre part que dans les verrières ; alors les architectes décorent les revers des portes sous les pignons, comme à Reims, comme à Meaux, comme à Paris même, du côté méridional.
Le XIVe siècle ne fournit pas, dans la construction de ses monuments religieux, des données nouvelles en fait de portes du second ordre ; les errements de la fin du XIIIe siècle sont suivis, et les exemples que nous pourrions présenter ne différeraient que par quelques détails de ceux déjà donnés. Quant au XVe siècle, il ne commence à construire des églises que vers les dernières années ; et si les portes d’édifices civils de cette époque ont un caractère original bien tranché, celles qui appartiennent à des monuments religieux ne se font remarquer que par l’habileté des traceurs et la délicatesse de la sculpture. Comme disposition générale, elles rentrent dans les derniers exemples donnés ici (voy. Trumeau, Tympan).
Portes d’édifices civils extérieurs et intérieurs. — Dans les villes du moyen âge, les châteaux et les palais possédaient seuls des portes charretières, et ces portes étaient habituellement fortifiées. Quant aux portes des maisons proprement dites, ces habitations, fussent-elles pourvues de cours, n’étaient toujours que ce que nous appelons des portes d’allée, c’est-à-dire disposées seulement pour des piétons, d’une largeur de 1 mètre à 1m,50, et d’une hauteur de 2m,50 à 3 mètres au plus.
Nous ne connaissons pas de portes d’édifices civils appartenant au XIe siècle en France, qui présentent un caractère particulier. Les baies d’entrée, très-rares d’ailleurs, de cette époque, ne consistent qu’en deux jambages avec un arc plein cintre en petit appareil, et ne diffèrent pas des petites portes d’églises que l’on voit encore ouvertes sur les flancs de quelques monuments religieux du Beauvaisis, du Berry, de la Touraine et du Poitou.
Ce n’est guère qu’au commencement du XIIe siècle qu’on peut assigner aux portes de maisons un caractère civil, et c’est encore dans la ville de Vézelay, au sein de cette ancienne commune, que nous trouverons des exemples de ces entrées d’habitations bourgeoises. Parmi ces maisons, quelques-unes possédaient un premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, et quelquefois une tour carrée. La façade extérieure était percée de fenêtres rares et assez étroites, les jours des appartements étant pris sur un petit jardin intérieur. De la rue au jardin ou à la cour, on pénétrait par un vestibule assez spacieux et par une porte plein cintre, relativement large. La figure 83 donne l’élévation extérieure d’une de ces portes en A, et sa coupe en B. En C, nous avons tracé, au cinquième, les profils des deux archivoltes.

On observera que cette baie (qui d’ailleurs se répète plusieurs fois sur la façade des maisons du XIIe siècle, à Vézelay, avec quelques modifications dans les détails) ne rappelle en rien le style de l’architecture religieuse de l’abbaye. Cette porte a un caractère civil, se rapprochant plutôt de ces édifices romano-grecs de Syrie dont nous avons déjà parlé. À l’intérieur est une arrière-voussure D relevé, qui permet le développement des vantaux. Ces portes d’habitations du XIIe siècle sont parfois accompagnées latéralement d’une petite fenêtre carrée, sorte de guichet percé à hauteur d’homme à l’intérieur, et qui permettait de reconnaître les gens qui frappaient ; ou encore d’un jour au-dessus de l’archivolte, qui éclairait le vestibule[84]. On abandonne bientôt cependant les portes plein cintre pour l’entrée des habitations, ou du moins des linteaux de pierre avec tympan viennent se loger sous ces cintres, qui demeurent comme arcs de décharge. C’est ainsi que sont conçues les portes des maisons des villes de Cluny, de Provins, bâties vers la fin du XIIe siècle et le commencement du XIIIe. Souvent même l’arc de décharge disparaît complétement à l’extérieur et ne forme qu’arrière-voussure à l’intérieur. Les vantaux de bois s’accommodent assez mal de la forme plein cintre ; il était plus simple de donner à ces vantaux la forme rectangulaire, surtout lorsqu’ils se composaient d’un seul battant. Le cintre fut donc abandonné pour les portes, et remplacé par l’ouverture rectangulaire. L’archivolte, si elle subsistait, ne faisait que soulager le linteau, afin d’éviter qu’il ne se brisât sous la charge. Alors, mais rarement, dans l’architecture civile, le tympan est décoré de sculptures. On voit encore, dans les bâtiments dépendant autrefois de l’abbaye de Saint-Vane, aujourd’hui englobés dans la citadelle de Verdun, une porte de ce genre, dont la composition est originale, et qui date des premières années du XIIIe siècle.

Cette porte (fig. 84), se compose d’une archivolte à doubles claveaux, reposant sur des jambages décorés, de chaque côté, de deux colonnettes monostyles, ainsi que l’indique en A la section horizontale de l’un de ces jambages. L’archivolte forme arc de décharge et voussure intérieure en B (voy. la coupe). Des consoles soulagent le linteau-tympan, orné de feuillages. Mais parfois ces portes extérieures d’habitations étaient munies d’auvents à demeure, soit de pierre, soit de bois, afin de permettre aux personnes qui frappaient à l’huis d’attendre à l’abri qu’on vînt leur ouvrir. Il existait encore une porte du XIIIe siècle ainsi composée, sur la façade d’une petite maison de la Châtre (Indre), il y a quelques années.

Cette entrée (fig. 85), d’une largeur inusitée pour une porte d’allée, était flanquée de deux pieds-droits saillants, comme des jouées, portant deux corbeaux, sur lesquels reposait un gâble de pierre, formant une forte avancée sur la voie. Une archivolte B, au nu du mur (voy. la coupe A), servait d’arc de décharge au-dessus du tympan, percé d’une petite fenêtre destinée à éclairer le vestibule lorsque les vantaux étaient clos[85]. Le gâble-abri se composait de simples dalles incrustées dans le parement du mur. À cause de la largeur de la baie, le linteau était remplacé par un arc surbaissé, avec feuillure intérieure pour recevoir les deux vantaux. En C, nous donnons, au double, la section de l’un des pieds-droits. Il semblerait que ces sortes d’entrées étaient assez habituellement employées dans cette province, car l’église du Blanc (Indre) possède encore une porte construite suivant la même donnée, mais sans linteau.
Le corbeau, le sommier de l’arc surbaissé, et la pénétration de l’archivolte, étaient pris dans la même pierre. Le sommier de cette archivolte faisait corps également avec l’assise G en encorbellement. Mais les matériaux dont on pouvait disposer ne permettaient pas toujours de pratiquer des saillies de pierre de nature à résister aux intempéries. Sans changer le programme, les architectes du moyen-âge établissaient parfois des auvents de bois au-dessus des portes des habitations. La figure 86 nous fournit un exemple de ces entrées de maisons.
S’il y a une grande variété dans la forme des portes d’églises à cette époque, c’est-à-dire pendant le XIIIe siècle, l’architecture civile ne présente pas un moins grand nombre de dispositions originales, et cependant nous ne possédons plus en France que peu de maisons bâties de 1180 à 1300.
Pendant cette période, d’ailleurs, il était d’un usage assez fréquent, surtout dans les provinces situées au sud de la Loire, de bâtir les maisons avec portiques. Sur la voie publique alors, les portes n’étaient qu’une simple arcade, ou une baie rectangulaire formée de deux jambages et d’un linteau. Fréquemment aussi les rez-de-chaussée des habitations urbaines étaient occupés par des boutiques dont les devantures s’ouvraient sous des arcs[87] ; l’une de ces arcades servait d’entrée à l’escalier communiquant aux étages supérieurs. La fermeture consistait en une huisserie avec vantaux. Les portes des maisons, pendant le XIVe siècle, sont généralement simples, très rarement ornées de sculptures ; elles ne consistent qu’en une archivolte en tiers-point au nu du mur, avec linteau au-dessous, ou en une ouverture quadrangulaire, avec chanfreins abattus sur les arêtes. Déjà, cependant, vers la fin de ce siècle, apparaît l’accolade creusée dans le linteau. En revanche, les portes de palais bâtis pendant cette période sont d’une grande richesse. Celles du Palais, à Paris, dont il reste quelques débris et des dessins, étaient fort belles (voy. Perron ). Celles de l’escalier du Louvre, bâti par Charles V, étaient également très-ornées.
Le XVe siècle, pendant lequel on bâtit peu d’églises, vit élever une quantité de châteaux, de palais et maisons, dont les portes extérieures étaient décorées de sculptures, de figures et d’armoiries. Parmi ces portes de palais du XVe siècle, nous devons placer en première ligne celle de l’hôtel de Jacques Cœur à Bourges, presque intacte encore aujourd’hui. Ce fut en 1443 que le célèbre trésorier de Charles VII commença la construction de cette belle résidence. Arrêté en 1451 à Taillebourg, sur l’ordre du roi, par Olivier Coetivi, Jacques Cœur put à peine jouir de l’hôtel qu’il avait fait construire dans sa ville natale.
On remarquera que l’idée de symétrie n’est entrée pour rien dans la composition de ce portail, et cependant que les vides et les pleins, les parties lisses et les parties ornées, se pondèrent d’une façon tout à fait heureuse, sans que l’œil soit préoccupe de ces démanchements d’axes. Il fallait une porte charretière et une poterne, l’architecte les a percées entre les deux murs de refend qui forment le pavillon. Il a pris l’axe de celui-ci pour ouvrir la fenêtre éclairant la chapelle, et a réuni la niche à cette fenêtre de manière à former une grande ordonnance supérieure, indiquant un étage élevé et voûté. Les fenêtres remplies par les deux figures tombent sous les angles du pavillon ; mais ces fenêtres sont pleines, et l’architecte a eu le soin de supposer un entrebâillement du vantail dans chacune d’elles qui renforce leurs pieds-droits sous l’angle du pavillon.
Nous citerons les portes d’entrée des hôtels de Sens et de Cluny à Paris, qui existent encore, et qui sont postérieures de quelques années à celles-ci[90]. À l’article Maison, nous avons présenté quelques portes des XIVe et XVe siècles[91], qui nous dispenseront d’entrer dans plus de détails sur cette partie importante des habitations du moyen âge. Cependant nous dirons quelques mots des portes extérieures d’escaliers, qui présentent une disposition particulière. Nous indiquons ailleurs[92] comment les escaliers des habitations pendant le moyen âge étaient presque toujours construits en vis. Ce parti pris nécessitait l’ouverture de portes assez basses, puisqu’il fallait que le linteau de ces portes masquât la première révolution du degré. Mais alors ce linteau était considéré souvent comme une imposte surmontée d’une fenêtre éclairant la deuxième révolution. Nous trouvons encore dans l’hôtel de Jacques Cœur, à Bourges, un exemple, complet de ces sortes de portes (fig. 88).
La première révolution de l’escalier passe derrière ce linteau et est éclairée par la fenêtre d’imposte[93].
Les portes intérieures des palais et maisons, c’est-à-dire celles qui s’ouvrent d’une pièce sur une autre, sont habituellement très-simples, basses et étroites avant la fin du XVe siècle. Ce ne sont que des ouvertures permettant à une seule personne de passer à la fois. Ces portes étaient en outre garnies de portières. Dans aucune habitation du moyen âge, fût-elle princière, on ne trouverait de ces portes d’appartements ayant 3 ou 4 mètres de hauteur, comme dans nos hôtels modernes, par cette raison bien naturelle, que si nobles qu’elles fussent, les personnes passant par ces portes n’avaient pas une taille qui atteignit six pieds. Si ces portes parfois sont larges, pour permettre une circulation facile, elles ne dépassent pas 2m,50 sous linteau.
C’est sous le règne de Louis XIV qu’on a commencé seulement à percer des portes d’appartements ayant une plus grande élévation : on considérait cela comme plus noble alors, sinon plus sensé.
Les portes intérieures des habitations du moyen âge sont très-simples, parce qu’elles s’ouvraient derrière des tapisseries, et qu’on n’en apercevait qu’à peine les jambages et les linteaux. Leurs vantaux seuls étaient travaillés avec recherche. Les linteaux sont, ou rectilignes, ou en portion d’arc de cercle, ou en cintre surbaissé. On voit déjà, dans des bâtiments du commencement du XIVe siècle, apparaître ces linteaux tracés au moyen de trois centres ; mais c’est surtout vers la fin du XVe siècle que leur emploi est fréquent. Pendant les XIIIe et XIVe siècles, très-souvent ces linteaux sont soulagés par des corbeaux ménagés dans l’épaisseur du tableau. Alors (fig. 89) un chanfrein ou un profil pourtournent la baie du côté opposé à la feuillure du vantail, car il est très-rare que ces portes soient à deux vantaux.
Vers la fin du XIVe siècle, les corbeaux soulageant les linteaux ne sont plus employés pour les portes d’appartements. Celles-ci sont quadrangulaires et ornées parfois d’un boudin formant colonnette, avec chapiteau et base (fig. 90).

Telles sont construites les portes d’appartements du château de Pierrefonds. Au-dessus du linteau est ménagée une clef en décharge, et du côté de l’ébrasement est pratiqué un arc ; ou si les portes sont étroites, un plafond d’un seul morceau de pierre. Le boudin qui orne le tableau, le chapiteau et la base, sont d’ailleurs pris dans l’épannelage rectangulaire des pieds-droits, et ne forment pas saillie sur le nu du mur.
Dans les habitations décorées avec luxe, les linteaux étaient surmontés de dessus de porte en menuiserie ; car nous avons souvent constaté la présence de scellements sur ces linteaux et sur les parements qui les recouvrent. Si nos hôtels modernes étaient un jour abandonnés, pillés et ruinés, on serait bien embarrassé de dire en quoi consistait la décoration de nos portes d’appartements, car elles ne sont, après tout, qu’une ouverture quadrangulaire dans un mur, ouverture que l’on revêt de boiseries, de stucs et de peintures. Sans donner un rôle aussi important à la décoration d’emprunt, les architectes du moyen âge ne se préoccupaient cependant que de l’encadrement du tableau qui restait apparent ; les lambris, les dessus de portes et les tapisseries faisaient le reste ; la pierre n’apparaissait absolument que dans le tableau et sur cette moulure d’encadrement. Cette simplicité des baies de portes intérieures était cachée sous la richesse des boiseries et tentures qui concouraient à la décoration des pièces, car il ne faudrait pas croire que nos aïeux habitaient entre des murailles nues[94], comme celles que nous laissent voir les ruines des châteaux. Beaucoup de ces portes d’appartements étaient d’ailleurs garnies de tambours ou de clotets, qui, ne s’élevant qu’à une hauteur de 6 à 7 pieds, empêchaient l’air extérieur de pénétrer dans la pièce lorsqu’on ouvrait un vantail. On ne possédait pas alors de calorifères, et si l’on ouvrait une porte, on introduisait un cube d’air froid, dans les pièces chauffées, fort désagréable. Ces tambours et ces portières étaient destinés à éviter cet inconvénient. On sait comme on gelait dans les appartements de Versailles, grâce à ces portes nobles qui, chaque fois qu’on les ouvrait, faisaient entrer une vingtaine de mètres d’air glacial dans les pièces à feu ; et comme Mme de Maintenon, qui craignait les coups d’air, n’avait trouvé d’autre remède contre ce soufflet perpétuel que d’établir son fauteuil dans ce que le duc de Saint-Simon appelle un tonneau.
Les portes des appartements du moyen âge, et jusqu’au règne de Louis XIV, sont donc basses et peu larges, et ne sont, si l’on peut ainsi parler, que des soupapes bien munies de clapets, pour éviter les courants d’air. Il faut en prendre son parti. Ces portes ne s’élargissent qu’autant qu’elles servent de communication entre de grandes salles destinées à offrir une série de pièces propres à donner des fêtes ou à recevoir un grand concours de monde, mais elles conservent toujours une hauteur variant entre 2 mètres et 2m,50 au plus.
Peut-être voudra-t-on prendre une idée de la manière dont ces portes d’appartements étaient décorées, dans des châteaux ou palais. C’est pour rendre intelligible ce que nous venons de dire à ce sujet, que nous avons réuni dans la figure 91 les renseignements recueillis,

soit dans des édifices civils de la fin du XIVe siècle ou du commencement du XVe, soit dans des vignettes de manuscrits, des peintures et des bas-reliefs. On voit ici que la porte proprement dite, la baie de pierre, est à peine visible ; les jambages et le bord inférieur de son linteau sont seuls apparents. Au-dessus est scellé un grand ouvrage de menuiserie peint, et qui se raccorde avec les porte-tapisseries moulurés. Ces tapisseries s’arrêtent sur un lambris inférieur qui garnissait généralement le bas des murs. La partie du mur laissée nue entre le plafond et les tapisseries était décorée de peintures, et une portière était suspendue à la boiserie formant dessus de porte.
Il arrivait que certaines portes d’appartements étaient complétement masquées sous la tapisserie, laquelle était fendue seulement pour laisser passer les habitants. C’étaient là de véritables portes sous tenture.
Les exemples de portes d’appartements de la fin du XVe siècle ne manquent pas, et l’on peut les trouver partout ; elles sont généralement terminées par un arc surbaissé, et quelquefois cet arc est couronné par une accolade. On voit encore de jolies portes de ce genre au palais des Ducs de Bourgogne à Dijon, à l’hôtel de Cluny à Paris, à l’évêché d’Évreux, au palais de justice de Rouen, et dans beaucoup de châteaux de cette époque, tels que ceux d’Amboise, de Blois, etc.
L’époque de la renaissance éleva de très-belles portes extérieures et intérieures dans les habitations seigneuriales ou dans les maisons ; mais l’étendue de cet article ne nous permet pas de dépasser la limite de l’ère gothique. Si nous voulions choisir parmi les beaux exemples des portes du commencement de la renaissance, nous serions entraîné beaucoup trop loin. D’ailleurs ces exemples sont reproduits dans un grand nombre d’ouvrages mis entre les mains de tous les artistes.
- ↑ Les traces de herses apparentes dans les pieds-droits de ces portes datent du moyen âge.
- ↑ Ainsi que nous l’avons dit plus haut, cette porte paraît ne pas remonter au delà du Ve siècle.
- ↑ La tour de droite seule existe jusqu’au niveau du sommet de la porte, mais son escalier, dont on ne voit plus que les traces, a été détruit.
- ↑ Nous donnons plus loin la porte de cette barbacane.
- ↑ Ce pont date du XIIIe siècle.
- ↑ Voy. Hourd, fig. 1.
- ↑ La porte de Laon à Coucy est d’une date un peu antérieure à la construction du château. Naturellement l’enceinte de la ville dut précéder l’édification du château et du fameux donjon ; cette porte, par son style et sa structure, appartient aux premières années du XIIIe siècle. Enguerrand III prit possession de sa seigneurie vers 1183, et mourut en 1242.
- ↑ Cette voie est encore apparente.
- ↑ Voy. Meurtrière, fig. 11.
- ↑ Nous n’avons, sur la tour G, aujourd’hui enterrée dans le boulevard et sous la route actuelle de Laon, que des données vagues, n’ayant pu faire des fouilles étendues. Quant au viaduc, il est complet et se distingue même au milieu des adjonctions du XVe siècle.
- ↑ Cette porte avait été terrassée au XVIe siècle, au moment des guerres de religion, pour pouvoir placer de l’artillerie au sommet des tours. Ces remblais ont été enlevés, il y a quelques années, par les soins de la Commission des monuments historiques, et ce déblaiement a permis de découvrir les dispositions anciennes que nous présentons dans cette suite de gravures.
- ↑ Voy. Meurtrière, fig. 6.
- ↑ Voyez l’article Architecture Militaire, fig. 11, et les Archives des monuments historiques.
- ↑ Ce plan est à l’échelle de 2 millimètres pour mètre.
- ↑ Voyez Échauguette, fig. 6.
- ↑ Voyez Architecture Militaire, fig. 24.
- ↑ Voyez Construction, fig. 149, 150, 151, 152, 153 et 154.
- ↑ Voyez Fenêtre, fig. 40.
- ↑ Ce plan est à 0m,002 pour mètre.
- ↑ Cette élévation est à 0m,0025 pour mètre.
- ↑ Pour de plus amples détails, voyez les Archives des monuments historiques publiées sous les auspices du ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts.
- ↑ Voyez l’article Siége.
- ↑ Voyez Hourd, Mâchicoulis.
- ↑ Voyez l’article Pont, où il est parlé de ces ouvrages à propos du pont Saint-Bénézet d’Avignon.
- ↑ Voyez l’article Siége.
- ↑ C’est à l’obligeance de M. Achard, le savant archiviste de la préfecture de Vaucluse, que nous devons la plus grande partie des renseignements qui nous ont aidé à restituer cette porte dans son état primitif.
- ↑ Les dessins appartiennent à M. Achard, qui a bien voulu nous les laisser copier.
- ↑ Voyez la tapisserie de l’hôtel de ville, le grand plan à vol d’oiseau de Mérian, les gravures d’Israël Sylvestre.
- ↑ Liv. III, p. 1062, édition de 1612.
- ↑ Coll. Michaud, t. II, p. 641.
- ↑ La gravure d’Israël Sylvestre fait voir la place de la fausse braie avec son fossé en arrière.
- ↑ Voyez Barrière.
- ↑ Voyez Bastille.
- ↑ Voyez aussi, à l’article Pont, divers systèmes de pont à bascule.
- ↑ Voyez Architecture Militaire, Engin.
- ↑ Voyez Pont, fig. 4.
- ↑ Voyez Androuet du Cerceau, Des plus excellens bastimens de France.
- ↑ Olivier de Clisson était surnommé par les contemporains, le Boucher.
- ↑ Voyez, pour le plan de cette barbacane, la figure 11, en E (Architecture Militaire).
- ↑ Voyez Barbacane, fig. 2 et 3.
- ↑ Voyez Topographie de la Gaule, Mérian.
- ↑ Voyez Topographie de la Gaule, Mérian.
- ↑ Voyez Château.
- ↑ Voyez Donjon.
- ↑ Voyez Château.
- ↑ Voyez Barre.
- ↑ Voyez Donjon, fig. 35.
- ↑ Voyez la description de cette porte dans le Bulletin monumental, t. IX, p. 300.
- ↑ Dans son excellent ouvrage sur l’Architecture militaire de la Guyenne, M. Léo Drouyn a présenté un assez grand nombre de ces exemples de portes.
- ↑ Voyez Porche, fig. 4.
- ↑ Cet agneau a été gratté à la fin du dernier siècle.
- ↑ Les têtes de ces figures ont été cassées, mais elles paraissent avoir été tournées du côté des personnages qui garnissent le linteau.
- ↑ On voudra bien se rappeler que dans beaucoup de sculptures et de peintures des XIIe et XIIIe siècle, l’orgueil est personnifié par un homme tombant de cheval.
- ↑ Les têtes de ces deux figures sont brisées.
- ↑ Voyez, dans les Archives des monuments historiques publiées sous les auspices de Son Exc. le Ministre de la maison de l’Empereur, la description des sculptures de Vézelay donnée par M. Mérimée.
- ↑ Voyez à l’article Architecture Religieuse, fig. 21, l’aspect intérieur de cette porte.
- ↑ Cette ornementation a été estampée et est bien connue des artistes. C’est un des plus beaux exemples de la sculpture du moyen âge, et qui peut rivaliser avec les œuvres de l’antiquité grecque.
- ↑ Cette porte, enclavée aujourd’hui dans une propriété particulière, a perdu son tympan, dont il existait, en 1845, des fragments dans un jardin voisin.
- ↑ Sauf une seule, ces statuettes ont été mutilées.
- ↑ M. Massenot, architecte à Amiens, a relevé pour nous cette porte avec le plus grand soin. Les fenêtres romanes de cette église sont empreintes du même caractère plein cintre, et ornées de cette volute terminale à la base des archivoltes si fréquente dans les monuments romano-grecs recueillis par M. le comte de Vogué et par M. Duthoit, en Syrie.
- ↑ Cette église a été habilement restaurée depuis peu par M. Abadie.
- ↑ Voyez Les églises de la Terre-Sainte, par M. le comte de Vogué, 1860.
- ↑ Le couronnement tracé sur notre figure est une restauration.
- ↑ Voyez l’article Statuaire.
- ↑ L’église de la Souterraine, d’un très-beau style, de la fin du XIIe siècle, a été restaurée depuis peu par M. Abadie.
- ↑ Le linteau et le trumeau de la porte de l’église de Nesle ont été enlevés et ne sont restitués ici que sur des fragments. Nous ne savons si le tympan contenait un bas-relief ; nous en doutons, considérant l’extrême sobriété de la sculpture de ce petit monument, élevé à l’aide de ressources très-minimes.
- ↑ Voyez Pignon, fig. 8.
- ↑ Ces statues d’anges, le dais et le nimbe crucifère du Christ existent encore.
- ↑ Voyez, pour de plus amples renseignements, la Description de Notre-Dame, cathédrale de Paris, par MM. de Guilhermy et Viollet-le-Duc, 1856. Les huit statues des ébrasements et celle de la Vierge, détruites à la fin du dernier siècle, ont été rétablies depuis peu.
- ↑ Cette statue n’a pas été posée, l’église n’ayant pu être achevée. Le pape Urbain IV, qui était de Troyes et avait fait les fonds nécessaires à la construction de l’église, étant mort en 1264, les travaux durent être suspendus, faute de ressources suffisantes, vers les dernières années du XIIIe siècle. Il y a tout lieu de croire que la statue du trumeau devait représenter saint Urbain. Sur beaucoup d’autres portes, à dater du milieu du XIIIe siècle, on voit un personnage saint et non le Christ, bien que le linteau et le tympan représentent le jugement dernier. C’est ainsi qu’à la belle porte méridionale de l’église abbatiale de Saint-Denis en France, que nous avons citée plus haut, on voyait la statue du saint évêque de Paris sur le trumeau, tandis que le linteau représentait le jugement dernier.
- ↑ Voyez Gâble.
- ↑ Cette porte était ainsi désignée parce qu’elle donnait du côté du cloître où se trouvait installée, pendant le moyen âge, la bibliothèque du chapitre.
- ↑ Voyez Gâble, fig. 5.
- ↑ Les deux portes de la Calende et des Libraires ont pu ainsi, sans trop de peine et de dépense, être restaurées par les deux architectes diocésains de Rouen, MM. Desmarets et Barthélemy.
- ↑ Voyez l’ouvrage de M. Caillat, Monographie de l’église Saint-Eustache.
- ↑ Voyez les Archives des monuments historiques publiées sous les auspices de Son Exc. le Ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts.
- ↑ Voyez l’ensemble de la chapelle de Sainte-Claire du Puy, dans l’Architecture et les arts qui en dépendent, par M. J. Gailhabaud, tome I.
- ↑ Voyez les détails de cette porte dans l’Architecture et les arts qui en dépendent, par M. Gailhabaud, tome II.
- ↑ Voyez Cathédrale, fig. 19 et 20.
- ↑ Cette sacristie est ménagée dans les chapelles carrées du chœur de cette église, côté septentrional (voy. Cathédrale, fig. 46).
- ↑ Voyez le plan de l’église de Saint-Urbain à l’article Construction, fig. 102.
- ↑ Voyez Porche, fig. 29.
- ↑ Cette porte, par son style, appartient évidemment aux reconstructions de 1257 ; bien que la plupart des Guides, nous ne savons d’après quelles autorités, la signalent comme appartenant au XVe siècle. Le XVe siècle n’a pas posé une seule pierre dans la cathédrale de Paris.
- ↑ Voyez Maison, et l’ouvrage sur l’Architecture civile, de MM. Verdier et Cattois.
- ↑ Cette maison a été détruite depuis ; nous n’avons pu en retrouver que la place lors d’un dernier voyage dans le département de l’Indre.
- ↑ Cette porte provient d’une maison de Château-Vilain (Haute-Marne).
- ↑ Voyez Maison, et l’ouvrage déjà cité de MM. Verdier et Cattois.
- ↑ On retrouve cette même disposition à l’entrée du château de Blois et au-dessus de la porte de l’hôtel de ville de Compiègne.
- ↑ Voyez Jacques Cœur, par M. Vallet de Viriville. Paris, 1864.
- ↑ Voyez Maison, fig. 39.
- ↑ Voyez fig. 21, 24, 25, 27, 28, 29, 37. Voyez aussi l’article Salle .
- ↑ Voyez Château, Escalier, Maison.
- ↑ Voyez Notices sur les monuments du Berry, par M. Hazé, 1834.
- ↑ Voyez le Dictionnaire du mobilier.
