Le Livre des mille nuits et une nuit/Tome 06/Texte entier
strictement réservés.
Soixante-quinze exemplaires sur papier de Hollande.
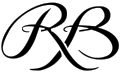
le très sage et très cher
Une modification, justifiée par certaines divergences entre les textes arabes, vient d’être apportée par le traducteur, dans ce volume et les suivants, à l’ordre dans lequel il se proposait d’abord de faire se succéder les contes. Ainsi l’Histoire de Sindbad a été placée ici, alors que primitivement elle ne devait paraître qu’au tome IX de la traduction. — J. C. M.
LES MILLE NUITS ET UNE NUIT
LA DEUX CENT SOIXANTE-DIXIÈME NUIT
La petite Doniazade attendit que Schahrazade eût fini sa chose ordinaire avec le roi Schahriar et, levant la tête, elle s’écria : « Ô ma sœur, je t’en prie, qu’attends-tu maintenant pour nous raconter des anecdotes sur le délicieux poète Abou-Nowas, l’ami du khalifat, le plus charmant de tous les poètes de l’Iran et de l’Arabie ? » Et Schahrazade sourit à sa sœur et lui dit : « Je n’attends que la permission du Roi pour narrer quelques-unes des aventures d’Abou-Nowas qui était en effet un poète exquis mais un bien grand libertin ! »
Alors la petite Doniazade sursauta et courut embrasser sa sœur en lui disant : « Oh ! je t’en prie, qu’a-t-il donc fait ? Hâte-toi de nous le dire ! »
Mais le roi Schahriar, se tournant vers Schahrazade, lui dit : « En vérité, Schahrazade, je ne serai point fâché de t’entendre nous raconter une ou deux de ces aventures que je prévois délicieuses. Mais je dois te dire que je me sens cette nuit porté vers des pensers plus élevés, et disposé à entendre de ta bouche quelques paroles de sagesse. Si donc tu connaissais une histoire qui pût me fortifier dans la connaissance des bons préceptes et faire profiter mon esprit de l’expérience des sages et des savants, ne crois point qu’elle ne m’intéresserait pas ! Au contraire ! Tu pourras ensuite, si ma patience n’est pas à bout, Schahrazade, m’entretenir de ces aventures d’Abou-Nowas. »
À ces paroles du roi Schahriar, Schahrazade se hâta de répondre : « Justement, ô Roi fortuné, j’ai réfléchi toute la journée passée à l’histoire d’une adolescente admirable de beauté et de savoir et qu’on nommait Sympathie. Et je suis toute prête à te rapporter ce que je sais de sa conduite et de ses merveilleuses connaissances ! »
Et le roi Schahriar s’écria : « Par Allah ! ne diffère pas davantage de me mettre au courant de ce que tu m’annonces là ! Car rien ne m’est plus agréable à écouter que les doctes paroles dites par des jeunes filles belles. Et je souhaite fort que l’histoire promise me satisfasse complètement et me soit un profit à la fois et un exemple de l’instruction que toute vraie musulmane doit posséder. »
Alors Schahrazade réfléchit un instant et, ayant levé un doigt, dit :
HISTOIRE DE LA DOCTE SYMPATHIE
Il est raconté — mais Allah est le mieux instruit sur toutes choses — qu’il y avait à Baghdad un marchand très riche, au commerce immense. Il avait honneurs, considération, prérogatives et privilèges de toutes sortes ; mais il n’était point heureux, car Allah n’étendait pas sur lui sa bénédiction jusqu’à lui accorder un enfant, fût-il même de sexe féminin. Aussi était-il devenu vieux dans la tristesse, et voyait-il de jour en jour ses os devenir transparents et son dos se voûter, sans qu’il pût obtenir de l’une de ses nombreuses épouses un résultat consolateur. Mais un jour qu’il avait distribué de très nombreuses aumônes et visité les santons et jeûné et prié avec ferveur, il coucha avec la plus jeune de ses épouses et, cette fois, par la bonté du Très-Haut, il la rendit enceinte à l’heure et à l’instant.
Le neuvième mois, jour pour jour, l’épouse du marchand accoucha heureusement d’un enfant mâle si beau qu’il était comme un morceau de lune.
Aussi le marchand, dans sa gratitude envers le Donateur, n’oublia pas d’accomplir les vœux qu’il avait formés, et il fit de grandes largesses aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, pendant sept jours entiers ; puis, au matin du septième jour, il songea à donner un nom à son fils, et l’appela Aboul-Hassan.
L’enfant fut porté sur les bras des nourrices et sur les bras des belles esclaves et soigné comme une chose précieuse par les femmes et les domestiques, jusqu’à ce qu’il fût d’âge à apprendre. Alors on le confia aux maîtres les plus savants, qui lui enseignèrent à lire les paroles sublimes du Korân, et lui apprirent là belle écriture, la poésie, le calcul, et surtout l’art de tirer de l’arc. Aussi son instruction dépassa-t-elle en étendue celle de sa génération et de son siècle et ce ne fut point tout !
En effet, il joignait à ces diverses connaissances un charme magicien, et il était parfaitement beau. Car voici en quels termes les poètes de son temps ont dépeint ses grâces juvéniles, la fraîcheur de ses joues, les fleurs de ses lèvres et le duvet naissant qui les ornait :
« Vois-tu sur le parterre de ses joues ces boutons de rose qui cherchent à s’entr’ouvrir, alors que le printemps est déjà passé sur les rosiers ?
« Ne t’étonnes-tu de voir fleurir encore la rose et, dans le coin ombreux des lèvres, le duvet pousser comme les violettes sous les feuilles ? »
Le jeune Aboul-Hassan fut donc la joie de son père et les délices de ses prunelles, aussi longtemps que la destinée l’avait devance fixé. Mais lorsque le vieillard sentit s’approcher le terme qui lui était échu, il fit asseoir son fils entre ses mains, un jour d’entre les jours, et lui dit : « Mon fils, voici que l’échéance est proche, et il ne me reste plus qu’à me préparer à paraître devant le Maître Souverain. Je te lègue de grands biens, beaucoup de richesses et de propriétés, des villages entiers et de belles terres et de beaux vergers, de quoi vous suffire, et au delà, à toi et aux enfants de tes enfants. Je te recommande seulement de savoir en jouir sans excès, en remerciant le Rétributeur et en vivant dans le respect qui Lui est dû ! » Puis le vieux marchand mourut de sa maladie, et Aboul-Hassan fut extrêmement affligé et, les devoirs des funérailles accomplis, il prit le deuil et s’enferma avec sa douleur.
Mais bientôt ses compagnons réussirent à le distraire et à l’arracher à ses chagrins et firent si bien qu’ils l’obligèrent à entrer au hammam se rafraîchir, puis à changer de vêtements ; et ils lui dirent pour le consoler tout à fait : « Celui qui se reproduit lui-même en des enfants comme toi ne meurt pas ! Éloigne donc la tristesse et songe à profiter de ta jeunesse et de tes biens ! »
Aussi Aboul-Hassan oublia-t-il peu à peu les conseils de son père, et finit-il par se persuader que le bonheur et la fortune étaient inusables. Dès lors, il ne cessa de satisfaire tous ses caprices, de s’adonner à tous les plaisirs, de fréquenter les chanteuses et les joueuses d’instruments, de manger tous les jours une quantité énorme de poulets, car il aimait les poulets, de se plaire à desceller les vieux pots de liqueurs enivrantes et d’entendre le cliquetis des coupes entrechoquées, de détériorer ce qu’il put détériorer, d’abîmer ce qu’il put abîmer, et de bouleverser ce qu’il put bouleverser, tant qu’à la fin il se réveillât un jour avec rien entre les mains si ce n’est lui-même ! Et, de tout ce que lui avait légué son défunt père en fait de serviteurs et de femmes, il ne lui resta plus rien qu’une seule esclave d’entre les nombreuses esclaves.
Mais encore faut-il d’avance admirer la continuité heureuse du sort qui voulut justement que ce fût la merveille même de toutes les esclaves des contrées de l’Orient et de l’Occident qui demeurât dans la maison, désormais sans lustre, du prodigue Aboul-Hassan, fils du défunt marchand.
En effet, cette esclave s’appelait Sympathie, et vraiment jamais nom n’avait mieux convenu aux qualités de celle qui le portait. L’esclave Sympathie était une adolescente aussi droite que la lettre « aleph », d’une taille proportionnée, et si mince et si délicate qu’elle pouvait défier le soleil d’allonger son ombre sur le sol ; la beauté et la fraîcheur de son visage étaient merveilleuses ; tous ses traits portaient clairement la marque de la bénédiction et du bon augure ; sa bouche paraissait scellée par le sceau de Soleïmân, comme pour garder précieusement le trésor de perles qu’elle renfermait ; ses dents étaient des colliers doubles et égaux ; les deux grenades de son sein étaient séparées par le plus charmant intervalle, et son nombril était assez creux et assez large pour contenir une once de beurre muscade. Quant à sa croupe monumentale, elle terminait à point la finesse de sa taille et laissait profondément imprimé sur les sofas et les matelas le creux formé par l’importance de son poids. Et c’est d’elle qu’il s’agissait dans ce chant du poète :
« Elle est solaire, elle est lunaire, elle est végétale telle la tige du rosier ; elle est aussi loin des couleurs de la tristesse que le soleil, la lune et la tige du rosier.
« Lorsqu’elle paraît, sa présence émeut profondément les cœurs, et lorsqu’elle s’éloigne, les cœurs restent anéantis.
« Le ciel est sur son visage ; les pelouses d’Éden, parmi lesquelles coule la source de vie, s’étendent sous sa tunique, et la lune brille sous son manteau.
« Sur son corps charmant s’harmonisent toutes les couleurs : l’incarnat des roses, l’éclatante blancheur de l’argent, le noir de la baie mûre et la couleur du sandal. Et sa beauté est si grande qu’elle la défend même contre le désir.
« Béni soit Celui qui a déployé sur elle la beauté, et heureux l’amant qui peut savourer les délices de ses paroles ! »
Telle était l’esclave Sympathie, seul trésor que possédât encore le prodigue Aboul-Hassan.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT SOIXANTE-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
Telle était l’esclave Sympathie, seul trésor que possédât encore le prodigue Aboul-Hassan.
Donc, à cette constatation de son patrimoine dissipé sans retour, Aboul-Hassan fut plongé dans un état de désolation qui lui enleva le sommeil et l’appétit ; et il resta ainsi trois jours et trois nuits sans manger, ni boire, ni dormir, si bien que l’esclave Sympathie crut le voir mourir et résolut coûte que coûte de le sauver.
Elle se para de ses robes le plus en état d’être exhibées et de ce qui lui restait de bijoux et d’atours, et se présenta à son maître avec, sur les lèvres, un sourire de bon augure, en lui disant : « Allah va faire cesser tes tribulations par mon entremise. Pour cela, tu n’auras qu’à me conduire devant notre maître l’émir des Croyants Haroun Al-Rachid, le cinquième des descendants d’Abbas, et à lui demander de moi, comme prix de vente, dix mille dinars. S’il trouve ce prix trop élevé, dis-lui : « Ô émir des Croyants, cette adolescente vaut encore davantage, ce dont tu te rendras bien mieux compte en la mettant à l’épreuve. Alors elle haussera beaucoup à tes yeux, et tu verras qu’elle n’a point d’égale ou de rivale, et qu’elle est digne vraiment de servir notre maître le khalifat ! » Puis elle lui recommanda, en y insistant beaucoup, de bien se garder de diminuer ce prix.
Aboul-Hassan, qui jusqu’à ce moment avait négligé, par insouciance, d’observer les qualités et les talents de sa belle esclave, n’était plus guère en état d’apprécier par lui-même les mérites qui pouvaient être en elle. Il trouva seulement que l’idée n’était pas mauvaise et avait des chances de réussite. Il se leva donc sur l’heure et, emmenant derrière lui Sympathie, il la conduisit devant le khalifat, à qui il répéta les paroles qu’elle lui avait recommandé de dire.
Alors le khalifat se tourna vers elle et lui demanda : « Comment t’appelles-tu ? » Elle dit : « Je m’appelle Sympathie. » Il lui dit : « Ô Sympathie, es-tu versée dans les connaissances, et peux-tu m’énumérer le titre des diverses branches du savoir que tu as cultivées ? » Elle répondit : « Ô mon maître, j’ai étudié la syntaxe, la poésie, le droit civil et le droit canon, la musique, l’astronomie, la géométrie, l’arithmétique, la jurisprudence au point de vue des successions, et l’art de déchiffrer les grimoires et de lire les anciennes inscriptions. Je connais par cœur le Livre Sublime, et je puis le lire de sept manières différentes ; je sais exactement le nombre de ses chapitres, de ses versets, de ses divisions, de ses diverses parties, et leurs combinaisons, et combien il renferme de lignes, de mots, de lettres, de consonnes et de voyelles ; je sais au juste quels chapitres ont été inspirés et écrits à la Mecque, et quels autres ont été dictés à Médine ; je connais les lois et les dogmes, je sais les distinguer d’avec les traditions et différencier leur degré d’authenticité ; je ne suis point étrangère à la logique, à l’architecture et à la philosophie, non plus qu’à l’éloquence, au beau langage, à la rhétorique et aux règles des vers, que je sais ordonner et cadencer en n’omettant aucun tour de force dans leur construction ; je sais les faire simples et coulants, comme aussi compliqués et enchevêtrés pour le plaisir des délicats seulement ; et si j’y mets parfois des obscurités, c’est pour mieux conserver l’attention et charmer l’esprit qui arrive à en dénouer la trame subtile et fragile ; enfin j’ai appris beaucoup de choses, et j’ai retenu tout ce que j’ai appris. Avec tout cela je sais parfaitement chanter, et danser comme un oiseau, et jouer du luth et de la flûte, de même que je manie tous les instruments à cordes, et cela sur plus de cinquante modes différents. Aussi, quand je chante et que je danse, ceux-là se damnent qui me voient et m’entendent ; si, habillée et parfumée, je marche en me balançant, je tue ; si je secoue ma croupe, je renverse ; si je cligne de l’œil, je transperce ; si je secoue mes bracelets, j’aveugle ; si je touche, je donne la vie, et, si je m’éloigne, je fais mourir ! Je suis versée dans tous les arts, et j’ai poussé dans ce sens mon savoir jusqu’à des limites telles que seuls pourraient arriver à en distinguer l’horizon les très rares dont les années auraient macéré dans l’étude de la sagesse ! »
Lorsque le khalifat Haroun Al-Rachid eut entendu ces paroles, il fut étonné et charmé de trouver tant d’éloquence à la fois et de beauté, tant de savoir et de jeunesse en celle qui se tenait devant lui, les yeux respectueusement baissés. Il se tourna vers Aboul-Hassan et lui dit : « Je veux à l’instant donner les ordres pour faire venir tous les maîtres de la science, afin de mettre ton esclave à l’épreuve et de m’assurer, par un examen public et décisif, si elle est réellement aussi instruite qu’elle est belle. Au cas où elle sortirait victorieuse de l’épreuve, non seulement je te donnerais les dix mille dinars, mais je te comblerais d’honneurs pour m’avoir amené une si grande merveille. Sinon, rien n’est fait, et elle reste ta propriété ! »
Puis, séance tenante, le khalifat fit mander le plus grand savant de cette époque, Ibrahim ben-Saïar, qui avait approfondi toutes les connaissances humaines ; il fit mander aussi tous les poètes, les grammairiens, les lecteurs du Korân, les médecins, les astronomes, les philosophes, les jurisconsultes et les doctes en théologie. Et tous se hâtèrent de se rendre au palais et s’assemblèrent dans la salle de réception sans savoir pour quel motif on les convoquait.
Lorsque le khalifat leur en eut donné l’ordre, ils s’assirent tous en rond sur les tapis, alors qu’au milieu, sur un siège d’or où l’avait fait placer le khalifat, l’adolescente Sympathie se tenait, le visage recouvert d’un léger voile, et que ses yeux brillaient et ses dents souriaient de leur sourire, à travers…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
… souriaient de leur sourire, à travers.
Quand sur cette assemblée le silence se fut établi si complet qu’on eût pu entendre le son d’une aiguille jetée sur le sol, Sympathie fit à tous un salam plein de grâce et de dignité et, d’une façon de parler exquise, en vérité, elle dit au khalifat :
« Ô émir des Croyants, ordonne ! me voici prête à répondre à toutes les questions que voudront me poser les doctes et vénérables savants, lecteurs du Korân, jurisconsultes, médecins, architectes, astronomes, géomètres, grammairiens, philosophes et poètes ! »
Alors le khalifat Haroun Al-Rachid, assis sur son trône, se tourna vers tous ceux-là et leur dit : « Je vous ai fait mander ici pour que vous examiniez cette adolescente sur ses connaissances en tant que variété et profondeur, et que vous n’épargniez rien pour mettre en valeur à la fois votre érudition et son savoir ! » Et tous les savants répondirent, en s’inclinant jusqu’à terre et en portant les mains sur leurs yeux et sur leur front : « L’ouïe et l’obéissance à Allah et à toi, ô émir des Croyants ! »
À ces paroles, l’adolescente Sympathie resta quelques instants la tête baissée, réfléchissant, puis releva le front et dit : « Ô vous tous, mes maîtres, quel est d’abord le plus versé d’entre vous dans le Korân et les traditions du Prophète ? (Sur lui la paix et la prière !) » Alors l’un des docteurs se leva, désigné par tous les doigts, et dit : « Je suis cet homme ! » Elle lui dit : « Interroge-moi donc à ta guise sur ta partie ! » Et le savant lecteur du Korân demanda :
« Ô jeune fille, du moment que tu as étudié à fond le saint Livre d’Allah, tu dois connaître le nombre de chapitres, de mots et de lettres qu’il renferme et les préceptes de notre foi ! Dis-moi donc, pour commencer, quel est ton Seigneur, quel est ton Prophète, quel est ton Imam, quelle est ton orientation, quelle est ta règle de vie, quel est ton guide dans les chemins, et quels sont tes frères ? »
Elle répondit : « Allah est mon Seigneur ; Môhammad (sur lui la prière et la paix !) est mon Prophète ; le Korân est ma loi, il est donc mon Imam ; la Kâaba, la maison d’Allah élevée par Abraham à la Mecque, est mon orientation ; l’exemple de notre saint Prophète est ma règle de vie ; la Sunna, recueil des traditions, est mon guide dans les chemins ; et tous les Croyants sont mes frères ! »
Le savant reprit, alors que le khalifat commençait à s’émerveiller de la netteté et de la précision de ces réponses dans la bouche d’une si gentille jeune fille :
« Dis-moi ! comment sais-tu qu’il y a un Dieu ? »
Elle répondit : « Par la raison ! »
Il demanda : « Qu’est-ce que la raison ? »
Elle dit : « La raison est un don double : il est inné et il est acquis. La raison innée est celle qu’Allah a placée dans le cœur de ceux de ses serviteurs qu’il a élus, afin de les faire marcher dans la voie de la vérité. Et la raison acquise est celle qui est, chez l’homme bien doué, le fruit de l’éducation et d’un labeur constant. »
Il reprit : « C’est excellent ! Mais où est le siège de la raison ? »
Elle répondit : « Dans notre cœur ! Et c’est de là que ses inspirations s’élèvent vers notre cerveau pour y établir domicile. »
Il dit : « Parfaitement ! Mais peux-tu me dire comment tu as appris à connaître le Prophète ? (Sur lui la prière et la paix !) »
Elle répondit : « Par la lecture du Livre d’Allah, par les sentences y incluses, par les preuves et les témoignages de cette mission divine ! »
Il dit : « C’est excellent ! Mais peux-tu me dire quels sont les devoirs indispensables de notre religion ? »
Elle répondit : « Il y a cinq devoirs indispensables dans notre religion : la profession de foi « Il n’y a de Dieu qu’Allah, et Môhammad est l’envoyé d’Allah ! » ; la prière ; l’aumône ; le jeûne du mois de Ramadan ; le pèlerinage à la Mecque, quand on peut le faire. »
Il demanda : « Quels sont les actes pies les plus méritoires ? »
Elle répondit : « Ils sont au nombre de six : la prière ; l’aumône ; le jeûne ; le pèlerinage ; la lutte contre les mauvais instincts et les choses illicites, et enfin la guerre sainte ! »
Il dit : « Que c’est bien répondu ! Mais dans quel but fais-tu la prière ? »
Elle répliqua : « Simplement pour offrir au Seigneur l’hommage de mon adoration, célébrer ses louanges et élever mon esprit vers les régions sereines ! »
Il s’écria : « Ya Allah ! que cette réponse est excellente ! Mais la prière ne suppose-t-elle pas au préalable des préparatifs indispensables ? »
Elle répondit : « Certes ! Il faut se purifier entièrement le corps par les ablutions rituelles, se vêtir d’habits qui n’aient pas l’indice d’une saleté, choisir un lieu propre et net pour s’y tenir, bien garantir la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux, avoir des intentions pures et se tourner vers la Kâaba, dans la direction de la Mecque sainte ! »
« Quelle est la valeur de la prière ? »
« Elle est le soutien de la foi, dont elle est la base ! »
« Quels sont les fruits de la prière ? Quelle en est l’utilité ? »
« La prière vraiment belle n’a point d’utilité terrestre. Elle est simplement le lien spirituel entre la créature et son Seigneur ! Elle peut produire dix fruits immatériels et d’autant plus beaux : elle éclaire le cœur, elle illumine le visage, elle plaît au Très-Clément, elle excite la fureur du Malin, elle attire la miséricorde, elle éloigne les maléfices, elle préserve du mal, elle préserve contre les entreprises des ennemis, elle consolide l’esprit qui chancelle et rapproche l’esclave de son Maître ! »
« Quelle est la clef de la prière ? Et quelle est la clef de cette clef ? »
« La clef de la prière, c’est l’ablution, et la clef de l’ablution, c’est la formule initiale : « Au nom d’Allah le Clément-sans-bornes, le Miséricordieux ! »
« Quelles sont les prescriptions à suivre dans l’ablution ? »
« D’après le rite orthodoxe de l’imam El-Schafiy ben-Idris, il y en a six : l’intention bien arrêtée de se purifier en vue simplement d’être agréable au Créateur ; l’ablution d’abord du visage ; l’ablution des mains jusqu’au coude ; le frottement d’une partie de la tête ; l’ablution des pieds, y compris les talons, jusqu’aux chevilles, et un ordre strict dans l’accomplissement de ces actes divers. Or, cet ordre suppose l’observance de douze conditions bien précises, à savoir :
« D’abord prononcer la formule initiale : « Au nom d’Allah ! » ; se laver les paumes des mains avant que de les plonger dans le vase ; se rincer la bouche ; se laver les narines en prenant l’eau dans le creux de la main et en la reniflant ; se frotter toute la tête et se frotter les oreilles à l’extérieur et à l’intérieur avec une nouvelle eau ; se peigner la barbe avec les doigts ; se tordre les doigts et les orteils en les faisant craquer ; placer le pied droit devant le pied gauche ; répéter trois fois chaque ablution ; prononcer après chaque ablution l’acte de foi ; et enfin, une fois les ablutions terminées, réciter en outre cette formule pieuse : « Ô mon Dieu ! compte-moi au nombre des repentants, des purs et fidèles serviteurs ! Louanges à mon Dieu ! Je confesse qu’il n’y a de Dieu que Toi seul ! C’est Toi mon refuge ; c’est de Toi que, plein de repentir, j’implore le pardon de mes fautes ! Amîn ! »
« C’est cette formule, en effet, que le Prophète (sur lui la prière et la paix) nous a bien recommandé de réciter, en disant : « J’ouvrirai toutes grandes à qui la récitera les huit portes d’Éden ; et il pourra entrer par la porte qui lui plaira ! »
Le savant dit : « Cela est répondu avec excellence, en vérité ! Mais que font les anges et les démons auprès de celui qui fait ses ablutions ? »
Sympathie répondit : « Lorsque l’homme se prépare à faire ses ablutions, les anges viennent se tenir à sa droite et les diables à sa gauche ; mais aussitôt qu’il prononce la formule initiale : « Au nom d’Allah ! » les diables prennent la fuite, et les anges s’approchent de lui en déployant sur sa tête un pavillon de lumière, de forme carrée, dont ils soutiennent les quatre coins ; et ils chantent les louanges d’Allah et implorent le pardon des péchés de cet homme. Mais, s’il oublie d’invoquer le nom d’Allah ou s’il cesse de le prononcer, les diables reviennent…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT SOIXANTE-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
»… les diables reviennent en foule et font tous leurs efforts pour jeter le trouble dans son âme, lui suggérer le doute et refroidir son esprit et sa ferveur !
« Il est obligatoire, pour l’homme qui fait ses ablutions, de faire couler l’eau sur tout son corps, sur tous ses poils, apparents ou secrets, et sur ses membres sexuels, de se bien frotter toutes les parties et de ne se laver les pieds qu’en dernier lieu ! »
Le savant dit : « Bien répondu ! Peux-tu maintenant me dire quels sont les usages à suivre dans l’ablution nommée tayamum ? »
Elle répondit : « L’ablution nommée tayamum est la purification avec le sable et la poussière. Cette ablution se fait dans les sept cas suivants, établis par les usages conformes à la pratique du Prophète. Et elle se fait suivant les quatre indications prévues par l’enseignement direct du Livre.
« Les sept cas qui permettent cette ablution sont : le manque d’eau ; la peur d’épuiser la provision d’eau ; le besoin de cette eau pour la boisson ; la crainte d’en perdre une partie en la transportant ; les maladies qui craignent l’usage de l’eau ; les fractures qui demandent le repos pour se consolider ; les blessures qu’on ne doit pas toucher.
« Quant aux quatre conditions nécessaires pour accomplir cette ablution avec le sable et la poussière, ce sont : d’abord être de bonne foi ; ensuite prendre le sable ou la poussière avec les mains et faire le geste de s’en frotter le visage ; puis faire le geste de s’en frotter les bras jusqu’aux coudes ; et s’essuyer les mains.
« Deux pratiques sont également recommandables, parce que conformes à la Sunna : commencer l’ablution par la formule invocatoire : « Au nom d’Allah ! » et faire l’ablution de toutes les parties droites du corps avant les parties gauches. »
Le savant dit : « C’est fort bien ! Mais, pour revenir à la prière, peux-tu me dire comment on doit l’accomplir, et quels actes elle comporte ? »
Elle reprit : « Les actes requis pour faire la prière constituent autant de colonnes qui la soutiennent. Ces colonnes de la prière sont : premièrement la bonne intention ; secondement la formule du Takbir, qui consiste à prononcer ces mots : « Allah est le plus grand ! » ; troisièmement réciter la Fatiha, qui est le chapitre qui ouvre le Korân ; quatrièmement se prosterner la face contre terre ; cinquièmement se relever ; sixièmement faire la profession de foi ; septièmement s’asseoir sur les talons ; huitièmement faire des vœux pour le Prophète, en disant : « Que sur lui soient la prière et la paix d’Allah ! » ; neuvièmement être toujours dans la même intention pure.
« D’autres conditions d’une bonne prière sont seulement tirées de la Sunna, à savoir : lever les deux bras, les paumes tournées en haut, dans la direction de la Mecque ; réciter encore une fois la Fatiha ; réciter un autre chapitre du Korân, par exemple la Sourate de la Vache ; prononcer diverses autres formules pieuses, et terminer par les vœux sur notre prophète Môhammad. (Sur lui la prière et la paix !) »
Le savant dit : « En vérité, cela est répondu parfaitement ! Peux-tu maintenant me dire comment on doit s’acquitter de la dîme de l’aumône ? »
Elle répondit : « On peut s’acquitter de la dîme de l’aumône de quatorze manières : en or ; en argent ; en chameaux ; en vaches ; en moutons ; en blé ; en orge ; en millet ; en maïs ; en fèves ; en pois chiches ; en riz ; en raisins secs et en dattes.
« Pour ce qui est de l’or, si l’on n’a qu’une somme inférieure à vingt drachmes d’or de la Mecque, on n’a point de dîme à payer ; au-dessus de cette somme, on donne le trois pour cent. Il en est de même pour l’argent, toutes proportions gardées.
« Pour ce qui est du bétail, celui qui possède cinq chameaux paie un mouton ; celui qui possède vingt-cinq chameaux en donne un comme dîme, et ainsi de suite, toutes proportions gardées.
« Pour ce qui est des moutons et des agneaux, on en donne un sur quarante. Et ainsi de suite pour tout le reste. »
Le savant dit : « Parfait ! Parle-moi maintenant du jeûne ! »
Sympathie répondit : « Le jeûne c’est l’abstinence du manger, du boire et des jouissances sexuelles, pendant la journée, jusqu’au coucher du soleil, durant le mois de Ramadan, aussitôt qu’on aperçoit la nouvelle lune. Il est recommandable de s’abstenir également, pendant le jeûne, de tout vain discours et de toute lecture autre que celle du Korân. »
Le savant demanda : « Mais n’y a-t-il point certaines choses qui, à première vue, paraîtraient rendre inefficace le jeûne, mais qui, selon l’enseignement du Livre, n’enlèvent en réalité rien à sa valeur ? »
Elle répondit : « Il y a, en effet, des choses qui ne rendent point le jeûne inefficace. Ce sont : les pommades, les baumes et les onguents ; le kohl pour les yeux et les collyres ; la poussière du chemin ; l’action d’avaler la salive ; les éjaculations nocturnes ou diurnes involontaires de la semence virile ; les regards jetés sur une femme étrangère non musulmane ; la saignée et les ventouses simples ou scarifiées. Ce sont là toutes choses qui n’enlèvent rien à l’efficacité du jeûne. »
Le savant dit : « C’est excellent ! Et la retraite spirituelle, qu’en penses-tu ? »
Elle dit : « La retraite spirituelle est un séjour de longue durée que l’on fait dans une mosquée, sans jamais en sortir que pour satisfaire un besoin, et en renonçant au commerce avec les femmes et à l’usage de la parole. Elle est simplement recommandée par la Sunna, mais n’est point une obligation dogmatique. »
Le savant dit : « Excellent ! Je désire maintenant t’entendre me parler du pèlerinage ! »
Elle répondit : « Le pèlerinage à la Mecque ou hadj est un devoir que tout musulman doit accomplir au moins une fois en sa vie, quand il a atteint l’âge de raison. Pour l’accomplir, diverses conditions sont à observer. On doit se revêtir du manteau de pèlerin ou ihram, se garder d’avoir commerce avec les femmes, de se raser les poils, de se couper les ongles et de se couvrir la tête et le visage. D’autres prescriptions sont également faites par la Sunna. »
Le savant dit : « C’est fort bien ! mais passons à la guerre sainte ! »
Elle répondit : « La guerre sainte est celle que l’on fait contre les infidèles quand l’Islam est en danger. On ne doit la faire que pour se défendre, et jamais on ne doit prendre l’offensive. Aussitôt que le Croyant est en armes il doit marcher sur l’infidèle sans jamais revenir sur ses pas ! »
Le savant demanda : « Peux-tu me donner quelques détails sur la vente et l’achat ? »
Sympathie répondit : « Dans la vente et l’achat, on doit être libre des deux côtés et dresser, dans les cas importants, un acte de consentement et d’acceptation.
« Mais il y a certaines choses dont la Sunna prohibe la vente ou l’achat. Ainsi, par exemple…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ainsi, par exemple, il est expressément défendu d’échanger des dattes sèches contre des dattes fraîches, des figues sèches contre des figues fraîches, de la viande séchée et salée contre de la viande fraîche, du beurre salé contre du beurre frais, et, d’une manière générale, toutes les provisions fraîches contre les anciennes et les sèches, quand elles sont de la même espèce. »
Lorsque le savant commentateur du Livre eut entendu ces réponses de Sympathie, il ne put s’empêcher de penser qu’elle en savait autant que lui et ne voulut pas s’avouer impuissant à la prendre en défaut. Il résolut donc de lui poser des questions plus subtiles et lui demanda :
« Que signifie linguistiquement le mot ablution ? »
Elle répondit : « Se débarrasser par le lavage de toutes impuretés internes ou externes. »
Il demanda : « Que signifie le mot jeûner ? »
Elle dit : « S’abstenir. »
Il demanda : « Que signifie le mot donner ? »
Elle dit : « S’enrichir. »
Il demanda : « Et aller en pèlerinage ? »
Elle répondit : « Atteindre le but. »
Il demanda : « Et faire la guerre ? »
Elle dit : « Se défendre. »
À ces paroles, le savant se leva debout sur ses pieds et s’écria : « En vérité, mes questions et mes arguments sont à court ! Cette esclave est étonnante de savoir et de clarté, ô émir des Croyants ! »
Mais Sympathie sourit légèrement et l’interrompit : « Je voudrais, lui dit-elle, te poser à mon tour une question. Peux-tu, ô savant lecteur, me dire quelles sont les bases de l’Islam ? »
Il réfléchit un instant et dit : « Elles sont au nombre de quatre : la foi éclairée par la saine raison ; la droiture ; la connaissance de ses devoirs et de ses droits stricts et la discrétion ; l’accomplissement des engagements pris. »
Elle reprit : « Permets-moi de te poser encore une question ! Si tu n’arrives pas à la résoudre, j’aurai le droit de t’arracher ton manteau distinctif de savant lecteur du Livre ! »
Il dit : « J’accepte ! Pose la question, ô esclave ! »
Elle demanda : « Quelles sont les branches de l’Islam ? »
Le savant resta un temps à réfléchir et finalement ne sut que répondre.
Alors le khalifat lui-même parla et dit à Sympathie : « Réponds toi-même à la question, et le manteau de ce savant t’appartient ! »
Sympathie s’inclina et répondit : « Les rameaux de l’Islam sont au nombre de vingt : l’observance stricte de l’enseignement du Livre ; se conformer aux traditions et à l’enseignement oral de notre saint Prophète ; ne jamais commettre d’injustice ; manger les aliments permis ; ne jamais manger les aliments défendus ; punir les malfaiteurs, pour ne point voir augmenter la malice des méchants par suite de l’indulgence des bons ; se repentir de ses fautes ; approfondir l’étude de la religion ; faire du bien à ses ennemis ; être modeste dans sa vie ; secourir les serviteurs d’Allah ; fuir toute innovation et tout changement ; déployer du courage dans l’adversité et de la force dans les épreuves ; pardonner quand on est fort et qu’on est puissant ; patienter dans le malheur ; connaître Allah Très-Haut ; connaître le Prophète (sur lui la prière et la paix !) ; résister aux suggestions du Malin ; résister à ses passions et aux mauvais instincts de son âme ; se vouer entièrement au service d’Allah en toute confiance et en toute soumission ! »
Lorsque le khalifat Haroun Al-Rachid eut entendu cette réponse, il ordonna d’arracher immédiatement le manteau du savant et de le donner à Sympathie : ce qui fut aussitôt exécuté, à la confusion du savant, qui sortit de la salle, la tête basse.
Alors un second savant se leva, qui était réputé pour sa subtilité dans les connaissances théologiques, et que tous les yeux désignaient à l’honneur d’interroger l’adolescente. Il se tourna vers Sympathie et lui dit :
« Je ne te poserai, ô esclave, que de brèves questions et en petit nombre. Peux-tu d’abord me dire quels sont les devoirs à observer pendant les repas ? »
Elle répondit : « On doit d’abord se laver les mains, invoquer le nom d’Allah et lui rendre des actions de grâces. On s’assied ensuite sur la hanche gauche, on se sert pour manger du pouce et des deux premiers doigts seulement, on ne prend que de petites bouchées, on mâche bien le morceau et on ne doit pas regarder son voisin de crainte de le gêner ou de lui couper l’appétit. »
Le savant demanda : « Peux-tu me dire maintenant, ô esclave, ce que c’est que quelque chose, la moitié de quelque chose, et moins que quelque chose ? »
Elle répondit sans hésiter : « Le Croyant c’est quelque chose, l’hypocrite est la moitié de quelque chose, et l’infidèle est moins que quelque chose ! »
Il reprit : « Cela est exact ! Dis-moi ! Où se trouve la foi ? »
Elle répondit : « La foi habite dans quatre endroits : dans le cœur, dans la tête, dans la langue et dans les membres. De la sorte, la force du cœur consiste dans la joie, la force de la tête dans la connaissance de la vérité, la force de la langue dans la sincérité et la force des autres membres dans la soumission ! »
Il demanda : « Combien y a-t-il de cœurs ? »
« Il y en a plusieurs : le cœur du croyant qui est un cœur pur et sain ; le cœur de l’infidèle, cœur complètement opposé au premier…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
»… le cœur de l’infidèle, cœur complètement opposé au premier ; le cœur attaché aux choses de la terre et le cœur attaché aux joies spirituelles ; il y a le cœur dominé par les passions ou par la haine ou par l’avarice ; il y a le cœur lâche, le cœur brûlé d’amour, le cœur gonflé d’orgueil ; puis il y a le cœur éclairé, comme celui des compagnons de notre saint Prophète, et il y a enfin le cœur de notre saint Prophète lui-même, cœur de l’Élu ! »
Lorsque le savant théologien eut entendu cette réponse, il s’écria : « Mon approbation t’est acquise, ô esclave ! »
Alors la belle Sympathie regarda le khalifat et dit : « Ô commandeur des Croyants, permets-moi de poser à mon tour une seule question à mon examinateur et de lui prendre son manteau s’il ne peut répondre ! » Et, le consentement accordé, elle demanda au savant :
« Peux-tu me dire, ô vénérable cheikh, quel est le devoir qui doit être rempli avant tous les devoirs bien qu’il n’en soit pas le plus important ? »
À cette question, le savant ne sut que dire, et l’adolescente se hâta de lui enlever son manteau et fit elle-même cette réponse :
« C’est le devoir de l’ablution ; car il est formellement prescrit de se purifier avant d’accomplir le moindre des devoirs religieux et avant tous les actes prévus par le Livre et la Sunna ! »
Après quoi Sympathie se tourna vers l’assemblée et l’interrogea d’un regard circulaire auquel répondit l’un des savants qui était un des hommes les plus célèbres du siècle et qui n’avait point son égal dans la connaissance du Korân. Il se leva et dit à Sympathie :
« Ô jeune fille pleine de spiritualité et de parfums charmants, peux-tu, puisque tu connais le Livre d’Allah, nous donner un échantillon de la précision de ton savoir ? »
Elle répondit :
« Le Korân est composé de cent quatorze sourates ou chapitres, dont soixante-dix ont été dictés à la Mecque et quarante-quatre à Médine.
« Il est divisé en six cent vingt-une divisions, appelées « aschar », et en six mille deux cent trente-six versets,
« Il renferme soixante-dix-neuf mille quatre cent trente-neuf mots, et trois cent vingt-trois mille six cent soixante-dix lettres, à chacune desquelles sont attachées dix vertus spéciales.
« On y trouve cité le nom de vingt-cinq prophètes : Adam, Nouh, Ibrahim, Ismaïl, Isaac, Yâcoub, Youssef, El-Yosh, Younés, Loth, Saleh, Houd, Schoaïb, Daoud, Soleïmân, Zoul-Kefel, Edris, Elias, Yahia, Zacharia, Ayoub, Moussa, Haroun, Issa [Jésus] et Môhammad. (Sur eux tous la prière et la paix !)
« On y trouve le nom de neuf oiseaux ou animaux ailés : le moustique, l’abeille, la mouche, la huppe, le corbeau, la sauterelle, la fourmi, l’oiseau ababil, et l’oiseau d’Issa (sur lui la prière et la paix !) qui n’est autre que la chauve-souris. »
Le cheikh dit : « Ta précision est merveilleuse. Aussi je voudrais savoir de toi quel est le verset où notre saint Prophète juge les infidèles ? »
Elle répondit : « C’est le verset où se trouvent ces paroles : « Les juifs disent que les chrétiens sont dans l’erreur et les chrétiens affirment que les juifs ignorent la vérité. Or, sachez que des deux côtés ils ont raison dans cette affirmation ! »
Lorsque le cheikh eut entendu ces paroles, il se déclara fort satisfait, mais voulut l’interroger encore.
Il lui demanda donc :
« Comment le Korân est-il venu sur terre du ciel. Est-il descendu tout complet, copié sur les tables qui sont gardées au ciel, ou bien est-il descendu en plusieurs fois ? »
Elle répondit : « C’est l’ange Gabriel qui, sur l’ordre du Maître de l’univers, l’a apporté à notre prophète Môhammad, le prince des envoyés d’Allah, et cela par versets, selon les circonstances, durant l’espace de vingt années. »
Il demanda : « Quels sont les compagnons du Prophète qui ont pris soin de rassembler tous les versets épars du Korân ? »
Elle dit : « Ils sont quatre : Abi ben-Kâab, Zeïd ben-Tabet, Abou-Obeïda ben-Al-Djerrah et Othman ben-Affân. (Qu’Allah les ait tous quatre dans ses bonnes grâces !) »
Il demanda :
« Quels sont ceux qui nous ont transmis et enseigné la vraie manière de lire le Korân ? »
Elle répondit : « Ils sont quatre : Abdallah ben-Mâssoud, Abi ben-Kâab, Moaz ben-Djabal et Salem ben-Abdallah. »
Il demanda : « À quelle occasion est descendu du ciel le verset suivant : « Ô Croyants, ne vous privez point des jouissances terrestres dans toute leur plénitude ! »
Elle répondit : « C’est lorsque quelques compagnons, voulant pousser plus loin qu’il ne fallait la spiritualité, eurent résolu de se châtrer et de porter des habits de crin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … eurent résolu de se châtrer et de porter des habits de crin. »
Lorsque le savant eut entendu ces réponses de Sympathie, il ne put s’empêcher de s’écrier : « Je témoigne, ô émir des Croyants, que cette jeune fille est inégalable de savoir ! »
Alors Sympathie demanda la permission de poser une question au cheikh et lui dit :
« Peux-tu me dire quel est le verset du Korân qui renferme vingt-trois fois la lettre kaf, quel est celui qui renferme seize fois la lettre mim et quel est celui qui renferme cent quarante fois la lettre aïn ? »
Le savant resta la bouche ouverte sans pouvoir faire la moindre citation ; et Sympathie, après lui avoir pris son manteau, se hâta d’indiquer elle-même les versets demandés, à la stupéfaction générale des assistants.
Alors du milieu de l’assemblée se leva un médecin réputé pour l’étendue de ses connaissances et qui avait composé des livres fort estimés. Il se tourna vers Sympathie et lui dit :
« Tu as parlé excellemment sur les choses spirituelles, il est temps de s’occuper du corps. Explique-nous, ô belle esclave, le corps de l’homme, sa formation, ses nerfs, ses os et ses vertèbres, et pourquoi Adam fut appelé Adam ! »
Elle répondit : « Le nom d’Adam vient du mot arabe adim qui signifie la peau, la surface de la terre, et fut donné au premier homme qui avait été créé avec une masse de terre formée du terrain de diverses parties du monde. En effet, la tête d’Adam fut formée avec la terre de l’Orient, sa poitrine avec la terre de la Kâaba, et ses pieds avec la terre de l’Occident.
« Allah composa le corps en y ménageant sept portes d’entrée et deux portes de sortie : les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche, et, de l’autre côté, un devant et un anus.
« Ensuite le Créateur, pour donner un tempérament à Adam, réunit en lui les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air. De la sorte, le tempérament bilieux eut la nature du feu, qui est chaud et sec ; le tempérament nerveux eut la nature de la terre, qui est sèche ; le lymphatique eut la nature de l’eau, qui est froide et humide ; et le sanguin, la nature de l’air, qui est chaud et sec.
« Après quoi Allah acheva de constituer le corps humain. Il y mit trois cent soixante conduits et deux cent quarante os. Il lui donna trois instincts : l’instinct de la vie, l’instinct de la reproduction et l’instinct de l’appétit. Ensuite il lui mit un cœur, une rate, des poumons, six tripes, un foie, deux reins, une cervelle, deux œufs, un nerf et une peau. Il le dota de cinq sens guidés par sept esprits vitaux. Quant à l’ordre des organes, Allah posa le cœur à gauche, dans la poitrine, et au-dessous de lui l’estomac, les poumons pour servir d’éventails au cœur, le foie à droite pour servir de garde au cœur, et l’entrelacement des intestins, et l’articulation des côtes.
« Pour ce qui est de la tête, elle est composée de quarante-huit os ; quant à la poitrine, elle contient vingt-quatre côtes chez l’homme et vingt-cinq chez la femme : cette côte supplémentaire se trouve à droite, et sert à renfermer l’enfant dans le ventre de sa mère et à le soutenir en l’entourant. »
Le savant médecin ne put réprimer sa surprise, puis ajouta : « Peux-tu maintenant nous parler des signes des maladies ? »
Elle répondit : « Les signes des maladies sont extérieurs et intérieurs, et servent à faire connaître le genre de la maladie et son degré de gravité.
« L’homme habile dans son art sait, en effet, deviner le mal rien qu’en prenant le pouls du malade : de la sorte il constate le degré de sécheresse, de chaleur, de raideur, de froid et d’humidité ; il sait également qu’un homme qui a des yeux jaunes doit avoir le foie malade, qu’un autre qui a le dos courbé doit avoir les poumons gravement atteints d’inflammation.
« Quant aux signes intérieurs qui guident l’observation du médecin, ce sont : les vomissements, les douleurs, les œdèmes, les excréments et les urines. »
Il demanda : « Quelles sont les causes du mal de tête ? »
Elle répondit : « Le mal de tête est dû principalement à la nourriture, quand on en fait entrer dans l’estomac avant que les premiers aliments ne soient digérés ; il est également dû à des repas faits quand la faim n’existe pas. C’est la gourmandise qui est la cause de toutes les maladies qui ravagent la terre. Celui qui veut prolonger sa vie doit donc pratiquer la sobriété et, de plus, se lever de bonne heure, éviter les veilles, ne pas faire d’excès de femmes, ne pas abuser de la saignée ou des scarifications, et enfin surveiller son ventre. Pour cela, il doit diviser son ventre en trois parties, qu’il remplira l’une de nourriture, l’autre d’eau et la troisième de rien du tout, afin de la laisser libre pour la respiration, et que l’âme puisse s’y loger. Il en sera de même pour l’intestin, dont la longueur est de dix-huit empans. »
Il demanda : « Quels sont les symptômes de l’ictère ? »
Elle répondit : « L’ictère, qui est la jaunisse fébrile, est caractérisé par le teint jaune, l’amertume de la bouche, les vertiges, la fréquence du pouls, les vomissements et le dégoût des femmes. Celui qui en est atteint est sous le coup de graves accidents, tels que les ulcères de l’intestin, la pleurésie, l’hydropisie et les œdèmes, ainsi que la mélancolie à forme grave qui, en affaiblissant le corps, peut provoquer le cancer et la lèpre. »
Il dit : « C’est parfait ! Mais comment divise-t-on la médecine ? »
Elle répondit : « On la divise en deux parties : l’étude des maladies et l’étude des remèdes. »
Il dit : « Je vois que ta science ne laisse rien à désirer. Mais peux-tu me dire quelle est la meilleure eau ? »
Elle répondit : « C’est l’eau pure et fraîche contenue dans un vase poreux frotté de quelque excellent parfum ou simplement parfumé aux vapeurs d’encens. On ne doit la boire que bien après le repas. On évitera ainsi toutes sortes de malaises et on mettra en pratique cette parole du Prophète (sur lui la prière et la paix !) qui a dit : « L’estomac est le réceptacle de toutes les maladies, la constipation la cause de toutes les maladies, et l’hygiène le principe de tous les remèdes. »
Il demanda : « Quel est le mets excellent entre tous ? »
Elle répondit : « C’est celui qui est préparé par la main d’une femme, qui n’a pas coûté trop de préparatifs et qui est mangé d’un cœur content. Le mets appelé « tharid » est certainement le plus délicieux de tous les mets, car le Prophète (sur lui la prière et la paix !) a dit : « Le tharid est de beaucoup le meilleur des mets, comme Aïscha est la plus vertueuse des femmes ! »
Il demanda : « Que penses-tu des fruits ? »
Elle dit : « C’est, avec la viande de mouton, la nourriture la plus saine. Mais il n’en faut plus manger quand la saison est passée. »
Il demanda : « Parle-nous du vin ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
Sympathie répondit : « Comment peux-tu m’interroger sur le vin, alors que le Livre est si explicite à ce sujet ? Malgré ses nombreuses vertus, il est défendu, parce qu’il trouble la raison et échauffe les humeurs. Le vin et le jeu de hasard sont deux choses que le Croyant doit éviter sous peine des pires calamités ! »
Il dit : « Ta réponse est sage. Peux-tu maintenant nous parler de la saignée ? »
Elle répondit : « La saignée est nécessaire à toutes les personnes qui ont trop de sang. On doit la pratiquer à jeun, dans une journée de printemps sans nuages, ni vent, ni pluie. Quand ce jour tombe un mardi, la saignée produit ses meilleurs effets, surtout si ce jour est le dix-septième du mois. En vérité, il n’y a rien qui soit aussi bon que la saignée pour la tête, les yeux et le sang. Mais rien n’est pire que la saignée si on la pratique pendant les grandes chaleurs ou les grands froids, si, en même temps, on mange des choses salées ou acides et que ce soit un mercredi ou un samedi. »
Le savant réfléchit un instant et dit : « Jusqu’ici tu as répondu parfaitement, mais je veux encore te poser une question capitale qui nous démontrera si ton savoir s’étend à toutes les choses essentielles à la vie. Peux-tu donc nous parler clairement de la copulation ? »
Lorsque la jeune fille eut entendu cette question, elle rougit et baissa la tête : ce qui fit croire au khalifat qu’elle était incapable d’y répondre. Mais elle ne tarda pas à relever la tête et, se tournant vers le khalifat, lui dit : « Par Allah, ô émir des Croyants, mon silence ne doit point être attribué à mon ignorance de cette question dont la réponse se trouve sur le bout de ma langue et refuse de sortir de mes lèvres par égard pour notre maître le khalifat ! » Mais il lui dit : « J’aurais un plaisir extrême à entendre cette réponse de ta bouche. Sois donc sans crainte, et parle clairement ! » Alors la docte Sympathie dit :
« La copulation est l’acte qui unit sexuellement l’homme à la femme. C’est une chose excellente, et, nombreuse sont ses bienfaits et ses vertus. La copulation allège le corps et soulage l’esprit, éloigne la mélancolie, tempère la chaleur de la passion, attire l’amour, contente le cœur, console de l’absence, et fait recouvrer le sommeil perdu. Il s’agit là, bien entendu, de la copulation d’un homme avec une femme jeune, mais c’est tout autre chose si la femme est vieille, car alors il n’y a pas de méfait que cet acte ne puisse engendrer. Copuler avec une vieille femme, c’est s’exposer à des maux sans nombre dont, entre autres, le mal des yeux, le mal des reins, le mal des cuisses et le mal du dos. En un mot, c’est affreux ! Il faut donc s’en garer avec soin comme d’un poison sans remède. De préférence il faut choisir pour cet acte une femme experte, qui comprenne d’un coup d’œil, qui parle avec les pieds et les mains et qui dispense son propriétaire d’avoir un jardin et des parterres de fleurs !
« Toute copulation complète est suivie d’humidité. Cette humidité est produite chez la femme par l’émotion que ressentent ses parties honorables, et chez l’homme par le suc que sécrètent ses deux œufs. Ce suc suit un chemin fort compliqué. En effet, l’homme possède une grosse veine qui donne naissance à toutes les autres veines. Le sang qui arrose toutes ces veines, au nombre de trois cent soixante, finit par se canaliser en un tuyau qui aboutit à l’œuf gauche. Dans cet œuf gauche le sang, à force de tourner, finit par se clarifier et se transformer en un liquide blanc qui s’épaissit grâce à la chaleur de l’œuf et dont l’odeur rappelle celle du lait de palmes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … un liquide blanc qui s’épaissit grâce à la chaleur de l’œuf et dont l’odeur rappelle celle du lait de palmes. »
Le savant s’écria : « Que c’est répondu avec sagacité ! Mais j’ai encore deux questions à te poser, et ce sera tout. Peux-tu me dire quel est l’être vivant qui ne vit qu’emprisonné et qui meurt sitôt qji’il respire l’air libre ? Et quels sont les meilleurs fruits ? »
Elle répondit : « Le premier, c’est le poisson ; et les seconds, sont le cédrat et la grenade ! »
Lorsque le médecin eut entendu toutes ces réponses de la belle Sympathie, il ne put s’empêcher de s’avouer incapable de la prendre en défaut de science, et voulut regagner sa place. Mais Sympathie l’en empêcha d’un signe et lui dit : « Il faut qu’à mon tour je te pose une question :
« Peux-tu me dire, ô savant, quelle est la chose qui est ronde comme la terre et se loge dans un œil, qui tantôt se sépare de cet œil et tantôt y pénètre, qui copule sans organe mâle, qui se sépare de sa compagne durant la nuit pour s’enlacer à elle durant le jour, et qui élit domicile habituellement aux extrémités ? »
À cette question, le savant eut beau se tourmenter l’esprit, il ne sut que répondre, et Sympathie, après lui avoir pris son manteau, sur l’invitation du khalifat, répondit elle-même : « C’est le bouton et la boutonnière ! »
Après quoi, d’entre les vénérables cheikhs un astronome se leva, qui était le plus fameux de tous les astronomes du royaume et que la belle Sympathie regarda en souriant, sûre d’avance qu’il trouverait ses yeux plus embarrassants que toutes les étoiles des cieux.
L’astronome vint donc s’asseoir devant l’adolescente et, après le préambule d’usage, lui demanda :
« D’où se lève le soleil et où va-t-il lorsqu’il disparaît ? »
Elle répondit : « Sache que le soleil se lève des sources de l’orient et disparaît dans les sources de l’occident. Ces sources sont au nombre de cent quatre-vingts. Le soleil est le sultan du jour, comme la lune est la sultane des nuits. Et Allah a dit dans le Livre : « C’est moi qui ai donné au soleil sa lumière et à la lune son éclat et qui leur ai assigné des places ordonnées, afin de vous permettre de connaître le calcul des jours et des années. C’est moi qui ai fixé une limite à la course des astres et défendu à la lune de jamais atteindre le soleil comme à la nuit de dépasser le jour ! De la sorte le jour et la nuit, les ténèbres et la lumière, sans jamais mêler leur essence, s’identifient continuellement ! »
Le savant astronome s’écria : « Quelle réponse merveilleuse de précision ! Mais, ô adolescente, peux-tu nous parler des autres astres et nous dire leurs bonnes ou mauvaises influences ? »
Elle répondit : « Si je devais parler de tous les autres astres, il faudrait y consacrer bien plus d’une séance. Je n’en dirai donc que peu de mots. Outre le soleil et la lune, il y a cinq autres planètes qui sont : Outared [Mercure], El-Zohrat [Vénus], El-Merrikh [Mars] El-Mouschtari [Jupiter] et Zôhal [Saturne].
« La Lune, froide et humide, de bonne influence, a pour séjour le Cancer, pour apogée le Taureau, pour inclinaison le Scorpion, et pour périgée le Capricorne.
« La planète Saturne, froide et sèche, d’influence maligne, a pour séjour le Capricorne et le Verseau, son apogée est la Balance, son inclinaison le Bélier, et son périgée le Capricorne et le Lion.
« Jupiter, d’influence bénigne, est chaud et humide et a pour séjour le Poisson et le Collier, pour apogée le Cancer, pour inclinaison le Capricorne, et pour périgée les Gémeaux et le Lion.
« Vénus, tempérée, d’influence bénigne, a pour séjour le Taureau, pour apogée les Poissons, pour inclinaison la Balance et pour périgée le Bélier et le Scorpion.
« Mercure, d’influence tantôt bénigne tantôt maligne, a pour séjour les Gémeaux, pour apogée la Vierge ; pour inclinaison les Poissons, pour périgée le Taureau.
« Mars enfin, chaud et humide, d’influence maligne, a pour séjour le Bélier, pour apogée le Capricorne, pour inclinaison le Cancer et pour périgée la Balance. »
Lorsque l’astronome eut entendu cette réponse, il admira fort la profondeur des connaissances de la jeune Sympathie. Il voulut pourtant essayer de la troubler par une question plus difficile et lui demanda :
« Ô adolescente, penses-tu que nous aurons de la pluie ce mois-ci ? »
À cette question, la docte Sympathie baissa la tête et réfléchit longuement : ce qui fit supposer au khalifat qu’elle se reconnaissait incapable d’y répondre. Mais bientôt elle releva la tête et dit au khalifat : « Ô émir des Croyants, je ne parlerai guère à moins d’une permission spéciale de dire toute ma pensée ! » Le khalifat, étonné, dit : « Tu as la permission ! » Elle dit : « Alors, ô émir des Croyants, je te prie de me prêter un instant ton sabre pour que je coupe la tête à cet astronome qui n’est qu’un esprit fort et un mécréant ! »
À ces paroles, le khalifat et tous les savants de l’assemblée ne purent s’empêcher de rire. Mais Sympathie continua : « En effet, sache, ô toi l’astronome, qu’il y a cinq choses qu’Allah seul connaît : l’heure de la mort, la tombée de la pluie, le sexe de l’enfant dans le sein de sa mère, les événements du lendemain et l’endroit où chacun devra mourir ! »
L’astronome sourit et lui dit : « Ma question ne t’a été posée que pour t’éprouver. Peux-tu, et ainsi nous ne nous éloignerons point trop du sujet, nous dire l’influence des astres sur les jours de la semaine ? »
Elle répondit : « Le dimanche est le jour consacré au soleil. Quand l’année commence un dimanche, c’est signe que les peuples auront beaucoup à souffrir de la tyrannie et des vexations de leurs sultans, de leurs rois et de leurs gouverneurs, qu’il y aura de la sécheresse, que les lentilles surtout ne pousseront guère, que les raisins tourneront et qu’il y aura des combats féroces entre les rois. Mais en tout cela Allah est encore plus savant !
« Le lundi est jour consacré à la lune. Quand l’année commence par un lundi, c’est de bon augure. Il y aura des pluies abondantes, beaucoup de grain et de raisin ; mais il y aura de la peste, et, en outre, le lin ne poussera pas et le coton sera mauvais ; de plus, la moitié du bétail mourra frappée d’épidémie. Mais Allah est plus savant !
« Le mardi, jour consacré à Mars, peut commencer l’année. Alors les grands et les puissants seront frappés de mort, les grains hausseront de prix, il y aura peu de pluie, peu de poisson, le miel sera à bon compte, les lentilles se vendront pour rien, les grains de lin seront d’un prix très élevé, il y aura une excellente récolte d’orge. Mais beaucoup de sang sera versé, et il y aura une épidémie chez les ânes, dont le prix haussera à l’extrême. Mais Allah est plus savant !
« Le mercredi est le jour de Mercure. Lorsque l’année commence le mercredi, c’est signe de grandes tueries sur mer, de beaucoup de journées d’orage et d’éclairs, de cherté des grains et de prix élevé des radis et des oignons, sans compter une épidémie qui frappera les petits enfants. Mais Allah est plus savant !
» Le jeudi est le jour consacré à Jupiter. Il est, s’il ouvre l’année, l’indice de la concorde entre les peuples, de la justice chez les gouverneurs et les vizirs, de l’intégrité chez les kâdis, et de grands bienfaits sur l’humanité, entre autres choses l’abondance des pluies, des fruits, des grains, du coton, du lin, du miel, du raisin et du poisson. Mais Allah est plus savant !
« Le vendredi est le jour consacré à Vénus. S’il ouvre l’année, c’est signe que la rosée sera abondante, le printemps fort beau, mais il naîtra une quantité énorme d’enfants des deux sexes, et il y aura beaucoup de concombres, de pastèques, de courges, d’aubergines et de tomates, et aussi des topinambours. Mais Allah est plus savant !
« Le samedi enfin est le jour de Saturne. Malheur à l’année qui commence ce jour-là ! Malheur à cette année ! Il y aura une avarice générale du ciel et de la terre, la famine succédera à la guerre, les maladies à la famine, et les habitants de l’Égypte et de la Syrie jetteront les hauts cris sous l’oppression qui les tiendra et la tyrannie des gouverneurs ! Mais Allah est plus savant ! »
Lorsque l’astronome eut entendu cette réponse il s’écria : « Que tout cela est admirablement répondu ! Mais peux-tu nous dire encore le point ou l’étage du ciel où sont suspendues les sept planètes ? »
Sympathie répondit : « Certainement ! La planète Saturne est suspendue exactement au septième ciel ; Jupiter est suspendu au sixième ciel ; Mars au cinquième ; le Soleil au quatrième ; Vénus au troisième ; Mercure au second ; et la Lune au premier ciel ! »
Puis Sympathie ajouta : « À mon tour maintenant de t’interroger…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … À mon tour maintenant de t’interroger ! Quelles sont les trois classes d’étoiles ? »
Le savant eut beau réfléchir et lever les yeux au ciel, il ne put se tirer d’embarras. Alors Sympathie, après lui avoir arraché son manteau, répondit elle-même à sa propre question :
« Les étoiles sont divisées en trois classes suivant leur destination : les unes sont suspendues à la voûte céleste, comme des flambeaux, et servent à éclairer la terre ; les autres sont situées dans l’air, par une suspension invisible, et servent à éclairer les mers ; et les étoiles de la troisième catégorie sont mobiles à volonté entre les doigts d’Allah : on les voit filer pendant la nuit, et elles servent alors à lapider et punir les démons qui veulent enfreindre les ordres du Très-Haut ! »
À ces paroles, l’astronome s’avoua de beaucoup inférieur en connaissances à la belle adolescente et se retira de la salle. Alors, sur l’ordre du khalifat, un philosophe lui succéda qui vint se placer devant Sympathie et lui demanda :
« Peux-tu nous parler de l’infidélité et nous dire si elle naît avec l’homme ? »
Elle répondit : « Là-dessus je veux te répondre par les paroles mêmes de notre Prophète (sur lui la prière et la paix !) qui a dit : « L’infidélité circule parmi les fils d’Adam comme le sang circule dans les veines, aussitôt qu’ils se laissent aller à blasphémer la terre et les fruits de la terre et les heures de la terre. Le plus grand crime est le blasphème contre le temps et le monde : car le temps, c’est Dieu même, et le monde est fait par Dieu ! »
Le philosophe s’écria : « Ces paroles sont sublimes et définitives ! Dis-moi maintenant quelles sont les cinq créatures d’Allah qui ont bu et mangé sans qu’il soit sorti quelque chose soit de leur corps, soit de leur ventre, soit de leur dos ! »
Elle répondit : « Ces cinq créatures sont : Adam, Siméon, le dromadaire de Saleh, le bélier d’Ismaël et l’oiseau que vit le saint Aboubekr dans la caverne ! »
Il lui dit : « Parfait ! Dis-moi encore quelles sont les cinq créatures du paradis qui ne sont ni hommes, ni génies, ni anges ! »
Elle répondit : « Ce sont : le loup de Jacob, le chien des sept dormants, l’âne d’El-Azir, le dromadaire de Saleh et la mule Daldal de notre saint Prophète. (Sur lui la prière et la paix !) »
Il demanda : « Peux-tu me dire quel est l’homme dont la prière ne se faisait ni dans le ciel ni sur la terre ? »
Elle répondit : « C’est Soleïmân, qui faisait sa prière sur un tapis suspendu en l’air, entre le ciel et la terre ! »
Il dit : « Explique-moi le fait suivant : un homme regarde le matin une esclave, et aussitôt il commet une action illicite ; il regarde cette même esclave à midi, et la chose devient licite ; il la regarde dans l’après-midi, et de nouveau la chose devient illicite ; au coucher du soleil il lui est permis de la regarder ; la nuit cela lui est défendu, et au matin il peut parfaitement s’approcher d’elle en toute liberté ! Peux-tu m’expliquer comment des circonstances aussi différentes peuvent se succéder si rapidement en un jour et une nuit ? »
Elle répondit : « L’explication est aisée ! Un homme jette ses regards le matin sur une esclave qui n’est point la sienne, et, d’après le Livre, cela est illicite. Mais à midi il l’achète, et alors il peut tant qu’il veut la regarder et en faire son plaisir ; dans l’après-midi, pour une raison ou une autre, il lui rend la liberté, et aussitôt il n’a plus le droit de jeter les yeux sur elle. Mais, au coucher du soleil, il l’épouse, et tout lui devient licite ; la nuit, il juge à propos de divorcer d’avec elle, et ne peut plus s’en approcher ; mais, le matin, il la reprend pour épouse, après les cérémonies d’usage, et peut alors renouer ses relations avec elle ! »
Le philosophe dit : « C’est juste ! Peux-tu me dire quel est le tombeau qui s’est mis à se mouvoir avec celui qu’il contenait ? »
Elle répondit : « C’est la baleine qui a englouti le prophète Jonas dans son ventre ! »
Il demanda : « Quelle est la vallée que le soleil n’éclaira qu’une seule fois et qu’il n’éclairera jamais plus, jusqu’au jour de la Résurrection ? »
Elle répondit : « C’est la vallée que forma la baguette de Moïse en fendant la mer pour laisser passer son peuple en fuite ! »
Il demanda : « Quelle est la première queue qui ait traîné sur le sol ? »
Elle répondit : « C’est la queue de la robe d’Agar, mère d’Ismaël, quand elle balaya la terre devant Sarah ! »
Il demanda : « Quelle est la chose qui respire sans être animée ? »
Elle répondit : « C’est le matin ! Car il est dit dans le Livre : « Lorsque le matin respire… »
Il dit : « Dis-moi ce que tu peux, concernant le problème que voici : une troupe de pigeons s’abat sur un arbre ; les uns se perchent sur les branches supérieures, et les autres sur les branches du bas. Les pigeons qui occupent la cime de l’arbre disent à ceux du bas : « Si l’un de vous se joint à nous, notre troupe sera double de la vôtre, mais si l’un de nous descend vers vous, vous nous égalerez en nombre. Combien y avait-il de pigeons ? »
Elle répondit : « Il y avait douze pigeons en tout. En effet, il y en avait sept sur la cime de l’arbre et cinq sur les branches du bas. Si l’un des pigeons du bas s’était joint à ceux du haut, le nombre de ces derniers se serait trouvé porté à huit, qui est le double de quatre ; mais si l’un de ceux du haut était descendu vers ceux du bas, ils eussent été six des deux côtés. Mais Allah est plus savant ! »
Lorsque le philosophe eut entendu ces diverses réponses, il craignit que l’adolescente ne l’interrogeât, et, comme il tenait à son manteau, il se hâta de prendre la fuite et de disparaître.
C’est alors que se leva l’homme le plus savant du siècle, le sage Ibrahim ben-Saïar qui vint prendre la place du philosophe et dit à la belle Sympathie : « Je veux croire que d’avance tu t’avoues vaincue, et qu’il est inutile de t’interroger davantage ! »
Elle répondit : « Ô vénérable savant, je te conseille d’envoyer chercher d’autres habits que ceux que tu portes, puisque dans quelques instants je dois te les enlever ! »
Le savant dit : « Nous allons bien voir ! Quelles sont les cinq choses que créa le Très-Haut avant Adam ? »
Elle répondit : « L’eau, la terre, la lumière, les ténèbres et le feu ! »
Il demanda : « Quelles sont les œuvres formées par les mains mêmes de la Toute-Puissance, alors que toutes les autres choses ont été créées par le simple effet de sa volonté ? »
Elle répondit : « Le Trône, l’Arbre du Paradis, l’Éden et Adam ! Oui, ces quatre choses ont été formées par les mains mêmes d’Allah, tandis que pour créer toutes les autres choses. Il dit : « Qu’elles soient ! » et elles furent ! »
Il demanda : « Quel est ton père dans l’Islam et quel est le père de ton père ? »
Elle répondit : « Mon père dans l’Islam est Môhammad (sur lui la prière et la paix !), et le père de Môhammad est Abraham, l’ami d’Allah ! »
« En quoi consiste la foi de l’Islam ? »
« Dans la simple profession de foi : « La ilah ill’Allah, oua Môhammad rassoul Allah ! »
« Quelle est la chose qui a commencé par être en bois et qui a fini par avoir la vie ? »
« C’est la verge que jeta Moïse et qui fut transformée en serpent. C’est cette même verge qui pouvait, suivant les cas, se transformer, une fois enfoncée dans le sol, soit en un arbre fruitier, soit en un grand arbre touffu pour garantir Moïse de l’ardeur du soleil, soit en un chien énorme qui veillait à la garde du troupeau durant la nuit. »
« Peux-tu me dire quelle est la femme qui a été engendrée par un homme, sans avoir été portée dans le sein d’une mère, et quel est l’homme qui fut engendré par une femme sans le concours d’un père ? »
« C’est Ève, qui naquit d’Adam, et c’est Jésus qui naquit de Marie ! »
Le savant continua…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Le savant continua : « Parle-moi des diverses sortes de feux ! »
Elle répondit : « Il y a le feu qui mange et qui ne boit pas : c’est le feu du monde ; le feu qui mange et qui boit : c’est le feu de l’enfer ; le feu qui boit et ne mange point : c’est le feu du soleil ; enfin le feu qui ne mange ni ne boit : c’est le feu de la lune ! »
« Quel est le mot de cette énigme : « Lorsque je bois, l’éloquence coule de mes lèvres ; et je marche et je parle sans faire de bruit. Et pourtant, en dépit de ces qualités, je ne suis guère dans les honneurs, pendant ma vie ; et après ma mort on ne me regrette pas davantage ! »
Elle répondit : « C’est la plume ! »
Et le mot de cette autre énigme : « Je suis oiseau, mais n’ai ni chair, ni sang, ni plumes, ni duvet ; on me mange rôti ou bouilli ou tel que je suis, et il est bien difficile de savoir si je suis vivant ou mort ; quant à ma couleur, elle est d’argent et d’or ! »
Elle répondit : « En vérité, c’est trop de mots pour me faire connaître qu’il s’agit simplement d’un œuf. Tâche donc de me demander quelque chose de plus ardu ! »
Il demanda : « Combien de paroles, en tout, Allah a-t-il dit à Moïse ? »
Elle répondit : « Allah a dit exactement à Moïse mille cinq cent quinze mots ! »
Il demanda : « Quelle est l’origine de la création ? »
Elle dit : « Allah a tiré Adam de la boue desséchée ; la boue fut formée avec de l’écume ; l’écume fut tirée de la mer ; la mer, des ténèbres ; les ténèbres, de la lumière ; la lumière, d’un monstre marin ; le monstre marin, d’un rubis ; le rubis, d’un rocher ; le rocher, de l’eau ; et l’eau fut créée par la parole toute-puissante : « Qu’elle soit ! »
Et le mot de cette autre énigme : « Je mange, sans avoir ni bouche ni ventre, et me nourris d’arbres et d’animaux. Les aliments seuls attisent en moi la vie, alors que toute boisson me tue ! »
« C’est le feu ! »
« Et le mot de cette énigme : « Ce sont deux amis qui n’ont jamais éprouvé de jouissance, bien qu’ils passent toutes leurs nuits dans les bras l’un de l’autre. Ce sont eux les gardiens de la maison et ils ne se séparent qu’avec le matin ! »
« Ce sont les deux battants d’une porte ! »
Quelle est la signification de ceci : « Je traîne toujours de longues queues derrière moi ; j’ai une oreille pour ne point entendre, et je fais des habits pour n’en porter jamais ! »
« C’est l’aiguille ! »
« Quelle est la longueur et la largeur du pont Sirat ? »
« La longueur du pont Sirat, sur lequel doivent passer tous les hommes au jour de la Résurrection, est de trois mille ans de chemin, mille pour le monter mille pour traverser son horizontalité et mille pour le descendre. Il est plus aigu que le tranchant d’un glaive et plus mince qu’un cheveu ! »
Il demanda : « Peux-tu maintenant me dire combien de fois le Prophète (sur lui la prière et la paix !) a le droit d’intercéder pour chaque croyant ? »
Elle répondit : « Trois fois, ni plus ni moins ! »
« Quel est le premier qui ait embrassé la foi de l’Islam ? »
« C’est Aboubekr ! »
« Mais alors ne crois-tu pas qu’Ali ait été musulman avant Aboubekr ? »
« Ali, par la grâce du Très-Haut, n’a jamais été idolâtre ; car dès l’âge de sept ans Allah l’a mis dans la voie droite et a éclairé son cœur en le dotant de la foi de Môhammad (sur lui la prière et la paix !)
« Oui ! mais je voudrais bien savoir qui des deux est le plus grand en mérites, à tes yeux, Ali ou Abbas ? »
À cette question fort insidieuse, Sympathie s’aperçut que le savant cherchait à tirer d’elle une réponse compromettante ; car, en accordant la prééminence à Ali, gendre du Prophète, elle déplairait au khalifat qui était le descendant d’Abbas, oncle de Môhammad. (Sur lui la prière et la paix !) Elle se mit d’abord à rougir, puis à pâlir, et, après un instant de réflexion, elle répondit :
« Sache, ô Ibrahim, qu’il n’y a aucune prééminence entre deux qui ont chacun un mérite excellent ! »
Lorsque le khalifat eut entendu cette réponse, il fut à la limite de l’enthousiasme et, se levant debout sur ses deux pieds, s’écria : « Par le Seigneur de la Kâaba ! quelle réponse admirable, ô Sympathie ! »
Mais le savant continua : « Peux-tu me dire de quoi il s’agit dans cette énigme : « Elle est svelte et tendre et de goût délicieux ; elle est droite comme la lance, mais n’a point de fer aigu ; elle est utile dans sa douceur, et se mange volontiers le soir, au mois de Ramadan ! »
Elle répondit : « C’est la canne à sucre ! »
Il dit : « J’ai encore quelques questions à t’adresser, et vais le faire rapidement. Peux-tu donc me dire, sans trop de mots : Qui est plus doux que le miel ? Qui est plus tranchant que le glaive ? Qui est plus rapide dans ses effets que le poison ? Quelle est la jouissance d’un instant ? Quel est le bonheur qui dure trois jours ? Quel est le jour le plus heureux ? Quelle est la joie d’une semaine ? Quelle est la dette que même le méchant ne peut s’empêcher de payer ? Quel est le supplice qui nous suit jusqu’au tombeau ? Quelle est la joie du cœur ? Quelle est la souffrance de l’esprit ? Quelle est la désolation de la vie ? Quel est le mal qui n’a point de remède ? Quelle est la honte qui ne peut s’effacer ? Quel est l’animal qui vit dans les endroits déserts et habite loin des villes, qui fuit l’homme, et qui réunit la forme et la nature de sept bêtes ? »
Elle répondit : « Avant de parler, je veux auparavant que tu me livres ton manteau ! »
Alors le khalifat Haroun Al-Rachid dit à Sympathie : « Tu as certainement raison. Mais peut-être vaudrait-il mieux, eu égard à son âge, que tu répondisses d’abord à ses questions ? »
Elle dit : « L’amour des enfants est plus doux que le miel ! La langue est plus tranchante que le glaive ! Le mauvais œil est plus rapide que le poison ! La jouissance de l’amour ne dure qu’un instant ! Le bonheur de trois jours est celui qu’éprouve le mari lors des époques mensuelles de son épouse, puisqu’il prend du repos ! Le jour le plus heureux est celui du gain dans une affaire ! La joie qui dure une semaine est celle de la noce ! La dette que toute personne doit payer, c’est la mort ! La mauvaise conduite des enfants est la peine qui nous suit jusqu’au tombeau ! La joie du cœur, c’est la femme soumise à son époux ! La souffrance de l’esprit, c’est un mauvais serviteur ! La pauvreté est la désolation de la vie. Le mauvais caractère est le mal sans remède ! La honte ineffaçable, c’est le déshonneur d’une fille. Quant à l’animal qui vit dans les endroits déserts et déteste l’homme, c’est la sauterelle, car elle réunit la forme et la nature de sept bêtes : elle a, en effet, la tête du cheval, le cou du taureau, les ailes de l’aigle, les pieds du chameau, la queue du serpent, le ventre du scorpion et les cornes de la gazelle ! »
Devant tant de sagacité et tant de savoir, le khalifat Haroun Al-Rachid fut édifié à l’extrême et ordonna au savant Ibrahim ben-Saïar de donner son manteau à l’adolescente. Le savant, après avoir livré son manteau, leva sa main droite et témoigna publiquement que l’adolescente l’avait dépassé en connaissances et qu’elle était la merveille du siècle.
Alors le khalifat demanda à Sympathie : « Sais-tu jouer des instruments d’harmonie et chanter en les accompagnant ? » Elle répondit : « Mais certainement ! » Aussitôt il fit apporter un luth dans un étui de satin rouge terminé par un gland de soie jaune et fermé avec une agrafe d’or. Sympathie tira le luth de l’étui, et y trouva ces vers gravés tout autour en caractères entrelacés et fleuris :
« J’étais encore un rameau vert et déjà les oiseaux amoureux m’apprenaient les chansons !
« Maintenant, sur les genoux des jeunes filles, je résonne sous les doigts et chante comme les oiseaux ! »
Alors elle l’appuya contre elle, se pencha comme une mère sur son nourrisson, en tira des accords sur douze modes différents et, au milieu du ravissement général, elle chanta d’une voix qui résonna dans tous les cœurs et arracha des larmes émues de tous les yeux.
Quand elle eut fini, le khalifat se leva debout sur ses deux pieds et s’écria : « Qu’Allah augmente en toi ses dons, ô Sympathie, et qu’il ait en sa miséricorde ceux qui ont été tes maîtres et ceux qui t’ont donné le jour ! » Et, séance tenante, il fit compter dix mille dinars d’or, en cent sacs, à Aboul-Hassan, et dit à Sympathie : « Dis-moi, ô merveilleuse adolescente, préfères-tu entrer dans mon harem et avoir un palais et un train de maison à toi seule, ou bien retourner avec ce jeune homme, ton ancien maître ? »
À ces paroles, Sympathie embrassa la terre entre les mains du khalifat…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Sympathie embrassa la terre entre les mains du khalifat et répondit : « Qu’Allah répande ses grâces sur notre maître le khalifat ! Mais son esclave souhaite retourner dans la maison de son ancien maître ! »
Le khalifat, loin de se montrer offensé de cette préférence, acquiesça immédiatement à sa demande, lui fit verser, en cadeau, cinq autres mille dinars, et lui dit : « Puisses-tu âtre aussi experte en amour que tu l’es en connaissances spirituelles ! » Puis il voulut encore mettre le comble à sa magnificence en nommant Aboul-Hassan à un haut emploi au palais ; et il l’admit au nombre de ses favoris les plus intimes. Puis il leva la séance.
Alors Sympathie, lourde des manteaux des savants, et Aboul-Hassan, chargé des sacs remplis des dinars d’or, sortirent tous deux de la salle, suivis par tous ceux de l’assemblée qui, tout en s’émerveillant de ce qu’ils venaient de voir et d’entendre, levaient les bras et s’écriaient : « Où y a-t-il dans le monde une générosité pareille à celle des descendants d’Abbas ? »
— Telles sont, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, les paroles que la docte Sympathie dit au milieu de l’assemblée des savants et qui, transmises par les annales du règne, servent depuis à faire l’instruction de toute femme musulmane. »
Puis Schahrazade, voyant que le roi Schahriar fronçait déjà les sourcils et réfléchissait d’une façon inquiétante, se hâta d’aborder les Aventures du Poète Abou-Nowas, et commença tout de suite le récit, tandis que la petite Doniazade, à moitié somnolente, se réveillait soudain en sursaut, en entendant prononcer le nom d’Abou-Nowas, et s’apprêtait, les yeux élargis d’attente, à écouter de toutes ses oreilles.
AVENTURE DU POÈTE ABOU-NOWAS
Il est raconté — mais Allah est plus savant — qu’une nuit d’entre les nuits le khalifat Haroun Al-Rachid, pris d’insomnie et l’esprit fort préoccupé, sortit seul de son palais et alla faire un tour du côté de ses jardins, pour essayer de distraire son ennui. Il arriva de la sorte devant un pavillon dont la porte était ouverte, mais barrée par le corps d’un eunuque noir endormi sur le seuil. Il franchit le corps de l’esclave et pénétra dans l’unique salle dont ce pavillon était composé, et il vit tout d’abord un lit aux rideaux abaissés, éclairé à droite et à gauche par deux grands flambeaux. À côté du lit, il y avait une petite table qui soutenait un plateau où était une cruche de vin surmontée d’une tasse renversée.
Le khalifat fut étonné de trouver dans ce pavillon ces choses qu’il n’y soupçonnait pas et, s’avançant vers le lit, il en releva les rideaux et s’immobilisa émerveillé de la beauté endormie qui s’offrait à son regard. C’était une jeune esclave aussi belle que la lune dans son plein et dont la chevelure éployée était le seul voile.
À cette vue, le khalifat, charmé à l’extrême, prit la tasse qui surmontait le goulot de la cruche, la remplit de vin et formula en son âme : « Aux roses de tes joues, adolescente ! » et la but lentement. Puis il se pencha sur le jeune visage et déposa un baiser sur une petite envie noire qui souriait sur le coin de la lèvre gauche.
Mais ce baiser, quelque léger qu’il fût, réveilla la jeune femme qui, reconnaissant l’émir des Croyants, se leva vivement sur son séant, pleine d’effroi. Mais le khalifat la calma et lui dit : « Ô jeune esclave, voici près de toi un luth ! Tu dois certes savoir en tirer des accords charmants. Comme j’ai résolu de passer cette nuit avec toi, bien que je ne te connaisse pas, je ne serais pas fâché de te voir le manier, en l’accompagnant de ta voix ! »
Alors la jeune femme prit le luth et, l’ayant accordé, en tira des sons admirables sur vingt-un modes différents, si bien que le khalifat s’exalta à la limite de l’exaltation, et la jeune femme, s’en étant aperçu, ne manqua pas d’en profiter. Elle lui dit donc : « Je souffre, ô commandeur des Croyants, des rigueurs de la destinée ! » Le khalifat demanda : « Et comment cela ? » Elle dit : « Ton fils El-Amîn, ô commandeur des Croyants, m’avait achetée il y a quelques jours pour dix mille dinars afin de te faire cadeau de ma personne. Mais ton épouse Sett Zobéida, ayant eu connaissance de ce projet, remboursa à ton fils l’argent qu’il avait dépensé pour mon achat, et me remit entre les mains d’un eunuque noir pour qu’il m’enfermât dans ce pavillon isolé ! »
Lorsque le khalifat eut entendu ces paroles, il fut extrêmement courroucé et promit à la jeune femme de lui donner, dès le lendemain, un palais pour elle seule avec un train de maison digne de sa beauté. Puis, après une prise de possession, il sortit à la hâte, réveilla l’eunuque endormi et lui ordonna d’aller immédiatement prévenir le poète Abou-Nowas qu’il eût à se rendre aussitôt au palais.
C’était, en effet, la coutume du khalifat d’envoyer chercher le poète toutes les fois qu’il avait des soucis, pour l’entendre improviser des poèmes ouïe voir mettre en vers une aventure quelconque qu’il lui racontait.
L’eunuque se rendit donc à la maison d’Abou-Nowas et, ne l’y ayant pas trouvé, se mit à sa recherche dans tous les endroits publics de Baghdad et finit par le trouver dans un cabaret mal famé, au fond du quartier de la Porte Verte. Il s’approcha de lui et lui dit : « Ô Abou-Nowas, notre maître le khalifat te demande ! » Abou-Nowas éclata de rire et répondit : « Comment veux-tu, ô père des blancheurs, que je bouge d’ici, alors que je suis retenu en otage par un jeune garçon de mes amis ? » L’eunuque demanda : « Où est-il et quel est-il ? » Il répondit : « Il est mignon, imberbe et joli. Je lui ai promis un cadeau de mille drachmes ; mais comme je n’ai point sur moi cet argent, je ne puis décemment m’en aller avant de m’acquitter de ma dette ! »
À ces paroles, l’eunuque s’écria : « Par Allah ! Abou-Nowas, montre-moi ce jeune garçon, et si vraiment il est aussi gentil que tu as l’air de me le donner à entendre, tu es tout excusé et au delà ! »
Comme ils s’entretenaient de la sorte, le mignon montra sa jolie tête dans l’entrebâillement de la porte, et Abou-Nowas s’exclama, en se tournant de son côté : « Si le rameau se balançait quel ne serait point le chant des oiseaux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Si le rameau se balançait, quel ne serait point le chant des oiseaux ! »
Alors le jeune garçon entra tout à fait dans la salle. Il était vraiment de la plus grande beauté et était vêtu de trois tuniques superposées et de couleur différente : la première, blanche entièrement ; la seconde, rouge ; la troisième, noire.
Lorsque Abou-Nowas le vit d’abord vêtu de blanc, il sentit pétiller en son esprit le feu de l’inspiration, et il improvisa ces vers en son honneur :
« Il s’est montré vêtu d’un lin à la blancheur de lait, et ses yeux étaient languissants sous ses paupières bleues, et les roses tendres de ses joues bénissaient Qui les avait créées !
« Et moi je lui dis : « Pourquoi passes-tu sans me regarder i alors que je consens à me livrer entre tes mains comme la victime sous les coups du sacrificateur ? »
« Il me répondit : « Laisse ces discours et regarde en silence l’œuvre du Créateur. Blanc est mon corps et blanche ma tunique, blanc est mon visage et blanche ma destinée : c’est blanc sur blanc, et blanc sur blanc ! »
Lorsque le jeune garçon eut entendu ces vers, il sourit et se dévêtit de sa tunique blanche pour paraître tout en rouge. À cette vue, Abou-Nowas sentit l’émotion poétique l’étreindre tout à fait et, séance tenante, il improvisa ces vers :
« Il s’est montré vêtu d’une tunique rouge comme ses procédés cruels !
« Et moi je m’écriai, ému de surprise : « Comment se fait-il que tu puisses, bien que tu sois d’une blancheur de lune, apparaître avec tes deux joues rougies, on le dirait, du sang de nos cœurs, et vêtu d’une tunique prise aux anémones ? »
« Il me répondit : « L’aurore m’avait d’abord prêté son vêtement, mais c’est maintenant le soleil lui-même qui m’a fait cadeau de ses flammes : de flamme sont mes joues et rouge mon habit, de flamme sont mes lèvres et rouge le vin qui les colore : c’est rouge sur rouge, et rouge sur rouge ! »
Lorsque le mignon eut entendu ces vers, d’un geste il rejeta sa tunique rouge et parut vêtu de la tunique noire qu’il portait directement sur la peau et qui dessinait bien la taille serrée par une ceinture de soie. Et Abou-Nowas, à cette vue, fut à la limite de l’exaltation et improvisa ces vers en son honneur :
« Il s’est montré vêtu d’une tunique noire comme la nuit, et il ne daigna me jeter un regard seulement ! Et je lui dis : « Ne vois-tu donc pas que mes ennemis et mes envieux exultent de ton abandon ?
« Ah ! je le vois bien maintenant : noirs sont tes vêtements et noire ta chevelure, noirs sont tes yeux et noire ma destinée : c’est noir sur noir, et noir sur noir ! »
Lorsque l’envoyé du khalifat eut vu le jeune homme et entendu ces vers, il excusa en son âme Abou-Nowas, et retourna sur l’heure au palais où il mit le khalifat au courant de l’aventure survenue à Abou-Nowas et lui raconta comment le poète s’était constitué en otage dans le cabaret, n’ayant pu payer la somme promise au beau jeune homme.
Alors le khalifat, fort irrité à la fois et amusé, remit à l’eunuque la somme nécessaire à la délivrance de l’otage, et lui ordonna d’aller le tirer de là sur le champ et de l’amener en sa présence, de gré ou de force.
L’eunuque se hâta d’exécuter l’ordre et bientôt s’en revint en soutenant avec difficulté le poète qui chancelait, pris de boisson. Et le khalifat l’apostropha d’une voix qu’il essaya de rendre furieuse ; puis, voyant qu’Abou-Nowas éclatait de rire, il s’approcha de lui, le prit par la main et s’achemina avec lui vers le pavillon où se trouvait l’adolescente.
Lorsque Abou-Nowas vit, assise sur le lit et tout de satin bleu habillée et le visage recouvert d’un léger voile de soie bleue, l’adolescente aux grands yeux noirs qui souriaient de sa mine, il se sentit dégrisé, mais, par contre, il fut enflammé d’enthousiasme et, inspiré sur l’heure, il improvisa cette strophe en son honneur :
« Dis à la belle au voile bleu que je la supplie de compatir à quelqu’un que brûle le désir de sa beauté. Dis-lui : « Je t’adjure, par la blancheur de ton beau teint que ne valent ni la tendre rose ni le jasmin, je t’adjure, par ton sourire qui fait pâlir perles et rubis, de me jeter un regard où je ne puisse lire la trace des calomnies que sur moi mes envieux ont inventées ! »
Lorsque Abou-Nowas eut fini son improvisation, l’adolescente présenta un plateau de boissons au khalifat qui, voulant s’amuser, invita le poète à boire tout seul tout le vin de la coupe. Abou-Nowas s’exécuta de bonne grâce et ne tarda pas à ressentir sur sa raison les effets de la liqueur enivrante. À ce moment, il prit fantaisie au khalifat, pour faire peur à Abou-Nowas, de se lever soudain et, le glaive à la main, de se précipiter sur lui en faisant mine de lui couper la tête.
À cette vue, Abou-Nowas terrifié se mit à courir à travers la salle en jetant de grands cris ; et le khalifat de le poursuivre dans tous les coins en le piquant de la pointe du glaive. Puis il finit par lui dire : « Soit ! reviens à ta place boire encore un coup ! » Et, en même temps, il fit signe à l’adolescente de cacher la coupe : c’est ce qu’elle fit immédiatement en la dissimulant sous sa robe. Mais Abou-Nowas, malgré son ivresse, s’en aperçut et improvisa cette strophe :
« Quelle étrange aventure est mon aventure ! Une naïve jeune fille se transforme en voleuse et me ravit la coupe pour la cacher sous sa robe dans un endroit où je me voudrais voir moi-même caché. C’est un endroit que je nommerai pas, par égard pour le khalifat ! »
En entendant ces vers, le khalifat se mit à rire et, par manière de plaisanterie, dit à Abou-Nowas : « Par Allah ! dès maintenant je veux te nommer à un haut emploi. Désormais tu es le chef attitré des entremetteurs de Baghdad ! » Abou-Nowas se mit à ricaner et riposta à l’instant : « Dans ce cas, ô commandeur des Croyants, je me mets à tes ordres et te prie de me dire si tu as tout de suite besoin de mon entremise ? »
À ces paroles, le khalifat entra dans une grande colère et cria à l’eunuque d’aller immédiatement appeler Massrour le porte-glaive, l’exécuteur de sa justice. Et quelques instants après, Massrour arriva, et le khalifat lui ordonna de dépouiller Abou-Nowas de ses vêtements…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… et le khalifat lui ordonna de dépouiller Abou-Nowas de ses vêtements, de lui mettre un bât sur le dos, de lui passer un licou, de lui enfoncer un aiguillon dans le fondement, et de le conduire ainsi équipé devant tous les pavillons des favorites et des autres esclaves, pour qu’il pût servir de risée à tous les habitants du palais, puis de le mener à la porte de la ville et, devant tout le peuple de Baghdad, de lui couper la tête et de la lui apporter sur un plateau. Et Massrour répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et aussitôt se mit à l’œuvre pour exécuter les ordres du khalifat.
Il emmena donc Abou-Nowas, qui jugea complètement vain d’essayer de détourner la fureur du khalifat, et, après l’avoir mis dans l’état prescrit, commença à le promener lentement devant les divers pavillons dont le nombre était exactement celui des jours de l’année.
Or, Abou-Nowas, dont la réputation de drôlerie était universelle dans le palais, ne manqua pas d’attirer la sympathie de toutes les femmes qui, pour mieux exprimer leur apitoiement, se mirent, chacune à son tour, à le couvrir d’or et de bijoux, et finirent par s’attrouper et le suivre, en lui disant de bonnes paroles ; si bien que le vizir Giafar Al-Barmaki, qui passait par là pour se rendre au palais où l’appelait une affaire de première importance, l’aperçut qui tantôt pleurait et tantôt se lamentait, s’approcha et lui dit : « C’est toi, Abou-Nowas ? Quel crime as-tu donc commis pour être châtié de la sorte ! » Il répondit : « Par Allah ! je n’ai pas commis même l’odeur d’un crime ! J’ai tout simplement récité quelques-uns de mes plus beaux vers devant le khalifat qui, par manière de gratitude, m’a loti de ses plus beaux vêtements ! »
Le khalifat, qui à ce moment précis se trouvait tout près, caché derrière une portière d’un des pavillons, entendit la réponse d’Abou-Nowas et ne put s’empêcher d’éclater de rire. Il pardonna à Abou-Nowas, lui fit don d’une robe d’honneur et d’une grosse somme d’argent et continua, comme par le passé, à en faire son compagnon inséparable dans ses moments de mauvaise humeur.
— Lorsque Schahrazade eut fini de raconter cette aventure du poète Abou-Nowas, la petite Doniazade, qui était prise d’un rire silencieux qu’elle étouffait vainement sur le tapis où elle était blottie, courut à sa sœur et lui dit : « Par Allah ! ma sœur Schahrazade, que cette histoire est amusante et comme Abou-Nowas déguisé en âne devait être drôle à regarder ! Tu serais si gentille de nous dire encore quelque chose à son sujet ! »
Mais le roi Schahriar s’écria : « Je n’aime pas du tout cet Abou-Nowas là ! Si tu tiens absolument à avoir la tête coupée sur l’heure, tu n’as qu’à continuer le récit de ses aventures. Sinon, et pour achever de nous faire passer cette nuit, hâte-toi de me raconter une histoire de voyages ; car, depuis le jour où, avec mon frère Schahzaman, roi de Samarcand Al-Ajam, j’ai entrepris une excursion aux pays lointains, à la suite de l’aventure avec ma femme maudite dont j’ai fait couper la tête, j’ai pris goût à tout ce qui a rapport aux voyages instructifs. Si donc tu connaissais un conte vraiment délicieux à écouter, ne tarde pas à le commencer ; car cette nuit mon insomnie est plus tenace que jamais ! »
À ces paroles du roi Schahriar, la diserte Schahrazade de s’écrier : « Justement ce sont ces histoires de voyages qui sont les plus étonnantes et les plus délicieuses d’entre toutes celles que j’ai racontées. Tu vas en juger tout de suite, ô Roi fortuné ; car, en vérité, il n’y a point dans les livres une histoire comparable à celle du voyageur qui s’appelle Sindbad le Marin[1]. Et c’est précisément de cette histoire là que je vais t’entretenir, ô Roi fortuné, du moment que tu veux bien me le permettre ! »
Et aussitôt Schahrazade de raconter :
HISTOIRE DE SINDBAD LE MARIN
Il est parvenu jusqu’à moi qu’il y avait, au temps du khalifat Haroun Al-Rachid, dans la ville de Baghdad, un homme appelé Sindbad le Portefaix. C’était un homme pauvre de condition et qui avait coutume, pour gagner sa vie, de porter des charges sur sa tête. Il lui arriva, un jour d’entre les jours, de porter une charge fort lourde ; et ce jour-là précisément était excessif de chaleur : aussi le portefaix se fatigua beaucoup de cette charge-là, et transpira. La chaleur était devenue intolérable, quand enfin le portefaix passa devant la porte d’une maison qui devait appartenir à quelque riche marchand, à en juger par le sol qui, tout autour, était bien balayé et arrosé d’eau de roses. Là soufflait une brise fort agréable ; et il y avait, près de la porte, un large banc où s’asseoir. Aussi le portefaix Sindbad, pour se reposer et respirer le bon air, déposa sa charge sur le banc en question, et sentit aussitôt une brise qui de cette porte-là s’en venait jusqu’à lui, pure et mêlée d’une délicieuse odeur ; aussi se délecta-t-il à tout cela, et alla-t-il s’asseoir à l’extrémité du banc. Alors il perçut un concert d’instruments divers et de luths qui accompagnaient des voix ravissantes chantant des chansons en une langue savante ; et il perçut aussi des voix d’oiseaux chanteurs qui glorifiaient Allah Très-Haut sur des modes charmeurs ; il distingua, entre autres, la voix des tourterelles, des rossignols, des merles, des bulbuls, des pigeons à collier et des perdrix apprivoisées. Alors il s’émerveilla en son âme et, à cause du plaisir énorme qu’il ressentait, il passa la tête par l’ouverture de la porte et vit, au fond, un jardin immense où se pressaient de jeunes serviteurs, et des esclaves, et des domestiques, et des gens de toute qualité, et il y avait là des choses qu’on ne pouvait trouver que chez les rois et les sultans.
Après cela, bouffa sur lui une bouffée d’odeurs de mets certainement admirables et délicieux, bouffée où se mêlaient toutes sortes de fumets exquis de toutes les diverses victuailles et boissons de bonne qualité. Alors il ne put s’empêcher de soupirer ; et il tourna les yeux vers le ciel et s’écria : « Gloire à Toi, Seigneur Créateur, Ô Donateur ! Tu fais tes donations à qui te plaît, sans calcul ! Ô mon Dieu ! si je crie vers toi, ce n’est point pour te demander compte de tes actes ou pour te questionner sur ta justice et ta volonté, car la créature n’a point à interroger son maître tout-puissant ! Mais, simplement, je constate. Gloire à toi ! Tu enrichis ou tu appauvris, tu élèves ou tu abaisses, selon tes désirs, et c’est toujours logique, bien que nous ne puissions comprendre ! Ainsi, voilà le maître de cette riche maison… Il est heureux aux extrêmes limites de la félicité ! Il est dans les délices de ces odeurs charmantes, de ces fumets agréables, de ces mets savoureux, de ces boissons supérieurement délicieuses ! Il est heureux et dispos et bien content, alors que d’autres, moi par exemple, sont aux limites extrêmes de la fatigue et de la misère ! »
Puis le portefaix appuya sa main contre sa joue et, de toute sa voix, chanta ces vers, qu’il improvisait à mesure :
« Souvent un malheureux sans gîte se réveille à l’ombre d’un palais créé par son destin. Moi, je me réveille, hélas ! chaque matin plus misérable que la veille !
« Mon infortune augmente encore d’instant en instant avec le faix chargeant mon dos qui se fatigue, tandis qu’au sein des biens que le sort leur prodigue, d’autres sont heureux et contents !
« Le destin chargea-t-il jamais le dos d’un homme d’une charge pareille à celle de mon dos ?… Pourtant d’autres, gorgés d’honneurs et de repos, ne sont que mes pareils en somme.
« Ils ne sont que pareils à moi, mais c’est en vain : le sort entre eux et moi mit quelque différence, puisque je leur ressemble autant qu’amer et rance le vinaigre ressemble au vin.
« Mais si je n’ai jamais joui de ta largesse, ô Seigneur, ne crois point que je t’accuse en rien ! Tu es grand, magnanime et juste ! Et je sais bien que tu jugeas avec sagesse ! »
Lorsque Sindbad le Portefaix eut fini de chanter ces vers, il se leva et voulut remettre la charge sur sa tête et continuer sa route, quand de la porte du palais sortit et s’avança vers lui un petit esclave au visage gentil, aux jolies formes ténues, aux vêtements fort beaux, qui vint le prendre doucement par la main en lui disant : « Entre parler à mon maître, car il désire te voir. » Le portefaix, fort intimidé, essaya bien de trouver quelque excuse qui pût le dispenser de suivre le jeune esclave, mais en vain. Il déposa donc sa charge chez le portier, dans le vestibule, et il pénétra avec l’enfant dans l’intérieur de la demeure.
Il vit une maison splendide, pleine de gens graves et respectueux, au centre de laquelle s’ouvrait une grande salle où il fut introduit. Il y remarqua une assemblée nombreuse composée de personnages à l’air honorable et de convives fort notables. Il y remarqua aussi des fleurs de toutes les sortes, des parfums de toutes les espèces, des confitures sèches de toutes les qualités, des sucreries, des pâtes d’amandes, des fruits merveilleux, et une quantité prodigieuse de plateaux chargés d’agneaux rôtis et de mets somptueux, et d’autres plateaux chargés de boissons extraites du jus des raisins. Il y remarqua aussi des instruments d’harmonie que tenaient sur leurs genoux de belles esclaves assises en bon ordre, chacune selon le rang qui lui était assigné.
Au centre de la salle, le portefaix aperçut, au milieu des autres convives, un homme au visage imposant et digne, dont la barbe était blanchie par les ans, dont les traits étaient fort beaux et très agréables à regarder, et dont toute la physionomie était empreinte de gravité, de bonté, de noblesse et de grandeur.
À la vue de tout cela, le portefaix Sindbad…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
… À la vue de tout cela, le portefaix Sindbad resta interdit et se dit en lui-même : « Par Allah ! cette demeure est quelque palais du pays des génies puissants ou la résidence d’un roi très grand ou d’un sultan ! » Puis il se hâta de prendre l’attitude que réclamaient la politesse et le savoir-vivre, fit ses souhaits de paix à tous les assistants, formula des vœux à leur intention, embrassa la terre entre leurs mains, et finit par se tenir debout, la tête baissée, avec respect et modestie.
Alors le maître du logis lui dit de s’approcher et l’invita à s’asseoir à ses côtés, puis, après lui avoir souhaité la bienvenue d’un ton fort aimable, il lui servit à manger, lui offrant ce qu’il y avait de plus délicat et de plus délicieux et de plus habilement apprêté parmi tous les mets qui couvraient les plateaux. Et Sindbad le Portefaix ne manqua pas de faire honneur à l’invitation, toutefois après avoir prononcé la formule invocatoire. Il mangea donc jusqu’à satiété ; puis il remercia Allah disant : « Louanges Lui soient rendues en toute occasion ! » Après quoi, il se lava les mains et remercia tous les convives pour leur amabilité.
Alors seulement le maître, suivant les usages qui ne permettent de questionner l’hôte que lorsqu’on lui a servi à manger et à boire, dit au portefaix : « Sois ici le bienvenu, et mets-toi largement à ton aise ! Que ta journée soit bénie ! Mais, ô mon hôte, peux-tu me dire ton nom et ta profession ? » Il lui répondit : « Ô mon maître, je m’appelle Sindbad le Portefaix, et ma profession consiste à porter sur ma tête des charges, moyennant salaire. » Le maître du lieu sourit et lui dit : « Sache, ô portefaix, que ton nom est comme mon nom, car je m’appelle Sindbad le Marin ! »
Puis il continua : « Sache aussi, ô portefaix, que, si je t’ai prié de venir ici, c’est pour t’entendre répéter les belles strophes que tu chantais quand tu étais assis dehors sur le banc ! »
À ces paroles, le portefaix devint fort confus et dit : « Par Allah sur toi ! ne me blâme pas trop pour cette action inconsidérée ; car les peines, les fatigues et la misère qui ne laisse rien dans la main apprennent à l’homme l’impolitesse, la sottise et l’insolence ! » Mais Sindbad le Marin dit à Sindbad le Portefaix : « N’aie aucune honte de ce que tu as chanté et sois ici sans gêne, car désormais tu es mon frère. Seulement hâte-toi, je t’en prie, de me chanter ces strophes que j’ai entendues et qui m’ont fort émerveillé ! » Alors le portefaix chanta les strophes en question, qui ravirent à l’extrême Sindbad le Marin.
Aussi, les strophes finies, Sindbad le Marin se tourna vers Sindbad le Portefaix et lui dit : « Ô portefaix, sache que j’ai une histoire, moi aussi, qui est étonnante et que je me réserve de te raconter à mon tour. Je te dirai ainsi toutes les aventures qui me sont arrivées et toutes les épreuves que j’ai subies avant de parvenir à cette félicité et d’habiter ce palais. Et tu verras alors au prix de quels terribles et étranges travaux, au prix de quelles calamités, de quels maux et de quels malheurs initiaux j’ai acquis ces richesses au milieu desquelles tu me vois vivre dans ma vieillesse. Car tu ignores sans doute les sept voyages extraordinaires que j’ai accomplis, et comment chacun de ces voyages est à lui seul une chose si prodigieuse que d’y penser seulement on reste interdit et à la limite de toutes les stupéfactions. Mais tout ce que je vais te raconter, à toi et à tous mes honorables invités, ne m’est, en somme, arrivé que parce que l’avait ainsi d’avance fixé la destinée, et que toute chose écrite doit courir sans qu’on puisse l’éviter ou la fuir !
LA PREMIÈRE HISTOIRE
DES HISTOIRES DE SINDBAD LE MARIN
ET C’EST LE PREMIER VOYAGE
Sachez, ô vous tous, seigneurs, ô très illustres, et toi honorable portefaix qui t’appelles, comme moi, Sindbad, que j’avais un père marchand qui était des grands d’entre les gens et les marchands. Chez lui il y avait de nombreuses richesses dont il faisait usage sans cesse pour distribuer aux pauvres des largesses, pourtant avec sagesse, car à sa mort il me laissa en héritage, alors que j’étais encore en bas âge, beaucoup de biens, de terres et de villages.
Lorsque j’eus atteint l’âge d’homme, je mis la main sur tout cela, et je me plus à manger des mets extraordinaires et à boire des boissons extraordinaires, à fréquenter les jeunes gens et à faire le beau avec des habits excessivement chers, et à cultiver les amis et les camarades. De la sorte, je finis par être convaincu que cela devait durer toujours pour mon plus grand avantage. Et je continuai à vivre ainsi un long espace de temps, jusqu’à ce qu’un jour, revenu de mon égarement et retourné à ma raison, j’eusse constaté que mes richesses étaient dissipées, ma condition changée et mes biens en allés. Alors, réveillé tout à fait de mon inaction, je me vis en proie à la peur et à l’ahurissement d’arriver un jour à la vieillesse dans le dénûment. Alors aussi me vinrent à la mémoire ces paroles que mon défunt père se plaisait à répéter, paroles de notre maître Soleïmân ben-Daoud (sur eux deux la prière et la paix !) : Il y a trois choses préférables à trois autres : le jour de la mort est moins fâcheux que le jour de la naissance, un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort, et le tombeau est préférable à la pauvreté.
À ces pensées, je me levai à l’heure et à l’instant ; je ramassai ce qui me restait en meubles et vêtements, et je le vendis, sans tarder, à l’encan avec les débris de ce qui était sous ma main en biens, propriétés et arpents. De la sorte, je réunis la somme de trois mille drachmes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… je réunis, de la sorte, la somme de trois mille drachmes, et aussitôt il me vint à l’esprit de voyager vers les contrées et les pays des hommes, car je me souvins des paroles du poète, qui a dit :
« Les peines font la gloire acquise encore plus belle ! La gloire des humains est la fille immortelle de bien des longues nuits qui passent sans sommeil !
« Celui qui veut trouver le trésor sans pareil des perles de la mer, blanches, grises ou roses, se fait plongeur avant d’atteindre aux belles choses.
« Il suivrait l’impossible espoir jusqu’à sa mort, celui-là qui voudrait la gloire sans effort ! »
Aussi, sans plus différer, je courus au souk, où je pris soin de faire emplette de marchandises diverses et de pacotilles de toutes sortes. Je transportai immédiatement le tout à bord d’un navire où se trouvaient déjà d’autres marchands prêts au départ, et, mon âme habituée maintenant à l’idée de la mer, je vis le navire s’éloigner de Baghdad et descendre le fleuve jusqu’à Bassra, sur la mer.
De Bassra le navire fit voile vers la haute mer et alors, durant des jours et des nuits, nous naviguâmes en atteignant des îles et des îles et une mer après une autre mer et une terre après une autre terre ! Et à chaque endroit où nous descendions, nous vendions des marchandises pour en acheter d’autres et nous faisions des trocs et des échanges fort avantageux.
Un jour, que nous naviguions depuis plusieurs jours sans voir de terre, nous vîmes émerger de la mer une île qui nous sembla, par sa végétation, quelque merveilleux jardin d’entre les jardins d’Éden. Aussi, le capitaine du navire voulut bien atterrir et, une fois l’ancre jetée et l’échelle abaissée, nous laisser débarquer.
Nous descendîmes, nous tous, les marchands, emportant avec nous tout ce qui était nécessaire en vivres et ustensiles de cuisine. Quelques-uns se chargèrent d’allumer le feu et de préparer la nourriture et de laver le linge, tandis que d’autres se contentèrent de se promener, de se divertir et de se reposer des fatigues de la mer. Moi, je fus du nombre de ceux qui préférèrent se promener et jouir des beautés de la végétation dont ces côtes étaient couvertes, tout en n’oubliant pas de manger et de boire.
Pendant que nous nous délassions de la sorte, nous sentîmes tout à coup l’île trembler dans toute sa masse et nous donner une secousse si rude que nous fûmes projetés à quelques pieds au-dessus du sol. Et, au même moment, nous vîmes apparaître à l’avant du navire le capitaine qui, d’une voix terrible et avec des gestes effrayants, nous cria : « Ô passagers, sauvez-vous ! Hâtez-vous ! Remontez vite à bord ! Lâchez tout ! Abandonnez vos effets à terre et sauvez vos âmes ! Fuyez l’abîme qui vous attend ! Courez vite ! Car l’île sur laquelle vous vous trouvez n’est point une île ! C’est une baleine gigantesque ! Elle a élu domicile au milieu de cette mer, depuis les temps de l’antiquité ; et les arbres ont poussé sur son dos, grâce au sable marin ! Vous l’avez réveillée, de son sommeil ! Vous avez troublé son repos et dérangé ses sensations en allumant du feu sur son dos ! Et la voici qui bouge ! Sauvez-vous, ou elle va s’enfoncer dans la mer qui vous engloutira sans retour ! Sauvez-vous ! Lâchez tout ! Je m’en vais ! »
À ces paroles du capitaine, les passagers épouvantés lâchèrent là leurs effets, vêtements, ustensiles et fourneaux et prirent leur course vers le navire qui déjà levait l’ancre. Quelques-uns purent l’atteindre juste à temps ; les autres ne le purent pas. Car la baleine était déjà en mouvement et, après quelques sauts effrayants, s’enfonçait dans la mer avec tous ceux qui se trouvaient sur son dos, et les flots qui se choquaient et s’entrechoquaient se refermaient sur elle et sur eux à tout jamais.
Or, moi, je fus du nombre de ceux qui furent abandonnés sur cette baleine-là et furent noyés !
Mais Allah Très-Haut me sauvegarda et me délivra de la noyade en me mettant sous la main une pièce de bois creuse, sorte de grand baquet qu’avaient apporté les passagers pour y laver leur linge. Je m’y cramponnai d’abord, puis je réussis à me mettre dessus à califourchon, grâce aux efforts extraordinaires dont me rendirent capable le danger et la cherté de mon âme, qui m’était précieuse ! Alors je me mis à battre l’eau avec mes pieds comme avec des avirons, tandis que les vagues se jouaient de moi et me faisaient chavirer tantôt à droite et tantôt à gauche !
Quant au capitaine, il s’était hâté de s’éloigner, toutes voiles au vent, avec ceux qui avaient pu se sauver, sans plus s’occuper de ceux qui surnageaient encore. Ceux-ci ne tardèrent pas à périr, tandis que moi je ramais de mes pieds, en y mettant toutes mes forces, pour essayer d’atteindre le navire que je suivis ainsi de l’œil jusqu’à ce qu’il eût disparu à ma vue, et que sur la mer la nuit tombât, m’apportant la certitude de ma perte et de mon abandon !
Je demeurai ainsi à lutter contre l’abîme durant une nuit et un jour entier. Je fus enfin entraîné par le vent et par les courants jusqu’aux bords d’une île escarpée couverte de plantes grimpantes qui descendaient le long des falaises et trempaient dans la mer. Je m’accrochai à ces branchages et réussis, m’aidant des pieds et des mains, à grimper jusqu’au haut de la falaise.
Alors, échappé de la sorte à une perdition si certaine, je songeai à m’examiner le corps, et je vis les meurtrissures qui le couvraient et le gonflement de mes pieds et les traces des morsures faites par les poissons qui s’étaient rempli le ventre de mes extrémités. Pourtant, je ne ressentais aucune douleur, tant j’étais insensibilisé par la fatigue et le danger couru. Je me jetai donc sur le sol de l’île à plat ventre comme un cadavre, et m’évanouis, noyé dans un abrutissement total.
Je restai dans cet état jusqu’au second jour et ne me réveillai que grâce au soleil qui tombait sur moi à pic. Je voulus me lever, mais mes pieds gonflés et endoloris me refusèrent leur secours, et je retombai sur le sol. Alors, bien attristé de l’état où je me trouvais réduit, je me mis à me traîner, tantôt en rampant sur les pieds et les mains, tantôt en marchant sur les genoux, à la recherche de quelque chose dont me nourrir. Je finis enfin par arriver au milieu d’une plaine couverte d’arbres fruitiers et arrosée par des sources à l’eau pure et excellente. Et je me reposai là durant plusieurs jours, mangeant des fruits et buvant aux sources. Aussi, mon âme ne tarda pas à se revivifier et à ranimer mon corps engourdi qui put se mouvoir plus aisément et recouvrer l’usage de ses membres, pas tout à fait cependant, car, pour marcher, je fus obligé de me confectionner une paire de béquilles dont me soutenir encore. De la sorte, je pus me promener lentement entre les arbres en rêvant et en mangeant des fruits, et passai de longs moments à admirer ce pays et à m’extasier devant l’œuvre du Tout-Puissant.
Un jour que je me promenais sur le rivage, je vis quelque chose au loin m’apparaître que je crus être une bête sauvage ou quelque monstre d’entre les monstres de la mer. Ce quelque chose m’intrigua si fort que, malgré les sentiments divers qui s’agitaient en moi, je m’en approchai, tantôt avançant et tantôt reculant. Et je finis par voir que c’était une cavale merveilleuse, attachée à un piquet. Elle était si belle, que je voulus m’en approcher encore pour la voir de tout près, quand soudain un cri épouvantable me terrifia et me figea sur place, alors que je ne souhaitais plus que fuir au plus vite ; et, au même instant, de dessous terre, un homme sortit qui, à grands pas, s’avança sur moi et me cria : « Qui es-tu ? Et d’où viens-tu ? Et quel est le motif qui t’a poussé à t’aventurer jusqu’ici ? »
Je répondis : « Ô mon maître, sache que je suis un homme étranger et que j’étais à bord d’un navire quand je me noyai avec divers autres passagers. Mais Allah me gratifia d’un baquet en bois que j’enfourchai et qui me soutint jusqu’à ce que je fusse jeté sur cette côte par les vagues ! »
Lorsqu’il eut entendu mes paroles, il me prit la main et me dit : « Suis-moi ! » Et je le suivis. Alors il me fit descendre dans une caverne souterraine, et me fit entrer dans une grande salle où il me fit asseoir à la place d’honneur, et il m’apporta quelque chose à manger, car j’avais faim. Moi, je mangeai jusqu’à ce que je fusse rassasié et en eusse assez et que mon âme se fût apaisée. Alors il m’interrogea sur mon aventure et je la lui racontai depuis le commencement jusqu’à la fin ; et elle l’étonna prodigieusement. Puis j’ajoutai : « Par Allah sur toi, ô mon maître, ne me blâme pas trop de ce que je vais te demander ! Moi je viens de te raconter la vérité sur mon aventure, et je souhaite maintenant savoir qui tu es et le motif de ton séjour dans cette salle de souterrain et la cause qui t’a fait attacher cette jument toute seule sur le rivage de la mer ! »
Il me dit : « Sache que dans cette île nous sommes plusieurs qui, postés à des endroits différents…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Sache donc que dans cette île nous sommes plusieurs qui, postés à des endroits différents, servons à garder les chevaux du roi Mihrajân. Tous les mois, à la nouvelle lune, chacun de nous amène ici une cavale de race, encore vierge, l’attache sur le rivage et se hâte de descendre se cacher dans la grotte souterraine. Alors, attiré par l’odeur de la femelle, sort de l’eau un cheval des chevaux marins qui regarde de droite et de gauche et qui, ne voyant personne, fond sur la cavale et la couvre. Puis, lorsqu’il a fini sa chose avec elle, il descend de sur son dos et essaie de l’emmener avec lui. Mais elle, attachée au piquet, ne peut le suivre ; alors il crie hautement et lui donne des coups avec la tête et les pieds, et il crie de plus en plus fort. Alors nous, nous l’entendons et nous comprenons qu’il a fini de la couvrir ; aussitôt nous sortons de tous les côtés et nous courons à lui en lançant de grands cris qui l’effraient et l’obligent à rentrer dans la mer ! Quant à la cavale, elle devient enceinte et enfante un poulain ou une pouliche qui vaut tout un trésor et qui ne peut avoir son semblable sur toute la surface de la terre. Et justement c’est aujourd’hui que viendra le cheval marin. Et moi, je te promets, une fois cette chose finie, de t’emmener avec moi et de te présenter à notre roi Mihrajân et de te faire connaître notre pays. Bénis donc Allah qui t’a fait me rencontrer, car sans moi tu mourais de tristesse dans cette solitude sans jamais plus revoir les tiens et ton pays, et sans que personne sût jamais ce que tu serais devenu ! »
À ces paroles, je remerciai beaucoup le gardien de la cavale et continuai à m’entretenir avec lui, quand soudain le cheval marin sortit de l’eau, fonça sur la cavale et la couvrit. Et quand il eut terminé ce qu’il avait à terminer, il descendit de dessus elle et voulut l’emmener ; or, elle ne pouvait se détacher du piquet et elle ruait et hennissait. Mais le gardien de la cavale se précipita hors de la caverne, appela ses compagnons à grands cris et tous, munis de glaives, de lances et de boucliers, s’élancèrent sur le cheval marin qui, pris de peur, lâcha prise et alla tel qu’un buffle se replonger dans la mer et disparut sous les eaux.
Alors tous les autres gardiens, chacun avec sa cavale, se groupèrent autour de moi et me firent mille amabilités et, après m’avoir encore offert à manger et avoir mangé avec moi, m’offrirent une bonne monture et, sur l’invitation du premier gardien, me proposèrent de les accompagner auprès du roi, leur maître. Moi, j’acceptai sur l’heure ; et nous partîmes tous ensemble.
Lorsque nous arrivâmes dans la ville, mes compagnons me précédèrent et allèrent mettre leur maître au courant de ce qui m’était arrivé. Après quoi, ils revinrent me chercher et me menèrent au palais ; et, sur la permission qui me fut accordée, j’entrai dans la salle du trône et vins me présenter entre les mains du roi Mihrajân, auquel je fis mon souhait de paix.
Le roi me rendit mon souhait de paix, me dit des paroles de bienvenue et voulut entendre de ma bouche le récit de mon aventure. J’obéis aussitôt et lui racontai tout ce qui m’était arrivé, sans omettre un détail.
À cette histoire, le roi Mihrajân fut émerveillé et me dit : « Mon fils, par Allah ! n’eût été ta chance d’avoir une vie longue, tu aurais déjà certainement succombé, à l’heure qu’il est, à tant d’épreuves et de malheurs. Mais louange à Allah pour ta délivrance ! » Il me dit encore beaucoup d’autres paroles bienveillantes, voulut m’admettre désormais dans son intimité, et, pour me donner une preuve de son bon vouloir à mon égard et de son estime pour mes connaissances maritimes, il me nomma sur-le-champ directeur des ports et rades de son île, et greffier des arrivages et départs de tous les navires.
Mes nouvelles fonctions ne m’empêchèrent pas de me rendre tous les jours au palais faire mes souhaits au roi, qui s’habitua tellement à moi qu’il me préféra à tous ses intimes et me le prouva par des présents sans nombre et des largesses étonnantes, et cela tous les jours. Aussi j’eus une telle influence sur lui, que toutes les requêtes et toutes les affaires du royaume passaient par mon entremise, pour le bien général des habitants.
Mais tous ces soins ne me faisaient point oublier mon pays ni perdre l’espoir d’y retourner. Aussi je ne manquais jamais d’interroger tous les voyageurs qui arrivaient dans l’île et tous les marins, en leur demandant s’ils connaissaient Baghdad et de quel côté elle était située. Mais nul ne pouvait me répondre à ce sujet ; et tous me disaient n’avoir jamais entendu parler de cette ville ni appris l’endroit où elle était. Et ma peine augmentait de plus en plus de me voir ainsi condamné à vivre en pays étranger, et ma perplexité était à ses limites de voir les gens ne pas même se douter de l’existence de ma ville et ignorer le chemin qui y conduisait.
Durant mon séjour dans cette île, j’eus l’occasion de voir des choses étonnantes, dont celles-ci entre mille.
Un jour que je m’étais rendu, selon mon habitude, auprès du roi Mihrajân, je fis la connaissance de personnages indiens qui, après les salams de part et d’autre, voulurent bien se prêter à mes questions et m’apprirent que dans le pays de l’Inde il y avait un grand nombre de castes, dont les deux principales étaient la caste des kchatryas, composée d’hommes nobles et justes qui ne commettaient jamais d’exactions ou d’actes repréhensibles, et la caste des brahmes, qui étaient des hommes purs ne buvant jamais de vin et amis de la joie, de la douceur des manières, des chevaux, du faste et de la beauté. Ce sont ces Indiens savants qui m’apprirent également que les castes principales se divisaient en soixante-douze autres castes qui n’avaient aucun rapport l’une avec l’autre. Cela m’étonna à la limite de l’étonnement.
Dans cette île-là, j’eus également l’occasion de visiter une terre appartenant au roi Mihrajân, et qu’on appelait Cabil. On y entendait toutes les nuits résonner les timbales et les tambours. Et j’ai pu constater que les habitants étaient très forts en syllogismes et fertiles en belles pensées. D’ailleurs, leur réputation était déjà faite à ce sujet auprès des voyageurs et des marchands.
Dans ces mers lointaines, j’ai vu un jour un poisson long de cent coudées et d’autres poissons dont le visage ressemblait au visage des hiboux.
En vérité, ô mes maîtres, j’ai vu encore des choses bien extraordinaires et des prodiges stupéfiants dont le récit m’entraînerait trop loin. Il me suffira d’ajouter que je demeurai encore dans cette île le temps nécessaire pour apprendre beaucoup de choses et m’enrichir par divers échanges, ventes et achats.
Un jour, j’étais, selon mon habitude, debout sur le rivage, dans l’exercice de mes fonctions, et j’étais, comme toujours, appuyé sur ma béquille, quand je vis entrer dans la rade un grand navire rempli de marchands. J’attendis que le navire eût jeté l’ancre solidement et abaissé son échelle, pour monter à bord et aller trouver le capitaine afin d’inscrire sa cargaison. Devant moi, les matelots débarquèrent tout le chargement, que je notais au fur et à mesure ; et, lorsqu’ils eurent terminé leur travail, je demandai au capitaine : « Y a-t-il encore quelque chose dans ton navire ? » Il me répondit : « Ô mon maître, il y a bien encore quelques marchandises au fond du ventre du navire, mais elles ne sont là qu’en dépôt seulement, car leur propriétaire, qui était avec nous en voyage, il y a longtemps de cela, s’est perdu en se noyant. Et nous voudrions bien maintenant vendre ces marchandises-là et en rapporter le prix aux parents du défunt à Baghdad, la demeure de paix ! »
Alors moi, ému à l’extrême limite de l’émotion, je m’écriai : « Et comment s’appelait-il ce marchand, ô capitaine ? » Il me répondit : « Sindbad le Marin ! » À ces mots, je regardai plus attentivement le capitaine, et je reconnus en lui le maître du navire qui avait été obligé de nous abandonner sur la baleine. Et de toute ma voix je m’écriai : « Je suis Sindbad le Marin ! »
Puis je continuai : « Lorsque la baleine se fut mouvementée sous l’action du feu allumé sur son dos, je fus de ceux-là qui ne purent gagner ton navire et se noyèrent. Mais je fus sauvé grâce au baquet en bois qu’avaient transporté les marchands pour y laver leur linge. Je me mis, en effet, à califourchon sur ce baquet-là, et je ramai des pieds comme avec des avirons. Et il arriva ce qui arriva, avec la permission de l’Ordonnateur ! »
Et je racontai au capitaine comment j’avais pu me sauver, et à travers quelles vicissitudes j’étais parvenu aux hautes fonctions de scribe maritime auprès du roi Mihrajân.
Lorsque le capitaine eut entendu mes paroles, il s’écria : « Il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah le Très-Haut, l’Omnipotent…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah le Très-Haut, l’Omnipotent ! Il n’y a plus de conscience ni d’honnêteté chez aucune créature de ce monde ! Comment oses-tu, ô scribe astucieux, prétendre être Sindbad le Marin, quand nous avons tous vu de nos yeux se noyer Sindbad avec tous les marchands ! Quelle honte sur toi de mentir si impudemment ! »
Alors moi, je répondis : « Certes, ô capitaine, le mensonge est l’apanage des fourbes ! Écoute-moi donc, car je vais te donner les preuves que je suis bien Sindbad le noyé ! » Et je racontai au capitaine divers incidents connus de moi seul et de lui, et qui étaient survenus durant cette maudite traversée-là. Alors le capitaine ne douta plus de mon identité et il appela les marchands passagers, et tous ensemble me félicitèrent pour ma délivrance et me dirent : « Par Allah ! nous ne pouvions croire que tu aies pu te sauver de la noyade ! Mais Allah t’a fait don d’une seconde vie ! »
Après cela, le capitaine se hâta de me livrer mes marchandises que je fis sur l’heure porter au souk, après toutefois m’être assuré que rien n’y manquait et que mon nom et mon cachet se trouvaient encore sur les ballots.
Une fois au souk, j’ouvris mes ballots et je vendis la plus grande partie de mes marchandises, avec des bénéfices de cent pour un, mais je pris soin de réserver quelques objets de prix que je me hâtai d’aller offrir en présent au roi Mihrajân.
Le roi, auquel je relatai l’arrivée du capitaine et du navire, fut extrêmement étonné de cette occurrence inattendue, et, comme il m’aimait beaucoup, il ne voulut pas être avec moi en reste d’amabilité, et me fit à son tour des cadeaux inestimables qui ne contribuèrent pas peu à m’enrichir tout à fait. Car je me hâtai de vendre tout cela et de réaliser ainsi une fortune considérable que je transportai à bord du navire même sur lequel j’avais entrepris mon voyage.
Cela fait, j’allai au palais prendre congé du roi Mihrajân et le remercier pour toutes ses générosités et sa protection. Il me donna congé en me disant des paroles fort touchantes, et ne me laissa partir qu’après m’avoir encore offert des présents somptueux et des objets de prix que je ne pus me décider à vendre, cette fois-là, et que d’ailleurs vous voyez devant vous dans cette salle, ô mes honorables invités ! Je pris également soin d’emporter avec moi, pour toute cargaison, les parfums que vous sentez ici, le bois d’aloès, le camphre, l’encens et le sandal, produits de cette île du loin.
Je me hâtai alors de monter à bord, et le navire mit aussitôt à la voile, avec l’autorisation d’Allah. Aussi fûmes-nous favorisés par la fortune et aidés par le destin durant cette traversée qui dura des jours et des nuits, et enfin nous arrivâmes un matin, en bonne santé, en vue de Bassra, où nous ne nous arrêtâmes que fort peu de temps, pour remonter aussitôt le fleuve et rentrer enfin, l’âme en joie, dans la cité de paix, Baghdad, mon pays.
J’arrivai de la sorte, chargé de richesses et la main prête aux largesses, dans ma rue, et j’entrai dans ma maison, où je revis ma famille et mes amis, tous en bonne santé. Et je me hâtai d’acheter des esclaves en grande quantité, de l’un et l’autre sexe, des mamalik, de belles femmes secrètes, des nègres et des terres et des maisons et des propriétés, plus que je n’en avais jamais eu à la mort de mon père.
J’oubliai, dans cette vie nouvelle, les vicissitudes passées, les peines et les dangers éprouvés, la tristesse de l’exil, les maux et les fatigues du voyage. J’eus des amis nombreux et délicieux, et je vécus, dans une vie pleine d’agrément et de plaisirs et exempte de soucis et de tracas, pendant un très long espace de temps, en jouissant de toute mon âme de ce qui me plaisait et en mangeant des mets admirables et en buvant des boissons précieuses.
Et tel est le premier de mes voyages !
Mais demain, si Allah veut, je vous raconterai, ô mes invités, le second des sept voyages que j’ai entrepris, et qui est bien plus extraordinaire que le premier ! »
Et Sindbad le Marin se tourna vers Sindbad le Portefaix et le pria à dîner avec lui. Puis, après l’avoir traité avec beaucoup d’égards et d’affabilité, lui fit donner mille pièces d’or et, avant de le quitter, l’invita à revenir le lendemain, en lui disant : « Tu seras pour moi une réjouissance par ton urbanité et un délice par tes bonnes manières ! » Et Sindbad le Portefaix répondit : « Sur ma tête et sur mon œil ! J’obéis avec respect ! Et que soit continuelle la joie dans ta maison, ô mon maître ! »
Alors il sortit de là, après avoir encore remercié et avoir pris avec lui le cadeau qu’il venait de recevoir, et il s’en retourna chez lui en s’émerveillant à la limite de l’émerveillement et songea toute la nuit à ce qu’il venait d’entendre et d’éprouver.
Aussi, à peine matin, il se hâta de retourner à la maison de Sindbad le Marin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
… il se hâta de retourner à la maison de Sindbad le Marin, qui le reçut d’un air affable et lui dit : « Qu’ici l’amitié te soit chose facile ! Et que l’aisance soit avec toi ! » Et le portefaix voulut lui baiser la main, et comme Sindbad ne voulait pas y consentir, il lui dit : « Qu’Allah blanchisse tes jours et consolide sur toi ses bienfaits ! » Et, comme les autres invités étaient déjà arrivés, on commença par s’asseoir en rond autour de la nappe tendue où jutaient les agneaux rôtis et se doraient les poulets, au milieu des farces délicieuses et des pâtes aux pistaches, aux noix et aux raisins ! Et l’on mangea, et l’on but, et l’on se divertit et l’on se charma l’esprit et l’ouïe en écoutant chanter les instruments sous les doigts expérimentés des joueurs.
Lorsqu’on eut fini, Sindbad, au milieu des convives silencieux, parla en ces termes :
LA SECONDE HISTOIRE
DES HISTOIRES DE SINDBAD LE MARIN
ET C’EST LE SECOND VOYAGE
Je me trouvais en vérité dans la plus savoureuse
vie quand, un jour d’entre les jours, se présenta à
mon esprit l’idée du voyage vers les contrées des
hommes ; et mon âme ressentit vivement l’envie
d’aller se promener et se réjouir par la vue des terres
et des îles et regarder avec curiosité les choses inconnues,
sans toutefois perdre de vue la vente et
l’achat dans les divers pays.
Je m’arrêtai résolument à ce projet et m’apprêtai aussitôt à l’exécuter. Je me rendis au souk où, moyennant une très forte somme d’argent, j’achetai des marchandises propres au trafic que j’avais en vue ; je les mis en ballots solides et les transportai au bord de l’eau, où je ne tardai pas à découvrir un navire bel et neuf, gréé de voiles de bonne qualité, et plein de matelots et d’un ensemble imposant de machineries de toutes formes. Sa vue m’inspira confiance et j’y transportai aussitôt mes ballots, comme le faisaient divers autres marchands qui m’étaient connus et avec lesquels je n’étais pas fâché de faire le voyage.
Nous partîmes le même jour ; et nous eûmes une excellente navigation. Nous voyageâmes d’île en île et de mer en mer pendant des jours et des nuits, et à chaque escale nous nous rendions auprès des marchands de l’endroit et des notables et des vendeurs et des acheteurs, et nous vendions et nous achetions et nous faisions des trocs à notre avantage. Et nous continuâmes à naviguer de la sorte, et nous touchâmes, guidés par la destinée, à une île fort belle, couverte de grands arbres, abondante en fruits, riche en fleurs, habitée par le chant des oiseaux, arrosée par des eaux pures, mais absolument vierge de toute habitation et de tout être vivant.
Le capitaine voulut bien se prêter à notre désir et s’arrêter là quelques heures, et il jeta l’ancre à proximité de la terre. Nous débarquâmes aussitôt et allâmes respirer le bon air dans les prairies ombragées par des arbres où s’ébattaient les oiseaux. Moi, muni de quelques provisions de bouche, j’allai m’asseoir près d’une source à l’eau limpide, abritée du soleil par les branches touffues, et je pris un plaisir extrême à manger un morceau et à boire à même cette eau délicieuse. Avec cela, une brise discrète jouait des accords en sourdine et invitait au repos parfait. Aussi je m’étendis sur le gazon et me laissai gagner par le sommeil, au milieu de la fraîcheur et des parfums de l’air.
Quand je me réveillai, je ne vis plus aucun des passagers, et le navire était parti sans que personne se fût douté de mon absence. J’eus beau, en effet, regarder à droite, à gauche, devant ou derrière, je ne vis d’autre personne dans toute l’île que moi seul. Au loin, sur la mer, une voile s’éloignait et disparaissait bientôt à ma vue.
Alors moi, je fus plongé dans une stupeur qui n’avait point sa pareille et qui ne pouvait avoir d’augmentation ; et de douleur et de chagrin je sentis ma vésicule biliaire sur le point d’éclater dans mon foie. Car que pouvais-je bien devenir dans cette île déserte, moi qui avais laissé à bord du navire tous mes effets et tous mes biens ? Qu’allait-il encore m’arriver de désastreux dans cette solitude inconnue ? À ces pensées désolantes, je m’écriai : « Tout espoir est perdu pour toi, Sindbad le Marin ! Si la première fois tu as pu te tirer d’affaire grâce à des circonstances suscitées par la destinée heureuse, ne crois point que ce sera toujours la même chose, car, comme dit le proverbe, se casse la gargoulette la seconde fois qu’on la jette ! »
Là-dessus, je me mis à pleurer, à gémir, puis à pousser des cris épouvantables jusqu’à ce que le désespoir se fût bien consolidé dans mon cœur. Alors je me frappai la tête de mes deux mains et je m’écriai encoure : « Qu’avais-tu donc besoin, misérable, de voyager encore, alors qu’à Baghdad tu vivais dans les délices ? N’avais-tu pas des mets excellents, des liquides excellents et des habits excellents ? Que manquait-il à ton bonheur ? Ton premier voyage ne t’a-t-il donc été d’aucun fruit ? » Alors je me jetai la face contre terre en pleurant déjà ma mort et disant : « Nous appartenons à Allah et vers lui nous devons retourner ! » Et ce jour-là je faillis devenir fou.
Mais comme à la fin je voyais bien que tous mes regrets étaient inutiles et mon repentir fort tardif, je me résignai à ma destinée. Je me levai, debout sur mes jambes, et, après avoir erré quelque temps sans but, j’eus bien peur de quelque rencontre désagréable d’une bête sauvage ou d’un ennemi inconnu, et je grimpai au haut d’un arbre d’où je me mis à regarder plus attentivement à droite et à gauche ; mais je ne pus distinguer rien autre chose que le ciel, la terre, la mer, les arbres, les oiseaux, les sables et les rochers. Toutefois, en observant un point de l’horizon avec plus d’attention, je crus apercevoir un fantôme blanc et gigantesque. Alors, attiré par la curiosité, je descendis de l’arbre ; mais, retenu par la peur, je ne me dirigeai que fort lentement et avec beaucoup de circonspection de son côté. Lorsque je ne fus plus qu’à quelque distance de cette blancheur, je découvris que c’était un dôme immense, d’un blanc éblouissant, large de base et d’une grande hauteur. Je m’en approchai encore davantage et j’en fis tout le tour ; mais je n’en découvris point la porte d’entrée, que je cherchais. Alors je voulus monter dessus ; mais il était si lisse et si glissant que je n’eus ni l’adresse ni l’agilité ni la possibilité de m’y hisser. Je me contentai alors de le mesurer : je marquai sur le sable la trace de mon premier pas, et je refis le tour en comptant mes pas. Je trouvai de la sorte que la rondeur exacte en était de cent cinquante pas, plutôt plus que moins.
Comme je réfléchissais tout de même à la façon dont je devais m’y prendre pour trouver quelque porte d’entrée ou de sortie à ce dôme, je m’aperçus que soudain le soleil disparaissait et que le jour se changeait en une nuit noire. Je crus tout d’abord que c’était un gros nuage qui passait sur le soleil, bien que la chose fût impossible en plein été. Je levai donc la tête pour juger de ce nuage qui m’étonnait, et je vis un oiseau énorme aux ailes formidables qui volait devant l’œil du soleil, qu’il cachait ainsi en entier en répandant l’obscurité sur l’île.
Mon étonnement alors fut à ses bornes extrêmes, et je me rappelai ce que, du temps de ma jeunesse, des voyageurs et des marins m’avaient raconté au sujet d’un oiseau de grosseur extraordinaire appelé « rokh » qui se trouvait dans une île fort éloignée, et qui pouvait soulever un éléphant. Je conclus alors que celui que je voyais maintenant devait être le rokh, et que le dôme blanc au pied duquel je me trouvais devait être un œuf d’entre les œufs de ce rokh-là ! Mais j’avais à peine eu cette idée que l’oiseau s’abattait sur l’œuf et se posait dessus comme pour le couver. En effet, il étendit ses ailes immenses sur l’œuf, laissa ses deux pieds se poser à terre de chaque côté, et s’endormit dessus ! (Béni soit Celui qui ne dort de toute l’éternité !)
Alors moi, qui m’étais aplati à plat ventre sur le sol et me trouvais juste au-dessous de l’un des pieds, qui me parut être plus gros qu’un vieux tronc d’arbre, je me relevai vivement, je défis l’étoffe de mon turban…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
… je me relevai vivement, je défis l’étoffe de mon turban, je la mis en double et la roulai de façon à en faire une grosse corde, je m’en entourai la taille solidement, et je finis par en enrouler les deux bouts autour de l’un des doigts de l’oiseau, en faisant un nœud à toute épreuve. Car je m’étais dit en mon âme : « Cet énorme oiseau-là finira bien par s’envoler et, de la sorte, me tirera de cette solitude et me transportera en quelque endroit où voir des êtres humains. En tout cas, le lieu où je serai déposé sera toujours préférable à cette île déserte dont je suis le seul habitant ! »
Tout cela ! Et malgré mes mouvements, l’oiseau ne s’apercevait pas plus de ma présence que si j’avais été quelque mouche sans importance ou quelque fourmi modeste en promenade !
Je restai en cet état toute la nuit, ne pouvant fermer l’œil dans la crainte que l’oiseau ne s’envolât et m’enlevât pendant mon sommeil. Mais il ne bougea pas jusqu’au lever du jour. Alors seulement il se leva de dessus son œuf, lança un cri effroyable et prit son vol en m’emportant. Il s’éleva et s’éleva si haut que je croyais déjà toucher à la voûte du ciel ; puis brusquement il descendit avec une telle rapidité que je ne sentais plus mon propre poids, et arriva avec moi sur le sol. Il se posa sur un endroit escarpé, alors que moi, sans attendre davantage, je me hâtais de délier mon turban, avec une terreur folle d’être de nouveau enlevé avant que j’eusse le temps de me libérer de mon attache. Mais je réussis à me détacher sans encombre et, après m’être secoué et avoir ramené ma robe sur moi, je m’éloignai vivement jusqu’à n’être plus à portée de l’oiseau, que je vis bientôt s’élever de nouveau dans les airs. Il tenait cette fois dans ses serres un gros objet noir, qui n’était autre chose qu’un serpent de longueur inouïe et de forme détestable. Bientôt il disparut, se dirigeant dans son vol vers la mer.
Moi, ému extrêmement de ce qui venait de m’arriver, je jetai mes regards autour de moi, et je restai cloué sur place d’épouvante. Je me trouvais, en effet, transporté dans une vallée large et profonde, environnée de toutes parts de montagnes si hautes que, pour les mesurer du regard, je dus tellement relever la tête que mon turban roula derrière mon dos sur le sol. Elles étaient, en outre, si escarpées qu’il était impossible d’en faire l’ascension, et que jugeai inutile toute tentative dans ce sens-là !
À cette constatation, ma désolation et mon désespoir furent sans bornes, et je m’écriai : « Ah ! comme il aurait mieux valu pour moi ne point bouger de l’île déserte où je me trouvais, et qui était mille fois préférable à cette solitude désolée et sèche, où il n’y a rien à manger ni à boire. Là-bas, du moins, il y avait des fruits plein les arbres et des sources à l’eau délicieuse ; mais ici, rien que des rochers hostiles et nus où mourir de faim et de soif ! Ô ma calamité ! Il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah l’Omnipotent ! Je n’échappe chaque fois à une catastrophe que pour tomber dans une autre pire et plus définitive ! »
Je me levai tout de même de ma place et marchai par cette vallée pour la reconnaître un peu, et je constatai qu’elle était entièrement formée de roches de diamant. Partout, autour de moi, le sol était jonché de gros et de petits diamants détachés de la montagne et qui faisaient en certains endroits des tas de la hauteur d’un homme.
Je commençais déjà à prendre quelque intérêt à les regarder, quand un spectacle plus effroyable que toutes les horreurs déjà éprouvées me figea immobile de terreur. Au milieu des roches de diamant je vis circuler les gardiens, qui étaient des serpents noirs en quantité innombrable, plus gros et plus grands que des palmiers, et qui pouvaient certainement engloutir, chacun d’eux, un gros éléphant. En ce moment, ils commençaient à rentrer dans leurs antres ; car pendant le jour ils se cachaient pour n’être pas enlevés par leur ennemi le rokh, et ne circulaient que la nuit.
Alors moi, avec des précautions infinies, j’essayai de m’éloigner de là, en regardant bien où poser mes pieds et en pensant en mon âme : « Voilà, pour avoir voulu abuser de la clémence du destin, ô Sindbad, homme à l’œil insatiable et toujours vide, ce que tu gagnes au change ! » Et, en proie à toutes les terreurs accumulées, je continuai à circuler sans but à travers la vallée des diamants, en me reposant de temps en temps dans les endroits qui me paraissaient le plus à l’abri, et cela jusqu’à la tombée de la nuit.
Pendant tout ce temps, j’avais complètement oublié le manger et le boire, et je ne pensais qu’à me tirer de ce mauvais pas et à sauver mon âme des serpents. Je finis de la sorte par découvrir, tout proche de l’endroit où je m’étais laissé tomber, une grotte dont l’entrée était fort étroite, mais suffisante pour que je pusse la franchir. Je m’avançai donc et pénétrai dans la grotte en prenant soin d’en boucher l’entrée avec un rocher que je réussis à rouler jusque-là. Rassuré de la sorte, je m’avançai à l’intérieur et me mis à chercher l’endroit le plus commode pour y dormir en attendant le matin ; et je pensai : « Demain, dès le lever du jour, je sortirai pour voir ce que me réserve le destin ! »
J’allais donc m’étendre, quand je m’aperçus que ce que tout d’abord je prenais pour une grosse roche noire était un effroyable serpent enroulé en couvaison sur ses œufs. Alors ma chair ressentit toute l’horreur de ce spectacle et ma peau se recroquevilla comme une feuille desséchée et frissonna dans toute son étendue ; et je tombai sans connaissance sur le sol, et je restai ainsi jusqu’au matin.
Alors, sentant que je n’avais pas encore été dévoré, j’eus la forcée de ramper jusqu’à l’entrée, de repousser le rocher et de me glisser au dehors, où j’arrivai comme ivre et sans pouvoir me soutenir sur mes jambes, tant j’étais épuisé par le manque de sommeil et de nourriture et par cette terreur sans répit.
Je regardai autour de moi et soudain, à quelques pas de mon nez, je vis tomber un gros quartier de viande qui vint s’aplatir avec fracas sur le sol. D’abord ébahi, je sursautai, puis je levai les yeux pour voir celui qui voulait ainsi m’assommer ; mais je ne vis personne. Alors je me souvins d’une histoire entendue jadis de la bouche des marchands voyageurs et des explorateurs de la montagne des diamants, où il était raconté que les chercheurs de diamants, ne pouvant descendre dans cette vallée inaccessible, avaient recours à un moyen curieux pour se procurer ces pierres précieuses. Ils tuaient des moutons, les découpaient en gros quartiers et les lançaient au fond de la vallée où ils allaient tomber sur les pointes des diamants qui s’y incrustaient profondément. Alors les rokhs et les aigles gigantesques venaient fondre sur cette proie et l’enlevaient de cette vallée pour la porter dans leurs nids, au haut des rochers, où servir de pâture à leurs petits. Alors les chercheurs de diamants se précipitaient sur l’oiseau en faisant de grands gestes et de grands cris qui lui faisaient lâcher prise et l’obligeaient à s’envoler. Ils fouillaient alors le quartier de viande et prenaient les diamants qu’ils y trouvaient attachés.
L’idée me vint que je pouvais encore essayer de sauver ma vie et de sortir de cette vallée qui m’avait bien l’air d’être mon tombeau. Je me levai donc et commençai par ramasser unp grande quantité de diamants, en choisissant les plus gros et les plus beaux. J’en mis partout sur moi ; j’en remplis mes poches, j’en fis glisser entre ma robe et ma chemise, j’en emplis mon turban et mon caleçon, et j’en mis jusque dans la doublure de mes vêtements. Après quoi, je déroulai l’étoffe de mon turban, comme la première fois…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Après quoi, je déroulai l’étoffe de mon turban, comme la première fois, je m’en ceignis la taille et j’allai me placer au-dessous du quartier de mouton, que j’attachai solidement sur ma poitrine avec les deux bouts du turban.
J’étais dans cette position depuis déjà quelque temps, quand soudain je me sentis enlevé dans les airs, comme une plume, dans les serres formidables d’un rokh, moi et le quartier de viande de mouton. Et, en un clin d’œil, j’étais hors de la vallée, sur le sommet de la montagne, dans le nid du rokh, qui s’apprêta aussitôt à déchiqueter la viande et ma propre chair, afin d’en nourrir ses petits rokhs. Mais soudain une clameur s’éleva et s’approcha qui fit peur à l’oiseau et l’obligea à prendre son vol en me lâchant là. Alors moi, je défis mes liens et me levai debout sur mes deux pieds, avec des traces de sang sur mes habits et ma figure.
Je vis alors s’approcher de l’endroit où j’étais un marchand qui eut l’air fort désappointé et fort effrayé en m’apercevant. Mais, en voyant que je ne lui voulais point de mal, et que, d’ailleurs, je ne bougeais pas, il se pencha sur le quartier de viande et le fouilla, sans arriver à y trouver les diamants qu’il cherchait. Alors il leva au ciel ses grands bras et se lamenta, disant : « Ô désillusion ! ô ma perte ! Il n’y a de recours qu’en Allah ! Je me réfugie en Allah contre le Maudit, le Malfaisant ! » Et il frappa ses paumes l’une contre l’autre, avec les signes d’un immense désespoir.
À cette vue, je m’approchai et lui souhaitai la paix. Mais lui, sans me rendre mon salam, me dévisagea avec fureur et me cria : « Qui es-tu ? Et de quel droit es-tu venu voler ici mon bien ? » Je répondis : « Sois sans crainte, ô digne marchand, car je ne suis point voleur, et ton bien n’a en rien diminué. Je suis un être humain, et non point un génie malfaisant, comme tu as l’air de le croire. Je suis même un honnête homme d’entre les honnêtes gens, et anciennement j’étais marchand de mon métier, avant que de courir des aventures étranges extrêmement. Quant au motif de ma venue en cet endroit, c’est une histoire étonnante, que je te raconterai tout à l’heure. Mais, auparavant, je veux te prouver mes bonnes intentions, en te gratifiant de quelques diamants, que j’ai moi-même ramassés au fond de ce gouffre qui n’a jamais été sondé par l’œil des humains ! »
Je tirai aussitôt de ma ceinture quelques beaux échantillons de diamant, et je les lui remis en disant : « Voilà un gain que, de ta vie, tu n’aurais osé espérer ! » Alors, le propriétaire du quartier de mouton fut dans une joie inimaginable et me remercia beaucoup, et, après mille effusions, me dit : « Ô mon maître, la bénédiction est en toi ! Mais un seul de ces diamants suffit pour m’enrichir jusqu’à la vieillesse la plus reculée ! Car, de ma vie, je n’en ai vu de semblables à la cour des rois et des sultans ! » Et il me remercia encore et finit par appeler les autres marchands qui étaient par là et qui vinrent s’attrouper autour de moi, en me souhaitant la paix et la bienvenue. Et moi, je leur racontai mon étrange aventure, depuis le commencement jusqu’à la fin. Mais il n’y a point d’utilité à la répéter.
Alors les marchands, revenus de leur étonnement, me félicitèrent beaucoup pour ma délivrance, en me disant : « Par Allah ! ta destinée t’a tiré d’un abîme d’où jamais personne avant toi n’est revenu ! » Puis, comme ils me voyaient exténué de fatigue, de faim et de soif, ils se hâtèrent de me donner largement à manger et à boire, et me conduisirent sous une tente où ils veillèrent sur mon sommeil, qui dura un jour entier et une nuit.
Au matin, les marchands m’emmenèrent avec eux, alors que je commençais à sentir avec intensité ma joie d’avoir échappé à ces dangers sans précédents. Nous arrivâmes, après un voyage assez court, dans une île fort agréable, où croissaient de magnifiques arbres à l’ombrage si touffu et si étendu, que chacun d’eux pouvait abriter aisément cent hommes. C’est justement de ces arbres-là qu’on tire la substance blanche, à l’odeur chaude et agréable, qui est le camphre. Dans ce but, on perce le haut de l’arbre, et on reçoit dans un vase le suc qui s’écoule d’abord sous forme de gouttes de gomme, et qui n’est autre chose que le miel de l’arbre.
C’est également dans cette île que j’ai vu l’effroyable animal nommé « karkadann », qui paît là-bas exactement comme paissent les vaches et les buffles dans nos prairies. Le corps de cette bête est plus gros que le corps du chameau ; son nez porte à son extrémité une corne longue de dix coudées, et sur laquelle est gravée la figure d’un être humain. Cette corne est si solide, qu’elle sert au karkadann à combattre et à vaincre l’éléphant, puis à l’embrocher et à le soulever de terre, jusqu’à ce qu’il soit mort. Alors la graisse de l’éléphant mort coule dans les yeux du karkadann, qui en est aveuglé et tombe sur place. Alors du haut des airs fond sur eux deux le terrible rokh, qui les soulève ensemble et les transporte dans son nid pour en nourrir ses petits.
Je vis aussi, dans cette île, diverses sortes de buffles.
Nous y séjournâmes quelque temps, à respirer le bon air ; ce qui me donna le temps de faire rechange de mes diamants contre de l’or et de l’argent comptant, plus que n’en pouvait tenir la cale d’un navire. Puis, nous partîmes de là ; et, d’île en île, et de pays en pays, et de ville en ville, où j’admirai chaque fois l’œuvre belle du Créateur, en faisant par-ci par-là quelques ventes, achats et échanges, nous finîmes par toucher, en pays béni, à Bassra, pour de là remonter jusqu’à Baghdad, la demeure de paix !
Alors je me hâtai de courir à ma rue et d’entrer dans ma demeure, riche de sommes considérables, de dinars d’or et des plus beaux diamants, que je n’avais pas eu le cœur de vendre. Aussi, après les effusions du retour au milieu de mes parents et de mes amis, je ne manquai pas de me comporter généreusement en répandant les largesses autour de moi, sans oublier personne.
Ensuite, j’usai joyeusement de la vie, en mangeant des mets exquis, en buvant délicatement, en m’habillant de riches habits, et en ne me privant guère de la société des personnes délicieuses. Aussi, j’avais tous les jours de nombreux visiteurs de marque qui, ayant entendu parler de mes aventures, m’honoraient de leur présence pour me demander de leur raconter mes voyages, et de les mettre au courant des affaires des pays lointains. Et moi, j’éprouvais un contentement effectif à les instruire sur tout cela : ce qui faisait que tous s’en allaient en me félicitant d’avoir échappé à de si terribles dangers, et en s’émerveillant de mon récit à la limite de l’émerveillement. Et c’est ainsi que prit fin mon second voyage.
Mais demain, ô mes amis…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Mais demain, ô mes amis, si Allah veut, je vous raconterai les péripéties de mon troisième périple qui certainement est, de beaucoup, plus intéressant et plus stupéfiant que les deux premiers ! »
Puis Sindbad se tut. Alors les esclaves servirent à manger et à boire à tous les invités, qui étaient prodigieusement étonnés de ce qu’ils venaient d’entendre. Ensuite, Sindbad le Marin fit donner cent pièces d’or à Sindbad le Terrien, qui les prit, en remerciant beaucoup, et s’en alla en appelant sur la tête de son hôte les bénédictions d’Allah, et arriva à sa maison en s’émerveillant de ce qu’il venait de voir et d’écouter.
Au matin, le portefaix Sindbad se leva, pria la prière du matin, et revint chez le riche Sindbad, comme cela lui avait été demandé. Et il fut reçu cordialement et traité avec beaucoup d’égards, et invité à prendre part au festin du jour et aux réjouissances, qui durèrent toute la journée. Après quoi, Sindbad le Marin, au milieu des convives attentifs et graves, commença son récit de la manière suivante…
L’HISTOIRE TROISIÈME
DES HISTOIRES DE SINDBAD LE MARIN
ET C’EST LE TROISIÈME VOYAGE
Sachez, ô mes amis, — mais Allah sait les choses
mieux que la créature ! — que dans la délicieuse vie
que je menais depuis mon retour du second voyage,
au milieu des richesses et de l’épanouissement, je
finis par perdre complètement le souvenir des maux
éprouvés et des dangers courus, et par m’ennuyer
de l’oisiveté monotone de mon existence à Baghdad.
Aussi mon âme désira-t-elle avec ardeur le changement
et la vue des choses du voyage. Et moi-même
je fus de nouveau tenté par l’amour du commerce,
du gain et du profit. Or, c’est toujours l’ambition qui
est la cause de nos malheurs. Je devais bientôt en
faire l’expérience de la façon la plus effroyable.
Je mis donc mon projet immédiatement à exécution, et, après m’être muni de riches marchandises du pays, je partis de Baghdad pour Bassra. Là je découvris un grand navire déjà rempli de passagers et de marchands qui étaient tous des gens de bien, honnêtes, au cœur bon, pleins de conscience, et capables de rendre service et de vivre entre eux dans les meilleurs rapports. Aussi je n’hésitai pas à m’embarquer avec eux sur ce navire ; et, aussitôt à bord, nous mîmes à la voile, avec la bénédiction d’Allah sur nous et sur notre traversée.
Notre navigation commença, en effet, sous d’heureux auspices. Dans tous les endroits où nous abordions, nous faisions d’excellentes affaires, tout en nous promenant et en nous instruisant de toutes les nouvelles choses que sans cesse nous voyions. Et vraiment rien ne manquait à notre bonheur, et nous étions à la limite de la dilatation et de l’épanouissement.
Un jour d’entre les jours, nous étions en pleine mer, bien loin des pays musulmans, quand soudain nous vîmes le capitaine du navire se donner de grands coups au visage, après avoir longtemps scruté l’horizon, s’arracher les poils de la barbe, déchirer ses habits et jeter à terre son turban. Puis il se mit à se lamenter, à gémir et à pousser des cris de désespoir.
À cette vue, nous entourâmes tous le capitaine et nous lui dîmes : « Qu’y a-t-il donc, ô capitaine ? » Il répondit : « Sachez, ô passagers de paix, que le vent contraire nous a vaincus et nous a fait dévier de notre route pour nous jeter dans cette mer sinistre. Et, pour mettre la dernière mesure à notre malechance, le destin nous fait aborder à cette île que vous voyez devant vous et dont jamais personne, après y avoir touché, n’a pu se tirer avec la vie sauve. Cette île est l’Île des Singes ! Je sens bien, dans le profond de mon intérieur, que nous sommes tous perdus sans recours ! »
Le capitaine n’avait pas encore fini ces explications que nous vîmes notre navire entouré par une multitude d’êtres velus comme des singes, plus innombrables qu’une armée de sauterelles, tandis que, sur le rivage de l’île, d’autres singes, en quantité inimaginable, poussaient des hurlements qui nous glacèrent sur place. Et nous, nous n’osâmes guère maltraiter, attaquer ou même chasser aucun d’entre eux, de peur qu’ils ne se ruassent tous sur nous et, grâce à leur nombre, ne nous tuassent jusqu’au dernier : car il est bien certain que le nombre vient toujours à bout du courage. Nous ne voulûmes donc faire aucun mouvement, alors que de tous côtés nous étions envahis par ces singes qui commençaient à faire main basse sur tout ce qui nous appartenait. Ils étaient bien laids. Ils étaient même plus laids que tout ce que j’avais vu de laid jusqu’à ce jour de ma vie. Ils étaient poilus et velus, avec des yeux jaunes dans des faces noires ; leur taille était toute petite, à peine longue de quatre empans, et leurs grimaces et leurs cris plus horribles que tout ce que l’on pourrait inventer dans ce sens-là ! Quant à leur langage, ils avaient beau nous parler et nous invectiver en claquant des mâchoires, nous ne parvenions guère à le comprendre, bien que nous y prêtassions la meilleure attention. Aussi nous les vîmes bientôt mettre à exécution le plus funeste des projets. Ils grimpèrent aux mâts, déplièrent les voiles, coupèrent tous les cordages avec leurs dents, et finirent par s’emparer du gouvernail. Alors le navire, poussé par le vent, alla à la côte, où il s’ensabla. Et les petits singes s’emparèrent de nous tous, nous firent débarquer l’un après l’autre, nous laissèrent sur le rivage et, sans plus s’occuper de nous, remontèrent sur le navire qu’ils réussirent à pousser au large, et disparurent tous avec lui sur la mer.
Alors nous, à la limite de la perplexité, nous-jugeâmes inutile de rester ainsi sur le rivage à regarder la mer, et nous nous avançâmes dans l’île où nous finîmes par découvrir quelques arbres fruitiers et de l’eau courante : ce qui nous permit de nous restaurer un peu pour retarder le plus longtemps possible une mort qui nous paraissait à tous certaine.
Pendant que nous étions en cet état, il nous sembla voir, entre les arbres, un édifice très grand qui avait l’air abandonné. Nous fûmes tentés de nous en approcher ; et quand nous y arrivâmes, nous découvrîmes que c’était un palais…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… nous découvrîmes que c’était un palais fort élevé, de forme carrée, entouré de solides murailles, et qui avait une grande porte d’ébène à deux battants. Comme cette porte était ouverte et qu’elle n’était gardée par aucun portier, nous la franchîmes et nous pénétrâmes de plain-pied dans une immense salle aussi vaste qu’une cour. Cette salle avait pour tous meubles d’énormes ustensiles de cuisine et des broches d’une longueur démesurée ; le sol avait, pour tous tapis, des monceaux d’ossements, les uns déjà blanchis, d’autres frais encore. Aussi, là-dedans, régnait une odeur qui offusqua à l’extrême nos narines. Mais comme nous étions exténués de fatigue et de peur, nous nous laissâmes choir tout de notre long et nous nous endormîmes profondément.
Le soleil était déjà couché quand un bruit de tonnerre nous fit sursauter et du coup nous réveilla ; et, devant nous, nous vîmes descendre du plafond un être à figure d’homme noir, de la hauteur d’un palmier, qui était plus horrible à voir que tous les singes réunis. Il avait des yeux rouges comme deux tisons enflammés, les dents de devant longues et saillantes comme les défenses d’un cochon, une bouche énorme aussi vaste que l’orifice d’un puits, des lèvres pendantes sur la poitrine, des oreilles sursautantes comme les oreilles de l’éléphant et qui lui couvraient les épaules, et des ongles crochus comme les griffes du lion.
À cette vue, nous commençâmes d’abord par nous convulser de terreur, puis nous devînmes rigides comme des morts. Mais lui vint s’asseoir sur un banc élevé adossé au mur et de là se mit à nous examiner en silence, un à un, de tous ses yeux. Après quoi, il s’avança sur nous, vint droit à moi, de préférence à tous les autres marchands, étendit la main et me saisit par la peau de la nuque, comme on saisit un paquet de chiffons. Il me tourna alors et me retourna dans tous les sens, en me palpant comme fait un boucher pour une tête de mouton. Mais il dut certainement ne point me trouver à sa convenance, liquéfié que j’étais par la terreur, et la graisse de ma peau fondue par les fatigues du voyage et le chagrin. Alors il me lâcha en me laissant rouler sur le sol, et se saisit de mon plus proche voisin, et le mania comme il m’avait manié, mais pour le rejeter ensuite et s’emparer du suivant. Il prit de la sorte tous les marchands, l’un après l’autre, et arriva en dernier lieu au capitaine du navire.
Or, le capitaine était un homme gras et plein de chair, et d’ailleurs il était le mieux portant et le plus solide de tous les hommes du navire. Aussi le choix de l’effroyable géant n’hésita pas à se fixer sur lui : il le prit entre ses doigts comme un boucher aurait tenu un agneau, le jeta par terre, lui posa un pied sur le cou et, d’un seul mouvement, lui cassa la nuque. Il se saisit alors d’une des immenses broches en question et la lui enfonça dans la bouche en la faisant sortir par le fondement. Alors il alluma un grand feu de bois dans le fourneau en terre qui se trouvait dans la salle, plaça au milieu de la flamme le capitaine embroché, et se mit à le tourner lentement jusqu’à cuisson parfaite. Il le retira alors du feu et commença par le séparer en morceaux comme on aurait fait d’un poulet, en se servant pour cela de ses ongles. Cela fait, il avala le tout en un clin d’œil. Après quoi il suça les os, les vida de leur moelle, et les jeta au milieu des tas qui s’amoncelaient dans la salle.
Ce repas achevé, l’effroyable géant alla s’étendre sur le banc, pour digérer, et ne tarda pas à s’endormir en ronflant exactement comme un buffle que l’on aurait égorgé ou comme un âne que l’on aurait excité à braire. Et il resta ainsi endormi jusqu’au matin. Nous le vîmes alors se lever et s’éloigner comme il était venu, en nous laissant figés d’épouvante.
Lorsque nous fûmes certains qu’il avait disparu, nous sortîmes du silence terrifié que nous avions gardé toute la nuit, pour enfin nous faire part les uns aux autres de nos réflexions, et pour sangloter et gémir en pensant au sort qui nous attendait.
Et nous nous disions tristement : « Que ne sommes-nous morts noyés dans la mer ou mangés par les singes, plutôt que d’être rôtis sur la braise. Par Allah ! c’est là une mort fort détestable ! Mais qu’y faire ! Ce que veut Allah doit courir ! Il n’y a de recours qu’en Allah le Tout-Puissant ! »
Nous sortîmes alors de cet édifice et nous rôdâmes toute la journée par l’île, à la recherche de quelque cachette où nous mettre à l’abri, mais vainement ; car cette île était plate, et ne contenait ni cavernes ni quoi que ce fût qui nous permit de nous soustraire aux recherches. Aussi, comme le soir tombait, nous trouvâmes qu’il était encore plus prudent de regagner le palais.
Mais à peine y étions-nous arrivés que l’horrible homme noir fit son apparition par un bruit de tonnerre et par l’enlèvement, après palpation et maniement, de l’un des marchands, mes compagnons, qu’il se hâta d’embrocher, de rôtir et d’avaler dans son ventre, pour ensuite s’étendre sur le banc et ronfler comme une brute égorgée, jusqu’au matin. Il se réveilla alors, et s’étira en grognant férocement, et s’en alla, sans plus s’occuper de nous que s’il ne nous voyait pas.
Lorsqu’il fut parti, et comme nous avions eu le temps de réfléchir sur notre triste situation, nous nous écriâmes tous à la fois : « Allons nous jeter à la mer et mourir noyés, plutôt que de finir rôtis et avalés. Car ce serait une mort bien affreuse ! » Comme nous allions mettre ce projet à exécution, l’un de nous se leva et dit : « Écoutez-moi, compagnons ! Ne pensez-vous pas qu’il vaut peut-être mieux tuer l’homme noir avant qu’il ne nous extermine ? » Alors moi, à mon tour, je levai le doigt et dis : « Écoutez-moi, compagnons ! Au cas où vraiment vous auriez résolu de tuer l’homme noir, il faudrait d’abord commencer par utiliser les pièces de bois dont le rivage est couvert pour nous construire un radeau sur lequel nous puissions fuir cette île maudite après avoir débarrassé la création de ce barbare mangeur de musulmans ! Nous aborderions alors dans quelque île où attendre la clémence du destin qui nous enverrait quelque navire pour retourner à notre pays ! En tout cas, si le radeau fait naufrage et que nous nous noyions, nous aurons évité la rôtisserie et nous n’aurons pas commis une mauvaise action en nous tuant volontairement. Notre mort serait un martyre et compterait au jour de la Rétribution…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Notre mort serait un martyre et compterait au jour de la Rétribution ! » Alors tous les marchands s’écrièrent : « Par Allah ! C’est là une idée excellente et une action raisonnable ! »
Aussitôt nous nous rendîmes sur le rivage et nous construisîmes le radeau en question, sur lequel nous eûmes soin de mettre quelques provisions, telles que fruits et herbes bonnes à manger ; puis nous retournâmes au palais attendre en tremblant l’arrivée de l’homme noir.
Il vint, avec un coup de tonnerre ; et nous crûmes voir entrer quelque énorme chien enragé. Il nous fallut nous résoudre encore à voir, sans murmurer, embrocher et rôtir l’un de nos compagnons qui fut choisi pour sa graisse et son embonpoint, après palpation et maniement. Mais lorsque l’effroyable brute se fut endormie et eut commencé à ronfler en tonnerre, nous songeâmes à profiter de son sommeil pour le rendre inoffensif à jamais.
Nous prîmes pour cela deux des immenses broches en fer, et nous les chauffâmes sur le feu jusqu’au rouge blanc ; puis nous les saisîmes fortement avec nos mains par le bout froid, et, comme elles étaient fort lourdes, nous nous mîmes à plusieurs pour porter chacune d’elles. Nous nous approchâmes alors doucement, et tous ensemble nous enfonçâmes les deux broches à la fois dans les deux yeux de l’horrible homme noir endormi, et nous pesâmes dessus de toutes nos forces, de façon qu’il fût définitivement aveuglé.
Il dut probablement ressentir une douleur extrême, car le cri qu’il lança fut si effroyable que du coup nous roulâmes sur le sol à une distance notoire. Et il bondit à l’aveuglette, et, étendant les mains dans le vide, il essaya, en hurlant et en courant de tous côtés, de se saisir de quelqu’un d’entre nous. Mais nous avions eu le temps de l’éviter et de nous jeter à plat ventre de droite et de gauche de façon à ce qu’il ne rencontrât que le vide chaque fois. Aussi, voyant qu’il ne pouvait réussir, il finit par se diriger à tâtons vers la porte et sortit en faisant des cris épouvantables.
Alors nous, persuadés que le géant aveugle finirait par mourir de son supplice, nous commençâmes à nous tranquilliser et, d’un pas lent, nous nous dirigeâmes vers la mer. Nous arrangeâmes un peu mieux le radeau, nous nous y embarquâmes, nous le détachâmes du rivage et déjà nous allions ramer pour nous éloigner, quand nous vîmes nous courir sus l’horrible géant aveugle, guidé par une femelle géante encore plus horrible et plus dégoûtante que lui. Arrivés sur le rivage, ils lancèrent des cris effroyables en nous voyant nous éloigner ; puis ils se saisirent chacun de quartiers de roche et se mirent à nous lapider en les lançant sur le radeau. Ils réussirent de la sorte à nous atteindre et à noyer tous mes compagnons, à l’exception de deux. Quant à nous trois, nous pûmes enfin nous éloigner hors de portée des roches lancées.
Nous arrivâmes bientôt au milieu de la mer où nous fûmes saisis par le vent et poussés vers une île qui était distante de deux jours de celle où nous avions failli périr embrochés et rôtis. Nous pûmes y trouver des fruits qui nous empêchèrent de succomber ; puis, comme la nuit était déjà avancée, nous grimpâmes sur un grand arbre pour y passer la nuit.
Lorsqu’au matin nous nous réveillâmes, le premier objet qui se présenta devant nos yeux effarés fut un terrible serpent, aussi gros que l’arbre sur lequel nous nous trouvions et qui dardait sur nous des yeux flamboyants en ouvrant une mâchoire large comme un four. Et soudain il se détendit, et sa tête fut sur nous, au sommet de l’arbre. Il saisit dans sa gueule l’un de mes deux compagnons et l’avala jusqu’aux épaules, puis d’un second mouvement de déglutition il l’avala tout entier. Et aussitôt nous entendîmes les os de l’infortuné craquer dans le ventre du serpent qui descendit de l’arbre et nous laissa anéantis d’épouvante et de douleur. Et nous pensâmes : « Par Allah ! chaque nouveau genre de mort est plus détestable que le premier. La joie d’avoir échappé à la broche de l’homme noir se change maintenant en un pressentiment pire encore que tout ce que nous avons éprouvé ! Il n’y a de recours qu’en Allah ! »
Nous eûmes tout de même la force de descendre de l’arbre et de cueillir quelques fruits que nous mangeâmes, et d’étancher notre soif à l’eau des ruisseaux. Après quoi, nous errâmes dans l’île à la recherche de quelque abri plus sûr que celui de la précédente nuit, et nous finîmes par trouver un arbre d’une hauteur prodigieuse qui nous parut pouvoir nous protéger efficacement. Nous y grimpâmes à la tombée de la nuit et, nous y étant installés le mieux que nous pûmes, nous commencions à nous assoupir quand un sifflement et un bruit de branches cassées nous réveilla, et avant que nous eussions le temps de faire un mouvement pour nous échapper, le serpent avait saisi mon compagnon, qui était perché plus bas que moi, et l’avait d’une seule déglutition avalé aux trois quarts. Je le vis ensuite s’enrouler autour de l’arbre et faire craquer dans son ventre les os de mon dernier compagnon qu’il acheva d’avaler. Puis, me laissant mort d’épouvante, il se retira.
Moi, je continuai à rester immobile sur l’arbre jusqu’au matin, et alors seulement je me décidai à en descendre. Mon premier mouvement fut d’aller me jeter à la mer pour en finir avec une vie misérable et pleine d’alarmes plus terribles les unes que les autres ; mais je m’arrêtai en route, car mon âme n’y consentit pas, étant donné que l’âme est une chose précieuse ; et même elle me suggéra une idée à laquelle je dus mon salut.
Je commençai par chercher du bois et, en ayant bientôt trouvé, je m’étendis par terre et je pris une grande planche que je fixai solidement dans toute sa longueur sur la plante de mes pieds ; j’en pris ensuite une seconde que j’attachai sur mon flanc gauche, une autre sur mon flanc droit, une quatrième sur mon ventre, et une cinquième, plus large et plus longue que les précédentes, que je fixai sur ma tête. Je me trouvais de la sorte entouré d’une muraille de planches qui, dans tous les sens, opposait un obstacle à la gueule du serpent. Cela fait, je restai étendu sur le sol, et j’attendis là ce que me réservait le destin.
À la tombée de la nuit, le serpent ne manqua pas de venir. Sitôt qu’il me vit, il fut sur moi et voulut m’avaler dans son ventre ; mais il en fut empêché par les planches. Il se mit alors à ramper et à tourner autour de moi pour essayer de me saisir par un côté plus accessible, mais il ne put y réussir malgré tous ses efforts et bien qu’il me tiraillât dans tous les sens. Il passa ainsi toute la nuit à me faire souffrir, et moi, déjà je me croyais mort et je sentais sur ma figure son haleine puante. Il finit enfin par me laisser là, au lever du jour, et s’éloigna plein de fureur contre moi et à la limite extrême de la rage et de la colère.
Lorsque je me fus assuré qu’il s’était véritablement éloigné…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsque je me fus assuré qu’il s’était véritablement éloigné, j’étendis la main et me débarrassai des liens qui m’attachaient aux planches. Mais j’étais si mal en point que je ne pus d’abord mouvoir mes membres et que, pendant plusieurs heures de temps, je désespérai de pouvoir en recouvrer jamais l’usage. Mais je finis tout de même par me mettre debout et peu à peu je pus marcher et rôder à travers l’île. Je me dirigeai vers la mer où, à peine arrivé, je découvris au loin un navire, toutes voiles dehors, qui filait à grande vitesse.
À cette vue, je me mis à agiter les bras et à crier comme un fou ; puis je dépliai la toile de mon turban et, l’ayant fixée à une branche d’arbre, je la levai au-dessus de ma tête et m’évertuai à faire des signaux pour que l’on me remarquât du navire.
Le destin voulut que mes efforts ne fussent pas inutiles. Bientôt, en effet, je vis le navire virer de bord et se diriger du côté de la terre ; et, peu après, j’étais recueilli par le capitaine et ses hommes.
Une fois à bord du navire, on commença par me donner des vêtements et cacher ma nudité, vu que, depuis le temps, j’avais usé ceux dont j’étais couvert ; puis on m’offrit de manger un morceau, ce que je fis de grand appétit, à cause de mes privations passées ; mais ce qui me ravit l’âme, ce fut surtout certaine eau fraîche juste à point et vraiment délicieuse dont je bus jusqu’à satiété. Aussi mon cœur se calma et mon âme se tranquillisa et je sentis le repos et le bien-être descendre enfin en mon corps exténué.
Je recommençai donc à vivre après avoir vu la mort de mes deux yeux, et je bénis Allah pour sa miséricorde et le remerciai pour avoir interrompu mes tribulations. De la sorte, je ne tardai pas à me remettre complètement de mes émotions et de mes fatigues, si bien que je ne fus pas loin de croire que toutes ces calamités ne m’étaient arrivées qu’en songe.
Notre navigation fut excellente et, avec la permission d’Allah, le vent nous fut tout le temps favorable et nous fit heureusement aborder à une île nommée Salahata, où nous devions faire escale et dans la rade de laquelle le capitaine fit jeter l’ancre pour permettre aux marchands de débarquer et de vaquer à leurs affaires.
Lorsque les passagers furent à terre, comme j’étais le seul à rester à bord, faute de marchandises à vendre ou à échanger, le capitaine s’approcha de moi et me dit : « Écoute ce que j’ai à te dire ! Tu es un homme pauvre et étranger, et tu nous as raconté combien tu as subi d’épreuves dans ta vie. Aussi je veux maintenant t’être de quelque utilité et t’aider à retourner dans ton pays, afin que, quand tu penseras à moi, ce soit avec plaisir et en appelant sur moi les bénédictions ! » Moi, je répondis : « Certainement, ô capitaine ! je ne manquerai pas de faire des vœux pour toi. » Il me dit : « Sache qu’il y a de cela quelques années nous avions avec nous un voyageur qui s’est perdu dans une île où nous avions fait escale. Et depuis lors nous n’avons plus eu de ses nouvelles, et nous ne savons s’il est mort ou s’il est encore en vie. Comme nous avons en dépôt dans le navire les marchandises laissées par ce voyageur, j’ai eu l’idée de te les confier pour que, moyennant un courtage prélevé sur le gain, tu les vendes dans cette île et m’en rapportes le prix afin qu’à mon retour à Baghdad je pusse le remettre à ses parents ou le lui remettre à lui-même s’il a réussi à regagner sa ville. » Et moi je répondis : « Je te dois l’ouïe et l’obéissance, ô mon maître ! Et je te devrai vraiment beaucoup de gratitude pour ce que tu veux me faire honnêtement gagner ! »
Alors le capitaine ordonna aux matelots de tirer les marchandises de la cale et de les porter sur le rivage, à mon intention. Puis il appela l’écrivain du navire et lui dit de les compter et de les inscrire, ballot par ballot. Et l’écrivain répondit : « À qui appartiennent ces ballots, et au nom de qui dois-je les inscrire ? » Le capitaine répondit : « Le propriétaire de ces ballots s’appelait Sindbad le Marin. Maintenant inscris-les au nom de ce pauvre passager, et demande-lui son nom. »
À ces paroles du capitaine, je fus prodigieusement étonné et je m’écriai : « Mais c’est moi, Sindbad le Marin ! » Et, ayant regardé attentivement le capitaine, je le reconnus pour celui qui, au commencement de mon second voyage, m’avait oublié dans l’île où je m’étais endormi.
Aussi mon émotion fut-elle à ses limites extrêmes, à cette découverte inattendue, et je continuai : « Ô capitaine, ne me reconnais-tu donc pas ? C’est bien moi, Sindbad le Marin, natif de Baghdad ! Écoute mon histoire ! Rappelle-toi, ô capitaine, que c’est bien moi qui étais descendu dans l’île, il y a tant d’années, et qui n’étais plus revenu. Je m’étais, en effet, endormi près d’une source délicieuse, après avoir mangé un morceau, et ne m’étais réveillé que pour voir le navire déjà éloigné sur la mer. D’ailleurs, beaucoup de marchands de la montagne des diamants m’ont vu et pourront témoigner que c’est bien moi Sindbad le Marin ! »
Je n’avais pas encore fini de m’expliquer que l’un des marchands qui étaient remontés à bord prendre des marchandises, s’approcha de moi, me considéra attentivement, et, sitôt que j’eus cessé de parler, frappa de surprise ses mains l’une contre l’autre, et s’écria : « Par Allah ! ô vous tous, vous ne m’aviez pas cru quand je vous avais raconté dans le temps l’étrange aventure qui m’était un jour arrivée dans la montagne des diamants, où je vous avais dit avoir vu un homme attaché à un quartier de mouton et transporté de la vallée sur la montagne par un oiseau nommé rokh. Eh bien ! cet homme-là, le voici ! C’est celui-ci même qui est Sindbad le Marin, l’homme généreux qui m’avait fait cadeau de si beaux diamants ! » Et, ayant parlé de la sorte, le marchand vint m’embrasser comme un frère retrouvé.
Alors, le capitaine du navire me considéra un instant et soudain me reconnut lui aussi pour être Sindbad le Marin. Et il me prit dans ses bras comme il aurait fait de son fils, me félicita d’être encore en vie et me dit : « Par Allah, ô mon maître, ton histoire est étonnante et ton aventure prodigieuse ! Mais béni soit Allah qui a permis notre réunion et t’a fait retrouver tes marchandises et ton bien ! » Puis il fit porter à terre mes marchandises pour que je les vendisse, à mon entier profit cette fois. Et, de fait, le gain que je fis fut énorme et me dédommagea au delà de toute espérance de ce que le temps m’avait fait perdre jusque-là.
Après quoi, nous quittâmes l’île Salahata et nous arrivâmes dans les pays de Sind, où nous vendîmes et achetâmes également.
Dans ces mers lointaines, je vis des choses étonnantes et des prodiges innombrables dont je ne puis vous faire le récit en détail. Mais, entre autres choses, je vis un poisson qui avait l’aspect d’une vache, et un autre qui ressemblait à un âne. Je vis aussi un oiseau qui naissait de la nacre marine, et dont les petits vivaient à la surface des eaux, sans jamais voler sur la terre.
Après cela, nous continuâmes notre navigation, avec la permission d’Allah, et nous finîmes par arriver à Bassra, où ne restâmes que peu de jours, pour enfin entrer dans Baghdad.
Alors je me dirigeai vers ma rue, j’entrai dans ma maison, je saluai mes parents, mes amis et mes anciens compagnons, et je fis de grandes largesses aux veuves et aux orphelins. J’étais, en effet, rentré enrichi plus que jamais des dernières affaires que j’avais faites en vendant mes marchandises.
Mais demain, ô mes amis, si Allah veut, je vous raconterai l’histoire de mon quatrième voyage qui dépasse en intérêt les trois que vous venez d’entendre ! »
Puis Sindbad le Marin fit donner, comme les jours précédents, cent pièces d’or à Sindbad le Portefaix en l’invitant à revenir le lendemain.
Le portefaix ne manqua pas d’obéir et, le jour suivant, il revint écouter ce que, le repas terminé, raconta Sindbad le Marin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… il revint écouter ce que, le repas terminé, raconta Sindbad le Marin.
L’HISTOIRE QUATRIÈME
DES HISTOIRES DE SINDBAD LE MARIN
ET C’EST LE QUATRIÈME VOYAGE
Et Sindbad le Marin dit :
« Ni les délices, ni les plaisirs de la vie à Baghdad, ô mes amis, ne surent me faire oublier les voyages. Par contre je ne me souvenais guère des fatigues endurées et des dangers courus. Et l’âme perfide qui m’habitait ne manqua pas de me montrer les avantages qu’il y aurait à parcourir de nouveau les contrées des hommes. Aussi je ne pus guère résister à ses tentations, et, un jour, laissant la maison et richesses, je pris avec moi une grande quantité de marchandises de prix, bien plus que je n’en avais emporté dans mes derniers voyages, et de Baghdad je partis pour Bassra, où je m’embarquai sur un grand navire en compagnie de plusieurs notables marchands fort avantageusement connus sur la place.
Notre voyage sur mer, grâce à la bénédiction, fut d’abord excellent. Nous allâmes d’île en île et d’une terre à une terre, vendant et achetant et réalisant des bénéfices fort appréciables jusqu’à ce qu’un jour, en pleine mer, le capitaine fît jeter l’ancre en nous criant : « Nous sommes perdus sans recours ! » Et soudain un coup de vent terrible souleva toute la mer qui se précipita sur le navire, le fracassa dans tous les sens, et emporta les passagers, y compris le capitaine, les matelots et moi-même. Et d’abord tout le monde se noya, et moi également.
Mais moi, je pus, grâce à la miséricorde, trouver sur l’abîme une planche du navire à laquelle je m’accrochai des mains et des pieds, et sur laquelle je fus ballotté pendant une demi-journée, moi et quelques autres marchands qui purent s’y accrocher avec moi.
Alors, à force de ramer avec nos pieds et nos mains, nous finîmes, aidés par le vent et le courant, par être jetés comme des épaves, morts déjà à moitié de froid et d’épouvante, sur le rivage d’une île.
Nous restâmes toute une nuit anéantis, sans mouvement, sur le rivage de cette île. Mais le lendemain nous pûmes nous lever et nous avancer à l’intérieur, où nous aperçûmes une habitation vers laquelle nous nous dirigeâmes.
À notre arrivée, nous vîmes sortir de la porte de cette habitation une troupe de gens complètement nus et noirs qui, sans nous dire un seul mot, s’emparèrent de nous et nous firent pénétrer dans une grande salle où, sur un haut siège, était assis un roi.
Le roi nous ordonna de nous asseoir, et nous nous assîmes. Alors devant nous on apporta des plateaux remplis de mets que de notre vie entière nous n’avions vus ailleurs. Leur vue n’excita guère mon appétit, contrairement à mes compagnons qui en mangèrent gloutonnement pour apaiser la faim qui les tenait depuis notre naufrage. Quant à moi, mon abstention fut la cause qui devait me conserver la vie jusqu’aujourd’hui.
En effet, dès les premières bouchées, une fringale énorme s’empara de mes compagnons, qui se mirent à avaler pendant des heures et des heures tout ce qu’on leur présentait, avec des gestes de fous et des reniflements extraordinaires.
Pendant qu’ils étaient en cet état, les hommes nus apportèrent un vase rempli d’une sorte de pommade dont ils leur enduisirent tout le corps, et dont l’effet sur leur ventre fut extraordinaire. En effet, je vis le ventre de mes compagnons se dilater peu à peu, dans tous les sens, jusqu’à devenir plus gros qu’une outre gonflée ; et leur appétit augmenta en proportion, si bien qu’ils continuèrent à manger sans arrêt, alors que moi je les regardais, effaré de voir que leur ventre ne se remplissait pas.
Or moi, voyant cet effet sur mes compagnons, je persistai à ne point toucher à ces mets et je refusai de me laisser enduire de pommade. Et vraiment ma sobriété fut salutaire, car je découvris que ces hommes nus étaient des mangeurs de chair humaine, et qu’ils employaient ces divers moyens pour engraisser les hommes qui tombaient entre leurs mains et rendre de la sorte leur chair plus tendre et plus juteuse. Et quant au roi de ces mangeurs, je découvris qu’il était ogre. On lui servait tous les jours en rôti un homme engraissé par cette méthode ; quant aux hommes nus ils n’aimaient pas le rôti et mangeaient la chair humaine crue, sans aucun assaisonnement, telle quelle.
À cette triste découverte, mon anxiété sur mon sort et sur celui de mes compagnons connut d’autant moins de bornes, que je constatai bientôt une diminution notable de l’intelligence de mes compagnons au fur et à mesure que leur ventre grossissait et que leur individu s’épaississait. Ils finirent même par s’abrutir complètement à force de manger et, devenus absolument comme des bêtes d’abattoir, ils furent confiés à la garde d’une berger qui tous les jours les conduisait paître dans la prairie.
Quant à moi, la faim d’un côté et la peur de l’autre avaient fait de moi l’ombre de moi-même, et ma viande s’était desséchée sur mes os. Aussi, quand les natifs de cette île me virent si maigre et si émacié, ils ne s’occupèrent plus de moi et m’oublièrent tout à fait, me jugeant sans doute indigne d’être servi en rôti à leur roi ou même en grillade.
Ce manque de surveillance de la part de ces insulaires noirs et nus me permit un jour de m’éloigner de leur habitation et de marcher dans une direction opposée. Sur ma route, je rencontrai le berger qui faisait paître le bétail composé de mes malheureux compagnons abrutis par leur ventre. Je me hâtai de m’enfoncer dans les hautes herbes et de marcher et de courir pour les perdre de vue, tant leur aspect m’était un objet de tortures et de tristesse.
Le soleil était déjà couché et je ne cessais pas de marcher. Je continuai à me diriger devant moi toute la nuit, sans éprouver le besoin de dormir, tant la peur me tenait de retomber entre les mains des noirs mangeurs de chair humaine. Et je marchai encore tout le jour suivant, et aussi les six autres jours, ne prenant que juste le temps nécessaire à un repas qui me permît de continuer ma route vers l’inconnu. Et, pour toute nourriture, je ramassais des herbes et je les mangeais, juste de quoi ne pas succomber à la faim.
Au matin du huitième jour…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Au matin du huitième jour j’arrivai sur le rivage opposé de l’île, et j’aperçus des hommes comme moi, blancs et habillés de vêtements, qui étaient occupés à cueillir des grains de poivre sur les arbres dont était couverte cette région. Lorsqu’ils m’eurent aperçu, ils vinrent m’entourer et me parlèrent dans ma langue, l’arabe, que depuis si longtemps je n’avais pas entendue. Ils me demandèrent qui j’étais et d’où je venais. Je répondis : « Ô bonnes gens, je suis un homme étranger et pauvre ! » Et je leur racontai ce que j’avais éprouvé de malheurs et de dangers. Mon récit les étonna merveilleusement, et ils me félicitèrent d’avoir su échapper aux avaleurs de chair humaine, m’offrirent à manger et à boire, me laissèrent me reposer une heure de temps, puis m’emmenèrent dans leur barque pour me présenter à leur roi dont la résidence était une autre île du voisinage.
L’île dans laquelle régnait ce roi avait pour capitale une ville fort peuplée, abondante en toutes les choses de la vie, riche en souks et en marchands dont les boutiques étaient pourvues d’objets de prix, percée de belles rues où circulaient de nombreux cavaliers sur des chevaux splendides, mais sans selles ni étriers. Aussi lorsque je fus présenté au roi, je ne manquai pas, après les salams, de lui faire part de l’étonnement où j’étais de voir les hommes monter à cru les chevaux. Et je lui dis : « Pour quel motif, ô notre maître et suzerain, ne se sert-on pas ici de la selle ? C’est un objet si commode pour aller à cheval ! Et puis cela rend le cavalier mieux maître de son cheval ! »
Le roi fut très étonné de mes paroles et me demanda : « Mais en quoi donc consiste une selle ? C’est là une chose que nous n’avons jamais vue de notre vie ! » Je lui dis : « Veux-tu alors me permettre de te confectionner une selle pour que tu puisses en essayer la commodité et en expérimenter l’agrément ? » Il me répondit : « Certainement ! »
Je fis venir alors un habile menuisier et je lui fis exécuter, sous mes yeux, le bois d’une selle exactement d’après mes indications. Et je restai près de lui jusqu’à ce qu’il l’eût terminé. Alors je garnis moi-même ce bois de la selle avec de la bourre de laine et du cuir, et achevai de l’orner tout autour avec de la broderie d’or et des glands de diverses couleurs. Je fis venir ensuite un forgeron auquel j’enseignai l’art de confectionner un mors et des étriers ; et il exécuta parfaitement ces choses, car je ne le quittai pas un instant.
Lorsque le tout fut dans un état parfait, je choisis le plus beau cheval des écuries du roi, et le sellai et bridai et harnachai splendidement, sans oublier de lui mettre les divers accessoires d’ornement, tels que longues traînes, glands de soie et d’or, houppe et collier bleu. Et j’allai aussitôt le présenter au roi qui l’attendait depuis quelques jours avec grande impatience.
Le roi monta dessus immédiatement, et se sentit si bien d’aplomb et fut si satisfait de cette invention qu’il m’en témoigna sa joie par des cadeaux somptueux et de grandes largesses.
Lorsque le grand-vizir eut vu cette selle, et constaté sa supériorité sur le mode ancien, il me pria de lui en faire une semblable. Et moi je voulus bien y consentir. Alors tous les grands du royaume et les hauts dignitaires voulurent également avoir une selle, et m’en firent la commande. Et ils me donnèrent des cadeaux qui en peu de temps firent de moi l’homme le plus riche et le plus considéré de la ville.
J’étais devenu l’ami du roi, et, comme j’allais un jour chez lui selon mon habitude, il se tourna vers moi et me dit : « Tu sais bien, Sindbad, que je t’aime beaucoup ! Tu es devenu, dans mon palais, comme l’un des miens, et je ne puis plus me passer de toi, ni supporter l’idée qu’un jour viendra où tu nous quitteras. Je désire donc te demander une chose sans te voir me la refuser ! » Je répondis : « Ô roi, ordonne ! Ton pouvoir sur moi est consolidé par tes bienfaits et par la gratitude que je te dois pour tout le bien dont je te suis redevable depuis mon arrivée dans ce royaume ! » Il répondit : « Je désire te marier chez nous avec une femme belle, jolie, parfaite, riche d’argent et de qualités, pour qu’elle te décide à toujours rester dans notre ville et dans mon palais. Je te demande donc de ne point rejeter mon offre et mes paroles ! »
Moi, à ce discours, je fus bien confus, je baissai la tête, et je ne pus faire de réponse, tant la timidité me retenait. Aussi le roi me demanda : « Pourquoi ne me réponds-tu pas, ô mon enfant ? » Je répliquai : « Ô roi du temps, l’affaire est ton affaire, et je suis ton esclave ! » Aussitôt il envoya chercher le kâdi et les témoins, et me donna, séance tenante, comme épouse une femme noble, de haute lignée, fort riche, maîtresse de meubles, de propriétés bâties et de terres, et douée d’une grande beauté. En même temps, il me fit présent d’un palais, tout meublé, avec ses domestiques, ses esclaves hommes et femmes, et un train de maison vraiment royal.
Aussi moi, je vécus dans un repos parfait, et j’arrivai à la limite de la dilatation et de l’épanouissement. Et je me réjouissais d’avance de pouvoir un jour m’échapper de cette ville et retourner à Baghdad en emmenant mon épouse ; car je l’aimais beaucoup et elle aussi m’aimait, et l’accord entre nous était parfait. Mais quand une chose a été fixée par le destin, nul pouvoir humain ne peut la faire dévier. Et quel est l’être créé qui peut connaître l’avenir ? Je devais, hélas ! faire encore une fois l’expérience que tous nos projets sont jeux enfantins en face du vouloir de la destinée.
Un jour, l’épouse de mon voisin, de par l’ordre d’Allah, mourut. Comme ce voisin était mon ami, je me rendis auprès de lui et essayai de le consoler en lui disant : « Ne t’afflige donc pas au delà de ce qui est permis, mon voisin ! Allah te dédommagera bientôt en te donnant une épouse encore plus bénie ! Qu’Allah prolonge tes jours ! » Mais mon voisin, stupéfait de mes paroles, releva la tête et me dit : « Comment peux-tu me souhaiter une longue vie alors que tu sais bien que je n’ai qu’une heure encore à vivre ! » Alors moi je fus à mon tour stupéfait, et je lui dis : « Mon voisin, pourquoi parler de la sorte, et avoir de pareils pressentiments ? Tu es, grâce à Allah, bien portant, et rien ne te menace ! Voudrais-tu donc te tuer de ta propre main ? » Il répondit : « Ah ! je vois bien maintenant ton ignorance des usages de notre pays. Sache donc que la coutume veut que tout mari vivant soit enterré vif avec sa femme morte, et que toute femme vivante soit enterrée vive avec son mari mort. Cela est inviolable ! Et tout à l’heure je dois être enterré vif avec ma femme morte ! Ici tout le monde, y compris le roi, doit subir cette loi établie par les ancêtres ! »
À ces paroles, je m’écriai : « Par Allah ! cette coutume est bien détestable ! Et jamais je ne pourrai m’y conformer ! »
Pendant que nous parlions de la sorte, les parents et les amis de mon voisin entrèrent, et se mirent effectivement à le consoler au sujet de sa propre mort et de celle de sa femme. Après quoi, on procéda aux funérailles. On mit le corps de la femme dans un cercueil découvert, après qu’il eût été revêtu des plus beaux habits et paré des joyaux les plus précieux. Puis le convoi fut formé ; le mari marcha en tête, derrière le cercueil ; et tout le monde, moi compris, se dirigea vers le lieu de l’enterrement.
Nous arrivâmes hors de la ville à une montagne sur la mer. À un certain endroit, je vis une sorte de puits immense dont on se hâta d’enlever le couvercle de pierre. On y descendit le cercueil, où se trouvait la femme morte parée de ses bijoux ; puis on se saisit de mon voisin, qui n’opposa aucune résistance ; on le descendit au moyen d’une corde jusqu’au fond du puits, avec un grand pot d’eau et sept pains, comme provisions. Cela fait, on reboucha l’orifice du puits avec les grandes pierres qui en faisaient le couvercle, et l’on s’en retourna par où l’on était venu.
Or, moi, j’avais assisté à tout cela dans un état inimaginable d’effroi, en pensant en mon âme : « Cela est encore pire que tout ce que j’ai vu ! » Et, à peine de retour au palais, je courus trouver le roi et lui dis : « Ô mon maître, j’ai parcouru jusqu’aujourd’hui bien des pays, mais je n’ai vu nulle part une coutume aussi barbare que celle qui consiste à enterrer le mari vivant avec sa femme morte ! Aussi je voudrais bien savoir, ô roi du temps, si l’étranger est également astreint à cette loi à la mort de sa femme ! » Il me répondit : « Mais certainement ! Il sera enterré avec elle ! »
Lorsque j’eus entendu ces paroles, je sentis de chagrin ma vésicule à fiel éclater dans mon foie, et je sortis de là fou de terreur et m’en allai chez moi, craignant déjà que mon épouse ne fût morte en mon absence, et que l’on ne m’astreignît à subir l’affreux supplice dont j’avais été témoin. J’essayai vainement de me consoler en disant : « Sindbad, sois tranquille. Tu mourras certainement le premier ! Et, de la sorte, tu n’auras pas à être enterré vivant ! » Cela ne devait me servir de rien, car, peu de temps après, ma femme tomba malade, s’alita quelques jours et mourut, malgré tous les soins de jour et de nuit dont je ne cessai de l’entourer.
Alors ma douleur fut sans limites ; car, en vérité, je ne trouvais guère que le fait d’être enterré vif fût moins déplorable que celui d’être dévoré par les mangeurs de chair humaine. Je ne doutai d’ailleurs plus de mon sort, quand je vis le roi en personne venir dans ma maison me faire ses condoléances au sujet de mon enterrement. Il voulut même, accompagné de tous les personnages de la cour, me faire l’honneur d’assister à mon enterrement en marchant à côté de moi à la tête du convoi, derrière le cercueil où l’on avait placé mon épouse morte couverte de ses joyaux et ornée de tous ses atours.
Lorsque nous fûmes au pied de la montagne située sur la mer, où s’ouvrait le puits en question, on fit descendre au fond du trou le corps de mon épouse ; après quoi, tous les assistants s’approchèrent de moi et me firent leurs condoléances et leurs adieux. Alors moi, je voulus faire une tentative sur l’esprit du roi et des assistants pour qu’ils me dispensassent de cette épreuve, et je m’écriai en pleurant : « Je suis un étranger, et il n’est pas juste que je sois soumis à votre loi ! J’ai d’ailleurs dans mon pays une épouse qui est en vie et des enfants qui ont besoin de moi ! »
Mais j’eus beau crier et sangloter, ils me saisirent, sans vouloir m’écouter, me fixèrent des cordes sous les bras, attachèrent sur moi un pot d’eau et sept pains, selon l’usage, et me descendirent au fond du puits. Lorsque je fus arrivé tout au bas, ils me crièrent : « Défais tes liens pour que nous retirions les cordes ! » Mais je ne voulus point me délier, et continuai à tirer dessus pour les décider à me remonter. Alors ils lâchèrent eux-mêmes les cordes en les jetant sur moi, rebouchèrent l’orifice du puits avec les grandes pierres, et s’en allèrent en leur chemin, sans plus écouter mes cris pitoyables…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRIÈME NUIT
Elle dit : … sans plus écouter mes cris pitoyables.
Bientôt la puanteur de ce lieu souterrain m’obligea à me boucher le nez. Mais cela ne m’empêcha pas, grâce au peu de lumière qui descendait du haut, d’inspecter cette grotte mortuaire, remplie de cadavres anciens et récents. Elle était fort spacieuse et s’étendait si loin que mon regard n’en pouvait sonder la profondeur. Alors je me jetai par terre, en pleurant, et je m’écriai : « Tu mérites bien ton sort, Sindbad à l’âme insatiable ! Et puis, qu’avais-tu donc besoin de prendre femme dans cette ville ? Ah ! que n’as-tu succombé dans la vallée des diamants ! ou que n’as-tu été dévoré par les mangeurs d’hommes ! Plût à Allah que tu eusses été englouti par la mer dans l’un de tes naufrages, plutôt que de succomber à une mort si effroyable ! » Et là-dessus je me mis à me donner de grands coups sur la tête et sur l’estomac et partout. Toutefois, pressé par la faim et la soif, je ne pus me décider à me laisser mourir d’inanition, et je détachai de la corde les pains et le pot d’eau, et je mangeai et je bus, mais parcimonieusement, en prévision des jours suivants.
Je vécus de la sorte pendant quelques jours, m’habituant peu à peu à l’odeur insupportable de cette grotte, et je m’endormais par terre dans un endroit que j’avais pris soin de déblayer des ossements qui le jonchaient. Mais bientôt je vis arriver le moment où il me resterait plus ni pain ni eau. Et ce moment arriva. Alors, au désespoir absolu, je fis mon acte de foi et j’allais fermer les yeux pour attendre la mort, quand soudain au-dessus de ma tête je vis s’ouvrir l’orifice du puits et descendre un homme mort dans un cercueil, et, après lui, son épouse avec les sept pains et le pot à eau.
Alors, moi, j’attendis que les hommes du haut eussent à nouveau bouché l’orifice et, sans faire le moindre bruit, tout doucement, je saisis un grand os de mort, et d’un bond je fus sur la femme que d’un coup sur la tête j’assommai ; et, pour m’assurer de sa mort, je lui assénai encore un second et un troisième coups de toute ma force. Je m’emparai alors des sept pains et de l’eau, et j’eus de la sorte des provisions pour quelques jours encore.
Au bout de ce temps-là, de nouveau l’orifice s’ouvrit et on descendit cette fois une femme morte et un homme. Je ne manquai pas pour vivre, car l’âme est chère ! d’assommer l’homme et de lui enlever ses pains et son eau. Et je continuai à vivre ainsi pendant un long temps, en tuant chaque fois la personne que l’on enterrait vivante et en lui volant ses provisions.
Un jour d’entre les jours, je dormais à ma place ordinaire, quand je me réveillai en sursaut à un bruit inaccoutumé. C’était comme un souffle humain et un bruit de pas. Je me levai et pris cet os qui me servait à assommer les individus enterrés vivants, pour me diriger du côté d’où semblait venir le bruit. Au bout de quelques pas, je crus entrevoir que quelque chose prenait la fuite en soufflant avec force. Alors moi, toujours armé de mon os, je suivis cette espèce d’ombre fuyante, je la suivis longtemps, et je continuais à courir derrière elle dans l’obscurité, en trébuchant à chaque pas sur les ossements des morts, quand soudain, droit devant moi, dans le fond de la grotte, je crus apercevoir comme une étoile lumineuse qui tantôt brillait et tantôt s’éteignait. Je continuai à m’avancer dans cette direction, et à mesure que j’avançais je voyais la lumière grandir et s’élargir. Mais je n’osais point croire que ce fût là, une ouverture par où m’échapper vers le dehors ; et je me disais : « Ce doit être certainement un second orifice de ce puits, par où des hommes font descendre un cadavre ! » Aussi quelle ne fut point mon émotion quand je vis l’ombre fuyante, qui n’était autre chose qu’un animal, prendre son élan et sauter à travers cet orifice. Alors je compris, que c’était là un trou creusé par les bêtes pour venir manger les corps morts, dans la grotte. Et moi je sautai derrière la bête et me trouvai soudain en plein air, sous le ciel.
À cette constatation, je tombai à genoux et remerciai de tout mon cœur le Très-Haut pour ma délivrance ; et j’apaisai mon âme et la tranquillisai dans son émoi.
J’examinai alors les cieux, et je vis que j’étais au pied d’une montagne, au bord de la mer ; et je remarquai que cette montagne ne devait avoir aucune communication avec la ville, tant elle était escarpée et impraticable. Je tentai, en effet, d’en faire l’ascension, mais en vain. Alors, pour ne pas mourir de faim, je rentrai dans la grotte par le trou en question et j’allai prendre du pain et de l’eau ; et je revins m’en nourrir sous le ciel : ce que je fis de bien meilleur appétit que durant mon séjour au milieu des morts.
Je continuai à aller tous les jours dans la grotte enlever les pains et l’eau, en assommant ceux que l’on enterrait vivants. Puis j’eus l’idée de ramasser tous les joyaux des morts, les diamants, les bracelets, les colliers, les perles, les rubis, les métaux ciselés, les étoffes précieuses et tous les objets en or et en argent. Et chaque fois je transportais mon butin au bord de la mer, dans l’espoir qu’un jour je pourrais me sauver avec ces richesses. Et, pour que le tout fût prêt, j’en fis des ballots bien enveloppés avec les habits et les étoffes de ceux, hommes ou femmes, qui étaient dans la grotte.
J’étais un jour assis à songer à mes aventures et à mon état actuel, au bord de la mer, quand je vis un navire passer assez près de ma montagne. Je me levai en hâte, je déroulai la toile de mon turban et me mis à l’agiter avec de grands gestes et de grands cris, en courant sur le rivage. Par la grâce d’Allah, les gens du navire aperçurent mes signaux, et détachèrent une barque pour me venir prendre et me porter à leur bord. Ils m’emmenèrent avec eux et voulurent bien se charger aussi de mes ballots.
Lorsque nous fûmes arrivés à bord, le capitaine s’approcha de moi et me dit : « Ô toi, qui es-tu et comment as-tu fait pour te trouver sur cette montagne où, depuis le temps que je navigue dans ces parages, je n’ai jamais vu que des animaux sauvages et des oiseaux de proie, mais jamais un être humain ? » Je répondis : « Ô mon maître, je suis un pauvre marchand, étranger à ces contrées. J’étais embarqué sur un grand navire qui a fait naufrage sur cette côte ; et moi, seul parmi tous mes compagnons, j’ai pu, grâce à mon courage et à mon endurance, me sauver de la noyade et sauver avec moi mes ballots de marchandises en les mettant sur une grande planche dont j’ai pu me saisir à temps quand ce navire eut été désemparé ! La destinée et mon sort m’ont jeté sur ce rivage, et Allah a voulu que je ne fusse pas mort de faim et de soif ! » Et voilà ce que je dis au capitaine, en me gardant bien de lui dire la vérité sur mon mariage et mon enterrement, de peur qu’il n’y eût à bord quelqu’un de cette ville où régnait l’effroyable coutume dont j’avais failli être la victime !
En achevant mon discours au capitaine, je tirai de l’un de mes paquets un bel objet de prix et le lui offris en présent, pour qu’il me regardât de bon œil pendant le voyage. Mais, à ma grande surprise, il fit preuve d’un rare désintéressement, ne voulut point accepter mon présent, et me dit d’un ton bienveillant : « Je n’ai point pour habitude de me faire payer une bonne action. Tu n’es point le premier que nous ayons recueilli en mer. Nous avons secouru d’autres naufragés, nous les avons transportés dans leur pays, pour Allah ; et non seulement nous n’avons point voulu nous faire payer, mais, comme ils étaient dénués de tout, nous leur avons donné à manger et à boire, et nous les avons vêtus ; et, toujours pour Allah, nous leur avons donné de quoi subvenir à leurs frais de route ! Car les hommes se doivent à leurs semblables, pour Allah ! »
À ces paroles, je remerciai le capitaine et fis des vœux pour lui en lui souhaitant une longue vie, alors qu’il ordonnait de déplier les voiles et faisait marcher le navire.
Nous naviguâmes excellemment pendant des jours et des jours, d’île en île et de mer en mer, alors que moi je restais étendu délicieusement pendant des heures à songer à mes étranges aventures et à me demander si réellement j’avais éprouvé tous ces maux ou si je n’étais pas en rêve. Et quelquefois même, en pensant à mon séjour dans la grotte souterraine avec mon épouse morte, je me sentais devenir fou d’épouvante.
Mais enfin, par le pouvoir d’Allah le Très-Haut, nous arrivâmes en bonne santé à Bassra, où nous ne nous arrêtâmes que quelques jours, pour ensuite entrer dans Baghdad.
Alors moi, chargé de richesses infinies, je pris le chemin de ma rue et de ma maison, où j’arrivai et où je trouvai mes parents et mes amis ; ils fêtèrent mon retour et se réjouirent à l’extrême en me félicitant pour mon salut. Alors moi, j’enfermai avec soin mes trésors dans les armoires, en n’oubliant pas toutefois de faire de grandes aumônes aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, et de grandes largesses aux amis et connaissances. Et depuis lors je ne cessai de m’adonner à tous les divertissements et à tous les plaisirs, en compagnie des personnes agréables.
Mais tout ce que je vous ai raconté là n’est vraiment rien en comparaison de ce que je me réserve de vous narrer demain, si Allah veut !
Ainsi parla Sindbad ce jour-là ! Et il ne manqua pas de faire donner cent pièces d’or au portefaix, et de l’inviter à dîner avec lui, en compagnie des notables qui étaient présents. Puis tout le monde s’en retourna chez soi, émerveillé de tout cela.
Quant à Sindbad le Portefaix…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Quant à Sindbad le portefaix il arriva chez lui, où il rêva toute la nuit à ce récit étonnant. Et le lendemain, quand il fut de retour à la maison de Sindbad le Marin, il était encore bien ému de l’enterrement de son hôte. Mais comme la nappe était déjà tendue, il prit place avec les autres, et mangea et but et bénit le Bienfaiteur. Après quoi, au milieu du silence général, il écouta ce que racontait Sindbad le Marin.
L’HISTOIRE CINQUIÈME
D’ENTRE LES HISTOIRES DE SINDBAD LE MARIN
ET C’EST LE CINQUIÈME VOYAGE
Sindbad dit :
Sachez, ô mes amis, qu’à mon retour du quatrième voyage je me plongeai dans la joie, les plaisirs et les divertissements, et tellement que j’oubliai bientôt mes souffrances passées, et ne me rappelai que les gains admirables que m’avaient procurés mes aventures extraordinaires. Aussi ne vous étonnez pas si je vous dis que je ne manquai point d’obéir à mon âme, qui m’incitait à de nouveaux voyages vers les pays des hommes.
Je me levai donc et achetai des marchandises que, par expérience, je savais être d’écoulement facile et de gain sûr et fructueux ; je les fis emballer et partis avec elles pour Bassra.
Là, j’allai me promener sur la rade et je vis un grand navire, tout neuf, qui me plut beaucoup et que j’achetai pour moi seul, séance tenante. Je pris à mon service un bon capitaine expérimenté et des matelots, et je fis charger sur mon navire mes marchandises par mes esclaves qui demeurèrent à bord pour me servir. J’acceptai aussi comme passagers quelques marchands à bonne mine, qui me payèrent honnêtement leur prix de passage. De la sorte, devenu cette fois maître d’un navire, je pouvais, grâce à l’expérience acquise aux choses de la mer, aider le capitaine de mes conseils.
Nous partîmes de Bassra le cœur léger et joyeux, en nous souhaitant mutuellement toutes sortes de bénédictions. Aussi notre navigation fut heureuse, favorisée tout le temps par un vent favorable et une mer clémente. Et, après avoir fait diverses escales, pour vendre et acheter, nous abordâmes un jour à une île complètement inhabitée et déserte, et où l’on ne voyait, pour toute habitation, qu’un seul dôme blanc. Mais moi, en examinant de plus près ce dôme blanc, je devinai que c’était l’œuf d’un rokh. Je n’en dis pourtant rien aux passagers, qui, une fois débarqués, ne trouvèrent rien de mieux à faire que de jeter de grosses pierres contre la surface de l’œuf. Aussi finirent-ils par le casser et, à leur grande stupéfaction, il en coula beaucoup d’eau ; et quelques instants après le petit rokh fit sortir l’un de ses pieds de l’œuf.
À cette vue, les marchands continuèrent à casser l’œuf ; puis ils tuèrent le petit rokh, en coupèrent de bonnes tranches, et revinrent à bord me raconter l’aventure.
Alors moi je fus à la limite de l’effroi et je m’écriai : « Nous sommes perdus ! Le père et la mère du rokh vont venir bientôt nous attaquer et nous faire périr ! Il faut donc nous éloigner au plus vite de cette île ! » Et aussitôt nous déployâmes les voiles et, aidés par le vent, nous prîmes le large.
Pendant ce temps, les marchands s’occupaient à rôtir les quartiers de rokh ; mais ils n’avaient pas même commencé de s’en régaler, que nous vîmes sur l’œil du soleil deux gros nuages qui le masquèrent complètement. Quand ces nuages furent plus près de nous, nous vîmes qu’ils n’étaient autre chose que deux gigantesques rokhs, le père et la mère de celui qui avait été tué. Et nous les entendîmes qui battaient des ailes et lançaient des cris plus terribles que le tonnerre. Et nous les vîmes bientôt juste au-dessus de nos têtes, mais à une grande hauteur, tenant chacun dans ses griffes un énorme rocher plus grand que notre navire.
À cette vue, nous ne doutâmes plus de notre perte, par l’effet de la vengeance des rokhs. Et soudain l’un des rokhs laissa du haut des airs tomber la roche dans la direction du navire. Mais le capitaine était fort expérimenté ; d’un coup de barre, il manœuvra si rapidement que le navire vira de bord, et que le rocher alla tomber, en passant juste à côté de nous, dans la mer qui s’entr’ouvrit d’une façon si béante que nous en vîmes le fond, et que le navire monta et descendit et remonta effroyablement. Mais, au même moment, notre destin voulut que le second rokh lâchât lui aussi son rocher qui, avant que nous eussions pu l’éviter, vint tomber sur l’arrière en brisant le gouvernail en vingt morceaux et en emportant la moitié du navire dans l’eau. Du coup, les marchands et les matelots furent les uns écrasés et les autres submergés. Moi, je fus au nombre des submergés.
Mais moi, je pus revenir un moment au-dessus de l’eau, tant j’avais lutté contre la mort poussé par l’instinct de conserver mon âme précieuse. Et, par bonheur, je pus m’accrocher à une planche de mon navire, qui avait disparu.
Je finis par pouvoir me mettre à califourchon sur cette planche et, en ramant des pieds, je pus, aidé par le vent et le courant, arriver à une île, juste à temps pour ne pas rendre mon dernier souffle, tant j’étais exténué de fatigue, de faim et de soif. Je me jetai d’abord sur le rivage où je restai anéanti une heure de temps, jusqu’à ce que mon âme et mon cœur pussent se reposer et se tranquilliser. Je me levai alors et m’avançai dans l’île pour reconnaître les lieux.
Je n’eus pas besoin de faire un long chemin pour remarquer que, cette fois, la destinée m’avait transporté dans un jardin si beau qu’il pouvait être comparé aux jardins du paradis. Partout, devant mes yeux charmés, des arbres aux fruits dorés, des ruisseaux coureurs, des oiseaux aux mille ramages et des fleurs ravissantes. Aussi je ne manquai point de manger de ces fruits, de boire à cette eau et de respirer ces fleurs ; et je trouvai le tout excellent au possible…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… et je trouvai le tout excellent au possible. Aussi je ne bougeai plus de l’endroit où je me trouvais, et continuai à m’y reposer de mes fatigues jusqu’au soir.
Mais lorsque vint la nuit et que je me vis seul dans cette île, au milieu de ces arbres, je ne pus m’empêcher, malgré la beauté et la paix qui m’entouraient, d’avoir une peur atroce ; aussi je ne pus guère dormir que d’un œil, et mon sommeil fut obsédé de cauchemars terribles, au milieu de ce silence et de cette solitude.
Avec le matin, je me levai, plus tranquille, et poussai un peu plus loin mon exploration. J’arrivai de la sorte près d’un réservoir où venait tomber l’eau d’une source, et sur le bord de ce réservoir était assis, immobile, un vénérable vieillard drapé d’un grand manteau fait avec les feuilles des arbres. Et moi je pensai en mon âme : « Ce vieillard doit être aussi quelque naufragé qui, avant moi, aura trouvé refuge dans cette île ! »
Je m’approchai donc et lui souhaitai la paix. Il me rendit mon souhait, mais seulement par signes, sans prononcer une parole. Et je lui demandai : « Ô vénérable cheikh, comment se fait-il que tu sois en cet endroit ? » Il ne me répondit pas davantage, mais il hocha la tête d’un air triste et me fit avec la main des signes qui signifiaient : « Je te prie de me prendre sur tes épaules et de me faire traverser le ruisseau : je voudrais cueillir des fruits de l’autre côté ! »
Alors moi je pensai : « Sindbad, certes tu feras une bonne action en rendant ce service à ce vieillard ! » Je me baissai donc et le chargeai sur mes épaules, en ramenant ses jambes sur ma poitrine ; et il m’entoura ainsi le cou de ses cuisses et la tête de ses bras. Et je le transportai de l’autre côté du ruisseau, jusqu’à l’endroit qu’il m’avait désigné ; puis je me baissai de nouveau et lui dis : « Descends tout doucement, ô vénérable cheikh ! » Mais il ne bougea pas ! Au contraire il serra davantage ses cuisses autour de mon cou, et se cramponna de toutes ses forces à mes épaules.
À cette constatation, je fus à la limite de l’étonnement et regardai plus attentivement ses jambes. Elles me parurent noires et velues et rudes comme la peau d’un buffle, et me firent bien peur. Aussi, pris soudain d’un effroi sans limites, je voulus me désenlacer de son étreinte et le jeter à terre ; mais alors il me serra si fortement à la gorge qu’il m’étrangla à moitié, et que le monde noircit devant mon visage. Je fis encore un dernier effort, mais ce fut pour perdre connaissance, à bout de respiration, et tomber évanoui sur le sol.
Au bout d’un certain temps, je revins à moi, et, malgré mon évanouissement, je trouvai le vieillard toujours cramponné à mes épaules ; il avait seulement légèrement écarté ses jambes pour permettre à l’air de pénétrer dans ma gorge.
Lorsqu’il me vit respirer, il me donna deux coups de pied dans l’estomac, pour m’obliger à me relever. La douleur me fit obéir, et je me remis debout sur mes jambes, tandis qu’il se cramponnait plus que jamais à mon cou. De la main il me fit signe de marcher sous les arbres ; et là il se mit à cueillir les fruits et à les manger. Et chaque fois que je m’arrêtais contre son gré ou que je marchais trop vite, il me donnait des coups de pied fort violents qui me forçaient à l’obéissance.
Il resta tout ce jour-là sur mes épaules, me faisant aller comme une bête de somme ; et, la nuit venue, il m’obligea à m’étendre avec lui, pour qu’il pût dormir, toujours attaché à mon cou. Et, le matin, d’un coup de pied dans le ventre il me réveilla pour se faire porter comme la veille.
Il resta ainsi cramponné sur mes épaules le jour et la nuit, sans discontinuer. Il faisait sur moi tous ses besoins liquides ou solides, et me faisait marcher sans pitié, à coups de pied et à coups de poing.
Aussi je vis bien que jamais je n’avais souffert dans mon âme autant d’humiliations et dans mon corps autant de mauvais traitements, qu’au service forcé de ce vieillard plus solide qu’un homme jeune et plus impitoyable qu’un ânier. Et je ne savais plus quel moyen employer pour me débarrasser de lui ; et je déplorais le bon mouvement qui me l’avait fait prendre en pitié, et porter sur mes épaules. Et vraiment, en ce moment, je me souhaitais la mort du plus profond de mon cœur.
J’étais depuis déjà un long temps dans cet état déplorable, quand un jour qu’il me faisait marcher sous des arbres où pendaient de grosses citrouilles, l’idée me vint de me servir de ces fruits desséchés pour m’en faire des récipients. Je ramassai donc une grosse calebasse sèche tombée depuis longtemps de l’arbre, je l’évidai entièrement et la nettoyai, et j’allai cueillir à une vigne de belles grappes de raisin que j’exprimai dedans jusqu’à la remplir. Je la bouchai ensuite soigneusement et la posai au soleil, où je la laissai plusieurs jours jusqu’à ce que le jus fût devenu du vin pur. Alors je pris la calebasse et en bus une quantité suffisante pour me relever les forces et m’aidera supporter les fatigues décharge, mais pas assez pourtant pour aller jusqu’à l’ivresse. Toutefois je me sentis ragaillardi et en grande gaîté, et tellement que, pour la première fois, je me mis à gambader de ci et de là, avec ma charge que je ne sentais plus, et à danser en chantant à travers les arbres. Je me mis même à applaudir en accompagnant ma danse et en riant aux éclats de toute ma gorge.
Lorsque le vieillard me vit dans cet état inaccoutumé et eut constaté que mes forces s’étaient multipliées tellement que je le portais sans fatigue, il m’ordonna par signes de lui passer la calebasse. Moi, je fus bien contrarié de cette demande ; mais j’avais tellement peur de lui que je n’osai pas refuser : je me hâtai donc de lui donner la calebasse, bien à contre-cœur. Il la prit de mes mains, la porta à ses lèvres, goûta d’abord pour essayer, et, comme il trouvait la liqueur agréable, il la but, vidant la calebasse jusqu’à la dernière goutte et la jetant ensuite loin de lui.
Bientôt l’effet du vin commença à se faire sentir sur son cerveau ; et comme il avait bu suffisamment pour s’enivrer, il ne tarda pas à danser d’abord à sa manière et à se trémousser sur mes épaules, pour ensuite s’affaisser, tous muscles relâchés, et à se pencher de droite et de gauche se tenant juste assez pour ne pas tomber.
Alors moi, sentant que je n’étais plus serré comme d’habitude, d’un mouvement rapide je dénouai ses jambes de mon col, et d’un coup d’épaules je l’envoyai sauter à quelques pieds et rouler sur le sol, où il resta sans mouvement. Alors je bondis sur lui, et, ramassant entre les arbres une pierre énorme, je lui en assénai sur la tête divers coups si bien ajustés que je lui écrasai le crâne et mêlai son sang à sa chair. Il mourut ! Puisse Allah n’avoir jamais compassion de son âme…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Puisse Allah n’avoir jamais compassion de son âme !
À la vue de son cadavre, je me sentis l’âme encore bien plus allégée que le corps, et je me mis à courir de joie et arrivai de la sorte sur le rivage, à l’endroit même où m’avait jeté la mer, lors du naufrage de mon navire. La destinée voulut que, juste à ce moment, des matelots se trouvassent là, débarqués d’un navire à l’ancre, pour chercher de l’eau et des fruits. Ils furent, en me voyant, à la limite de l’étonnement, et vinrent m’entourer et m’interroger, après les salams de part et d’autre. Et moi je leur racontai ce qui venait de m’arriver, comment j’avais fait naufrage et comment j’avais été réduit à l’état de perpétuelle bête de somme par le vieillard que j’avais fini par tuer.
Au récit de mon histoire, les matelots furent stupéfaits et s’écrièrent : « Quelle chose prodigieuse que tu aies pu échapper à ce cheikh, connu de tous les navigateurs sous le nom de Vieillard de la mer ! Tu es le premier qu’il n’ait pas étranglé ; car il a toujours étouffé entre ses cuisses tous ceux dont il était parvenu à se rendre maître. Béni soit Allah qui t’en a délivré ! »
Après quoi, ils m’emmenèrent à leur navire où leur capitaine me reçut cordialement et me donna des vêtements pour couvrir ma nudité ; et, après m’avoir fait raconter mon aventure, il me félicita de ma délivrance, et remit à la voile.
Après plusieurs jours et plusieurs nuits de navigation, nous entrâmes dans la rade d’une ville aux maisons bien bâties et donnant sur la mer. Cette ville s’appelait la Ville des Singes, à cause de la quantité prodigieuse de singes qui habitaient les arbres d’alentour.
Je descendis à terre avec l’un des marchands du navire, pour visiter cette ville et essayer de faire quelque affaire. Le marchand, qui était devenu mon ami, me donna un sac en coton et me dit : « Prends ce sac, remplis-le de cailloux, et joins-toi aux habitants de la ville qui sortent des murs. Tu feras exactement comme tu les verras faire. Et de la sorte tu gagneras largement ta vie. »
Alors moi, je fis ce qu’il me conseillait, je remplis mon sac de cailloux et, comme je finissais ce travail, je vis sortir de la ville une troupe de gens également chargés chacun d’un sac semblable au mien. Mon ami le marchand me recommanda chaleureusement à eux, en leur disant : « C’est un homme pauvre et étranger. Emmenez-le pour lui apprendre à gagner ici sa vie ! En lui rendant ce service, vous serez largement récompensés par le Rétributeur ! » Ils répondirent par l’ouïe et l’obéissance et m’emmenèrent avec eux.
Après avoir marché quelque temps, nous arrivâmes dans une large vallée couverte d’arbres si hauts que nul ne pouvait y grimper ; et ces arbres étaient peuplés des singes en question et leurs branches étaient lourdes de gros fruits à l’écorce dure, nommés cocos d’Inde.
Nous nous arrêtâmes au pied de ces arbres, et mes compagnons déposèrent leurs sacs à terre et se mirent à lapider les singes en leur lançant les cailloux. Et moi, je fis comme eux. Alors les singes, furieux, ripostèrent en nous lançant du haut des arbres une quantité énorme de cocos. Et nous, en nous garant de temps à autre, nous ramassions ces fruits et en remplissions nos sacs.
Une fois nos sacs remplis, nous les rechargeâmes sur nos épaules et reprîmes le chemin de la ville, où le marchand me prit le sac et m’en donna la valeur en argent. Et moi je continuai de la sorte à accompagner tous les jours les ramasseurs de cocos, et à vendre en ville les fruits, et cela jusqu’à ce que, peu à peu, à force d’amasser ce que je gagnais, j’eusse acquis une fortune qui elle-même grossit à la suite de divers échanges et achats, et me permit de m’embarquer sur un navire qui partait pour la Mer des Perles.
Comme j’avais pris soin d’emporter avec moi une quantité prodigieuse de cocos, je ne manquai pas, en arrivant dans diverses îles de les échanger contre du poivre et de la cannelle ; et je vendis le poivre et la cannelle ailleurs, et avec l’argent que je gagnai, je me rendis dans la Mer des Perles, où je pris des plongeurs à mes gages.
Ma chance, dans la pêche des perles, fut admirable. Elle me permit de réaliser en peu de temps une fortune immense. Aussi je ne voulus pas différer davantage mon retour et après avoir acheté, pour mon usage personnel, du bois d’aloès de la meilleure qualité aux indigènes de ce pays idolâtre, je m’embarquai sur un navire qui faisait voile pour Bassra, où j’arrivai heureusement après une excellente navigation. De là, je partis sans retard pour Baghdad, et courus à ma rue et à ma maison, où je fus reçu avec des transports de joie par mes parents et mes amis.
Comme je revenais plus riche que je ne l’avais jamais été, je ne manquai pas de répandre l’aisance autour de moi en faisant de grandes largesses à ceux qui étaient dans le besoin. Et moi-même je vécus dans un repos parfait, au sein de la joie et des plaisirs.
Mais, vous autres, ô mes amis, dînez ce soir chez moi, et demain ne manquez pas de revenir écouter le récit de mon sixième voyage ; car celui-là est vraiment étonnant, et vous fera oublier les aventures que vous venez d’entendre, quelque extraordinaires qu’elles aient été !
Puis Sindbad le Marin, ayant terminé cette histoire, fit donner, selon son habitude, cent pièces d’or au portefaix émerveillé qui se retira, après le dîner, avec les autres convives. Et le lendemain, devant la même assistance, après un festin aussi somptueux que la veille, Sindbad le Marin parla en ces termes :
L’HISTOIRE SIXIÈME
D’ENTRE LES HISTOIRES DE SINDBAD LE MARIN
ET C’EST LE SIXIÈME VOYAGE
Sachez, ô vous tous, mes amis, mes compagnons et mes chers hôtes, qu’à mon retour du cinquième voyage j’étais un jour assis devant ma porte à prendre le frais, et je me sentais vraiment à la limite de l’épanouissement, quand je vis passer dans ma rue des marchands qui avaient l’air de revenir de voyage. À cette vue, je me rappelai avec bonheur les jours de mon arrivée, moi aussi, de voyage, ma joie de retrouver mes parents, mes amis et mes anciens compagnons, et ma joie encore plus grande de revoir mon pays natal ; et ce souvenir invita mon âme au voyage et au commerce. Aussi je résolus de voyager ; j’achetai de riches marchandises de prix, propres à supporter la mer, je fis charger mes ballots, et je partis de la ville de Baghdad pour la ville de Bassra. Là je trouvai un grand navire rempli de marchands et de notables qui avaient avec eux des marchandises somptueuses. Je fis embarquer mes ballots avec les leurs à bord de ce navire, et nous quittâmes en paix la ville de Bassra…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… et nous quittâmes en paix la ville de Bassra.
Nous ne cessâmes de naviguer de place en place et de ville en ville, en vendant, en achetant et en nous réjouissant la vue au spectacle des pays des hommes, favorisés tout le temps par une heureuse navigation que nous mettions à profit pour jouir de la vie. Mais voici qu’un jour d’entre les jours, pendant que nous étions en pleine sécurité, nous entendîmes des cris de désespoir. C’était le capitaine lui-même qui les poussait. En même temps nous le vîmes jeter à terre son turban, se frapper la figure, s’arracher la barbe et se laisser choir au beau milieu du navire, en proie à un chagrin inimaginable.
Alors tous les passagers et les marchands l’entourèrent et lui demandèrent : « Ô capitaine, quelle nouvelle y-a-t-il donc ? » Le capitaine leur répondit : « Sachez, bonnes gens ici assemblés, que nous nous sommes égarés avec notre navire, et nous sommes sortis de la mer où nous étions pour entrer dans une mer dont nous ne connaissons guère la route. Si donc Allah ne nous destine pas quelque chose pour nous sauver de cette mer, nous sommes anéantis, tous tant que nous sommes. Il faut donc supplier Allah Très-Haut de nous tirer de cette affaire-là ! »
Le capitaine, après cela, se ramassa et monta sur le mât et voulut ranger les voiles ; mais le vent soudain souffla avec violence et renversa le navire sur l’arrière si brusquement que le gouvernail se cassa, tandis que nous étions tout près d’une haute montagne. Alors le capitaine descendit du mât et s’écria : « Il n’y a de recours et de force qu’en Allah le Très-Haut le Tout-Puissant ! Nul ne peut arrêter le destin ! Par Allah ! nous sommes tombés dans une perdition effroyable, sans aucune chance de salut ou de délivrance ! »
À ces paroles, les passagers se mirent tous à pleurer sur eux-mêmes, et à se faire mutuellement leurs adieux avant de voir s’achever leur existence et tomber leur espoir. Et soudain le navire se pencha sur la montagne en question et se brisa et se dispersa en planches de tous côtés. Et tous ceux qui étaient dedans furent submergés. Et les marchands tombèrent à la mer. Les uns furent noyés et les autres se cramponnèrent à la montagne en question et purent se sauver. Moi je fus du nombre de ceux qui purent s’accrocher à la montagne.
Cette montagne était située dans une île très grande dont les côtes étaient couvertes de débris de navires naufragés, et de toutes sortes d’épaves. À l’endroit où nous primes pied, nous vîmes autour de nous une quantité prodigieuse de ballots rejetés par la mer, des marchandises et de riches objets de toutes sortes. Et moi je me mis à marcher au milieu de ces choses éparses et, au bout de quelques pas, j’arrivai à une petite rivière d’eau douce qui, contrairement à toutes les autres rivières, qui viennent se jeter à la mer, sortait de la montagne et s’éloignait de la mer pour s’enfoncer plus loin dans une grotte située au bas de cette même montagne, et y disparaître.
Mais ce n’est point tout. Je remarquai que les bords de cette rivière étaient semés de pierres de rubis, de gemmes de toutes les couleurs, de pierreries de toutes les formes et de métaux précieux. Et toutes ces pierres précieuses étaient aussi nombreuses que les cailloux dans le lit d’un fleuve. Aussi tout le terrain environnant brillait-il et étincelait-il de ces reflets et de ces feux, tellement que les yeux n’en pouvaient supporter l’éclat.
Je remarquai également que cette île contenait la meilleure qualité du bois d’aloès chinois et d’aloès comari.
Il y avait aussi, dans cette île, une source d’ambre brut liquide, de la couleur du bitume, qui coulait comme de la cire fondue sur le rivage sous l’action du soleil ; et les gros poissons sortaient de la mer et venaient l’avaler ; ils le chauffaient dans leur ventre, et le vomissaient au bout d’un certain temps à la surface de l’eau ; alors il devenait dur et changeait de nature et de couleur ; et les vagues le rapportaient sur le rivage qui en était embaumé. Quant à l’ambre que les poissons n’avalaient pas, il fondait sous l’action des rayons du soleil et répandait par toute l’île une odeur semblable au parfum du musc.
Je dois également vous dire que toutes ces richesses ne pouvaient servir à personne, puisque nul n’avait pu aborder à cette île et en sortir vivant ou mort. En effet, tout navire qui s’en approchait était brisé contre la montagne ; et nul ne pouvait faire l’ascension de cette montagne, tant elle était impraticable.
Aussi les passagers qui avaient pu se sauver du naufrage de notre navire, et moi-même, nous fûmes bien perplexes, et nous demeurâmes sur le rivage hébétés de tout ce que nous avions sous les yeux en richesses, et du sort misérable qui nous attendait au milieu de ces somptuosités.
Nous demeurâmes donc pendant un certain temps sur le rivage, sans savoir quel parti prendre ; puis, comme nous avions trouvé quelques provisions, nous les partageâmes entre nous en toute équité. Or, mes compagnons, qui n’étaient point habitués aux aventures, mangèrent leur part en une seule fois ou en deux fois ; aussi ils ne tardèrent pas, au bout d’un certain temps, variable suivant l’endurance de chacun, à succomber l’un après l’autre, faute de nourriture. Mais moi je sus ménager avec prudence mes provisions, et je n’en mangeai qu’une fois par jour ; d’ailleurs j’avais trouvé, à moi seul, d’autres provisions dont je me gardai bien de parler à mes compagnons.
Ceux d’entre nous qui moururent les premiers furent enterrés par les autres, après qu’on les eut lavés et mis dans un linceul confectionné avec les étoffes ramassées sur le rivage. Aux privations vint d’ailleurs s’ajouter une épidémie de mal de ventre, occasionnée par le climat humide de la mer. Aussi mes compagnons ne tardèrent pas à mourir jusqu’au dernier ; et c’est moi-même qui creusai de ma main la fosse du dernier de mes compagnons.
À ce moment, il ne me restait plus que très peu de provisions, malgré mon économie et ma prudence ; et, comme je voyais approcher le moment de ma mort, je me mis à pleurer sur moi-même en pensant : « Pourquoi n’ai-je pas succombé avant mes compagnons qui m’eussent rendu les derniers devoirs en me lavant et m’ensevelissant ! Il n’y a de recours et de force qu’en Allah le Tout-Puissant ! » Et là-dessus je me mis à me mordre les mains de désespoir…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… je me mis à me mordre les mains de désespoir.
Je me décidai alors à me lever, et me mis à creuser une fosse profonde, en me disant : « Lorsque je sentirai arriver mon dernier moment, je me traînerai jusque-là et me mettrai dans cette fosse où je mourrai. Le vent se chargera d’accumuler peu à peu le sable sur ma tête et de combler la fosse ! » Et moi, tout en faisant ce travail, je me reprochais mon manque d’intelligence et mon départ de mon pays, malgré tout ce que j’avais enduré dans mes précédents voyages et ce que j’avais éprouvé premièrement, secondement, troisièmement, quatrièmement et cinquièmement, et chaque épreuve pire que la précédente. Et je me disais : « Que de fois tu t’es repenti pour recommencer ! Qu’avais-tu besoin de voyager encore ? N’avais-tu pas à Baghdad des richesses suffisantes et de quoi dépenser sans compter et sans crainte de jamais épuiser ton fonds qui suffirait à deux existences comme la tienne ? »
À ces pensées, succéda bientôt une autre réflexion suscitée par la vue de la rivière. Je me dis en effet : « Par Allah ! cette rivière doit certainement avoir un commencement et une fin. J’en vois bien d’ici le commencement, mais la fin en est invisible ! Pourtant cette rivière qui s’enfonce ainsi sous la montagne doit, à n’en pas douter, sortir de l’autre côté par quelque endroit. Aussi je pense que la seule idée vraiment pratique pour m’échapper d’ici, c’est de me construire une embarcation quelconque, de me mettre dedans, et de me laisser aller au courant de l’eau qui me fera entrer dans la grotte. Si c’est ma destinée, je trouverai bien par là le moyen de me sauver ; sinon je mourrai là-dedans, et ce sera moins affreux que de mourir de faim sur cette plage ! »
Je me levai donc, un peu ragaillardi par cette idée, et me mis aussitôt à exécuter mon projet. Je rassemblai de grands fagots de bois d’aloès comari et chinois, et les liai entre eux solidement avec des cordes ; je posai dessus de grandes planches de bois ramassées sur le rivage et provenant des navires naufragés, et réunis le tout ainsi sous forme d’un radeau aussi large que la rivière, ou plutôt un petit peu moins large, mais pas de beaucoup. Quand ce travail fut achevé, je chargeai le radeau de quelques gros sacs remplis de rubis, de perles et de toutes sortes de pierreries, en choisissant les plus grosses, celles qui étaient comme des cailloux ; et je pris aussi quelques ballots d’ambre gris, que je choisis tout à fait bon et débarrassé de ses impuretés ; et je ne manquai pas d’emporter aussi ce qui me restait de provisions. Je mis alors le tout bien en équilibre sur le radeau que j’avais pris soin de munir de deux planches en guise de rames, et je finis par m’embarquer dessus en me confiant à la volonté d’Allah et en me rappelant ces vers du poète :
« Ami, déserte les lieux où règne l’oppression, et laisse la demeure résonner de cris de deuil sur ceux qui l’ont bâtie.
« Tu trouveras d’autre terre que ta terre, mais ton âme est une et tu ne la retrouveras pas.
« Et ne t’afflige point devant les accidents des nuits, car les malheurs, même les plus grands, voient arriver leur terme.
« Et sache bien que celui dont le trépas a été d’avance fixé sur une terre, ne pourra mourir sur une autre terre que celle-là !
« Et dans ton malheur n’envoie point de message à quelque conseiller : nul ne te sera meilleur conseiller que ton âme ! »
Le radeau fut donc entraîné par le courant sous la voûte de la grotte, où il commença à se frotter fort rudement contre les parois, et ma tête aussi reçut divers chocs contre la voûte, alors que moi, épouvanté de l’obscurité complète où je me trouvais soudain, je voulais déjà revenir sur la plage. Mais je ne pouvais plus reculer ; le courant très fort m’entraînait de plus en plus à l’intérieur ; et le lit de la rivière tantôt s’élargissait et tantôt se rétrécissait, tandis que les ténèbres de plus en plus autour de moi s’épaississaient, et me fatiguaient par-dessus toutes choses. Alors moi, lâchant les rames qui ne m’avaient d’ailleurs pas servi à grand’chose, je me jetai à plat ventre sur le radeau pour ne pas me briser le crâne contre la voûte, et, je ne sais comment, je fus insensibilisé dans un profond sommeil.
Mon sommeil dura certainement une année ou plus, si j’en dois juger par le chagrin qui l’avait sans doute occasionné. En tout cas, en me réveillant, je me trouvai en pleine lumière. J’ouvris mieux les yeux et me vis étendu sur l’herbe, dans une vaste campagne ; et mon radeau était attaché au bord d’une rivière ; et tout autour de moi il y avait des Indiens et des Abyssins.
Lorsque ces hommes me virent me réveiller, ils se mirent à me parler ; mais je ne compris rien à leur langage et ne pus leur répondre. Je commençais même à croire que tout cela n’était qu’un rêve, quand je vis s’avancer vers moi un homme qui me dit en langue arabe : « La paix sur toi, ô notre frère ! Qui es-tu, d’où viens-tu, et quel motif t’a fait venir en ce pays ? Quant à nous, nous sommes des laboureurs qui venons ici arroser nos plantations et nos champs. Nous avons aperçu le radeau sur lequel tu étais endormi, et nous l’avons arrêté et attaché sur la rive ; puis nous avons attendu que tu te fusses réveillé seul tout doucement, pour ne pas t’effrayer. Raconte-nous donc par quelle aventure tu te trouves en ce lieu ! » Moi je répondis : « Par Allah sur toi, ô mon maître, donne-moi d’abord à manger, car je suis affamé ; et ensuite interroge-moi tant qu’il te plaira ! »
À ces paroles, l’homme se hâta de courir et de m’apporter de la nourriture ; et moi je mangeai jusqu’à ce que je me fusse rassasié et apaisé et ragaillardi. Je sentis alors mon âme revenir, et je remerciai Allah en l’occurrence, et je me félicitai fort d’avoir échappé à cette rivière souterraine. Après quoi, je racontai à ceux qui m’entouraient tout ce qui m’était arrivé, depuis le commencement jusqu’à la fin.
Lorsqu’ils eurent entendu mon récit, ils furent merveilleusement étonnés et se mirent à se parler entre eux, et celui qui parlait arabe m’expliquait ce qu’ils se disaient, comme il leur avait d’ailleurs fait comprendre mes paroles. Ils voulaient, tant ils étaient dans l’admiration, me conduire auprès de leur roi pour qu’il entendît mes aventures. Moi je consentis immédiatement ; et ils m’emmenèrent. Et ils ne manquèrent pas de transporter également le radeau tel quel avec ses ballots d’ambre et ses gros sacs remplis de pierreries.
Le roi, auquel ils racontèrent qui j’étais, me reçut avec beaucoup de cordialité ; et, après les salams réciproques, il me demanda de lui faire moi-même le récit de mes aventures. Aussitôt j’obéis et lui narrai tout ce qui m’était arrivé, sans omettre un détail. Mais il n’y a point utilité à le répéter.
À mon récit, le roi de cette île, qui était l’île de Serendib, fut à la limite de l’étonnement, et me félicita beaucoup d’avoir eu la vie sauve malgré tous les dangers courus. Alors moi je voulus lui montrer que les voyages m’avaient tout de même servi à quelque chose, et je me hâtai d’ouvrir en sa présence mes sacs et mes ballots.
Alors le roi, qui était grand connaisseur en pierreries, admira fort ma collection ; et moi, par égard pour lui, je choisis un échantillon fort beau de chaque espèce de pierres, et aussi plusieurs grosses perles et des morceaux entiers d’or et d’argent, et les lui offris en cadeau. Il voulut bien les accepter, et, en retour, me combla de prévenances et d’honneurs, et me pria de loger dans son propre palais. C’est ce que je fis. Aussi je devins dès ce jour l’ami du roi et des principaux personnages de l’île. Et tous m’interrogeaient sur mon pays, et je leur répondais ; et à mon tour je les interrogeais sur leur pays, et ils me répondaient. J’appris de la sorte que l’île de Serendib avait quatre-vingts parasanges de longueur et quatre-vingts de largeur ; qu’elle avait une montagne, qui était la plus haute de toute la terre, sur le sommet de laquelle notre père Adam avait habité durant un certain temps ; qu’elle contenait beaucoup de perles et pierres précieuses, moins belles, il est vrai, que celles de mes ballots, et beaucoup de cocotiers…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT ONZIÈME NUIT
Elle dit :
… et beaucoup de cocotiers.
Un jour, le roi de Serendib m’interrogea lui-même sur les affaires publiques à Baghdad et sur la façon de gouverner du khalifat Haroun Al-Rachid. Et moi je lui racontai combien le khalifat était équitable et plein de magnanimité, et je m’étendis longuement sur ses mérites et ses belles qualités. Et le roi de Serendib fut émerveillé et me dit : « Par Allah ! je vois que le khalifat connaît véritablement la sagesse et l’art de gouverner son empire. Et toi tu viens de me le faire prendre en grande affection. Aussi je désirerais fort lui préparer quelque cadeau digne de lui et le lui envoyer avec toi ! » Moi je répondis aussitôt : « J’écoute et j’obéis, ô notre maître. Certes ! je remettrai fidèlement ton cadeau au khalifat qui en sera à la limite de l’enchantement. Et en même temps je lui dirai quel excellent ami tu es pour lui, et qu’il peut compter sur ton alliance ! »
À ces paroles, le roi de Serendib donna quelques ordres à ses chambellans qui se hâtèrent d’obéir. Et voici en quoi consistait le cadeau qu’ils me remirent pour le khalifat Haroun Al-Rachid. Il y avait là, premièrement, un grand vase taillé dans un seul rubis, de couleur admirable, et haut d’un demi-pied et épais d’un doigt. Ce vase, qui avait la forme d’une coupe, était entièrement rempli de perles rondes et blanches, de la grosseur d’une noisette, chacune. Deuxièmement, il y avait un tapis formé d’une énorme peau de serpent, avec des écailles grandes comme un dinar d’or, qui avait la vertu de guérir de toutes les maladies ceux qui couchaient dessus. Troisièmement, il y avait deux cents grains du camphre le plus exquis, chaque grain de la grosseur d’une pistache. Quatrièmement, il y avait deux dents d’éléphant, longues chacune de douze coudées, et larges, par la base, de deux coudées. En plus, il y avait, couverte de ses pierreries, une belle jeune fille de Serendib.
En même temps, le roi me remit une lettre pour l’émir des Croyants, en me disant : « Tu m’excuseras auprès du khalifat du peu que je lui envoie en cadeau. Et tu lui diras que je l’aime beaucoup ! » Et moi je répondis : « J’écoute et j’obéis ! » et je lui baisai la main. Alors il me dit : « Toutefois, Sindbad, si tu préfères rester dans mon royaume, tu seras sur notre tête et dans nos yeux ; et, dans ce cas, j’enverrai quelqu’un à ta place auprès du khalifat, à Baghdad ! » Alors moi je m’écriai : « Par Allah ! ô roi du siècle, ta générosité est une grande générosité, et tu m’as comblé de tes bienfaits ; mais il y a justement un navire en partance pour Bassra, et je désirerais fort m’y embarquer pour aller voir mes parents, mes enfants et mon pays ! »
À ces paroles, le roi ne voulut pas me presser davantage de rester, et fit immédiatement mander le capitaine du navire en question, ainsi que les marchands qui partaient avec moi, et leur fit mille recommandations à mon sujet, leur ordonnant de me traiter avec toutes sortes d’égards. Il paya lui-même le prix de mon passage, et me fit cadeau de beaucoup de choses précieuses que je conserve encore, car je n’ai pu me résoudre à les vendre, en souvenir de cet excellent roi de Serendib.
Après les adieux au roi et à tous les amis que je m’étais faits durant mon séjour dans cette île charmante, je m’embarquai sur le navire, qui mit aussitôt à la voile. Nous partîmes avec un bon vent, en nous confiant à la miséricorde d’Allah, et nous naviguâmes d’île en île et de mer en mer, jusqu’à ce que nous fussions arrivés, par la grâce d’Allah, en toute sécurité à Bassra, d’où je me rendis en hâte à Baghdad, avec mes richesses et le présent destiné au khalifat.
Aussi, avant toute chose, je me rendis au palais de l’émir des Croyants, et je fus introduit dans la salle de réception. Alors j’embrassai la terre entre les mains du khalifat, je lui remis la lettre et les présents et lui racontai mon aventure dans tous ses détails. Lorsque le khalifat eut fini de lire la lettre du roi de Serendib et qu’il eut examiné les présents, il me demanda si ce roi était aussi riche et aussi puissant que l’indiquaient sa lettre et ses présents. Moi, je répondis : « Ô émir des Croyants, je puis témoigner que le roi de Serendib n’exagère pas. De plus, à sa puissance et à sa richesse il joint un grand sentiment de justice, et gouverne son peuple avec sagesse. Il est le seul kâdi de son royaume, où d’ailleurs les gens sont si paisibles qu’ils n’ont jamais entre eux de contestations ! En vérité, ce roi est digne de ton amitié, ô émir des Croyants ! »
Le khalifat fut satisfait de mes paroles et me dit : « La lettre que je viens de lire et ton discours me prouvent que le roi de Serendib est un homme excellent qui n’ignore point les préceptes de la sagesse et du savoir-vivre. Heureux le peuple qu’il gouverne ! » Puis le khalifat me fit présent d’une robe d’honneur et de riches cadeaux, et me combla d’égards et de prérogatives, et voulut que mon histoire fût écrite par les scribes les plus habiles pour être conservée dans les archives du règne.
Alors, moi, je me retirai, et courus à ma rue et à ma maison, où je vécus au sein des richesses et des honneurs, au milieu de mes parents et de mes amis, oubliant mes tribulations passées et ne songeant qu’à tirer de l’existence tous les biens qu’elle pouvait me procurer.
Et telle est mon histoire durant ce sixième voyage. Mais demain, ô mes hôtes, si Allah veut, je vous raconterai l’histoire de mon septième voyage, qui est plus merveilleux et plus étonnant et plus plein de prodiges que les six autres réunis.
Et Sindbad le Marin fit tendre la nappe du festin et servir à dîner à ses hôtes, y compris Sindbad le Portefaix, à qui il fit donner, avant son départ, cent pièces d’or comme les autres jours. Et le portefaix se retira chez lui, s’émerveillant de tout ce qu’il venait d’entendre. Puis, le lendemain, il fit sa prière du matin et revint au palais de Sindbad le Marin.
Lorsque tous les invités furent au complet et qu’ils eurent mangé et bu et causé entre eux et ri et entendu les chants et les jeux des instruments, ils se rangèrent en cercle, graves et muets. Et Sindbad le Marin ainsi parla :
L’HISTOIRE SEPTIÈME
DES HISTOIRES DE SINDBAD LE MARIN
ET C’EST LE SEPTIÈME ET DERNIER VOYAGE
Sachez, ô mes amis, qu’à mon retour du sixième voyage, je laissai résolument de côté toute idée d’en faire d’autres désormais ; car non seulement mon âge ne me permettait plus les expéditions lointaines, mais vraiment je n’avais plus guère le désir de tenter de nouvelles aventures après tous les dangers courus et les maux éprouvés. D’ailleurs, j’étais devenu l’homme le plus riche de Baghdad, et le khalifat me faisait souvent appeler auprès de lui pour entendre de ma bouche le récit des choses extraordinaires que j’avais vues durant mes voyages.
Un jour que le khalifat m’avait fait venir, selon son habitude, je me disposais à lui raconter une ou deux ou trois de mes aventures, quand il me dit : « Sindbad, il faut aller auprès du roi de Serendib lui porter ma réponse et les cadeaux que je lui destine. Nul ne connaît comme toi la route qui conduit à ce royaume dont le roi sera certainement fort content de te revoir ! Prépare-toi donc à partir aujourd’hui même ; car il ne serait pas bienséant pour nous d’être redevables au roi de cette île, ni digne de nous de différer davantage notre réponse et notre envoi ! »
À ces paroles du khalifat, le monde noircit devant mon visage, et je fus à la limite de la perplexité et de la surprise. Pourtant je parvins à maîtriser mes sentiments, pour ne point déplaire au khalifat ; et, bien que j’eusse fait vœu de ne jamais plus sortir de Baghdad, j’embrassai la terre entre les mains du khalifat et répondis par l’ouïe et l’obéissance. Alors il me fit donner dix mille dinars d’or pour mes frais de voyage, et me remit une lettre écrite de sa main et les cadeaux destinés au roi de Serendib.
Et voici en quoi consistaient ces cadeaux. Il y avait d’abord un magnifique lit complet de velours cramoisi, qui pouvait bien valoir une somme énorme de dinars d’or ; il y avait un autre lit d’une autre couleur, et encore un d’une autre couleur. Il y avait cent robes en étoffe fine et brodée de Koufa et d’Alexandrie, et cinquante de Baghdad. Il y avait un vase, en cornaline blanche, qui datait des temps anciens, et sur le fond duquel était figuré un guerrier armé de son arc tendu contre un lion. Il y avait encore bien d’autres choses qu’il serait interminable d’énumérer, et, de plus, une paire de chevaux de la plus belle race d’Arabie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazâde vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… une paire de chevaux de la plus belle race d’Arabie.
Alors, moi, je fus bien obligé de partir, contre mon gré cette fois, et je m’embarquai à Bassra sur un navire en partance.
Le destin nous favorisa tellement qu’au bout de deux mois, jour pour jour, nous arrivâmes à Serendib en toute sécurité. Et je me hâtai de porter au roi les présents et la lettre de l’émir des Croyants.
Le roi, en me revoyant, se dilata et s’épanouit ; et il fut très satisfait de la courtoisie du khalifat. Il voulut alors me retenir auprès de lui pour un long séjour ; mais je ne voulus rester que juste le temps de me reposer. Après quoi, je pris congé de lui, et, comblé d’égards et de cadeaux, je me hâtai de me rembarquer pour prendre la route de Bassra, comme j’étais venu.
Le vent nous fut d’abord favorable, et le premier endroit où nous abordâmes fut une île nommée l’île de Sin. Et vraiment jusque-là nous avions été dans un état parfait de contentement ; et, pendant toute la traversée, nous parlions entre nous et nous causions et nous devisions de choses et d’autres, fort agréablement.
Mais un jour, comme nous avions quitté depuis une semaine l’île en question où les marchands avaient fait divers échanges et achats, et comme nous étions étendus bien tranquilles, selon notre habitude, soudain sur nos têtes un orage terrible éclata et une pluie torrentielle nous inonda. Alors nous nous hâtâmes de tendre de la toile de chanvre sur nos ballots et nos marchandises pour éviter que l’eau les détériorât, et nous nous mîmes à supplier Allah d’éloigner tout danger de notre route.
Pendant que nous étions en cet état, le capitaine du navire se leva, se serra la taille avec sa ceinture, retroussa ses manches et releva sa robe, puis grimpa au haut du mât, d’où il se mit à regarder longtemps à droite et à gauche. Puis il descendit, bien jaune de teint, nous regarda avec un air de complet désespoir, se mit à se donner en silence de grands coups sur la figure et à s’arracher la barbe. Alors, nous, fort effrayés, nous courûmes vers lui et nous lui demandâmes : « Qu’y a-t-il ? » Il nous répondit : « Demandez à Allah de nous tirer de l’abîme où nous sommes tombés ! Ou plutôt pleurez sur vous-mêmes et faites vous les uns aux autres vos adieux ! Sachez, en effet, que le courant nous a fait dévier de notre route et nous a jetés aux confins des mers du monde ! »
Puis, ayant parlé de la sorte, le capitaine ouvrit sa caisse et en tira un sac en coton qu’il dénoua et d’où il retira de la poussière qui ressemblait à de la cendre. Il mouilla cette terre avec un peu d’eau, patienta quelques instants, et se mit ensuite à renifler le mélange. Après quoi, il prit dans la caisse un petit livre, y lut quelques pages en marmottant, et finit par nous dire : « Sachez, ô passagers, que ce livre prodigieux vient de me confirmer dans mes suppositions. La terre que vous voyez se dessiner devant vous, dans le loin, est la terre connue sous le nom de Climat des Rois. C’est là que se trouve le tombeau de notre seigneur Soleïman ben-Daoud. (Sur eux deux la prière et la paix !) Là on voit des monstres et des serpents à la mine effroyable. De plus, cette mer où nous sommes est habitée par des monstres marins qui peuvent avaler, en une seule bouchée, les navires les plus grands avec leur cargaison et leurs passagers ! Vous voilà donc avertis ! Et adieu ! »
Lorsque nous entendîmes ces paroles du capitaine, nous fûmes stupéfaits à l’extrême ; et nous nous demandions ce qui allait se passer d’épouvantable, quand nous nous sentîmes soulevés avec le navire, puis brusquement descendus, tandis qu’un cri, aussi terrible que le tonnerre, s’élevait de la mer. Nous fûmes si épouvantés que nous fîmes notre dernière prière et nous nous immobilisâmes, comme morts. Et voici que devant nous, sur l’eau bouillonnante, nous aperçûmes s’avancer vers le navire un monstre aussi grand et aussi haut qu’une montagne, puis un second monstre encore plus grand et un troisième qui les suivait, aussi grand que les deux réunis. Ce dernier bondit soudain sur la mer qui s’écartait en gouffre, ouvrit une gueule plus énorme qu’un abîme, et avala notre navire aux trois quarts, avec tout ce qu’il contenait. Moi, j’eus juste le temps de reculer vers le haut du navire et de sauter dans la mer, pendant que le monstre achevait d’engloutir dans son ventre le quatrième quart et disparaissait dans les profondeurs, avec ses deux autres compagnons.
Quant à moi, je réussis à me cramponner à une des planches qui avaient éclaté du navire sous les dents du monstre marin, et je pus, après mille difficultés, aborder à une île qui heureusement était couverte d’arbres fruitiers et arrosée par une rivière à l’eau excellente. Mais je remarquai que cette rivière était d’une grande rapidité de courant, et tellement qu’elle se faisait entendre par un bruit qui s’étendait au loin. Alors, moi, je conçus l’idée, en me rappelant la façon dont j’avais échappé à la mort dans l’ile aux pierreries, de me construire un radeau, comme le précédent, et de me laisser emporter par le courant. Je voulais, en effet, malgré la clémence de cette île nouvelle, essayer de regagner mon pays. Et je me disais : « Si je parviens à me sauver, tout sera pour le mieux, et je ferai le vœu de ne jamais faire venir sur ma langue le mot voyage, et de ne jamais plus penser à la chose durant le reste de ma vie. Si, au contraire, je péris dans ma tentative, tout sera également pour le mieux ; car j’en aurai de la sorte fini avec les tribulations et les dangers, définitivement ! »
Je me levai donc sur l’heure et, après avoir mangé quelques fruits, je ramassai une grande quantité de grosses branches, dont j’ignorais alors l’espèce, mais que plus tard je sus être du bois de sandal, de la qualité la plus estimée par les marchands à cause de sa rareté. Cela fait, je me mis à la recherche de cordes et de ficelles, et je n’en trouvai point d’abord ; mais je remarquai, sur les arbres, des plantes grimpantes et flexibles, fort solides, qui pouvaient faire mon affaire. J’en coupai autant qu’il m’en fallait, et m’en servis pour lier entre elles les grosses branches de sandal. Je confectionnai de la sorte un radeau énorme, sur lequel je plaçai beaucoup de fruits, et je m’y embarquai moi-même, en formulant : « Si je suis sauvé, c’est d’Allah ! »
À peine étais-je sur le radeau et avais-je eu le temps de le détacher de la rive, qu’il fut entraîné avec une rapidité effroyable par le courant, et que j’eus le vertige et tombai évanoui sur le tas de fruits que j’y avais placés, exactement comme un poulet ivre.
Quand je repris connaissance, je regardai autour de moi, et je fus plus que jamais immobilisé d’épouvante et assourdi par un bruit de tonnerre. La rivière n’était plus qu’un torrent d’écume bouillonnante qui, plus rapide que le vent et avec des fracas contre les rochers, se précipitait vers un précipice béant que je sentais plus que je ne voyais. J’allais indubitablement me fracasser en y tombant qui sait de quelle hauteur !
À cette idée terrifiante, je me cramponnai de toutes mes forces aux branches du radeau, et je fermai les yeux d’instinct pour ne pas me voir en état d’écrasement et réduit en bouillie, et j’invoquai le nom d’Allah, avant de mourir. Et tout d’un coup, au lieu de rouler dans l’abîme, je sentis le radeau s’arrêter brusquement sur l’eau, et j’ouvris les yeux une minute pour juger du point où j’en étais de ma mort, et ce fut pour me voir non point, fracassé contre les rochers, mais saisi, avec mon radeau, dans un immense filet que des gens avaient lancé sur moi du rivage. Je fus pris de la sorte et traîné vers la terre, et là je fus retiré, mort à moitié et vivant à moitié, d’entre les mailles du filet, tandis qu’on ramenait mon radeau sur la rive.
Comme j’étais là étendu, inerte et grelottant, vers moi s’avança un vénérable cheikh à barbe blanche qui commença par me souhaiter la bienvenue et par me couvrir de vêtements chauds qui me firent le plus grand bien…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
… qui me firent le plus grand bien.
Une fois ranimé par les frictions et le massage qu’eut la bonté de me faire le vieillard, je pus me lever sur mon séant, sans toutefois recouvrer encore l’usage de la parole. Alors le vieillard me soutint par le bras et me conduisit doucement au hammam où il me fit donner un bain excellent qui acheva de me restituer mon âme, puis il me fit humer des parfums exquis et m’en répandit sur tout le corps, puis il m’emmena chez lui.
Lorsque je fus introduit dans la maison de ce vieillard, toute sa famille se réjouit fort de mon arrivée et me reçut avec beaucoup de cordialité et de démonstrations d’amitié. Le vieillard lui-même me fit m’asseoir au milieu du divan de la salle de réception et me fit manger des choses de premier ordre et boire d’une eau agréablement parfumée aux fleurs. Après quoi, on brûla autour de moi de l’encens, et les esclaves m’apportèrent de l’eau chaude et parfumée pour m’en laver les mains et me présentèrent des serviettes ourlées de soie pour m’essuyer les doigts, la barbe et les lèvres. Après quoi, le vieillard me conduisit dans une chambre fort bien meublée, où il me laissa seul, et se retira avec beaucoup de discrétion. Mais il laissa à mes ordres divers esclaves qui, de temps à autre, venaient voir si je n’avais pas besoin de leurs services.
Pendant trois jours je fus traité de la sorte, sans que personne m’eût interrogé ou posé une question quelconque ; et on ne me laissait manquer de rien, me soignant avec beaucoup d’obligeance, jusqu’à ce qu’enfin j’eusse senti mes forces complètement revenues et mon âme et mon cœur calmés et rafraîchis. Alors, comme c’était le matin du quatrième jour, le vieillard vint s’asseoir à côté de moi, après les salams, et me dit : « Ô notre hôte, que ta présence nous a remplis d’aise et de plaisir ! Qu’Allah soit béni qui nous a mis sur ta route pour te sauver de l’abîme ! Qui es-tu et d’où viens-tu ? » Alors, moi, je remerciai beaucoup le vieillard pour le service énorme qu’il m’avait rendu en me sauvant la vie et ensuite en me faisant manger excellemment et boire excellemment et en me parfumant excellemment, et je lui dis : « Je m’appelle Sindbad le Marin ! On me nomme ainsi à cause de mes grands voyages sur mer et des choses extraordinaires qui m’arrivèrent et qui, si elles étaient écrites avec les aiguilles sur le coin de l’œil, serviraient de leçon aux lecteurs attentifs ! » Et je racontai au vieillard mon histoire depuis le commencement jusqu’à la fin, sans omettre un détail.
Alors le vieillard fut prodigieusement étonné et resta une heure de temps sans pouvoir parler, tant il était ému par ce qu’il venait d’entendre. Ensuite il releva la tête, me réitéra l’expression de sa joie de m’avoir secouru, et me dit : « Maintenant, ô mon hôte, si tu voulais écouter mon conseil, tu vendrais tes marchandises qui valent certainement beaucoup d’argent, à cause de leur rareté et de leur qualité ! »
À ces paroles du vieillard, je fus à la limite de l’étonnement, et, ne sachant ni ce qu’il voulait dire, ni de quelles marchandises il parlait, puisque j’étais dénué de tout, je me tus d’abord pendant quelques instants ; puis, comme je ne voulais pas tout de même laisser échapper une occasion si extraordinaire qui se présentait fortuitement, je pris un air entendu, et répondis : « Cela se peut bien ! » Alors le vieillard me dit : « N’aie aucune préoccupation, mon enfant, au sujet de ta marchandise. Tu n’as seulement qu’à te lever et à m’accompagner au souk. Et je me charge de tout le reste. Si elle rapporte à la criée un prix qui vraiment puisse nous convenir, nous l’accepterons ; sans quoi, je te rendrai le service de garder la marchandise dans mes magasins jusqu’à la hausse du cours ; et alors nous pourrons en tirer le prix le plus avantageux ! »
Alors, moi, je fus intérieurement de plus en plus perplexe ; mais je n’en fis rien paraître, car je me disais : « Patiente encore, Sindbad, et tu verras bien de quoi il s’agit ! » Et je dis au vieillard : « Ô mon oncle vénérable, j’écoute et j’obéis ! Tout ce que tu jugeras bon de faire sera plein de bénédiction ! Pour ma part, après tout ce que tu as fait pour mon bien, je ne saurais que me conformer à ta volonté ! » Et je me levai sur l’heure et l’accompagnai au souk.
Lorsque nous arrivâmes au milieu du souk où se faisait la criée publique, quel ne fut pas mon étonnement de voir mon radeau transporté là et entouré par une foule de courtiers et de marchands qui le regardaient avec respect et haussements de tête. Et de tous les côtés j’entendais les exclamations d’admiration : « Ya Allah ! quelle merveilleuse qualité de sandal ! Nulle part dans le monde il n’y a une qualité pareille ! » Alors, moi, je compris que c’était là la marchandise en question, et je jugeai important pour la vente de prendre un air digne et réservé.
Mais voici que tout de suite le vieillard, mon protecteur, s’approchant du chef des courtiers, lui dit : « Ouvre la criée ! » Et la criée fut ouverte, comme première mise à prix sur le radeau, à mille dinars ! Et le chef courtier cria : « À mille dinars, le radeau de sandal, ô acheteurs ! » Alors le vieillard s’écria : « Je suis preneur à deux mille ! » Mais un autre cria : « À trois mille ! » Et les marchands continuèrent à hausser la mise à prix jusqu’à dix mille dinars ! Alors le chef courtier regarda de mon côté et me demanda : « C’est dix mille ! on n’augmente plus. » Mais moi je dis : « Je ne vends pas à ce prix-là ! »
Alors mon protecteur s’approcha de moi et me dit : « Mon enfant, le souk, ces temps-ci, n’est pas très prospère, et la marchandise a un peu perdu de sa valeur. Il vaut donc mieux accepter le prix offert. Mais moi, si tu veux, je vais encore hausser à mon compte, et j’augmente de cent dinars ! Veux-tu donc me laisser le tout à dix mille dinars et cent dinars ? » Je répondis : « Par Allah ! mon bon oncle, pour toi seulement je ferai la chose, afin de reconnaître tes bienfaits ! Je consens à te laisser le bois pour la somme ! » À ces paroles, le vieillard ordonna à ses esclaves de transporter tout le sandal dans les magasins de réserve, et m’emmena à sa maison, où il me compta sur l’heure les dix mille dinars et cent dinars, et les renferma dans une caisse solide dont il me remit la clef, en me remerciant encore de ce que j’avais fait pour lui.
Ensuite, il fit tendre la nappe, et nous mangeâmes, et nous bûmes et nous devisâmes gaiement. Après quoi, nous nous lavâmes les mains et la bouche ; puis il me dit : « Mon enfant, je veux te faire une demande que je souhaite beaucoup te voir accepter ! » Je répondis : « Mon bon oncle, tout me sera aisé à t’accorder ! » Il me dit : « Tu vois, mon fils, que je suis devenu un homme très avancé en âge, et que je n’ai point d’enfant mâle qui puisse hériter un jour de mes biens. Mais je dois te dire que j’ai une fille, toute jeune encore, pleine de charme et de joliesse, qui sera fort riche à ma mort. Aussi je souhaite te la donner en mariage, à condition que tu consentes à habiter notre pays et à vivre notre vie. Tu seras ainsi le maître de tout ce que je possède et de tout ce que ma main dirige. Et tu me remplaceras dans mon autorité et dans la possession de mes biens ! »
Lorsque j’eus entendu ces paroles du vieillard, je baissai la tête en silence, et restai de la sorte sans dire une parole. Il reprit alors : « Crois-moi, ô mon fils, accorde-moi ce que je te demande ! Cela te portera la bénédiction ! J’ajouterai, pour tranquilliser ton âme, qu’après ma mort tu pourras retourner dans ton pays en emmenant ton épouse, ma fille. Je ne te demande que de rester ici le temps qui m’est encore échu sur la terre ! » Alors moi je répondis : « Par Allah, mon oncle le cheikh, tu es comme mon père et, devant toi, je ne puis avoir d’opinion ni prendre de résolution autres que celles qui te conviennent ; car, moi, chaque fois que j’ai voulu dans ma vie exécuter un projet, je n’ai eu que des malheurs et des déceptions. Je suis donc prêt à me conformer à ta volonté ! »
Aussitôt le vieillard, extrêmement réjoui de ma réponse, ordonna à ses esclaves d’aller quérir le kâdi et les témoins, qui ne tardèrent pas à arriver…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
… le kâdi et les témoins qui ne tardèrent pas à arriver. Et le vieillard me maria avec sa fille, et nous donna un festin énorme et nous fit une noce splendide. Après quoi il me prit et me conduisit chez sa fille que je n’avais pas encore vue. Je la trouvai à la perfection de la beauté et de la gentillesse, de la finesse de taille et des proportions. De plus, elle était parée de somptuosités et de bijoux, de soieries et de brocarts, de joyaux et de pierreries ; et ce qu’elle portait sur elle valait des milliers et des milliers de pièces d’or, et même personne n’en aurait pu faire exactement l’estimation.
Aussi, lorsque je fus auprès d’elle, elle me plut. Nous devînmes amoureux l’un de l’autre. Et nous restâmes ensemble longtemps, à la limite de la câlinerie et du bonheur.
Quelque temps après, le vieillard, père de mon épouse, trépassa dans la paix et la miséricorde du Très-Haut. Nous lui fîmes de belles funérailles et nous l’enterrâmes. Et moi, je mis la main sur tout ce qu’il possédait, et tous ses esclaves et ses serviteurs devinrent mes esclaves et mes serviteurs, sous ma seule autorité. De plus, les marchands de la ville me nommèrent leur chef, à sa place, et je fus à même alors d’étudier les mœurs des habitants de cette ville et leur manière de vivre.
En effet, je remarquai un jour, à ma stupéfaction, que les gens de cette ville éprouvaient chaque année une mue, à l’époque du printemps : ils muaient du jour au lendemain en changeant de forme et d’aspect ; des ailes leur poussaient aux épaules, et ils devenaient des volatiles. Ils pouvaient alors s’envoler jusqu’au plus haut de la voûte aérienne ; et ils profitaient de leur état nouveau pour s’envoler tous de la ville, n’y laissant que les femmes et les enfants qui, eux, n’avaient pas ce pouvoir d’avoir des ailes.
Cette découverte m’étonna les premiers temps, mais je finis par m’habituer à ces changements périodiques. Seulement, un jour vint où je commençai à avoir honte d’être le seul homme sans ailes, et d’être obligé de garder à moi seul la ville avec les femmes et les enfants. J’eus beau alors m’informer auprès des habitants du moyen à employer pour que des ailes me poussassent aux épaules, nul ne put ni ne voulut me répondre à ce sujet. Et moi, je fus bien mortifié de n’être que Sindbad le Marin, sans pouvoir ajouter à mon surnom la qualité d’aérien.
Un jour, comme je désespérais de pouvoir arriver jamais à leur faire avouer ce secret de la croissance des ailes, j’avisai l’un d’eux, auquel j’avais rendu maints services, et, le prenant par le bras, je lui dis : « Par Allah sur toi, au moins rends-moi une fois, en raison de ce que j’ai fait pour toi, le service de me laisser me suspendre à toi, et de m’en voler avec toi dans ta course à travers les airs. C’est là un voyage qui me tente beaucoup, et que je veux ajouter au nombre de ceux que j’ai faits sur mer ! » L’homme ne voulut pas d’abord m’écouter ; mais à force de prières je finis par le décider à consentir. Je fus tellement enchanté de la chose que je ne pris même pas le temps d’avertir mon épouse et les gens de ma maison ; je me suspendis à lui en le prenant par la taille, et il m’emporta dans les airs en s’envolant, les ailes largement éployées.
Notre course à travers les airs fut d’abord ascendante en droite ligne, pendant un temps considérable. Aussi nous finîmes par arriver si haut dans la voûte céleste, que je fus à même d’entendre distinctement les anges chanter leurs mélodies sous la coupole des cieux.
En entendant ces chants merveilleux, je fus à la limite de l’émotion religieuse, et je m’écriai, moi aussi : « Louange à Allah au profond des cieux ! Béni soit-il et glorifié par toutes les créatures ! »
À peine avais-je prononcé ces paroles, que mon porteur ailé lança un jurement effroyable, et brusquement, dans un coup de tonnerre précédé d’un éclair terrible, descendit avec une rapidité telle que l’air me manqua et que je faillis m’évanouir et lâcher prise au risque de tomber dans l’abîme insondable. Et, en un clin d’œil, nous arrivâmes sur le sommet d’une montagne où mon porteur, me jetant un regard infernal, m’abandonna et disparut en reprenant son vol dans l’invisible.
Alors, moi, resté seul sur cette montagne déserte ; je ne sus plus que devenir ni de quel côté me diriger pour retourner auprès de mon épouse, et je m’écriai, à la limite de la perplexité : « Il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah le Très-Haut l’Omnipotent ! Chaque fois que je finis avec une calamité, je recommence avec une autre encore pire ! Au fond je mérite bien tout ce qui m’arrive là ! »
Je m’assis alors sur un rocher pour réfléchir au moyen de remédier au présent, quand soudain je vis s’avancer vers moi deux jeunes garçons d’une beauté merveilleuse qui ressemblaient à deux lunes. Chacun d’eux tenait à la main une canne en or rouge, sur laquelle il s’appuyait en marchant. Alors, moi, je me levai vivement, j’allai à leur rencontre et leur souhaitai la paix. Ils me rendirent gentiment mon souhait : ce qui m’encouragea à leur adresser la parole, et je leur dis : « Par Allah sur vous deux, ô merveilleux jeunes garçons, dites-moi qui vous êtes et ce que vous faites ! » Ils me répondirent : « Nous sommes des adorateurs du vrai Dieu ! » Puis l’un d’eux, sans ajouter une parole de plus, me fit de la main un signe dans une direction, comme pour m’inviter à diriger mes pas de ce côté-là, me laissa entre les mains sa canne d’or, et, prenant son beau compagnon par la main, il disparut avec lui à mes yeux.
Alors, moi, je pris la canne d’or en question et n’hésitai pas à me diriger dans le sens qui m’avait été indiqué, tout en m’émerveillant au souvenir de ces deux garçons si beaux. Comme je marchais de la sorte depuis un certain temps, je vis soudain sortir de derrière un rocher un serpent gigantesque qui tenait dans sa gueule un homme aux trois quarts avalé et dont je ne voyais que la tête et les bras. Les bras se débattaient désespérément et la tête criait : « Ô passant, sauve-moi de la gueule de ce serpent, et tu n’auras pas à te repentir de ton action ! » Moi, alors, je courus derrière le serpent et lui assénai par derrière avec ma canne d’or rouge un coup si bien ajusté qu’il resta inanimé à l’heure et à l’instant. Et je tendis la main à l’homme avalé et l’aidai à sortir du ventre du serpent.
Lorsque j’eus mieux regardé l’homme au visage, je fus à la limite de la surprise de reconnaître en lui le volatile qui m’avait fait faire mon voyage aérien et avait fini par se précipiter avec moi, au risque de m’abîmer, du haut de la voûte du ciel sur le sommet de la montagne, où il m’avait abandonné en danger de mourir de faim et de soif. Mais je ne voulus tout de même pas lui montrer de la rancune pour sa mauvaise action, et me contentai de lui dire doucement : « Est-ce ainsi que les amis agissent avec leurs amis ? » Il me répondit : « J’ai d’abord à te remercier de ce que tu viens de faire pour moi. Seulement tu ignores que c’est toi, grâce à tes invocations inopportunes en prononçant le Nom, qui m’as, malgré moi, précipité du haut des airs ! Le Nom a sur nous tous cet effet ! Aussi nous ne le prononçons jamais ! » Alors, moi, pour qu’il me tirât de cette montagne, je lui dis : « Excuse-moi et ne me blâme pas, car vraiment je ne pouvais deviner les conséquences funestes de mon hommage au Nom ! Je te promets de ne plus le prononcer, durant le trajet, si tu veux maintenant consentir à me transporter à ma maison ! »
Alors le volatile se baissa, me prit sur son dos et, en un clin d’œil, me déposa sur la terrasse de ma maison, et retourna chez lui.
Lorsque mon épouse me vit, descendant de la terrasse, entrer dans la maison après une si longue absence, elle comprit tout ce qui venait de se passer, et elle bénit Allah qui m’avait encore une fois sauvé de la perdition. Puis, après les effusions du retour, elle me dit : « Il ne faut plus désormais fréquenter les habitants de cette ville : ce sont les frères des démons ! » Je lui dis : « Mais comment donc ton père vivait-il avec eux ? » Elle me répondit : « Mon père n’appartenait pas à leur société, et ne faisait guère comme eux et ne vivait point de leur vie. En tout cas, si j’ai un conseil à te donner, nous n’avons rien de mieux à faire, puisque mon père est mort…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
« … nous n’avons rien de mieux à faire, puisque mon père est mort, que de quitter cette ville impie, après avoir toutefois vendu nos biens, nos maisons et nos propriétés. Tu réaliseras tout cela le mieux que tu pourras, tu achèteras de belles marchandises avec une partie de la somme que tu toucheras, et tous deux nous nous en irons à Baghdad, ton pays, voir tes parents et tes amis, et vivre dans la paix et la sécurité, et dans le respect dû à Allah Très-Haut ! » Alors, moi, je répondis par l’ouïe et l’obéissance.
Aussitôt je me mis à vendre, au mieux de mon savoir-faire, pièce par pièce, et chaque chose en son temps, tous les biens de mon oncle le cheikh, père de mon épouse, le défunt qu’Allah ait en sa pitié et en sa miséricorde ! Et je réalisai de la sorte tout ce qui nous appartenait, comme meubles ou propriétés, en pièces d’or ; et je fis ainsi un bénéfice de cent pour un.
Après quoi, j’emmenai mon épouse et les marchandises que j’avais pris soin d’acheter, j’affrétai à mon compte un navire qui, avec la volonté d’Allah, eut une heureuse et fructueuse navigation ; si bien que, d’île en île et de mer en mer, nous finîmes par arriver en sécurité à Bassra, où nous ne nous arrêtâmes que fort peu de temps. Nous remontâmes le fleuve et nous entrâmes dans Baghdad, la cité de paix.
Je me dirigeai alors, avec mon épouse et mes richesses, vers ma rue et ma maison, où mes parents nous reçurent avec de grands transports de joie, et aimèrent beaucoup mon épouse, la fille du cheikh.
Quant à moi, je me hâtai de mettre ordre définitivement à mes affaires, j’emmagasinai mes belles marchandises, j’enfermai mes richesses, et je pus enfin, en paix, recevoir les félicitations de mes amis et de mes proches qui, ayant calculé le temps que j’étais resté absent, trouvèrent que ce septième voyage, le dernier de mes voyages, avait duré exactement vingt-sept années d’un bout à l’autre. Et moi, je leur racontai en détail mes aventures durant cette longue absence ; et je fis le vœû, que je tiens scrupuleusement, comme vous voyez, de ne jamais plus, durant le reste de ma vie, entreprendre un voyage, par mer fût-il ou simplement par terre. Et je ne manquai de rendre grâces à Allah Très-Haut de m’avoir, à plusieurs reprises et malgré mes récidives, délivré de tant de dangers et ramené au milieu de ma famille et de mes amis !
Et tel a été, ô mes invités, ce voyage septième et dernier qui fut le définitif remède à mes désirs aventureux ! »
Lorsque Sindbad le Marin eut terminé de la sorte son récit, au milieu des convives silencieux et émerveillés, il se tourna vers Sindbad le Portefaix et lui dit : « Et maintenant, ô Sindbad terrien, considère les travaux que j’ai accomplis et les difficultés que j’ai surmontées par la grâce d’Allah, et dis-moi si ton sort comme portefaix, n’a pas été de beaucoup plus favorable à une vie tranquille que celui qui m’est échu par la destinée ? Tu es, il est vrai, resté pauvre et moi j’ai acquis des richesses incalculables ; mais n’est-ce point que chacun de nous a été rétribué selon son effort ? » À ces paroles, Sindbad le Portefaix vint baiser la main de Sindbad le Marin et lui dit : « Par Allah sur toi, ô mon maître, excuse l’inconséquence de ma chanson ! »
Alors Sindbad le Marin fit tendre la nappe pour ses invités, et leur donna un festin qui dura trente nuits. Puis il voulut garder auprès de lui, comme intendant de sa maison, Sindbad le Portefaix. Et tous deux vécurent en amitié parfaite et à la limite de la dilatation jusqu’à ce que vint les visiter celle qui fait s’évanouir les délices, qui rompt les amitiés, qui détruit les palais et élève les tombeaux, l’amère mort. Gloire au Vivant qui ne meurt pas !
— Lorsque Schahrazade, la fille du vizir, eut fini de raconter l’histoire de Sindbad le Marin, elle se sentit légèrement fatiguée, et, comme elle voyait d’ailleurs s’approcher le matin et ne voulait pas, discrète selon son habitude, abuser de la permission accordée, elle se tut en souriant.
Alors la petite Doniazade qui avait écouté, émerveillée et les yeux dilatés, cette histoire étonnante, se leva du tapis où elle était blottie et courut embrasser sa sœur en lui disant : « Ô Schahrazade, ma sœur, que tes paroles sont douces et gentilles et pures et délicieuses au goût et savoureuses en leur fraîcheur ! Et qu’il est terrible et prodigieux et téméraire, Sindbad le Marin ! »
Et Schahrazade lui sourit et dit : « Oui, ma sœur ! Mais qu’est cela comparé à ce que je vous raconterai à tous deux la nuit prochaine, si je suis encore en vie par la grâce d’Allah et le bon plaisir du Roi ! »
Et le roi Schahriar, qui avait trouvé les voyages de Sindbad beaucoup plus longs que celui qu’il avait fait lui-même avec son frère Schahzaman dans la prairie, au bord de la mer, là où leur était apparu le genni chargé de la caisse, se tourna vers Schahrazade et lui dit : « En vérité, Schahrazade, je ne vois pas quelle histoire tu peux encore me raconter ! En tout cas, j’en veux une qui soit farcie de poèmes ! Tu m’en avais déjà promis, et tu n’as pas l’air de te douter que si tu diffères davantage d’accomplir ta promesse, ta tête ira rejoindre les têtes de celles qui t’ont précédée ! » Et Schahrazade dit : « Sur mes yeux ! Justement celle que je te réserve, ô Roi fortuné, te donnera entière satisfaction, et, de plus, elle est infiniment plus attachante que toutes celles que tu as entendues ! Tu peux déjà en juger par le titre qui est : Histoire de la belle Zoumourroud[2] et d’Alischar fils de Gloire. »
Alors le roi Schahriar dit en son âme : « Je ne la tuerai qu’après ! » Puis il la prit dans ses bras et passa avec elle le reste de la nuit.
Au matin, il se leva et sortit vers la salle de sa justice. Et le diwan fut rempli de la foule des vizirs, des émirs, des chambellans, des gardes et des gens du palais. Et le dernier qui entra fut le grand-vizir, père de Schahrazade, qui arriva avec, sous le bras, le linceul destiné à sa fille qu’il croyait, cette fois, trépassée pour de bon. Mais le Roi ne lui dit rien à ce sujet, et continua à juger, à nommer aux emplois, à destituer, à gouverner et à terminer les affaires pendantes, et cela jusque la fin du jour. Puis le diwan fut levé et le Roi rentra dans le palais, tandis que le grand-vizir restait dans la perplexité et à l’extrême limite de l’étonnement.
Puis, lorsque vint la nuit, le roi Schahriar pénétra chez Schahrazade et ils firent ensemble leur chose ordinaire.
LA TROIS CENT SEIZIÈME NUIT
La petite Doniazade, une fois la chose terminée entre le Roi et Schahrazade, s’écria de l’endroit où elle était blottie :
« Ô ma sœur, je t’en prie, qu’attends-tu encore pour commencer l’histoire promise de la belle Zoumourroud avec Alischar fils de Gloire ? »
Et Schahrazade, en souriant, répondit : « Je n’attends que la permission de ce Roi bien élevé et doué de bonnes manières ! » Alors le roi Schahriar prononça : « Tu peux ! »
Et Schahrazade dit :
HISTOIRE DE LA BELLE ZOUMOURROUD
AVEC ALISCHAR FILS DE GLOIRE.
Il est raconté qu’il y avait en l’antiquité du temps
et le passé de l’âge et du moment, dans le pays de
Khorassân, un fort riche marchand qui s’appelait
Gloire et avait un fils, beau comme la pleine lune,
nommé Alischar.
Or, un jour le riche marchand Gloire, déjà fort avancé en âge, se sentit atteint de la maladie de la mort. Il appela son fils auprès de lui et lui dit : « Ô mon fils, voici tout proche le terme de ma destinée, et je désire te recommander une recommandation ! » Alischar, bien peiné, dit : « Et quelle est-elle, ô mon père ? » Le marchand Gloire dit : « Je te recommande de ne jamais te créer de relations et de ne jamais fréquenter le monde, car le monde est comparable au forgeron : s’il ne te brûle pas avec le feu de sa forge ou s’il ne te crève pas un œil ou les deux yeux avec les étincelles de son enclume, il te suffoquera sûrement avec sa fumée ! Et d’ailleurs le poète a dit :
« Illusion ! Ne crois point trouver sur ta route noire, quand la destinée t’a trahi, l’ami au cœur fidèle.
« Ô solitude ! chère solitude bénie, tu enseignes à qui te cultive la force qui ne dévie point et l’art de ne se fier qu’à soi-même ! »
Un autre a dit :
« Néfaste sur ses deux faces, tel est le monde, si ton attention l’examine : l’une de ses faces est l’hypocrisie, et l’autre la trahison. »
Un autre a dit :
« Futilités, sottises et propos saugrenus, c’est là le riche apanage du monde ! Mais si le destin sur ton chemin place un être exceptionnel, fréquente-le quelquefois : simplement pour t’améliorer ! »
Lorsque le jeune Alischar eut entendu ces paroles de son père mourant, il répondit : « Ô mon père, je suis ton écouteur obéissant ! Que me conseilles-tu encore ? » Et Gloire le marchand dit : « Fais le bien, si toutefois tu le peux. Et n’attends point d’en être récompensé en retour par de la gratitude ou un semblable bien. Ô mon fils, on n’a pas, hélas ! l’occasion de faire le bien tous les jours. » Et Alischar répondit : « J’écoute et j’obéis ! Mais sont-ce là toutes tes recommandations ? » Gloire le marchand dit : « N’éparpille point les richesses que je te laisse : tu ne seras considéré qu’en raison de ce que ta main possède sous son pouvoir ! Et le poète a dit :
« Du temps de ma pauvreté, je ne me connaissais point d’amis ; et maintenant ils pullulent à ma porte et me coupent l’appétit.
« Ô ! combien de féroces ennemis a domptés ma richesse, et que d’ennemis je gagnerais si ma richesse diminuait ! »
Puis le vieillard continua : « Ne néglige pas les conseils des gens d’expérience, et ne crois point inutile de demander conseil à qui peut te conseiller ; car le poète a dit :
« Joins ton idée à l’idée du conseiller, pour te mieux assurer du résultat. Quand tu veux regarder ton visage, un seul miroir te suffit ; mais si c’est ton derrière obscur que tu désires inspecter, tu ne peux le tirer au clair que par le jeu de deux miroirs ! »
« De plus, mon fils, j’ai encore un dernier conseil à te donner. Garde-toi du vin ! Il est la cause de tous les maux. Il risque de t’enlever la raison, et de te rendre un objet de risée et de dédain.
« Telles sont mes recommandations sur le seuil dernier. Ô mon enfant, souviens-toi de mes paroles. Sois un excellent fils. Et que ma bénédiction t’accompagne dans la vie ! »,
Et Gloire, le vieux marchand, ayant parlé ainsi, ferma un instant les yeux et se recueillit. Puis il leva son index à la hauteur de ses yeux et prononça son acte de foi. Après quoi il trépassa dans la miséricorde du Très-Haut.
Il fut pleuré par son fils et par toute sa famille ; et on lui fit des funérailles auxquelles assistèrent les plus grands et les plus petits, les plus riches et les plus pauvres. Et, après qu’on l’eut mis en terre, on inscrivit ces vers sur la pierre de son tombeau :
« De la poussière je suis né et à la poussière je suis revenu, poussière moi-même ! C’est comme si je n’avais jamais vécu ! ».
Et voilà pour le marchand Gloire. Mais pour ce qui est d’Alischar fils de Gloire, voici :
Après la mort de son père, Alischar continua le commerce dans la boutique principale du souk, et suivit consciencieusement les recommandations paternelles, notamment en ce qui concernait les relations avec autrui. Mais, au bout d’un an exactement et d’un jour, heure pour heure, il se laissa tenter par les perfides garçons, les fils de putains, les adultérins sans vergogne. Et il les fréquenta avec frénésie, et connut leurs mères et leurs sœurs, des rouées, filles de chiens. Et il se plongea jusqu’au cou dans la débauche, et il nagea dans le vin et la dépense, dans une voie bien opposée au droit chemin. Car, n’étant plus dans un état sain d’esprit, il se faisait ce triste raisonnement : « Du moment que mon père m’a laissé toutes ses richesses, il faut bien que j’en use, pour ne pas en faire hériter d’autres après moi ! Et je veux profiter du moment et du plaisir qui passe, car je ne vivrai pas deux fois ! »
Or, ce raisonnement lui réussit si bien, et Alischar continua si régulièrement à unir le jour et la nuit par leurs extrémités, sans épargner aucun excès, qu’il se vit bientôt réduit à vendre sa boutique, sa maison, ses meubles et tous ses vêtements ; et il ne lui resta que juste les habits qu’il avait sur le corps.
Alors il put, en toute évidence, voir clair dans ses errements, et constater l’excellence des conseils de son père Gloire. Les amis qu’il avait fastueusement traités, et à la porte desquels il alla frapper à tour de rôle, trouvèrent tous un motif quelconque pour l’éconduire. Aussi, réduit maintenant à l’extrême limite de la misère, il fut obligé, n’ayant rien mangé depuis la veille, de sortir du misérable khân où il logeait et de mendier de porte en porte, dans les rues.
Pendant qu’il cheminait de la sorte, il arriva sur la place du marché, où il vit une grande foule rassemblée en cercle. Il fut tenté de s’en approcher, pour juger de ce qui se passait, et il vit, au milieu du cercle formé par les marchands, par les courtiers et les acheteurs…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… il vit, au milieu du cercle formé par les marchands, par les courtiers et les acheteurs, une jeune esclave blanche d’une élégante et délicieuse tournure : une taille de cinq palmes, et des roses comme joues, et des seins bien assis, et quel derrière ! Aussi pouvait-on lui appliquer, sans crainte de se tromper, ces vers du poète :
« Du moule de la Beauté sans défaut elle est sortie ! Ses proportions sont admirables : ni trop grande, ni trop petite, ni trop grasse, ni trop maigre ; et des rondeurs partout.
« Aussi la Beauté elle-même se trouva-t-elle éprise de son image que rehaussait le léger voile tamisant ses traits modestes à la fois et hautains.
« La lune est son visage ; le flexible rameau qui ondule, sa taille ; et le suave parfum du musc, son haleine.
« On la dirait formée de perles liquides ; car ses membres sont si polis qu’ils réfléchissent la lune de son visage, et paraissent eux-mêmes formés de lunes, à leur tour.
« Mais où est la langue qui saurait décrire ce miracle de clarté : son derrière brillant… ? »
Lorsque Alischar eut jeté ses regards sur la belle jeune fille, il fut extrêmement émerveillé, et, soit qu’il fût immobilisé par l’admiration, soit qu’il voulût oublier un instant sa misère au spectacle de la beauté, il se mêla à la foule rassemblée qui déjà s’apprêtait à la vente. Et les marchands et les courtiers qui étaient là, ignorant encore sa ruine, ne doutèrent pas un instant qu’il ne fût venu pour acquérir l’esclave : car ils le savaient très riche de l’héritage de son père, le syndic Gloire.
Mais bientôt à côté de l’esclave vint se placer le chef courtier et, par-dessus les têtes empressées, il clama : « Ô marchands, ô maîtres des richesses, citadins ou habitants libres du désert, l’ouvreur de la porte de l’encan n’a aucun blâme à encourir ! Hardi donc ! Voici devant vous la souveraine de toutes les lunes, la perle des perles, la vierge pleine de pudeur, la noble Zoumourroud, incitatrice de tous les désirs et jardin de toutes les fleurs ! Ouvrez l’encan, ô assistants ! Nul blâme à l’ouvreur de l’encan ! Voici devant vous la souveraine de toutes les lunes, la vierge pleine de pudeur Zoumourroud, jardin de toutes les fleurs ! »
Aussitôt d’entre les marchands quelqu’un cria : « J’ouvre à cinq cents dinars ! » Un autre dit : « Et dix ! » Alors un vieux, difforme et hideux, aux yeux bleus et louches, qui s’appelait Rachideddîn, cria : « Et cent ! » Mais une voix dit : « Et dix ! » À ce moment, le vieillard aux yeux bleus si laids renchérit en bloc en criant : « Mille dinars ! »
Alors tous les autres acheteurs emprisonnèrent leur langue et gardèrent le silence. Et le crieur se tourna vers le maître de la jeune esclave et lui demanda si le prix offert par le vieillard lui convenait et s’il fallait conclure le marché. Et le maître de l’esclave répondit : « Je veux bien. Mais, auparavant, il faut que mon esclave y consente aussi, car je lui ai juré de ne la céder qu’à l’acheteur qui lui plairait. Il te faut donc lui demander son consentement, ô courtier ! » Et le courtier s’approcha de la belle Zoumourroud et lui dit : « Ô souveraine des lunes, voudrais-tu appartenir à ce vénérable vieillard, le cheikh Rachideddîn ? »
La belle Zoumourroud, à ces paroles, jeta un regard sur celui que lui indiquait le courtier, et le trouva tel que nous venons de le dépeindre. Alors elle se détourna, avec un geste de dégoût, et s’écria : « Ne connais-tu donc pas, ô chef courtier, ce que disait un poète vieux, bien que pas aussi repoussant que ce vieillard-ci ? Écoute alors :
« Je la priai pour un baiser. Elle me regarda. Et son regard ne fut point haineux, ni dédaigneux, mais il fut indifférent !
« Elle me savait riche pourtant et considéré. Elle passa. Et ces mots d’un pli de sa bouche tombèrent :
« Les cheveux blancs ne sont point pour me plaire : je n’aime point entre mes lèvres mettre du coton mouillé ! »
En entendant ces vers, le courtier dit à Zoumourroud : « Par Allah ! tu refuses et tu as bien raison ! Ce n’est d’ailleurs pas un prix, mille dinars ! Tu en vaux dix mille, à mon estimation ! » Puis il se tourna vers la foule des acheteurs et demanda si un autre ne désirait pas l’esclave au prix déjà offert. Alors un marchand s’approcha et dit : « Moi ! » Et la belle Zoumourroud le regarda, et vit qu’il n’était point hideux comme le vieux Rachideddîn, et que ses yeux n’étaient ni bleus ni louches ; mais elle remarqua qu’il s’était teint la barbe en rouge, pour avoir l’air plus jeune qu’il n’était. Alors elle s’écria : « Ô honte ! noircir et rougir de la sorte la face de la vieillesse ! » Et, sur le champ, elle improvisa ces vers :
« Ô toi qui es épris de ma taille et de mon visage, tu peux tant qu’il te plaît te déguiser sous des couleurs d’emprunt, tu ne réussiras pas à attirer mon regard.
« Tu teintes d’opprobre tes cheveux blancs, sans réussir à cacher tes tares.
« Tu changes de barbe comme tu changes de visage, et tu deviens un épouvantail tel, qu’à te regarder la femme avorte dans sa fécondité ! »
Lorsque le chef courtier eut entendu ces vers, il dit à Zoumourroud : « Par Allah ! la vérité est de ton côté ! » Mais déjà, comme cette seconde proposition n’était pas agréée, un troisième marchand s’avança et dit au courtier : « J’y mets le prix. Demande-lui si elle m’accepte ! » Et le courtier interrogea la belle adolescente qui regarda alors l’homme en question. Elle vit qu’il était borgne, et éclata de rire en disant : « Mais ne sais-tu, ô courtier, les paroles du poète sur le borgne ? Écoute donc :
« Ami, crois-moi, ne fais jamais d’un borgne ton compagnon, et méfie-toi de ses mensonges et de sa fausseté.
» Il y a si peu à gagner à le fréquenter, qu’Allah s’est hâté de lui enlever un œil pour le signaler à la méfiance ! »
Alors le courtier lui montra un quatrième acquéreur et lui demanda : « Voudrais-tu de celui-ci ? » Elle examina ce dernier et vit que c’était un tout petit homme avec une barbe qui lui traînait jusqu’au nombril ; et aussitôt elle dit : « Quant à ce petit barbu-là, voici comment l’a dépeint le poète :
« Il a une barbe prodigieuse, plante inutile et encombrante. Elle est triste comme une nuit d’hiver longue, froide et obscure. »
Lorsque le crieur vit qu’aucun n’était accepté de ceux-là qui d’eux-mêmes se présentaient pour l’achat, il dit à Zoumourroud : « Ô ma maîtresse, regarde tous ces marchands et ces nobles acheteurs, et indique-moi celui qui a la chance de te plaire pour que j’aille t’offrir à lui pour l’achat ! »
Alors la belle adolescente examina un à un tous les assistants avec la plus grande attention, et son regard finit par tomber sur Alischar fils de Gloire. Et l’aspect du jeune homme l’enflamma subitement du plus violent amour ; car Alischar fils de Gloire était, en vérité, d’une beauté extraordinaire, et nul ne le pouvait voir sans se sentir porté vers lui avec ardeur. Aussi la jeune Zoumourroud se hâta de le montrer au crieur, et dit : « Ô crieur, c’est ce jouvenceau-là que je veux, celui au visage gentil, à la taille onduleuse ; car je le trouve délicieux et d’un sang sympathique et plus léger que la brise du nord ; et c’est de lui que le poète a dit :
« Ô jouvenceau, comment ceux qui t’ont vu dans ta beauté pourront-ils t’oublier ?
« Que ceux qui déplorent les tourments dont tu leur remplis le cœur, cessent de te regarder.
« Ceux-là qui veulent se préserver de tes charmes dangereux, que ne couvrent-ils d’un voile ton visage enchanteur !… »
« Et c’est également de lui qu’un autre poète a dit :
« Ô mon seigneur, comprends ! Comment ne point t’aimer ? Ta taille n’est-elle point svelte et tes reins ne sont-ils pas cambrés ?
« Comprends, ô mon seigneur ! L’amour de ces choses n’est-il pas l’attribut des sages, des gens exquis et des esprits fins ?
« Ô jouvenceau, mon seigneur, je te contemple et mes forces s’évanouissent !
« Si tu t’assieds sur mes genoux, tes fesses sont lourdes ; mais, si tu t’en vas, leur absence me pèse !
« Ô ! ne me tue pas d’un regard : nulle religion ne recommande le meurtre. Ô ! que ton cœur soit tendre et fléchisse comme ta taille ! Que ton œil pour moi soit doux, comme lisse est ta joue ! »
« Un troisième poète a dit :
« Ses joues sorti pleines et glissantes ; sa salive est un lait doux à boire, remède aux maladies ; son regard fait rêver les prosateurs et les poètes ; et ses perfections rendent perplexes les architectes. »
« Un autre a dit :
« La liqueur de ses lèvres est un vin enivrant ; son haleine a le parfum de l’ambre, et ses dents sont des grains de camphre.
« Aussi Radouân, le gardien du Paradis, l’a-t-il prié de s’en aller, de crainte qu’il ne séduisît les houris.
« Les gens grossiers, à l’esprit lourd, déplorent ses gestes et sa conduite, comme si la lune n’est pas belle dans tous ses quartiers, comme si sa marche n’est pas également harmonieuse dans toutes les parties du ciel ! »
« Un poète a dit encore :
« Ce jeune faon, à la chevelure frisée, aux joues pleines de roses, au regard enchanteur, consentit enfin à un rendez-vous. Et me voici exact, avec le cœur ému et l’œil anxieux.
« Il me l’a promis, ce rendez-vous, en fermant les yeux pour me dire oui ! Mais si ses paupières sont fermées comment peuvent-elles tenir leur promesse ? »
« Enfin un autre a dit à son sujet :
« J’ai des amis peu subtils qui m’ont demandé : « Comment peux-tu si passionnément aimer un jeune homme dont les joues sont ombragées par un duvet déjà si fort ? »
« Je leur dis : « Qu’elle est grande votre ignorance ! Les fruits du jardin d’Éden ont été cueillis sur ses belles joues ! Comment auraient-elles, ces joues, fourni de si beaux fruits, si elles n’étaient déjà si touffues ? »
Le courtier fut extrêmement émerveillé de voir tant de talent chez une esclave si jeune, et il exprima son étonnement au propriétaire, qui lui dit : « Je comprends que tu sois émerveillé de tant de beauté et de tant de finesse d’esprit. Mais sache que cette miraculeuse adolescente, qui rend honteux les astres et le soleil, ne se contente pas seulement de connaître les poètes les plus délicats et les plus compliqués, et d’être elle-même une constructrice de strophes, elle sait, en outre, écrire, avec sept plumes, les sept caractères différents, et ses mains sont plus précieuses que tout un trésor. Elle connaît, en effet, l’art de la broderie et du tissage de la soie, et tout tapis ou rideau qui sort de ses mains est coté au souk cinquante dinars. Note, de plus, qu’il lui suffit de huit jours pour parachever le tapis le plus beau ou le rideau le plus somptueux. Aussi l’acquéreur qui l’achètera rentrera-t-il dans son argent au bout de quelques mois, en toute certitude ! »
À ces paroles, le courtier leva ses bras d’admiration et s’écria : « Ô bonheur de celui qui aura cette perle dans sa demeure, et la conservera comme son trésor le plus secret ! » Et il s’approcha d’Alischar fils de Gloire, que lui avait indiqué l’adolescente, s’inclina devant lui jusqu’à terre, lui prit la main et la baisa, puis il lui dit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… s’inclina devant lui jusqu’à terre, lui prit la main et la baisa, puis il lui dit : « En vérité, ô mon maître, ta chance est une grande chance de pouvoir acheter ce trésor pour la centième partie de sa valeur, et le Donateur n’a point lésiné avec toi dans ses dons ! Que cette adolescente t’apporte donc avec elle le bonheur ! »
À ces paroles, Alischar baissa la tête, et ne put s’empêcher de rire en lui-même de l’ironie de la destinée, et il se dit : « Par Allah ! je n’ai pas de quoi m’acheter un morceau de pain, et l’on me croit assez riche pour acheter cette esclave ! En tout cas, je ne dirai ni oui ni non, pour ne pas me couvrir de honte devant tous les marchands ! » Et il baissa les yeux et ne souffla mot.
Comme il ne bougeait pas, Zoumourroud le regarda pour l’encourager dans l’achat ; mais il tenait les yeux baissés et ne la voyait pas ; elle dit alors au courtier : « Prends-moi par la main et conduis-moi auprès de lui ; je veux lui parler moi-même et le décider à m’acheter ; car j’ai bien résolu de n’appartenir qu’à lui, et pas à un autre ! » Et le courtier la prit par la main et la conduisit auprès d’Alischar fils de Gloire.
L’adolescente se tint droite, dans sa vive beauté, devant le jeune homme et lui dit : « Ô mon maître bien-aimé, ô jouvenceau dont brûlent mes entrailles, que ne proposes-tu le prix d’achat ? Et même que ne donnes-tu toi-même l’estimation qui te semble plus juste ! Je veux être ton esclave, à n’importe quel prix ! » Alischar releva la tête, en la secouant avec tristesse, et dit : « La vente et l’achat ne sont jamais une obligation ! » Zoumourroud s’écria : « Je vois, ô mon maître bien-aimé, que tu trouves trop élevé le prix de mille dinars. N’en offre donc que neuf cents, et je t’appartiens ! » Il hocha la tête et ne dit mot. Elle reprit : « Achète-moi alors pour huit cents ! » Il hocha la tête. Elle dit : « Pour sept cents ! » Il hocha encore la tête. Elle se mit encore à diminuer jusqu’à lui dire : « Pour cent dinars seulement ! » Alors il lui dit : « Eh bien ! ces cent dinars je ne les ai pas tout à fait au complet ! » Elle se mit à rire et lui dit : « Combien t’en manque-t-il pour faire cette somme de cent dinars ? Car, si tu n’as pas le tout aujourd’hui, tu paieras le reste un autre jour. » Il répondit : « Ô ma maîtresse, sache enfin que je n’ai ni cent ni même un dinar ! Par Allah ! moi, je ne possède pas plus une pièce blanche qu’une pièce rouge, un dinar d’or qu’un drachme d’argent. Ainsi ne perds pas ton temps avec moi, et cherche un autre acheteur ! »
Lorsque Zoumourroud eut compris que le jeune homme n’avait aucune ressource, elle lui dit : « Conclus tout de même le marché : frappe-moi dans la main, enveloppe-moi de ton manteau et passe un de tes bras autour de ma taille : c’est, comme tu le sais, le signe de l’acceptation ! » Alischar, alors, n’ayant plus de motif de refuser, se hâta de faire ce que lui ordonnait Zoumourroud ; et, au même instant, celle-ci tira de sa poche une bourse qu’elle lui remit, et lui dit : « Il y a là-dedans mille dinars ; il te faut en offrir neuf cents à mon maître, et garder les cent autres pour subvenir à nos besoins les plus pressants ! » Et aussitôt Alischar compta au marchand les neuf cents dinars, et se hâta de prendre l’esclave par la main et de l’emmener chez lui.
Lorsqu’on fut arrivé à la maison, Zoumourroud ne fut pas peu surprise de voir que le logis consistait en une misérable chambre n’ayant pour tous meubles qu’une méchante natte vieille et déchirée en plusieurs endroits. Elle se hâta de lui remettre encore mille dinars dans une seconde bourse et lui dit : « Cours vite au souk nous acheter tout ce qui est nécessaire en meubles et tapis, et tout ce qu’il faut pour manger et boire. Et choisis ce qu’il y a de meilleur au souk ! De plus rapporte-moi une grande pièce de soie de Damas, de la plus belle qualité, rouge grenat, et des bobines de fil d’or et des bobines de fil d’argent et des bobines de fil de soie de sept couleurs différentes. N’oublie pas non plus de m’acheter de grandes aiguilles et un dé en or pour mon doigt du milieu ! » Et Alischar exécuta aussitôt ces ordres, et apporta à Zoumourroud tout cela. Alors elle étendit par terre les tapis, rangea les matelas et les divans, mit tout en ordre, et tendit la nappe, après avoir allumé les flambeaux.
Tous deux s’assirent alors, et mangèrent et burent et furent contents. Après quoi, ils s’étendirent sur leur couche neuve, et se satisfirent mutuellement. Et ils passèrent toute la nuit étroitement enlacés, dans les plus pures délices et les plus gais ébats, jusqu’au matin. Et leur amour se consolida par des preuves indubitables, et se grava dans leur cœur d’une façon inaltérable.
Sans perdre de temps, la diligente Zoumourroud se mit aussitôt à l’ouvrage. Elle prit la pièce de soie rouge grenat de Damas, et, en quelques jours, elle en fit un rideau sur le pourtour duquel elle représenta avec un art infini des figures d’oiseaux et d’animaux ; et elle ne laissa pas un seul animal dans le monde, grand ou petit, qu’elle ne l’eût dessiné sur cette étoffe. Et l’exécution en fut si frappante de ressemblance et si vivante, que les animaux à quatre pieds semblaient se mouvoir, et que l’on croyait entendre chanter les oiseaux. Au milieu du rideau étaient brodés de grands arbres chargés de leurs fruits, et à l’ombrage si beau que l’on sentait une grande fraîcheur à s’y reposer les yeux. Et tout cela fut exécuté en huit jours, ni plus ni moins ! Gloire à Celui qui met tant d’habileté dans les doigts de ses créatures !
Le rideau achevé, Zoumourroud le lustra, le lissa, le plia et le remit à Alischar en lui disant : « Va le porter au souk et vends-le à quelque marchand en boutique, pour pas moins de cinquante dinars. Seulement garde-toi bien de le céder à quelqu’un de passage, qui ne soit pas connu dans le souk ; sinon tu serais la cause entre nous d’une cruelle séparation. Nous avons, en effet, des ennemis qui nous guettent : méfie-toi du passant ! » Et Alischar répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et il alla au souk et vendit pour cinquante dinars à un marchand en boutique le merveilleux rideau en question…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
… et vendit pour cinquante dinars à un marchand en boutique le merveilleux rideau en question. Puis, de nouveau, il acheta de la soie et des fils d’or et d’argent, en quantité suffisante pour un nouveau rideau ou quelque belle tapisserie, et porta le tout à Zoumourroud, qui se remit à l’ouvrage et, en huit jours, exécuta un tapis encore plus beau que la première fois, lequel rapporta également la somme de cinquante dinars. Et ils vécurent de la sorte, en mangeant, en buvant, et en ne manquant de rien, sans oublier de satisfaire leur mutuel amour, plus ardent de jour en jour, pendant encore l’espace d’une année.
Un jour, Alischar sortit de la maison, porteur, selon son habitude, d’un paquet renfermant une tapisserie exécutée par Zoumourroud ; et il prit le chemin du souk pour le proposer aux marchands, par l’entremise du crieur, comme toujours. Arrivé au souk, il la remit au crieur qui se mit à la crier devant les boutiques des marchands, quand vint à passer un chrétien, un de ces individus comme il en pullule à l’entrée des souks et qui obsèdent le client de leurs offres de service.
Ce chrétien s’approcha du crieur et d’Alischar et leur proposa soixante dinars de la tapisserie, au lieu de cinquante qui en était le prix crié. Mais Alischar, qui avait de l’aversion et de la défiance pour ces sortes d’individus et qui, d’ailleurs, se rappelait la recommandation de Zoumourroud, ne voulut pas la lui céder. Alors le chrétien augmenta son offre, et finit par proposer cent dinars ; et le crieur dit à l’oreille d’Alischar : « En vérité, ne laisse pas échapper cette excellente aubaine ! » Car le crieur avait déjà été secrètement soudoyé par le chrétien moyennant dix dinars. Et il manœuvra si bien sur l’esprit d’Alischar, qu’il le décida à livrer la tapisserie au chrétien, contre la somme convenue. Il le fit donc, mais non sans une grande appréhension, toucha les cent dinars, et reprit le chemin de sa maison.
Tandis qu’il marchait, il s’aperçut à un tournant de rue que le chrétien le suivait. Il s’arrêta et lui demanda : « Qu’as-tu à faire dans ce quartier où n’entrent pas les gens de ton espèce, chrétien ? » Celui-ci dit : « Excuse-moi, ô mon maître, mais j’ai une commission à remplir au bout de cette ruelle. Qu’Allah te conserve ! » Alischar continua sa route et arriva à la porte de sa maison ; et là il s’aperçut que le chrétien, après avoir fait un crochet, était revenu par l’autre bout de la rue, et arrivait devant sa porte au même moment que lui. Il lui cria, pris de colère : « Maudit chrétien, qu’as-tu à me suivre de la sorte partout où je vais ? » Il répondit : « Ô mon maître, crois bien que c’est par hasard que je suis là encore ; mais je te prie de me donner une gorgée d’eau, et Allah t’en rémunérera, car la soif me brûle l’intérieur ! » Et Alischar pensa : « Par Allah ! il ne sera pas dit qu’un musulman ait refusé de donner à boire à un chien altéré ! Je vais donc lui porter de l’eau. » Et il entra dans sa maison, prit une cruche d’eau et allait ressortir pour l’aller porter au chrétien, quand Zoumourroud l’entendit ouvrir le loquet et courut à sa rencontre, émue de son absence prolongée. Elle lui dit, en l’embrassant : « Pourquoi as-tu tant tardé à rentrer aujourd’hui ? As-tu fini par vendre la tapisserie, et est-ce à un brave marchand en boutique, ou à un passant ? » Il répondit, troublé fort visiblement : « J’ai tardé un peu car le souk était plein ; j’ai fini tout de même par vendre la tapisserie à un marchand ! » Elle dit, avec un doute dans la voix : « Par Allah ! mon cœur n’est pas tranquille. Mais où portes-tu cette cruche ? » Il dit : « Je vais donner à boire au crieur du souk qui m’a accompagné jusqu’ici ! » Mais cette réponse ne la satisfit point, et, tandis qu’Alischar sortait, elle récita, fort anxieuse, ce vers du poète :
« Ô mon cœur qui t’attaches à l’aimé, pauvre cœur plein d’espoir et qui crois éternel le baiser, ne vois-tu qu’à ton chevet, les bras tendus, veille la séparatrice, et que dans l’ombre te guette, perfide, la destinée ?… »
Comme Alischar se dirigeait vers le dehors, il trouva le chrétien déjà entré dans le vestibule, par la porte laissée ouverte. À cette vue, le monde noircit devant son visage et il s’écria : « Que fais-tu là, chien fils de chien ? Et comment as-tu osé pénétrer dans ma maison sans mon consentement ? » Il répondit : « De grâce, ô mon maître, excuse-moi ! Épuisé d’avoir marché tout le jour, et ne pouvant plus me tenir debout, je me vis forcé de franchir ton seuil, puisqu’on somme il n’y a pas grande différence entre la porte et le vestibule. D’ailleurs, le temps seulement de prendre haleine, et je m’en vais ! Ne me repousse pas et Allah ne te repoussera pas ! » Et il prit la cruche que tenait Alischar fort perplexe, but son besoin, et la lui rendit. Et Alischar resta debout en face de lui, à attendre qu’il s’en allât. Mais une heure se passa de la sorte et le chrétien ne bougeait pas. Alors Alischar lui cria, suffoqué : « Veux-tu tout de suite sortir d’ici et t’en aller en ta voie ? » Mais le chrétien lui répondit : « Ô mon maître, tu n’es certes pas de ceux qui font un bienfait à quelqu’un pour le lui faire sentir toute la vie, ni de ceux dont le poète a dit :
« Évanouie, la race généreuse de ceux qui sans compter remplissaient la main du pauvre avant qu’elle ne fût tendue.
« Maintenant c’est une race vile d’usuriers qui supputent l’intérêt d’un peu d’eau prêtée au pauvre du chemin. »
« Quant à moi, ô mon maître, j’ai déjà étanché ma soif à l’eau de ta maison, mais la faim m’est en ce moment une telle torture que je me contenterais bien des restes de ton repas, ne serait-ce qu’un morceau de pain sec et un oignon, rien de plus ! » Alischar, de plus en plus furieux, lui cria : « Allons ! va-t’en d’ici ! assez de citations comme ça ! Il n’y a plus rien à la maison ! » Il répondit sans bouger de sa place : « Mon seigneur, pardonne-moi ! mais, s’il n’y a plus rien à la maison, tu as sur toi les cent dinars que t’a rapportés la tapisserie. Je te prie donc, par Allah, d’aller au souk le plus proche m’acheter une galette de froment, pour qu’il ne soit pas dit que j’aie quitté ta maison sans qu’il y ait eu entre nous le pain et le sel ! »
Lorsqu’Alischar eut entendu ces paroles, il se dit en lui-même : « Il n’y a pas de doute possible, ce maudit chrétien est un fou et un extravagant. Et je vais le jeter à la porte et exciter après lui les chiens de la rue ! » Et comme il s’apprêtait à le pousser dehors, le chrétien immobile lui dit : « Ô mon maître, ce n’est qu’un seul pain que je désire, et un seul oignon, de quoi seulement chasser la faim. Ne va donc pas faire une grande dépense pour moi, c’est vraiment de trop ! Car le sage se contente de peu ; et, comme dit le poète :
« Un pain sec suffit pour mettre en fuite la faim qui torture le sage, alors que le monde entier ne saurait calmer le faux appétit du gourmand. »
Quand Alischar vit qu’il ne pouvait faire autrement que de s’exécuter, il dit au chrétien : « Je vais au souk te chercher à manger. Reste ici à m’attendre, sans bouger ! » Et il sortit de la maison, après avoir fermé la porte et enlevé la clef de la serrure pour la mettre dans sa poche. Il alla en toute hâte au souk, où il acheta du fromage rôti au miel, des concombres, des bananes, des feuilletés et du pain soufflé tout frais sortant du four, et apporta le tout au chrétien en lui disant : « Mange ! » Mais celui-ci se récusa en disant : « Mon seigneur, quelle générosité est la tienne ! Ce que tu apportes là suffira à nourrir dix personnes ! C’est vraiment trop ! à moins que tu ne veuilles m’honorer en mangeant avec moi ! » Alischar répondit : « Moi, je suis rassasié ; mange donc tout seul ! » Il s’écria : « Mon seigneur, la sagesse des nations nous apprend que celui qui refuse de manger avec son hôte est indubitablement un bâtard adultérin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-UNIÈME NUIT
Elle dit :
»… celui qui refuse de manger avec son hôte est indubitablement un bâtard adultérin ! » À ces paroles sans réplique possible, Alischar n’osa refuser et s’assit à côté du chrétien et se mit à manger avec lui, distraitement. Le chrétien profita de l’inattention de son hôte pour éplucher une banane, la partager et y glisser adroitement du banj pur mêlé à de l’extrait d’opium, à dose suffisante pour terrasser un éléphant et l’endormir pendant un an. Il trempa cette banane dans le miel blanc où nageait l’excellent fromage rôti, et l’offrit à Alischar en lui disant : « Ô mon seigneur, par la vérité de ta foi ! accepte de ma main cette succulente banane que j’ai épluchée à ton intention ! » Alischar, qui tenait à en finir, prit la banane et l’avala.
À peine la banane était-elle arrivée dans son estomac, qu’Alischar tomba à la renverse, la tête avant les pieds, privé de sentiment. Alors le chrétien bondit tel un loup pelé et s’élança au dehors où, dans la ruelle en face, se tenaient aux aguets des hommes avec un mulet, ayant à leur tête le vieux Rachideddîn, le misérable aux yeux bleus auquel n’avait pas voulu appartenir Zoumourroud, et qui avait juré de l’avoir de force, coûte que coûte. Ce Rachideddîn n’était qu’un ignoble chrétien qui professait extérieurement l’islamisme pour en avoir les privilèges auprès des marchands, et il était le propre frère du chrétien qui venait de trahir Alischar, et dont le nom était Barssoum.
Ce Barssoum courut donc aviser son misérable frère du succès de leur ruse, et tous deux, suivis de leurs hommes, pénétrèrent dans la maison d’Alischar, se précipitèrent dans l’appartement d’à côté, qu’avait loué Alischar pour en faire le harem de Zoumourroud, s’élancèrent sur la belle adolescente, qu’ils bâillonnèrent et prirent à bras le corps pour la transporter en un clin d’œil sur le dos du mulet qu’ils mirent au galop pour arriver, en quelques instants, sans avoir été inquiétés en route, à la maison du vieux Rachideddîn.
Le vieux misérable aux yeux bleus et louches fit alors porter Zoumourroud dans la chambre la plus retirée de la maison, et il s’assit seul près d’elle, après lui avoir ôté le bâillon, et lui dit : « Te voici enfin en mon pouvoir, belle Zoumourroud, et ce n’est point ce vaurien d’Alischar qui viendra maintenant te tirer de mes mains. Commence donc, avant que de coucher dans mes bras et d’éprouver ma vaillance au combat, par abjurer ta mécréante foi et consentir à devenir chrétienne comme je suis chrétien. Par le Messie et la Vierge ! si, tout de suite, tu ne te rends à mon double désir, je te ferai subir les pires tortures et te rendrai plus malheureuse qu’une chienne ! »
À ces paroles du misérable chrétien, les yeux de l’adolescente se remplirent de larmes qui roulèrent le long de ses joues, et ses lèvres frémirent, et elle s’écria : « Ô scélérat à barbe blanche, par Allah ! tu peux me faire couper en morceaux, mais tu n’arriveras pas à me faire abjurer ma foi ; tu peux même prendre mon corps par la violence, comme le bouc en rut la chèvre enfantine, mais tu ne soumettras pas mon esprit à l’impureté partagée ! Et Allah saura bien tôt ou tard te demander compte de tes ignominies ! »
Lorsque le vieillard vit qu’il ne pouvait la persuader par la parole, il appela ses esclaves et leur dit : « Renversez-la et tenez-la sur le ventre solidement ! » Et ils la renversèrent et la couchèrent sur le ventre. Alors ce misérable vieux chrétien prit un fouet et se mit à l’en flageller cruellement sur ses belles parties arrondies, de façon que chaque coup laissait une longue raie rouge sur le blanc de son derrière. Et Zoumourroud à chaque coup qu’elle recevait, loin de faiblir dans sa foi, s’écriait : « Il n’y a de Dieu qu’Allah, et Môhammad est l’envoyé d’Allah ! » Et il ne s’arrêta de la frapper que lorsqu’il ne put plus lever le bras. Alors il ordonna à ses esclaves de la jeter à la cuisine, avec les servantes, et de ne lui rien donner à manger ni à boire. Et ils obéirent à l’instant. Et voilà pour eux !
Quant à Alischar, il resta étendu, privé de sentiment, dans le vestibule de sa maison, jusqu’au lendemain. Il put alors reprendre ses sens et ouvrir les yeux, une fois dissipée l’ivresse du banj et envolées de sa tête les fumées de l’opium. Il se leva alors sur son séant et, de toutes ses forces, il appela : « Ya Zoumourroud ! » Mais personne ne lui répondit. Il se leva anxieux et entra dans l’appartement, qu’il trouva vide et silencieux, et où les voiles de Zoumourroud. et ses écharpes gisaient sur le sol. Alors il se rappela le chrétien ; et, comme lui aussi avait disparu, il ne douta plus de l’enlèvement de sa bien-aimée Zoumourroud. Il se jeta alors par terre, en se frappant la tête et en sanglotant ; puis il déchira ses vêtements, et pleura toutes les larmes de la désolation, et, à la limite du désespoir, il s’élança hors de sa maison, ramassa deux gros cailloux dont il se mit un dans chaque main, et commença à parcourir, hagard, toutes les rues en se frappant la poitrine avec ces cailloux et en criant : « Ya Zoumourroud ! Zoumourroud ! » Et les enfants l’entourèrent en courant avec lui et en criant : « Un fou ! un fou ! » Et les gens de connaissance qui le rencontraient le regardaient avec compassion et pleuraient la perte de sa raison, en disant : « C’est le fils de Gloire ! Pauvre Alischar ! »
Il continua à errer de la sorte, les cailloux lui faisant résonner la poitrine, quand il fut rencontré par une vieille femme d’entre les femmes de bien, qui lui dit : « Mon enfant, puisses-tu jouir de la sécurité et de la raison ! Depuis quand es-tu devenu fou ? » Et Alischar lui répondit par ce vers :
« C’est l’absence d’une qui m’a fait perdre la raison ! Ô vous qui croyez à ma folie, ramenez celle qui l’a causée, et sur mon esprit vous mettrez la fraîcheur d’un dictame ! »
En entendant ce vers et en regardant Alischar plus attentivement, la bonne vieille comprit qu’il devait être un amoureux en souffrance, et lui dit : « Mon enfant, ne crains pas de me raconter tes peines et ton infortune. Peut-être qu’Allah ne m’a placée sur ton chemin que pour te venir en aide ! » Alors Alischar lui raconta son aventure avec Barssoum le chrétien.
La bonne vieille, à ce discours, réfléchit pendant une heure de temps, puis elle releva la tête et dit à Alischar : « Lève-toi, mon enfant, et va vite m’acheter une corbeille de colporteur, dans laquelle tu mettras, après les avoir achetés au souk, des bracelets de verre coloré, des anneaux en cuivre argenté, des pendants d’oreilles, des breloques, et diverses autres choses comme en vendent aux femmes dans les maisons les vieilles pourvoyeuses. Et moi je mettrai cette corbeille sur ma tête, et j’irai faire le tour de toutes les maisons de la ville, en vendant aux femmes ces diverses choses. Et de la sorte je pourrai faire des investigations qui nous mettront sur la bonne voie et nous feront, s’il plaît à Allah, retrouver ton amante Sett Zoumourroud…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
»… retrouver ton amante Sett Zoumourroud. » Et Alischar se mit à pleurer de joie et, après avoir baisé les mains de la bonne vieille, se hâta d’aller acheter et de lui rapporter ce qu’elle lui avait indiqué.
Alors la vieille rentra chez elle pour s’habiller. Elle se voila le visage avec un voile couleur de miel brun, se couvrit la tête d’un foulard de cachemire, et s’enveloppa d’un grand voile de soie noire ; puis elle mit sur sa tête la corbeille en question et, prenant en main un bâton pour soutenir sa respectable vieillesse, elle se mit à faire lentement le tour des harems des notables et des marchands, dans les différents quartiers, et ne tarda pas à arriver à la maison du vieux Rachideddîn, le misérable chrétien qui se faisait passer pour musulman, le maudit qu’Allah confonde et brûle dans les feux de son enfer et torture jusqu’à l’extinction des temps. Amîn !
Or, elle y arriva juste au moment où la malheureuse adolescente, jetée au milieu des esclaves et des servantes de la cuisine, endolorie encore des coups qu’elle avait reçus, gisait à moitié morte sur une méchante natte.
Elle frappa à la porte, et l’une des esclaves vint lui ouvrir et la saluer avec amitié ; et la vieille lui dit : « Ma fille, j’ai là quelques jolis objets à vendre. Y a-t-il chez vous autres des acheteurs ? » La servante dit : « Mais je crois bien ! » Et elle l’introduisit à la cuisine, où la vieille s’assit avec componction et fut aussitôt entourée par les esclaves. Elle fut fort accommodante dans la vente, et se mit à leur céder, pour des prix fort modiques, bracelets, anneaux et pendants d’oreilles, si bien qu’elle gagna leur confiance et qu’elles l’aimèrent pour son langage onctueux et la douceur de ses manières.
Mais, en tournant la tête, voici qu’elle aperçut Zoumourroud étendue ; et elle interrogea à son sujet les esclaves, qui lui apprirent tout ce qu’elles savaient. Et aussitôt elle fut persuadée qu’elle était en présence de celle qu’elle cherchait. Elle s’approcha de l’adolescente et lui dit : « Ma fille, que tout mal s’éloigne de toi ! Allah m’envoie à ton secours ! Tu es Zoumourroud, l’esclave aimée d’Alischar fils de Gloire ! » Et elle lui apprit pourquoi elle était venue, déguisée en pourvoyeuse, et lui dit : « Demain soir tiens-toi prête à être enlevée ; mets-toi à la fenêtre de la cuisine qui donne sur la rue, et quand tu verras quelqu’un dans l’ombre qui se mettra à siffler, ce sera le signal. Réponds-lui en sifflant, et saute sans crainte dans la rue. C’est Alischar lui-même qui sera là et qui te délivrera ! » Et Zoumourroud baisa les mains de la vieille, qui se hâta de sortir et d’aller mettre Alischar au courant de ce qui venait de se passer, ajoutant : « Tu iras donc là-bas, au-dessous de la fenêtre de la cuisine de ce maudit-là, et tu feras comme ça et comme ça. »
Alors Alischar remercia beaucoup la vieille pour ses bons offices et voulut lui faire cadeau de quelque chose ; mais elle refusa et s’en alla, en lui souhaitant le succès et le bonheur, le laissant se réciter des vers sur l’amertume de la séparation.
Le lendemain soir, Alischar prit la route qui conduisait à la maison dépeinte par la bonne vieille, et finit par la trouver. Il vint s’asseoir au bas du mur, où il attendit que fût venue l’heure de siffler ! Mais comme il était là depuis un certain temps, et qu’il avait déjà passé deux nuits sans sommeil, il fut tout d’un coup vaincu par la fatigue et s’endormit. Glorifié soit le Seul qui jamais ne s’endort !
Pendant qu’Alischar était ainsi assoupi au bas de la cuisine, cette nuit-là, le destin poussa de ce côté, en quête de quelque bonne aubaine, un larron d’entre les larrons audacieux, qui, après avoir fait tout le tour de la maison, sans trouver d’issue, arriva à l’endroit où dormait Alischar. Il se pencha sur lui et, tenté par la richesse de ses habits, il lui vola tout doucement son beau turban et son manteau et s’en affubla en un clin d’œil. Et au même moment il vit la fenêtre s’ouvrir et entendit quelqu’un siffler. Il regarda et aperçut une forme de femme, et cette femme lui faisait signe et sifflait. C’était Zoumourroud qui le prenait pour Alischar.
À cette vue, le voleur, sans trop comprendre, se dit : « Si je lui répondais ? » Et il siffla. Aussitôt Zoumourroud sortit de la fenêtre et sauta dans la rue, en s’aidant d’une corde. Et le voleur, qui était un fort solide gaillard, la reçut sur son dos et s’éloigna avec la rapidité de l’éclair.
Quand Zoumourroud vit une telle force cher son porteur, elle fut extrêmement étonnée et lui dit : « Alischar, mon bien-aimé, la vieille m’a dit que tu pouvais à peine te traîner, tant tu avais été affaibli par la douleur et la crainte. Et je vois que tu es plus fort qu’un cheval ! » Mais comme le voleur ne répondait pas et galopait plus rapidement, Zoumourroud lui passa la main sur le visage, et le trouva tout hérissé de poils plus durs que le balai du hammam, et tel qu’on l’eût cru quelque cochon ayant avalé une poule dont les plumes lui seraient sorties de la gueule. À cette constatation elle eut une terreur épouvantable et se mit à lui donner des coups sur la figure en lui criant : « Qui es-tu ? Qu’est-ce que tu es ? » Or, comme à ce moment ils étaient déjà loin des habitations, dans la pleine campagne envahie par la nuit et la solitude, le voleur s’arrêta un instant, déposa à terre l’adolescente et lui cria : « Moi, je suis Djiwân le Kourde, le plus terrible compagnon de la bande d’Ahmad Ed-Danaf. Nous sommes quarante gaillards qui depuis longtemps sommes privés de chair fraîche ! La nuit prochaine sera la plus bénie de tes nuits, car nous monterons tous sur toi, à tour de rôle, et nous pataugerons dans ton ventre, et nous nous vautrerons entre tes cuisses scélératement, et nous ferons rouler ton bouton jusqu’au matin ! »
Lorsque Zoumourroud eut entendu ces paroles de son ravisseur, elle comprit toute l’horreur de sa situation, et se mit à pleurer en se frappant le visage et en déplorant l’erreur qui l’avait livrée à ce bandit perpétrateur de violences, et bientôt à ses compagnons les quarante. Puis voyant que la mauvaise destinée avait pris le dessus dans sa vie, et qu’il n’y avait pas à lutter contre elle, elle se laissa emporter de nouveau par son ravisseur, sans opposer de résistance, et se contenta de soupirer : « Il n’y a de Dieu qu’Allah ! En Lui je me réfugie ! Chacun porte sa destinée attachée à son cou, et, quoi qu’il fasse, il ne peut s’en éloigner…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … Chacun porte sa destinée attachée à son cou, et, quoi qu’il fasse, il ne peut s’en éloigner ! »
Le terrible Kourde Djiwân rechargea donc l’adolescente sur son dos et continua à courir jusqu’à une caverne, cachée dans les rochers, où la bande des quarante et son chef avaient élu domicile. Là une vieille, la mère justement du ravisseur de Zoumourroud, faisait le ménage des larrons et préparait leur nourriture. Ce fut donc elle qui, entendant le signal convenu, sortit à l’entrée de la caverne recevoir son fils et sa capture. Djiwân remit Zoumourroud à sa mère et lui dit : « Prends bien soin de cette gazelle jusqu’à mon retour, car je vais à la recherche de mes compagnons, afin qu’ils viennent la monter avec moi. Mais, comme nous ne serons pas revenus avant demain à midi, à cause de quelques exploits que nous avons à accomplir, je te charge de la bien nourrir pour qu’elle soit capable de supporter nos charges et nos assauts. » Et il s’en alla.
Alors la vieille s’approcha de Zoumourroud et lui porta à boire et lui dit : « Ma fille, quel bonheur pour toi de te sentir bientôt pénétrée dans ton milieu par quarante jeunes gaillards, sans compter leur chef qui est à lui seul plus solide qu’eux tous ! Par Allah ! que tu es heureuse d’être jeune et désirable ! » Zoumourroud ne put répondre et, s’enveloppant la tête de son voile, s’étendit par terre et resta ainsi jusqu’au matin.
Or, la nuit l’avait fait réfléchir ; et elle avait repris courage et s’était dit : « Quelle est donc cette indifférence condamnable vis-à-vis de moi-même dans un tel moment ? Me faudrait-il donc attendre sans bouger la venue de ces quarante bandits perforateurs, qui vont m’abîmer en me pénétrant et qui me rempliront comme l’eau remplit un navire jusqu’à ce qu’il s’enfonce au fond de la mer ! Non, par Allah ! je sauverai mon âme et je ne leur livrerai pas mon corps ! » Et comme déjà c’était le matin, elle se leva et, s’approchant de la vieille, elle lui baisa la main et lui dit : « Cette nuit m’a bien reposée, ma bonne mère, et je me sens ragaillardie et toute disposée à faire honneur à mes hôtes ! Que nous faut-il faire maintenant pour passer le temps jusqu’à leur arrivée ? Veux-tu, par exemple, venir avec moi au soleil et me laisser te chercher les poux de la tête et te lisser les cheveux, ma bonne mère ? » La vieille répondit : « Par Allah ! ton idée est excellente, ma fille, car depuis le temps que je suis dans cette caverne, je n’ai pu me laver la tête, et elle sert maintenant d’habitation à toutes les espèces de poux qui se logent dans les cheveux des hommes et les poils des animaux ; et, la nuit venue, ils sortent de ma tête et circulent en bande sur mon corps : il y en a de blancs et de noirs, de gros et de petits ; il y en a même, ma fille, qui ont une queue fort large et qui se promènent à rebours ; d’autres ont une odeur plus fétide que les vieilles vesses et les pets les plus puants ! Si donc tu arrives à me débarrasser de ces bêtes malfaisantes, ta vie avec moi sera fort heureuse ! » Et elle sortit avec Zoumourroud hors de la caverne et s’accroupit au soleil en enlevant le mouchoir qu’elle avait sur la tête. Zoumourroud alors put voir qu’en effet il y avait là toutes les variétés de poux connues et les autres également. Sans perdre courage, elle se mit donc à les enlever d’abord par poignées, puis à peigner les cheveux à la racine avec plusieurs grosses épines ; et, quand il ne resta plus qu’une quantité normale de ces poux, elle se mit à les chercher avec des doigts agiles et nombreux et à les écraser entre deux ongles, comme à l’ordinaire. Cela fait, elle lui lissa les cheveux lentement, si lentement que la vieille se sentit délicieusement envahie par la tranquillité de sa propre peau nettoyée, et finit par s’assoupir profondément.
Sans perdre de temps, Zoumourroud se leva et courut à la caverne où elle prit des vêtements d’homme dont elle s’affubla ; elle s’entoura la tête d’un beau turban, un de ceux qui venaient des vols commis par les quarante, et ressortit en hâte pour aviser un cheval, également volé, qui paissait par là, les deux pieds attachés ; elle le sella et le brida, sauta dessus à califourchon, et le mit au grand galop, droit devant elle, en invoquant le Maître de la délivrance.
Elle galopa ainsi, sans répit, jusqu’à la tombée de la nuit ; et le lendemain matin, dès l’aube, elle reprit sa course, ne s’arrêtant que de temps à autre pour se reposer, manger quelques racines et laisser paître son cheval. Et elle continua de la sorte pendant dix jours et dix nuits.
Vers le matin du onzième jour, elle sortit enfin du désert qu’elle venait de traverser, et elle déboucha dans une verdoyante prairie où couraient de belles eaux et où s’égayaient les regards au spectacle des grands arbres, des ombrages et des roses et des fleurs qu’un climat printanier faisait là pousser par milliers ; là s’ébattaient aussi des oiseaux de la création et paissaient par troupeaux les gazelles et les plus jolis des animaux.
Zoumourroud se reposa une heure en cet endroit délicieux, puis elle remonta à cheval et suivit une route fort belle qui courait entre les massifs de verdure et conduisait à une grande ville dont au loin, sous le soleil, brillaient les minarets.
Lorsqu’elle fut proche des murs et de la porte de la ville, elle vit une foule immense qui, à sa vue, se mit à pousser des cris délirants de joie et de triomphe ; et, aussitôt, de la porte sortirent et vinrent à sa remontre des émirs à cheval et des notables et des chefs de soldats qui se prosternèrent et embrassèrent la terre avec les marques de la soumission des sujets à leur roi, tandis que, de tous côtés, une clameur immense s’élevait de la multitude délirante : « Qu’Allah donne la victoire à notre sultan ! Que ta bienvenue apporte la bénédiction au peuple des musulmans, ô roi de l’univers ! Qu’Allah consolide ton règne, ô notre roi ! » Et, en même temps, des milliers de guerriers à cheval firent la haie sur deux rangs, pour écarter et maintenir la foule à la limite de l’enthousiasme, et un crieur public, juché sur un chameau richement caparaçonné, annonçait au peuple, de toute sa voix, l’arrivée heureuse de son roi !
Mais Zoumourroud, toujours déguisée en cavalier, ne comprenait guère ce que tout cela pouvait signifier, et elle finit par demander aux grands dignitaires qui avaient pris les rênes du cheval, de chaque côté : « Qu’y a-t-il donc, honorables seigneurs, dans votre ville ? Et que me voulez-vous ? » Alors, d’entre tous ceux-là, s’avança un grand chambellan qui, après s’être incliné jusqu’à terre, dit à Zoumourroud : « Le Donateur, ô notre maître, n’a point compté ses grâces en te les accordant ! Louanges Lui soient rendues ! Il t’amène par la main jusqu’à nous pour te placer comme notre roi sur le trône de ce royaume ! Louanges à Lui qui nous donne un roi si jeune et si beau, de la noble race des enfants des Turcs, au brillant visage ! Gloire à Lui ! car s’il nous avait envoyé quelque mendiant ou toute autre personne de peu d’importance, nous eussions été également forcés de l’accepter comme notre roi et de lui rendre hommage. Sache, en effet…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Sache, en effet, que notre usage, à nous habitants de cette ville, lorsque notre roi meurt sans laisser d’enfant mâle, est de nous rendre sur cette route-ci et d’attendre l’arrivée du premier passant que nous envoie le destin, pour l’élire notre nouveau roi et le saluer comme tel ! Et nous avons aujourd’hui le bonheur de te rencontrer, ô toi le plus beau de tous les rois de la terre, et l’unique de ton siècle et de tous les siècles ! »
Or, Zoumourroud, qui était une femme de tête et d’idées excellentes, ne se laissa pas décontenancer par cette nouvelle si extraordinaire, et elle dit au grand-chambellan et aux autres dignitaires : « Ô vous tous, mes sujets désormais fidèles, ne croyez point tout de même que je sois quelque Turc de naissance obscure ou quelque fils de roturier. Au contraire ! Vous avez devant vous un Turc de haute lignée qui a fui son pays et sa maison, après s’être brouillé avec ses parents, et qui a résolu de parcourir le monde en cherchant des aventures. Et comme justement le destin me fait rencontrer une occasion assez belle de voir du nouveau, je consens à être votre roi ! »
Aussitôt elle se mit à la tête du cortège et, au milieu des acclamations et des cris de joie de tout un peuple, elle fit dans la ville son entrée triomphale.
Lorsqu’elle fut arrivée devant la grande porte du palais, les émirs et les chambellans mirent pied à terre et vinrent la soutenir sous les bras et l’aidèrent à descendre de cheval, et la transportèrent sur leurs bras dans la grande salle de réception et la firent s’asseoir, l’ayant revêtue des attributs royaux, sur le trône d’or des anciens rois. Et tous ensemble se prosternèrent et embrassèrent la terre entre ses mains, en prononçant le serment de soumission.
Alors Zoumourroud commença son règne en faisant ouvrir les trésors royaux accumulés depuis les siècles ; et elle en fit tirer des sommes considérables qu’elle distribua aux soldats, aux pauvres et aux indigents. Aussi le peuple l’aima-t-il et fit-il des vœux pour la durée de son règne. Et, d’autre part, Zoumourroud n’oublia pas non plus de faire cadeau d’une grande quantité de robes d’honneur aux dignitaires du palais, et d’accorder des faveurs aux émirs et aux chambellans ainsi qu’à leurs épouses et à toutes les femmes du harem. En outre, elle abolit les perceptions d’impôts, les octrois et les contributions, et fit élargir les prisonniers et redressa tous les torts. Et de la sorte elle gagna l’affection des grands et des petits, qui tous la prenaient pour un homme et s’émerveillaient de sa continence et de sa chasteté en apprenant qu’elle n’entrait jamais dans le harem et ne couchait jamais avec ses femmes. En effet, elle n’avait voulu prendre à son service particulier de nuit que deux gentils petits eunuques qu’elle faisait coucher en travers de sa porte.
Bien loin d’être heureuse, Zoumourroud ne faisait que penser à son bien-aimé Alischar qu’elle ne put retrouver malgré toutes les recherches qu’elle fit faire secrètement. Aussi elle ne cessait de pleurer toute seule et de prier et de jeûner, pour attirer la bénédiction du Très-Haut sur Alischar et obtenir de le retrouver sain et sauf, après l’absence. Et elle resta ainsi une année ; si bien que toutes les femmes du palais levaient les bras de désespoir et s’écriaient : « Quel malheur sur nous que le roi soit si dévot et si continent ! »
Au bout de l’année, Zoumourroud eut une idée, et voulut tout de suite la mettre à exécution. Elle fit appeler les vizirs et les chambellans et leur ordonna de faire aplanir par les architectes et les ingénieurs un vaste meidân long d’un parasange et large d’autant, et de faire construire en son milieu un magnifique pavillon en dôme qui serait richement tapissé et où seraient placés un trône et autant de sièges qu’il y avait de dignitaires dans le palais.
L’ordre de Zoumourroud fut exécuté en fort peu de temps. Et, le meidân tracé et le pavillon élevé et le trône et les sièges disposés dans l’ordre hiérarchique, Zoumourroud y convoqua tous les grands de la ville et du palais, et leur donna un festin qui de mémoire de vieillard n’avait eu son pareil dans le royaume. Et, à la fin du festin, Zoumourroud se tourna vers les invités et leur dit : « Désormais, durant tout mon règne, je vous convoquerai dans ce pavillon au commencement de chaque mois, et vous prendrez place sur vos sièges, et je convoquerai également tout mon peuple, afin qu’il prenne part au festin et qu’il mange et boive et remercie le Créateur pour ses dons ! » Et tous lui répondirent par l’ouïe et l’obéissance. Alors elle ajouta : « Les crieurs publics appelleront mon peuple au festin, et l’aviseront que quiconque refusera de venir sera pendu ! »
Donc, au commencement du mois, les crieurs publics parcoururent les rues de la ville en criant : « Ô vous tous, marchands et acheteurs, riches et pauvres, affamés ou rassasiés, par l’ordre de notre maître le roi, accourez au pavillon du meidân. Vous y mangerez et vous y boirez et vous bénirez le Bienfaiteur. Et pendu sera quiconque ne s’y rendra ! Fermez vos boutiques et cessez la vente et les achats ! Quiconque refusera pendu sera ! »
À cette invitation, la foule accourut et se massa dans le pavillon en flots pressés, au milieu de la salle, alors que le roi était assis sur son trône et que, tout autour de lui, sur leurs sièges respectifs, étaient hiérarchiquement rangés les grands et les dignitaires. Et tous se mirent à manger toutes sortes de choses excellentes, telles que moutons rôtis, riz au beurre, et surtout de cet excellent mets appelé « kisck », préparé au blé pulvérisé et au lait fermenté. Et pendant qu’ils mangeaient, le roi les examinait attentivement, l’un après l’autre, et si longtemps, que chacun disait à son voisin : « Par Allah ! je ne sais pour quel motif le roi me regarde avec obstination ! » Et les grands et les dignitaires, pendant ce temps, ne cessaient d’encourager tous ces gens, leur disant : « Mangez sans honte et rassasiez-vous ! Vous ne pouvez faire plus grand plaisir au roi que de lui montrer votre appétit ! » Et eux se disaient : « Par Allah ! de notre vie nous n’avons vu un roi aimer à ce point son peuple et lui vouloir tant de bien ! »
Or, parmi les gloutons qui mangeaient avec le plus d’ardente voracité, faisant disparaître dans leur gosier des plateaux entiers, se trouvait le misérable chrétien Barssoum qui avait endormi Alischar et volé Zoumourroud, aidé de son frère le vieux Rachideddîn. Lorsque ce Barssoum eut fini de manger la viande et les mets au beurre ou au gras, il avisa un plateau, placé hors de portée de sa main, et qui était rempli d’un admirable riz à la crème, saupoudré de sucre fin et de cannelle ; il bouscula tous ses voisins et atteignit le plateau qu’il attira à lui et plaça sous sa main, et en prit une énorme bouchée qu’il engouffra dans sa bouche. Alors, l’un de ses voisins, scandalisé, lui dit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors l’un de ses voisins, scandalisé, lui dit : « N’as-tu donc pas honte de tendre la main vers ce qui est loin de ta portée, et de t’emparer pour toi seul d’un si grand plateau ? Ignores-tu donc que la politesse nous enseigne de ne manger que ce qui est devant nous ? » Et un autre voisin ajouta : « Puisse ce mets te peser sur le ventre et bouleverser tes tripes ! » Et un amusant bonhomme, grand mangeur de haschich lui dit : « Hé, par Allah ! partageons ! Approche-moi ça, que j’en prenne une bouchée ou deux ou trois ! » Mais Barssoum lui jeta un regard de mépris et lui cria violemment : « Ah ! maudit mangeur de haschich, ce noble mets n’est pas fait pour ta mâchoire ; il est destiné au palais des émirs et des gens délicats ! » Et il s’apprêtait à plonger ses doigts dans la délicieuse pâte, quand Zoumourroud, qui l’observait depuis un certain temps, le reconnut et dépêcha vers lui quatre gardes, en leur disant : « Courez vite vous emparer de cet individu qui mange du riz au lait, et amenez-le-moi ! » Et les quatre gardes se précipitèrent sur Barssoum, lui arrachèrent des doigts la bouchée qu’il s’apprêtait à avaler, le jetèrent la face contre terre, et le traînèrent par les jambes devant le roi, au milieu des spectateurs étonnés qui cessèrent aussitôt de manger en se chuchotant les uns aux autres : « Voilà ce que c’est que de faire le glouton et de s’emparer de la nourriture d’autrui ! » Et le mangeur de haschich dit à ceux qui l’entouraient : « Par Allah ! j’ai bien fait de ne pas manger avec lui de cet excellent riz à la cannelle ! Qui sait la punition qui va lui être infligée ? » Et tous se mirent à regarder attentivement ce qui allait se passer.
Zoumourroud, les yeux intérieurement allumés, demanda à l’homme : « Dis-moi, toi, l’homme aux mauvais yeux bleus, quel est ton nom, et quel est le motif de ta venue dans notre pays ? » Le misérable chrétien qui s’était coiffé du turban blanc, privilège des seuls musulmans, dit : « Ô notre maître le roi, je m’appelle Ali, et j’exerce le métier de passementier. Je suis venu dans ce pays pour exercer mon métier, et gagner ma vie du travail de mes mains ! »
Alors Zoumourroud dit à l’un de ses petits eunuques : « Va vite me chercher ma table de sable divinatoire et la plume de cuivre qui me sert à y tracer les lignes géomantiques ! » Et, son ordre aussitôt exécuté, Zoumourroud étendit soigneusement le sable divinatoire sur la surface plane de la table et, avec la plume de cuivre, y traça la figure d’un singe et quelques lignes de caractères inconnus. Après quoi, elle réfléchit pendant quelques instants, puis releva soudain la tête et, d’une voix terrible qui fut entendue de toute la foule, elle cria au misérable : « Ô chien, comment oses-tu mentir aux rois ?
« N’es-tu point chrétien et ton nom n’est-il pas Barssoum ? Et n’es-tu donc pas venu dans ce pays pour te mettre à la recherche d’une esclave volée par toi dans le temps ? Ah ! chien ! Ah ! maudit ! tu vas tout de suite avouer la vérité que vient de me révéler si clairement mon sable divinatoire ! »
À ces paroles, le chrétien terrifié croula sur le sol, les mains jointes, et dit : « Grâce ! ô roi du temps, tu ne te trompes pas ! Je suis, en effet — préservé sois-tu de tout mal ! — un ignoble chrétien, et je suis venu ici dans l’intention de ravir une musulmane que j’avais volée et qui s’était enfuie de notre maison ! »
Alors Zoumourroud, au milieu des murmures d’admiration de tout le peuple qui disait : « Ouallah ! il n’y a pas dans le monde un géomancien liseur de sable comparable à notre roi ! » appela le porte-glaive et ses aides et leur dit : « Emmenez ce misérable chien hors de la ville, écorchez-le vif, empaillez-le avec du foin de mauvaise qualité, et revenez clouer cette peau à la porte du meidân ! Quant à son cadavre, il faut le brûler avec des excréments desséchés, et enfouir ce qui en restera dans la fosse aux ordures ! » Et ils répondirent par l’ouïe et l’obéissance, emmenèrent le chrétien, et l’exécutèrent selon la sentence que le peuple trouva pleine de justice et de sagesse.
Quant aux voisins qui avaient vu le misérable manger du riz au lait, ils ne purent s’empêcher de se communiquer mutuellement leurs impressions. L’un dit : « Ouallah ! jamais plus de ma vie je ne me laisserai tenter par ce plat que pourtant j’aime à l’extrême. Il porte malheur ! » Et le mangeur de haschich, se tenant le ventre tant il avait des coliques de terreur, s’écria : « Hé ! ouallah ! ma bonne destinée m’a préservé de toucher à ce maudit riz à la cannelle ! » Et tous jurèrent de ne jamais plus prononcer le mot de riz à la crème !
En effet, quand vint le mois suivant et que le peuple fut de nouveau convoqué à prendre part au festin en présence du roi, il y eut un grand vide autour du plateau qui contenait le riz à la crème, et personne ne voulut même regarder de ce côté. Puis tout le monde, pour faire plaisir au roi, qui observait chaque convive avec la plus grande attention, se mit à manger et à boire et à se réjouir, mais chacun en ne touchant qu’aux mets placés devant lui.
Sur ces entrefaites, entra un homme à l’aspect effrayant qui s’avança rapidement en bousculant tout le monde sur son passage, et qui, voyant toutes les places prises excepté à l’entour du plateau de riz à la crème, vint s’accroupir devant ce plateau et, au milieu de l’effarement général, se disposa à tendre la main pour en manger.
Or, Zoumourroud aussitôt reconnut en cet homme son ravisseur le terrible Djiwân le Kourde, l’un des quarante de la bande d’Ahmad Ed-Danaf. Le motif qui l’amenait en cette ville n’était autre que la recherche de l’adolescente dont la fuite l’avait mis dans une fureur épouvantable, alors qu’il s’était préparé à la monter avec ses compagnons. Et il s’était mordu la main de désespoir et avait fait le serment de la retrouver, fût-elle derrière le mont Caucase ou cachée comme la pistache dans sa coque. Et il était parti à sa recherche, et avait fini par arriver à la ville en question et entrer, avec les autres, dans le pavillon, pour ne pas être pendu…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… et entrer dans le pavillon pour ne pas être pendu.
Il s’assit donc en face du plateau de riz à la crème en question, et plongea sa main tout entière au beau milieu. Alors de toutes parts on lui cria : « Holà ! que vas-tu faire ! Prends garde ! Tu vas être écorché vif ! Ne touche pas à ce plat qui porte malheur ! » Mais l’homme roula des yeux terribles et leur cria : « Taisez-vous, vous autres ! Je veux manger de ce plat-là et m’en remplir le ventre. Je l’aime, ce riz doux à la crème ! » On lui cria encore : « Tu seras pendu écorché ! » Pour toute réponse il attira à lui encore davantage le plateau dans lequel il avait déjà plongé la main, et se pencha dessus. À cette vue, le mangeur de haschich, son plus proche voisin, s’enfuit épouvanté et dégrisé des vapeurs du haschich, pour aller s’asseoir plus loin, en protestant qu’il n’était pour rien dans ce qui allait se passer.
Donc, Djiwân le Kourde, après avoir plongé dans le plateau sa main noire comme la patte du corbeau, la sortit énorme et pesante comme le pied du chameau. Il arrondit dans sa paume la prodigieuse poignée qu’il avait retirée, en fit une boule aussi grosse qu’un cédrat, et la lança d’un mouvement tournant au fond de son gosier où elle s’engloutit avec un fracas de tonnerre et comme le bruit d’une cascade dans une caverne sonore, tant que le dôme du pavillon résonna d’un écho retentissant qui se répercuta bondissant et rebondissant. Et la trace fut telle dans la masse où la bouchée avait été prise que le fond apparut à nu du grand plateau !
À cette vue, le mangeur de haschich leva les bras et s’écria : « Qu’Allah nous protège ! il a englouti le plateau d’une seule bouchée. Grâces soient rendues à Allah qui ne m’a pas créé riz au lait ou cannelle ou autre chose semblable entre ses mains ! » Et il ajouta : « Laissons-le manger à son aise, car déjà je vois sur son front se dessiner l’image de l’écorché et du pendu qu’il sera ! » Puis il se mit encore plus hors de portée de la main du Kourde, et lui cria : « Puisse ta digestion s’arrêter et t’étouffer, ô effroyable abîme ! » Mais le Kourde, sans prêter attention à ce qui se disait autour de lui, plongea une seconde fois ses doigts, aussi gros que des matraques, dans la masse tendre qui s’entr’ouvrit avec un claquement sourd, et il les retira avec, au bout, une grosse boule telle une courge ; et il la faisait déjà tourner dans sa paume avant que de l’engloutir, quand Zoumourroud dit aux gardes ; « Vite amenez-moi l’homme au riz avant qu’il n’avale la bouchée ! » Et les gardes bondirent sur le Kourde qui ne les voyait pas, courbé qu’il était de toute la moitié du corps sur le plateau. Et ils le renversèrent avec agilité et lui lièrent les bras derrière le dos, et le traînèrent devant le roi, tandis que les assistants se disaient : « Il a voulu lui-même sa propre perte. Nous lui avions bien conseillé de s’abstenir de toucher à ce néfaste riz à la crème ! »
Lorsqu’il fut devant elle, Zoumourroud lui demanda : « Quel est ton nom ? quel est ton métier ? et quel motif t’a poussé à venir dans notre ville ? » Il répondit : « Je m’appelle Othmân, et je suis jardinier de mon métier. Quant au motif de ma venue, c’est la recherche d’un jardin où travailler pour manger ! » Zoumourroud s’écria : « Qu’on m’apporte la table de sable et la plume de cuivre ! » Et lorsqu’elle eut les objets entre les mains, elle traça avec la plume des caractères et des figures sur le sable étalé, réfléchit et calcula une heure de temps, puis releva la tête et dit : « Malheur à toi, misérable menteur ! Mes calculs sur ma table de sable m’apprennent que de ton vrai nom tu t’appelles Djiwân le Kourde, et que de ton métier tu es bandit, voleur et assassin ! Ah ! cochon, fils de chien et de mille putains ! avoue tout de suite la vérité, ou les coups te la feront retrouver ! »
En entendant ces paroles du roi, qu’il était loin de soupçonner être l’adolescente ravie naguère par lui, il devint jaune de teint et ses mâchoires claquèrent et ses lèvres se contractèrent sur des dents qui apparurent tels des crocs de loup ou de quelque bête sauvage. Puis il pensa sauver sa tête en avouant la vérité, et dit : « Tu dis vrai, ô roi ! Mais je me repens sur tes mains dès cet instant, et je serai à l’avenir dans la bonne voie ! » Mais Zoumourroud lui dit : « I] ne m’est pas permis de laisser vivre une bête malfaisante sur le chemin des musulmans ! » Puis elle ordonna : « Qu’on l’emmène et qu’on l’écorche vif et qu’on l’empaille pour le clouer sur la porte du pavillon, et qu’on fasse subir à son cadavre le même sort qu’à celui du chrétien ! »
Lorsque le mangeur de haschich vit les gardes emmener l’homme en question, il se leva et tourna son derrière au plateau de riz et dit : « Ô riz à la crème, ô saupoudré de sucre et de cannelle, je te tourne le dos, car, ô plat de malheur, je ne te juge pas digne de mon regard, et à peine de mon derrière…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
» … car, ô plat de malheur, je ne te juge pas digne de mon regard, et à peine de mon derrière ! Je crache sur toi et t’abomine ! » Et voilà pour lui.
Mais pour ce qui est du troisième festin, voici ! Comme dans les deux circonstances précédentes, les crieurs firent la même annonce, et l’on fit les mêmes préparatifs ; puis le peuple se rassembla sous le pavillon, les grands se placèrent en ordre et le roi s’assit sur son trône. Et tout le monde se mit à manger, à boire et à se réjouir ; et la foule était massée partout, excepté devant le plateau de riz à la crème qui restait intact au milieu de la salle, ayant tous les dos des mangeurs tournés de son côté. Et soudain on vit entrer un homme à barbe blanche qui, voyant vide l’endroit tout autour du plateau, se dirigea de ce côté et s’assit pour manger, afin de n’être pas pendu. Et Zoumourroud le regarda et reconnut le vieux Rachideddîn, le misérable chrétien qui l’avait fait enlever par son frère Barssoum.
En effet, comme Rachideddîn, au bout d’un mois, ne voyait pas revenir son frère qu’il avait envoyé à la recherche de l’adolescente enfuie, il résolut de partir lui-même essayer de la retrouver, et le destin le conduisit dans cette ville jusqu’à ce pavillon, devant le plateau de riz à la crème.
Zoumourroud, en reconnaissant le maudit chrétien, pensa en elle-même : « Par Allah ! ce riz à la crème est un mets béni, puisqu’il me fait retrouver tous les êtres malfaisants. Il me faut un jour le faire crier par toute la ville comme mets obligatoire pour tous les habitants. Et je ferai pendre ceux qui ne l’aimeront pas ! En attendant, je vais m’occuper de ce vieux scélérat ! » Elle cria donc à ses gardes : « Amenez-moi l’homme au riz ! » Et les gardes, habitués maintenant, reconnurent l’homme aussitôt, et se précipitèrent sur lui et le traînèrent par la barbe devant le roi qui lui demanda : « Quel est ton nom ? quelle est ta profession ? et quel est le motif de ton arrivée parmi nous ? » II répondit : « Ô roi fortuné, je m’appelle Rustem, mais je n’ai point de profession si ce n’est d’être un pauvre, un derviche ! » Elle s’écria : « À moi, le sable et la plume ! » Et on les lui apporta. Et elle, après avoir étendu le sable et y avoir tracé des figures et des caractères, réfléchit une heure de temps, puis releva la tête et dit : « Tu mens devant le roi, chien maudit ! Ton nom est Rachideddîn ; ton métier est de faire enlever traîtreusement les femmes des musulmans et de les enfermer dans ta maison ; tu professes extérieurement la foi de l’Islam en restant au fond du cœur un misérable chrétien pourri de vices. Avoue la vérité ou ta tête va sur l’heure sauter à tes pieds ! » Et le misérable, terrifié, crut sauver sa tête et avoua ses crimes et ses hontes. Alors Zoumourroud dit aux gardes : « Renversez-le et appliquez-lui mille coups de bâton sur chaque plante des pieds ! » Et cela fut exécuté immédiatement. Elle dit alors : « Maintenant emmenez-le, arrachez-lui la peau, empaillez-la avec du foin pourri et clouez-la, avec les deux autres, à l’entrée du pavillon. Et faites subir à son cadavre le même sort qu’à celui des deux autres chiens ! » Et cela fut exécuté sur-le-champ.
Cela fait, tout le monde se remit à manger en s’émerveillant de la sagesse et de la science divinatoire du roi, et en vantant sa justice et son équité.
Lorsque le festin eut pris fin, le peuple s’écoula et la reine Zoumourroud rentra dans son palais. Mais elle n’était point heureuse intérieurement, et elle se disait : « Grâces soient rendues à Allah qui m’a apaisé le cœur en m’aidant à tirer vengeance de ceux qui m’avaient fait du mal ! Mais tout cela ne me rend pas mon bien-aimé Alischar ! Pourtant le Très-Haut est en même temps le Tout-Puissant, et il peut ce qui lui plait, à l’égard de ceux qui l’adorent et le reconnaissent pour leur seul Dieu ! » Et, émue au souvenir de son amoureux, elle versa d’abondantes larmes toute la nuit ; puis elle, s’enferma seule, avec sa douleur, jusqu’au commencement du mois suivant.
Alors le peuple fut encore rassemblé pour le festin accoutumé, et le roi et les dignitaires prirent place, comme à l’ordinaire, sous le dôme. Et déjà le festin était en train, et Zoumourroud désespérait de jamais retrouver son bien-aimé, et elle faisait en son âme cette prière : « Ô toi qui as rendu Youssouf à son vieux père Yâcoub, qui as guéri de ses plaies inguérissables le saint Ayoub, accorde-moi dans ta bonté de retrouver moi aussi mon bien-aimé Alischar. Tu es l’Omnipotent, ô Maître de l’univers ! Toi qui mets dans la bonne voie ceux qui sont dans l’égarement, toi qui écoutes toutes les voix, qui exauces tous les vœux, et qui fais succéder le jour à la nuit, rends-moi ton esclave Alischar ! »
À peine Zoumourroud avait-elle formulé intérieurement cette invocation, qu’un jeune homme entra par la porte du meidân, et sa taille flexible ployait comme sous la brise se balance le rameau du saule.
Il était beau comme est belle la lumière, mais il paraissait délicat et un peu pâle et fatigué. Il chercha partout une place où s’asseoir, et ne trouva libre que l’endroit autour du plateau de riz à la crème en question. Il vint y prendre place, et de tous côtés le suivaient les regards épouvantés de ceux qui le croyaient déjà perdu, et le voyaient écorché et pendu.
Or, Zoumourroud dès le premier regard reconnut Alischar. Et son cœur se mit à battre précipitamment, et elle faillit lancer un cri de joie. Mais elle réussit à vaincre ce mouvement irréfléchi, pour ne point s’exposer à se trahir devant son peuple. Pourtant elle était prise d’une grande émotion, et ses entrailles s’agitèrent, et son cœur battit de plus en plus fort. Et elle attendit de s’être calmée tout à fait avant que de faire venir Alischar.
Quant à Alischar, voici ! Lorsqu’il s’était réveillé…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsqu’il s’était réveillé, le jour était levé, et les marchands commençaient déjà à ouvrir le souk. Alischar, étonné de se voir étendu dans cette rue, porta la main à son front, et constata que son turban avait disparu, et son manteau également. Il commença alors & comprendre la réalité, et courut, fort ému, raconter sa mésaventure à la bonne vieille qu’il pria d’aller aux nouvelles. Elle y consentit de bon cœur, et partit pour revenir au bout d’une heure, le visage et les cheveux défaits, lui apprendre la disparition de Zoumourroud, et lui dire : « Je crois bien, mon enfant, que désormais tu dois renoncer à jamais retrouver ton amoureuse. Il n’y a de recours et de force dans les calamités qu’en Allah le Tout-Puissant ! Tout ce qui t’arrive est bien de ta faute ! »
À ces paroles, Alischar vit la lumière se changer en ténèbres devant son visage, et il désespéra de la vie, et souhaita mourir, et se mit à pleurer et à sangloter dans les bras de la bonne vieille, tellement qu’il s’évanouit. Puis, à force de bons soins, il reprit ses sens, mais ce fut pour s’aliter, atteint d’une grave maladie qui lui fit perdre le goût du sommeil et qui l’aurait certainement conduit droit à la tombe s’il n’avait eu la bonne vieille pour le soigner, l’aimer et l’encourager. Il resta ainsi fort malade durant la longueur d’une année, sans que la vieille le quittât un instant ; elle lui donnait à boire les sirops, et lui faisait bouillir les poulets, et lui faisait respirer les parfums vivifiants. Et lui, dans un état d’extrême faiblesse et de langueur, se laissait faire, et se récitait des vers fort tristes sur la séparation, dont ceux-ci entre mille :
« Les soucis s’accumulent, l’amour se désagrège, les larmes coulent et le cœur est brûlé.
« Le faix de la douleur pèse sur un dos qui ne peut le tolérer, sur un cœur épuisé par le désir d’aimer, par la passion sans chemin, et par les veilles continues.
« Seigneur Dieu, est-il encore moyen de me venir en aide ? Hâte-toi de me secourir avant que le souffle dernier de vie ne s’exhale d’un corps exténué ! »
Alischar resta donc en cet état sans espoir de guérir comme sans espoir de revoir Zoumourroud. Et la bonne vieille ne savait plus comment faire pour le tirer de sa torpeur, quand un jour elle lui dit : « Mon enfant, ce n’est point en continuant à te lamenter sans sortir de ta maison que tu pourras retrouver ton amie. Si tu veux me croire, lève-toi et raffermis tes forces et sors la chercher dans les villes et les contrées. On ne sait jamais le chemin d’où peut venir le salut ! » Et elle ne cessa de l’encourager de la sorte et de lui donner de l’espoir qu’elle ne l’eût obligé à se lever et à entrer au hammam, où elle lui donna elle-même le bain, et lui fit boire des sorbets, et lui fit manger un poulet. Et elle continua pendant un mois à le traiter de la sorte, si bien qu’il finit par être en état de voyager. Alors il fit ses adieux à la vieille, après avoir terminé ses préparatifs de départ, et se mit en route à la recherche de Zoumourroud. Et c’est ainsi qu’il finit par arriver dans la ville où Zoumourroud était roi, et par entrer dans le pavillon du festin et s’asseoir devant le plateau de riz à la crème saupoudré de sucre et de cannelle.
Comme il avait une grande faim, il releva ses manches jusqu’aux coudes, dit la formule « Bismillah » et se disposa à manger. Alors ses voisins, apitoyés de voir à quel danger il s’exposait, le prévinrent qu’il lui arriverait certainement malheur s’il avait la mauvaise chance de toucher à ce mets. Et, comme il s’obstinait, le mangeur de haschich lui dit : « Tu seras écorché et pendu, prends garde ! » Il répondit : « Bénie soit la mort qui me délivrera d’une vie pleine d’infortunes ! Mais auparavant je veux manger de ce riz à la crème ! » Et il tendit la main et se mit à manger de grand appétit.
Tout cela ! Et Zoumourroud qui, tout en émoi, l’observait, se dit : « Je veux d’abord le laisser assouvir sa faim, avant que de le faire venir ! » Et lorsqu’elle vit qu’il avait cessé de manger, et qu’il avait prononcé la formule : « Le merci à Allah ! » elle dit aux gardes : « Allez trouver tout doucement ce jeune homme qui est assis devant le plateau de riz à la crème, et priez-le, avec beaucoup de bonnes manières, de venir me parler, en lui disant : « Le roi vous demande pour une question et sa réponse, sans plus ! » Et les gardes vinrent s’incliner devant Alischar et lui dirent : « Seigneur, notre maître le roi te demande pour une question et une réponse, sans plus ! » Alischar répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il se leva et les accompagna devant le roi.
Pendant ce temps, les gens du peuple faisaient entre eux mille conjectures. Les uns disaient : « Quel malheur pour sa jeunesse ! Qui sait ce qui va lui arriver ! » Mais d’autres répondaient : « S’il devait lui arriver malheur, le roi ne l’aurait pas laissé manger à satiété ! Il l’aurait fait arrêter dès la seconde bouchée ! » Et d’autres disaient : « Les gardes ne l’ont pas traîné par les pieds ou par les habits ! Ils l’ont accompagné, en le suivant respectueusement à distance ! »
Tout cela, pendant qu’Alischar se présentait devant le roi. Là il s’inclina et embrassa la terre entre les mains du roi, qui lui demanda, d’une voix tremblante et fort douce : « Quel est ton nom, ô tendre jouvenceau ? quel est ton métier ? et quel motif t’a obligé à quitter ton pays pour ces contrées lointaines ? » Il répondit : « Ô roi fortuné, je m’appelle Alischar fils de Gloire, et je suis un d’entre les enfants des marchands, dans le pays de Khorassân. Ma profession était celle de mon père, mais il y a longtemps que les calamités m’y firent renoncer. Quant au motif de ma venue dans ce pays…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Quant au motif de ma venue dans ce pays, c’est la recherche d’une personne aimée que j’ai perdue, et qui m’était plus chère que ma vue et mon ouïe et mon âme ! Et depuis qu’elle m’a été prise, je vis comme un somnambule ! Et telle est ma lamentable histoire ! » Et Alischar, en achevant ces paroles, fondit en larmes, et fut pris d’un tel hoquet qu’il tomba évanoui.
Alors Zoumourroud, à la limite de l’attendrissement, ordonna à ses deux petits eunuques de lui asperger le visage avec de l’eau de roses. Et les deux petits esclaves aussitôt exécutèrent l’ordre, et Alischar revint à lui en sentant l’eau de roses. Alors Zoumourroud dit : « Maintenant qu’on m’apporte la table de sable et la plume de cuivre ! » Et elle prit la table et elle prit la plume, et, après avoir tracé des lignes et des caractères et réfléchi pendant une heure de temps, elle dit doucement, mais de façon à être entendue de tout le peuple : « Ô Alischar fils de Gloire, le sable divinatoire confirme tes paroles. Tu dis la vérité. Aussi je puis te prédire que bientôt Allah te fera retrouver ta bien-aimée ! Que ton âme s’apaise et que ton cœur se rafraîchisse ! » Puis elle leva la séance, et ordonna aux deux petits esclaves de le conduire au hammam, et de le revêtir après le bain d’une robe de l’armoire royale, de le faire monter sur un cheval des écuries royales, et de le lui ramener à l’entrée de la nuit ! Et les deux petits eunuques répondirent par l’ouïe et l’obéissance, et se hâtèrent d’exécuter l’ordre de leur roi.
Quant aux gens du peuple qui avaient assisté à toute cette scène et entendu les ordres donnés, ils se demandèrent les uns aux autres : « Quel motif secret a donc poussé le roi à traiter ce joli jouvenceau avec tant d’égards et de douceur ? » D’autres répondirent : « Par Allah ! le motif est tout indiqué : le garçon est fort beau ! » Et d’autres dirent : « Nous avons prévu ce qui allait se passer, rien qu’en voyant le roi le laisser assouvir sa faim à ce plateau de riz à la crème douce ! Ouallah ! nous n’avions jamais entendu dire que le riz à la crème pût produire de pareils prodiges ! » Et ils s’en allèrent, chacun donnant son avis ou lâchant un bon mot.
Quant à Zoumourroud, elle attendit avec une impatience inimaginable l’entrée de la nuit, pour pouvoir enfin s’isoler avec le bien-aimé de son cœur. Aussi à peine le soleil eut-il disparu et les muezzins eurent-ils appelé les croyants à la prière, Zoumourroud se déshabilla et s’étendit sur sa couche, ne gardant pour tout vêtement que sa chemise de soie. Et elle abaissa les rideaux, pour être dans l’ombre, et ordonna aux deux eunuques de faire entrer Alischar qui attendait dans le vestibule.
Quant aux chambellans et aux dignitaires du palais, ils ne doutèrent plus des intentions du roi en le voyant traiter de cette façon inaccoutumée le bel Alischar. Et ils se dirent : « Il est maintenant bien certain que le roi est épris de ce jouvenceau. Et sûrement demain, après sa nuit avec lui, il le nommera chambellan ou général d’armée ! » Et voilà pour eux.
Quant à Alischar, voici ! Lorsqu’il fut en présence du roi, il embrassa la terre entre ses mains, en lui adressant ses hommages et lui offrant ses vœux, et il attendit d’être interrogé. Alors Zoumourroud pensa en son âme : « Je ne puis lui révéler tout de suite qui je suis ; car, s’il me reconnaissait subitement, il mourrait d’émotion. Elle se tourna donc vers lui, et lui dit : « Ô gentil jouvenceau, viens plus près de moi ! Dis ! as-tu été au hammam ? » Il répondit : « Oui, ô mon seigneur ! » Elle reprit : « T’es-tu lavé partout et parfumé et rafraîchi ? » Il répondit : « Oui, ô mon seigneur ! » Elle demanda : « Sûrement le bain a dû exciter ton appétit, ô Alischar ! Voici, à portée de ta main, sur ce tabouret, un plateau rempli de poulets et de pâtisseries. Commence d’abord par apaiser ta faim ! » Alors Alischar répondit par l’ouïe et l’obéissance, et mangea son plein, et fut content. Et Zoumourroud lui dit : « Tu dois avoir soif maintenant ! Voici, sur le second tabouret, le plateau des boissons. Bois ta soif, et puis viens tout près de moi ! » Et Alischar but une tasse de chaque pot de boisson, et, fort timidement, s’approcha de la couche du roi.
Alors le roi lui prit la main et lui dit : « Tu me plais beaucoup, ô jouvenceau ! Tu as une jolie figure, et j’aime les jolies figures ! Baisse-toi et commence par me masser les pieds ! » Et Alischar se baissa, et, relevant ses manches, se mit à masser les pieds du roi.
Au bout d’un certain temps, le roi lui dit : « Masse-moi maintenant les jambes et les cuisses ! » Et Alischar fils de Gloire se mit à masser les jambes et les cuisses du roi. Et il fut étonné à la fois et émerveillé de leur trouver une tendreté et une souplesse et une blancheur sans pareilles. Et il se disait : « Ouallahi ! les cuisses des rois sont bien blanches ! Et puis elles n’ont pas de poils ! »
À ce moment, Zoumourroud lui dit : « Ô joli jouvenceau, aux mains si expertes dans l’art du massage, allonge tes mouvements jusqu’à mon nombril, en passant par le milieu ! » Mais Alischar s’arrêta soudain dans son massage, et, fort intimidé, dit : « Excuse-moi, mon seigneur, mais je ne sais point faire le massage du corps plus haut que les cuisses. Tout ce que je sais, je te l’ai fait…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TRENTIÈME NUIT
Elle dit :
« … plus haut que les cuisses. Tout ce que je sais, je te l’ai fait ! »
À ces paroles, Zoumourroud prit un ton de voix fort courroucé, et s’écria : « Comment ! Tu oses me désobéir ? Par Allah ! si tu hésites encore, ta nuit sera bien néfaste sur ta tête ! Hâte-toi donc de t’incliner et de satisfaire à mon désir ! Et moi, en retour, je ferai de toi mon amant en titre, et je te nommerai émir entre les émirs et chef d’armée entre les chefs de mes armées ! » Alischar demanda : « Je ne comprends pas exactement ce que tu veux, ô roi ! Que faut-il que je fasse pour t’obéir ? » Elle répondit : « Défais ton caleçon et étends-toi sur la figure ! » Alischar s’écria : « C’est là une chose que de ma vie je n’ai faite ! Si donc tu veux me forcer à la commettre, je t’en demanderai compte au jour de la Résurrection. Laisse-moi donc sortir d’ici et m’en aller dans mon pays ! » Mais Zoumourroud reprit, d’un ton encore plus furieux : « Je t’ordonne de mettre bas ton caleçon et de te coucher sur le visage, sinon je te fais sur l’heure trancher la tête ! Viens donc, ô jouvenceau, et dors avec moi ! Tu ne t’en repentiras pas ! »
Alors Alischar, désespéré, ne put faire autrement que d’obéir. Il mis bas son caleçon et se coucha sur le visage. Aussitôt Zoumourroud le prit dans ses bras et, montant sur lui, elle s’étendit tout de son long sur le dos d’Alischar.
Lorsque Alischar vit le roi peser avec cette impétuosité sur son dos, il se dit : « Il va m’abîmer sans recours ! » Mais bientôt il sentit sur lui, légèrement, quelque chose de doux qui le caressait, comme de la soie ou du velours, quelque chose de tendre à la fois et d’arrondi, au toucher beurré à la fois et ferme, et il se dit : « Ouallah ! ce roi a une peau préférable à celle de toutes les femmes ! » Et il attendit le moment redoutable. Mais, au bout d’une heure qu’il était dans cette posture sans rien sentir d’effroyable et de perforant, il vit le roi se détacher soudain de son dos, et s’étendre lui-même sur le dos, à ses côtés. Et il pensa : « Béni et glorifié soit Allah qui n’a pas permis à son zebb de s’ériger ! Que serais-je devenu si cela avait réussi ! » Et il commençait à respirer plus à son aise, quand le roi lui dit : « Sache, ô Alischar, que mon zebb est habitué à s’ériger seulement quand on le manipule avec les doigts ! Il te faut donc me le manipuler ou tu es un homme mort ! Allons ! donne ta main ! » Et, toujours étendue sur le dos, Zoumourroud prit la main d’Alischar fils de Gloire, et la posa doucement sur la rotondité de son histoire ! Et Alischar, à ce toucher, sentit une rondeur haute comme un trône, et grasse comme un poulet, et plus chaude que la gorge du pigeon, et plus brûlante qu’un cœur brûlé par la passion ; et cette rondeur était lisse et blanche et fondante et énorme ! Et soudain il la sentit, sous ses doigts, se cabrer comme un mulet piqué aux naseaux, ou comme un âne aiguillonné au milieu du dos !
À cette constatation, Alischar, à la limite de l’étonnement, pensa en son âme : « Ce roi a une fente, c’est certain ! C’est là la chose la plus prodigieuse d’entre tous les prodiges ! » Et Alischar, enhardi par cette trouvaille qui lui enlevait ses dernières hésitations, se mit soudain à s’ériger quant à son zebb, et cela à l’extrême limite de l’érection !
Or, Zoumourroud n’attendait que ce moment-là ! Et tout à coup elle éclata de rire quant à son gosier, et tellement qu’elle serait tombée à la renverse si elle n’eût été à la renverse déjà. Puis elle dit à Alischar : « Comment se fait-il que tu ne reconnaisses pas ta servante, ô mon maître bien-aimé ? » Mais Alischar ne comprenait pas encore, et demanda : « Quelle servante et quel maître, ô roi du temps ? » Elle répondit : « Ô Alischar, je suis Zoumourroud, ton esclave ! Ne me reconnais-tu pas à tous ces signes-là ! »
À ces paroles, Alischar regarda plus attentivement le roi, et reconnut en lui sa bien-aimée Zoumourroud. Et il la prit dans ses bras et l’embrassa avec les plus grands transports de joie. Et Zoumourroud lui demanda : « Maintenant opposeras-tu encore de la résistance ? » Et Alischar, pour toute réponse, fondit sur elle comme le lion sur la brebis, et, reconnaissant la route, il enfonça le bâton du berger dans le sac à provisions, et alla de l’avant sans se soucier de l’étroitesse du sentier. Et, arrivé au terme de la route, il resta longtemps droit et rigide, portier de cette porte et imam de ce mihrab. Et elle, de son côté, ne le quittait pas d’un doigt, et s’élevait avec lui, et s’agenouillait, et roulait, et se relevait, et haletait, en suivant le mouvement. Et à la câlinerie répondait la câlinerie, et au remous un second remous, et diverses agaceries, minauderies et coquetteries ! Et ils se répondaient par de tels soupirs et de tels cris, que les deux petits eunuques, attirés par le bruit, soulevèrent le rideau pour voir si le roi n’avait pas besoin de leurs services. Et devant leurs yeux effarés apparut le spectacle de leur roi étendu sur le dos avec, le couvrant intimement, le jouvenceau, en diverses poses mouvementées, donnant la réplique aux ronflements par des ronflements, aux assauts par des coups de lance, aux incrustations par des coups de ciseau, et aux remuements par des agitations.
À cette vue, les deux eunuques…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TRENTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… À cette vue, les deux eunuques se hâtèrent de s’éloigner silencieusement, en se disant : « Il est certain que ces façons de faire du roi ne sont point des façons d’un homme, mais d’une femme en délire ! » Mais ils se gardèrent bien de divulguer aux autres ce secret.
Lorsque vint le matin, Zoumourroud se revêtit de ses habits royaux et fit assembler dans la grande cour du palais ses vizirs, ses chambellans, ses conseillers, ses émirs, ses chefs d’armée, et les notables d’entre les habitants, et leur dit ; « Je vous permets, ô vous tous, mes sujets fidèles, d’aller dès aujourd’hui sur la route où vous m’avez rencontré, et de chercher quelqu’un d’autre pour l’élire comme votre roi à ma place. Moi, j’ai résolu d’abdiquer la royauté et de m’en aller vivre dans le pays de cet adolescent, que j’ai choisi comme ami pour la vie ; car je veux lui donner tous mes instants comme je lui ai donné mon affection. Ouassalam ! »
À ces paroles, les assistants lui répondirent par l’ouïe et l’obéissance ; et les esclaves aussitôt s’empressèrent, en rivalisant de zèle, de faire les préparatifs du départ, et remplirent, des caisses et des caisses de provisions de route, de richesses, de bijoux, de robes, de choses somptueuses, et d’or et d’argent, et les chargèrent sur le dos des mulets et des chameaux. Et, sitôt tout cela prêt, Zoumourroud et Alischar montèrent sur un palanquin de velours et de brocart porté par un dromadaire, et, suivis des deux petits eunuques seulement, ils retournèrent dans le Khorassân, dans la ville où se trouvaient leur maison et leurs parents. Et ils y arrivèrent en toute sécurité ; et Alischar fils de Gloire ne manqua pas de faire de grandes largesses aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, et de distribuer des cadeaux extraordinaires à ses amis, à ses connaissances et à ses voisins. Et tous deux vécurent de nombreuses années, au milieu de beaucoup d’enfants que leur octroya le Donateur. Et ils furent à la limite des joies et des félicités, jusqu’à ce que vînt les visiter la destructrice des plaisirs et la séparatrice des amants ! Gloire à Celui qui demeure dans son éternité ! Et béni soit Allah, dans tous les cas !
— Mais, continua Schahrazade en s’adressant au roi Schahriar, ne crois point un instant que cette histoire soit plus délicieuse que l’Histoire des Six Adolescentes aux couleurs différentes ! Et si les vers n’y sont pas de beaucoup plus admirables que tous ceux que tu as déjà entendus, tu me feras couper la tête sans différer davantage !
Et Schahrazade dit :
HISTOIRE DES SIX ADOLESCENTES
AUX COULEURS DIFFÉRENTES
On raconte qu’un jour d’entre les jours l’émir des
Croyants El-Mâmoun s’assit sur son trône, dans la
salle de son palais, et fit rassembler entre ses mains,
outre ses vizirs, ses émirs et les principaux chefs de
son empire, tous les poètes et tous les gens d’esprit
délicieux dont il avait fait ses intimes. Or, le plus intime
d’entre les plus intimes de ceux qui se trouvaient
là réunis, était Môhammad El-Bassri. Et le
khalifat El-Mâmoun se tourna vers lui et lui dit :
« Ô Môhammad, j’ai bien envie de t’entendre me raconter
à cette heure quelque histoire jamais entendue ! »
Il répondit : « Ô émir des Croyants, la chose
est facile ! Mais veux-tu de moi une histoire que j’aie
ouïe de mes oreilles, ou bien quelque fait que, témoin,
j’aie observé de mes yeux ? » Et El-Mâmoun
dit : « Ô Môhammad, il n’importe ! Mais je veux le
plus merveilleux ! » Alors Môhammad El-Bassri dit :
Sache, ô émir des Croyants, que j’ai connu, ces temps derniers, un homme de fortune considérable, natif de l’Yamân, qui avait quitté son pays pour venir habiter dans Baghdad, notre ville, afin d’y mener une vie agréable et tranquille. Il s’appelait Ali El-Yamani. Et comme, au bout d’un certain temps, il avait trouvé les mœurs de Baghdad absolument à sa convenance, il fit venir de l’Yamân ses effets en entier, ainsi que son harem composé de six jeunes esclaves belles comme autant de lunes.
La première de ces adolescentes était blanche, la seconde brune, la troisième grasse, la quatrième mince, la cinquième blonde et la sixième noire. Et toutes les six, en vérité, étaient à la limite des perfections, avaient l’esprit orné de la connaissance des belles-lettres, et excellaient dans l’art de la danse et des instruments d’harmonie.
L’adolescente blanche s’appelait…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TRENTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
L’adolescente, blanche s’appelait Visage-de-Lune ; la brune, s’appelait Flamme-du-Brasier ; la grasse, Pleine-Lune ; la mince, Houria-du-Paradis ; la blonde, Soleil-du-Jour ; la noire, Prunelle-de-l’Œil.
Or, un jour, Ali El-Yamani, heureux de la quiétude goûtée dans la délectable Baghdad, et se sentant dans des dispositions d’esprit meilleures encore que d’habitude, invita ses six esclaves à la fois à venir dans la salle de réunion lui tenir compagnie et passer le temps à boire, à s’entretenir et à chanter avec lui. Et toutes les six se présentèrent aussitôt entre ses mains ; et par toutes sortes de jeux, de réjouissances et d’amusements, ils se délectèrent ensemble infiniment.
Lorsque la gaieté régna sans mélange parmi eux, Ali El-Yamani prit une coupe, la remplit de vin, et, se tournant vers Visage-de-Lune, lui dit : « Ô blanche et aimable esclave, ô Visage-de-Lune, fais-nous entendre quelques accords délicats de ta ravissante voix ! » Et Visage-de-Lune, l’esclave blanche, prit un luth, en harmonisa les sons et y exécuta quelques préludes bas qui firent danser les pierres et se lever les bras ! Puis elle s’accompagna, en chantant ces vers qu’elle improvisa :
« L’ami que j’ai, qu’il soit loin ou qu’il soit près, a pour toujours empreint son image sur mes yeux, et gravé à jamais son nom sur mes membres fidèles.
« Pour dorloter son souvenir je deviens entièrement un cœur, et pour le contempler je deviens entièrement un œil !
« Le censeur qui me blâme sans cesse, m’a dit : « Vas-tu oublier enfin cet amour enflammé ? » Je lui dis : « Ô censeur sévère, laisse-moi et va-t’en ! Ne vois-tu comme tu te leurres en me demandant l’impossible ? »
En entendant ces vers, le maître de Visage-de-Lune fut ému de plaisir, et, après avoir mouillé ses lèvres à la coupe, il l’offrit à l’adolescente qui la but. Il la remplit alors une seconde fois et, la tenant à la main, il se tourna vers l’esclave brune et lui dit : « Ô Flamme-du-Brasier, ô remède des âmes, tâche, sans m’embraser toutefois, de me faire entendre les accents de ta voix, en chantant quelques vers de ton choix ! » Et Flamme-du-Brasier prit le luth et l’accorda sur une autre clef ; puis elle préluda par un jeu qui fit danser les pierres et les cœurs, et tout de suite après elle chanta :
« Je le jure par ce cher visage, je t’aime et n’aimerai que toi jusqu’à la mort ; et jamais je ne trahirai ton amour !
« Ô brillant visage que la beauté enveloppe de ses voiles, tu enseignes aux êtres les plus beaux ce que peut être une chose belle !
« Par ta gentillesse tu as fait la conquête de tous les cœurs, car tu es bien l’œuvre pure sortie des doigts du Créateur ! »
En entendant ces vers, le maître de Flamme-du-Brasier fut ému de plaisir, et, après avoir mouillé ses lèvres à la coupe, il l’offrit à l’adolescente qui la but. Il la remplit alors une seconde fois et, la tenant à la main, il se tourna vers l’esclave à l’embonpoint considérable, et lui dit : « Pleine-Lune, ô lourde à la surface mais au sang si sympathique et si léger, veux-tu nous chanter un air sur de beaux vers clairs comme ta chair ! » Et l’adolescente grasse prit le luth et l’accorda et préluda de façon à faire vibrer les âmes et les roches les plus dures, et, après quelques agréables murmures, elle chanta d’une voix pure :
« Si je pouvais réussir à te plaire, ô toi, objet de mon désir, je braverais tout l’univers et sa colère, avec ton seul sourire comme salaire.
« Si vers mon âme qui soupire tu t’avançais de ta fière démarche balancée, les rois de la terre entière disparaîtraient que je ne m’en apercevrais !
« Si tu agréais l’humilité de mon amour, mon bonheur serait de passer à tes pieds tous mes jours, ô toi vers qui convergent les attributs de la beauté et ses atours ! »
En entendant ces vers, le maître de la grasse Pleine-Lune fut ému de plaisir, et, après avoir mouillé ses lèvres à la coupe, il l’offrit à l’adolescente qui la but. Alors il la remplit de nouveau et, la tenant à la main, il se tourna vers l’esclave mince et lui dit : « Ô svelte Houria-du-Paradis, à ton tour maintenant de nous procurer l’extase des beaux chants ! » Et la svelte adolescente s’inclina sur le luth, comme une mère sur son enfant, et chanta les vers suivants :
« Pour toi mon ardeur est extrême, et ton indifférence l’égale. Où est la loi qui conseille des sentiments si opposés ?
« Est-il un juge suprême des cas d’amour, afin d’y avoir recours ? Il rendrait les parties égales en donnant l’excès de mon ardeur au bien-aimé, et en me donnant l’excès de son indifférence ! »
En entendant ces vers, le maître de la mince et svelte Houria-du-Paradis fut ému de plaisir et, après avoir mouillé ses lèvres à la coupe, il l’offrit à l’adolescente qui la but. Après quoi, il la remplit de nouveau et, la tenant à la main, il se tourna vers l’esclave blonde et lui dit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TRENTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… il se tourna vers l’esclave blonde et lui dit : « Ô Soleil-du-Jour, ô corps d’ambre et d’or, veux-tu, sur un délicat motif d’amour, nous broder quelques vers encore ? » Et la blonde adolescente inclina sa tête d’or sur l’instrument sonore, ferma à demi ses yeux clairs comme l’aurore, préluda par quelques mélodieux accords qui firent vibrer sans effort les âmes et les corps, au dedans comme au dehors, et, après avoir incité les transports par un début pas trop fort, elle donna à sa voix, trésor des trésors, le plein de son essor, et chanta pour lors :
« L’ami que j’ai, lorsque devant lui je parais,
« Il me contemple et darde sur mon cœur
« Le glaive tranchant de ses regards.
« Je dis à mon pauvre cœur transpercé : « Pourquoi ne veux-tu pas guérir de tes blessures ?
« Pourquoi ne te tiens-tu pas sur tes gardes envers lui ? »
« Mais mon cœur ne me répond pas, et toujours cède au penchant qui l’entraîne sous ses pas ! »
En entendant ces vers, le maître de la blonde esclave Soleil-du-Jour fut ému de plaisir et, après avoir mouillé ses lèvres à la coupe, il l’offrit à l’adolescente qui la but. Après quoi, il la remplit de nouveau et, la tenant à la main, il se tourna vers l’esclave noire et lui dit : « Ô Prunelle-de-l’Œil, ô noire à la surface et si blanche au dedans, toi dont le corps porte la couleur de deuil et dont le visage de bon accueil cause le bonheur de notre seuil, cueille-nous quelques vers qui soient des merveilles aussi vermeilles que le soleil ! »
Alors, la noire Prunelle-de-l’Œil prit le luth et y joua des variantes de vingt manières différentes. Après quoi, elle reprit le premier air et chanta ce chant qu’elle chantait d’ordinaire, et qu’elle avait composé sur le mode impair :
« Mes yeux, laissez couler abondamment vos larmes
« Sur le meurtre de mon cœur par le feu de mon amour.
« Tout ce feu dont je brûle, toute cette passion qui me consume,
« Je les dois à l’ami cruel qui me fait languir,
« Au cruel qui fait la joie de mes rivales.
« Mes censeurs me blâment, et m’encouragent à renoncer aux roses de ses joues en fleur !
« Mais que faire d’un cœur sensible aux fleurs et aux roses ?…
« Maintenant, voici la coupe de vin qui circule là-bas,
« Et les sons de la guitare invitent au plaisir nos âmes, et nos corps à la volupté…
« Moi, je n’aime que son haleine ! —
« Mes joues hélas ! sont flétries par les feux de mes désirs. Mais que m’importe ! Les roses du Paradis — ses joues — les voici !
« Que m’importe, puisque je l’adore ! Si, toutefois, mon crime n’est pas trop grand d’aimer la créature ! »
En entendant ces vers, le maître de Prunelle-de-l’Œil fut ému de plaisir et, après avoir mouillé ses lèvres à la coupe, il l’offrit à l’adolescente qui la but.
Après quoi, toutes les six se levèrent à la fois et embrassèrent la terre entre les mains de leur maître, et le prièrent de leur faire connaître celle dont il avait été le plus charmé et dont les vers et la voix étaient le plus plaisants. Et Ali El-Yamani fut à la limite de la perplexité, et se mit à longtemps les regarder et à admirer leurs charmes et leurs mérites avec des regards indécis ; et il trouvait, en son âme, que leurs formes et leurs couleurs étaient également admirables. Il finit enfin par se décidera parler et dit :
« Louanges à Allah le Distributeur des grâces et de la beauté, qui m’a donné en vous autres, les six, des femmes merveilleuses douées de toutes les perfections ! Eh bien, voici ! Je vous déclare que je vous préfère toutes également, et que je ne puis prendre sur ma conscience d’accorder à l’une d’entre vous la préexcellence. Venez donc, mes agneaux, m’embrasser toutes à la fois ! »
À ces paroles de leur maître, les six adolescentes se précipitèrent dans ses bras, et le caressèrent mille fois, et lui également, pendant une heure de temps. Après quoi, il les fit se ranger en cercle devant lui et leur dit : « Je n’ai point voulu moi-même commettre l’injustice de fixer spécialement mon choix sur l’une de vous, en lui accordant la préférence sur ses compagnes. Mais ce que je n’ai point fait, vous pouvez le faire vous-mêmes. Toutes, en effet, vous êtes également versées dans la lecture du Korân et dans les belles-lettres ; vous avez lu les annales des anciens et l’histoire de nos pères musulmans ; vous êtes enfin douées d’éloquence et d’une diction merveilleuse. Je veux donc que chacune de vous se donne les louanges qu’elle croit mériter, qu’elle fasse remarquer ses avantages et ses qualités, et qu’elle rabaisse les charmes de sa rivale. Ainsi, que la lutte s’engage, par exemple, entre deux rivales de couleurs ou de formes différentes, entre la blanche et la noire, la maigre et la grasse, la blonde et la brune ; mais dans cette lutte vous ne devez pas vous battre autrement qu’avec les belles paroles, les belles maximes, les citations des sages et des savants, l’autorité des poètes et l’appui du Korân…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TRENTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … l’autorité des poètes et l’appui du Korân ! » Et les six adolescentes répondirent par l’ouïe et l’obéissance, et se disposèrent à la lutte charmante.
La première qui se leva fut la blanche esclave Visage-de-Lune, qui fit signe à la noire Prunelle-de-l’Œil de venir se tenir vis à vis d’elle. Et aussitôt elle dit :
« Ô noire, il est rapporté dans les livres des savants que la Blancheur parla ainsi : « Je suis une lumière éclatante ! Je suis une lune qui se lève à l’horizon ! Ma couleur est claire et évidente ! Mon front brille de l’éclat de l’argent. Et ma beauté a inspiré le poète qui a dit :
« Blanche, aux joues lisses et douces et polies, elle est une perle de beauté soigneusement gardée.
« Elle est droite comme la lettre aleph ; la lettre mim, c’est sa bouche ; ses sourcils sont deux nouns renversés ; et ses regards sont des flèches lancées par l’arc redoutable de ses sourcils.
« Mais si tu veux savoir ses joues et sa taille, je te dirai : Ses joues — des feuilles de rose, des fleurs de myrte et des narcisses. Sa taille — un tendre rameau flexible qui gracieux se balance dans le jardin, et pour lequel on donnerait le jardin entier et ses parterres ! »
« Mais, ô noire, je continue !
« Ma couleur est la couleur du jour. Elle est aussi la couleur de la fleur d’oranger et de l’étoile perlée du matin.
« Sache qu’Allah Très-Haut, dans le Livre vénéré, dit à Moussa (sur lui la prière et la paix !) qui avait la main couverte de lèpre : « Fais entrer ta main dans ta poche ; et quand tu l’en retireras tu la trouveras blanche, c’est-à-dire pure et intacte ! »
« Il est également écrit dans le Livre de notre foi : « Ceux qui ont su garder leur visage blanc, c’est-à-dire indemne de toute souillure, seront du nombre des élus dans la miséricorde d’Allah ! »
« Ma couleur est donc la reine des couleurs, et ma beauté, c’est ma perfection, et ma perfection, c’est ma beauté.
« Les beaux vêtements et les belles parures siéent toujours à ma couleur, et font mieux ressortir mon éclat qui subjugue les âmes et les cœurs.
« Ignores-tu que la neige qui tombe du ciel est toujours blanche ?
« Ignores-tu que les Croyants ont choisi de préférence la mousseline blanche comme toile pour leur turban ?
« Que de choses admirables n’aurais-je pas encore à dire sur ma couleur ! Mais je ne veux pas m’étendre davantage sur mes mérites, car la vérité est évidente par elle-même, comme la lumière frappe les regards. Et puis je veux tout de suite commencer ta critique, ô noire, couleur de l’encre et du fumier, limaille du forgeron, visage du corbeau, le plus néfaste des oiseaux !
« Et d’abord rappelle-toi les vers du poète qui parlait de la blanche et de la noire :
« Ne sais-tu que la valeur d’une perle tient à sa blancheur, et qu’un sac de charbon s’achète pour un drachme à peine ?
« Ne sais-tu que les visages blancs sont de bon augure et qu’ils portent le signe du paradis, mais que les visages noirs ne sont que de la poix et du goudron destinés à entretenir le feu de l’enfer ? »
« Apprends aussi que les annales des hommes justes rapportent que le saint homme Nouh s’endormit un jour, alors que ses deux fils Sâm et Hâm étaient à ses côtés. Et voici que s’éleva une brise qui vint soulever sa robe et mettre à nu ses membres cachés. À cette vue, Hâm se mit à rire et, fort amusé du spectacle, car Nouh, second père des hommes, était fort riche en rigides somptuosités, ne voulut pas recouvrir la nudité de son père. Alors Sâm se leva gravement et se hâta de cacher le tout en ramenant la robe. Sur ces entrefaites, le vénérable Nouh se réveilla et, voyant rire Hâm, il le maudit ; et, voyant la mine grave de Sâm, il le bénit. Et à l’instant la figure de Sâm devint blanche, et celle de Hâm devint noire. Et, dès lors, Sâm fut la souche d’où naquirent les prophètes, les pasteurs des peuples, les sages et les rois ; et Hâm, qui s’était enfui de la présence de son père, fut le tronc d’où naquirent les nègres, les soudaniens ! Et tu sais bien, ô noire, que tous les savants, et tous les hommes en général, sont d’accord sur cette opinion, à savoir : qu’il ne peut y avoir un sage dans l’espèce nègre et dans les pays noirs ! »
À ces paroles de l’esclave blanche, son maître lui dit : « Tu peux maintenant t’arrêter ! Au tour de la noire ! » Alors Prunelle-de-l’Œil, qui s’était tenue immobile, regarda Visage-de-Lune, et lui dit :
« Ne connais-tu pas, ô blanche ignorante, le passage du Korân où Allah Très-Haut a juré par la nuit ténébreuse et le jour éclatant ? Or, Allah Très-Haut, dans ce serment, a commencé par nommer d’abord la nuit, et ensuite le jour. Il ne l’aurait pas fait, s’il ne préférait la nuit au jour.
« Et puis ! La couleur noire des poils et des cheveux n’est-elle pas le signe et l’ornement de la jeunesse, comme la couleur blanche est l’indice de la vieillesse et de la fin des jouissances de la vie ? Et si la couleur noire n’était pas la plus estimée des couleurs…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TRENTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et si la couleur noire n’était pas la plus estimée des couleurs, Allah ne l’eût pas rendue tellement chère au noyau des yeux et du cœur. Aussi, qu’elles sont vraies ces paroles du poète :
« Si j’aime tant un corps d’ébène, c’est qu’il est jeune et contient un cœur chaud et des prunelles de feu.
« Quant à ce qui est blanc, ô l’horreur extrême ! Si des fois je suis forcé d’avaler un blanc d’œuf, ou de me consoler, à défaut de mieux, d’une chair couleur de blanc d’œuf, c’est fort rare !
« Mais jamais vous ne me verrez éprouver un amour extrême pour un linceul blanc, ou me plaire à des cheveux de même couleur. »
« Et un autre poète a dit :
« Si je deviens fou de l’excès de mon amour pour cette femme noire au corps lustré, ne vous étonnez pas, ô mes amis,
« Car toute folie, nous apprennent les médecins, est toujours précédée par des idées noires ! »
« Un autre a dit également :
« Je n’aime point ces femmes blanches dont on croirait la peau recouverte de farine dartreuse !
« L’amie que j’aime est une noire dont la couleur est celle de la nuit et le visage celui de la lune : couleur et visage inséparables, car si la nuit n’existait pas il n’y aurait pas de clarté de lune ! »
« Et puis ! Quand se font-elles, les réunions intimes des amis, si ce n’est la nuit ? Et quelle gratitude ne doivent-ils point, les amoureux, aux ténèbres de la nuit qui favorisent leurs ébats, les préservent des indiscrets et les abritent contre les blâmes. Mais, par contre, quels sentiments de répulsion n’ont-ils point contre le jour indiscret qui les dérange et les compromet ? Cette seule différence devrait te suffire, ô blanche ! Mais écoute encore ce que dit le poète :
« Je n’aime point ce garçon lourd dont la couleur blanche est due à la graisse dont il est bouffi ; mais j’aime ce jeune noir, svelte et mince, aux chairs fermes.
« Car de ma nature j’ai toujours préféré comme monture, pour la joute des lances, un jeune étalon aux fins jarrets, et j’ai laissé les autres monter les éléphants ! »
« Et un autre a dit :
« L’ami est venu me voir cette nuit, et nous nous couchâmes côte à côte avec délices. Le matin nous surprit accolés encore !
« Si j’ai un vœu à formuler au Seigneur, c’est de faire de tous mes jours des nuits pour que jamais ne me quitte l’ami ! »
« Si donc, ô blanche, je devais continuer à t’énumérer les mérites et les louanges de la couleur noire, j’irais contre ce dicton : « Des mots nets et courts valent mieux qu’un long discours ! » Seulement je dois encore te dire que tes mérites à côté des miens font une bien piètre mine. Tu es blanche, en effet, comme la lèpre est blanche et fétide et suffocante ! Et si tu te compares à la neige, oublies-tu donc que dans l’enfer il n’y a pas seulement du feu, mais que, dans certains endroits, la neige produit un froid terrible qui torture les réprouvés plus que la brûlure des flammes ? Et si tu me compares à l’encre, oublies-tu que c’est avec l’encre noire qu’est écrit le Livre d’Allah, et que noir est le musc précieux dont les rois se font des présents ? Enfin je te conseille, pour ton bien, de te rappeler ces vers du poète :
« N’as-tu point remarqué que le musc ne serait plus le musc s’il n’était si noir, et que le plâtre n’est si méprisable que parce qu’il est blanc ?
« Et le noir de l’œil, quel prix n’y attache-t-on pas, alors qu’on s’inquiète si peu du blanc ! »
À ces paroles de Prunelle-de-l’Œil, son maître, Ali El-Yamani, lui dit : « Certes, ô noire, et toi esclave blanche, vous avez toutes deux excellemment parlé. Au tour maintenant de deux autres ! »
Alors la grosse et la mince se levèrent, tandis que la blanche et la noire regagnaient leur place. Et elles se tinrent debout en face l’une de l’autre, et la grosse Pleine-Lune se disposa à parler la première.
Mais auparavant elle commença par se déshabiller, en mettant à découvert ses poignets, ses chevilles, ses bras et ses cuisses, et elle finit par se mettre presque complètement nue, de façon à bien faire valoir l’opulence de son ventre aux magnifiques plis superposés, et la rondeur de son nombril ombreux, et la richesse de sa croupe considérable. Et elle ne garda sur elle que sa chemise fine dont le tissu léger et transparent, sans cacher ses formes arrondies, les voilait agréablement. Et alors seulement, après quelques frissonnements, elle se tourna vers sa rivale, la mince Houria-du-Paradis, et lui dit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TRENTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et alors seulement la grasse Pleine-Lune, après quelques frissonnements, se tourna vers sa rivale la mince Houria-du-Paradis, et lui dit :
« Louanges à Allah qui m’a créée avec de l’embonpoint, qui a mis des coussins dans tous mes coins et mes recoins, qui a pris soin de me farcir la peau avec de la graisse qui sent le benjoin de près et de loin, et qui, néanmoins, n’a point refusé de me donner, comme appoint, assez de muscles pour, en cas de besoin, appliquer à mon ennemi un coup de poing qui en fasse une marmelade de coings.
« Or, ô maigre, sache que les sages ont dit : « La joie de la vie et la volupté consistent en trois choses : manger de la chair, monter sur de la chair, et faire entrer la chair dans la chair ! »
« Qui pourrait, sans frémir de plaisir, contempler mes formes plantureuses ? Allah lui-même, dans le Livre, fait l’éloge de la graisse quand il commande d’immoler dans les sacrifices des moutons gras ou des agneaux gras ou des veaux gras.
« Mon corps est un verger dont les fruits sont : les grenades, mes seins ; les pêches, mes joues ; les pastèques, mes fesses.
« Quel est le volatile qui fut le plus regretté dans le désert par les Bani-Israïl en fuite hors d’Égypte ? N’est-ce point la caille à la chair juteuse et grasse ?
« A-t-on jamais vu quelqu’un s’arrêter chez le boucher pour lui demander de la chair étique ? Et le boucher ne donne-t-il pas à ses meilleurs clients les morceaux les plus charnus ?
« Écoute, d’ailleurs, ô maigre, ce que le poète dit au sujet de la femme grasse comme je le suis :
« Regarde-la marcher quand elle remue des deux côtés deux outres balancées, lourdes et redoutables dans leur lasciveté !
« Regarde-la quand elle s’assied, comme elle laisse à l’endroit quitté, en souvenir de son passage, ses fesses imprimées !
« Regarde-la danser quand d’un coup de hanche elle fait se pâmer nos âmes, et tomber nos cœurs à ses pieds ! »
« Quant à toi, ô maigre, à quoi peux-tu bien ressembler sinon à quelque moineau déplumé ; et tes jambes sont-elles faites autrement que les pattes du corbeau ; et tes cuisses ne ressemblent-elles pas au bâton du four ; et ton corps enfin n’est-il point sec et dur comme le poteau du pendu ? Et c’est bien de toi, femme décharnée, qu’il s’agit dans ces vers du poète :
« Qu’Allah me préserve d’être jamais forcé d’accoler cette femme maigre, et de servir de frottoir dans son passage obstrué de cailloux.
« Elle a dans chaque membre une corne qui se heurte et se bat avec mes os, tant que je me réveille avec la peau bleuie et fendillée ! »
Lorsque Ali El-Yamani eut entendu ces paroles de la grasse Pleine-Lune, il lui dit : « Tu peux maintenant t’arrêter ! Au tour de Houria-du-Paradis ! »
Alors la mince et svelte adolescente regarda la grasse Pleine-Lune en souriant et lui dit :
« Louanges à Allah qui m’a créée en me donnant la forme du flexible rameau du peuplier, la souplesse de la tige du cyprès et le balancement du lis !
« Lorsque je me lève, je suis légère ; lorsque je m’assieds, je suis gentille ; lorsque je plaisante, je suis charmante. Mon haleine est douce et parfumée, car mon âme est simple et pure de tout contact épaississant.
« Je n’ai jamais, ô grasse, entendu un amant louer sa bien-aimée en disant : « Elle est énorme comme l’éléphant ; elle est charnue comme une montagne est haute ! »
« Par contre, j’ai toujours entendu l’amant, pour dépeindre sa bien-aimée, dire : « Sa taille est mince et souple et élégante. Sa démarche est si légère que ses pas s’impriment à peine sur le sol ! Peu de chose suffit à la nourrir, et quelques gouttes d’eau apaisent sa soif. Ses jeux et ses caresses sont discrets, et ses embrassements pleins de volupté. Elle est plus agile que le moineau, et plus vive que l’étourneau ! Elle est flexible comme la tige du bambou ! Son sourire est gracieux et gracieuses sont ses manières. Si je l’attire à moi, c’est sans faire d’effort. Et quand elle se penche sur moi, elle s’incline délicatement ; et si elle s’assied sur mes genoux, elle ne tombe pas lourdement, mais elle se pose comme une plume d’oiseau ! »
« Sache donc, ô grasse, que c’est moi la svelte, la fine, pour qui brûlent tous les cœurs. C’est moi qui inspire les passions les plus violentes et qui rend fous les hommes les plus sensés !
» C’est moi enfin qu’on compare à la vigne grimpante autour du palmier, qui s’enlace à la tige avec tant de nonchalance. C’est moi, la gazelle svelte aux beaux yeux humides et languissants. Et mon nom de Houria n’est point usurpé !
« Quant à toi, ô grasse, laisse-moi maintenant te dire tes vérités…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT TRENTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Quant à toi, ô grasse, laisse-moi maintenant te dire tes vérités.
« Ô monceau de graisse et de chair, quand tu marches, c’est comme le canard ; quand tu manges, c’est comme l’éléphant. Dans la copulation tu es insatiable, et dans le repos tu es intraitable.
« D’ailleurs, quel est l’homme au membre assez long pour arriver à ta cavité cachée par les montagnes de ton ventre et de tes cuisses ?
« Et si cet homme se rencontre et qu’il puisse te pénétrer, il est aussitôt repoussé d’un coup de ton ventre gonflé !
« Tu n’as guère l’air de te douter que, grasse comme tu es, tu n’es bonne que comme viande de boucherie !
« Ton âme est aussi grossière que ton corps. Ta plaisanterie est si pesante qu’elle suffoque. Tes jeux sont si lourds qu’ils tuent. Et ton rire si épouvantable qu’il fracasse les os de l’oreille.
« Si ton amant soupire dans tes bras, tu peux à peine respirer ; s’il t’embrasse, tu es moite et gluante de sueur.
« Lorsque tu dors, tu es ronflante ; lorsque tu veilles, tu souffles comme un buffle ; tu peux à peine changer de place ; et lorsque tu reposes, tu es un fardeau pour toi-même. Ta vie se passe à mouvoir tes mâchoires, comme la vache, et à régurgiter comme le chameau.
« Si tu pisses, tu mouilles tes robes ; si tu jouis, tu inondes les matelas ; si tu vas à la selle, tu t’y plonges jusqu’au cou ; et si tu vas au bain, tu ne peux atteindre ta vulve, qui reste macérée dans son jus et embrouillée dans ses poils jamais épilés !
« Si l’on te regarde par devant, tu es comme l’éléphant ; si l’on te regarde de côté, tu es comme le chameau ; et si l’on te regarde par derrière tu es comme une outre gonflée.
« Enfin c’est de toi certainement que le poète a dit :
« Elle est lourde comme une vessie gonflée d’urine ; ses cuisses sont deux contreforts de montagne, et sa démarche ébranle le sol comme un tremblement.
« Mais si elle vient à lâcher un pet en Occident, l’Orient entier en retentit ! »
À ces paroles de Houria-du-Paradis, Ali El-Yamani, son maître, lui dit : « En vérité, ô Houria, ton éloquence est notoire ! Et toi, Pleine-Lune, ton langage est admirable. Mais maintenant il est temps de regagner vos places afin de laisser parler la blonde et la brune ! »
Alors Soleil-du-Jour et Flamme-du-Brasier se levèrent et vinrent se tenir en face l’une de l’autre. Et, la première, l’adolescente blonde dit à sa rivale :
« C’est moi la blonde décrite longuement dans le Korân ! C’est moi qu’Allah a qualifiée quand il a dit : « Le jaune est la couleur qui réjouit les regards ! » Je suis ainsi la plus belle des couleurs !
« Ma couleur est une merveille, ma beauté est une limite, et mon charme est une fin. Car ma couleur donne à l’or sa valeur, et au soleil et aux astres leur beauté.
« C’est elle qui embellit les pommes et les pêches, et donne sa teinte au safran. Je donne leurs tons aux pierres précieuses, et aux blés leur maturité !
« Les automnes me doivent l’or de leur parure, et la terre n’est si belle de son tapis de feuilles qu’à cause de la teinte qui fige sur elle les rayons du soleil.
« Mais toi, ô brune, quand ta couleur se trouve dans un objet, elle suffit pour le déprécier. Rien n’est plus commun ou plus laid que cela ! Regarde les buffles, les ânes, les loups et les chiens : ils sont bruns !
« Nomme-moi un seul mets dans lequel on voie de bon œil ta couleur ! Ni les fleurs, ni les pierreries n’ont jamais été brunes ; seul le cuivre sale a ta couleur.
« Tu n’es point blanche, et tu n’es point noire. Aussi on ne peut t’attribuer aucun des mérites de ces deux couleurs ni aucune des paroles qu’on dit à leur louange ! »
À ces paroles de la blonde, son maître lui dit : « Laisse maintenant parler Flamme-du-Brasier ! »
Alors la brune adolescente fit briller dans un sourire le double collier de ses dents — des perles — et, comme elle avait, outre sa couleur de miel, des formes gracieuses, une taille merveilleuse, des proportions harmonieuses, des manières élégantes et des cheveux de charbon qui retombaient en lourdes nattes jusqu’à sa croupe qui était admirable, elle commença d’abord par mettre en valeur ses charmes, dans un moment de silence, puis elle dit à sa rivale la blonde :
« Louanges à Allah qui ne m’a faite ni grasse difforme, ni maigre maladive, ni blanche comme le plâtre, ni jaune comme les coliques, ni noire comme la poudre de charbon, mais qui a réuni en moi, avec un art admirable, les couleurs les plus délicates et les formes les plus attrayantes.
« Tous les poètes d’ailleurs ont chanté à l’envi mes louanges dans tous les langages, et je suis la préférée de tous les âges et de tous les sages.
« Mais, sans moi-même faire mon éloge, qui n’est plus à faire, voici quelques-uns seulement des poèmes ouvragés en mon honneur.
« Un poète a dit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT TRENTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
»… voici quelques-uns seulement des poèmes ouvragés en mon honneur.
« Un poète a dit :
« Les brunes ont en elles un sens caché. Si tu le devines, tes yeux ne daigneront jamais plus regarder les autres femmes.
« Elles savent, les enchanteresses, l’art subtil dans tous ses détours, et l’enseigneraient même à l’ange Harout. »
« Un autre a dit :
« J’aime une brune charmante dont la couleur m’enchante, et dont la taille est droite comme la lance.
« La soyeuse petite tache noire, tant caressée, tant baisée, qui orne son cou, tant de fois m’a ravi !
« Par la couleur de sa peau lisse, par le parfum délicat qui s’en exhale, elle ressemble à la tige odorante de l’aloès.
« Et quand la nuit étend les voiles des ombres, elle vient me voir, la brune. Et je la retiens auprès de moi, jusqu’à ce que les ombres elles-mêmes deviennent de la couleur de nos songes ! »
« Mais toi, ô jaune, tu es fanée comme les feuilles de la mouloukhia[3] de mauvaise qualité que l’on cueille à Bab El-Louk, et qui est fibreuse et dure.
« Tu as la couleur de la marmite en terre cuite qui sert au marchand de têtes de mouton.
« Tu as la teinte de l’ocre et de l’orpiment dont on se sert au hammam pour s’épiler, et du chiendent.
« Tu as un visage de cuivre jaune, semblable aux fruits de l’arbre Zakoum qui, dans l’enfer, porte comme fruits des crânes diaboliques.
« Et c’est de toi que le poète a dit :
« Le sort m’a doté d’une femme à la couleur jaune si criarde qu’elle me fait mal à la tête, et que mon cœur et mes yeux tressautent de malaise.
« Si mon âme ne veut pas renoncer pour toujours à la voir, pour me punir je me donnerai de grands coups au visage, de façon à m’arracher les molaires ! »
Lorsque Ali El-Yamani eut entendu ces paroles, il se trémoussa de plaisir, et se mit à rire tellement qu’il tomba à la renverse, après quoi il dit aux deux adolescentes de s’asseoir à leur place ; et, pour leur prouver à toutes la joie qu’il avait eue de les entendre, il leur fit des dons égaux, en belles robes et en pierreries terrestres et marines !
Et telle est, ô émir des Croyants, continua Môhammad El-Bassri en s’adressant au khalifat El-Mâmoun, l’histoire de ces six adolescentes qui maintenant continuent à vivre en bons termes entre elles, dans la demeure de leur maître Ali El-Yamani, à Baghdad, notre ville ! »
Le khalifat fut charmé à l’extrême de cette histoire et demanda : « Mais, ô Môhammad, sais-tu au moins où est la maison du maître de ces adolescentes ? Et pourrais-tu aller lui demander s’il veut les vendre ? S’il veut les vendre, achète-les moi et me les amène ! » Môhammad répondit : « Ce que je puis te dire, ô émir des Croyants, c’est que je suis sûr que le maître de ces esclaves ne voudra pas s’en séparer, vu qu’il en est amoureux à l’extrême ! » El-Mâmoun dit : « Prends avec toi, pour prix de chacune d’elles, dix mille dinars : ce qui fait en tout soixante mille dinars. Tu les remettras de ma part à cet Ali El-Yamani, et tu lui diras que je désire ses six esclaves ! »
À ces paroles du khalifat, Môhammad El-Bassri se hâta de prendre la somme en question, et alla trouver le maître des esclaves, à qui il fit part du désir de l’émir des Croyants. Ali El-Yamani, dans son premier mouvement, n’osa pas se refuser à la demande du khalifat, et, ayant touché les soixante mille dinars, il remit les six esclaves à Môhammad El-Bassri qui les conduisit aussitôt entre les mains d’El-Mâmoun.
Le khalifat, à leur vue, fut à la limite de l’enchantement, tant de la variété de leur couleur, que de leurs manières élégantes, de leur esprit cultivé et de leurs divers agréments. Et il leur donna à chacune, dans son harem, une place de choix, et, durant plusieurs jours, il put jouir de leurs perfections et de leur beauté.
Sur ces entrefaites, le premier maître des six, Ali El-Yamani, sentit peser sur lui la solitude, et se mit à regretter le mouvement qui l’avait fait céder au désir du khalifat. Puis, un jour, à bout de patience, il envoya au khalifat une lettre pleine de désespoir, et où, entre autres choses tristes, il y avait les vers suivants :
« Que mon salut désespéré aille aux belles dont mon âme est séparée. Elles sont mes yeux, mes oreilles, ma nourriture, ma boisson, mon jardin et ma vie.
« Depuis que j’en suis éloigné, rien ne vient distraire ma douleur, et le sommeil lui-même a fui mes paupières !
« Que ne les ai-je, plus jaloux que je ne l’ai été, enfermées toutes les six dans mes yeux, et sur elles que n’ai-je abaissé mes paupières comme rideaux !
« Ô douleur ! ô douleur ! J’eusse préféré n’être point né, que de tomber blessé par des flèches — leurs regards — meurtrières, retirées de la blessure ! »
Lorsque le khalifat El-Mâmoun eut parcouru cette lettre, comme il avait une âme magnanime, il fit appeler en toute hâte les six adolescentes, leur donna à chacune dix mille dinars, et des robes merveilleuses, et d’autres cadeaux admirables, et les fit aussitôt rendre à leur ancien maître.
Lorsque Ali El-Yamani les vit arriver, plus belles qu’elles ne l’avaient jamais été, et plus riches et plus heureuses, il fut à la limite de la joie, et continua à vivre avec elles dans les délices et les plaisirs, jusqu’au jour de la séparation dernière !
— Mais, continua Schahrazade, ne crois point, ô Roi fortuné, que toutes les histoires que tu as entendues jusqu’à présent puissent valoir, de près ou de loin, l’Histoire prodigieuse de la ville d’Airain, que je me réserve de te raconter, la nuit prochaine, si tel est toutefois ton désir !
Et la petite Doniazade s’écria : « Ô ! que tu serais gentille, Schahrazade, de nous en dire, en attendant, les premiers mots seulement ! »
Alors elle sourit et dit :
On raconte qu’il y avait un roi — Allah seul est roi ! — dans la ville de…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
