Sans famille/Dentu, 1887/Texte entier
Dentu E., .
Pendant que j’ai écrit ce livre, j’ai constamment pensé à toi, mon enfant, et ton nom m’est venu à chaque instant sur les lèvres. — Lucie sentira-t-elle cela ? — Lucie prendra-t-elle intérêt à cela ? Lucie, toujours. Ton nom, prononcé si souvent, doit donc être inscrit en tête de ces pages : je ne sais la fortune qui leur est réservée, mais quelle qu’elle soit, elles m’auront donné des plaisirs qui valent tous les succès, — la satisfaction de penser que tu peux les lire, — la joie de te les offrir.
PREMIÈRE PARTIE
I
AU VILLAGE
Je suis un enfant trouvé.
Mais jusqu’à huit ans j’ai cru que, comme tous les autres enfants, j’avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras, en me berçant, que mes larmes s’arrêtaient de couler.
Jamais je ne me couchais dans mon lit, sans qu’une femme vînt m’embrasser, et, quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains et elle restait à me les réchauffer en me chantant une chanson, dont je retrouve encore dans ma mémoire l’air et quelques paroles.
Quand je gardais notre vache le long des chemins herbus ou dans les brandes, et que j’étais surpris par une pluie d’orage, elle accourait au-devant de moi et me forçait à m’abriter sous son jupon de laine relevé qu’elle me ramenait sur la tête et sur les épaules.
Enfin quand j’avais une querelle avec un de mes camarades, elle me faisait conter mes chagrins, et presque toujours elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison.
Par tout cela et par bien d’autres choses encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu’elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu’elle était ma mère.
Voici comment j’appris qu’elle n’était que ma nourrice.
Mon village, ou pour parler plus justement, le village où j’ai été élevé, car je n’ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance, pas plus que je n’ai eu de père et de mère, le village enfin où j’ai passé mon enfance se nomme Chavanon ; c’est l’un des plus pauvres du centre de la France.
Cette pauvreté, il la doit non à l’apathie ou à la paresse de ses habitants, mais à sa situation même dans une contrée peu fertile. Le sol n’a pas de profondeur, et pour produire de bonnes récoltes il lui faudrait des engrais ou des amendements qui manquent dans le pays. Aussi ne rencontre-t-on (ou tout au moins ne rencontrait-on à l’époque dont je parle) que peu de champs cultivés, tandis qu’on voit partout de vastes étendues de brandes dans lesquelles ne croissent que des bruyères et des genêts. Là où les brandes cessent, les landes commencent ; et sur ces landes élevées les vents âpres rabougrissent les maigres bouquets d’arbres qui dressent çà et là leurs branches tordues et tourmentées.
Pour trouver de beaux arbres, il faut abandonner les hauteurs et descendre dans les plis du terrain, sur les bords des rivières, où dans d’étroites prairies poussent de grands châtaigniers et des chênes vigoureux.
C’est dans un de ces replis de terrain, sur les bords d’un ruisseau qui va perdre ses eaux rapides dans un des affluents de la Loire que se dresse la maison où j’ai passé mes premières années.
Jusqu’à huit ans, je n’avais jamais vu d’homme dans cette maison ; cependant ma mère n’était pas veuve, mais son mari qui était tailleur de pierre, comme un grand nombre d’autres ouvriers de la contrée, travaillait à Paris, et il n’était pas revenu au pays depuis que j’étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m’entourait. De temps en temps seulement, il envoyait de ses nouvelles par un de ses camarades qui rentrait au village.
— Mère Barberin, votre homme va bien ; il m’a chargé de vous dire que l’ouvrage marche fort, et de vous remettre l’argent que voilà ; voulez-vous compter ?
Et c’était tout. Mère Barberin se contentait de ces nouvelles : son homme était en bonne santé ; l’ouvrage donnait ; il gagnait sa vie.
De ce que Barberin était resté si longtemps à Paris, il ne faut pas croire qu’il était en mauvaise amitié avec sa femme. La question de désaccord n’était pour rien dans cette absence. Il demeurait à Paris parce que le travail l’y retenait ; voilà tout. Quand il serait vieux, il reviendrait vivre près de sa vieille femme, et avec l’argent qu’ils auraient amassé, ils seraient à l’abri de la misère pour le temps où l’âge leur aurait enlevé la force et la santé.
Un jour de novembre, comme le soir tombait, un homme, que je ne connaissais pas, s’arrêta devant notre barrière. J’étais sur le seuil de la maison occupé à casser une bourrée. Sans pousser la barrière, mais en levant sa tête par-dessus en me regardant, l’homme me demanda si ce n’était pas là que demeurait la mère Barberin.
Je lui dis d’entrer.
Il poussa la barrière qui cria dans sa hart, et à pas lents il s’avança vers la maison.
Jamais je n’avais vu un homme aussi crotté ; des plaques de boue, les unes encore humides, les autres déjà sèches, le couvraient des pieds à la tête, et à le regarder l’on comprenait que depuis longtemps il marchait dans les mauvais chemins.
Au bruit de nos voix, mère Barberin accourut, et au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à face avec lui.
— J’apporte des nouvelles de Paris, dit-il.
C’étaient là des paroles bien simples et qui déjà plus d’une fois avaient frappé nos oreilles, mais le ton avec lequel elles furent prononcées ne ressemblait en rien à celui qui autrefois accompagnait les mots : « Votre homme va bien, l’ouvrage marche. »
— Ah ! mon Dieu ! s’écria mère Barberin, en joignant les mains, un malheur est arrivé à Jérôme.
— Eh bien, oui, mais il ne faut pas vous rendre malade de peur ; votre homme a été blessé voilà la vérité ; seulement il n’est pas mort. Pourtant il sera peut-être estropié. Pour le moment il est à l’hôpital. J’ai été son voisin de lit, et comme je rentrais au pays il m’a demandé de vous conter la chose en passant. Je ne peux pas m’arrêter, car j’ai encore trois lieues à faire et la nuit vient vite.
Mère Barberin, qui voulait en savoir plus long, pria l’homme de rester à souper ; les routes étaient mauvaises ; on parlait de loups qui s’étaient montrés dans les bois ; il repartirait le lendemain matin.
Il s’assit dans le coin de la cheminée et tout en mangeant, il nous raconta comment le malheur était arrivé : Barberin avait été à moitié écrasé par des échafaudages qui s’étaient abattus, et comme on avait prouvé qu’il ne devait pas se trouver à la place où il avait été blessé, l’entrepreneur refusait de lui payer aucune indemnité.
— Pas de chance, le pauvre Barberin, dit-il, pas de chance ; il y a des malins qui auraient trouvé là-dedans un moyen pour se faire faire des rentes, mais votre homme n’aura rien.
Et tout en séchant les jambes de son pantalon qui devenait raide sous leur enduit de boue durcie, il répétait ce mot : « pas de chance » avec une peine sincère, qui montrait que pour lui, il se fût fait volontiers estropier dans l’espérance de gagner ainsi de bonnes rentes.
— Pourtant, dit-il en terminant son récit, je lui ai donné le conseil de faire un procès à l’entrepreneur.
— Un procès, cela coûte gros.
— Oui, mais quand on le gagne !
Mère Barberin aurait voulu aller à Paris, mais c’était une terrible affaire qu’un voyage si long et si coûteux.
Le lendemain matin nous descendîmes au village pour consulter le curé. Celui-ci ne voulut pas la laisser partir sans savoir avant si elle pouvait être utile à son mari. Il écrivit à l’aumônier de l’hôpital où Barberin était soigné, et quelques jours après il reçut une réponse, disant que mère Barberin ne devait pas se mettre en route, mais qu’elle devait envoyer une certaine somme d’argent à son mari, parce que celui-ci allait faire un procès à l’entrepreneur chez lequel il avait été blessé.
Les journées, les semaines s’écoulèrent et de temps en temps il arriva des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d’argent ; la dernière, plus pressante que les autres, disait que s’il n’y avait plus d’argent, il fallait vendre la vache pour s’en procurer.
Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu’il y a de détresses et de douleurs dans ces trois mots : « vendre la vache. »
Pour le naturaliste, la vache est un animal ruminant ; pour le promeneur, c’est une bête qui fait bien dans le paysage lorsqu’elle lève au-dessus des herbes son mufle noir humide de rosée ; pour l’enfant des villes, c’est la source du café au lait et du fromage à la crème ; mais pour le paysan, c’est bien plus et bien mieux encore. Si pauvre qu’il puisse être et si nombreuse que soit sa famille, il est assuré de ne pas souffrir de la faim tant qu’il a une vache dans son étable. Avec une longe ou même avec une simple hart nouée autour des cornes, un enfant promène la vache le long des chemins herbus, là où la pâture n’appartient à personne, et le soir la famille entière a du beurre dans sa soupe et du lait pour mouiller ses pommes de terre : le père, la mère, les enfants, les grands comme les petits, tout le monde vit de la vache.
Nous vivions si bien de la nôtre, mère Barberin et moi, que jusqu’à ce moment je n’avais presque jamais mangé de viande. Mais ce n’était pas seulement notre nourrice qu’elle était, c’était encore notre camarade, notre amie, car il ne faut pas s’imaginer que la vache est une bête stupide, c’est au contraire un animal plein d’intelligence et de qualités morales d’autant plus développées qu’on les aura cultivées par l’éducation. Nous caressions la nôtre, nous lui parlions, elle nous comprenait, et de son côté, avec ses grands yeux ronds pleins de douceur, elle savait très-bien nous faire entendre ce qu’elle voulait ou ce qu’elle ressentait.
Enfin nous l’aimions et elle nous aimait, ce qui est tout dire.
Pourtant il fallut s’en séparer, car c’était seulement par « la vente de la vache » qu’on pouvait satisfaire Barberin.
Il vint un marchand à la maison et après avoir bien examiné la Roussette, après l’avoir longuement palpée en secouant la tête d’un air mécontent, après avoir dit et répété cent fois qu’elle ne lui convenait pas du tout, que c’était une vache de pauvres gens qu’il ne pourrait pas revendre, qu’elle n’avait pas de lait, qu’elle faisait du mauvais beurre, il avait fini par dire qu’il voulait bien la prendre, mais seulement par bonté d’âme et pour obliger mère Barberin qui était une brave femme.
La pauvre Roussette, comme si elle comprenait ce qui se passait, avait refusé de sortir de son étable et elle s’était mise à meugler.
— Passe derrière et chasse-la, m’avait dit le marchand en me tendant le fouet qu’il portait passé autour de son cou.
— Pour ça non, avait dit mère Barberin.
Et, prenant la vache par la longe, elle lui avait parlé doucement.
— Allons, ma belle, viens, viens.
Et Roussette n’avait plus résisté ; arrivée sur la route, le marchand l’avait attachée derrière sa voiture, et il avait bien fallu qu’elle suivît le cheval.
Nous étions rentrés dans la maison. Mais longtemps encore nous avions entendu ses beuglements.
Plus de lait, plus de beurre. Le matin un morceau de pain ; le soir des pommes de terre au sel.
Le mardi gras arriva justement peu de temps après la vente de Roussette ; l’année précédente, pour le mardi gras, mère Barberin m’avait fait un régal avec des crêpes et des beignets ; et j’en avais tant mangé, tant mangé qu’elle en avait été toute heureuse.
Mais alors nous avions Roussette, qui nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le beurre pour mettre dans la poêle.
Plus de Roussette, plus de lait, plus de beurre, plus de mardi gras ; c’était ce que je m’étais dit tristement.
Mais mère Barberin m’avait fait une surprise ; bien qu’elle ne fût pas emprunteuse, elle avait demandé une tasse de lait à l’une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre et quand j’étais rentré, vers midi, je l’avais trouvée en train de verser de la farine dans un grand poêlon en terre.
— Tiens ! de la farine, dis-je en m’approchant d’elle.
— Mais oui, fit-elle en souriant, c’est bien de la farine, mon petit Rémi, de la belle farine de blé ; tiens, vois comme elle fleure bon.
Si j’avais osé, j’aurais demandé à quoi devait servir cette farine ; mais précisément parce que j’avais grande envie de le savoir, je n’osais pas en parler. Et puis d’un autre côté je ne voulais pas dire que je savais que nous étions au mardi gras pour ne pas faire de la peine à mère Barberin.
— Qu’est-ce qu’on fait avec de la farine ? dit-elle me regardant.
— Du pain.
— Et puis encore ?
— De la bouillie.
— Et puis encore ?
— Dame… Je ne sais pas.
— Si, tu sais bien. Mais comme tu es un bon petit garçon, tu n’oses pas le dire. Tu sais que c’est aujourd’hui mardi gras, le jour des crêpes et des beignets. Mais comme tu sais aussi que nous n’avons ni beurre, ni lait, tu n’oses pas en parler. C’est vrai ça ?
— Oh ! mère Barberin.
— Comme d’avance j’avais deviné tout cela, je me suis arrangée pour que mardi gras ne te fasse pas vilaine figure. Regarde dans la huche.
Le couvercle levé, et il le fut vivement, j’aperçus le lait, le beurre, des œufs et trois pommes.
— Donne-moi les œufs, me dit-elle, et, pendant que je les casse, pèle les pommes.
Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout, en versant dessus, de temps en temps, une cuillerée de lait.
Quand la pâte fut délayée, mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes, et il n’y eut plus qu’à attendre le soir, car c’était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets.
Pour être franc, je dois avouer que la journée me parut longue et que plus d’une fois j’allai soulever le linge qui recouvrait la terrine.
— Tu vas faire prendre froid à la pâte, disait mère Barberin, et elle lèvera mal.
Mais elle levait bien, et de place en place se montraient des renflements, des sortes de bouillons qui venaient crever à la surface. De toute la pâte en fermentation se dégageait une bonne odeur d’œufs et de lait.
— Casse de la bourrée, me disait-elle ; il nous faut un bon feu clair, sans fumée.
Enfin, la chandelle fut allumée.
— Mets du bois au feu ! me dit-elle.
Il ne fut pas nécessaire de me répéter deux fois cette parole que j’attendais avec tant d’impatience. Bientôt une grande flamme monta dans la cheminée et sa lueur vacillante emplit la cuisine.
Alors mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme.
— Donne-moi le beurre.
Elle en prit, au bout de son couteau, un morceau gros comme une petite noix et le mit dans la poêle, où il fondit en grésillant.
Ah ! c’était vraiment une bonne odeur qui chatouillait d’autant plus agréablement notre palais que depuis longtemps nous ne l’avions pas respirée.
C’était aussi une joyeuse musique que celle produite par les grésillements et les sifflements du beurre.
Cependant, si attentif que je fusse à cette musique, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour.
Qui pouvait venir nous déranger à cette heure ? Une voisine sans doute, pour nous demander du feu.
Mais je ne m’arrêtai pas à cette idée, car mère Barberin qui avait plongé la cuiller à pot dans la terrine, venait de faire couler dans la poêle une nappe de pâte blanche, et ce n’était pas le moment de se laisser aller aux distractions.
Un bâton heurta le seuil, puis aussitôt la porte s’ouvrit brusquement.
— Qui est là ? demanda mère Barberin sans se retourner.
Un homme était entré, et la flamme qui l’avait éclairé en plein m’avait montré qu’il était vêtu d’une blouse blanche et qu’il tenait à la main un gros bâton.
— On fait donc la fête ici ? Ne vous gênez pas, dit-il d’un ton rude.
— Ah ! mon Dieu ! s’écria mère Barberin en posant vivement sa poêle à terre, c’est toi, Jérôme ?
Puis me prenant par le bras elle me poussa vers l’homme qui s’était arrêté sur le seuil.
— C’est ton père.
II
UN PÈRE NOURRICIER
Je m’étais approché pour l’embrasser à mon tour, mais du bout de son bâton il m’arrêta :
— Qu’est-ce que c’est que celui-là ?
— C’est Rémi.
— Tu m’avais dit…
— Eh bien oui, mais… ce n’était pas vrai, parce que…
— Ah ! pas vrai, pas vrai.
Il fit quelques pas vers moi son bâton levé et instinctivement je reculai.
Qu’avais-je fait ? De quoi étais-je coupable ? Pourquoi cet accueil lorsque j’allais à lui pour l’embrasser ?
Je n’eus pas le temps d’examiner ces diverses questions qui se pressaient dans mon esprit troublé.
— Je vois que vous faisiez mardi gras, dit-il, ça se trouve bien, car j’ai une solide faim. Qu’est-ce que tu as pour souper ?
— Je faisais des crêpes.
— Je vois bien ; mais ce n’est pas des crêpes que tu vas donner à manger à un homme qui a dix lieues dans les jambes.
— C’est que je n’ai rien : nous ne t’attendions pas.
— Comment rien ; rien à souper ?
Il regarda autour de lui.
— Voilà du beurre.
Il leva les yeux au plafond à l’endroit où l’on accrochait le lard autrefois ; mais depuis longtemps le crochet était vide ; et à la poutre pendaient seulement maintenant quelques glanes d’ail et d’oignon.
— Voilà de l’oignon, dit-il, en faisant tomber une glane avec son bâton ; quatre ou cinq oignons, un morceau de beurre et nous aurons une bonne soupe. Retire ta crêpe et fricasse-nous les oignons dans la poêle.
Retirer la crêpe de la poêle ! mère Barberin ne répliqua rien. Au contraire elle s’empressa de faire ce que son homme demandait tandis que celui-ci s’asseyait sur le banc qui était dans le coin de la cheminée.
Je n’avais pas osé quitter la place où le bâton m’avait amené, et, appuyé contre la table, je le regardais.
C’était un homme d’une cinquantaine d’années environ, au visage rude, à l’air dur ; il portait la tête inclinée sur l’épaule droite par suite de la blessure qu’il avait reçue, et cette difformité contribuait à rendre son aspect peu rassurant.
Mère Barberin avait replacé la poêle sur le feu.
— Est-ce que c’est avec ce petit morceau de beurre que tu vas nous faire la soupe ? dit-il.
Alors prenant lui-même l’assiette où se trouvait le beurre, il fit tomber la motte entière dans la poêle.
Plus de beurre, dès lors plus de crêpes.
En tout autre moment, il est certain que j’aurais été profondément touché par cette catastrophe, mais je ne pensais plus aux crêpes ni aux beignets et l’idée qui occupait mon esprit, c’était que cet homme qui paraissait si dur était mon père.
— Mon père, mon père ! C’était là le mot que je me répétais machinalement.
Je ne m’étais jamais demandé d’une façon bien précise ce que c’était qu’un père, et vaguement, d’instinct, j’avais cru que c’était une mère à grosse voix, mais en regardant celui qui me tombait du ciel, je me sentis pris d’un effroi douloureux.
J’avais voulu l’embrasser, il m’avait repoussé du bout de son bâton, pourquoi ? Mère Barberin ne me repoussait jamais lorsque j’allais l’embrasser, bien au contraire, elle me prenait dans ses bras et me serrait contre elle.
— Au lieu de rester immobile comme si tu étais gelé, me dit-il, mets les assiettes sur la table.
Je me hâtai d’obéir. La soupe était faite. Mère Barberin la servit dans les assiettes.
Alors quittant le coin de la cheminée il vint s’asseoir à table et commença à manger, s’arrêtant seulement de temps en temps pour me regarder.
J’étais si troublé, si inquiet, que je ne pouvais manger, et je le regardais aussi, mais à la dérobée, baissant les yeux quand je rencontrais les siens.
— Est-ce qu’il ne mange pas plus que ça d’ordinaire ? dit-il tout à coup en tendant vers moi sa cuiller.
— Ah ! si, il mange bien.
— Tant pis ; si encore il ne mangeait pas.
Naturellement je n’avais pas envie de parler, et mère Barberin n’était pas plus que moi disposée à la conversation : elle allait et venait autour de la table, attentive à servir son mari.
— Alors tu n’as pas faim ? me dit-il.
— Non.
— Eh bien, va te coucher, et tâche de dormir tout de suite ; sinon je me fâche.
Mère Barberin me lança un coup d’œil qui me disait d’obéir sans répliquer. Mais cette recommandation était inutile, je ne pensais pas à me révolter.
Comme cela se rencontre dans un grand nombre de maisons de paysans, notre cuisine était en même temps notre chambre à coucher. Auprès de la cheminée tout ce qui servait au manger, la table, la huche, le buffet ; à l’autre bout les meubles propres au coucher ; dans un angle le lit de mère Barberin, dans le coin opposé le mien qui se trouvait dans une sorte d’armoire entourée d’un lambrequin en toile rouge.
Je me dépêchai de me déshabiller et de me coucher. Mais dormir était une autre affaire.
On ne dort pas par ordre ; on dort parce qu’on a sommeil et qu’on est tranquille.
Or je n’avais pas sommeil et n’étais pas tranquille.
Terriblement tourmenté au contraire, et de plus très-malheureux.
Comment cet homme était mon père ! Alors pourquoi me traitait-il si durement ?
Le nez collé contre la muraille je faisais effort pour chasser ces idées et m’endormir comme il me l’avait ordonné ; mais c’était impossible ; le sommeil ne venait pas ; je ne m’étais jamais senti si bien éveillé.
Au bout d’un certain temps, je ne saurais dire combien, j’entendis qu’on s’approchait de mon lit.
Au pas lent, traînant et lourd je reconnus tout de suite que ce n’était pas mère Barberin.
Un souffle chaud effleura mes cheveux.
— Dors-tu ? demanda une voix étouffée.
Je n’eus garde de répondre, car les terribles mots : « je me fâche » retentissaient encore à mon oreille.
— Il dort, dit mère Barberin ; aussitôt couché, aussitôt endormi, c’est son habitude ; tu peux parler sans craindre qu’il t’entende.
Sans doute, j’aurais dû dire que je ne dormais pas, mais je n’osai point ; on m’avait commandé de dormir, je ne dormais pas, j’étais en faute.
— Ton procès, où en est-il ? demanda mère Barberin.
— Perdu ! Les juges ont décidé que j’étais en faute de me trouver sous les échafaudages et que l’entrepreneur ne me devait rien.
Là-dessus il donna un coup de poing sur la table et se mit à jurer sans dire aucune parole sensée.
— Le procès perdu, reprit-il bientôt ; notre argent perdu, estropié, la misère ; voilà ! Et comme si ce n’était pas assez, en rentrant ici je trouve un enfant. M’expliqueras-tu pourquoi tu n’as pas fait comme je t’avais dit de faire ?
— Parce que je n’ai pas pu.
— Tu n’as pas pu le porter aux Enfants trouvés ?
— On n’abandonne pas comme ça un enfant qu’on a nourri de son lait et qu’on aime.
— Ce n’était pas ton enfant.
— Enfin je voulais faire ce que tu demandais, mais voilà précisément qu’il est tombé malade.
— Malade ?
— Oui, malade ; ce n’était pas le moment, n’est-ce pas, de le porter à l’hospice pour le tuer ?
— Et quand il a été guéri ?
— C’est qu’il n’a pas été guéri tout de suite. Après cette maladie en est venue une autre : il toussait, le pauvre petit, à vous fendre le cœur. C’est comme ça que notre petit Nicolas est mort ; il me semblait que si je portais celui-là à la ville, il mourrait aussi.
— Mais après ?
— Le temps avait marché. Puisque j’avais attendu jusque-là je pouvais bien attendre encore.
— Quel âge a-t-il présentement ?
— Huit ans.
— Eh bien ! il ira à huit ans là où il aurait dû aller autrefois, et ça ne lui sera pas plus agréable : voilà ce qu’il y aura gagné.
— Ah ! Jérôme, tu ne feras pas ça.
— Je ne ferai pas ça ! Et qui m’en empêchera ? Crois-tu que nous pouvons le garder toujours ?
Il y eut un moment de silence et je pus respirer ; l’émotion me serrait à la gorge au point de m’étouffer.
Bientôt mère Barberin reprit :
— Ah ! comme Paris t’a changé ! tu n’aurais pas parlé comme ça avant d’aller à Paris.
— Peut-être. Mais ce qu’il y a de sûr, c’est que si Paris m’a changé, il m’a aussi estropié. Comment gagner sa vie maintenant, la tienne, la mienne ? nous n’avons plus d’argent. La vache est vendue. Faut-il que quand nous n’avons pas de quoi manger, nous nourrissions un enfant qui n’est pas le nôtre ?
— C’est le mien.
— Ce n’est pas plus le tien que le mien. Ce n’est pas un enfant de paysan. Je le regardais pendant le souper : c’est délicat, c’est maigre, pas de bras, pas de jambes.
— C’est le plus joli enfant du pays.
— Joli, je ne dis pas. Mais solide ! Est-ce que c’est sa gentillesse qui lui donnera à manger ? Est-ce qu’on est un travailleur avec des épaules comme les siennes ? On est un enfant de la ville, et les enfants des villes, il ne nous en faut pas ici.
— Je te dis que c’est un brave enfant, et il a de l’esprit comme un chat, et avec cela bon cœur. Il travaillera pour nous.
— En attendant, il faudra que nous travaillions pour lui, et moi je ne peux plus travailler.
— Et si ses parents le réclament, qu’est-ce que tu diras ?
— Ses parents ! Est-ce qu’il a des parents ? S’il en avait, ils l’auraient cherché, et depuis huit ans trouvé bien sûr. Ah ! j’ai fait une fameuse sottise de croire qu’il avait des parents qui le réclameraient un jour, et nous payeraient notre peine pour l’avoir élevé. Je n’ai été qu’un nigaud, qu’un imbécile. Parce qu’il était enveloppé dans de beaux langes avec des dentelles, cela ne voulait pas dire que ses parents le chercheraient. Ils sont peut-être morts, d’ailleurs.
— Et s’ils ne le sont pas ? Si un jour ils viennent nous le demander ? J’ai dans l’idée qu’ils viendront.
— Que les femmes sont donc obstinées !
— Enfin, s’ils viennent ?
— Eh bien ! nous les enverrons à l’hospice. Mais assez causé. Tout cela m’ennuie. Demain je le conduirai au maire. Ce soir, je vais aller dire bonjour à François. Dans une heure je reviendrai.
La porte s’ouvrit et se referma.
Il était parti.
Alors me redressant vivement, je me mis à appeler mère Barberin.
— Ah ! maman.
Elle accourut près de mon lit :
— Est-ce que tu me laisseras aller à l’hospice ?
— Non, mon petit Rémi, non.
Et elle m’embrassa tendrement en me serrant dans ses bras.
Cette caresse me rendit le courage, et mes larmes s’arrêtèrent de couler.
— Tu ne dormais donc pas ? me demanda-t-elle doucement.
— Ce n’est pas ma faute.
— Je ne te gronde pas ; alors tu as entendu tout ce qu’a dit Jérôme ?
— Oui, tu n’es pas ma maman, mais lui n’est pas mon père.
Je ne prononçai pas ces quelques mots sur le même ton, car si j’étais désolé d’apprendre qu’elle n’était pas ma mère, j’étais heureux, j’étais presque fier de savoir que lui n’était pas mon père. De là une contradiction dans mes sentiments qui se traduisit dans ma voix.
Mais mère Barberin ne parut pas y prendre attention.
— J’aurais peut-être dû, dit-elle, te faire connaître la vérité ; mais tu étais si bien mon enfant, que je ne pouvais pas te dire, sans raison, que je n’étais pas ta vraie mère ! Ta mère, pauvre petit, tu l’as entendu, on ne la connaît pas. Est-elle vivante, ne l’est-elle plus ? On n’en sait rien. Un matin, à Paris, comme Jérôme allait à son travail et qu’il passait dans une rue qu’on appelle l’avenue de Breteuil, qui est large et plantée d’arbres, il entendit les cris d’un enfant. Ils semblaient partir de l’embrasure de la porte d’un jardin. C’était au mois de février ; il faisait petit jour. Il s’approcha de la porte et aperçut un enfant couché sur le seuil. Comme il regardait autour de lui pour appeler quelqu’un, il vit un homme sortir de derrière un gros arbre et se sauver. Sans doute cet homme s’était caché là pour voir si l’on trouverait l’enfant qu’il avait lui-même placé dans l’embrasure de la porte. Voilà Jérôme bien embarrassé, car l’enfant criait de toutes ses forces, comme s’il avait compris qu’un secours lui était arrivé, et qu’il ne fallait pas le laisser échapper. Pendant que Jérôme réfléchissait à ce qu’il devait faire, il fut rejoint par d’autres ouvriers, et l’on décida qu’il fallait porter l’enfant chez le commissaire de police. Il ne cessait pas de crier. Sans doute il souffrait du froid. Mais comme dans le bureau du commissaire il faisait très-chaud, et que les cris continuaient, on pensa qu’il souffrait de la faim, et l’on alla chercher une voisine qui voudrait bien lui donner le sein. Il se jeta dessus. Il était véritablement affamé. Alors on le déshabilla devant le feu. C’était un beau garçon de cinq ou six mois, rose, gros, gras, superbe ; les langes et les linges dans lesquels il était enveloppé disaient clairement qu’il appartenait à des parents riches. C’était donc un enfant qu’on avait volé et ensuite abandonné. Ce fut au moins ce que le commissaire expliqua. Qu’allait-on en faire ? Après avoir écrit tout ce que Jérôme savait, et aussi la description de l’enfant avec celle de ses langes qui n’étaient pas marqués, le commissaire dit qu’il allait l’envoyer à l’hospice des Enfants trouvés, si personne, parmi tous ceux qui étaient là, ne voulait s’en charger : c’était un bel enfant, sain, solide qui ne serait pas difficile à élever ; ses parents qui bien sûr allaient le chercher, récompenseraient généreusement ceux qui en auraient pris soin. Là-dessus, Jérôme s’avança et dit qu’il voulait bien s’en charger ; on le lui donna. J’avais justement un enfant du même âge ; mais ce n’était pas pour moi une affaire d’en nourrir deux. Ce fut ainsi que je devins ta mère.
— Oh ! maman.
— Au bout de trois mois, je perdis mon enfant, et alors je m’attachai à toi davantage. J’oubliais que tu n’étais pas vraiment notre fils. Malheureusement Jérôme ne l’oublia pas, lui, et, voyant au bout de trois ans que tes parents ne t’avaient pas cherché, au moins qu’ils ne t’avaient pas trouvé, il voulut te mettre à l’hospice. Tu as entendu pourquoi je ne lui ai pas obéi.
— Oh ! pas à l’hospice, m’écriai-je en me cramponnant à elle ; mère Barberin, pas à l’hospice, je t’en prie !
— Non, mon enfant, tu n’iras pas. J’arrangerai cela. Jérôme n’est pas un méchant homme, tu verras ; c’est le chagrin, c’est la peur du besoin qui l’ont monté. Nous travaillerons, tu travailleras aussi.
— Oui, tout ce que tu voudras. Mais pas l’hospice.
— Tu n’iras pas ; mais à une condition, c’est que tu vas tout de suite dormir. Il ne faut pas, quand il rentrera, qu’il te trouve éveillé.
Et, après m’avoir embrassé, elle me tourna le nez contre la muraille.
J’aurais voulu m’endormir ; mais j’avais été trop rudement ébranlé, trop profondément ému pour trouver à volonté le calme et le sommeil.
Ainsi, mère Barberin, si bonne, si douce pour moi n’était pas ma vraie mère ! mais alors qu’était donc une vraie mère ? Meilleure, plus douce encore ? Oh ! non, ce n’était pas possible.
Mais ce que je comprenais, ce que je sentais parfaitement, c’est qu’un père eût été moins dur que Barberin, et ne m’eût pas regardé avec ces yeux froids, le bâton levé.
Il voulait m’envoyer à l’hospice ; mère Barberin pourrait-elle l’en empêcher ?
Qu’était-ce que l’hospice ?
Il y avait au village deux enfants qu’on appelait « les enfants de l’hospice » ; ils avaient une plaque de plomb au cou avec un numéro ; ils étaient mal habillés et sales ; on se moquait d’eux ; on les battait ; les autres enfants les poursuivaient souvent comme on poursuit un chien perdu pour s’amuser, et aussi parce qu’un chien perdu n’a personne pour le défendre.
Ah ! je ne voulais pas être comme ces enfants ; je ne voulais pas avoir un numéro au cou, je ne voulais pas qu’on courût après moi en criant : « À l’hospice ! à l’hospice ! »
Cette pensée seule me donnait froid et me faisait claquer les dents.
Et je ne dormais pas.
Et Barberin allait rentrer.
Heureusement il ne revint pas aussitôt qu’il avait dit et le sommeil arriva pour moi avant lui.
III
LA TROUPE DU SIGNOR VITALIS
Sans doute je dormis toute la nuit sous l’impression du chagrin et de la crainte, car le lendemain matin en m’éveillant, mon premier mouvement fut de tâter mon lit et de regarder autour de moi, pour être certain qu’on ne m’avait pas emporté.
Pendant toute la matinée, Barberin ne me dit rien, et je commençai à croire que le projet de m’envoyer à l’hospice était abandonné. Sans doute mère Barberin avait parlé ; elle l’avait décidé à me garder.
Mais comme midi sonnait, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre.
Effrayé, je tournai les yeux vers mère Barberin pour implorer son secours. Mais, à la dérobée, elle me fit un signe qui disait que je devais obéir ; en même temps un mouvement de sa main me rassura : il n’y avait rien à craindre.
Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin.
La distance est longue de notre maison au village : il y en a bien pour une heure de marche. Cette heure s’écoula sans qu’il m’adressât une seule fois la parole. Il marchait devant, doucement, en clopinant, sans que sa tête fît un seul mouvement, et de temps en temps il se retournait tout d’une pièce pour voir si je le suivais.
Où me conduisait-il ?
Cette question m’inquiétait, malgré le signe rassurant que m’avait fait mère Barberin, et pour me soustraire à un danger que je pressentais sans le connaître, je pensais à me sauver.
Dans ce but, je tâchais de rester en arrière ; quand je serais assez loin, je me jetterais dans le fossé, et il ne pourrait pas me rejoindre.
Tout d’abord, il se contenta de me dire de marcher sur ses talons ; mais bientôt, il devina sans doute mon intention et me prit par le poignet.
Je n’avais plus qu’à le suivre, ce que je fis.
Ce fut ainsi que nous entrâmes dans le village, et tout le monde sur notre passage se retourna pour nous voir passer, car j’avais l’air d’un chien hargneux qu’on mène en laisse.
Comme nous passions devant le café, un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barberin et l’engagea à entrer.
Celui-ci me prenant par l’oreille me fit passer devant lui, et quand nous fûmes entrés il referma la porte.
Je me sentis soulagé ; le café ne me paraissait pas un endroit dangereux ; et puis d’un autre côté c’était le café, et il y avait longtemps que j’avais envie de franchir sa porte.
Le café, le café de l’auberge Notre-Dame ! qu’est-ce que cela pouvait bien être ?
Combien de fois m’étais-je posé cette question !
J’avais vu des gens sortir du café la figure enluminée et les jambes flageolantes ; en passant devant sa porte, j’avais souvent entendu des cris et des chansons qui faisaient trembler les vitres.
Que faisait-on là dedans ? Que se passait-il derrière ses rideaux rouges ?
J’allais donc le savoir.
Tandis que Barberin se plaçait à une table avec le maître du café qui l’avait engagé à entrer, j’allai m’asseoir près de la cheminée et regardai autour de moi.
Dans le coin opposé à celui que j’occupais, se trouvait un grand vieillard à barbe blanche, qui portait un costume bizarre et tel que je n’en avais jamais vu.
Sur ses cheveux qui tombaient en longues mèches sur ses épaules, était posé un haut chapeau de feutre gris orné de plumes vertes et rouges. Une peau de mouton, dont la laine était en dedans, le serrait à la taille. Cette peau n’avait pas de manches, et, par deux trous ouverts aux épaules, sortaient les bras vêtus d’une étoffe de velours qui autrefois avait dû être bleue. De grandes guêtres en laine lui montaient jusqu’aux genoux, et elles étaient serrées par des rubans rouges qui s’entre-croisaient plusieurs fois autour des jambes.
Il se tenait allongé sur sa chaise, le menton appuyé dans sa main droite ; son coude reposait sur son genou ployé.
Jamais je n’avais vu une personne vivante dans une attitude si calme ; il ressemblait à l’un des saints en bois de notre église.
Auprès de lui trois chiens tassés sous sa chaise se chauffaient sans remuer. Un caniche blanc, un barbet noir, et une petite chienne grise à la mine futée et douce ; le caniche était coiffé d’un vieux bonnet de police retenu sous son menton par une lanière de cuir.
Pendant que je regardais le vieillard avec une curiosité étonnée, Barberin et le maître du café causaient à demi-voix et j’entendais qu’il était question de moi.
Barberin racontait qu’il était venu au village pour me conduire au maire, afin que celui-ci demandât aux hospices de lui payer une pension pour me garder.
C’était donc là ce que mère Barberin avait pu obtenir de son mari, et je compris tout de suite que si Barberin trouvait avantage à me garder près de lui, je n’avais plus rien à craindre.
Le vieillard, sans en avoir l’air, écoutait aussi ce qui se disait ; tout à coup il étendit la main droite vers moi, et s’adressant à Barberin :
— C’est cet enfant-là qui vous gêne ? dit-il avec un accent étranger.
— Lui-même.
— Et vous croyez que l’administration des hospices de votre département va vous payer des mois de nourrice.
— Dame, puisqu’il n’a pas de parents et qu’il est à ma charge, il faut bien que quelqu’un paye pour lui ; c’est juste, il me semble.
— Je ne dis pas non, mais croyez-vous que tout ce qui est juste se fait ?
— Pour ça non.
— Eh bien, je crois bien que vous n’obtiendrez jamais la pension que vous demandez.
— Alors, il ira à l’hospice ; il n’y a pas de loi qui le force à rester quand même dans ma maison si je n’en veux pas.
— Vous avez consenti autrefois à le recevoir, c’était prendre l’engagement de le garder.
— Eh bien, je ne le garderai pas ; et quand je devrais le mettre dans la rue, je m’en débarrasserai.
— Il y aurait peut-être un moyen de vous en débarrasser tout de suite, dit le vieillard après un moment de réflexion, et même de gagner à cela quelque chose.
— Si vous me donnez ce moyen-là, je vous paye une bouteille, et de bon cœur encore.
— Commandez la bouteille, et votre affaire est faite.
— Sûrement ?
— Sûrement.
Le vieillard quittant sa chaise, vint s’asseoir vis-à-vis de Barberin. Chose étrange, au moment où il se leva, sa peau de mouton fut soulevée par un mouvement que je ne m’expliquai pas : c’était à croire qu’il avait un chien dans le bras gauche.
Qu’allait-il dire ? Qu’allait-il se passer ?
Je l’avais suivi des yeux avec une émotion cruelle.
— Ce que vous voulez, n’est-ce pas, dit-il, c’est que cet enfant ne mange pas plus longtemps votre pain ; ou bien s’il continue à le manger, c’est qu’on vous le paye.
— Juste ; parce que…
— Oh ! le motif, vous savez, ça ne me regarde pas, je n’ai donc pas besoin de le connaître ; il me suffit de savoir que vous ne voulez plus de l’enfant ; s’il en est ainsi, donnez-le-moi, je m’en charge.
— Vous le donner !
— Dame, ne voulez-vous pas vous en débarrasser ?
— Vous donner un enfant comme celui-là, un si bel enfant, car il est bel enfant, regardez-le.
— Je l’ai regardé.
— Rémi ! viens ici.
Je m’approchai de la table en tremblant.
— Allons n’aie pas peur, petit, dit le vieillard.
— Regardez, continua Barberin.
— Je ne dis pas que c’est un vilain enfant. Si c’était un vilain enfant, je n’en voudrais pas, les monstres ce n’est pas mon affaire.
— Ah ! si c’était un monstre à deux têtes, ou seulement un nain…
— Vous ne parleriez pas de l’envoyer à l’hospice. Vous savez qu’un monstre a de la valeur et qu’on peut en tirer profit, soit en le louant, soit en l’exploitant soi-même. Mais celui-là n’est ni nain ni monstre ; bâti comme tout le monde il n’est bon à rien.
— Il est bon pour travailler.
— Il est bien faible.
— Lui faible, allons donc, il est fort comme un homme, et solide, et sain ; tenez, voyez ses jambes, en avez-vous jamais vu de plus droites ?
Barberin releva mon pantalon.
— Trop mince, dit le vieillard.
— Et ses bras ? continua Barberin.
— Les bras sont comme les jambes ; ça peut aller ; mais ça ne résisterait pas à la fatigue et à la misère.
— Lui, ne pas résister ; mais tâtez donc, voyez, tâtez vous-même.
Le vieillard passa sa main décharnée sur mes jambes en les palpant, secouant la tête et faisant la moue.
J’avais déjà assisté à une scène semblable quand le marchand était venu pour acheter notre vache. Lui aussi l’avait tâtée et palpée. Lui aussi avait secoué la tête et fait la moue : ce n’était pas une bonne vache, il lui serait impossible de la revendre, et cependant il l’avait achetée, puis emmenée.
Le vieillard allait-il m’acheter et m’emmener ; ah ! mère Barberin, mère Barberin !
Malheureusement elle n’était pas là pour me défendre.
Si j’avais osé j’aurais dit que la veille Barberin m’avait précisément reproché d’être délicat et de n’avoir ni bras ni jambes ; mais je compris que cette interruption ne servirait à rien qu’à m’attirer une bourrade, et je me tus.
— C’est un enfant comme il y en a beaucoup, dit le vieillard, voilà la vérité, mais un enfant des villes ; aussi est-il bien certain qu’il ne sera jamais bon à rien pour le travail de la terre ; mettez-le un peu devant la charrue à piquer les bœufs, vous verrez combien il durera.
— Dix ans.
— Pas un mois.
— Mais voyez-le donc.
— Voyez-le vous-même.
J’étais au bout de la table entre Barberin et le vieillard, poussé par l’un, repoussé par l’autre.
— Enfin, dit le vieillard, tel qu’il est je le prends. Seulement, bien entendu, je ne vous l’achète pas, je vous le loue. Je vous en donne vingt francs par an.
— Vingt francs !
— C’est un bon prix et je paye d’avance : vous touchez quatre belles pièces de cent sous et vous êtes débarrassé de l’enfant.
— Mais si je le garde, l’hospice me payera plus de dix francs par mois.
— Mettez-en sept, mettez-en huit, je connais les prix, et encore faudra-t-il que vous le nourrissiez.
— Il travaillera.
— Si vous le sentiez capable de travailler, vous ne voudriez pas le renvoyer. Ce n’est pas pour l’argent de leur pension qu’on prend les enfants de l’hospice, c’est pour leur travail ; on en fait des domestiques qui payent et ne sont pas payés. Encore un coup, si celui-là était en état de vous rendre des services, vous le garderiez.
— En tous cas, j’aurais toujours les dix francs.
— Et si l’hospice au lieu de vous le laisser, le donne à un autre, vous n’aurez rien du tout ; tandis qu’avec moi, pas de chance à courir : toute votre peine consiste à allonger la main.
Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse de cuir dans laquelle il prit quatre pièces d’argent qu’il étala sur la table en les faisant sonner.
— Pensez-donc, s’écria Barberin, que cet enfant aura des parents un jour ou l’autre ?
— Qu’importe ?
— Il y aura du profit pour ceux qui l’auront élevé ; si je n’avais pas compté là-dessus je ne m’en serais jamais chargé.
Ce mot de Barberin : « Si je n’avais pas compté sur ses parents, je ne me serais jamais chargé de lui, » me fit le détester un peu plus encore. Quel méchant homme.
— Et c’est parce que vous ne comptez plus sur ses parents, dit le vieillard, que vous le mettez à la porte. Enfin à qui s’adresseront-ils, ces parents, si jamais ils paraissent ? à vous, n’est-ce pas, et non à moi qu’ils ne connaissent pas ?
— Et si c’est vous qui les retrouvez.
— Alors convenons que s’il a des parents un jour, nous partagerons le profit, et je mets trente francs.
— Mettez-en quarante.
— Non pour les services qu’il me rendra, ce n’est pas possible.
— Et quels services voulez-vous qu’il vous rende. Pour de bonnes jambes, il a de bonnes jambes, pour de bons bras, il a de bons bras, je m’en tiens à ce que j’ai dit, mais enfin à quoi le trouvez-vous propre ?
Le vieillard regarda Barberin d’un air narquois et vidant son verre à petits coups :
— À me tenir compagnie, dit-il ; je me fais vieux et le soir quelquefois après une journée de fatigue, quand le temps est mauvais, j’ai des idées tristes ; il me distraira.
— Il est sûr que pour cela les jambes seront assez solides.
— Mais pas trop, car il faudra danser, et puis sauter, et puis marcher, et puis après avoir marché, sauter encore ; enfin il prendra place dans la troupe du signor Vitalis.
— Et où est-elle votre troupe ?
— Le signor Vitalis c’est moi, comme vous devez vous en douter ; la troupe, je vais vous la montrer, puisque vous désirez faire sa connaissance.
Disant cela il ouvrit sa peau de mouton, et prit dans sa main un animal étrange qu’il tenait sous son bras gauche serré contre sa poitrine.
C’était cet animal qui plusieurs fois avait fait soulever la peau de mouton ; mais ce n’était pas un petit chien comme je l’avais pensé.
Quelle pouvait être cette bête ?
Était-ce même une bête ?
Je ne trouvais pas de nom à donner à cette créature bizarre que je voyais pour la première fois, et que je regardais avec stupéfaction.
Elle était vêtue d’une blouse rouge bordée d’un galon doré, mais les bras et les jambes étaient nus, car c’étaient bien des bras et des jambes qu’elle avait et non des pattes ; seulement ces bras et ces jambes étaient couverts d’une peau noire, et non blanche ou carnée.
Noire aussi était la tête grosse à peu près comme mon poing fermé ; la face était large et courte, le nez était retroussé avec des narines écartées, les lèvres étaient jaunes ; mais ce qui plus que tout le reste me frappa, ce furent deux yeux très-rapprochés l’un de l’autre, d’une mobilité extrême, brillants comme des miroirs.
— Ah ! le vilain singe ! s’écria Barberin.
Ce mot me tira de ma stupéfaction, car si je n’avais jamais vu des singes j’en avais au moins entendu parler ; ce n’était donc pas un enfant noir que j’avais devant moi, c’était un singe.
— Voici le premier sujet de ma troupe, dit Vitalis, c’est M. Joli-Cœur. Joli-Cœur, mon ami, saluez la société.
Joli-Cœur porta sa main fermée à ses lèvres et nous envoya à tous un baiser.
— Maintenant, continua Vitalis étendant sa main vers le caniche blanc, à un autre : le signor Capi va avoir l’honneur de présenter ses amis à l’estimable société ici présente.
À ce commandement le caniche qui jusque-là n’avait pas fait le plus petit mouvement, se leva vivement et se dressant sur ses pattes de derrière il croisa ses deux pattes de devant sur sa poitrine, puis il salua son maître si bas que son bonnet de police toucha le sol.
Ce devoir de politesse accompli, il se tourna vers ses camarades, et d’une patte, tandis qu’il tenait toujours l’autre sur sa poitrine, il leur fit signe d’approcher.
Les deux chiens, qui avaient les yeux attachés sur leur camarade, se dressèrent aussitôt, et se donnant chacun une patte de devant, comme on se donne la main dans le monde, ils firent gravement six pas en avant puis après trois pas en arrière, et saluèrent la société.
— Celui que j’appelle Capi, continua Vitalis, autrement dit Capitano en italien, est le chef des chiens, c’est lui qui, comme le plus intelligent, transmet mes ordres. Ce jeune élégant à poil noir est le signor Zerbino, ce qui signifie le galant, nom qu’il mérite à tous les égards. Quant à cette jeune personne à l’air modeste, c’est la signora Dolce, une charmante Anglaise qui n’a pas volé son nom de douce. C’est avec ces sujets remarquables à des titres différents que j’ai l’avantage de parcourir le monde en gagnant ma vie plus ou moins bien, suivant les hasards de la bonne ou de la mauvaise fortune. Capi !
Le caniche croisa les pattes.
— Capi, venez ici, mon ami et soyez assez aimable, je vous prie, — ce sont des personnages bien élevés à qui je parle toujours poliment, — soyez assez aimable pour dire à ce jeune garçon qui vous regarde avec des yeux ronds comme des billes, quelle heure il est.
Capi décroisa les pattes, s’approcha de son maître, écarta la peau de mouton, fouilla dans la poche du gilet, en tira une grosse montre en argent, regarda le cadran et jappa deux fois distinctement ; puis après ces deux jappements bien accentués, d’une voix forte et nette, il en poussa trois autres plus faibles.
Il était en effet deux heures et trois quarts.
— C’est bien, dit Vitalis, je vous remercie, signor Capi ; et, maintenant, je vous prie d’inviter la signora Dolce à nous faire le plaisir de danser un peu à la corde.
Capi fouilla aussitôt dans la poche de la veste de son maître et en tira une corde. Il fit un signe à Zerbino et celui-ci alla vivement lui faire vis-à-vis. Alors Capi lui jeta un bout de la corde, et tous deux se mirent gravement à la faire tourner.
Quand le mouvement fut régulier, Dolce s’élança dans le cercle et sauta légèrement en tenant ses beaux yeux tendres sur les yeux de son maître.
— Vous voyez, dit celui-ci, que mes élèves sont intelligents ; mais l’intelligence ne s’apprécie à toute sa valeur que par la comparaison. Voilà pourquoi j’engage ce garçon dans ma troupe ; il fera le rôle d’une bête et l’esprit de mes élèves n’en sera que mieux apprécié.
— Oh ! pour faire la bête, interrompit Barberin.
— Il faut avoir de l’esprit, continua Vitalis, et je crois que ce garçon n’en manquera pas quand il aura pris quelques leçons. Au reste nous verrons bien. Et pour commencer nous allons en avoir tout de suite une preuve. S’il est intelligent il comprendra qu’avec le signor Vitalis on a la chance de se promener, de parcourir la France et dix autres pays, de mener une vie libre au lieu de rester derrière des bœufs, à marcher tous les jours dans le même champ, du matin au soir. Tandis que s’il n’est pas intelligent, il pleurera, il criera, et comme le signor Vitalis n’aime pas les enfants méchants, il ne l’emmènera pas avec lui. Alors l’enfant méchant ira à l’hospice où il faut travailler dur et manger peu.
J’étais assez intelligent pour comprendre ces paroles, mais de la compréhension à l’exécution, il y avait une terrible distance à franchir.
Assurément les élèves du signor Vitalis étaient bien drôles, bien amusants, et ce devait être bien amusant aussi de se promener toujours ; mais pour les suivre et se promener avec eux il fallait quitter mère Barberin.
Il est vrai que si je refusais, je ne resterais peut-être pas avec mère Barberin, on m’enverrait à l’hospice.
Comme je demeurais troublé, les larmes dans les yeux, Vitalis me frappa doucement du bout du doigt sur la joue.
— Allons, dit-il, l’enfant comprend puisqu’il ne crie pas, la raison entrera dans cette petite tête, et demain…
— Oh ! monsieur, m’écriai-je ; laissez-moi à maman Barberin, je vous en prie !
Mais avant d’en avoir dit davantage, je fus interrompu par un formidable aboiement de Capi.
En même temps le chien s’élança vers la table sur laquelle Joli-Cœur était resté assis.
Celui-ci, profitant d’un moment où tout le monde était tourné vers moi, avait doucement pris le verre de son maître, qui était plein de vin, et il était en train de le vider. Mais Capi, qui faisait bonne garde, avait vu cette friponnerie du singe, et, en fidèle serviteur qu’il était, il avait voulu l’empêcher.
— Monsieur Joli-Cœur, dit Vitalis, d’une voix sévère, vous êtes un gourmand et un fripon ; allez vous mettre là-bas, dans le coin, le nez tourné contre la muraille, et vous, Zerbino, montez la garde devant lui ; s’il bouge, donnez-lui une bonne claque. Quant à vous, monsieur Capi, vous êtes un bon chien ; tendez-moi la patte que je vous la serre.
Tandis que le singe obéissait en poussant des petits cris étouffés, le chien, heureux, fier, tendait la patte à son maître.
— Maintenant, continua Vitalis, revenons à nos affaires. Je vous donne donc trente francs.
— Non, quarante.
Une discussion s’engagea ; mais bientôt Vitalis l’interrompit :
— Cet enfant doit s’ennuyer ici, dit-il ; qu’il aille donc se promener dans la cour de l’auberge et s’amuser.
En même temps il fit un signe à Barberin.
— Oui, c’est cela, dit celui-ci, va dans la cour, mais n’en bouge pas avant que je t’appelle, ou sinon je me fâche.
Je n’avais qu’à obéir, ce que je fis.
J’allai donc dans la cour, mais je n’avais pas le cœur à m’amuser. Je m’assis sur une pierre et restai à réfléchir.
C’était mon sort qui se décidait en ce moment même. Quel allait-il être ? Le froid et l’angoisse me faisait grelotter.
La discussion entre Vitalis et Barberin dura longtemps, car il s’écoula plus d’une heure avant que celui-ci vînt dans la cour.
Enfin je le vis paraître : il était seul. Venait-il me chercher pour me remettre aux mains de Vitalis ?
— Allons, me dit-il, en route pour la maison.
La maison ! Je ne quitterais donc pas mère Barberin ?
J’aurais voulu l’interroger, mais je n’osai pas, car il paraissait de fort mauvaise humeur.
La route se fit silencieusement.
Mais environ dix minutes avant d’arriver, Barberin qui marchait devant s’arrêta :
— Tu sais, me dit-il en me prenant rudement par l’oreille, que si tu racontes un seul mot de ce que tu as entendu aujourd’hui, tu le paieras cher ; ainsi, attention !
IV
LA MAISON MATERNELLE
— Eh bien ! demanda mère Barberin quand nous rentrâmes, qu’a dit le maire ?
— Nous ne l’avons pas vu.
— Comment, vous ne l’avez pas vu ?
— Non, j’ai rencontré des amis au café Notre-Dame, et quand nous sommes sortis, il était trop tard ; nous y retournerons demain.
Ainsi Barberin avait bien décidément renoncé à son marché avec l’homme aux chiens.
En route je m’étais plus d’une fois demandé s’il n’y avait pas une ruse dans ce retour à la maison, mais ces derniers mots chassèrent les doutes qui s’agitaient confusément dans mon esprit troublé. Puisque nous devions retourner le lendemain au village pour voir le maire, il est certain que Barberin n’avait pas accepté les propositions de Vitalis.
Cependant malgré ses menaces j’aurais parlé de mes doutes à mère Barberin, si j’avais pu me trouver seul un instant avec elle, mais de toute la soirée Barberin ne quitta pas la maison, et je me couchai sans avoir pu trouver l’occasion que j’attendais.
Je m’endormis en me disant que ce serait pour le lendemain.
Mais le lendemain, quand je me levai, je n’aperçus point mère Barberin.
Comme je la cherchais en rôdant autour de la maison, Barberin me demanda ce que je voulais.
— Maman.
— Elle est au village, elle ne reviendra qu’après midi.
Sans savoir pourquoi, cette absence m’inquiéta. Elle n’avait pas dit la veille qu’elle irait au village. Comment n’avait-elle pas attendu pour nous accompagner, puisque nous devions y aller après midi ? Serait-elle revenue quand nous partirions ?
Une crainte vague me serra le cœur ; sans me rendre compte du danger qui me menaçait, j’eus cependant le pressentiment d’un danger.
Barberin me regardait d’un air étrange, peu fait pour me rassurer.
Voulant échapper à ce regard, je m’en allai dans le jardin.
Ce jardin, qui n’était pas grand, avait pour nous une valeur considérable, car c’était lui qui nous nourrissait, nous fournissant, à l’exception du blé, à peu près tout ce que nous mangions : pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets. Aussi n’y trouvait-on pas de terrain perdu. Cependant mère Barberin m’en avait donné un petit coin dans lequel j’avais réuni une infinité de plantes, d’herbes, de mousse arrachées le matin à la lisière des bois ou le long des haies pendant que je gardais notre vache, et replantées l’après-midi dans mon jardin, pêle-mêle, au hasard, les unes à côté des autres.
Assurément ce n’était point un beau jardin avec des allées bien sablées et des plates-bandes divisées au cordeau, pleines de fleurs rares ; ceux qui passaient dans le chemin ne s’arrêtaient point pour le regarder par-dessus la haie d’épine tondue au ciseau, mais tel qu’il était, il avait ce mérite et ce charme de m’appartenir ; il était ma chose, mon bien, mon ouvrage ; je l’arrangeais comme je voulais, selon ma fantaisie de l’heure présente, et quand j’en parlais, ce qui m’arrivait vingt fois par jour, je disais « mon jardin ».
C’était pendant l’été précédent que j’avais récolté et planté ma collection, c’était donc au printemps qu’elle devait sortir de terre, les espèces précoces sans même attendre la fin de l’hiver, les autres successivement.
De là ma curiosité, en ce moment vivement excitée.
Déjà les jonquilles montraient leurs boutons, dont la pointe jaunissait, les lilas de terre poussaient leurs petites hampes pointillées de violet, et du centre des feuilles ridées des primevères sortaient des bourgeons qui semblaient prêts à s’épanouir.
Comment tout cela fleurirait-il ?
C’était ce que je venais voir tous les jours avec curiosité.
Mais il y avait une autre partie de mon jardin que j’étudiais avec un sentiment plus vif que la curiosité, c’est-à-dire avec une sorte d’anxiété.
Dans cette partie de jardin j’avais planté un légume qu’on m’avait donné et qui était presque inconnu dans notre village, — des topinambours. On m’avait dit qu’il produisait des tubercules bien meilleurs que ceux des pommes de terre, car ils avaient le goût de l’artichaut, du navet et plusieurs autres légumes encore. Ces belles promesses m’avaient inspiré l’idée d’une surprise à faire à mère Barberin. Je ne lui disais rien de ce cadeau, je plantais mes tubercules dans mon jardin ; quand ils poussaient des tiges, je lui laissais croire que c’était des fleurs ; puis un beau jour, quand le moment de la maturité était arrivé, je profitais de l’absence de mère Barberin pour arracher mes topinambours, je les faisais cuire moi-même, comment ? je ne savais pas trop, mais mon imagination ne s’inquiétait pas d’un aussi petit détail, et quand mère Barberin rentrait pour souper, je lui servais mon plat.
Qui était bien étonnée ? Mère Barberin.
Qui était bien contente ? Encore mère Barberin.
Car nous avions un nouveau mets pour remplacer nos éternelles pommes de terre, et mère Barberin n’avait plus autant à souffrir de la vente de la pauvre Roussette.
Et l’inventeur de ce nouveau mets, c’était moi, moi Rémi ; j’étais donc utile dans la maison.
Avec un pareil projet dans la tête, on comprend combien je devais être attentif à la levée de mes topinambours ; tous les jours je venais regarder le coin dans lequel je les avais plantés, et il semblait à mon impatience qu’ils ne pousseraient jamais.
J’étais à deux genoux sur la terre, appuyé sur mes mains, le nez baissé dans mes topinambours, quand j’entendis crier mon nom d’une voix impatiente. C’était Barberin qui m’appelait.
Que me voulait-il ?
Je me hâtai de rentrer à la maison.
Quelle ne fut pas ma surprise d’apercevoir devant la cheminée Vitalis et ses chiens.
Instantanément je compris ce que Barberin voulait de moi.
Vitalis venait me chercher, et c’était pour que mère Barberin ne pût pas me défendre que le matin Barberin l’avait envoyée au village.
Sentant bien que je n’avais ni secours ni pitié à attendre de Barberin, je courus à Vitalis :
— Oh ! monsieur, m’écriai-je, je vous en prie, ne m’emmenez pas.
Et j’éclatai en sanglots.
— Allons, mon garçon, me dit-il assez doucement, tu ne seras pas malheureux avec moi, je ne bats point les enfants, et puis tu auras la compagnie de mes élèves qui sont très-amusants. Qu’as-tu à regretter ?
— Mère Barberin ! mère Barberin !
— En tous cas, tu ne resteras pas ici, dit Barberin, en me prenant rudement par l’oreille ; monsieur ou l’hospice, choisis !
— Non ! mère Barberin !
— Ah ! tu m’ennuies à la fin, s’écria Barberin, qui se mit dans une terrible colère ; s’il faut te chasser d’ici à coups de bâton, c’est ce que je vas faire.
— Cet enfant regrette sa mère Barberin, dit Vitalis ; il ne faut pas le battre pour cela ; il a du cœur, c’est bon signe.
— Si vous le plaignez, il va hurler plus fort.
— Maintenant, aux affaires.
Disant cela, Vitalis étala sur la table huit pièces de cinq francs, que Barberin en un tour de main, fit disparaître dans sa poche.
— Où est le paquet ? demanda Vitalis.
— Le voilà, répondit Barberin en montrant un mouchoir en cotonnade bleue noué par les quatre coins.
Vitalis défit ces nœuds et regarda ce que renfermait le mouchoir ; il s’y trouvait deux de mes chemises et un pantalon de toile.
— Ce n’est pas de cela que nous étions convenus, dit Vitalis, vous deviez me donner ses affaires et je ne trouve là que des guenilles.
— Il n’en a pas d’autres.
— Si j’interrogeais l’enfant, je suis sûr qu’il dirait que ce n’est pas vrai. Mais je ne veux pas disputer là-dessus. Je n’ai pas le temps. Il faut se mettre en route. Allons, mon petit. Comment se nomme-t-il ?
— Rémi.
— Allons, Rémi, prend ton paquet, et passe devant Capi, en avant, marche !
Je tendis les mains vers lui, puis vers Barberin, mais tous deux détournèrent la tête, et je sentis que Vitalis me prenait par le poignet.
Il fallut marcher.
Ah ! la pauvre maison, il me sembla, quand j’en franchis le seuil, que j’y laissais un morceau de ma peau.
Vivement, je regardai autour de moi, mes yeux obscurcis par les larmes ne virent personne à qui demander secours : personne sur la route, personne dans les prés d’alentour.
Je me mis à appeler :
— Maman, mère Barberin !
Mais personne ne répondit à ma voix, qui s’éteignit dans un sanglot.
Il fallut suivre Vitalis, qui ne m’avait pas lâché le poignet.
— Bon voyage ! cria Barberin.
Et il rentra dans la maison.
Hélas ! c’était fini.
— Allons, Rémi, marchons, mon enfant, dit Vitalis.
Et sa main tira mon bras.
Alors je me mis à marcher près de lui. Heureusement il ne pressa point son pas, et même je crois bien qu’il le régla sur le mien.
Le chemin que nous suivions s’élevait en lacets le long de la montagne, et, à chaque détour, j’apercevais la maison de mère Barberin qui diminuait, diminuait. Bien souvent j’avais parcouru ce chemin et je savais que quand nous serions à son dernier détour, j’apercevrais la maison encore une fois, puis qu’aussitôt que nous aurions fait quelques pas sur le plateau, ce serait fini ; plus rien ; devant moi l’inconnu ; derrière moi la maison où j’avais vécu jusqu’à ce jour si heureux, et que sans doute je ne reverrais jamais.
Heureusement la montée était longue ; cependant à force de marcher, nous arrivâmes au haut.
Vitalis ne m’avait pas lâché le poignet.
— Voulez-vous me laisser reposer un peu ? lui dis-je.
— Volontiers, mon garçon.
Et, pour la première fois, il desserra la main.
Mais, en même temps, je vis son regard se diriger vers Capi, et faire un signe que celui-ci comprit.
Aussitôt, comme un chien de berger, Capi abandonna la tête de la troupe et vint se placer derrière moi.
Cette manœuvre acheva de me faire comprendre ce que le signe m’avait déjà indiqué : Capi était mon gardien ; si je faisais un mouvement pour me sauver, il devait me sauter aux jambes.
J’allai m’asseoir sur le parapet gazonné, et Capi me suivit de près.
Assis sur le parapet, je cherchai de mes yeux obscurcis par les larmes la maison de mère Barberin.
Au-dessous de nous descendait le vallon que nous venions de remonter, coupé de prés et de bois, puis tout au bas se dressait isolée la maison maternelle, celle où j’avais été élevé.
Elle était d’autant plus facile à trouver au milieu des arbres, qu’en ce moment même une petite colonne de fumée jaune sortait de sa cheminée, et, montant droit dans l’air tranquille, s’élevait jusqu’à nous.
Soit illusion du souvenir, soit réalité, cette fumée m’apportait l’odeur des feuilles de chêne qui avaient séché autour des branches des bourrées avec lesquelles nous avions fait du feu pendant tout l’hiver : il me sembla que j’étais encore au coin du foyer, sur mon petit banc, les pieds dans les cendres quand le vent s’engouffrant dans la cheminée nous rabattait la fumée au visage.
Malgré la distance et la hauteur à laquelle nous nous trouvions, les choses avaient conservé leurs formes nettes et distinctes, diminuées, rapetissées seulement.
Sur le fumier, notre poule, la dernière qui restât, allait de çà de là, mais elle n’avait plus sa grosseur ordinaire, et si je ne l’avais pas bien connue je l’aurais prise pour un petit pigeon. Au bout de la maison je voyais le poirier au tronc crochu que pendant si longtemps j’avais transformé en cheval. Puis à côté du ruisseau qui traçait une ligne blanche dans l’herbe verte, je devinais le canal de dérivation que j’avais eu tant de peine à creuser pour qu’il allât mettre en mouvement une roue de moulin, fabriquée de mes mains ; laquelle roue, hélas ! n’avait jamais pu tourner malgré tout le travail qu’elle m’avait coûté.
Tout était là à sa place ordinaire, et ma brouette, et ma charrue faite d’une branche torse, et la niche dans laquelle j’élevais des lapins quand nous avions des lapins, et mon jardin, mon cher jardin.
Qui les verrait fleurir, mes pauvres fleurs ? Qui les arrangerait, mes topinambours ? Barberin sans doute, le méchant Barberin.
Encore un pas sur la route et à jamais tout cela disparaissait.
Tout à coup dans le chemin qui du village monte à la maison, j’aperçus au loin une coiffe blanche. Elle disparut derrière un groupe d’arbres ; puis elle reparut bientôt.
La distance était telle que je ne distinguais que la blancheur de la coiffe, qui comme un papillon printanier aux couleurs pâles, voltigeait entre les branches.
Mais il y a des moments où le cœur voit mieux et plus loin que les yeux les plus perçants : je reconnus mère Barberin ; c’était elle ; j’en étais certain ; je sentais que c’était elle.
— Eh bien ? demanda Vitalis, nous mettons-nous en route ?
— Oh ! monsieur, je vous en prie.
— C’est donc faux ce qu’on disait, tu n’as pas de jambes ; pour si peu, déjà fatigué ; cela ne nous promet pas de bonnes journées.
Mais je ne répondis pas, je regardais.
C’était mère Barberin ; c’était sa coiffe, c’était son jupon bleu, c’était elle.
Elle marchait à grands pas, comme si elle avait hâte de rentrer à la maison.
Arrivée devant notre barrière, elle la poussa et entra dans la cour qu’elle traversa rapidement.
Aussitôt je me levai debout sur le parapet, sans penser à Capi qui sauta près de moi.
Mère Barberin ne resta pas longtemps dans la maison. Elle ressortit et se mit à courir de çà de là, dans la cour, les bras étendus.
Elle me cherchait.
Je me penchai en avant, et de toutes mes forces, je me mis à crier :
— Maman ! maman !
Mais ma voix ne pouvait ni descendre, ni dominer le murmure du ruisseau, elle se perdit dans l’air.
— Qu’as-tu donc, demanda Vitalis, deviens-tu fou ?
Sans répondre, je restai les yeux attachés sur mère Barberin ; mais elle ne me savait pas si près d’elle et elle ne pensa pas à lever la tête.
Elle avait traversé la cour, et revenue sur le chemin, elle regardait de tous côtés.
Je criai plus fort, mais comme la première fois, inutilement.
Alors Vitalis, soupçonnant la vérité, monta aussi sur le parapet.
Il ne lui fallut pas longtemps pour apercevoir la coiffe blanche.
— Pauvre petit, dit-il à demi-voix.
— Oh ! je vous en prie, m’écriai-je encouragé par ces mots de compassion, laissez-moi retourner.
Mais il me prit par le poignet et me fit descendre sur la route.
— Puisque tu es reposé, dit-il, en marche, mon garçon.
Je voulus me dégager, mais il me tenait solidement.
— Capi, dit-il, Zerbino !
Et les deux chiens m’entourèrent : Capi derrière, Zerbino devant.
Il fallut suivre Vitalis.
Au bout de quelques pas, je tournai la tête.
Nous avions dépassé la crête de la montagne, et je ne vis plus ni notre vallée, ni notre maison ; tout au loin seulement des collines bleuâtres semblaient remonter jusqu’au ciel : mes yeux se perdirent dans des espaces sans bornes.
V
EN ROUTE
Pour acheter les enfants quarante francs, il n’en résulte pas nécessairement qu’on est un ogre et qu’on fait provision de chair fraîche afin de la manger.
Vitalis ne voulait pas me manger, et, par une exception rare chez les acheteurs d’enfants, ce n’était pas un méchant homme.
J’en eus bientôt la preuve.
C’était sur la crête même de la montagne qui sépare le bassin de la Loire de celui de la Dordogne qu’il m’avait repris le poignet, et, presque aussitôt nous avions commencé à descendre sur le versant exposé au Midi.
Après avoir marché environ un quart d’heure, il m’abandonna le bras.
— Maintenant, dit-il, chemine doucement près de moi ; mais n’oublie pas que, si tu voulais te sauver, Capi et Zerbino t’auraient bien vite rejoint ; ils ont les dents pointues.
Me sauver, je sentais que c’était maintenant impossible et que par suite il était inutile de le tenter.
Je poussai un soupir.
— Tu as le cœur gros, continua Vitalis, je comprends cela et ne t’en veux pas. Tu peux pleurer librement si tu en as envie. Seulement tâche de sentir que ce n’est pas pour ton malheur que je t’emmène. Que serais-tu devenu ? Tu aurais été très-probablement à l’hospice. Les gens qui t’ont élevé ne sont pas tes père et mère. Ta maman, comme tu dis, a été bonne pour toi et tu l’aimes, tu es désolé de la quitter, tout cela c’est bien ; mais fais réflexion qu’elle n’aurait pas pu te garder malgré son mari. Ce mari, de son côté, n’est peut-être pas aussi dur que tu crois. Il n’a pas de quoi vivre ; il est estropié ; il ne peut plus travailler, et il calcule qu’il ne peut pas se laisser mourir de faim pour te nourrir. Comprends aujourd’hui, mon garçon, que la vie est trop souvent une bataille dans laquelle on ne fait pas ce qu’on veut.
Sans doute c’étaient là des paroles de sagesse, ou tout au moins d’expérience. Mais il y avait un fait qui en ce moment, criait plus fort que toutes les paroles, — la séparation.
Je ne verrais plus celle qui m’avait élevé, qui m’avait caressé, celle que j’aimais, — ma mère.
Et cette pensée me serrait à la gorge, m’étouffait.
Cependant je marchais près de Vitalis, cherchant à me répéter ce qu’il venait de me dire.
Sans doute, tout cela était vrai ; Barberin n’était pas mon père, et il n’y avait pas de raisons qui l’obligeassent à souffrir la misère pour moi : il avait bien voulu me recueillir et m’élever ; si maintenant il me renvoyait, c’était parce qu’il ne pouvait plus me garder. Ce n’était pas de la présente journée que je devais me souvenir en pensant à lui, mais des années passées dans sa maison.
— Réfléchis à ce que je t’ai dit, petit, répétait de temps en temps Vitalis, tu ne seras pas trop malheureux avec moi.
Après avoir descendu une pente assez rapide, nous étions arrivés sur une vaste lande qui s’étendait plate et monotone à perte de vue. Pas de maisons, pas d’arbres. Un plateau couvert de bruyères rousses, avec çà et là des grandes nappes de genêts rabougris qui ondoyaient sous le souffle du vent.
— Tu vois, me dit Vitalis étendant la main sur la lande, qu’il serait inutile de chercher à te sauver, tu serais tout de suite repris par Capi et Zerbino.
Me sauver ! Je n’y pensais plus. Où aller d’ailleurs ? Chez qui ?
Après tout, ce grand vieillard à barbe blanche n’était peut-être pas aussi terrible que je l’avais cru d’abord ; et s’il était mon maître, peut-être ne serait-il pas un maître impitoyable.
Longtemps nous cheminâmes au milieu de tristes solitudes, ne quittant les landes que pour trouver des champs de brandes, et n’apercevant tout autour de nous, aussi loin que le regard s’étendait, que quelques collines arrondies aux sommets stériles.
Je m’étais fait une tout autre idée des voyages, et quand parfois dans mes rêveries enfantines j’avais quitté mon village, ç’avait été pour de belles contrées qui ne ressemblaient en rien à celle que la réalité me montrait.
C’était la première fois que je faisais une pareille marche d’une seule traite et sans me reposer.
Mon maître s’avançait d’un grand pas régulier, portant Joli-Cœur sur son épaule ou sur son sac, et autour de lui les chiens trottinaient sans s’écarter.
De temps en temps Vitalis leur disait un mot d’amitié, tantôt en français, tantôt dans une langue que je ne connaissais pas.
Ni lui, ni eux ne paraissaient penser à la fatigue. Mais il n’en était pas de même pour moi. J’étais épuisé. La lassitude physique s’ajoutant au trouble moral, m’avait mis à bout de forces.
Je traînais les jambes et j’avais la plus grande peine à suivre mon maître. Cependant je n’osais pas demander à m’arrêter.
— Ce sont tes sabots qui te fatiguent, me dit-il ; à Ussel je t’achèterai des souliers.
Ce mot me rendit le courage.
En effet, des souliers avaient toujours été ce que j’avais le plus ardemment désiré. Le fils du maire et aussi le fils de l’aubergiste avaient des souliers, de sorte que le dimanche, quand ils arrivaient à la messe, ils glissaient sur les dalles sonores, tandis que nous autres paysans, avec nos sabots, nous faisions un tapage assourdissant.
— Ussel, c’est encore loin ?
— Voilà un cri du cœur, dit Vitalis en riant ; tu as donc bien envie d’avoir des souliers, mon garçon ? Eh bien ! je t’en promets avec des clous dessous. Et je te promets aussi une culotte de velours, une veste et un chapeau. Cela va sécher tes larmes, j’espère, et te donner des jambes pour faire les six lieues qui nous restent.
Des souliers avec des clous dessous ! Je fus ébloui. C’était déjà une chose prodigieuse pour moi que ces souliers, mais quand j’entendis parler de clous, j’oubliai mon chagrin.
Non, bien certainement, mon maître n’était pas un méchant homme.
Est-ce qu’un méchant se serait aperçu que mes sabots me fatiguaient ?
Des souliers, des souliers à clous ! une culotte de velours ! une veste ! un chapeau !
Ah ! si mère Barberin me voyait, comme elle serait contente, comme elle serait fière de moi !
Quel malheur qu’Ussel fût encore si loin !
Malgré les souliers et la culotte de velours qui étaient au bout des six lieues qui nous restaient à faire, il me sembla que je ne pourrais pas marcher si loin.
Heureusement le temps vint à mon aide.
Le ciel, qui avait été bleu depuis notre départ, s’emplit peu à peu de nuages gris, et bientôt il se mit à tomber une pluie fine qui ne cessa plus.
Avec sa peau de mouton, Vitalis était assez bien protégé, et il pouvait abriter Joli-Cœur qui, à la première goutte de pluie, était promptement rentré dans sa cachette. Mais les chiens et moi, qui n’avions rien pour nous couvrir, nous n’avions pas tardé à être mouillés jusqu’à la peau ; encore les chiens pouvaient-ils de temps en temps se secouer, tandis que ce moyen naturel n’étant pas fait pour moi, je devais marcher sous un poids qui m’écrasait et me glaçait.
— T’enrhumes-tu facilement ? me demanda mon maître.
— Je ne sais pas ; je ne me rappelle pas avoir été jamais enrhumé.
— Bien cela, bien ; décidément il y a du bon en toi. Mais je ne veux pas t’exposer inutilement, nous n’irons pas plus loin aujourd’hui. Voilà un village là-bas, nous y coucherons.
Mais il n’y avait pas d’auberge dans ce village, et personne ne voulut recevoir une sorte de mendiant qui traînait avec lui un enfant et trois chiens aussi crottés les uns que les autres.
— On ne loge pas ici, nous disait-on.
Et l’on nous fermait la porte au nez. Nous allions d’une maison à l’autre, sans qu’aucune s’ouvrît.
Faudrait-il donc faire encore, et sans repos, les quatre lieues qui nous séparaient d’Ussel ? La nuit arrivait, la pluie nous glaçait, et pour moi je sentais mes jambes raides comme des barres de bois.
Ah ! la maison de mère Barberin !
Enfin un paysan plus charitable que ses voisins, voulut bien nous ouvrir la porte d’une grange. Mais avant de nous laisser entrer il nous imposa la condition de ne pas avoir de lumière.
— Donnez-moi vos allumettes, dit-il à Vitalis, je vous les rendrai demain, quand vous partirez.
Au moins nous avions un toit pour nous abriter et la pluie ne nous tombait plus sur le corps.
Vitalis était un homme de précaution qui ne se mettait pas en route sans provisions. Dans le sac de soldat qu’il portait sur ses épaules se trouvait une grosse miche de pain qu’il partagea en quatre morceaux.
Alors je vis pour la première fois comment il maintenait l’obéissance et la discipline dans sa troupe.
Pendant que nous errions de porte en porte, cherchant notre gîte, Zerbino était entré dans une maison, et il en était ressorti aussitôt rapidement, portant une croûte dans sa gueule. Vitalis n’avait dit qu’un mot :
— À ce soir, Zerbino.
Je ne pensais plus à ce vol, quand je vis, au moment où notre maître coupait la miche, Zerbino prendre une mine basse.
Nous étions assis sur deux bottes de fougère, Vitalis et moi, à côté l’un de l’autre, Joli-Cœur entre nous deux ; les trois chiens étaient alignés devant nous, Capi et Dolce les yeux attachés sur ceux de leur maître, Zerbino le nez incliné en avant, les oreilles rasées.
— Que le voleur sorte des rangs, dit Vitalis d’une voix de commandement, et qu’il aille dans un coin ; il se couchera sans souper.
Aussitôt Zerbino quitta sa place et marchant en rampant, il alla se cacher dans le coin que la main de son maître lui avait indiqué ; il se fourra tout entier sous un amas de fougère, et nous ne le vîmes plus, mais nous l’entendions souffler plaintivement avec des petits cris étouffés.
Cette exécution accomplie, Vitalis me tendit mon pain, et tout en mangeant le sien, il partagea par petites bouchées entre Joli-Cœur, Capi et Dolce les morceaux qui leur étaient destinés.
Pendant les derniers mois que j’avais vécu auprès de mère Barberin, je n’avais certes pas été gâté ; cependant le changement me parut rude.
Ah ! comme la soupe chaude que mère Barberin nous faisait tous les soirs, m’eût paru bonne, même sans beurre !
Comme le coin du feu m’eût été agréable ; comme je me serais glissé avec bonheur dans mes draps, en remontant les couvertures jusqu’à mon nez !
Mais, hélas ! il ne pouvait être question ni de draps, ni de couverture, et nous devions nous trouver encore bien heureux d’avoir un lit de fougère.
Brisé par la fatigue, les pieds écorchés par mes sabots, je tremblais de froid dans mes vêtements mouillés.
La nuit était venue tout à fait, mais je ne pensais pas à dormir.
— Tes dents claquent, dit Vitalis ; tu as froid ?
— Un peu.
Je l’entendis ouvrir son sac.
— Je n’ai pas une garde-robe bien montée, dit-il, mais voici une chemise sèche et un gilet dans lesquels tu pourras t’envelopper après avoir défait tes vêtements mouillés ; puis tu t’enfonceras sous la fougère, tu ne tarderas pas à te réchauffer et à t’endormir.
Cependant, je ne me réchauffai pas aussi vite que Vitalis le croyait ; longtemps je me tournai et me retournai sur mon lit de fougère, trop endolori, trop malheureux pour pouvoir m’endormir.
Est-ce qu’il en serait maintenant tous les jours ainsi ? marcher sans repos sous la pluie, coucher dans une grange, trembler de froid, n’avoir pour souper qu’un morceau de pain sec, personne pour me plaindre, personne à aimer, plus de mère Barberin ?
Comme je réfléchissais tristement, le cœur gros et les yeux pleins de larmes, je sentis un souffle tiède me passer sur le visage.
J’étendis la main en avant et je rencontrai le poil laineux de Capi.
Il s’était doucement approché de moi, s’avançant avec précaution sur la fougère, et il me sentait ; il reniflait doucement ; son haleine me courait sur la figure et dans les cheveux.
Que voulait-il ?
Il se coucha bientôt sur la fougère, tout près de moi, et délicatement il se mit à me lécher la main.
Tout ému de cette caresse, je me soulevai à demi et l’embrassai sur son nez froid.
Il poussa un petit cri étouffé, puis, vivement, il mit sa patte dans ma main et ne bougea plus.
Alors j’oubliai fatigue et chagrins ; ma gorge contractée se desserra ; je respirai ; je n’étais plus seul : j’avais un ami.
VI
MES DÉBUTS
Le lendemain nous nous mîmes en route de bonne heure.
Plus de pluie ; un ciel bleu, et, grâce au vent sec qui avait soufflé pendant la nuit, peu de boue. Les oiseaux chantaient joyeusement dans les buissons du chemin et les chiens gambadaient autour de nous. De temps en temps, Capi se dressait sur ses pattes de derrière et il me lançait au visage deux ou trois aboiements dont je comprenais très-bien la signification.
— Du courage, du courage ! disaient-ils.
Car c’était un chien fort intelligent, qui savait tout comprendre et toujours se faire comprendre. Bien souvent j’ai entendu dire qu’il ne lui manquait que la parole. Mais je n’ai jamais pensé ainsi. Dans sa queue seule il y avait plus d’esprit et d’éloquence que dans la langue ou dans les yeux de bien des gens. En tout cas la parole n’a jamais été utile entre lui et moi ; du premier jour nous nous sommes tout de suite compris.
N’étant jamais sorti de mon village, j’étais curieux de voir une ville.
Mais je dois avouer qu’Ussel ne m’éblouit point. Ses vieilles maisons à tourelles, qui font sans doute le bonheur des archéologues, me laissèrent tout à fait indifférent.
Il est vrai de dire que dans ces maisons ce que je cherchais ce n’était point le pittoresque.
Une idée emplissait ma tête et obscurcissait mes yeux, ou tout au moins ne leur permettait de voir qu’une seule chose : une boutique de cordonnier.
Mes souliers, les souliers promis par Vitalis, l’heure était venue de les chausser.
Où était la bienheureuse boutique qui allait me les fournir ?
C’était cette boutique que je cherchais : le reste, tourelles, ogives, colonnes n’avait aucun intérêt pour moi.
Aussi le seul souvenir qui me reste d’Ussel est-il celui d’une boutique sombre et enfumée située auprès des halles. Il y avait en étalage devant sa devanture des vieux fusils, un habit galonné sur les coutures avec des épaulettes en argent, beaucoup de lampes, et dans des corbeilles de la ferraille, surtout des cadenas et des clefs rouillées.
Il fallait descendre trois marches pour entrer, et alors on se trouvait dans une grande salle, où la lumière du soleil n’avait assurément jamais pénétré depuis que le toit avait été posé sur la maison.
Comment une aussi belle chose que des souliers pouvait-elle se vendre dans un endroit aussi affreux !
Cependant Vitalis savait ce qu’il faisait en venant dans cette boutique, et bientôt j’eus le bonheur de chausser mes pieds dans des souliers ferrés qui pesaient bien dix fois le poids de mes sabots.
La générosité de mon maître ne s’arrêta pas là ; après les souliers, il m’acheta une veste de velours bleu, un pantalon de laine et un chapeau de feutre ; enfin tout ce qu’il m’avait promis.
Du velours pour moi, qui n’avais jamais porté que de la toile ; des souliers ; un chapeau quand je n’avais eu que mes cheveux pour coiffure ; décidément c’était le meilleur homme du monde, le plus généreux et le plus riche.
Il est vrai que le velours était froissé, il est vrai que la laine était râpée ; il est vrai aussi qu’il était fort difficile de savoir quelle avait été la couleur primitive du feutre, tant il avait reçu de pluie et de poussière, mais ébloui par tant de splendeurs, j’étais insensible aux imperfections qui se cachaient sous leur éclat.
J’avais hâte de revêtir ces beaux habits, mais avant de me les donner Vitalis leur fit subir une transformation qui me jeta dans un étonnement douloureux.
En rentrant à l’auberge, il prit des ciseaux dans son sac et coupa les deux jambes de mon pantalon à la hauteur des genoux.
Comme je le regardais avec des yeux ébahis :
— Ceci est à seule fin, me dit-il, que tu ne ressembles pas à tout le monde. Nous sommes en France, je t’habille en Italien ; si nous allons en Italie, ce qui est possible, je t’habillerai en Français.
Cette explication ne faisant pas cesser mon étonnement, il continua :
— Que sommes-nous ? Des artistes, n’est-ce pas ? des comédiens qui par leur seul aspect doivent provoquer la curiosité. Crois-tu que si nous allions tantôt sur la place publique habillés comme des bourgeois ou des paysans, nous forcerions les gens à nous regarder et à s’arrêter autour de nous ? Non, n’est-ce pas ? Apprends donc que dans la vie le paraître est quelquefois indispensable ; cela est fâcheux, mais nous n’y pouvons rien.
Voilà comment de Français que j’étais le matin, je devins Italien avant le soir.
Mon pantalon s’arrêtant au genou, Vitalis attacha mes bas avec des cordons rouges croisés tout le long de la jambe ; sur mon feutre il croisa aussi d’autres rubans, et il l’orna d’un bouquet de fleurs en laine.
Je ne sais pas ce que d’autres auraient pu penser de moi, mais pour être sincère je dois déclarer que je me trouvai superbe ; et cela devait être, car mon ami Capi, après m’avoir longuement contemplé, me tendit la patte d’un air satisfait.
L’approbation que Capi donnait à ma transformation me fut d’autant plus agréable que pendant que j’endossais mes nouveaux vêtements, Joli-Cœur s’était campé devant moi, et avait imité mes mouvements en les exagérant. Ma toilette terminée, il s’était posé les mains sur les hanches et renversant sa tête en arrière il s’était mis à rire en poussant des petits cris moqueurs.
J’ai entendu dire que c’était une question scientifique intéressante de savoir si les singes riaient. Je pense que ceux qui se sont posé cette question sont des savants en chambre, qui n’ont jamais pris la peine d’étudier les singes. Pour moi qui pendant longtemps ai vécu dans l’intimité de Joli-Cœur, je puis affirmer qu’il riait et souvent même d’une façon qui me mortifiait. Sans doute son rire n’était pas exactement semblable à celui de l’homme. Mais enfin lorsqu’un sentiment quelconque provoquait sa gaieté, on voyait les coins de sa bouche se tirer en arrière, ses paupières se plissaient, ses mâchoires remuaient rapidement, et ses yeux noirs semblaient lancer des flammes comme des petits charbons sur lesquels on aurait soufflé.
Au reste, je fus bientôt à même d’observer en lui ces signes caractéristiques du rire dans des conditions assez pénibles pour mon amour-propre.
— Maintenant que voilà ta toilette terminée, me dit Vitalis quand je me fus coiffé de mon chapeau, nous allons nous mettre au travail, afin de donner demain, jour de marché, une grande représentation dans laquelle tu débuteras.
Je demandai ce que c’était que débuter, et Vitalis m’expliqua que c’était paraître pour la première fois devant le public en jouant la comédie.
— Nous donnerons demain notre première représentation, dit-il, et tu y figureras. Il faut donc que je te fasse répéter le rôle que je te destine.
Mes yeux étonnés lui dirent que je ne le comprenais pas.
— J’entends par rôle ce que tu auras à faire dans cette représentation. Si je t’ai emmené avec moi, ce n’est pas précisément pour te procurer le plaisir de la promenade. Je ne suis pas assez riche pour cela. C’est pour que tu travailles. Et ton travail consistera à jouer la comédie avec mes chiens et Joli-Cœur.
— Mais je ne sais pas jouer la comédie ! m’écriai-je effrayé.
— C’est justement pour cela que je dois te l’apprendre. Tu penses bien que ce n’est pas naturellement que Capi marche si gracieusement sur ses deux pattes de derrière, pas plus que ce n’est pour son plaisir que Dolce danse à la corde. Capi a appris à se tenir debout sur ses pattes, et Dolce a appris aussi à danser à la corde ; ils ont même dû travailler beaucoup et longtemps pour acquérir ces talents, ainsi que ceux qui les rendent d’habiles comédiens. Eh bien ! toi aussi, tu dois travailler pour apprendre les différents rôles que tu joueras avec eux. Mettons-nous donc à l’ouvrage.
J’avais à cette époque des idées tout à fait primitives sur le travail. Je croyais que pour travailler il fallait bêcher la terre, ou fendre un arbre, ou tailler la pierre, et n’imaginais point autre chose.
— La pièce que nous allons représenter, continua Vitalis, a pour titre le Domestique de M. Joli-Cœur ou le Plus bête des deux n’est pas celui qu’on pense. Voici le sujet : M. Joli-Cœur a eu jusqu’à ce jour un domestique dont il est très-content, c’est Capi. Mais Capi devient vieux ; et, d’un autre côté, M. Joli-Cœur veut un nouveau domestique. Capi se charge de lui en procurer un. Mais ce ne sera pas un chien qu’il se donnera pour successeur, ce sera un jeune garçon, un paysan nommé Rémi.
— Comme moi ?
— Non, comme toi ; mais toi-même. Tu arrives de ton village pour entrer au service de Joli-Cœur.
— Les singes n’ont pas de domestiques.
— Dans les comédies ils en ont. Tu arrives donc, et M. Joli-Cœur trouve que tu as l’air d’un imbécile.
— Ce n’est pas amusant, cela.
— Qu’est-ce que cela te fait, puisque c’est pour rire ? D’ailleurs, figure-toi que tu arrives véritablement chez un monsieur pour être domestique et qu’on te dit, par exemple, de mettre la table. Précisément en voici une qui doit servir dans notre représentation. Avance et dispose le couvert.
Sur cette table, il y avait des assiettes, un verre, un couteau, une fourchette et du linge blanc.
Comment devait-on arranger tout cela ?
Comme je me posais ces questions, et restais les bras tendus, penché en avant, la bouche ouverte, ne sachant par où commencer, mon maître battit des mains en riant aux éclats.
— Bravo, dit-il, bravo, c’est parfait. Ton jeu de physionomie est excellent. Le garçon que j’avais avant toi prenait une mine futée et son air disait clairement : « Vous allez voir comme je fais bien la bête » ; tu ne dis rien, toi, tu es, ta naïveté est admirable.
— Je ne sais pas ce que je dois faire.
— Et c’est par là précisément que tu es excellent. Demain, dans quelques jours tu sauras à merveille ce que tu devras faire. C’est alors qu’il faudra te rappeler l’embarras que tu éprouves présentement, et feindre ce que tu ne sentiras plus. Si tu peux retrouver ce jeu de physionomie et cette attitude, je te prédis le plus beau succès. Qu’est ton personnage dans ma comédie ? celui d’un jeune paysan qui n’a rien vu et qui ne sait rien ; il arrive chez un singe et il se trouve plus ignorant et plus maladroit que ce singe ; de là mon sous-titre : « le plus bête des deux n’est pas celui qu’on pense » ; plus bête que Joli-Cœur, voilà ton rôle ; pour le jouer dans la perfection, tu n’aurais qu’à rester ce que tu es en ce moment, mais comme cela est impossible, tu devras te rappeler ce que tu as été et devenir artistiquement ce que tu ne seras plus naturellement.
Le Domestique de M. Joli-Cœur n’était pas une grande comédie, et sa représentation ne prenait pas plus de vingt minutes. Mais notre répétition dura près de trois heures ; Vitalis nous faisant recommencer deux fois, quatre fois, dix fois la même chose, aux chiens comme à moi.
Ceux-ci, en effet, avaient oublié certaines parties de leur rôle, et il fallait les leur apprendre de nouveau.
Je fus alors bien surpris de voir la patience et la douceur de notre maître. Ce n’était point ainsi qu’on traitait les bêtes dans mon village, où les jurons et les coups étaient les seuls procédés d’éducation qu’on employât à leur égard.
Pour lui, tant que se prolongea cette longue répétition, il ne se fâcha pas une seule fois ; pas une seule fois il ne jura.
— Allons, recommençons, disait-il sévèrement, quand ce qu’il avait demandé n’était pas réussi ; c’est mal, Capi ; vous ne faites pas attention, Joli-Cœur, vous serez grondé.
Et c’était tout ; mais cependant c’était assez.
— Eh bien, me dit-il, quand la répétition fut terminée, crois-tu que tu t’habitueras à jouer la comédie ?
— Je ne sais pas.
— Cela t’ennuie-t-il ?
— Non, cela m’amuse.
— Alors tout ira bien ; tu as de l’intelligence, et ce qui est plus précieux encore peut-être, de l’attention ; avec de l’attention et de la docilité, on arrive à tout. Vois mes chiens et compare-les à Joli-Cœur. Joli-Cœur a peut-être plus de vivacité et d’intelligence, mais il n’a pas de docilité. Il apprend facilement ce qu’on lui enseigne, mais il l’oublie aussitôt. D’ailleurs ce n’est jamais avec plaisir qu’il fait ce qu’on lui demande ; volontiers il se révolterait, et toujours il est contrariant. Cela tient à sa nature, et voilà pourquoi je ne me fâche pas contre lui : le singe n’a pas, comme le chien, la conscience du devoir, et par là il lui est très-inférieur. Comprends-tu cela ?
— Il me semble.
— Sois donc attentif, mon garçon ; sois docile ; fais de ton mieux ce que tu dois faire. Dans la vie, tout est là !
Causant ainsi, je m’enhardis à lui dire que ce qui m’avait le plus étonné dans cette répétition, ç’avait été l’inaltérable patience dont il avait fait preuve aussi bien avec Joli-Cœur et les chiens, qu’avec moi.
Il se mit alors à sourire doucement :
— On voit bien, me dit-il, que tu n’as vécu jusqu’à ce jour qu’avec des paysans durs aux bêtes et qui croient qu’on doit conduire celles-ci le bâton toujours levé. C’est là une erreur fâcheuse : on obtient peu de chose par la brutalité, tandis qu’on obtient beaucoup pour ne pas dire tout par la douceur. Pour moi, c’est en ne me fâchant jamais contre mes bêtes que j’ai fait d’elles ce qu’elles sont. Si je les avais battues, elles seraient craintives, et la crainte paralyse l’intelligence. Au reste en me laissant aller à la colère avec elles, je ne serais pas moi-même ce que je suis, et je n’aurais pas acquis cette patience à toute épreuve qui m’a gagné ta confiance. C’est que qui instruit les autres, s’instruit soi-même. Mes chiens m’ont donné autant de leçons qu’ils en ont reçu de moi. J’ai développé leur intelligence, ils m’ont formé le caractère.
Ce que j’entendais me parut si étrange, que je me mis à rire.
— Tu trouves cela bien bizarre, n’est-ce pas, qu’un chien puisse donner des leçons à un homme ? Et cependant rien n’est plus vrai. Réfléchis un peu. Admets-tu qu’un chien subisse l’influence de son maître.
— Oh ! bien sûr.
— Alors tu vas comprendre que le maître est obligé de veiller sur lui-même quand il entreprend l’éducation d’un chien. Ainsi suppose un moment qu’en instruisant Capi je me sois abandonné à l’emportement et à la colère. Qu’aura fait Capi ? il aura pris l’habitude de la colère et de l’emportement. C’est-à-dire qu’en se modelant sur mon exemple, il se sera corrompu. Le chien est presque toujours le miroir de son maître ; et qui voit l’un, voit l’autre. Montre-moi ton chien ; je dirai qui tu es. Le brigand a pour chien, un gredin ; le voleur, un voleur ; le paysan sans intelligence, un chien grossier ; l’homme poli et affable un chien aimable.
Mes camarades, les chiens et le singe, avaient sur moi le grand avantage d’être habitués à paraître en public, de sorte qu’ils virent arriver le lendemain sans crainte. Pour eux il s’agissait de faire ce qu’ils avaient déjà fait cent fois, mille fois peut-être.
Mais pour moi, je n’avais pas leur tranquille assurance. Que dirait Vitalis, si je jouais mal mon rôle ? Que diraient nos spectateurs ?
Cette préoccupation troubla mon sommeil et quand je m’endormis, je vis en rêve des gens qui se tenaient les côtes à force de rire, tant ils se moquaient de moi.
Aussi mon émotion était-elle vive, lorsque le lendemain nous quittâmes notre auberge pour nous rendre sur la place, où devait avoir lieu notre représentation.
Vitalis ouvrait la marche, la tête haute, la poitrine cambrée, et il marquait le pas des deux bras et des pieds en jouant une valse sur un fifre en métal.
Derrière lui venait Capi, sur le dos duquel se prélassait M. Joli-Cœur, en costume de général anglais, habit et pantalon rouge galonné d’or, avec un chapeau à claque surmonté d’un large plumet.
Puis, à une distance respectueuse s’avançaient sur une même ligne Zerbino et Dolce.
Enfin je formais la queue du cortège, qui, grâce à l’espacement indiqué par notre maître, tenait une certaine place dans la rue.
Mais ce qui mieux encore que la pompe de notre défilé provoquait l’attention, c’étaient les sons perçants du fifre qui allaient jusqu’au fond des maisons éveiller la curiosité des habitants d’Ussel. On accourait sur les portes pour nous voir passer, les rideaux de toutes les fenêtres se soulevaient rapidement.
Quelques enfants s’étaient mis à nous suivre, des paysans ébahis s’étaient joints à eux, et quand nous étions arrivés sur la place, nous avions derrière nous et autour de nous un véritable cortège.
Notre salle de spectacle fut bien vite dressée ; elle consistait en une corde attachée à quatre arbres, de manière à former un carré long, au milieu duquel nous nous plaçâmes.
La première partie de la représentation consista en différents tours exécutés par les chiens ; mais ce que furent ces tours, je ne saurais le dire, occupé que j’étais à me répéter mon rôle et troublé par l’inquiétude.
Tout ce que je me rappelle, c’est que Vitalis avait abandonné son fifre et l’avait remplacé par un violon au moyen duquel il accompagnait les exercices des chiens, tantôt avec des airs de danse, tantôt avec une musique douce et tendre.
La foule s’était rapidement amassée contre nos cordes, et quand je regardais autour de moi, machinalement bien plus qu’avec une intention déterminée, je voyais une infinité de prunelles qui, toutes fixées sur nous, semblaient projeter des rayons.
La première pièce terminée, Capi prit une sébile entre ses dents, et marchant sur ses pattes de derrière, commença à faire le tour « de l’honorable société ». Lorsque les sous ne tombaient pas dans la sébile, il s’arrêtait et plaçant celle-ci dans l’intérieur du cercle hors la portée des mains, il posait ses deux pattes de devant sur le spectateur récalcitrant, poussait deux ou trois aboiements, et frappait des petits coups sur la poche qu’il voulait ouvrir.
Alors dans le public c’étaient des cris, des propos joyeux et des railleries.
— Il est malin, le caniche, il connaît ceux qui ont le gousset garni.
— Allons, la main à la poche !
— Il donnera !
— Il donnera pas !
— L’héritage de votre oncle vous le rendra.
Et le sou était finalement arraché des profondeurs où il se cachait.
Pendant ce temps, Vitalis, sans dire un mot, mais ne quittant pas la sébile des yeux, jouait des airs joyeux sur son violon qu’il levait et qu’il baissait selon la mesure.
Bientôt Capi revint auprès de son maître, portant fièrement la sébile pleine.
C’était à Joli-Cœur et à moi à entrer en scène.
— Mesdames et messieurs, dit Vitalis en gesticulant d’une main avec son archet et de l’autre avec son violon, nous allons continuer le spectacle par une charmante comédie intitulée : le Domestique de M. Joli-Cœur, ou Le plus bête des deux n’est pas celui qu’on pense. Un homme comme moi ne s’abaisse pas à faire d’avance l’éloge de ses pièces et de ses acteurs ; je ne vous dis donc qu’une chose : écarquillez les yeux, ouvrez les oreilles et préparez vos mains pour applaudir.
Ce qu’il appelait « une charmante comédie » était en réalité une pantomime, c’est-à-dire une pièce jouée avec des gestes et non avec des paroles. Et cela devait être ainsi, par cette bonne raison que deux des principaux acteurs, Joli-Cœur et Capi, ne savaient pas parler, et que le troisième (qui était moi-même) aurait été parfaitement incapable de dire deux mots.
Cependant, pour rendre le jeu des comédiens plus facilement compréhensible, Vitalis l’accompagnait de quelques paroles qui préparaient les situations de la pièce et les expliquaient.
Ce fut ainsi que jouant en sourdine un air guerrier, il annonça l’entrée de M. Joli-Cœur, général anglais qui avait gagné ses grades et sa fortune dans les guerres des Indes. Jusqu’à ce jour, M. Joli-Cœur n’avait eu pour domestique que le seul Capi, mais il voulait se faire servir désormais par un homme, ses moyens lui permettant ce luxe : les bêtes avaient été assez longtemps les esclaves des hommes, il était temps que cela changeât.
En attendant que ce domestique arrivât, le général Joli-Cœur se promenait en long et en large, et fumait son cigare. Il fallait voir comme il lançait sa fumée au nez du public !
Il s’impatientait, le général, et il commençait à rouler de gros yeux comme quelqu’un qui va se mettre en colère ; il se mordait les lèvres et frappait la terre du pied.
Au troisième coup de pied, je devais entrer en scène, amené par Capi.
Si j’avais oublié mon rôle, le chien me l’aurait rappelé. Au moment voulu, il me tendit la patte et m’introduisit auprès du général.
Celui-ci, en m’apercevant, leva les deux bras d’un air désolé. Eh quoi ! c’était là le domestique qu’on lui présentait ? Puis il vint me regarder sous le nez et tourner autour de moi en haussant les épaules.
Sa mine fut si drolatique que tout le monde éclata de rire : on avait compris qu’il me prenait pour un parfait imbécile ; et c’était aussi le sentiment des spectateurs.
La pièce était, bien entendu, bâtie pour montrer cette imbécillité sous toutes les faces ; dans chaque scène je devais faire quelque balourdise nouvelle, tandis que Joli-Cœur, au contraire, devait trouver une occasion pour développer son intelligence et son adresse.
Après m’avoir examiné longuement, le général, pris de pitié, me faisait servir à déjeuner.
— Le général croit que quand ce garçon aura mangé il sera moins bête, disait Vitalis, nous allons voir cela.
Et je m’asseyais devant une petite table sur laquelle le couvert était mis, une serviette posée sur mon assiette.
Que faire de cette serviette ?
Capi m’indiquait que je devais m’en servir.
Mais comment ?
Après avoir bien cherché, je me mouchai dedans.
Là-dessus le général se tordit de rire, et Capi tomba les quatre pattes en l’air renversé par ma stupidité.
Voyant que je me trompais, je contemplais de nouveau la serviette, me demandant comment l’employer.
Enfin une idée m’arriva ; je roulai la serviette et m’en fis une cravate.
Nouveaux rires du général, nouvelle chute de Capi.
Et ainsi de suite jusqu’au moment où le général exaspéré m’arracha de ma chaise, s’assit à ma place et mangea le déjeuner qui m’était destiné.
Ah ! il savait se servir d’une serviette, le général. Avec quelle grâce il la passa dans une boutonnière de son uniforme et l’étala sur ses genoux. Avec quelle élégance il cassa son pain, et vida son verre !
Mais où ses belles manières produisirent un effet irrésistible, ce fut lorsque, le déjeuner terminé, il demanda un cure-dent et le passa rapidement entre ses dents.
Alors les applaudissements éclatèrent de tous les côtés et la représentation s’acheva dans un triomphe.
Comme le singe était intelligent ! comme le domestique était bête !
En revenant à notre auberge, Vitalis me fit ce compliment, et j’étais déjà si bien comédien, que je fus fier de cet éloge.
VII
J’APPRENDS À LIRE
C’étaient assurément des comédiens du plus grand talent, que ceux qui composaient la troupe du signor Vitalis, — je parle des chiens et du singe, — mais ce talent n’était pas très-varié.
Lorsqu’ils avaient donné trois ou quatre représentations, on connaissait tout leur répertoire ; ils ne pouvaient plus que se répéter.
De là résultait la nécessité de ne pas rester longtemps dans une même ville.
Trois jours après notre arrivée à Ussel, il fallut donc se remettre en route.
Où allions-nous ?
Je m’étais assez enhardi avec mon maître pour me permettre cette question.
— Tu connais le pays ? me répondit-il en me regardant.
— Non.
— Alors pourquoi me demandes-tu où nous allons ?
— Pour savoir.
— Savoir quoi ?
Je restai interloqué regardant, sans trouver un mot, la route blanche qui s’allongeait devant nous au fond d’un vallon boisé.
— Si je te dis, continua-t-il, que nous allons à Aurillac pour nous diriger ensuite sur Bordeaux et de Bordeaux sur les Pyrénées, qu’est-ce que cela t’apprendra ?
— Mais vous, vous connaissez donc le pays ?
— Je n’y suis jamais venu.
— Et pourtant vous savez où nous allons ?
Il me regarda encore longuement comme s’il cherchait quelque chose en moi.
— Tu ne sais pas lire, n’est-ce pas ? me dit-il.
— Non.
— Sais-tu ce que c’est qu’un livre ?
— Oui ; on emporte les livres à la messe pour dire ses prières quand on ne récite pas son chapelet ; j’en ai vu, des livres, et des beaux, avec des images dedans et du cuir tout autour.
— Bon ; alors tu comprends qu’on peut mettre des prières dans un livre ?
— Oui.
— On peut y mettre autre chose encore. Quand tu récites ton chapelet, tu récites des mots que ta mère t’a mis dans l’oreille, et qui de ton oreille ont été s’entasser dans ton esprit pour revenir ensuite sur ta langue quand tu les appelles. Eh bien, ceux qui disent leurs prières avec des livres ne tirent point les mots dont se composent ces prières de leur mémoire ; mais ils les prennent avec leurs yeux dans les livres où ils ont été mis, c’est-à-dire qu’ils lisent.
— J’ai vu lire, dis-je avec un ton glorieux comme une personne qui n’est point une bête, et qui sait parfaitement ce dont on lui parle.
— Ce qu’on fait pour les prières, on le fait pour tout. Dans un livre que je vais te montrer quand nous nous reposerons, nous trouverons les noms et l’histoire des pays que nous traversons. Des hommes qui ont habité ou parcouru ces pays, ont mis dans mon livre ce qu’ils avaient vu ou appris ; si bien que je n’ai qu’à ouvrir ce livre et à le lire pour connaître ces pays, je les vois comme si je les regardais avec mes propres yeux ; j’apprends leur histoire comme si on me la racontait.
J’avais été élevé comme un véritable sauvage qui n’a aucune idée de la vie civilisée. Ces paroles furent pour moi une sorte de révélation, confuse d’abord, mais qui peu à peu s’éclaircit.
Il est vrai cependant qu’on m’avait envoyé à l’école. Mais ce n’avait été que pour un mois. Et pendant ce mois on ne m’avait pas mis un livre entre les mains, on ne m’avait parlé ni de lecture, ni d’écriture, on ne m’avait donné aucune leçon de quelque genre que ce fût.
Il ne faut pas conclure de ce qui se passe actuellement dans les écoles, que ce que je dis là est impossible. À l’époque dont je parle, il y avait un grand nombre de communes en France qui n’avaient pas d’écoles, et parmi celles qui existaient, il s’en trouvait qui étaient dirigées par des maîtres qui, pour une raison ou pour une autre, parce qu’ils ne savaient rien, ou bien parce qu’ils avaient autre chose à faire, ne donnaient aucun enseignement aux enfants qu’on leur confiait.
C’était là le cas du maître d’école de notre village. Savait-il quelque chose ? c’est possible ; et je ne veux pas porter contre lui une accusation d’ignorance. Mais la vérité est que pendant le temps que je restai chez lui, il ne nous donna pas la plus petite leçon, ni à mes camarades, ni à moi ; il avait autre chose à faire, étant de son véritable métier, sabotier. C’était à ses sabots qu’il travaillait, et du matin au soir, on le voyait faire voler autour de lui les copeaux de hêtre et de noyer. Jamais il ne nous adressait la parole si ce n’est pour nous parler de nos parents, ou bien du froid, ou bien de la pluie ; mais de lecture, de calcul, jamais un mot. Pour cela il s’en remettait à sa fille, qui était chargée de le remplacer et de nous faire la classe. Mais comme celle-ci de son véritable métier était couturière, elle faisait comme son père, et tandis qu’il manœuvrait sa plane ou sa cuiller elle poussait vivement son aiguille.
Il fallait bien vivre, et comme nous étions douze élèves payant chacun cinquante centimes par mois, ce n’était pas six francs qui pouvaient nourrir deux personnes pendant trente jours : les sabots et la couture complétaient ce que l’école ne pouvait pas fournir.
Je n’avais donc absolument rien appris à l’école, pas même mes lettres.
— C’est difficile de lire ? demandai-je à Vitalis après avoir marché assez longtemps en réfléchissant.
— C’est difficile pour ceux qui ont la tête dure, et plus difficile encore pour ceux qui ont mauvaise volonté. As-tu la tête dure ?
— Je ne sais pas ; mais il me semble que si vous vouliez m’apprendre à lire, je n’aurais pas mauvaise volonté.
— Eh bien, nous verrons ; nous avons du temps devant nous.
Du temps devant nous ! Pourquoi ne pas commencer aussitôt ? Je ne savais pas combien il est difficile d’apprendre à lire et je m’imaginais que tout de suite j’allais ouvrir un livre et voir ce qu’il y avait dedans.
Le lendemain, comme nous cheminions, je vis mon maître se baisser et ramasser sur la route un bout de planche à moitié recouvert par la poussière.
— Voilà le livre dans lequel tu vas apprendre à lire, me dit-il.
Un livre, cette planche ! Je le regardai pour voir s’il ne se moquait pas de moi. Puis comme je le trouvai sérieux, je regardai attentivement sa trouvaille.
C’était bien une planche, rien qu’une planche de bois de hêtre, longue comme le bras, large comme les deux mains, bien polie ; il ne se trouvait dessus aucune inscription, aucun dessin.
Comment lire sur cette planche, et quoi lire ?
— Ton esprit travaille, me dit Vitalis en riant.
— Vous voulez vous moquer de moi ?
— Jamais, mon garçon ; la moquerie peut avoir du bon pour réformer un caractère vicieux, mais lorsqu’elle s’adresse à l’ignorance, elle est une marque de sottise chez celui qui l’emploie. Attends que nous soyons arrivés à ce bouquet d’arbres qui est là-bas ; nous nous y reposerons, et tu verras comment je peux t’enseigner la lecture avec ce morceau de bois.
Nous arrivâmes rapidement à ce bouquet d’arbres et nos sacs mis à terre, nous nous assîmes sur le gazon qui commençait à reverdir et dans lequel des pâquerettes se montraient çà et là. Joli-Cœur, débarrassé de sa chaîne, s’élança sur un des arbres en secouant les branches les unes après les autres, comme pour en faire tomber des noix, tandis que les chiens, plus tranquilles et surtout plus fatigués, se couchaient en rond autour de nous.
Alors Vitalis tirant son couteau de sa poche, essaya de détacher de la planche une petite lame de bois aussi mince que possible. Ayant réussi, il polit cette lame sur ses deux faces, dans toute sa longueur, puis cela fait, il la coupa en petits carrés, de sorte qu’elle lui donna une douzaine de petits morceaux plats d’égale grandeur.
Je ne le quittais pas des yeux, mais j’avoue que malgré ma tension d’esprit je ne comprenais pas du tout comment avec ces petits morceaux de bois il voulait faire un livre ; car enfin, si ignorant que je fusse, je savais qu’un livre se composait d’un certain nombre de feuilles de papier sur lesquelles étaient tracés des signes noirs. Où étaient les feuilles de papier ? Où étaient les signes noirs ?
— Sur chacun de ces petits morceaux de bois, me dit-il, je creuserai demain, avec la pointe de mon couteau, une lettre de l’alphabet. Tu apprendras ainsi la forme des lettres et quand tu les sauras bien sans te tromper, de manière à les reconnaître rapidement à première vue, tu les réuniras les unes au bout des autres de manière à former des mots. Quand tu pourras ainsi former les mots que je te dirai, tu seras en état de lire dans un livre.
Bientôt j’eus mes poches pleines d’une collection de petits morceaux de bois, et je ne tardai pas à connaître les lettres de l’alphabet, mais pour savoir lire ce fut une autre affaire, les choses n’allèrent pas si vite, et il arriva même un moment où je regrettai d’avoir voulu apprendre à lire.
Je dois dire cependant, pour être juste envers moi-même, que ce ne fut pas la paresse qui m’inspira ce regret, ce fut l’amour-propre.
En m’apprenant les lettres de l’alphabet, Vitalis avait pensé qu’il pourrait les apprendre en même temps à Capi ; puisque le chien avait bien su se mettre les chiffres des heures dans la tête, pourquoi ne s’y mettrait-il pas les lettres ?
Et nous avions pris nos leçons en commun ; j’étais devenu le camarade de classe de Capi, ou le chien était devenu le mien, comme on voudra.
Bien entendu Capi ne devait pas appeler les lettres qu’il voyait, puisqu’il n’avait pas la parole, mais lorsque nos morceaux de bois étaient étalés sur l’herbe, il devait avec sa patte tirer les lettres que notre maître nommait.
Tout d’abord j’avais fait des progrès plus rapides que lui ; mais si j’avais l’intelligence plus prompte, il avait par contre la mémoire plus sûre : une chose bien apprise était pour lui une chose sue pour toujours ; il ne l’oubliait plus ; et comme il n’avait pas de distractions, il n’hésitait, ou ne se trompait jamais.
Alors quand je me trouvais en faute, notre maître ne manquait jamais de dire :
— Capi saura lire avant Rémi.
Et le chien, comprenant sans doute, remuait la queue d’un air de triomphe.
— Plus bête qu’une bête, c’est bon dans la comédie, disait encore Vitalis, mais dans la réalité c’est honteux.
Cela me piqua si bien, que je m’appliquai de tout cœur, et tandis que le pauvre chien en restait à écrire son nom, en triant les quatre lettres qui le composent parmi toutes les lettres de l’alphabet, j’arrivai enfin à lire dans un livre.
— Maintenant que tu sais lire l’écriture, me dit Vitalis, veux-tu apprendre à lire la musique ?
— Est-ce que quand je saurai lire la musique, je pourrai chanter comme vous ?
— Tu voudrais donc chanter comme moi ?
— Oh ! pas comme vous, je sais bien que cela n’est pas possible, mais enfin chanter.
— Tu as du plaisir à m’entendre chanter !
— Le plus grand plaisir qu’on puisse éprouver ; le rossignol chante bien, mais il me semble que vous chantez bien mieux encore : et puis ce n’est pas du tout la même chose ; quand vous chantez, vous faites de moi ce que vous voulez, j’ai envie de pleurer ou bien j’ai envie de rire, et puis je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître bête : quand vous chantez un air doux ou triste, cela me ramène auprès de mère Barberin, c’est à elle que je pense, c’est elle que je vois dans notre maison ; et pourtant je ne comprends pas les paroles que vous prononcez, puisqu’elles sont italiennes.
Je lui parlais en le regardant, il me sembla voir ses yeux se mouiller ; alors je m’arrêtai et lui demandai si je le peinais de parler ainsi.
— Non, mon enfant, me dit-il d’une voix émue, tu ne me peines pas, bien au contraire, tu me rappelles ma jeunesse, mon beau temps ; sois tranquille, je t’apprendrai à chanter, et comme tu as du cœur, toi aussi tu feras pleurer et tu seras applaudi, tu verras…
Il s’arrêta tout à coup et je crus comprendre qu’il ne voulait point se laisser aller sur ce sujet. Mais les raisons qui le retenaient, je ne les devinai point. Ce fut plus tard seulement que je les ai connues, beaucoup plus tard, et dans des circonstances douloureuses, terribles pour moi, que je raconterai lorsqu’elles se présenteront au cours de mon récit.
Dès le lendemain, mon maître fit pour la musique, ce qu’il avait déjà fait pour la lecture, c’est-à-dire qu’il recommença à tailler des petits carrés de bois, qu’il grava avec la pointe de son couteau.
Mais cette fois son travail fut plus considérable, car les divers signes nécessaires à la notation de la musique offrent des combinaisons plus compliquées que l’alphabet.
Afin d’alléger mes poches, il utilisa les deux faces de ses carrés de bois, et après les avoir rayés toutes deux de cinq lignes qui représentaient la portée, il inscrivit sur une face la clé de sol et sur l’autre la clé de fa.
Puis quand il eut tout préparé, les leçons commencèrent et j’avoue qu’elles ne furent pas moins dures que ne l’avaient été celles de lecture.
Plus d’une fois Vitalis, si patient avec ses chiens, s’exaspéra contre moi.
— Avec une bête, s’écriait-il, on se contient parce qu’on sait que c’est une bête, mais toi tu me feras mourir.
Et alors, levant les mains au ciel dans un mouvement théâtral, il les laissait tomber tout à coup sur ses cuisses où elles claquaient fortement.
Joli-Cœur, qui prenait plaisir à répéter tout ce qu’il trouvait drôle, avait copié ce geste, et comme il assistait presque toujours à mes leçons, j’avais le dépit, lorsque j’hésitais, de le voir lever les bras au ciel et laisser tomber ses mains sur ses cuisses en les faisant claquer.
— Joli-Cœur, lui-même, se moque de toi, s’écriait Vitalis.
Si j’avais osé, j’aurais répliqué qu’il se moquait autant du maître que de l’élève, mais le respect autant qu’une certaine crainte vague, arrêtèrent toujours heureusement cette répartie ; je me contentai de me la dire tout bas, quand Joli-Cœur faisait claquer ses mains avec une mauvaise grimace, et cela me rendait jusqu’à un certain point la mortification moins pénible.
Enfin les premiers pas furent franchis avec plus ou moins de peine, et j’eus la satisfaction de solfier un air écrit par Vitalis sur une feuille de papier.
Ce jour-là il ne fit pas claquer ses mains, mais il me donna deux belles claques amicales sur chaque joue, en déclarant que si je continuais ainsi, je deviendrais certainement un grand chanteur.
Bien entendu, ces études ne se firent pas en un jour, et, pendant des semaines, pendant des mois, mes poches furent constamment remplies de mes petits morceaux de bois.
D’ailleurs, mon travail n’était pas régulier comme celui d’un enfant qui suit les classes d’une école, et c’était seulement à ses moments perdus que mon maître pouvait me donner mes leçons.
Il fallait chaque jour accomplir notre parcours, qui était plus ou moins long, selon que les villages étaient plus ou moins éloignés les uns des autres ; il fallait donner nos représentations partout où nous avions chance de ramasser une recette ; il fallait faire répéter les rôles aux chiens et à M. Joli-Cœur ; il fallait préparer nous-mêmes notre déjeuner ou notre dîner, et c’était seulement après tout cela qu’il était question de lecture ou de musique, le plus souvent dans une halte, au pied d’un arbre, ou bien sur un tas de cailloux, le gazon ou la route servant de table pour étaler mes morceaux de bois.
Cette éducation ne ressemblait guère à celle que reçoivent tant d’enfants, qui n’ont qu’à travailler, et qui se plaignent pourtant de n’avoir pas le temps de faire les devoirs qu’on leur donne.
Mais il faut bien dire qu’il y a quelque chose de plus important encore que le temps qu’on emploie au travail, c’est l’application qu’on y apporte ; ce n’est pas l’heure que nous passons sur notre leçon qui met cette leçon dans notre mémoire, c’est la volonté d’apprendre.
Par bonheur, j’étais capable de tendre ma volonté sans me laisser trop souvent entraîner par les distractions qui nous entouraient. Qu’aurais-je appris si je n’avais pu travailler que dans une chambre, les oreilles bouchées avec mes deux mains, les yeux collés sur un livre comme certains écoliers ? Rien, car nous n’avions pas de chambre pour nous enfermer, et en marchant le long des grandes routes je devais regarder au bout de mes pieds sous peine de me laisser souvent choir sur le nez.
Enfin j’appris quelque chose, et en même temps j’appris aussi à faire de longues marches qui ne me furent pas moins utiles que les leçons de Vitalis : j’étais un enfant assez chétif quand je vivais avec mère Barberin, et la façon dont on avait parlé de moi le prouve bien ; « un enfant de la ville, » avait dit Barberin, « avec des jambes et des bras trop minces, » avait dit Vitalis ; auprès de mon maître et vivant de sa vie en plein air, à la dure, mes jambes et mes bras se fortifièrent, mes poumons se développèrent, ma peau se cuirassa et je devins capable de supporter, sans en souffrir, le froid comme le chaud, le soleil comme la pluie, la peine, les privations, les fatigues.
Et ce me fut un grand bonheur que cet apprentissage, il me mit à même de résister aux coups qui plus d’une fois devaient s’abattre sur moi, durs et écrasants, pendant ma jeunesse.
VIII
PAR MONTS ET PAR VAUX
Nous avions parcouru une partie du midi de la France : l’Auvergne, le Velay, le Vivarais, le Quercy, le Rouergue, les Cévennes, le Languedoc.
Notre façon de voyager était des plus simples ; nous allions droit devant nous, au hasard, et quand nous trouvions un village qui de loin ne nous paraissait pas trop misérable, nous nous préparions pour faire une entrée triomphale. Je faisais la toilette des chiens, coiffant Dolce, habillant Zerbino, mettant un emplâtre sur l’œil de Capi pour qu’il pût jouer le rôle d’un vieux grognard, enfin je forçais Joli-Cœur à endosser son habit de général. Mais c’était là la partie la plus difficile de ma tâche, car le singe qui savait très-bien que cette toilette était le prélude d’un travail pour lui, se défendait tant qu’il pouvait, et inventait les tours les plus drôles pour m’empêcher de l’habiller. Alors j’appelais Capi à mon aide, et par sa vigilance, par son instinct et sa finesse, il arrivait presque toujours à déjouer les malices du singe.
La troupe en grande tenue, Vitalis prenait son fifre, et nous mettant en bel ordre nous défilions par le village.
Si le nombre des curieux que nous entraînions derrière nous était suffisant, nous donnions une représentation ; si, au contraire, il était trop faible pour faire espérer une recette, nous continuions notre marche.
Dans les villes seulement nous restions plusieurs jours, et alors le matin j’avais la liberté d’aller me promener où je voulais. Je prenais Capi avec moi, — Capi, simple chien, bien entendu, sans son costume de théâtre, et nous flânions par les rues.
Vitalis qui d’ordinaire me tenait étroitement près de lui, pour cela me mettait volontiers la bride sur le cou.
— Puisque le hasard, me disait-il, te fait parcourir la France à un âge où les enfants sont généralement à l’école ou au collège, ouvre les yeux, regarde et apprends. Quand tu seras embarrassé, quand tu verras quelque chose que tu ne comprendras pas, si tu as des questions à me faire, adresse-les-moi sans peur. Peut-être ne pourrai-je pas toujours te répondre, car je n’ai pas la prétention de tout connaître, mais peut-être aussi me serait-il possible de satisfaire parfois ta curiosité. Je n’ai pas toujours été directeur d’une troupe d’animaux savants, et j’ai appris autre chose que ce qui m’est en ce moment utile pour « présenter Capi ou M. Joli-Cœur devant l’honorable société. »
— Quoi donc ?
— Nous causerons de cela plus tard. Pour le moment sache seulement qu’un montreur de chiens peut avoir occupé une certaine position dans le monde. En même temps, comprends aussi que si en ce moment tu es sur la marche la plus basse de l’escalier de la vie, tu peux, si tu le veux, arriver peu à peu à une plus haute. Cela dépend des circonstances pour un peu, et pour beaucoup de toi. Écoute mes leçons, écoute mes conseils, enfant, et plus tard, quand tu seras grand, tu penseras, je l’espère, avec émotion, avec reconnaissance au pauvre musicien qui t’a fait si grande peur quand il t’a enlevé à ta mère nourrice ; j’ai dans l’idée que notre rencontre te sera heureuse.
Quelle avait pu être cette position dont mon maître parlait assez souvent avec une retenue qu’il s’imposait ? Cette question excitait ma curiosité et faisait travailler mon esprit. S’il avait été sur une marche haute de l’escalier de la vie, comme il disait, pourquoi était-il maintenant sur une marche basse ? Il prétendait que je pouvais m’élever si je le voulais, moi qui n’étais rien, qui ne savais rien, qui étais sans famille, qui n’avais personne pour m’aider. Alors pourquoi lui-même était-il descendu ?
Après avoir quitté l’Auvergne, nous étions descendus dans les causses du Quercy. On appelle ainsi de grandes plaines inégalement ondulées, où l’on ne rencontre guère que des terrains incultes et de maigres taillis. Aucun pays n’est plus triste, plus pauvre. Et ce qui accentue encore cette impression que le voyageur reçoit en le traversant, c’est que presque nulle part il n’aperçoit des eaux. Point de rivières, point de ruisseaux, point d’étangs. Çà et là des lits pierreux de torrents, mais vides. Les eaux se sont engouffrées dans des précipices et elles ont disparu sous terre, pour aller sourdre plus loin et former des rivières ou des fontaines.
Au milieu de cette plaine, brûlée par la sécheresse au moment où nous la traversâmes, se trouve un gros village qui a nom la Bastide-Murat ; nous y passâmes la nuit dans la grange d’une auberge.
— C’est ici, me dit Vitalis en causant le soir avant de nous coucher, c’est ici, dans ce pays, et probablement dans cette auberge, qu’est né un homme qui a fait tuer des milliers de soldats et qui ayant commencé la vie par être garçon d’écurie est devenu prince et roi : il s’appelait Murat ; on en a fait un héros et l’on a donné son nom à ce village. Je l’ai connu, et bien souvent je me suis entretenu avec lui.
Malgré moi une interruption m’échappa.
— Quand il était garçon d’écurie ?
— Non, répondit Vitalis en riant, quand il était roi. C’est la première fois que je viens à la Bastide, et c’est à Naples que je l’ai connu, au milieu de sa cour.
— Vous avez connu un roi !
Il est à croire que le ton de mon exclamation fut fort drôle, car le rire de mon maître éclata de nouveau et se prolongea longtemps.
Nous étions assis sur un banc devant l’écurie, le dos appuyé contre la muraille qui gardait la chaleur du jour. Dans un grand sycomore qui nous couvrait de son feuillage des cigales chantaient leur chanson monotone. Devant nous, par-dessus les toits des maisons la pleine lune qui venait de se lever, montait doucement au ciel. Cette soirée était pour nous d’autant plus douce que la journée avait été brûlante.
— Veux-tu dormir ? me demanda Vitalis, ou bien veux-tu que je te conte l’histoire du roi Murat ?
— Oh ! l’histoire du roi, je vous en prie.
Alors il me raconta longuement cette histoire, et pendant plusieurs heures nous restâmes sur notre banc ; lui, parlant ; moi, les yeux attachés sur son visage, que la lune éclairait de sa pâle lumière.
Eh quoi, tout cela était possible ; non-seulement possible, mais encore vrai !
Je n’avais eu jusqu’alors aucune idée de ce qu’était l’histoire. Qui m’en eût parlé ? Pas mère Barberin, à coup sûr ; elle ne savait même pas ce que c’était. Elle était née à Chavanon, et elle devait y mourir. Son esprit n’avait jamais été plus loin que ses yeux. Et pour ses yeux l’univers tenait dans le pays qu’enfermait l’horizon qui se développait du haut du mont Audouze.
Mon maître avait vu un roi ; ce roi lui avait parlé.
Qu’était donc mon maître, au temps de sa jeunesse ?
Et comment était-il devenu ce que je le voyais au temps de sa vieillesse ?
Il y avait là, on en conviendra, de quoi faire travailler une imagination enfantine, éveillée, alerte et curieuse de merveilleux.
IX
JE RENCONTRE UN GÉANT CHAUSSÉ DE BOTTES DE SEPT LIEUES
En quittant le sol desséché des causses et des garrigues, je me trouve, par le souvenir, dans une vallée toujours fraîche et verte, celle de la Dordogne, que nous descendons à petites journées, car la richesse du pays fait celle des habitants, et nos représentations sont nombreuses, les sous tombent assez facilement dans la sébile de Capi.
Un pont aérien, léger, comme s’il était soutenu dans le brouillard par des fils de la Vierge, s’élève au-dessus d’une large rivière qui roule doucement ses eaux paresseuses ; — c’est le pont de Cubzac, et la rivière est la Dordogne.
Une ville en ruines, avec des fossés, des grottes, des tours, et, au milieu des murailles croulantes d’un cloître, des cigales qui chantent dans les arbustes accrochés çà et là, — c’est Saint-Émilion.
Mais tout cela se brouille confusément dans ma mémoire, tandis que bientôt se présente un spectacle qui la frappe assez fortement pour qu’elle garde l’empreinte qu’elle a alors reçue et se la représente aujourd’hui avec tout son relief.
Nous avions couché dans un village assez misérable et nous en étions partis le matin, au jour naissant. Longtemps nous avions marché sur une route poudreuse, lorsque tout à coup nos regards, jusque-là enfermés dans un chemin que bordaient des vignes, s’étendirent librement sur un espace immense, comme si un rideau, touché par une baguette magique, s’était subitement abaissé devant nous.
Une large rivière s’arrondissait doucement autour de la colline sur laquelle nous venions d’arriver ; et au-delà de cette rivière les toits et les clochers d’une grande ville s’éparpillaient jusqu’à la courbe indécise de l’horizon. Que de maisons ! que de cheminées ! Quelques-unes plus hautes et plus étroites, élancées comme des colonnes, vomissaient des tourbillons de fumée noire qui, s’envolant au caprice de la brise, formait, au-dessus de la ville, un nuage de vapeur sombre. Sur la rivière, au milieu de son cours et le long d’une ligne de quais se tassaient de nombreux navires qui, comme les arbres d’une forêt, emmêlaient les uns dans les autres leurs mâtures, leurs cordages, leurs voiles et leurs drapeaux multicolores qui flottaient au vent. On entendait des ronflements sourds, des bruits de ferraille et de chaudronnerie, des coups de marteaux et par-dessus tout le tapage produit par le roulement de nombreuses voitures qu’on voyait courir çà et là sur les quais.
— C’est Bordeaux, me dit Vitalis.
Pour un enfant, élevé comme moi, qui n’avait vu jusque-là que les pauvres villages de la Creuse, ou les quelques petites villes que le hasard de la route nous avait fait rencontrer, c’était féerique.
Sans que j’eusse réfléchi, mes pieds s’arrêtèrent, je restai immobile, regardant devant moi, au loin, auprès, tout à l’entour.
Mais bientôt mes yeux se fixèrent sur un point : la rivière et les navires qui la couvraient.
En effet, il se produisait là un mouvement confus qui m’intéressait d’autant plus fortement que je n’y comprenais absolument rien.
Des navires, leurs voiles déployées, descendaient la rivière légèrement inclinés sur un côté, d’autres la remontaient ; il y en avait qui restaient immobiles comme des îles, et il y en avait aussi qui tournaient sur eux-mêmes sans qu’on vît ce qui les faisait tourner ; enfin il y en avait encore qui, sans mâture, sans voilure, mais avec une cheminée qui déroulait dans le ciel des tourbillons de fumée, se mouvaient rapidement, allant en tous sens et laissant derrière eux, sur l’eau jaunâtre, des sillons d’écume blanche.
— C’est l’heure de la marée, me dit Vitalis, répondant sans que je l’eusse interrogé, à mon étonnement ; il y a des navires qui arrivent de la pleine mer, après de longs voyages : ce sont ceux dont la peinture est salie et qui sont comme rouillés ; il y en a d’autres qui quittent le port ; ceux que tu vois au milieu de la rivière, tourner sur eux-mêmes, évitent sur leurs ancres de manière à présenter leur proue au flot montant. Ceux qui courent enveloppés dans des nuages de fumée sont des remorqueurs.
Que de mots étranges pour moi ! que d’idées nouvelles !
Lorsque nous arrivâmes au pont qui fait communiquer la Bastide avec Bordeaux, Vitalis n’avait pas eu le temps de répondre à la centième partie des questions que je voulais lui adresser.
Jusque-là nous n’avions jamais fait long séjour dans les villes qui s’étaient trouvées sur notre passage, car les nécessités de notre spectacle nous obligeaient à changer chaque jour le lieu de nos représentations, afin d’avoir un public nouveau. Avec des comédiens tels que ceux qui composaient « la troupe de l’illustre signor Vitalis, » le répertoire ne pouvait pas en effet être bien varié, et quand nous avions joué le Domestique de M. Joli-Cœur, la Mort du général, le Triomphe du juste, le Malade purgé et trois ou quatre autres pièces, c’était fini, nos acteurs avaient donné tout ce qu’ils pouvaient ; il fallait ailleurs recommencer le Malade purgé ou le Triomphe du juste devant des spectateurs qui n’eussent pas vu ces pièces.
Mais Bordeaux est une grande ville, où le public se renouvelle facilement, et en changeant de quartier, nous pouvions donner jusqu’à trois et quatre représentations par jour, sans qu’on nous criât, comme cela nous était arrivé à Cahors :
— C’est donc toujours la même chose ?
De Bordeaux, nous devions aller à Pau. Notre itinéraire nous fit traverser ce grand désert qui, des portes de Bordeaux, s’étend jusqu’aux Pyrénées et qu’on appelle les Landes.
Bien que je ne fusse plus tout à fait le jeune souriceau dont parle la fable et qui trouve dans tout ce qu’il voit un sujet d’étonnement, d’admiration ou d’épouvante, je tombai, dès le commencement de ce voyage, dans une erreur qui fit bien rire mon maître et me valut ses railleries jusqu’à notre arrivée à Pau.
Nous avions quitté Bordeaux depuis sept ou huit jours et, après avoir tout d’abord suivi les bords de la Garonne, nous avions abandonné la rivière à Langon et nous avions pris la route de Mont-de-Marsan, qui s’enfonce à travers les terres. Plus de vignes, plus de prairies, plus de vergers, mais des bois de pins et des bruyères. Bientôt les maisons devinrent plus rares, plus misérables. Puis nous nous trouvâmes au milieu d’une immense plaine qui s’étendait devant nous à perte de vue, avec de légères ondulations. Pas de cultures, pas de bois, la terre grise au loin, et, tout auprès de nous, le long de la route, recouverte d’une mousse veloutée, des bruyères desséchées et des genêts rabougris.
— Nous voici dans les Landes, dit Vitalis ; nous avons vingt ou vingt-cinq lieues à faire au milieu de ce désert. Mets ton courage dans tes jambes.
C’était non-seulement dans les jambes qu’il fallait le mettre, mais dans la tête et le cœur ; car, à marcher sur cette route qui semblait ne devoir finir jamais, on se sentait envahi par une vague tristesse, une sorte de désespérance.
Depuis cette époque, j’ai fait plusieurs voyages en mer, et toujours, lorsque j’ai été au milieu de l’Océan sans aucune voile en vue, j’ai retrouvé en moi ce sentiment de mélancolie indéfinissable qui me saisit dans ces solitudes.
Comme sur l’Océan, nos yeux couraient jusqu’à l’horizon noyé dans les vapeurs de l’automne, sans apercevoir rien que la plaine grise qui s’étendait devant nous plate et monotone.
Nous marchions. Et lorsque nous regardions machinalement autour de nous, c’était à croire que nous avions piétiné sur place sans avancer, car le spectacle était toujours le même : toujours des bruyères, toujours des genêts, toujours des mousses ; puis des fougères, dont les feuilles souples et mobiles ondulaient sous la pression du vent, se creusant, se redressant, se mouvant comme des vagues.
À de longs intervalles seulement nous traversions des bois de petite étendue, mais ces bois n’égayaient pas le paysage comme cela se produit ordinairement. Ils étaient plantés de pins dont les branches étaient coupées jusqu’à la cime. Le long de leur tronc on avait fait des entailles profondes, et par ces cicatrices rouges s’écoulait leur résine en larmes blanches cristallisées. Quand le vent passait par rafales dans leurs ramures, il produisait une musique si plaintive qu’on croyait entendre la voix même de ces pauvres arbres mutilés qui se plaignaient de leurs blessures.
Vitalis m’avait dit que nous arriverions le soir à un village où nous pourrions coucher.
Mais le soir approchait, et nous n’apercevions rien qui nous signalât le voisinage de ce village : ni champs cultivés, ni animaux pâturant dans la lande, ni au loin une colonne de fumée qui nous aurait annoncé une maison.
J’étais fatigué de la route parcourue depuis le matin, et encore plus abattu par une sorte de lassitude générale : ce bienheureux village ne surgirait-il donc jamais au bout de cette route interminable ?
J’avais beau ouvrir les yeux et regarder au loin, je n’apercevais rien que la lande, et toujours la lande dont les buissons se brouillaient de plus en plus dans l’obscurité qui s’épaississait.
L’espérance d’arriver bientôt nous avait fait hâter le pas, et mon maître lui-même, malgré l’habitude de ses longues marches, se sentait fatigué. Il voulut s’arrêter et se reposer un moment sur le bord de la route.
Mais au lieu de m’asseoir près de lui, je voulus gravir un petit monticule planté de genêts qui se trouvait à une courte distance du chemin, pour voir si de là je n’apercevrais pas quelque lumière dans la plaine.
J’appelai Capi pour qu’il vînt avec moi ; mais Capi, lui aussi, était fatigué et il avait fait la sourde oreille, ce qui était sa tactique habituelle avec moi lorsqu’il ne lui plaisait pas de m’obéir.
— As-tu peur ? demanda Vitalis.
Ce mot me décida à ne pas insister et je partis seul pour mon exploration : je voulais d’autant moins m’exposer aux plaisanteries de mon maître que je ne me sentais pas la moindre frayeur.
Cependant la nuit était venue, sans lune, mais avec des étoiles scintillantes qui éclairaient le ciel et versaient leur lumière dans l’air chargé de légères vapeurs que le regard traversait.
Tout en marchant et en jetant les yeux à droite et à gauche, je remarquai que ce crépuscule vaporeux donnait aux choses des formes étranges ; il fallait faire un raisonnement pour reconnaître les buissons, les bouquets de genêts et surtout les quelques petits arbres qui çà et là dressaient leurs troncs tordus et leurs branches contournées ; de loin ces buissons, ces genêts et ces arbres ressemblaient à des êtres vivants appartenant à un monde fantastique.
Cela était bizarre, et il semblait qu’avec l’ombre la lande s’était transfigurée comme si elle s’était peuplée d’apparitions mystérieuses.
L’idée me vint, je ne sais comment, qu’un autre à ma place aurait peut-être été effrayé par ces apparitions ; cela était possible, après tout, puisque Vitalis m’avait demandé si j’avais peur ; cependant, en m’interrogeant, je ne trouvai pas en moi cette frayeur.
À mesure que je gravissais la pente du monticule, les genêts devenaient plus forts, les bruyères et les fougères plus hautes, leur cime dépassait souvent ma tête, et parfois j’étais obligé de me glisser sous leur couvert.
Cependant je ne tardai pas à atteindre le sommet de ce petit tertre. Mais j’eus beau ouvrir les yeux, je n’aperçus pas la moindre lumière. Mes regards se perdaient dans l’obscurité : rien que des formes indécises, des ombres étranges, des genêts qui semblaient tendre leurs branches vers moi, comme des longs bras flexibles, des buissons qui dansaient.
Ne voyant rien qui m’annonçât le voisinage d’une maison, j’écoutai pour tâcher de percevoir un bruit quelconque, le meuglement d’une vache, l’aboiement d’un chien.
Après être resté un moment l’oreille tendue, ne respirant pas pour mieux entendre, un frisson me fit tressaillir, le silence de la lande m’avait effaré ; j’avais peur. De quoi ? Je n’en savais rien. Du silence sans doute, de la solitude et de la nuit. En tous cas, je me sentais sous le coup d’un danger.
À ce moment même, regardant autour de moi avec angoisse, j’aperçus au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des genêts, et en même temps j’entendis comme un bruissement de branches qu’on frôlait.
J’essayai de me dire que c’était la peur qui m’abusait, et que ce que je prenais pour une ombre était sans doute un arbuste, que tout d’abord je n’avais pas aperçu.
Mais ce bruit, quel était-il ?
Il ne faisait pas un souffle de vent.
Les branches, si légères qu’elles soient, ne se meuvent pas seules, il faut que la brise les agite, ou bien que quelqu’un les remue.
Quelqu’un ?
Mais non, ce ne pouvait pas être un homme ce grand corps noir qui venait sur moi ; un animal que je ne connaissais pas plutôt, un oiseau de nuit gigantesque, ou bien une immense araignée à quatre pattes dont les membres grêles se découpaient au-dessus des buissons et des fougères, sur la pâleur du ciel.
Ce qu’il y avait de certain c’est que cette bête, montée sur des jambes d’une longueur démesurée, s’avançait de mon côté par des bonds précipités.
Assurément elle m’avait vu, et c’était sur moi qu’elle accourait.
Cette pensée me fit retrouver mes jambes et tournant sur moi-même, je me précipitai dans la descente pour rejoindre Vitalis.
Mais chose étrange, j’allai moins vite en dévalant que je n’avais été en montant ; je me jetais dans les touffes de genêts et de bruyères, me heurtant, m’accrochant, j’étais à chaque pas arrêté.
En me dépêtrant d’un buisson, je glissai un regard en arrière : la bête s’était rapprochée ; elle arrivait sur moi.
Heureusement la lande n’était plus embarrassée de broussailles, je pus courir plus vite à travers les herbes.
Mais si vite que j’allasse, la bête allait encore plus vite que moi ; je n’avais plus besoin de me retourner, je la sentais sur mon dos.
Je ne respirais plus, étouffé que j’étais par l’angoisse et par ma course folle ; je fis cependant un dernier effort et vins tomber aux pieds de mon maître, tandis que les trois chiens, qui s’étaient brusquement levés, aboyaient à pleine voix.
Je ne pus dire que deux mots que je répétai machinalement :
— La bête, la bête !
Au milieu des vociférations des chiens, j’entendis tout à coup un grand éclat de rire. En même temps mon maître me posant la main sur l’épaule m’obligea à me retourner.
— La bête, c’est toi, disait-il en riant, regarde donc un peu si tu l’oses.
Son rire, plus encore que ses paroles m’avait rappelé à la raison ; j’osai ouvrir les yeux et suivre la direction de sa main.
L’apparition qui m’avait affolé s’était arrêtée, elle se tenait immobile sur la route.
J’eus encore, je l’avoue, un premier moment de répulsion et d’effroi, mais je n’étais plus au milieu de la lande, Vitalis était là, les chiens m’entouraient, je ne subissais plus l’influence troublante de la solitude et du silence.
Je m’enhardis et je fixai sur elle des yeux plus fermes.
Était-ce une bête ?
Était-ce un homme ?
De l’homme, elle avait le corps, la tête, les bras.
De la bête, une peau velue qui la couvrait entièrement, et deux longues pattes maigres sur lesquelles elle restait posée.
Bien que la nuit se fût épaissie, je distinguais ces détails, car cette grande ombre se dessinait en noir, comme une silhouette, sur le ciel, où de nombreuses étoiles versaient une pâle lumière.
Je serais probablement resté longtemps indécis à tourner et retourner ma question, si mon maître n’avait adressé la parole à mon apparition.
— Pourriez-vous me dire si nous sommes éloignés d’un village ? demanda-t-il.
C’était donc un homme, puisqu’on lui parlait ?
Mais pour toute réponse je n’entendis qu’un rire sec semblable au cri d’un oiseau.
C’était donc un animal ?
Cependant mon maître continua ses questions, ce qui me parut tout à fait déraisonnable, car chacun sait que si les animaux comprennent quelquefois ce que nous leur disons, ils ne peuvent pas nous répondre.
Quel ne fut pas mon étonnement lorsque cet animal dit qu’il n’y avait pas de maisons aux environs, mais seulement une bergerie, où il nous proposa de nous conduire.
Puisqu’il parlait, comment avait-il des pattes ?
Si j’avais osé je me serais approché de lui, pour voir comment étaient faites ces pattes, mais bien qu’il ne parût pas méchant, je n’eus pas ce courage, et ayant ramassé mon sac, je suivis mon maître sans rien dire.
— Vois-tu maintenant ce qui t’a fait si grande peur ? me demanda-t-il en marchant.
— Oui, mais je ne sais pas ce que c’est ; il y a donc des géants dans ce pays-ci ?
— Oui, quand ils sont montés sur des échasses.
Et il m’expliqua comment les Landais, pour traverser leurs terres sablonneuses ou marécageuses et ne pas enfoncer dedans jusqu’aux hanches, se servaient de deux longs bâtons garnis d’un étrier, auxquels ils attachaient leurs pieds.
— Et voilà comment ils deviennent des géants avec des bottes de sept lieues pour les enfants peureux.
X
DEVANT LA JUSTICE
De Pau il m’est resté un souvenir agréable : dans cette ville le vent ne souffle presque jamais.
Et, comme nous y restâmes pendant l’hiver, passant nos journées dans les rues, sur les places publiques et sur les promenades, on comprend que je dus être sensible à un avantage de ce genre.
Ce ne fut pourtant pas cette raison qui, contrairement à nos habitudes, détermina ce long séjour en un même endroit, mais une autre toute-puissante auprès de mon maître, — je veux dire l’abondance de nos recettes.
En effet, pendant tout l’hiver, nous eûmes un public d’enfants qui ne se fatigua point de notre répertoire et ne nous cria jamais : « C’est donc toujours la même chose ! »
C’étaient, pour le plus grand nombre, des enfants anglais : de gros garçons avec des chairs roses et de jolies petites filles avec des grands yeux doux, presque aussi beaux que ceux de Dolce. Ce fut alors que j’appris à connaître les Albert, les Huntley et autres pâtisseries sèches, dont avant de sortir ils avaient soin de bourrer leurs poches, pour les distribuer ensuite généreusement entre Joli-Cœur, les chiens et moi.
Quand le printemps s’annonça par de chaudes journées, notre public commença à devenir moins nombreux, et, après la représentation, plus d’une fois des enfants vinrent donner des poignées de main à Joli-Cœur et à Capi. C’étaient leurs adieux qu’ils faisaient ; le lendemain nous ne devions plus les revoir.
Bientôt nous nous trouvâmes seuls sur les places publiques, et il fallut songer à abandonner, nous aussi, les promenades de la Basse-Plante et du Parc.
Un matin nous nous mîmes en route, et nous ne tardâmes pas à perdre de vue les tours de Gaston Phœbus et de Montauset.
Nous avions repris notre vie errante, à l’aventure, par les grands chemins.
Pendant longtemps, je ne sais combien de jours, combien de semaines, nous allâmes devant nous, suivant des vallées, escaladant des collines, laissant toujours à notre droite les cimes bleuâtres des Pyrénées, semblables à des entassements de nuages.
Puis, un soir, nous arrivâmes dans une grande ville, située au bord d’une rivière, au milieu d’une plaine fertile : les maisons, fort laides pour la plupart, étaient construites en briques rouges ; les rues étaient pavées de petits cailloux pointus, durs aux pieds des voyageurs qui avaient fait une dizaine de lieues dans leur journée.
Mon maître me dit que nous étions à Toulouse et que nous y resterions longtemps.
Comme à l’ordinaire, notre premier soin, le lendemain, fut de chercher des endroits propices à nos représentations.
Nous en trouvâmes un grand nombre, car les promenades ne manquent pas à Toulouse, surtout dans la partie de la ville qui avoisine le Jardin des Plantes ; il y a là une belle pelouse ombragée de grands arbres, sur laquelle viennent déboucher plusieurs boulevards qu’on appelle des allées. Ce fut dans une de ces allées que nous nous installâmes, et dès nos premières représentations nous eûmes un public nombreux.
Par malheur, l’homme de police qui avait la garde de cette allée, vit cette installation avec déplaisir, et, soit qu’il n’aimât pas les chiens, soit que nous fussions une cause de dérangement dans son service, soit toute autre raison, il voulut nous faire abandonner notre place.
Peut-être, dans notre position, eût-il été sage de céder à cette tracasserie, car la lutte entre de pauvres saltimbanques tels que nous et des gens de police n’était pas à armes égales, mais mon maître n’en jugea pas ainsi.
Bien qu’il ne fût qu’un montreur de chiens savants pauvre et vieux, — au moins présentement et en apparence, il avait de la fierté ; de plus il avait ce qu’il appelait le sentiment de son droit, c’est-à-dire, ainsi qu’il me l’expliqua, la conviction qu’il devait être protégé tant qu’il ne ferait rien de contraire aux lois ou aux règlements de police.
Il refusa donc d’obéir à l’agent lorsque celui-ci voulut nous expulser de notre allée.
Lorsque mon maître ne voulait pas se laisser emporter par la colère, ou bien lorsqu’il lui prenait fantaisie de se moquer des gens, — ce qui lui arrivait souvent, — il avait pour habitude d’exagérer sa politesse italienne : c’était à croire alors, en entendant ses façons de s’exprimer, qu’il s’adressait à des personnages considérables.
— L’illustrissime représentant de l’autorité, dit-il en répondant chapeau bas à l’agent de police, peut-il me montrer un règlement émanant de ladite autorité, par lequel il serait interdit à d’infimes baladins tels que nous d’exercer leur chétive industrie sur cette place publique ?
L’agent répondit qu’il n’y avait pas à discuter, mais à obéir.
— Assurément, répliqua Vitalis, et c’est bien ainsi que je l’entends ; aussi je vous promets de me conformer à vos ordres aussitôt que vous m’aurez fait savoir en vertu de quels règlements vous les donnez.
Ce jour-là, l’agent de police nous tourna le dos, tandis que mon maître, le chapeau à la main, le bras arrondi et la taille courbée, l’accompagnait en riant silencieusement.
Mais il revint le lendemain et, franchissant les cordes qui formaient l’enceinte de notre théâtre, il se jeta au beau milieu de notre représentation.
— Il faut museler vos chiens, dit-il durement à Vitalis.
— Museler mes chiens !
— Il y a un règlement de police ; vous devez le connaître.
Nous étions en train de jouer le Malade purgé, et comme c’était la première représentation de cette comédie à Toulouse, notre public était plein d’attention.
L’intervention de l’agent provoqua des murmures et des réclamations.
— N’interrompez pas !
— Laissez finir la représentation.
Mais d’un geste, Vitalis réclama et obtint le silence.
Alors ôtant son feutre dont les plumes balayèrent le sable tant son salut fut humble, il s’approcha de l’agent en faisant trois profondes révérences.
— L’illustrissime représentant de l’autorité n’a-t-il pas dit que je devais museler mes comédiens ? demanda-t-il.
— Oui, muselez vos chiens et plus vite que ça.
— Museler Capi, Zerbino, Dolce, s’écria Vitalis s’adressant bien plus au public qu’à l’agent, mais votre seigneurie n’y pense pas ! Comment le savant médecin Capi, connu de l’univers entier, pourra-t-il ordonner ses médicaments purgatifs pour expulser la bile de l’infortuné M. Joli-Cœur, si ledit Capi porte au bout de son nez une muselière ? encore si c’était un autre instrument mieux approprié à sa profession de médecin, et qui celui-là ne se met point au nez des gens.
Sur ce mot, il y eut une explosion de rires et l’on entendit les voix cristallines des enfants se mêler aux voix gutturales des parents.
Vitalis encouragé par ces applaudissements, continua :
— Et comment la charmante Dolce, notre garde-malade, pourra-t-elle user de son éloquence et de ses charmes pour décider notre malade à se laisser balayer et nettoyer les entrailles, si, au bout de son nez elle porte l’instrument que l’illustre représentant de l’autorité veut lui imposer ? Je le demande à l’honorable société et la prie respectueusement de prononcer entre nous.
L’honorable société appelée ainsi à se prononcer, ne répondit pas directement, mais ses rires parlaient pour elle : on approuvait Vitalis, on se moquait de l’agent, et surtout on s’amusait des grimaces de Joli-Cœur, qui, s’étant placé derrière « l’illustrissime représentant de l’autorité, » faisait des grimaces dans le dos de celui-ci, croisant ses bras comme lui, se campant le poing sur la hanche et rejetant sa tête en arrière avec des mines et des contorsions tout à fait réjouissantes.
Agacé par le discours de Vitalis, exaspéré par les rires du public, l’agent de police, qui n’avait pas l’air d’un homme patient, tourna brusquement sur ses talons.
Mais alors il aperçut le singe qui se tenait le poing sur la hanche dans l’attitude d’un matamore ; durant quelques secondes l’homme et la bête restèrent en face l’un de l’autre, se regardant comme s’il s’agissait de savoir lequel des deux baisserait les yeux le premier.
Les rires qui éclatèrent, irrésistibles et bruyants, mirent fin à cette scène.
— Si demain vos chiens ne sont pas muselés, s’écria l’agent en nous menaçant du poing, je vous fais un procès ; je ne vous dis que cela.
— À demain, signor, dit Vitalis, à demain.
Et tandis que l’agent s’éloignait à grands pas, Vitalis resta courbé en deux dans une attitude respectueuse ; puis, la représentation continua.
Je croyais que mon maître allait acheter des muselières pour nos chiens ; mais il n’en fit rien et la soirée s’écoula même sans qu’il parlât de sa querelle avec l’homme de police.
Alors je m’enhardis à lui en parler moi-même.
— Si vous voulez que Capi ne brise pas demain sa muselière pendant la représentation, lui dis-je, il me semble qu’il serait bon de la lui mettre un peu à l’avance. En le surveillant, on pourrait peut-être l’y habituer.
— Tu crois donc que je vais leur mettre une carcasse de fer ?
— Dame, il me semble que l’agent est disposé à vous tourmenter.
— Tu n’es qu’un paysan, et comme tous les paysans tu perds la tête par peur de la police et des gendarmes. Mais sois tranquille, je m’arrangerai demain pour que l’agent ne puisse pas me faire un procès, et en même temps pour que mes élèves ne soient pas trop malheureux. D’un autre côté, je m’arrangerai aussi pour que le public s’amuse un peu. Il faut que cet agent nous procure plus d’une bonne recette, et joue un rôle comique dans la pièce que je lui prépare, cela donnera de la variété à notre répertoire et nous fera rire nous-mêmes un peu. Pour cela, tu te rendras tout seul demain à notre place avec Joli-Cœur ; tu tendras les cordes, tu joueras quelques morceaux de harpe, et quand tu auras autour de toi un public suffisant, et quand l’agent sera arrivé je ferai mon entrée avec les chiens. C’est alors que la comédie commencera.
Il ne me plaisait guère de m’en aller tout seul ainsi préparer notre représentation, mais je commençais à connaître mon maître et à savoir quand je pouvais lui résister ; or il était évident que dans les circonstances présentes je n’avais aucune chance de lui faire abandonner la partie de plaisir sur laquelle il comptait ; je me décidai donc à obéir.
Le lendemain je m’en allai à notre place ordinaire, et tendis mes cordes. J’avais à peine joué quelques mesures, qu’on accourut de tous côtés, et qu’on s’entassa dans l’enceinte que je venais de tracer.
En ces derniers temps, surtout pendant notre séjour à Pau, mon maître m’avait fait travailler la harpe, et je commençais à ne pas trop mal jouer quelques morceaux qu’il m’avait appris. Il y avait entre autres une canzonetta napolitaine que je chantais en m’accompagnant de la harpe et qui me valait toujours des applaudissements.
J’étais déjà artiste par plus d’un côté, et par conséquent disposé à croire, quand notre troupe avait du succès, que c’était à mon talent que ce succès était dû ; cependant ce jour-là j’eus le bon sens de comprendre que ce n’était point pour entendre ma canzonetta qu’on se pressait ainsi dans nos cordes.
Ceux qui avaient assisté la veille à la scène de l’agent de police, étaient revenus, et ils avaient amené avec eux des amis. On aime peu les gens de police, à Toulouse, comme à peu près partout ailleurs, et l’on était curieux de voir comment le vieil Italien se tirerait d’affaire et roulerait son ennemi. Bien que Vitalis n’eût pas prononcé d’autres mots que : « À demain, signor, » il avait été compris par tout le monde que ce rendez-vous donné et accepté était l’annonce d’une grande représentation dans laquelle on trouverait des occasions de rire et de s’amuser au dépens de la police.
De là l’empressement du public.
Aussi en me voyant seul avec Joli-Cœur, plus d’un spectateur inquiet m’interrompait-il pour me demander si « l’Italien » ne viendrait pas.
— Il va arriver bientôt.
Et je continuai ma canzonetta.
Ce ne fut pas mon maître qui arriva, ce fut l’agent de police. Joli-Cœur l’aperçut le premier, et aussitôt, se campant la main sur la hanche et rejetant sa tête en arrière, il se mit à se promener autour de moi en long et en large, raide, cambré, avec une prestance ridicule.
Le public partit d’un éclat de rire et applaudit à plusieurs reprises.
L’agent fut déconcerté et il me lança des yeux furieux.
Bien entendu, cela redoubla l’hilarité du public.
J’avais moi-même envie de rire, mais d’un autre côté je n’étais guère rassuré. Comment tout cela allait-il finir ? Quand Vitalis était là, c’était bien, il répondait à l’agent. Mais j’étais seul, et je l’avoue je ne savais comment je répondrais si l’agent m’interpellait.
La figure de l’agent n’était pas faite pour me donner bonne espérance ; elle était vraiment furieuse, exaspérée par la colère.
Il allait de long en large devant mes cordes et quand il passait près de moi, il avait une façon de me regarder par-dessus son épaule qui me faisait craindre une mauvaise fin.
Joli-Cœur, qui ne comprenait pas la gravité de la situation, s’amusait de l’attitude de l’agent. Il se promenait, lui aussi, le long de ma corde, mais en dedans, tandis que l’agent se promenait en dehors, et en passant devant moi, il me regardait par-dessus son épaule avec une mine si drôle, que les rires du public redoublaient.
Ne voulant point pousser à bout l’exaspération de l’agent, j’appelai Joli-Cœur, mais celui-ci n’était point en disposition d’obéissance, ce jeu l’amusait, et il refusa de m’obéir, continuant sa promenade en courant, et m’échappant lorsque je voulais le prendre.
Je ne sais comment cela se fit, mais l’agent que la colère aveuglait sans doute, s’imagina que j’excitais le singe, et vivement, il enjamba la corde.
En deux enjambées il fut sur moi, et je me sentis à moitié renversé par un soufflet.
Quand je me remis sur mes jambes et rouvris les yeux, Vitalis, survenu je ne sais comment, était placé entre moi et l’agent qu’il tenait par le poignet.
— Je vous défends de frapper cet enfant, dit-il ; ce que vous avez fait est une lâcheté.
L’agent voulut dégager sa main, mais Vitalis serra la sienne.
Et, pendant quelques secondes, les deux hommes se regardèrent en face, les yeux dans les yeux.
L’agent était fou de colère.
Mon maître était magnifique de noblesse : il tenait haute sa belle tête encadrée de cheveux blancs et son visage exprimait l’indignation et le commandement.
Il me sembla que, devant cette attitude, l’agent allait rentrer sous terre, mais il n’en fut rien ; d’un mouvement vigoureux, il dégagea sa main, empoigna mon maître par le collet et le poussa devant lui avec brutalité.
Vitalis faillit tomber, tant la poussée avait été rude ; mais il se redressa, et, levant son bras droit, il en frappa fortement le poignet de l’agent.
Mon maître était un vieillard vigoureux, il est vrai, mais enfin un vieillard ; l’agent, un homme jeune encore et plein de force, la lutte entre eux n’aurait pas été longue.
Mais il n’y eut pas lutte.
— Que voulez-vous ? demanda Vitalis.
— Je vous arrête, suivez-moi au poste.
— Pourquoi avez-vous frappé cet enfant ?
— Pas de paroles, suivez-moi !
Vitalis ne répondit pas, mais se tournant vers moi :
— Rentre à l’auberge, me dit-il, restes-y avec les chiens, je te ferai parvenir des nouvelles.
Il n’en put pas dire davantage, l’agent l’entraîna.
Ainsi finit cette représentation, que mon maître avait voulu faire amusante et qui finit si tristement.
Le premier mouvement des chiens avait été de suivre leur maître, mais je leur ordonnai de rester près de moi, et, habitués à obéir, ils revinrent sur leurs pas. Je m’aperçus alors qu’ils étaient muselés, mais au lieu d’avoir le nez pris dans une carcasse en fer ou dans un filet, ils portaient tout simplement une faveur en soie nouée avec des bouffettes autour de leur museau ; pour Capi, qui était à poil blanc, la faveur était rouge ; pour Zerbino, qui était noir, blanche ; pour Dolce, qui était grise, bleue. C’étaient des muselières de théâtre, et Vitalis avait ainsi costumé les chiens sans doute pour la farce qu’il voulait jouer à l’agent.
Le public s’était rapidement dispersé : quelques personnes seulement avaient gardé leurs places, discutant sur ce qui venait de se passer.
— Le vieux a eu raison.
— Il a eu tort.
— Pourquoi l’agent a-t-il frappé l’enfant, qui ne lui avait rien dit ni rien fait ?
— Mauvaise affaire ; le vieux ne s’en tirera pas sans prison, si l’agent constate la rébellion.
Je rentrai à l’auberge fort affligé et très-inquiet.
Je n’étais plus au temps où Vitalis m’inspirait de l’effroi. À vrai dire, ce temps n’avait duré que quelques heures. Assez rapidement, je m’étais attaché à lui d’une affection sincère, et cette affection avait été en grandissant chaque jour. Nous vivions de la même vie, toujours ensemble du matin au soir, et souvent du soir au matin, quand, pour notre coucher, nous partagions la même botte de paille. Un père n’a pas plus de soins pour son enfant qu’il en avait pour moi. Il m’avait appris à lire, à chanter, à écrire, à compter. Dans nos longues marches, il avait toujours employé le temps à me donner des leçons tantôt sur une chose, tantôt sur une autre, selon que les circonstances ou le hasard lui suggéraient ces leçons. Dans les journées de grand froid, il avait partagé avec moi ses couvertures : par les fortes chaleurs, il m’avait toujours aidé à porter la part de bagages et d’objets dont j’étais chargé. À table, ou plus justement, dans nos repas, car nous ne mangions pas souvent à table, il ne me laissait jamais le mauvais morceau, se réservant le meilleur ; au contraire, il nous partageait également le bon et le mauvais. Quelquefois, il est vrai qu’il me tirait les oreilles ou m’allongeait une taloche d’une main un peu plus rude que ne l’eût été celle d’un père ; mais il n’y avait pas, dans ces petites corrections, de quoi me faire oublier ses soins, ses bonnes paroles et tous les témoignages de tendresse qu’il m’avait donnés depuis que nous étions ensemble. Il m’aimait et je l’aimais.
Cette séparation m’atteignit donc douloureusement.
Quand nous reverrions-nous ?
On avait parlé de prison. Combien de temps pouvait durer cet emprisonnement ?
Qu’allais-je faire pendant ce temps ? Comment vivre ? De quoi ?
Mon maître avait l’habitude de porter sa fortune sur lui, et avant de se laisser entraîner par l’agent de police, il n’avait pas eu le temps de me donner de l’argent.
Je n’avais que quelques sous dans ma poche ; seraient-ils suffisants pour nous nourrir tous, Joli-Cœur, les chiens et moi ?
Je passai ainsi deux journées dans l’angoisse, n’osant pas sortir de la cour de l’auberge, m’occupant de Joli-Cœur et des chiens, qui, tous, se montraient inquiets et chagrins.
Enfin, le troisième jour, un homme m’apporta une lettre de Vitalis.
Par cette lettre, mon maître me disait qu’on le gardait en prison pour le faire passer en police correctionnelle le samedi suivant, sous la prévention de résistance à un agent de l’autorité, et de voies de fait sur la personne de celui-ci.
« En me laissant emporter par la colère, ajoutait-il, j’ai fait une lourde faute qui pourra me coûter cher. Mais il est trop tard pour le reconnaître. Viens à l’audience ; tu y trouveras une leçon. »
Puis il ajoutait des conseils pour ma conduite ; il terminait en m’embrassant et me recommandant de faire pour lui une caresse à Capi, à Joli-Cœur, à Dolce et à Zerbino.
Pendant que je lisais cette lettre, Capi, entre mes jambes, tenait son nez sur le papier, flairant, reniflant, et les mouvements de sa queue me disaient que bien certainement, il reconnaissait, par l’odorat, qu’elle avait passé par les mains de son maître ; depuis trois jours, c’était la première fois qu’il manifestait de l’animation et de la joie.
Ayant pris des renseignements, on me dit que l’audience de la police correctionnelle commençait à dix heures. À neuf heures, le samedi, j’allai m’adosser contre la porte et, le premier, je pénétrai dans la salle. Peu à peu, la salle s’emplit, et je reconnus plusieurs personnes qui avaient assisté à la scène avec l’agent de police.
Je ne savais pas ce que c’était que les tribunaux et la justice, mais d’instinct j’en avais une peur horrible ; il me semblait que, bien qu’il s’agît de mon maître et non de moi, j’étais en danger ; j’allai me blottir derrière un gros poêle, et, m’enfonçant contre la muraille, je me fis aussi petit que possible.
Ce ne fut pas mon maître qu’on jugea le premier ; mais des gens qui avaient volé, qui s’étaient battus, qui, tous, se disaient innocents, et qui, tous, furent condamnés.
Enfin, Vitalis vint s’asseoir entre deux gendarmes sur le banc où tous ces gens l’avaient précédé.
Ce qui se dit tout d’abord, ce qu’on lui demanda, ce qu’il répondit, je n’en sais rien ; j’étais trop ému pour entendre, ou tout au moins pour comprendre. D’ailleurs, je ne pensais pas à écouter, je regardais.
Je regardais mon maître qui se tenait debout, ses grands cheveux blancs rejetés en arrière, dans l’attitude d’un homme honteux et peiné ; je regardais le juge qui l’interrogeait.
— Ainsi, dit celui-ci, vous reconnaissez avoir porté des coups à l’agent qui vous arrêtait ?
— Non des coups, monsieur le Président, mais un coup ; lorsque j’arrivai sur la place où devait avoir lieu notre représentation, je vis l’agent donner un soufflet à l’enfant qui m’accompagnait.
— Cet enfant n’est pas à vous ?
— Non, monsieur le Président, mais je l’aime comme s’il était mon fils. Lorsque je le vis frapper, je me laissai entraîner par la colère, je saisis vivement la main de l’agent et l’empêchai de frapper de nouveau.
— Vous avez vous-même frappé l’agent ?
— C’est-à-dire que lorsque celui-ci me mit la main au collet, j’oubliai quel était l’homme qui se jetait sur moi, ou plutôt je ne vis en lui qu’un homme au lieu de voir un agent, et un mouvement instinctif, involontaire, m’a emporté.
— À votre âge, on ne se laisse pas emporter.
— On ne devrait pas se laisser emporter ; malheureusement on ne fait pas toujours ce qu’on doit ; je le sens aujourd’hui.
— Nous allons entendre l’agent.
Celui-ci raconta les faits tels qu’ils s’étaient passés, mais en insistant plus sur la façon dont on s’était moqué de sa personne, de sa voix, de ses gestes, que sur le coup qu’il avait reçu.
Pendant cette déposition, Vitalis, au lieu d’écouter avec attention, regardait de tous côtés dans la salle. Je compris qu’il me cherchait. Alors je me décidai à quitter mon abri, et, me faufilant au milieu des curieux, j’arrivai au premier rang.
Il m’aperçut, et sa figure attristée s’éclaira ; je sentis qu’il était heureux de me voir, et, malgré moi, mes yeux s’emplirent de larmes.
— C’est tout ce que vous avez à dire pour votre défense ? demanda enfin le président.
— Pour moi, je n’aurais rien à ajouter ; mais pour l’enfant que j’aime tendrement et qui va rester seul, pour lui je réclame l’indulgence du tribunal, et le prie de nous tenir séparés le moins longtemps possible.
Je croyais qu’on allait mettre mon maître en liberté. Mais il n’en fut rien.
Un autre magistrat parla pendant quelques minutes, puis le président, d’une voix grave, dit que le nommé Vitalis, convaincu d’injures et de voies de fait envers un agent de la force publique, était condamné à deux mois de prison et à cent francs d’amende.
Deux mois de prison !
À travers mes larmes, je vis la porte par laquelle Vitalis était entré, se rouvrir ; celui-ci suivit un gendarme, puis la porte se referma.
Deux mois de séparation.
Où aller ?
XI
EN BATEAU
Quand je rentrai à l’auberge, le cœur gros, les yeux rouges, je trouvai sous la porte de la cour l’aubergiste qui me regarda longuement.
J’allais passer pour rejoindre les chiens, quand il m’arrêta.
— Eh bien ? me dit-il, ton maître ?
— Il est condamné.
— À combien ?
— À deux mois de prison.
— Et à combien d’amende ?
— Cent francs.
— Deux mois, cent francs, répéta-t-il à trois ou quatre reprises.
Je voulus continuer mon chemin ; de nouveau il m’arrêta.
— Et qu’est-ce que tu veux faire pendant ces deux mois ?
— Je ne sais pas, monsieur.
— Ah ! tu ne sais pas. Tu as de l’argent pour vivre et pour nourrir tes bêtes, je pense ?
— Non, monsieur.
— Alors tu comptes sur moi pour vous loger ?
— Oh ! non, monsieur, je ne compte sur personne.
Rien n’était plus vrai ; je ne comptais sur personne.
— Eh bien ! mon garçon, continua l’aubergiste, tu as raison, ton maître me doit déjà trop d’argent, je ne peux pas te faire crédit pendant deux mois sans savoir si au bout du compte je serai payé ; il faut t’en aller d’ici.
— M’en aller ! mais où voulez-vous que j’aille, monsieur ?
— Ça, ce n’est pas mon affaire : je ne suis pas ton père, je ne suis pas non plus ton maître. Pourquoi veux-tu que je te garde ?
Je restai un moment abasourdi. Que dire ? Cet homme avait raison. Pourquoi m’aurait-il gardé chez lui ? Je ne lui étais rien qu’un embarras et une charge.
— Allons, mon garçon, prends tes chiens et ton singe, puis file ; tu me laisseras, bien entendu, le sac de ton maître. Quand il sortira de prison il viendra le chercher, et alors nous réglerons notre compte.
Ce mot me suggéra une idée, et je crus avoir trouvé le moyen de rester dans cette auberge.
— Puisque vous êtes certain de faire régler votre compte à ce moment, gardez-moi jusque-là, et vous ajouterez ma dépense à celle de mon maître.
— Vraiment, mon garçon ? Ton maître pourra bien
me payer quelques journées ; mais deux mois, c’est une autre affaire.
— Je mangerai aussi peu que vous voudrez.
— Et tes bêtes ? Non, vois-tu, il faut t’en aller ! Tu trouveras bien à travailler et à gagner ta vie dans les villages.
— Mais, monsieur, où voulez-vous que mon maître me trouve en sortant de prison ? C’est ici qu’il viendra me chercher.
— Tu n’auras qu’à revenir ce jour-là ; d’ici là, va faire une promenade de deux mois dans les environs, dans les villes d’eaux. À Bagnères, à Cauterets, à Luz, il y a de l’argent à gagner.
— Et si mon maître m’écrit ?
— Je te garderai sa lettre.
— Mais si je ne lui réponds pas ?
— Ah ! tu m’ennuies à la fin. Je t’ai dit de t’en aller ; il faut sortir d’ici, et plus vite que ça ! Je te donne cinq minutes pour partir ; si je te retrouve quand je vais revenir dans la cour, tu auras affaire à moi.
Je sentis bien que toute insistance était inutile. Comme le disait l’aubergiste, « il fallait sortir d’ici. »
J’entrai à l’écurie, et, après avoir détaché les chiens et Joli-Cœur, après avoir bouclé mon sac et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe, je sortis de l’auberge.
L’aubergiste était sur sa porte pour me surveiller.
— S’il vient une lettre, me cria-t-il, je te la conserverai !
J’avais hâte de sortir de la ville, car mes chiens n’étaient pas muselés. Que répondre si je rencontrais un agent de police ? Que je n’avais pas d’argent pour leur acheter des muselières ? C’était la vérité, car, tout compte fait, je n’avais que onze sous dans ma poche, et ce n’était pas suffisant pour une pareille acquisition. Ne m’arrêterait-il pas à mon tour ? Mon maître en prison, moi aussi, que deviendraient les chiens et Joli-Cœur ? J’étais devenu directeur de troupe, chef de famille, moi, l’enfant sans famille, et je sentais ma responsabilité.
Tout en marchant rapidement les chiens levaient la tête vers moi, et me regardaient d’un air qui n’avait pas besoin de paroles pour être compris : ils avaient faim.
Joli-Cœur, que je portais juché sur mon sac, me tirait de temps en temps l’oreille pour m’obliger à tourner la tête vers lui : alors il se brossait le ventre par un geste qui n’était pas moins expressif que le regard des chiens.
Moi aussi j’aurais bien comme eux parlé de ma faim, car je n’avais pas déjeuné plus qu’eux tous ; mais à quoi bon ?
Mes onze sous ne pouvaient pas nous donner à déjeuner et à dîner, nous devions tous nous contenter d’un seul repas, qui, fait au milieu de la journée, nous tiendrait lieu des deux.
L’auberge où nous avions logé et d’où nous venions d’être chassés, se trouvant dans le faubourg Saint-Michel sur la route de Montpellier, c’était naturellement cette route que j’avais suivie.
Dans ma hâte de fuir une ville où je pouvais rencontrer des agents de police, je n’avais pas le temps de me demander où les routes conduisaient ; ce que je désirais c’était qu’elles m’éloignassent de Toulouse, le reste m’importait peu. Je n’avais pas intérêt à aller dans un pays plutôt que dans un autre ; partout on me demanderait de l’argent pour manger et pour nous loger. Encore la question du logement était-elle de beaucoup la moins importante ; nous étions dans la saison chaude et nous pouvions coucher à la belle étoile à l’abri d’un buisson ou d’un mur.
Mais manger ?
Je crois bien que nous marchâmes près de deux heures sans que j’osasse m’arrêter, et cependant les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants, tandis que Joli-Cœur me tirait l’oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort.
Enfin je me crus assez loin de Toulouse pour n’avoir rien à craindre, ou tout au moins pour dire que je musèlerais mes chiens le lendemain si on me demandait de le faire, et j’entrai dans la première boutique de boulanger que je trouvai.
Je demandai qu’on me servît une livre et demie de pain.
— Vous prendrez bien un pain de deux livres, me dit la boulangère ; avec votre ménagerie ce n’est pas trop ; il faut bien les nourrir, ces pauvres bêtes !
Sans doute ce n’était pas trop pour ma ménagerie qu’un pain de deux livres, car sans compter Joli-Cœur, qui ne mangeait pas de gros morceaux, cela ne nous donnait qu’une demi-livre pour chacun de nous, mais c’était trop pour ma bourse.
Le pain était alors à cinq sous la livre, et si j’en prenais deux livres elles me coûteraient dix sous, de sorte que sur mes onze sous il ne m’en resterait qu’un seul.
Or je ne trouvais pas prudent de me laisser entraîner à une aussi grande prodigalité, avant d’avoir mon lendemain assuré. En n’achetant qu’une livre et demie de pain qui me coûtait sept sous et trois centimes, il me restait pour le lendemain trois sous et deux centimes, c’est-à-dire assez pour ne pas mourir de faim, et attendre une occasion de gagner quelque argent.
J’eus vite fait ce calcul et je dis à la boulangère d’un air que je tâchai de rendre assuré, que j’avais bien assez d’une livre et demie de pain et que je la priais de ne pas m’en couper davantage.
— C’est bon, c’est bon, répondit-elle.
Et autour d’un beau pain de six livres que nous aurions bien certainement mangé tout entier, elle me coupa la quantité que je demandais et la mit dans la balance, à laquelle elle donna un petit coup.
— C’est un peu fort, dit-elle, cela sera pour les deux centimes.
Et elle fit tomber mes huit sous dans son tiroir.
J’ai vu des gens repousser les centimes qu’on leur rendait, disant qu’ils n’en sauraient que faire ; moi, je n’aurais pas repoussé ceux qui m’étaient dus ; cependant je n’osai pas les réclamer et sortis sans rien dire, avec mon pain étroitement serré sous mon bras.
Les chiens, joyeux, sautaient autour de moi, et Joli-Cœur me tirait les cheveux en poussant des petits cris.
Nous n’allâmes pas bien loin.
Au premier arbre qui se trouva sur la route, je posai ma harpe contre son tronc et m’allongeai sur l’herbe ; les chiens s’assirent en face de moi, Capi au milieu, Dolce d’un côté, Zerbino de l’autre ; quant à Joli-Cœur, qui n’était pas fatigué, il resta debout pour être tout prêt à voler les morceaux qui lui conviendraient.
C’était une affaire délicate que le découpage de ma miche ; j’en fis cinq parts aussi égales que possible, et, pour qu’il n’y eût pas de pain gaspillé, je les distribuai en petites tranches ; chacun avait son morceau à son tour, comme si nous avions mangé à la gamelle.
Joli-Cœur, qui avait besoin de moins de nourriture que nous, se trouva le mieux partagé, et il n’eut plus faim alors que nous étions encore affamés. Sur sa part je pris trois morceaux que je serrai dans mon sac pour les donner aux chiens plus tard ; puis, comme il en restait encore quatre, nous en eûmes chacun un ; ce fut à la fois notre plat de supplément et notre dessert.
Bien que ce festin n’eût rien de ceux qui provoquent aux discours, le moment me parut venu d’adresser quelques paroles à mes camarades. Je me considérais naturellement comme leur chef, mais je ne me croyais pas assez au-dessus d’eux pour être dispensé de leur faire part des circonstances graves dans lesquelles nous nous trouvions.
Capi avait sans doute deviné mon intention, car il tenait collés sur les miens ses grands yeux intelligents et affectueux.
— Oui, mon ami Capi, dis-je, oui, mes amis Dolce, Zerbino et Joli-Cœur, oui, mes chers camarades, j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer : notre maître est éloigné de nous pour deux mois.
— Ouah ! cria Capi.
— Cela est bien triste pour lui d’abord, et aussi pour nous. C’était lui qui nous faisait vivre, et en son absence, nous allons nous trouver dans une terrible situation. Nous n’avons pas d’argent.
Sur ce mot, qu’il connaissait parfaitement, Capi se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à marcher en rond comme s’il faisait la quête dans les « rangs de l’honorable société. »
— Tu veux que nous donnions des représentations, continuai-je, c’est assurément un bon conseil, mais ferons-nous recette ? Tout est là. Si nous ne réussissons pas, je vous préviens que nous n’avons que trois sous pour toute fortune. Il faudra donc se serrer le ventre. Les choses étant ainsi, j’ose espérer que vous comprendrez la gravité des circonstances et qu’au lieu de me jouer de mauvais tours, vous mettrez votre intelligence au service de la société. Je vous demande de l’obéissance, de la sobriété et du courage. Serrons nos rangs, et comptez sur moi comme je compte sur vous-mêmes.
Je n’ose pas affirmer que mes camarades comprirent toutes les beautés de mon discours improvisé, mais certainement ils en sentirent les idées générales. Ils savaient par l’absence de notre maître qu’il se passait quelque chose de grave, et ils attendaient de moi une explication. S’ils ne comprirent pas tout ce que je leur dis, ils furent au moins satisfaits de mon procédé à leur égard, et ils me prouvaient leur contentement par leur attention.
Quand je dis leur attention, je parle des chiens seulement, car pour Joli-Cœur, il lui était impossible de tenir son esprit longtemps fixé sur un même sujet. Pendant la première partie de mon discours, il m’avait écouté avec les marques du plus vif intérêt ; mais au bout d’une vingtaine de mots il s’était élancé sur l’arbre qui nous couvrait de son feuillage, et il s’amusait maintenant à se balancer en sautant de branche en branche. Si Capi m’avait fait une pareille injure j’en aurais certes été blessé, mais de Joli-Cœur rien ne m’étonnait ; ce n’était qu’un étourdi, une cervelle creuse ; et puis après tout il était bien naturel qu’il eût envie de s’amuser un peu.
J’avoue que j’en aurais fait volontiers autant et que comme lui je me serais balancé avec plaisir, mais l’importance et la dignité de mes fonctions ne me permettaient plus de semblables distractions.
Après quelques instants de repos, je donnai le signal du départ : il nous fallait gagner notre coucher, en tous cas notre déjeuner du lendemain, si, comme cela était probable, nous faisions l’économie de coucher en plein air.
Au bout d’une heure de marche à peu près, nous arrivâmes en vue d’un village qui me parut propre à la réalisation de mon dessein.
De loin il s’annonçait comme assez misérable, et la recette ne pouvait être par conséquent que bien chétive, mais il n’y avait pas là de quoi me décourager ; je n’étais pas exigeant sur le chiffre de la recette, et je me disais que plus le village était petit, moins nous avions de chance de rencontrer des agents de police.
Je fis donc la toilette de mes comédiens, et en aussi bel ordre que possible nous entrâmes dans ce village ; malheureusement le fifre de Vitalis nous manquait et aussi sa prestance qui, comme celle d’un tambour-major, attirait toujours les regards. Je n’avais pas comme lui l’avantage d’une grande taille et d’une tête expressive ; bien petite au contraire était ma taille, bien mince, et sur mon visage devait se montrer plus d’inquiétude que d’assurance.
Tout en marchant je regardais à droite et à gauche pour voir l’effet que nous produisions ; il était médiocre, on levait la tête, puis on la rebaissait, personne ne nous suivait.
Arrivés sur une petite place au milieu de laquelle se trouvait une fontaine ombragée par des platanes, je pris ma harpe et commençai à jouer une valse. La musique était gaie, mes doigts étaient légers, mais mon cœur était chagrin, et il me semblait que je portais sur mes épaules un poids bien lourd.
Je dis à Zerbino et à Dolce de valser ; ils m’obéirent aussitôt et se mirent à tourner en mesure.
Mais personne ne se dérangea pour venir nous regarder, et cependant sur le seuil des portes je voyais des femmes qui tricotaient ou qui causaient.
Je continuai de jouer ; Zerbino et Dolce continuèrent de valser.
Peut-être quelqu’un se déciderait-il à s’approcher de nous ; s’il venait une personne, il en viendrait une seconde, puis dix, puis vingt autres.
Mais j’avais beau jouer, Zerbino et Dolce avaient beau tourner, les gens restaient chez eux ; ils ne regardaient même plus de notre côté.
C’était à désespérer.
Cependant je ne désespérais pas et jouais avec plus de force, faisant sonner les cordes de ma harpe à les casser.
Tout à coup un petit enfant, si petit qu’il s’essayait je crois bien à ses premiers pas, quitta le seuil de sa maison et se dirigea vers nous.
Sa mère allait le suivre sans doute, puis après la mère, arriverait une amie, nous aurions notre public, et nous aurions ensuite une recette.
Je jouai moins fort pour ne pas effrayer l’enfant et pour l’attirer plutôt.
Les mains dressées, se balançant sur ses hanches, il s’avança doucement.
Il venait ; il arrivait ; encore quelques pas et il était près de nous.
La mère leva la tête, surprise sans doute et inquiète de ne pas le sentir près d’elle.
Elle l’aperçut aussitôt. Mais alors au lieu de courir après lui comme je l’avais espéré, elle se contenta de l’appeler, et l’enfant docile retourna près d’elle.
Peut-être ces gens n’aimaient-ils pas la danse. Après tout c’était possible.
Je commandai à Zerbino et à Dolce de se coucher et me mis à chanter ma canzonetta ; et jamais bien certainement je ne m’y appliquai avec plus de zèle :
Fenesta vascia e patrona crudele
Quanta sospire m’aje fato jettare.
J’entamais la deuxième strophe quand je vis un homme vêtu d’une veste et coiffé d’un feutre se diriger vers nous.
Enfin !
Je chantai avec plus d’entraînement.
— Holà ! cria-t-il, que fais-tu ici, mauvais garnement ?
Je m’interrompis, stupéfié par cette interpellation, et restai à le regarder venir vers moi, bouche ouverte.
— Eh bien, répondras-tu ? dit-il.
— Vous voyez, monsieur, je chante.
— As-tu une permission pour chanter sur la place de notre commune ?
— Non, monsieur.
— Alors va-t’en si tu ne veux pas que je te fasse un procès.
— Mais, monsieur…
— Appelle-moi monsieur le garde champêtre, et tourne les talons, mauvais mendiant.
Un garde champêtre ! Je savais par l’exemple de mon maître, ce qu’il en coûtait de vouloir se révolter contre les sergents de ville et les gardes champêtres.
Je ne me fis pas répéter cet ordre deux fois ; je tournai sur mes talons comme il m’avait été ordonné, et rapidement je repris le chemin par lequel j’étais venu.
Mendiant ! cela n’était pas juste cependant. Je n’avais pas mendié : j’avais chanté, j’avais dansé, ce qui était ma manière de travailler, quel mal avais-je fait ?
En cinq minutes je sortis de cette commune peu hospitalière mais bien gardée.
Mes chiens me suivaient la tête basse et la mine attristée, comprenant assurément qu’il venait de nous arriver une mauvaise aventure.
Capi de temps en temps me dépassait et, se tournant vers moi, il me regardait curieusement avec ses yeux intelligents. Tout autre à sa place m’eût interrogé, mais Capi était un chien trop bien élevé, trop bien discipliné pour se permettre une question indiscrète, il se contentait seulement de manifester sa curiosité, et je voyais ses mâchoires trembler, agitées par l’effort qu’il faisait pour retenir ses aboiements.
Lorsque nous fûmes assez éloignés pour n’avoir plus à craindre la brutale arrivée du garde champêtre, je fis un signe de la main, et immédiatement les trois chiens formaient le cercle autour de moi, Capi au milieu, immobile, les yeux sur les miens.
Le moment était venu de leur donner l’explication qu’ils attendaient.
— Comme nous n’avons pas de permission pour jouer, dis-je, on nous renvoie.
— Et alors ? demanda Capi d’un coup de tête.
— Alors nous allons coucher à la belle étoile, n’importe où, sans souper.
Au mot souper, il y eut un grognement général.
Je montrai mes trois sous.
— Vous savez que c’est tout ce qui nous reste ; si nous dépensons nos trois sous ce soir, nous n’aurons rien pour déjeuner demain ; or, comme nous avons mangé aujourd’hui, je trouve qu’il est sage de penser au lendemain.
Et je remis mes trois sous dans ma poche.
Capi et Dolce baissèrent la tête avec résignation. Mais Zerbino, qui n’avait pas toujours bon caractère et qui de plus était gourmand, continua de gronder.
Après l’avoir regardé sévèrement sans pouvoir le faire taire, je me tournai vers Capi :
— Explique à Zerbino, lui dis-je, ce qu’il paraît ne pas vouloir comprendre ; il faut nous priver d’un second repas aujourd’hui, si nous voulons en faire un seul demain.
Aussitôt Capi donna un coup de patte à son camarade et une discussion parut s’engager entre eux.
Qu’on ne trouve pas le mot « discussion » impropre parce qu’il est appliqué à deux bêtes. Il est bien certain, en effet, que les bêtes ont un langage particulier à chaque espèce. Si vous avez habité une maison aux corniches ou aux fenêtres de laquelle les hirondelles suspendent leurs nids, vous êtes assurément convaincu que ces oiseaux ne sifflent pas simplement un petit air de musique, alors qu’au jour naissant, elles jacassent si vivement entre elles : ce sont de vrais discours qu’elles tiennent, des affaires sérieuses qu’elles agitent, ou des paroles de tendresse qu’elles échangent. Et les fourmis d’une même tribu, lorsqu’elles se rencontrent dans un sentier et se frottent antennes contre antennes, que croyez-vous qu’elles fassent si vous n’admettez pas qu’elles se communiquent ce qui les intéresse ? Quant aux chiens, non-seulement ils savent parler, mais encore ils savent lire : voyez-les le nez en l’air, ou bien la tête basse flairant le sol, sentant les cailloux et les buissons ; tout à coup ils s’arrêtent devant une touffe d’herbe ou une muraille et ils restent là un moment ; nous ne voyons rien sur cette muraille, tandis que le chien y lit toutes sortes de choses curieuses, écrites dans un caractère mystérieux que nous ne voyons même pas.
Ce que Capi dit à Zerbino je ne l’entendis pas, car si les chiens comprennent le langage des hommes, les hommes ne comprennent pas le langage des chiens ; je vis seulement que Zerbino refusait d’entendre raison et qu’il insistait pour dépenser immédiatement les trois sous ; il fallut que Capi se fâchât, et ce fut seulement quand il eut montré ses crocs, que Zerbino qui n’était pas très-brave, se résigna au silence.
La question du souper étant ainsi réglée, il ne restait plus que celle du coucher.
Heureusement le temps était beau, la journée était chaude, et coucher à la belle étoile en cette saison n’était pas bien grave ; il fallait s’installer seulement de manière à échapper aux loups s’il y en avait dans le pays, et ce qui me paraissait beaucoup plus dangereux, aux gardes champêtres, les hommes étant encore plus à craindre pour nous que les bêtes féroces.
Il n’y avait donc qu’à marcher droit devant soi sur la route blanche jusqu’à la rencontre d’un gîte.
Ce que nous fîmes.
La route s’allongea, les kilomètres succédèrent aux kilomètres, et les dernières lueurs roses du soleil couchant avaient disparu du ciel que nous n’avions pas encore trouvé ce gîte.
Il fallait, tant bien que mal, se décider.
Quand je me décidai à nous arrêter pour passer la nuit, nous étions dans un bois que coupaient çà et là des espaces dénudés au milieu desquels se dressaient des blocs de granit. L’endroit était bien triste, bien désert, mais nous n’avions pas mieux à choisir, et je pensai qu’au milieu de ces blocs de granit nous pourrions trouver un abri contre la fraîcheur de la nuit. Je dis nous, en parlant de Joli-Cœur et de moi, car, pour les chiens, je n’étais pas en peine d’eux ; il n’y avait pas à craindre qu’ils gagnassent la fièvre à coucher dehors. Mais, pour moi, je devais être soigneux, car j’avais conscience de ma responsabilité. Que deviendrait ma troupe si je tombais malade ? que deviendrais-je moi-même, si j’avais Joli-Cœur à soigner ?
Quittant la route, nous nous engageâmes au milieu des pierres, et bientôt j’aperçus un énorme bloc de granit planté de travers de manière à former une sorte de cavité à sa base et un toit à son sommet. Dans cette cavité les vents avaient amoncelé un lit épais d’aiguilles de pin desséchées. Nous ne pouvions mieux trouver : un matelas pour nous étendre, une toiture pour nous abriter ; il ne nous manquait qu’un morceau de pain pour souper ; mais il fallait tâcher de ne pas penser à cela ; d’ailleurs le proverbe n’a-t-il pas dit : « Qui dort dîne. »
Avant de dormir, j’expliquai à Capi que je comptais sur lui pour nous garder, et la bonne bête au lieu de venir avec nous se coucher sur les aiguilles de pin, resta en dehors de notre abri, posté en sentinelle. Je pouvais être tranquille, je savais que personne ne nous approcherait sans que j’en fusse prévenu.
Cependant, bien que rassuré sur ce point, je ne m’endormis pas aussitôt que je me fus étendu sur les aiguilles de pin, Joli-Cœur enveloppé près de moi dans ma veste, Zerbino et Dolce couchés en rond à mes pieds, mon inquiétude étant plus grande encore que ma fatigue.
La journée, cette première journée de voyage, avait été mauvaise, que serait celle du lendemain ? J’avais faim, j’avais soif, et il ne me restait que trois sous. J’avais beau les manier machinalement dans ma poche, ils n’augmentaient pas : un, deux, trois, je m’arrêtais toujours à ce chiffre.
Comment nourrir ma troupe, comment me nourrir moi-même, si je ne trouvais pas le lendemain et les jours suivants à donner des représentations ? des muselières, une permission pour chanter, où voulait-on que j’en eusse ? Faudrait-il donc tous mourir de faim au coin d’un bois, sous un buisson ?
Et tout en agitant ces tristes questions, je regardais les étoiles qui brillaient au-dessus de ma tête dans le ciel sombre. Il ne faisait pas un souffle de vent. Partout le silence, pas un bruissement de feuilles, pas un cri d’oiseau, pas un roulement de voiture sur la route ; aussi loin que ma vue pouvait s’étendre dans les profondeurs bleuâtres, le vide : comme nous étions seuls, abandonnés !
Je sentis mes yeux s’emplir de larmes, puis tout à coup je me mis à pleurer : pauvre mère Barberin ! pauvre Vitalis !
Je m’étais couché sur le ventre, et je pleurais dans mes deux mains sans pouvoir m’arrêter quand je sentis un souffle tiède passer dans mes cheveux ; vivement je me retournai, et une grande langue douce et chaude se colla sur mon visage. C’était Capi, qui m’avait entendu pleurer et qui venait me consoler, comme il était déjà venu à mon secours lors de ma première nuit de voyage.
Je le pris par le cou à deux bras et j’embrassai son museau humide ; alors il poussa deux ou trois gémissements étouffés et il me sembla qu’il pleurait avec moi.
Quand je me réveillai il faisait grand jour et Capi, assis devant moi, me regardait ; les oiseaux sifflaient dans le feuillage ; au loin, tout au loin, une cloche sonnait l’Angelus ; le soleil, déjà haut dans le ciel, lançait des rayons chauds et réconfortants, aussi bien pour le cœur que pour le corps.
Notre toilette matinale fut bien vite faite, et nous nous mîmes en route, nous dirigeant du côté d’où venaient les tintements de la cloche ; là était un village, là sans doute était un boulanger ; quand on s’est couché sans dîner et sans souper, la faim parle de bonne heure.
Mon parti était pris : je dépenserais mes trois sous, et après nous verrions.
En arrivant dans le village, je n’eus pas besoin de demander où était la boulangerie ; notre nez nous guida sûrement vers elle ; j’eus l’odorat presque aussi fin que celui de mes chiens pour sentir de loin la bonne odeur du pain chaud.
Trois sous de pain quand il coûte cinq sous la livre, ne nous donnèrent à chacun qu’un bien petit morceau, et notre déjeuner fut rapidement terminé.
Le moment était donc venu de voir, c’est-à-dire d’aviser aux moyens de faire une recette dans la journée. Pour cela je me mis à parcourir le village en cherchant la place la plus favorable à une représentation, et aussi en examinant la physionomie des gens pour tâcher de deviner s’ils nous seraient amis ou ennemis.
Mon intention n’était pas de donner immédiatement cette représentation, car l’heure n’était pas convenable, mais d’étudier le pays, de faire choix du meilleur emplacement, et de revenir dans le milieu de la journée, sur cet emplacement, tenter la chance.
J’étais absorbé par cette idée, quand tout à coup j’entendis crier derrière moi ; je me retournai vivement et je vis arriver Zerbino poursuivi par une vieille femme. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce qui provoquait cette poursuite et ces cris : profitant de ma distraction, Zerbino m’avait abandonné, et il était entré dans une maison où il avait volé un morceau de viande qu’il emportait dans sa gueule.
— Au voleur ! criait la vieille femme, arrêtez-le, arrêtez-les tous !
En entendant ces derniers mots, me sentant coupable, ou tout au moins responsable de la faute de mon chien, je me mis à courir aussi. Que répondre si la vieille femme me demandait le prix du morceau de viande volé ? Comment le payer ? Une fois arrêtés, ne nous garderait-on pas ?
Me voyant fuir, Capi et Dolce ne restèrent pas en arrière, et je les sentis sur mes talons, tandis que Joli-Cœur que je portais sur mon épaule, m’empoignait par le cou pour ne pas tomber.
Il n’y avait guère à craindre qu’on nous attrapât en nous rejoignant, mais on pouvait nous arrêter au passage, et justement il me sembla que telle était l’intention de deux ou trois personnes qui barraient la route. Heureusement une ruelle transversale venait déboucher sur la route avant ce groupe d’adversaires. Je me jetai dedans accompagné des chiens, et toujours courant à toutes jambes nous fûmes bientôt en pleine campagne. Cependant je ne m’arrêtai que lorsque la respiration commença à me manquer, c’est-à-dire après avoir fait au moins deux kilomètres. Alors je me retournai, osant regarder en arrière ; personne ne nous suivait ; Capi et Dolce étaient toujours sur mes talons, Zerbino arrivait tout au loin, s’étant arrêté sans doute pour manger son morceau de viande.
Je l’appelai, mais Zerbino, qui savait qu’il avait mérité une sévère correction s’arrêta, puis au lieu de venir à moi, il se sauva.
C’était poussé par la faim que Zerbino avait volé ce morceau de viande. Mais je ne pouvais pas accepter cette raison comme une excuse. Il y avait vol. Il fallait que le coupable fût puni, ou bien c’en était fait de la discipline dans ma troupe : au prochain village, Dolce imiterait son camarade, et Capi lui-même finirait par succomber à la tentation.
Je devais donc administrer une correction publique à Zerbino. Mais pour cela il fallait qu’il voulût bien comparaître devant moi, et ce n’était pas chose facile que de le décider.
J’eus recours à Capi.
— Va me chercher Zerbino.
Et il partit aussitôt pour accomplir la mission que je lui confiais. Cependant il me sembla qu’il acceptait ce rôle avec moins de zèle que de coutume, et dans le regard qu’il me jeta avant de partir, je crus voir qu’il se ferait plus volontiers l’avocat de Zerbino que mon gendarme.
Je n’avais plus qu’à attendre le retour de Capi et de son prisonnier, ce qui pouvait être assez long, car Zerbino, très-probablement, ne se laisserait pas ramener tout de suite. Mais il n’y avait rien de bien désagréable pour moi dans cette attente. J’étais assez loin du village pour n’avoir guère à craindre qu’on me poursuivît. Et d’un autre côté, j’étais assez fatigué de ma course pour désirer me reposer un moment. D’ailleurs à quoi bon me presser, puisque je ne savais pas où aller et que je n’avais rien à faire ?
Justement l’endroit où je m’étais arrêté était fait à souhait pour l’attente et le repos. Sans savoir où j’allais dans ma course folle ; j’étais arrivé sur les bords du canal du Midi, et après avoir traversé des campagnes poussiéreuses depuis mon départ de Toulouse, je me trouvais dans un pays vert et frais : des eaux, des arbres, de l’herbe, une petite source coulant à travers les fentes d’un rocher tapissé de plantes qui tombaient en cascades fleuries suivant le cours de l’eau ; c’était charmant, et j’étais là à merveille pour attendre le retour des chiens.
Une heure s’écoula sans que je les visse revenir ni l’un ni l’autre, et je commençais à m’inquiéter, quand Capi reparut seul, la tête basse.
— Où est Zerbino ?
Capi se coucha dans une attitude craintive, alors en le regardant je m’aperçus qu’une de ses oreilles était ensanglantée.
Je n’eus pas besoin d’explication pour comprendre ce qui s’était passé : Zerbino s’était révolté contre la gendarmerie, il avait fait résistance et Capi, qui peut-être n’obéissait qu’à regret à un ordre qu’il considérait comme bien sévère, s’était laissé battre.
Fallait-il le gronder et le corriger aussi ? Je n’en eus pas le courage, je n’étais pas en disposition de peiner les autres, étant déjà bien assez affligé de mon propre chagrin.
L’expédition de Capi n’ayant pas réussi, il ne me restait qu’une ressource qui était d’attendre que Zerbino voulût bien revenir ; je le connaissais, après un premier mouvement de révolte, il se résignerait à subir sa punition, et je le verrais apparaître repentant.
Je m’étendis sous un arbre, tenant Joli-Cœur attaché de peur qu’il ne lui prît fantaisie de rejoindre Zerbino, et ayant, couchés à mes pieds, Capi et Dolce.
Le temps s’écoula, Zerbino ne parut pas, insensiblement le sommeil me prit et je m’endormis.
Quand je m’éveillai le soleil était au-dessus de ma tête, et les heures avaient marché. Mais je n’avais plus besoin du soleil pour me dire qu’il était tard, mon estomac me criait qu’il y avait longtemps que j’avais mangé mon morceau de pain. De leur côté les deux chiens et Joli-Cœur me montraient aussi qu’ils avaient faim. Capi et Dolce, avec des mines piteuses, Joli-Cœur avec des grimaces.
Et Zerbino n’apparaissait toujours pas.
Je l’appelai, je le sifflai, mais tout fut inutile, il ne parut pas ; ayant bien déjeuné il digérait tranquillement, blotti sous un buisson.
Ma situation devenait critique : si je m’en allais il pouvait très-bien se perdre et ne pas nous rejoindre ; si je restais, je ne trouvais pas l’occasion de gagner quelques sous et de manger.
Et précisément le besoin de manger devenait de plus en plus impérieux. Les yeux des chiens s’attachaient sur les miens désespérément et Joli-Cœur se brossait le ventre en poussant des petits cris de colère.
Le temps s’écoulant et Zerbino ne venant pas, j’envoyai une fois encore Capi à la recherche de son camarade, mais au bout d’une demi-heure il revint seul et me fit comprendre qu’il ne l’avait pas trouvé.
Que faire ?
Bien que Zerbino fût coupable et nous eût mis tous par sa faute encore dans une terrible situation, je ne pouvais pas avoir l’idée de l’abandonner. Que dirait mon maître si je ne lui ramenais pas ses trois chiens ? Et puis, malgré tout, je l’aimais ce coquin de Zerbino.
Je résolus donc d’attendre jusqu’au soir, mais il était impossible de rester ainsi dans l’inaction à écouter notre estomac crier la faim, car ses cris étaient d’autant plus douloureux qu’ils étaient seuls à se faire entendre, sans aucune distraction aussi bien que sans relâche.
Il fallait inventer quelque chose qui pût nous occuper tous les quatre et nous distraire.
Si nous pouvions oublier que nous avions faim, nous aurions assurément moins faim pendant ces heures d’oubli.
Mais à quoi nous occuper ?
Comme j’examinais cette question, je me souvins que Vitalis m’avait dit qu’à la guerre quand un régiment était fatigué par une longue marche, on faisait jouer la musique, si bien qu’en entendant des airs gais ou entraînants, les soldats oubliaient leurs fatigues.
Si je jouais un air gai, peut-être oublierions-nous tous notre faim ; en tous cas étant occupé à jouer et les chiens à danser avec Joli-Cœur, le temps passerait plus vite pour nous.
Je pris ma harpe, qui était posée contre un arbre, et tournant le dos au canal, après avoir mis mes comédiens en position, je commençai à jouer un air de danse, puis après une valse.
Tout d’abord mes acteurs ne semblaient pas très-disposés à la danse, il était évident que le morceau de pain eût bien mieux fait leur affaire, mais peu à peu ils s’animèrent, la musique produisit son effet obligé, nous oubliâmes tous le morceau de pain que nous n’avions pas et nous ne pensâmes plus, moi qu’à jouer, eux qu’à danser.
Tout à coup j’entendis une voix claire, une voix d’enfant crier : « bravo ! » Cette voix venait de derrière moi. Je me retournai vivement.
Un bateau était arrêté sur le canal, l’avant tourné vers la rive sur laquelle je me trouvais ; les deux chevaux qui le traînaient avaient fait halte sur la rive opposée.
C’était un singulier bateau, et tel que je n’en avais pas encore vu de pareil ; il était beaucoup plus court que les péniches qui servent ordinairement à la navigation sur les canaux, et au-dessus de son pont peu élevé au dessus de l’eau était construite une sorte de galerie vitrée ; à l’avant de cette galerie se trouvait une verandah ombragée par des plantes grimpantes, dont le feuillage accroché çà et là aux découpures du toit retombait par places en cascades vertes ; sous cette verandah j’aperçus deux personnes : une dame jeune encore, à l’air noble et mélancolique qui se tenait debout, et un enfant, un garçon à peu près de mon âge qui me parut couché.
C’était cet enfant sans doute qui avait crié « bravo. »
Remis de ma surprise, car cette apparition n’avait rien d’effrayant, je soulevai mon chapeau pour remercier celui qui m’avait applaudi.
— C’est pour votre plaisir que vous jouez ? me demanda la dame, parlant avec un accent étranger.
— C’est pour faire travailler mes comédiens et aussi… pour me distraire.
L’enfant fit un signe et la dame se pencha vers lui.
— Voulez-vous jouer encore ? me demanda la dame en relevant la tête.
Si je voulais jouer ! Jouer pour un public qui m’arrivait si à propos. Je ne me fis pas prier.
— Voulez-vous une danse ou une comédie ? dis-je.
— Oh ! une comédie ! s’écria l’enfant.
Mais la dame interrompit pour dire qu’elle préférait une danse.
— La danse, c’est trop court, s’écria l’enfant.
— Après la danse, nous pourrons, si l’honorable société le désire, représenter différents tours, « tels qu’ils se font dans les cirques de Paris. »
C’était une phrase de mon maître, je tâchai de la débiter comme lui avec noblesse. En réfléchissant, j’étais bien aise qu’on eût refusé la comédie, car j’aurais été assez embarrassé pour organiser la représentation, d’abord parce que Zerbino me manquait et aussi parce que je n’avais pas les costumes et les accessoires nécessaires.
Je repris donc ma harpe et je commençai à jouer une valse ; aussitôt Capi entoura la taille de Dolce avec ses deux pattes et ils se mirent à tourner en mesure. Puis Joli-Cœur dansa un pas seul. Puis successivement nous passâmes en revue tout notre répertoire. Nous ne sentions pas la fatigue. Quant à mes comédiens, ils avaient assurément compris qu’un dîner serait le paiement de leurs peines, et ils ne s’épargnaient pas plus que je m’épargnais moi-même.
Tout à coup, au milieu d’un de mes exercices, je vis Zerbino sortir d’un buisson, et quand ses camarades passèrent près de lui, il se plaça effrontément au milieu d’eux et prit son rôle.
Tout en jouant et en surveillant mes comédiens, je regardais de temps en temps le jeune garçon, et, chose étrange, bien qu’il parût prendre grand plaisir à nos exercices, il ne bougeait pas : il restait couché, allongé, dans une immobilité complète, ne remuant que les deux mains pour nous applaudir.
Était-il paralysé ? il semblait qu’il était attaché sur une planche.
Insensiblement le vent avait poussé le bateau contre la berge sur laquelle je me trouvais et je voyais maintenant l’enfant comme si j’avais été sur le bateau même près de lui : il était blond de cheveux, son visage était pâle, si pâle qu’on voyait les veines bleues de son front sous sa peau transparente ; son expression était la douceur et la tristesse, avec quelque chose de maladif.
— Combien faites-vous payer les places à votre théâtre ? me demanda la dame.
— On paye selon le plaisir qu’on a éprouvé.
— Alors, maman, il faut payer très-cher, dit l’enfant.
Puis il ajouta quelques paroles dans une langue que je ne comprenais pas.
— Arthur voudrait voir vos acteurs de plus près, me dit la dame.
Je fis un signe à Capi qui prenant son élan, sauta dans le bateau.
— Et les autres ? cria Arthur.
Zerbino et Dolce suivirent leur camarade.
— Et le singe !
Joli-Cœur aurait facilement fait le saut, mais je n’étais jamais sûr de lui ; une fois à bord, il pouvait se livrer à des plaisanteries qui n’auraient peut-être pas été du goût de la dame.
— Est-il méchant ? demanda-t-elle.
— Non, madame ; mais il n’est pas toujours obéissant et j’ai peur qu’il ne se conduise pas convenablement.
— Eh bien ! embarquez avec lui.
Disant cela, elle fit signe à un homme qui se tenait à l’arrière auprès du gouvernail, et aussitôt cet homme passant à l’avant jeta une planche sur la berge.
C’était un pont. Il me permit d’embarquer sans risquer le saut périlleux, et j’entrai dans le bateau gravement, ma harpe sur l’épaule et Joli-Cœur dans ma main.
— Le singe ! le singe ! s’écria Arthur.
Je m’approchai de l’enfant, et, tandis qu’il flattait et caressait Joli-Cœur, je pus l’examiner à loisir.
Chose surprenante, il était bien véritablement attaché sur une planche, comme je l’avais cru tout d’abord.
— Vous avez un père, n’est-ce pas, mon enfant ? me demanda la dame.
— Oui, mais je suis seul en ce moment.
— Pour longtemps ?
— Pour deux mois.
— Deux mois ! Oh ! mon pauvre petit ! comment seul ainsi pour si longtemps à votre âge !
— Il le faut bien, madame !
— Votre maître vous oblige sans doute à lui rapporter une somme d’argent au bout de ces deux mois ?
— Non, madame ; il ne m’oblige à rien. Pourvu que je trouve à vivre avec ma troupe, cela suffit.
— Et vous avez trouvé à vivre jusqu’à ce jour ?
J’hésitai avant de répondre : je n’avais jamais vu une dame qui m’inspirât un sentiment de respect comme celle qui m’interrogeait. Cependant elle me parlait avec tant de bonté, sa voix était si douce, son regard était si affable, si encourageant, que je me décidai à dire la vérité. D’ailleurs, pourquoi me taire ?
Je lui racontai donc comment j’avais dû me séparer de Vitalis, condamné à la prison pour m’avoir défendu, et comment depuis que j’avais quitté Toulouse, je n’avais pas pu gagner un sou.
Pendant que je parlais, Arthur jouait avec les chiens, mais cependant il écoutait et entendait ce que je disais.
— Comme vous devez tous avoir faim ! s’écria-t-il.
À ce mot, qu’ils connaissaient bien, les chiens se mirent à aboyer et Joli-Cœur se frotta le ventre avec frénésie.
— Oh ! maman, dit Arthur.
La dame comprit cet appel : elle dit quelques mots en langue étrangère à une femme qui montrait sa tête dans une porte entre-bâillée et presque aussitôt cette femme apporta une petite table servie.
— Asseyez-vous, mon enfant, me dit la dame.
Je ne me fis pas prier, je posai ma harpe et m’assis vivement devant la table ; les chiens se rangèrent aussitôt autour de moi et Joli-Cœur prit place sur mon genou.
— Vos chiens mangent-ils du pain ? me demanda Arthur.
S’ils mangeaient du pain ! Je leur en donnai à chacun un morceau qu’ils dévorèrent.
— Et le singe ? dit Arthur.
Mais il n’y avait pas besoin de s’occuper de Joli-Cœur, car tandis que je servais les chiens, il s’était emparé d’un morceau de croûte de pâté avec lequel il était en train de s’étouffer sous la table.
À mon tour, je pris une tranche de pain, et si je ne m’étouffai pas comme Joli-Cœur, je dévorai au moins aussi gloutonnement que lui.
— Pauvre enfant ! disait la dame en emplissant mon verre.
Quant à Arthur, il ne disait rien, mais il nous regardait les yeux écarquillés, émerveillé assurément de notre appétit, car nous étions aussi voraces les uns que les autres, même Zerbino, qui cependant aurait dû se rassasier jusqu’à un certain point avec la viande qu’il avait volée.
— Et où auriez-vous dîné ce soir si nous ne nous étions pas rencontrés ? demanda Arthur.
— Je crois bien que nous n’aurions pas dîné.
— Et demain où dînerez-vous ?
— Peut-être demain aurons-nous la chance de faire une bonne rencontre comme aujourd’hui.
Sans continuer de s’entretenir avec moi Arthur se tourna vers sa mère, et une longue conversation s’engagea entre eux dans la langue étrangère que j’avais déjà entendue : il paraissait demander une chose qu’elle n’était pas disposée à accorder ou tout au moins contre laquelle elle soulevait des objections.
Tout à coup il tourna de nouveau sa tête vers moi, car son corps ne bougeait pas.
— Voulez-vous rester avec nous ? dit-il.
Je le regardai sans répondre, tant cette question me prit à l’improviste.
— Mon fils vous demande si vous voulez rester avec nous.
— Sur ce bateau !
— Oui, sur ce bateau : mon fils est malade, les médecins ont ordonné de le tenir attaché sur une planche ainsi que vous voyez. Pour qu’il ne s’ennuie pas, je le promène dans ce bateau. Vous demeurerez avec nous. Vos chiens et votre singe donneront des représentations pour Arthur qui sera leur public. Et vous, si vous le voulez bien, mon enfant, vous nous jouerez de la harpe. Ainsi vous nous rendrez service, et nous de notre côté nous vous serons peut-être utiles. Vous n’aurez point chaque jour à trouver un public, ce qui pour un enfant de votre âge n’est pas toujours très-facile.
En bateau ! Je n’avais jamais été en bateau, et ç’avait été mon grand désir. J’allais vivre en bateau, sur l’eau, quel bonheur !
Ce fut la première pensée qui frappa mon esprit et l’éblouit. Quel rêve !
Quelques secondes de réflexion me firent sentir tout ce qu’il y avait d’heureux pour moi dans cette proposition, et combien était généreuse celle qui me l’adressait.
Je pris la main de la dame et la baisai.
Elle parut sensible à ce témoignage de reconnaissance, et affectueusement, presque tendrement, elle me passa à plusieurs reprises la main sur le front.
— Pauvre petit ! dit-elle.
Puisqu’on me demandait de jouer de la harpe, il me sembla que je ne devais pas différer de me rendre au désir qu’on me montrait : l’empressement était jusqu’à un certain point une manière de prouver ma bonne volonté en même temps que ma reconnaissance.
Je pris mon instrument et j’allai me placer tout à l’avant du bateau, puis je commençai à jouer.
En même temps la dame approcha de ses lèvres un petit sifflet en argent et elle en tira un son aigu.
Je cessai de jouer aussitôt, me demandant pourquoi elle sifflait ainsi : était-ce pour me dire que je jouais mal ou pour me faire taire ?
Arthur, qui voyait tout ce qui se passait autour de lui, devina mon inquiétude.
— Maman a sifflé pour que les chevaux se remettent en marche, dit-il.
En effet, le bateau qui s’était éloigné de la berge commençait à filer sur les eaux tranquilles du canal, entraîné par les chevaux, l’eau clapotait contre la carène, et de chaque côté les arbres fuyaient derrière nous éclairés par les rayons obliques du soleil couchant.
— Voulez-vous jouer ? demanda Arthur.
Et, d’un signe de tête, appelant sa mère auprès de lui, il lui prit la main et la garda dans les siennes pendant tout le temps que je jouai les divers morceaux que mon maître m’avait appris.
XII
MON PREMIER AMI
La mère d’Arthur était Anglaise, elle se nommait madame Milligan ; elle était veuve et Arthur était son seul enfant, — au moins son seul enfant vivant, car elle avait eu un fils aîné, qui avait disparu dans des conditions mystérieuses.
À l’âge de six mois, cet enfant avait été perdu ou volé, et jamais on n’avait pu retrouver ses traces. Il est vrai qu’au moment où cela était arrivé, madame Milligan n’avait pas pu faire les recherches nécessaires. Son mari était mourant et elle-même était très-gravement malade, n’ayant pas sa connaissance et ne sachant rien de ce qui se passait autour d’elle. Quand elle était revenue à la vie, son mari était mort et son fils avait disparu. Les recherches avaient été dirigées par M. James Milligan, son beau-frère. Mais il y avait cela de particulier dans ce choix, que M. James Milligan avait un intérêt opposé à celui de sa belle-sœur. En effet, son frère mort sans enfants, il devenait l’héritier de celui-ci. Ses recherches n’aboutirent point : en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, il fut impossible de découvrir ce qu’était devenu l’enfant disparu.
Cependant M. James Milligan n’hérita point de son frère, car sept mois après la mort de son mari madame Milligan mit au monde un enfant, qui était le petit Arthur.
Mais cet enfant chétif et maladif, ne pouvait pas vivre, disaient les médecins ; il devait mourir d’un moment à l’autre, et ce jour-là M. James Milligan devenait enfin l’héritier du titre et de la fortune de son frère aîné, car les lois de l’héritage ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et en Angleterre elles permettent, dans certaines circonstances, que ce soit un oncle qui hérite au détriment d’une mère.
Les espérances de M. James Milligan se trouvèrent donc retardées par la naissance de son neveu, elles ne furent pas détruites ; il n’avait qu’à attendre.
Il attendit.
Mais les prédictions des médecins ne se réalisèrent point : Arthur resta maladif ; il ne mourut pourtant pas ainsi qu’il avait été décidé ; les soins de sa mère le firent vivre ; c’est un miracle qui, Dieu merci, se répète assez souvent.
Vingt fois on le crut perdu, vingt fois il fut sauvé ; successivement, quelquefois même ensemble il avait eu toutes les maladies qui peuvent s’abattre sur les enfants.
En ces derniers temps s’était déclaré un mal terrible qu’on appelle coxalgie, et dont le siège est dans la hanche. Pour ce mal on avait ordonné les eaux sulfureuses, et madame Milligan était venue dans les Pyrénées. Mais après avoir essayé des eaux inutilement, on avait conseillé un autre traitement qui consistait à tenir le malade allongé, sans qu’il pût mettre le pied à terre.
C’est alors que madame Milligan avait fait construire à Bordeaux le bateau sur lequel je m’étais embarqué.
Elle ne pouvait pas penser à laisser son fils enfermé dans une maison, il y serait mort d’ennui ou de privation d’air : Arthur ne pouvant plus marcher, la maison qu’il habiterait devait marcher pour lui.
On avait transformé un bateau en maison flottante avec chambre, cuisine, salon et verandah. C’était dans ce salon ou sous cette verandah, selon les temps, qu’Arthur se tenait du matin au soir, avec sa mère à ses côtés, et les paysages défilaient devant lui, sans qu’il eût d’autre peine que d’ouvrir les yeux.
Ils étaient partis de Bordeaux depuis un mois, et après avoir remonté la Garonne, ils étaient entrés dans le canal du Midi ; par ce canal, ils devaient gagner les étangs et les canaux qui longent la Méditerranée, remonter ensuite le Rhône, puis la Saône, passer de cette rivière dans la Loire jusqu’à Briare, prendre là le canal de ce nom, arriver dans la Seine et suivre le cours de ce fleuve jusqu’à Rouen où ils s’embarqueraient sur un grand navire pour rentrer en Angleterre.
Bien entendu, ce ne fut pas dès le jour de mon arrivée que j’appris tous ces détails sur madame Milligan et sur Arthur ; je ne les connus que successivement, peu à peu, et si je les ai groupés ici, c’est pour l’intelligence de mon récit.
Le jour de mon arrivée, je fis seulement connaissance de la chambre que je devais occuper dans le bateau qui s’appelait le Cygne. Bien qu’elle fût toute petite, cette chambre, deux mètres de long sur un mètre à peu près de large, c’était la plus charmante cabine, la plus étonnante que puisse rêver une imagination enfantine.
Le mobilier qui la garnissait consistait en une seule commode, mais cette commode ressemblait à la bouteille inépuisable des physiciens qui renferme tant de choses. Au lieu d’être fixe, la tablette supérieure était mobile, et quand on la relevait, on trouvait sous elle un lit complet, matelas, oreiller, couverture. Bien entendu il n’était pas très-large ce lit, cependant il était assez grand pour qu’on y fût très-bien couché. Sous ce lit était un tiroir garni de tous les objets nécessaires à la toilette. Et sous ce tiroir s’en trouvait un autre divisé en plusieurs compartiments, dans lesquels on pouvait ranger le linge et les vêtements. Point de tables, point de sièges, au moins dans la forme habituelle, mais contre la cloison, du côté de la tête du lit, une planchette qui, en s’abaissant, formait table, et du côté des pieds, une autre qui formait chaise.
Un petit hublot percé dans le bordage et qu’on pouvait fermer avec un verre rond, servait à éclairer et à aérer cette chambre.
Jamais je n’avais rien vu de si joli, ni de si propre ; tout était revêtu de boiseries en sapin verni, et sur le plancher était étendue une toile cirée à carreaux noirs et blancs.
Mais ce n’étaient pas seulement les yeux qui étaient charmés.
Quand, après m’être déshabillé, je m’étendis dans le lit, j’éprouvai un sentiment de bien-être tout nouveau pour moi ; c’était la première fois que des draps me flattaient la peau, au lieu de me la gratter ; chez mère Barberin je couchais dans des draps de toile de chanvre raides et rugueux ; avec Vitalis nous couchions bien souvent sans draps sur la paille ou sur le foin, et quand on nous en donnait, dans les auberges, mieux aurait valu, presque toujours, une bonne litière ; comme ils étaient fins ceux dans lesquels je m’enveloppais ; comme ils étaient doux, comme ils sentaient bon ! et le matelas comme il était plus moelleux que les aiguilles de pin sur lesquelles j’avais couché la veille ! Le silence de la nuit n’était plus inquiétant, l’ombre n’était plus peuplée, et les étoiles que je regardais par le hublot ne me disaient plus que des paroles d’encouragement et d’espérance.
Si bien couché que je fusse dans ce bon lit, je me levai dès le point du jour, car j’avais l’inquiétude de savoir comment mes comédiens avaient passé la nuit.
Je trouvai tout mon monde à la place où je l’avais installé la veille et dormant comme si ce bateau eût été leur habitation depuis plusieurs mois. À mon approche, les chiens s’éveillèrent et vinrent joyeusement me demander leur caresse du matin. Seul, Joli-Cœur, bien qu’il eût un œil à demi ouvert, ne bougea pas, mais il se mit à ronfler comme un trombone.
Il n’y avait pas besoin d’un grand effort d’esprit pour comprendre ce que cela signifiait : M. Joli-Cœur, qui était la susceptibilité en personne, se fâchait avec une extrême facilité, et une fois fâché, boudait longtemps. Dans les circonstances présentes, il était peiné que je ne l’eusse pas emmené dans ma chambre, et il me témoignait son mécontentement par ce sommeil simulé.
Je ne pouvais pas lui expliquer les raisons qui m’avaient obligé, à mon grand regret, de le laisser sur le pont, et, comme je sentais que j’avais, du moins en apparence, des torts envers lui, je le pris dans mes bras, pour lui témoigner mes regrets par quelques caresses.
Tout d’abord il persista dans sa bouderie, mais bientôt, avec sa mobilité d’humeur, il pensa à autre chose, et, par sa pantomime, il m’expliqua que, si je voulais aller me promener avec lui à terre, il me pardonnerait peut-être.
Le marinier que j’avais vu la veille au gouvernail était déjà levé et il s’occupait à nettoyer le pont : il voulut bien mettre la planche à terre, et je pus descendre dans la prairie avec ma troupe.
En jouant avec les chiens et avec Joli-Cœur, en courant, en sautant les fossés, en grimpant aux arbres, le temps passa vite ; quand nous revînmes, les chevaux étaient attelés au bateau et attachés à un peuplier sur le chemin de halage : ils n’attendaient qu’un coup de fouet pour partir.
J’embarquai vite ; quelques minutes après, l’amarre qui retenait le bateau à la rive fut larguée, le marinier prit place au gouvernail, le haleur enfourcha son cheval, la poulie dans laquelle passait la remorque grinça ; nous étions en route.
Quel plaisir que le voyage en bateau ! les chevaux trottaient sur le chemin de halage, et, sans que nous sentissions un mouvement, nous glissions légèrement sur l’eau ; les deux rives boisées fuyaient derrière nous, et l’on n’entendait d’autre bruit que celui du remous contre la carène dont le clapotement se mêlait à la sonnerie des grelots que les chevaux portaient à leur cou.
Nous allions, et penché sur le bordage, je regardais les peupliers qui, les racines dans l’herbe fraîche, se dressaient fièrement, agitant dans l’air tranquille du matin leurs feuilles toujours émues ; leur longue file alignée selon la rive, formait un épais rideau vert qui arrêtait les rayons obliques du soleil, et ne laissait venir à nous qu’une douce lumière tamisée par le branchage.
De place en place l’eau se montrait toute noire, comme si elle recouvrait des abîmes insondables ; ailleurs au contraire, elle s’étalait en nappes transparentes qui laissaient voir des cailloux lustrés et des herbes veloutées.
J’étais absorbé dans ma contemplation, lorsque j’entendis prononcer mon nom derrière moi.
Je me retournai vivement : c’était Arthur qu’on apportait sur sa planche ; sa mère était près de lui.
— Vous avez bien dormi ? me demanda Arthur, mieux que dans les champs ?
Je m’approchai et répondis en cherchant des paroles polies que j’adressai à la mère tout autant qu’à l’enfant.
— Et les chiens ? dit-il.
Je les appelai, ainsi que Joli-Cœur ; ils arrivèrent en saluant et Joli-Cœur en faisant des grimaces, comme lorsqu’il prévoyait que nous allions donner une représentation.
Mais il ne fut pas question de représentation, ce matin-là.
Madame Milligan avait installé son fils à l’abri des rayons du soleil ; et elle s’était placée près de lui.
— Voulez-vous emmener les chiens et le singe, me dit-elle, nous avons à travailler.
Je fis ce qui m’était demandé, et je m’en allai avec ma troupe, tout à l’avant.
À quel travail ce pauvre petit malade était-il donc propre ?
Je vis que sa mère lui faisait répéter une leçon, dont elle suivait le texte dans un livre ouvert.
Étendu sur sa planche, Arthur répétait sans faire un mouvement.
Ou plus justement, il essayait de répéter, car il hésitait terriblement, et ne disait pas trois mots couramment ; encore bien souvent se trompait-il.
Sa mère le reprenait avec douceur, mais en même temps avec fermeté.
— Vous ne savez pas votre fable, dit-elle.
Cela me parut étrange de l’entendre dire vous à son fils, car je ne savais pas alors que les Anglais ne se servent pas du tutoiement.
— Oh ! maman, dit-il d’une voix désolée.
— Vous faites plus de fautes aujourd’hui que vous n’en faisiez hier.
— J’ai tâché d’apprendre.
— Et vous n’avez pas appris.
— Je n’ai pas pu.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas… parce que je n’ai pas pu… Je suis malade.
— Vous n’êtes pas malade de la tête ; je ne consentirai jamais à ce que vous n’appreniez rien, et que, sous prétexte de maladie, vous grandissiez dans l’ignorance.
Elle me paraissait bien sévère, madame Milligan, et cependant elle parlait sans colère et d’une voix tendre.
— Pourquoi me désolez-vous en n’apprenant pas vos leçons ?
— Je ne peux pas, maman, je vous assure que je ne peux pas.
Et Arthur se prit à pleurer.
Mais madame Milligan ne se laissa pas ébranler par ses larmes, bien qu’elle parût touchée et même désolée, comme elle avait dit.
— J’aurais voulu vous laisser jouer ce matin avec Rémi et avec les chiens, continua-t-elle, mais vous ne jouerez que quand vous m’aurez répété votre fable sans faute.
Disant cela, elle donna le livre à Arthur et fit quelques pas, comme pour rentrer dans l’intérieur du bateau, laissant son fils couché sur sa planche.
Il pleurait à sanglots et de ma place j’entendais sa voix entrecoupée.
Comment madame Milligan pouvait-elle être sévère avec ce pauvre petit, qu’elle paraissait aimer si tendrement ? s’il ne pouvait pas apprendre sa leçon, ce n’était pas sa faute, c’était celle de la maladie sans doute.
Elle allait donc disparaître sans lui dire une bonne parole.
Mais elle ne disparut pas ; au lieu d’entrer dans le bateau, elle revint vers son fils.
— Voulez-vous que nous essayions de l’apprendre ensemble ? dit-elle.
— Oh ! oui, maman, ensemble.
Alors elle s’assit près de lui, et reprenant le livre, elle commença à lire doucement la fable, qui s’appelait : Le Loup et le jeune Mouton ; après elle, Arthur répétait les mots et les phrases.
Lorsqu’elle eut lu cette fable trois fois, elle donna le livre à Arthur, en lui disant d’apprendre maintenant tout seul, et elle rentra dans le bateau.
Aussitôt Arthur se mit à lire sa fable, et de ma place où j’étais resté, je le vis remuer les lèvres.
Il était évident qu’il travaillait et qu’il s’appliquait.
Mais cette application ne dura pas longtemps ; bientôt il leva les yeux de dessus son livre, et ses lèvres remuèrent moins vite, puis tout à coup elles s’arrêtèrent complètement.
Il ne lisait plus, et ne répétait plus.
Ses yeux, qui erraient çà et là, rencontrèrent les miens.
De la main je lui fis un signe pour l’engager à revenir à sa leçon.
Il me sourit doucement comme pour me dire qu’il me remerciait de mon avertissement, et ses yeux se fixèrent de nouveau sur son livre.
Mais bientôt ils se relevèrent et allèrent d’une rive à l’autre du canal.
Comme ils ne regardaient pas de mon côté, je me levai et ayant ainsi provoqué son attention, je lui montrai son livre.
Il le reprit d’un air confus.
Malheureusement, deux minutes après, un martin-pêcheur, rapide comme une flèche, traversa le canal à l’avant du bateau, laissant derrière lui un rayon bleu.
Arthur souleva la tête pour le suivre.
Puis quand la vision fut évanouie, il me regarda.
Alors m’adressant la parole :
— Je ne peux pas, dit-il, et cependant je voudrais bien.
Je m’approchai.
— Cette fable n’est pourtant pas bien difficile, lui dis-je.
— Oh ! si, bien difficile, au contraire.
— Elle m’a paru très-facile ; et en écoutant votre maman la lire, il me semble que je l’ai retenue.
Il se mit à sourire d’un air de doute.
— Voulez-vous que je vous la dise ?
— Pourquoi, puisque c’est impossible.
— Mais non, ce n’est pas impossible ; voulez-vous que j’essaye ? prenez le livre.
Il reprit le livre et je commençai à réciter ; il n’eut à me reprendre que trois ou quatre fois.
— Comment, vous la savez ! s’écria-t-il.
— Pas très-bien, mais maintenant je crois que je la dirais sans faute.
— Comment avez-vous fait pour l’apprendre ?
— J’ai écouté votre maman la lire, mais je l’ai écoutée avec attention sans regarder ce qui se passait autour de nous.
Il rougit et détourna les yeux ; puis après un court moment de honte :
— Je comprends comment vous avez écouté, dit-il, et je tâcherai d’écouter comme vous ; mais comment avez-vous fait pour retenir tous ces mots qui se brouillent dans ma mémoire ?
Comment j’avais fait ? Je ne savais trop, car je n’avais pas réfléchi à cela ; cependant je tâchai de lui expliquer ce qu’il me demandait en m’en rendant compte moi-même.
— De quoi s’agit-il dans cette fable ? dis-je. D’un mouton. Je commence donc à penser à des moutons. Ensuite je pense à ce qu’ils font : « Des moutons étaient en sûreté dans leur parc. » Je vois les moutons couchés et dormant dans leur parc puisqu’ils sont en sûreté, et les ayant vus je ne les oublie plus.
— Bon, dit-il, je les vois aussi : « Des moutons étaient en sûreté dans leur parc. » J’en vois des blancs et des noirs ; je vois des brebis et des agneaux. Je vois même le parc : il est fait de claies.
— Alors vous ne l’oublierez plus ?
— Oh ! non.
— Ordinairement qui est-ce qui garde les moutons ?
— Des chiens.
— Quand ils n’ont pas besoin de garder les moutons, parce que ceux-ci sont en sûreté, que font les chiens ?
— Ils n’ont rien à faire.
— Alors ils peuvent dormir ; nous disons donc : « les chiens dormaient. »
— C’est cela, c’est bien facile.
— N’est-ce pas que c’est très-facile ? Maintenant, pensons à autre chose. Avec les chiens, qu’est-ce qui garde les moutons ?
— Un berger.
— Si les moutons sont en sûreté, le berger n’a rien à faire, à quoi peut-il employer son temps.
— À jouer de la flûte.
— Le voyez-vous ?
— Oui.
— Où est-il ?
— À l’ombre d’un grand ormeau.
— Il est seul ?
— Non, il est avec d’autres bergers voisins.
— Alors, si vous voyez les moutons, le parc, les chiens et le berger, est-ce que vous ne pouvez pas répéter sans faute le commencement de votre fable ?
— Il me semble.
— Essayez.
En m’entendant parler ainsi et lui expliquer comment il pouvait être facile d’apprendre une leçon qui tout d’abord paraissait difficile, Arthur me regarda avec émotion et avec crainte, comme s’il n’était pas convaincu de la vérité de ce que je lui disais ; cependant, après quelques secondes d’hésitation, il se décida.
— « Des moutons étaient en sûreté dans leur parc, les chiens dormaient, et le berger, à l’ombre d’un grand ormeau, jouait de la flûte avec d’autres bergers voisins. »
Alors frappant ses mains l’une contre l’autre :
— Mais je sais, s’écria-t-il, je n’ai pas fait de faute.
— Voulez-vous apprendre le reste de la fable de la même manière ?
— Oui, avec vous je suis sûr que je vais l’apprendre. Ah ! comme maman sera contente !
Et il se mit à apprendre le reste de la fable, comme il avait appris sa première phrase.
En moins d’un quart d’heure il la sut parfaitement et il était en train de la répéter sans faute lorsque sa mère survint derrière nous.
Tout d’abord elle se fâcha de nous voir réunis, car elle crut que nous n’étions ensemble que pour jouer, mais Arthur ne lui laissa pas dire deux paroles :
— Je la sais, s’écria-t-il, et c’est lui qui me l’a apprise.
Madame Milligan me regardait toute surprise, et elle allait sûrement m’interroger, quand Arthur se mit, sans qu’elle le lui demandât, à répéter le Loup et le jeune Mouton. Il le fit d’un air de triomphe et de joie, sans hésitation et sans faute.
Pendant ce temps, je regardais madame Milligan ; je vis son beau visage s’éclairer d’un sourire, puis il me sembla que ses yeux se mouillèrent ; mais comme à ce moment elle se pencha sur son fils pour l’embrasser tendrement en l’entourant de ses deux bras, je ne sais pas si elle pleurait.
— Les mots, disait Arthur, c’est bête, ça ne signifie rien, mais les choses on les voit, et Rémi m’a fait voir le berger avec sa flûte ; quand je levais les yeux en apprenant je ne pensais plus à ce qui m’entourait, je voyais la flûte du berger et j’entendais l’air qu’il jouait. Voulez-vous que je vous chante l’air, maman ?
Et il chanta en anglais une chanson mélancolique.
Cette fois madame Milligan pleurait pour tout de bon, et quand elle se releva, je vis ses larmes sur les joues de son enfant. Alors elle s’approcha de moi et, me prenant la main, elle me la serra si doucement que je me sentis tout ému :
— Vous êtes un bon garçon, me dit-elle.
Si j’ai raconté tout au long ce petit incident, c’est pour faire comprendre le changement qui, à partir de ce jour-là, se fit dans ma position : la veille on m’avait pris comme montreur de bêtes pour amuser, moi, mes chiens et mon singe, un enfant malade ; mais cette leçon me sépara des chiens et du singe, je devins un camarade, presque un ami.
Il faut dire aussi, tout de suite, ce que je ne sus que plus tard, c’est que madame Milligan était désolée de voir que son fils n’apprenait, ou plus justement ne pouvait rien apprendre. Bien qu’il fût malade elle voulait qu’il travaillât, et précisément parce que cette maladie devait être longue, elle voulait dès maintenant donner à son esprit, des habitudes qui lui permissent de réparer le temps perdu, le jour où la guérison serait venue.
Jusque-là, elle avait fort mal réussi : si Arthur n’était point rétif au travail, il l’était absolument à l’attention et à l’application ; il prenait sans résistance le livre qu’on lui mettait aux mains, il ouvrait même assez volontiers ses mains pour le recevoir, mais son esprit il ne l’ouvrait pas, et c’était mécaniquement, comme une machine, qu’il répétait tant bien que mal, et plutôt mal que bien, les mots qu’on lui faisait entrer de force dans la tête.
De là un vif chagrin chez sa mère, qui désespérait de lui.
De là aussi une vive satisfaction lorsqu’elle lui entendit répéter une fable apprise avec moi en une demi-heure, qu’elle-même n’avait pas pu, en plusieurs jours, lui mettre dans la mémoire.
Quand je pense maintenant aux jours passés sur ce bateau, auprès de madame Milligan et d’Arthur, je trouve que ce sont les meilleurs de mon enfance.
Arthur s’était pris pour moi d’une ardente amitié, et de mon côté je me laissais aller sans réfléchir et sous l’influence de la sympathie à le regarder comme un frère : pas une querelle entre nous ; chez lui pas la moindre marque de la supériorité que lui donnait sa position, et chez moi pas le plus léger embarras ; je n’avais même pas conscience que je pouvais être embarrassé.
Cela tenait sans doute à mon âge et à mon ignorance des choses de la vie ; mais assurément cela tenait beaucoup encore à la délicatesse et à la bonté de madame Milligan, qui bien souvent me parlait comme si j’avais été son enfant.
Et puis ce voyage en bateau était pour moi un émerveillement ; pas une heure d’ennui ou de fatigue ; du matin au soir, toutes nos heures remplies.
Depuis la construction des chemins de fer, on ne visite plus, on ne connaît même plus le canal du Midi, et cependant c’est une des curiosités de la France.
De Villefranche de Lauraguais nous avions été à Avignonnet, et d’Avignonnet aux pierres de Naurouse où s’élève le monument érigé à la gloire de Riquet, le constructeur du canal, à l’endroit même où se trouve la ligne de faîte entre les rivières qui vont se jeter dans l’Océan et celles qui descendent à la Méditerranée.
Puis nous avions traversé Castelnaudary, la ville des moulins, Carcassonne, la cité du moyen âge, et par l’écluse de Fouserannes, si curieuse avec ses huit sas accolés, nous étions descendus à Béziers.
Quand le pays était intéressant, nous ne faisions que quelques lieues dans la journée ; quand au contraire il était monotone, nous allions plus vite.
C’était la route elle-même qui décidait notre marche et notre départ. Aucune des préoccupations ordinaires aux voyageurs ne nous gênait ; nous n’avions pas à faire de longues étapes pour gagner une auberge où nous serions certains de trouver à dîner et à coucher.
À heure fixe, nos repas étaient servis sous la verandah ; et tout en mangeant nous suivions tranquillement le spectacle mouvant des deux rives.
Quand le soleil s’abaissait, nous nous arrêtions où l’ombre nous surprenait ; et nous restions là jusqu’à ce que la lumière reparût.
Toujours chez nous, dans notre maison, nous ne connaissions point les heures désœuvrées du soir, si longues et si tristes bien souvent pour le voyageur.
Ces heures du soir, tout au contraire, étaient pour nous souvent trop courtes, et le moment du coucher nous surprenait presque toujours alors que nous ne pensions guère à dormir.
Le bateau arrêté, s’il faisait frais, on s’enfermait dans le salon, et, après avoir allumé un feu doux, pour chasser l’humidité ou le brouillard, qui étaient mauvais pour le malade, on apportait les lampes ; on installait Arthur devant la table ; je m’asseyais près de lui, et madame Milligan nous montrait des livres d’images ou des vues photographiques. De même que le bateau qui nous portait avait été construit pour cette navigation spéciale, de même les livres et les vues avaient été choisis pour ce voyage. Quand nos yeux commençaient à se fatiguer, elle ouvrait un de ces livres et nous lisait les passages qui devaient nous intéresser et que nous pouvions comprendre ; ou bien fermant livres et albums, elle nous racontait les légendes, les faits historiques se rapportant aux pays que nous venions de traverser. Elle parlait les yeux attachés sur ceux de son fils, et c’était chose touchante de voir la peine qu’elle se donnait pour n’exprimer que des idées, pour n’employer que des mots qui pussent être facilement compris.
Pour moi, quand les soirées étaient belles, j’avais aussi un rôle actif ; alors je prenais ma harpe, et descendant à terre, j’allais à une certaine distance me placer derrière un arbre qui me cachait dans son ombre, et là je chantais toutes les chansons, je jouais tous les airs que je savais ; pour Arthur c’était un grand plaisir que d’entendre ainsi de la musique dans le calme de la nuit, sans voir celui qui la faisait ; souvent il me criait : « encore ! » et je recommençais l’air que je venais de jouer.
C’était là une vie douce et heureuse pour un enfant qui comme moi n’avait quitté la chaumière de mère Barberin que pour suivre sur les grandes routes le signor Vitalis.
Quelle différence entre le plat de pommes de terre au sel de ma pauvre nourrice et les bonnes tartes aux fruits, les gelées, les crèmes, les pâtisseries de la cuisinière de madame Milligan !
Quel contraste entre les longues marches à pied, dans la boue, sous la pluie, par un soleil de feu, derrière mon maître, et cette promenade en bateau !
Mais, pour être juste envers moi-même, je dois dire que j’étais encore plus sensible au bonheur moral que je trouvais dans cette vie nouvelle, qu’aux jouissances matérielles qu’elle me donnait.
Oui, elles étaient bien bonnes les pâtisseries de madame Milligan ; oui, il était agréable de ne plus souffrir de la faim, du chaud ou du froid ; mais combien plus que tout cela étaient bons et agréables pour mon cœur les sentiments qui l’emplissaient.
Deux fois j’avais vu se briser ou se dénouer les liens qui m’attachaient à ceux que j’aimais : la première, lorsque j’avais été arraché d’auprès de mère Barberin ; la seconde, lorsque j’avais été séparé de Vitalis ; et ainsi deux fois je m’étais trouvé seul au monde, sans appui, sans soutien, n’ayant d’autres amis que mes bêtes.
Et voilà que dans mon isolement et dans ma détresse j’avais trouvé quelqu’un qui m’avait témoigné de la tendresse, et que j’avais pu aimer : une femme, une belle dame, douce, affable et tendre, un enfant de mon âge qui me traitait comme si j’avais été son frère.
Quelle joie, quel bonheur pour un cœur qui, comme le mien, avait tant besoin d’aimer !
Combien de fois en regardant Arthur couché sur sa planche, pâle et dolent, je me prenais à envier son bonheur, moi, plein de santé et de force !
Ce n’était pas le bien-être qui l’entourait que j’enviais, ce n’étaient pas ses livres, ses jouets luxueux, ce n’était pas son bateau, c’était l’amour que sa mère lui témoignait.
Comme il devait être heureux d’être ainsi aimé, d’être ainsi embrassé dix fois, vingt fois par jour, et de pouvoir lui-même embrasser de tout son cœur cette belle dame, sa mère, dont j’osais à peine toucher la main lorsqu’elle me la tendait.
Et alors je me disais tristement que moi je n’aurais jamais une mère qui m’embrasserait et que j’embrasserais : peut-être un jour je reverrais mère Barberin, et ce me serait une grande joie, mais enfin je ne pourrais plus maintenant lui dire comme autrefois : « maman, » puisqu’elle n’était pas ma mère.
Seul, je serais toujours seul !
Aussi cette pensée me faisait-elle goûter avec plus d’intensité la joie que j’éprouvais à me sentir traiter tendrement par madame Milligan et Arthur.
Je ne devais pas me montrer trop exigeant pour ma part de bonheur en ce monde, et puisque je n’aurais jamais ni mère, ni frère, ni famille, je devais me trouver heureux d’avoir des amis.
Je devais être heureux et en réalité je l’étais pleinement.
Cependant si douces que me parussent ces nouvelles habitudes, il me fallut bientôt les interrompre pour revenir aux anciennes.
XIII
ENFANT TROUVÉ
Le temps avait passé vite pendant ce voyage, et le moment approchait où mon maître allait sortir de prison.
À mesure que nous nous éloignions de Toulouse, cette pensée m’avait de plus en plus vivement tourmenté.
C’était charmant de s’en aller ainsi en bateau, sans peine comme sans souci ; mais il faudrait revenir et faire à pied la route parcourue sur l’eau.
Ce serait moins charmant : plus de bon lit, plus de crèmes, plus de pâtisseries, plus de soirées autour de la table.
Et ce qui me touchait encore bien plus vivement, il faudrait me séparer d’Arthur et de madame Milligan ; il faudrait renoncer à leur affection, les perdre comme déjà j’avais perdu mère Barberin. N’aimerais-je donc, ne serais-je donc aimé que pour être séparé brutalement de ceux près de qui je voudrais passer ma vie !
Je puis dire que cette préoccupation a été le seul nuage de ces journées radieuses.
Un jour enfin, je me décidai à en faire part à madame Milligan, en lui demandant combien elle croyait qu’il me faudrait de temps pour retourner à Toulouse, car je voulais me trouver devant la porte de la prison, juste au moment où mon maître la franchirait.
En entendant parler de départ, Arthur poussa les hauts cris :
— Je ne veux pas que Rémi parte ! s’écria-t-il.
Je répondis que je n’étais pas libre de ma personne, que j’appartenais à mon maître, à qui mes parents m’avaient loué, et que je devais reprendre mon service auprès de lui le jour où il aurait besoin de moi.
Je parlai de mes parents sans dire qu’ils n’étaient pas réellement mes père et mère, car il aurait fallu avouer en même temps que je n’étais qu’un enfant trouvé ; et c’était là une honte à laquelle je ne pouvais pas me résigner tant j’avais souffert, depuis que je me rendais compte de mes sensations, du mépris que j’avais vu, dans notre village, marquer en toutes occasions aux enfants des hospices : enfant trouvé ! il me semblait que c’était tout ce qu’il y avait de plus abject au monde. Mon maître savait que j’étais un enfant trouvé, mais il était mon maître, tandis que je serais mort bouche close plutôt que d’avouer à madame Milligan et à Arthur, qui m’avaient élevé jusqu’à eux, que j’étais un enfant trouvé ; est-ce qu’ils ne m’auraient pas alors rejeté et repoussé avec dégoût !
— Maman, il faut retenir Rémi, continua Arthur qui en dehors du travail, était le maître de sa mère, et faisait d’elle tout ce qu’il voulait.
— Je serais très-heureuse de garder Rémi, répondit madame Milligan, vous l’avez pris en amitié, et moi-même j’ai pour lui beaucoup d’affection ; mais pour le retenir près de nous, il faut la réunion de deux conditions que ni vous ni moi ne pouvons décider. La première c’est que Rémi veuille rester avec nous…
— Ah ! Rémi voudra bien, interrompit Arthur, n’est-ce pas, Rémi, que vous ne voulez pas retourner à Toulouse ?
— La seconde, continua madame Milligan sans attendre ma réponse, c’est que son maître consente à renoncer aux droits qu’il a sur lui.
— Rémi, Rémi d’abord, interrompit Arthur poursuivant son idée.
Assurément Vitalis avait été un bon maître pour moi, et je lui étais reconnaissant de ses soins aussi bien que de ses leçons, mais il n’y avait aucune comparaison à établir entre l’existence que j’avais menée près de lui et celle que m’offrait madame Milligan ; et même il n’y avait aucune comparaison à établir entre l’affection que j’éprouvais pour Vitalis et celle que m’inspiraient madame Milligan et Arthur. Quand je pensais à cela, je me disais que c’était mal à moi de préférer à mon maître ces étrangers que je connaissais depuis si peu de temps ; mais enfin, cela était ainsi ; j’aimais tendrement madame Milligan et Arthur.
— Avant de répondre, continua madame Milligan, Rémi doit réfléchir que ce n’est pas seulement une vie de plaisir et de promenade que je lui propose, mais encore une vie de travail ; il faudra étudier, prendre de la peine, rester penché sur les livres, suivre Arthur dans ses études ; il faut mettre cela en balance avec la liberté des grands chemins.
— Il n’y a pas de balance, dis-je, et je vous assure, madame, que je sens tout le prix de votre proposition.
— Là, voyez-vous, maman ! s’écria Arthur, Rémi veut bien.
Et il se mit à applaudir. Il était évident que je venais de le tirer d’inquiétude, car lorsque sa mère avait parlé de travail et de livres j’avais vu son visage exprimer l’anxiété. Si j’allais refuser ! et cette crainte pour lui qui avait l’horreur des livres, avait dû être des plus vives. Mais je n’avais pas heureusement cette même crainte, et les livres, au lieu de m’épouvanter, m’attiraient. Il est vrai qu’il y avait bien peu de temps qu’on m’en avait mis entre les mains, et ceux qui y avaient passé m’avaient donné plus de plaisir que de peine. Aussi l’offre de madame Milligan me rendait-elle très-heureux, et étais-je parfaitement sincère en la remerciant de sa générosité. Je n’allais donc pas abandonner le Cygne ; je n’allais pas renoncer à cette douce existence, je n’allais pas me séparer d’Arthur et de sa mère.
— Maintenant, poursuivit madame Milligan, il nous reste à obtenir le consentement de son maître ; pour cela je vais lui écrire de venir nous trouver à Cette, car nous ne pouvons pas retourner à Toulouse : je lui enverrai ses frais de voyage et après lui avoir fait comprendre les raisons qui nous empêchent de prendre le chemin de fer j’espère qu’il voudra bien se rendre à mon invitation. S’il accepte mes propositions, il ne me restera plus qu’à m’entendre avec les parents de Rémi ; car eux aussi doivent être consultés.
Jusque-là tout dans cet entretien avait marché à souhait pour moi, exactement comme si une bonne fée m’avait touché de sa baguette ; mais ces derniers mots me ramenèrent durement du rêve où je planais dans la triste réalité.
Consulter mes parents !
Mais sûrement ils diraient ce que je voulais qui restât caché. La vérité éclaterait. Enfant trouvé !
Alors ce serait Arthur, ce serait madame Milligan qui ne voudraient pas de moi ; alors l’amitié qu’ils me témoignaient serait anéantie ; mon souvenir même leur serait pénible ; Arthur aurait joué avec un enfant trouvé, en aurait fait son camarade, son ami, presque son frère.
Je restai atterré.
Madame Milligan me regarda avec surprise et voulut me faire parler, mais je n’osai pas répondre à ses questions ; alors croyant sans doute que c’était la pensée de la prochaine arrivée de mon maître qui me troublait ainsi, elle n’insista pas.
Heureusement cela se passait le soir, peu de temps avant l’heure du coucher ; je pus échapper bientôt aux regards curieux d’Arthur et aller m’enfermer dans ma cabine avec mes craintes et mes réflexions.
Ce fut ma première mauvaise nuit à bord du Cygne, mais elle fut terriblement mauvaise, longue et fiévreuse.
Que faire ? Que dire ?
Je ne trouvais rien.
Et après avoir tourné et retourné cent fois les mêmes idées, après avoir adopté les résolutions les plus contradictoires, je m’arrêtai enfin à ne rien faire et à ne rien dire. Je laisserais aller les choses et je me résignerais, si je ne pouvais mieux, à ce qui arriverait.
Peut-être Vitalis ne voudrait-il pas renoncer à moi, et alors il n’y aurait pas à faire connaître la vérité.
Et tel était mon effroi de cette vérité, que je croyais si horrible, que j’en vins à souhaiter que Vitalis n’acceptât pas la proposition de madame Milligan.
Sans doute, il faudrait m’éloigner d’Arthur et de sa mère, renoncer à les revoir jamais peut-être ; mais au moins, ils ne garderaient pas de moi un mauvais souvenir.
Trois jours après avoir écrit à mon maître, madame Milligan reçut une réponse. En quelques lignes Vitalis disait qu’il aurait l’honneur de se rendre à l’invitation de madame Milligan et qu’il arriverait à Cette le samedi suivant par le train de deux heures.
Je demandai à madame Milligan la permission d’aller à la gare, et prenant les chiens ainsi que Joli-Cœur avec moi, nous attendîmes l’arrivée de notre maître.
Les chiens étaient inquiets comme s’ils se doutaient de quelque chose, Joli-Cœur était indifférent, et pour moi j’étais terriblement ému. C’était ma vie qui allait se décider. Ah ! si j’avais osé, comme j’aurais prié Vitalis de ne pas dire que j’étais un enfant trouvé !
Mais je n’osais pas, et je sentais que ces deux mots : « enfant trouvé, » ne pourraient jamais sortir de ma gorge.
Je m’étais placé dans un coin de la cour de la gare, tenant mes trois chiens en laisse, et Joli-Cœur sous ma veste, et j’attendais sans trop voir ce qui se passait autour de moi.
Ce furent les chiens qui m’avertirent que le train était arrivé, et qu’ils avaient flairé notre maître. Tout à coup je me sentis entraîné en avant, et comme je n’étais pas sur mes gardes, les chiens m’échappèrent. Ils couraient en aboyant joyeusement, et presque aussitôt je les vis sauter autour de Vitalis qui dans son costume habituel, venait d’apparaître. Plus prompt, bien que moins souple que ses camarades, Capi s’était élancé dans les bras de son maître, tandis que Zerbino et Dolce se cramponnaient à ses jambes.
Je m’avançai à mon tour, et Vitalis posant Capi à terre, me serra dans ses bras : pour la première fois, il m’embrassa en me répétant à plusieurs reprises :
— Buon di, povero caro !
Mon maître n’avait jamais été dur pour moi, mais n’avait jamais non plus été caressant, et je n’étais pas habitué à ces témoignages d’effusion ; cela m’attendrit, et me fit venir les larmes aux yeux, car j’étais dans des dispositions où le cœur se serre vite.
Je le regardai, et je trouvai qu’il avait bien vieilli en prison ; sa taille s’était voûtée ; son visage avait pâli, ses lèvres s’étaient décolorées.
— Eh bien ! tu me trouves changé, n’est-ce pas, mon garçon ? me dit-il ; la prison est un mauvais séjour, et l’ennui une mauvaise maladie ; mais cela va aller mieux maintenant.
Puis changeant de sujet :
— Et cette dame qui m’a écrit, dit-il, comment l’as-tu connue ?
Alors, je lui racontai comment j’avais rencontré le Cygne, et comment depuis ce moment j’avais vécu auprès de madame Milligan et de son fils ; ce que nous avions vu, ce que nous avions fait.
Mon récit fut d’autant plus long que j’avais peur d’arriver à la fin et d’aborder un sujet qui m’épouvantait ; car jamais maintenant je ne pourrais dire à mon maître que je désirais le quitter pour rester avec madame Milligan et Arthur.
Mais je n’eus pas cet aveu à lui faire, car nous arrivâmes à l’hôtel où madame Milligan s’était logée avant que mon récit fût terminé. D’ailleurs Vitalis ne me dit rien de la lettre de madame Milligan et ne me parla pas des propositions qu’elle avait dû lui adresser dans cette lettre.
— Et cette dame m’attend ? dit-il, quand nous entrâmes à l’hôtel.
— Oui, je vais vous conduire à son appartement.
— C’est inutile, donne-moi le numéro et reste ici à m’attendre, avec les chiens et Joli-Cœur.
Quand mon maître avait parlé, je n’avais pas l’habitude de répliquer ou de discuter ; je voulus cependant risquer une observation, pour lui demander de l’accompagner auprès de madame Milligan, ce qui me semblait aussi naturel que juste ; mais d’un geste il me ferma la bouche et je lui obéis, restant à la porte de l’hôtel, sur un banc, avec les chiens autour de moi. Eux aussi avaient voulu le suivre, mais ils n’avaient pas plus résisté à son ordre de ne pas entrer, que je n’y avais résisté moi-même ; Vitalis savait commander.
Pourquoi n’avait-il pas voulu que j’assistasse à son entretien avec madame Milligan ? Ce fut ce que je me demandai, tournant cette question dans tous les sens. Je ne lui avais pas encore trouvé de réponse lorsque je le vis revenir.
— Va faire tes adieux à cette dame, me dit-il, je t’attends ici ; nous partons dans dix minutes.
Je fus renversé.
— Eh bien ! dit-il après quelques minutes d’attente, tu ne m’as donc pas compris ? tu restes là stupide : dépêchons !
Ce n’était pas son habitude de me parler durement, et depuis que j’étais avec lui, il ne m’en avait jamais autant dit.
Je me levai pour obéir machinalement sans comprendre.
Mais après avoir fait quelques pas pour monter à l’appartement de madame Milligan :
— Vous avez donc dit… demandai-je.
— J’ai dit que tu m’étais utile et que je t’étais moi-même utile ; par conséquent, que je n’étais pas disposé à céder les droits que j’avais sur toi ; marche et reviens.
Cela me rendit un peu de courage, car j’étais si complètement sous l’influence de mon idée fixe d’enfant trouvé, que j’imaginais que, s’il fallait partir avant dix minutes, c’était parce que mon maître avait dit ce qu’il savait de ma naissance.
En entrant dans l’appartement de madame Milligan, je trouvai Arthur en larmes et sa mère penchée sur lui pour le consoler.
— N’est-ce pas, Rémi, que vous n’allez pas partir ? s’écria Arthur.
Ce fut madame Milligan qui répondit pour moi, en expliquant que je devais obéir.
— J’ai demandé à votre maître de vous garder près de nous, me dit-elle d’une voix qui me fit monter les larmes aux yeux, mais il ne veut pas y consentir, et rien n’a pu le décider.
— C’est un méchant homme ! s’écria Arthur.
— Non, ce n’est point un méchant homme, poursuivit madame Milligan, vous lui êtes utile, et de plus je crois qu’il a pour vous une véritable affection. D’ailleurs, ses paroles sont celles d’un honnête homme et de quelqu’un au-dessus de sa condition. Voilà ce qu’il m’a répondu pour expliquer son refus : « J’aime cet enfant, il m’aime ; le rude apprentissage de la vie que je lui fais faire près de moi lui sera plus utile que l’état de domesticité déguisée dans lequel vous le feriez vivre malgré vous. Vous lui donneriez de l’instruction, de l’éducation, c’est vrai ; vous formeriez son esprit, c’est vrai, mais non son caractère. Il ne peut pas être votre fils ; il sera le mien ; cela vaudra mieux que d’être le jouet de votre enfant malade, si doux, si aimable que paraisse être cet enfant. Moi aussi je l’instruirai. »
— Puisqu’il n’est pas le père de Rémi ! s’écria Arthur.
— Il n’est pas son père, cela est vrai, mais il est son maître, et Rémi lui appartient, puisque ses parents le lui ont loué. Il faut que pour le moment Rémi lui obéisse.
— Je ne veux pas que Rémi parte.
— Il faut cependant qu’il suive son maître ; mais j’espère que ce ne sera pas pour longtemps. Nous écrirons à ses parents, et je m’entendrai avec eux.
— Oh ! non ! m’écriai-je.
— Comment, non ?
— Oh ! non, je vous en prie !
— Il n’y a cependant que ce moyen, mon enfant.
— Je vous en prie, n’est-ce pas ?
Il est à peu près certain que si madame Milligan n’avait pas parlé de mes parents, j’aurais donné à nos adieux beaucoup plus que les dix minutes qui m’avaient été accordées par mon maître.
— C’est à Chavanon, n’est-ce pas ? continua madame Milligan.
Sans lui répondre, je m’approchai d’Arthur et le prenant dans mes bras, je l’embrassai à plusieurs reprises, mettant dans ces baisers toute l’amitié fraternelle que je ressentais pour lui. Puis m’arrachant à sa faible étreinte et revenant à madame Milligan, je me mis à genoux devant elle, et lui baisai la main.
— Pauvre enfant ! dit-elle en se penchant sur moi.
Et elle m’embrassa au front.
Alors je me relevai vivement et courant à la porte :
— Arthur, je vous aimerai toujours ! dis-je d’une voix entrecoupée par les sanglots, et vous, madame, je ne vous oublierai jamais !
— Rémi, Rémi ! cria Arthur.
Mais je n’en entendis pas davantage ; j’étais sorti et j’avais refermé la porte.
Une minute après, j’étais auprès de mon maître.
— En route ! me dit-il.
Et nous sortîmes de Cette par la route de Frontignan.
Ce fut ainsi que je quittai mon premier ami et me lançai dans des aventures qui m’auraient été épargnées, si victime d’un odieux préjugé, je ne m’étais pas laissé affoler par une sotte crainte.
XIV
NEIGE ET LOUPS
Il fallut de nouveau emboîter le pas derrière mon maître et, la bretelle de ma harpe tendue sur mon épaule endolorie, cheminer le long des grandes routes, par la pluie comme par le soleil, par la poussière comme par la boue.
Il fallut faire la bête sur les places publiques et rire ou pleurer pour amuser l’honorable société.
La transition fut rude, car on s’habitue vite au bien-être et au bonheur.
J’eus des dégoûts, des ennuis et des fatigues que je ne connaissais pas avant d’avoir vécu pendant deux mois de la douce vie des heureux de ce monde.
Plus d’une fois, dans nos longues marches, je restai en arrière pour penser librement à Arthur, à madame Milligan, au Cygne, et par le souvenir, retourner et vivre dans le passé.
Ah ! le bon temps ! Et quand le soir, couché dans une sale auberge de village, je pensais à ma cabine du Cygne, combien les draps de mon lit me paraissaient rugueux !
Je ne jouerais donc plus avec Arthur, je n’entendrais donc plus la voix caressante de madame Milligan !
Heureusement, dans mon chagrin, qui était très-vif et persistant, j’avais une consolation : mon maître était beaucoup plus doux, — beaucoup plus tendre même, — si ce mot peut être juste appliqué à Vitalis, — qu’il ne l’avait jamais été !
De ce côté il s’était fait un grand changement dans son caractère ou tout au moins dans ses manières d’être avec moi, et cela me soutenait, cela m’empêchait de pleurer quand le souvenir d’Arthur me serrait le cœur ! Je sentais que je n’étais pas seul au monde et que dans mon maître, il y avait plus qu’un maître.
Souvent même, si j’avais osé, je l’aurais embrassé, tant j’avais besoin d’épancher au dehors les sentiments d’affection qui étaient en moi ; mais je n’osais pas, car Vitalis n’était pas un homme avec lequel on risquait des familiarités.
Tout d’abord, et pendant les premiers temps, ç’avait été la crainte qui m’avait tenu à distance ; maintenant c’était quelque chose de vague qui ressemblait à un sentiment de respect.
En sortant de mon village, Vitalis n’était pour moi qu’un homme comme les autres, car j’étais alors incapable de faire des distinctions ; mais mon séjour auprès de madame Milligan m’avait jusqu’à un certain point ouvert les yeux et l’intelligence ; et chose étrange, il me semblait, quand je regardais mon maître avec attention, que je retrouvais en lui, dans sa tenue, dans son air, dans ses manières, des points de ressemblance avec la tenue, l’air et les manières de madame Milligan.
Alors je me disais que cela était impossible, parce que mon maître n’était qu’un montreur de bêtes, tandis que madame Milligan était une dame.
Mais ce que me disait la réflexion n’imposait pas silence à ce que mes yeux me répétaient ; quand Vitalis le voulait, il était un monsieur tout comme madame Milligan était une dame ; la seule différence qu’il y eût entre eux tenait à ce que madame Milligan était toujours dame, tandis que mon maître n’était monsieur que dans certaines circonstances ; mais alors il l’était si complètement, qu’il en eût imposé aux plus hardis comme aux plus insolents.
Or, comme je n’étais ni hardi, ni insolent, je subissais cette influence et je n’osais pas m’abandonner à mes épanchements alors même qu’il les provoquait par quelques bonnes paroles.
Après être partis de Cette, nous étions restés plusieurs jours sans parler de madame Milligan et de mon séjour sur le Cygne, mais peu à peu ce sujet s’était présenté dans nos entretiens, mon maître l’abordant toujours le premier, et bientôt il ne s’était guère passé de jours sans que le nom de madame Milligan fût prononcé.
— Tu l’aimais bien, cette dame ? me disait Vitalis, oui ; je comprends cela ; elle a été bonne, très-bonne pour toi ; il ne faut penser à elle qu’avec reconnaissance.
Puis souvent il ajoutait :
— Il le fallait !
Qu’avait-il fallu ?
Tout d’abord je n’avais pas bien compris ; mais peu à peu j’en étais venu à me dire, que ce qu’il avait fallu, ç’avait été repousser la proposition de madame Milligan, de me garder près d’elle.
C’était à cela assurément que mon maître pensait quand il disait : « Il le fallait » ; et il me semblait que dans ces quelques mots, il y avait comme un regret ; il aurait voulu me laisser près d’Arthur, mais cela avait été impossible.
Et au fond du cœur, je lui savais gré de ce regret, bien que je ne devinasse point pourquoi il n’avait pas pu accepter les propositions de madame Milligan, les explications qui m’avaient été répétées par celle-ci ne me paraissant pas très-compréhensibles.
— Maintenant, peut-être les accepterait-il ?
Et c’était là pour moi un sujet de grande espérance.
— Pourquoi ne rencontrerions-nous pas le Cygne ?
Il devait remonter le Rhône, et nous, nous longions les rives de ce fleuve.
Aussi tout en marchant, mes yeux se tournaient plus souvent vers l’eau que vers les collines et les plaines fertiles qui la bordent de chaque côté.
Lorsque nous arrivions dans une ville, Arles, Tarascon, Avignon, Montélimar, Valence, Tournon, Vienne, ma première visite était pour les quais et pour les ponts : je cherchais le Cygne, et quand j’apercevais de loin un bateau à demi noyé dans les brumes confuses, j’attendais qu’il grandît pour voir si ce n’était pas le Cygne.
Mais ce n’était pas lui.
Quelquefois je m’enhardissais jusqu’à interroger les mariniers, et je leur décrivais le bateau que je cherchais : ils ne l’avaient pas vu passer.
Maintenant que mon maître était décidé à me céder à madame Milligan, au moins je me l’imaginais, il n’y avait plus à craindre qu’on parlât de ma naissance ou qu’on écrivît à mère Barberin ; l’affaire se traiterait entre mon maître et madame Milligan ; au moins dans mon rêve enfantin, j’arrangeais ainsi les choses : madame Milligan désirait me prendre près d’elle, mon maître consentait à renoncer à ses droits sur moi, tout était dit.
Nous restâmes plusieurs semaines à Lyon, et tout le temps que j’eus à moi je le passai sur les quais du Rhône et de la Saône ; je connais les ponts d’Ainay, de Tilsitt, de la Guillotière ou de l’Hôtel-Dieu, aussi bien qu’un Lyonnais de naissance.
Mais j’eus beau chercher : je ne trouvai pas le Cygne.
Il nous fallut quitter Lyon et nous diriger vers Dijon ; alors l’espérance de retrouver jamais madame Milligan et Arthur commença à m’abandonner ; car j’avais à Lyon étudié toutes les cartes de France que j’avais pu trouver aux étalages des bouquinistes, et je savais que le canal du Centre que devait prendre le Cygne pour gagner la Loire, se détache de la Saône à Chalon.
Nous arrivâmes à Chalon et nous en repartîmes sans avoir vu le Cygne : c’en était donc fait, il fallait renoncer à mon rêve.
Ce ne fut pas sans un très-vif chagrin.
Justement pour accroître mon désespoir, qui pourtant était déjà bien assez grand, le temps devint détestable ; la saison était avancée, l’hiver approchait, et les marches sous la pluie, dans la boue devenaient de plus en plus pénibles. Quand nous arrivions le soir dans une mauvaise auberge ou dans une grange, harassés par la fatigue, mouillés jusqu’à la chemise, crottés jusqu’aux cheveux, je ne me couchais point avec des idées riantes.
Lorsque, après avoir quitté Dijon, nous traversâmes les collines de la Côte-d’Or, nous fûmes pris par un froid humide qui nous glaçait jusqu’aux os, et Joli-Cœur devint plus triste et plus maussade que moi.
Le but de mon maître était de gagner Paris au plus vite, car à Paris seulement nous avions chance de pouvoir donner quelques représentations pendant l’hiver ; mais, soit que l’état de sa bourse ne lui permît pas de prendre le chemin de fer, soit toute autre raison, c’était à pied que nous devions faire la route qui sépare Dijon de Paris.
Quand le temps nous le permettait, nous donnions une courte représentation dans les villes et dans les villages que nous traversions, puis, après avoir ramassé une maigre recette, nous nous remettions en route.
Jusqu’à Châtillon, les choses allèrent à peu près, quoique nous eussions toujours à souffrir du froid et de l’humidité ; mais après avoir quitté cette ville, la pluie cessa et le vent tourna au nord.
Tout d’abord nous ne nous en plaignîmes pas, bien qu’il soit peu agréable d’avoir le vent du nord en pleine figure ; à tout prendre, mieux valait encore cette bise, si âpre qu’elle fût, que l’humidité dans laquelle nous pourrissions depuis plusieurs semaines.
Par malheur, le vent ne resta pas au sec ; le ciel s’emplit de gros nuages noirs, le soleil disparut entièrement, et tout annonça que nous aurions bientôt de la neige.
Nous pûmes cependant arriver à un gros village sans être pris par la neige, mais l’intention de mon maître était de gagner Troyes au plus vite, parce que Troyes est une grande ville dans laquelle nous pourrions donner plusieurs représentations, si le mauvais temps nous obligeait à y séjourner.
— Couche-toi vite, me dit-il, quand nous fûmes installés dans notre auberge ; nous partirons demain matin de bonne heure ; je crains d’être surpris par la neige.
Pour lui, il ne se coucha pas aussi tôt, mais il resta au coin de l’âtre de la cheminée de la cuisine pour réchauffer Joli-Cœur qui avait beaucoup souffert du froid de la journée et qui n’avait cessé de gémir, malgré que nous eussions pris soin de l’envelopper dans des couvertures.
Le lendemain matin je me levai de bonne heure comme il m’avait été commandé ; il ne faisait pas encore jour, le ciel était noir et bas, sans une étoile ; il semblait qu’un grand couvercle sombre s’était abaissé sur la terre et allait l’écraser. Quand on ouvrait la porte, un vent âpre s’engouffrait dans la cheminée et ravivait les tisons qui la veille au soir avaient été enfouis sous la cendre.
— À votre place, dit l’aubergiste, s’adressant à mon maître, je ne partirais pas ; la neige va tomber.
— Je suis pressé, répondit Vitalis, et j’espère arriver à Troyes avant la neige.
— Trente kilomètres ne se font pas en une heure.
Nous partîmes néanmoins.
Vitalis tenait Joli-Cœur serré sous sa veste pour lui communiquer un peu de sa propre chaleur, et les chiens joyeux de ce temps sec couraient devant nous ; mon maître m’avait acheté à Dijon une peau de mouton, dont la laine se portait en dedans, je m’enveloppai dedans et la bise qui nous soufflait au visage me la colla sur le corps.
Il n’était pas agréable d’ouvrir la bouche : nous marchâmes gardant l’un et l’autre le silence, hâtant le pas, autant pour nous presser que pour nous échauffer.
Bien que l’heure fût arrivée où le jour devait paraître, il ne se faisait pas d’éclaircies dans le ciel.
Enfin, du côté de l’Orient, une bande blanchâtre entr’ouvrit les ténèbres, mais le soleil ne se montra pas : il ne fit plus nuit, mais c’eût été une grosse exagération de dire qu’il faisait jour.
Cependant, dans la campagne, les objets étaient devenus plus distincts ; la livide clarté qui rasait la terre, jaillissant du levant comme d’un immense soupirail, nous montrait des arbres dépouillés de leurs feuilles, et çà et là des haies ou des broussailles auxquelles les feuilles desséchées adhéraient encore, faisant entendre, sous l’impulsion du vent qui les secouait et les tordait, un bruissement sec.
Personne sur la route, personne dans les champs, pas un bruit de voiture, pas un coup de fouet ; les seuls êtres vivants étaient les oiseaux qu’on entendait, mais qu’on ne voyait pas, car ils se tenaient abrités sous les feuilles ; seules des pies sautillaient sur la route, la queue relevée, le bec en l’air, s’envolant à notre approche pour se poser en haut d’un arbre, d’où elles nous poursuivaient de leurs jacassements qui ressemblaient à des injures ou à des avertissements de mauvais augure.
Tout à coup un point blanc se montra au ciel, dans le nord ; il grandit rapidement en venant sur nous, et nous entendîmes un étrange murmure de cris discordants ; c’étaient des oies ou des cygnes sauvages, qui du Nord émigraient dans le Midi ; ils passèrent au-dessus de nos têtes et ils étaient déjà loin qu’on voyait encore voltiger dans l’air quelques flocons de duvet, dont la blancheur se détachait sur le ciel noir.
Le pays que nous traversions était d’une tristesse lugubre qu’augmentait encore le silence ; aussi loin que les regards pouvaient s’étendre dans ce jour sombre, on ne voyait que des champs dénudés, des collines arides et des bois roussis.
Le vent soufflait toujours du nord avec une légère tendance cependant à tourner à l’ouest ; de ce côté de l’horizon arrivaient des nuages cuivrés, lourds et bas, qui paraissaient peser sur la cime des arbres.
Bientôt quelques flocons de neige, larges comme des papillons, nous passèrent devant les yeux ; ils montaient, descendaient, tourbillonnaient sans toucher la terre.
Nous n’avions pas encore fait beaucoup de chemin et il me paraissait impossible d’arriver à Troyes avant la neige ; au reste cela m’inquiétait peu et je me disais même que la neige en tombant arrêterait ce vent du nord et apaiserait le froid.
Mais je ne savais pas ce que c’était qu’une tempête de neige.
Je ne tardai pas à l’apprendre, et de façon à n’oublier jamais cette leçon.
Les nuages qui venaient du nord-ouest s’étaient approchés, et une sorte de lueur blanche éclairait le ciel de leur côté ; leurs flancs s’étaient entr’ouverts, c’était la neige.
Ce ne furent plus des papillons qui voltigèrent devant nous, ce fut une pluie de neige qui nous enveloppa.
— Il était écrit que nous n’arriverions pas à Troyes, dit Vitalis ; il faudra nous mettre à l’abri dans la première maison que nous rencontrerons.
C’était là une bonne parole qui ne pouvait m’être que très-agréable ; mais où trouverions-nous cette maison hospitalière ? Avant que la neige nous enveloppât dans sa blanche obscurité, j’avais examiné le pays aussi loin que ma vue pouvait s’étendre et je n’avais pas aperçu de maison, ni rien qui annonçât un village. Tout au contraire nous étions sur le point d’entrer dans une forêt dont les profondeurs sombres se confondaient dans l’infini, devant nous, aussi bien que de chaque côté sur les collines qui nous entouraient.
Il ne fallait donc pas trop compter sur cette maison promise ; mais après tout la neige ne continuerait peut-être pas.
Elle continua, et elle augmenta.
En peu d’instants elle avait couvert la route ou plus justement tout ce qui l’arrêtait sur la route : tas de pierres, herbes des bas côtés, broussailles et buissons des fossés, car poussée par le vent qui n’avait pas faibli, elle courait ras de terre pour s’entasser contre tout ce qui lui faisait obstacle.
L’ennui pour nous était d’être au nombre de ces obstacles ; lorsqu’elle nous frappait elle glissait sur les surfaces rondes, mais partout où se trouvait une fente elle entrait comme une poussière et ne tardait pas à fondre.
Pour moi, je la sentais me descendre en eau froide dans le cou, et mon maître, dont la peau de mouton était soulevée pour laisser respirer Joli-Cœur, ne devait pas être mieux protégé.
Cependant nous continuions de marcher contre le vent et contre la neige sans parler ; de temps en temps nous retournions à demi la tête pour respirer.
Les chiens n’allaient plus en avant, ils marchaient sur nos talons, nous demandant un abri que nous ne pouvions leur donner.
Nous avancions lentement, avec peine, aveuglés, mouillés, glacés, et bien que nous fussions depuis assez longtemps déjà en pleine forêt, nous ne nous trouvions nullement abrités, la route étant exposée en plein au vent.
Heureusement (est-ce bien heureusement qu’il faut dire), ce vent qui soufflait en tourmente s’affaiblit peu à peu, mais alors la neige augmenta, et au lieu de s’abattre en poussière, elle tomba large et compacte.
En quelques minutes la route fut couverte d’une épaisse couche de neige dans laquelle nous marchâmes sans bruit.
De temps en temps je voyais mon maître regarder sur la gauche comme s’il cherchait quelque chose, mais on n’apercevait qu’une vaste clairière dans laquelle on avait fait une coupe au printemps précédent, et dont les jeunes baliveaux aux tiges flexibles se courbaient sous le poids de la neige.
Qu’espérait-il trouver de ce côté ?
Pour moi je regardais droit devant moi, sur la route, aussi loin que mes yeux pouvaient porter, cherchant si cette forêt ne finirait pas bientôt et si nous n’apercevrions pas une maison.
Mais c’était folie de vouloir percer cette averse blanche ; à quelques mètres les objets se brouillaient et l’on ne voyait plus rien que la neige qui descendait en flocons de plus en plus serrés et nous enveloppait comme dans les mailles d’un immense filet.
La situation n’était pas gaie, car je n’ai jamais vu tomber la neige, alors même que j’étais derrière une vitre dans une chambre bien chauffée, sans éprouver un sentiment de vague tristesse, et présentement je me disais que la chambre chauffée devait être bien loin encore.
Cependant il fallait marcher et ne pas se décourager, parce que nos pieds enfonçaient de plus en plus dans la couche de neige qui nous montait aux jambes, et parce que le poids qui chargeait nos chapeaux devenait de plus en plus lourd.
Tout à coup, je vis Vitalis étendre la main dans la direction de la gauche, comme pour attirer mon attention. Je regardai, et il me sembla apercevoir confusément dans la clairière une hutte en branchages recouverte de neige.
Je ne demandai pas d’explication, comprenant que si mon maître m’avait montré cette hutte, ce n’était pas pour que j’admirasse l’effet qu’elle produisait dans le paysage ; il s’agissait de trouver le chemin qui conduisait à cette hutte.
C’était difficile, car la neige était déjà assez épaisse pour effacer toute trace de route ou de sentier ; cependant à l’extrémité de la clairière, à l’endroit où recommençaient les bois de haute futaie, il me sembla que le fossé de la grande route était comblé : là sans doute débouchait le chemin qui conduisait à la hutte.
C’était raisonner juste ; la neige ne céda pas sous nos pieds lorsque nous descendîmes dans le fossé, et nous ne tardâmes pas à arriver à cette hutte.
Elle était formée de fagots et de bourrées, au-dessus desquels avaient été disposés des branchages en forme de toit ; et ce toit était assez serré pour que la neige n’eût point passé à travers.
C’était un abri qui valait une maison.
Plus pressés ou plus vifs que nous, les chiens étaient entrés les premiers dans la hutte et ils se roulaient sur le sol sec et dans la poussière en poussant des aboiements joyeux.
Notre satisfaction n’était pas moins vive que la leur, mais nous la manifestâmes autrement qu’en nous roulant dans la poussière ; ce qui cependant n’eût pas été mauvais pour nous sécher.
— Je me doutais bien, dit Vitalis, que dans cette jeune vente devait se trouver quelque part une cabane de bûcheron ; maintenant la neige peut tomber.
— Oui, qu’elle tombe ! répondis-je d’un air de défi.
Et j’allai à la porte, ou plus justement à l’ouverture de la hutte, car elle n’avait ni porte ni fenêtre, pour secouer ma veste et mon chapeau, de manière à ne pas mouiller l’intérieur de notre appartement.
Il était tout à fait simple, cet appartement, aussi bien dans sa construction que dans son mobilier qui consistait en un banc de terre et en quelques grosses pierres servant de sièges. Mais ce qui, dans les circonstances où nous nous trouvions, était encore d’un plus grand prix pour nous, c’étaient cinq ou six briques posées de champ dans un coin et formant le foyer.
Du feu ! nous pouvions faire du feu.
Il est vrai qu’un foyer ne suffit pas pour faire du feu, il faut encore du bois à mettre dans le foyer.
Dans une maison comme la nôtre, le bois n’était pas difficile à trouver, il n’y avait qu’à le prendre aux murailles et au toit, c’est-à-dire à tirer des branches des fagots et des bourrées, en ayant pour tout soin de prendre ces branches çà et là, de manière à ne pas compromettre la solidité de notre maison.
Cela fut vite fait, et une flamme claire ne tarda pas à briller en pétillant joyeusement au-dessus de notre âtre.
Ah ! le beau feu ! le bon feu !
Il est vrai qu’il ne brûlait pas sans fumée, et que celle-ci, ne montant pas dans une cheminée, se répandait dans la hutte ; mais que nous importait ; c’était de la flamme, c’était de la chaleur que nous voulions.
Pendant que, couché sur les deux mains, je soufflais le feu, les chiens s’étaient assis autour du foyer, et gravement sur leur derrière, le cou tendu, ils présentaient leur ventre mouillé et glacé au rayonnement de la flamme.
Bientôt Joli-Cœur écarta la veste de son maître, et, mettant prudemment le bout du nez dehors, il regarda où il se trouvait ; rassuré par son examen, il sauta vivement à terre, et, prenant la meilleure place devant le feu, il présenta à la flamme ses deux petites mains tremblotantes.
Nous étions assurés maintenant de ne pas mourir de froid, mais la question de la faim n’était pas résolue.
Il n’y avait dans cette cabane hospitalière ni huche à pain ni fourneau avec des casseroles chantantes.
Heureusement, notre maître était homme de précaution et d’expérience : le matin, avant que je fusse levé, il avait fait ses provisions de route : une miche de pain et un petit morceau de fromage ; mais ce n’était pas le moment de se montrer exigeant ou difficile ; aussi, quand nous vîmes apparaître la miche, y eut-il chez nous tous un vif mouvement de satisfaction.
Malheureusement les parts ne furent pas grosses, et pour mon compte mon espérance fut désagréablement trompée ; au lieu de la miche entière, mon maître ne nous en donna que la moitié.
— Je ne connais pas la route, dit-il en répondant à l’interrogation de mon regard, et je ne sais pas si d’ici Troyes nous trouverons une auberge où manger. De plus, je ne connais pas non plus cette forêt. Je sais seulement que ce pays est très-boisé, et que d’immenses forêts se joignent les unes aux autres : les forêts de Chaource, de Rumilly, d’Othe, d’Aumont. Peut-être sommes-nous à plusieurs lieues d’une habitation ? Peut-être aussi allons-nous rester bloqués longtemps dans cette cabane ? Il faut garder des provisions pour notre dîner.
C’était là des raisons que je devais comprendre, mais elles ne touchèrent point les chiens qui voyant serrer la miche dans le sac, alors qu’ils avaient à peine mangé, tendirent la patte à leur maître, lui grattèrent les genoux, et se livrèrent à une pantomime expressive pour faire ouvrir le sac sur lequel ils dardaient leurs yeux suppliants.
Prières et caresses furent inutiles, le sac ne s’ouvrit point.
Cependant, si frugal qu’eût été ce léger repas, il nous avait réconfortés ; nous étions à l’abri, le feu nous pénétrait d’une douce chaleur ; nous pouvions attendre que la neige cessât de tomber.
Rester dans cette cabane n’avait rien de bien effrayant pour moi, d’autant mieux que je n’admettais pas que nous dussions y rester bloqués longtemps, comme Vitalis l’avait dit, pour justifier son économie ; la neige ne tomberait pas toujours.
Il est vrai que rien n’annonçait qu’elle dût cesser bientôt.
Par l’ouverture de notre hutte nous apercevions les flocons descendre rapides et serrés ; comme il ne ventait plus, ils tombaient droit, les uns par-dessus les autres, sans interruption.
On ne voyait pas le ciel, et la clarté, au lieu de descendre d’en haut, montait d’en bas, de la nappe éblouissante qui couvrait la terre.
Les chiens avaient pris leur parti de cette halte forcée, et s’étant tous les trois installés devant le feu, celui-ci couché en rond, celui-là étalé sur le flanc, Capi le nez dans les cendres, ils dormaient.
L’idée me vint de faire comme eux ; je m’étais levé de bonne heure, et il serait plus agréable de voyager dans le pays des rêves, peut-être sur le Cygne, que de regarder cette neige.
Je ne sais combien je dormis de temps ; quand je m’éveillai la neige avait cessé de tomber, je regardai au dehors ; la couche qui s’était entassée devant notre hutte avait considérablement augmenté ; s’il fallait se remettre en route, j’en aurais plus haut que les genoux.
Quelle heure était-il ?
Je ne pouvais pas le demander au maître, car en ces derniers mois les recettes médiocres n’avaient pas remplacé l’argent que la prison et son procès lui avaient coûté, si bien qu’à Dijon, pour acheter ma peau de mouton et différents objets pour lui et pour moi, il avait dû vendre sa montre, la grosse montre en argent sur laquelle j’avais vu Capi dire l’heure, quand Vitalis m’avait engagé dans la troupe.
C’était au jour de m’apprendre ce que je ne pouvais plus demander à notre bonne grosse montre.
Mais rien au dehors ne pouvait me répondre : en bas, sur le sol, une ligne blanche éblouissante : au-dessus et dans l’air un brouillard sombre ; au ciel une lueur confuse, avec çà et là des teintes d’un jaune sale.
Rien de tout cela n’indiquait à quelle heure de la journée nous étions.
Les oreilles n’en apprenaient pas plus que les yeux, car il s’était établi un silence absolu que ne venait troubler ni un cri d’oiseau, ni un coup de fouet, ni un roulement de voiture ; jamais nuit n’avait été plus silencieuse que cette journée.
Avec cela régnait autour de nous une immobilité complète ; la neige avait arrêté tout mouvement, tout pétrifié ; de temps en temps seulement, après un petit bruit étouffé, à peine perceptible, on voyait une branche de sapin se balancer lourdement ; sous le poids qui la chargeait, elle s’était peu à peu inclinée vers la terre, et quand l’inclinaison avait été trop raide, la neige avait glissé jusqu’en bas ; alors la branche s’était brusquement redressée, et son feuillage d’un vert noir tranchait sur le linceul blanc qui enveloppait les autres arbres depuis la cime jusqu’aux pieds, de sorte que lorsqu’on regardait de loin on croyait voir un trou sombre s’ouvrir çà et là dans ce linceul.
Comme je restais dans l’embrasure de la porte, émerveillé devant ce spectacle, je m’entendis interpeller par mon maître.
— As-tu donc envie de te remettre en route ? me dit-il.
— Je ne sais pas ; je n’ai aucune envie ; je ferai ce que vous voudrez que nous fassions.
— Eh bien, mon avis est de rester ici, où nous avons au moins un abri et du feu.
Je pensai que nous n’avions guère de pain, mais je gardai ma réflexion pour moi.
— Je crois que la neige va reprendre bientôt, poursuivit Vitalis, il ne faut pas nous exposer sur la route sans savoir à quelle distance nous sommes des habitations ; la nuit ne serait pas douce au milieu de cette neige ; mieux vaut encore la passer ici ; au moins nous aurons les pieds secs.
La question de nourriture mise de côté, cet arrangement n’avait rien pour me déplaire ; et d’ailleurs en nous remettant en marche tout de suite, il n’était nullement certain que nous pussions, avant le soir, trouver une auberge où dîner, tandis qu’il n’était que trop évident que nous trouverions sur la route une couche de neige qui n’ayant pas encore été foulée, serait pénible pour la marche.
Il faudrait se serrer le ventre dans notre hutte, voilà tout.
Ce fut ce qui arriva lorsque, pour notre dîner, Vitalis nous partagea entre six ce qui restait de la miche.
Hélas ! qu’il en restait peu, et comme ce peu fut vite expédié, bien que nous fissions les morceaux aussi petits que possible, afin de prolonger notre repas.
Lorsque notre pauvre dîner si chétif et si court fut terminé, je crus que les chiens allaient recommencer leur manége du déjeuner, car il était évident qu’ils avaient encore terriblement faim. Mais il n’en fut rien, et je vis une fois de plus combien vive était leur intelligence.
Notre maître ayant remis son couteau dans la poche de son pantalon, ce qui indiquait que notre festin était fini, Capi se leva et après avoir fait un signe de tête à ses deux camarades, il alla flairer le sac dans lequel on plaçait habituellement la nourriture. En même temps il posa délicatement la patte sur le sac pour le palper. Ce double examen le convainquit qu’il n’y avait rien à manger. Alors il revint à sa place devant le foyer, et après avoir fait un nouveau signe de tête à Dolce et à Zerbino, il s’étala tout de son long avec un soupir de résignation.
— Il n’y a plus rien ; il est inutile de demander.
Ce fut exprimé aussi clairement que par la parole.
Ses camarades comprenant ce langage, s’étalèrent comme lui devant le feu, en poussant le même soupir, mais celui de Zerbino ne fut pas résigné, car à un grand appétit Zerbino joignait une vive gourmandise, et ce sacrifice était pour lui plus douloureux que pour tout autre.
La neige avait repris depuis longtemps et elle tombait toujours avec la même persistance ; d’heure en heure on voyait la couche qu’elle formait sur le sol monter le long des jeunes cépées, dont les tiges seules émergeaient encore de la marée blanche, qui allait bientôt les engloutir.
Mais lorsque notre dîner fut terminé on commença à ne plus voir que confusément ce qui se passait au dehors de la hutte, car en cette sombre journée l’obscurité était vite venue.
La nuit n’arrêta pas la chute de la neige, qui du ciel noir, continua à descendre en gros flocons sur la terre blanche.
Puisque nous devions coucher là, le mieux était de dormir au plus vite ; je fis donc comme les chiens et après m’être roulé dans ma peau de mouton qui, exposée à la flamme, avait séché durant le jour, je m’allongeai auprès du feu, la tête sur une pierre plate qui me servait d’oreiller.
— Dors, me dit Vitalis, je te réveillerai quand je voudrai dormir à mon tour, car bien que nous n’ayons rien à craindre des bêtes ou des gens dans cette cabane, il faut que l’un de nous veille pour entretenir le feu ; nous devons prendre nos précautions contre le froid qui peut devenir âpre, si la neige cesse.
Je ne me fis pas répéter l’invitation deux fois, et m’endormis.
Quand mon maître me réveilla la nuit devait être déjà avancée ; au moins je me l’imaginai ; la neige ne tombait plus ; notre feu brûlait toujours.
— À ton tour maintenant, me dit Vitalis, tu n’auras qu’à mettre de temps en temps du bois dans le foyer ; tu vois que je t’ai fait ta provision.
En effet, un amas de fagots était entassé à portée de la main. Mon maître, qui avait le sommeil beaucoup plus léger que moi, n’avait pas voulu que je l’éveillasse en allant tirer un morceau de bois à notre muraille chaque fois que j’en aurais besoin, et il m’avait préparé ce tas, dans lequel il n’y avait qu’à prendre sans bruit.
C’était là sans doute une sage précaution, mais elle n’eut pas, hélas ! les suites que Vitalis attendait.
Me voyant éveillé et prêt à prendre ma faction, il s’était allongé à son tour devant le feu, ayant Joli-Cœur contre lui, roulé dans une couverture, et bientôt sa respiration, plus haute et plus régulière, m’avait dit qu’il venait de s’endormir.
Alors je m’étais levé et doucement, sur la pointe des pieds, j’avais été jusqu’à la porte, pour voir ce qui se passait au dehors.
La neige avait tout enseveli, les herbes, les buissons, les cépées, les arbres ; aussi loin que la vue pouvait s’étendre, ce n’était qu’une nappe inégale, mais uniformément blanche ; le ciel était parsemé d’étoiles scintillantes, mais, si vive que fût leur clarté, c’était de la neige que montait la pâle lumière qui éclairait le paysage. Le froid avait repris et il devait geler au dehors, car l’air qui entrait dans notre cabane était glacé. Dans le silence lugubre de la nuit, on entendait parfois des craquements qui indiquaient que la surface de la neige se congelait.
Nous avions été vraiment bien heureux de rencontrer cette cabane ; que serions-nous devenus en pleine forêt, sous la neige et par ce froid ?
Si peu de bruit que j’eusse fait en marchant, j’avais éveillé les chiens, et Zerbino s’était levé pour venir avec moi à la porte. Comme il ne regardait pas avec des yeux pareils aux miens les splendeurs de cette nuit neigeuse, il s’ennuya bien vite et voulut sortir.
De la main je lui donnai l’ordre de rentrer ; quelle idée d’aller dehors par ce froid ; n’était-il pas meilleur de rester devant le feu que d’aller vagabonder ? Il obéit, mais il resta le nez tourné vers la porte, en chien obstiné qui n’abandonne pas son idée.
Je demeurai encore quelques instants à regarder la neige, car bien que ce spectacle me remplît le cœur d’une vague tristesse, je trouvais une sorte de plaisir à le contempler : il me donnait envie de pleurer, et quoiqu’il me fût facile de ne plus le voir, puisque je n’avais qu’à fermer les yeux ou à revenir à ma place, je ne bougeais pas.
Enfin je me rapprochai du feu, et l’ayant chargé de trois ou quatre morceaux de bois croisés les uns par-dessus les autres, je crus que je pouvais m’asseoir sans danger sur la pierre qui m’avait servi d’oreiller.
Mon maître dormait tranquillement ; les chiens et Joli-Cœur dormaient aussi, et du foyer avivé s’élevaient de belles flammes qui montaient en tourbillons jusqu’au toit, en jetant des étincelles pétillantes qui, seules, troublaient le silence.
Pendant assez longtemps je m’amusai à regarder ces étincelles, mais peu à peu, la lassitude me prit et m’engourdit sans que j’en eusse conscience.
Si j’avais eu à m’occuper de ma provision de bois, je me serais levé, et, en marchant autour de la cabane, je me serais tenu éveillé ; mais, en restant assis, n’ayant d’autre mouvement à faire que d’étendre la main pour mettre des branches au feu, je me laissai aller à la somnolence qui me gagnait et, tout en me croyant sûr de me tenir éveillé, je me rendormis.
Tout à coup je fus réveillé en sursaut par un aboiement furieux.
Il faisait nuit ; j’avais sans doute dormi longtemps, et le feu s’était éteint, ou tout au moins il ne donnait plus de flammes qui éclairassent la hutte.
Les aboiements continuaient : c’était la voix de Capi ; mais, chose étrange, Zerbino, pas plus que Dolce ne répondaient à leur camarade.
— Eh bien, quoi ? s’écria Vitalis se réveillant aussi, que se passe-t-il ?
— Je ne sais pas.
— Tu t’es endormi et le feu s’éteint.
Capi s’était élancé vers la porte, mais n’était point sorti, et c’était de la porte qu’il aboyait.
La question que mon maître m’avait adressée, je me la posai : que se passait-il ?
Aux aboiements de Capi répondirent deux ou trois hurlements plaintifs dans lesquels je reconnus la voix de Dolce. Ces hurlements venaient de derrière notre hutte, et à une assez courte distance.
J’allais sortir ; mon maître m’arrêta en me posant la main sur l’épaule.
— Mets d’abord du bois sur le feu, me commanda-t-il.
Et pendant que j’obéissais, il prit dans le foyer un tison sur lequel il souffla pour aviser la pointe carbonisée.
Puis au lieu de rejeter ce tison dans le foyer, lorsqu’il fut rouge, il le garda à la main.
— Allons voir, dit-il, et marche derrière moi ; en avant, Capi !
Au moment où nous allions sortir, un formidable hurlement éclata dans le silence, et Capi se rejeta dans nos jambes, effrayé.
— Ce sont des loups ; où sont Zerbino et Dolce ?
À cela je ne pouvais répondre. Sans doute les deux chiens étaient sortis pendant mon sommeil ; Zerbino réalisant le caprice qu’il avait manifesté, et que j’avais contrarié, Dolce suivant son camarade.
Les loups les avaient-ils emportés ? Il me semblait que l’accent de mon maître, lorsqu’il avait demandé où ils étaient, avait trahi cette crainte.
— Prends un tison, me dit-il, et allons à leur secours.
J’avais entendu raconter dans mon village d’effrayantes histoires de loups ; cependant je n’hésitai pas ; je m’armai d’un tison et suivis mon maître.
Mais lorsque nous fûmes dans la clairière nous n’aperçûmes ni chiens, ni loups.
On voyait seulement sur la neige les empreintes creusées par les deux chiens.
Nous suivîmes ces empreintes ; elles tournaient autour de la hutte ; puis à une certaine distance se montrait dans l’obscurité un espace où la neige avait été foulée, comme si des animaux s’étaient roulés dedans.
— Cherche, cherche, Capi, disait mon maître et en même temps il sifflait pour appeler Zerbino et Dolce.
Mais aucun aboiement ne lui répondait, aucun bruit ne troublait le silence lugubre de la forêt, et Capi, au lieu de chercher comme on lui commandait, restait dans nos jambes, donnant des signes manifestes d’inquiétude et d’effroi, lui qui ordinairement était aussi obéissant que brave.
La réverbération de la neige ne donnait pas une clarté suffisante pour nous reconnaître dans l’obscurité et suivre les empreintes ; à une courte distance, les yeux éblouis se perdaient dans l’ombre confuse.
De nouveau, Vitalis siffla, et d’une voix forte il appela Zerbino et Dolce.
Nous écoutâmes ; le silence continua ; j’eus le cœur serré.
Pauvre Zerbino ! Pauvre Dolce !
Vitalis précisa mes craintes.
— Les loups les ont emportés, dit-il ; pourquoi les as-tu laissés sortir ?
Ah ! oui, pourquoi ? Je n’avais pas, hélas ! de réponse à donner.
— Il faut les chercher, dis-je.
Et je passai devant ; mais Vitalis m’arrêta.
— Et où veux-tu les chercher ? dit-il.
— Je ne sais pas, partout.
— Comment nous guider au milieu de l’obscurité, et dans cette neige ?
Et, de vrai, ce n’était pas chose facile ; la neige nous montait jusqu’à mi-jambe, et ce n’étaient pas nos deux tisons qui pouvaient éclairer les ténèbres.
— S’ils n’ont pas répondu à mon appel, c’est qu’ils sont… bien loin, dit-il ; et puis, il ne faut pas nous exposer à ce que les loups nous attaquent nous-mêmes ; nous n’avons rien pour nous défendre.
C’était terrible d’abandonner ainsi ces deux pauvres chiens, ces deux camarades, ces deux amis, pour moi particulièrement, puisque je me sentais responsable de leur faute ; si je n’avais pas dormi, ils ne seraient pas sortis.
Mon maître s’était dirigé vers la hutte et je l’avais suivi, regardant derrière moi à chaque pas et m’arrêtant pour écouter ; mais je n’avais rien vu que la neige, je n’avais rien entendu que les craquements de la neige.
Dans la hutte, une surprise nouvelle nous attendait ; en notre absence, les branches que j’avais entassées sur le feu s’étaient allumées, elles flambaient, jetant leurs lueurs dans les coins les plus sombres.
Je ne vis point Joli-Cœur.
Sa couverture était restée devant le feu, mais elle était plate et le singe ne se trouvait pas dessous.
Je l’appelai ; Vitalis l’appela à son tour ; il ne se montra pas.
Qu’était-il devenu ?
Vitalis me dit qu’en s’éveillant, il l’avait senti près de lui, c’était donc depuis que nous étions sortis qu’il avait disparu ?
Avait-il voulu nous suivre ?
Nous prîmes une poignée de branches enflammées, et nous sortîmes, penchés en avant, nos branches inclinées sur la neige, cherchant les traces de Joli-Cœur.
Nous n’en trouvâmes point : il est vrai que le passage des chiens et nos piétinements avaient brouillé les empreintes, mais pas assez cependant pour qu’on ne pût pas reconnaître les pieds du singe.
Il n’était donc pas sorti.
Nous rentrâmes dans la cabane pour voir s’il ne s’était pas blotti dans quelque fagot.
Notre recherche dura longtemps ; dix fois nous passâmes à la même place, dans les mêmes coins ; je montai sur les épaules de Vitalis pour explorer les branches qui formaient notre toit ; tout fut inutile.
De temps en temps nous nous arrêtions pour l’appeler ; rien, toujours rien.
Vitalis paraissait exaspéré, tandis que moi j’étais sincèrement désolé.
Pauvre Joli-Cœur !
Comme je demandais à mon maître s’il pensait que les loups avaient pu aussi l’emporter :
— Non, me dit-il, les loups n’auraient pas osé entrer dans la cabane ; je crois qu’ils auront sauté sur Zerbino et sur Dolce qui étaient sortis, mais ils n’ont pas pénétré ici ; il est probable que Joli-Cœur épouvanté se sera caché quelque part pendant que nous étions dehors ; et c’est là ce qui m’inquiète pour lui, car par ce temps abominable il va gagner froid et pour lui le froid serait mortel.
— Alors cherchons encore.
Et de nouveau nous recommençâmes nos recherches ; mais elles ne furent pas plus heureuses que la première fois.
— Il faut attendre le jour, dit Vitalis.
— Quand viendra-t-il ?
— Dans deux ou trois heures, je pense.
Et il s’assit devant le feu, la tête entre ses deux mains.
Je n’osai pas le troubler. Je restai immobile près de lui, ne faisant un mouvement que pour mettre des branches sur le feu ; de temps en temps il se levait pour aller jusqu’à la porte, alors il regardait le ciel et il se penchait pour écouter ; puis il revenait prendre sa place.
Il me semblait que j’aurais mieux aimé qu’il me grondât, plutôt que de le voir ainsi morne et accablé.
Les trois heures dont il avait parlé s’écoulèrent avec une lenteur exaspérante ; c’était à croire que cette nuit ne finirait jamais.
Cependant les étoiles pâlirent et le ciel blanchit, c’était le matin, bientôt il ferait jour.
Mais avec le jour naissant le froid augmenta, l’air qui entrait par la porte était glacé.
Si nous retrouvions Joli-Cœur, serait-il encore vivant ?
Mais quelle espérance raisonnable de le retrouver pouvions-nous avoir ?
Qui pouvait savoir si le jour n’allait pas nous ramener la neige ?
Alors comment le chercher ?
Heureusement il ne la ramena pas ; le ciel au lieu de se couvrir comme la veille s’emplit d’une lueur rosée qui présageait le beau temps.
Aussitôt que la clarté froide du matin eut donné aux buissons et aux arbres leurs formes réelles, nous sortîmes. Vitalis s’était armé d’un fort bâton et j’en avais pris un pareillement.
Capi ne paraissait plus être sous l’impression de frayeur qui l’avait paralysé pendant la nuit ; les yeux sur ceux de son maître il n’attendait qu’un signe pour s’élancer en avant.
Comme nous cherchions sur la terre les empreintes de Joli-Cœur, Capi leva la tête et se mit à aboyer joyeusement ; cela signifiait que c’était en l’air qu’il fallait chercher et non à terre.
En effet, nous vîmes que la neige qui couvrait notre cabane avait été foulée çà et là, jusqu’à une grosse branche penchée sur notre toit.
Nous suivîmes des yeux cette branche, qui appartenait à un gros chêne, et tout au haut de l’arbre, blottie dans une fourche, nous aperçûmes une petite forme de couleur sombre.
C’était Joli-Cœur, et ce qui s’était passé n’était pas difficile à deviner : effrayé par les hurlements des chiens et des loups, Joli-Cœur au lieu de rester près du feu, s’était élancé sur le toit de notre hutte, quand nous étions sortis, et de là il avait grimpé au haut du chêne, où se trouvant en sûreté, il était resté blotti, sans répondre à nos appels.
La pauvre petite bête si frileuse devait être glacée.
Mon maître l’appela doucement, mais il ne bougea pas plus que s’il était mort.
Pendant plusieurs minutes, Vitalis répéta ses appels : Joli-Cœur ne donna pas signe de vie.
J’avais à racheter ma négligence de la nuit.
— Si vous voulez, dis-je, je vais l’aller chercher.
— Tu vas te casser le cou.
— Il n’y a pas de danger.
Le mot n’était pas très-juste ; il y avait danger au contraire, surtout il y avait difficulté ; l’arbre était gros, et de plus il était couvert de neige dans les parties de son tronc et de ses branches qui avaient été exposées au vent.
Heureusement j’avais appris de bonne heure à grimper aux arbres et j’avais acquis dans cet art une force remarquable. Quelques petites branches avaient poussé çà et là, le long du tronc ; elles me servirent d’échelons, et bien que je fusse aveuglé par la neige que mes mains me faisaient tomber dans les yeux, je parvins bientôt à la première fourche. Arrivé là, l’ascension devenait facile ; je n’avais plus qu’à veiller à ne pas glisser sur la neige.
Tout en montant, je parlais doucement à Joli-Cœur qui ne bougeait pas, mais qui me regardait avec ses yeux brillants.
J’allais arriver à lui et déjà j’allongeais la main pour le prendre, lorsqu’il fit un bond et s’élança sur une autre branche.
Je le suivis sur cette branche, mais les hommes, hélas ! et même les gamins sont très-inférieurs aux singes pour courir dans les arbres.
Aussi est-il bien probable que je n’aurais jamais pu atteindre Joli-Cœur si la neige n’avait pas couvert les branches ; mais comme cette neige lui mouillait les mains et les pieds il fut bientôt fatigué de cette poursuite. Alors dégringolant de branches en branches il sauta d’un bond sur les épaules de son maître, et se cacha sous la veste de celui-ci.
C’était beaucoup d’avoir retrouvé Joli-Cœur, mais ce n’était pas tout : il fallait maintenant chercher les chiens.
Nous arrivâmes en quelques pas à l’endroit où nous étions déjà venus dans la nuit, et où nous avions trouvé la neige piétinée.
Maintenant qu’il faisait jour, il nous fut facile de deviner ce qui s’était passé : la neige gardait imprimée en creux l’histoire de la mort des chiens.
En sortant de la cabane l’un derrière l’autre, ils avaient longé les fagots et nous suivions distinctement leurs traces pendant une vingtaine de mètres ; puis ces traces disparaissaient dans la neige bouleversée ; alors on voyait d’autres empreintes ; d’un côté celles qui montraient par où les loups, en quelques bonds allongés, avaient sauté sur les chiens ; et de l’autre celles qui disaient par où ils les avaient emportés après les avoir boulés ; de traces des chiens il n’en existait plus, à l’exception d’une traînée de rouge qui çà et là ensanglantait la neige.
Il n’y avait plus maintenant à poursuivre nos recherches plus loin ; les deux pauvres chiens avaient été égorgés là et emportés pour être dévorés à loisir dans quelque hallier épineux.
D’ailleurs nous devions nous occuper au plus vite de réchauffer Joli-Cœur.
Nous rentrâmes dans la cabane et tandis que Vitalis lui présentait les pieds et les mains au feu comme on fait pour les petits enfants, je chauffai bien sa couverture et nous l’enveloppâmes dedans.
Mais ce n’était pas seulement une couverture qu’il fallait, c’était encore un bon lit bassiné, c’était surtout une boisson chaude, et nous n’avions ni l’un ni l’autre ; heureux encore d’avoir du feu.
Nous nous étions assis, mon maître et moi, autour du foyer, sans rien dire, et nous restions là, immobiles, regardant le feu brûler.
Mais il n’était pas besoin de paroles, il n’était pas besoin de regard pour exprimer ce que nous ressentions.
— Pauvre Zerbino, pauvre Dolce, pauvres amis !
C’étaient les paroles que tous deux nous murmurions chacun de notre côté, ou tout au moins les pensées de nos cœurs.
Ils avaient été nos camarades, nos compagnons de bonne et mauvaise fortune, et pour moi, pendant mes jours de détresse et de solitude, mes amis, presque mes enfants.
Et j’étais coupable de leur mort.
Car je ne pouvais m’innocenter : si j’avais fait bonne garde comme je le devais, si je ne m’étais pas endormi, ils ne seraient pas sortis, et les loups ne seraient pas venus nous attaquer dans notre cabane, ils auraient été retenus à distance, effrayés par notre feu.
J’aurais voulu que Vitalis me grondât ; j’aurais presque demandé qu’il me battît.
Mais il ne me disait rien, il ne me regardait même pas ; il restait la tête penchée au-dessus du foyer : sans doute il songeait à ce que nous allions devenir sans les chiens. Comment donner nos représentations sans eux ? Comment vivre ?
XV
MONSIEUR JOLI-CŒUR
Les pronostics du jour levant s’étaient réalisés ; le soleil brillait dans un ciel sans nuages et ses pâles rayons étaient réfléchis par la neige immaculée ; la forêt triste et livide la veille était maintenant éblouissante d’un éclat qui aveuglait les yeux.
De temps en temps Vitalis passait la main sous la couverture pour tâter Joli-Cœur ; mais celui-ci ne se réchauffait pas, et lorsque je me penchais sur lui je l’entendais grelotter.
Il devint bientôt évident que nous ne pourrions pas réchauffer ainsi son sang glacé dans ses veines.
— Il faut gagner un village, dit Vitalis en se levant, ou Joli-Cœur va mourir ici ; heureux nous serons, s’il ne meurt pas en route. Partons.
La couverture bien chauffée, Joli-Cœur fut enveloppé dedans, et mon maître le plaça sous sa veste contre sa poitrine.
Nous étions prêts à partir.
— Voilà une auberge, dit Vitalis, qui nous a fait payer cher l’hospitalité qu’elle nous a vendue.
En disant cela, sa voix tremblait.
Il sortit le premier, et je marchai dans ses pas.
Il fallut appeler Capi, qui était resté sur le seuil de la hutte, le nez tourné vers l’endroit où ses camarades avaient été surpris.
Dix minutes après être arrivés sur la grande route, nous croisâmes une voiture dont le charretier nous apprit qu’avant une heure nous trouverions un village.
Cela nous donna des jambes, et cependant marcher était difficile autant que pénible, au milieu de cette neige, dans laquelle j’enfonçais jusqu’à mi-corps.
De temps en temps, je demandais à Vitalis comment se trouvait Joli-Cœur, et il me répondait qu’il le sentait toujours grelotter contre lui.
Enfin au bas d’une côte se montrèrent les toits blancs d’un gros village ; encore un effort et nous arrivions.
Nous n’avions point pour habitude de descendre dans les meilleures auberges, celles qui par leur apparence cossue, promettaient bon gîte et bonne table ; tout au contraire nous nous arrêtions ordinairement à l’entrée des villages ou dans les faubourgs, choisissant quelque pauvre maison, d’où l’on ne nous repousserait pas, et où l’on ne viderait pas notre bourse.
Mais cette fois, il n’en fut pas ainsi : au lieu de s’arrêter à l’entrée du village, Vitalis continua jusqu’à une auberge devant laquelle se balançait une belle enseigne dorée ; par la porte de la cuisine, grande ouverte, on voyait une table chargée de viande, et sur un large fourneau plusieurs casseroles en cuivre rouge chantaient joyeusement, lançant au plafond des petits nuages de vapeur ; de la rue, on respirait une bonne odeur de soupe grasse qui chatouillait agréablement nos estomacs affamés.
Mon maître ayant pris ses airs « de monsieur » entra dans la cuisine, et le chapeau sur la tête, le cou tendu en arrière, il demanda à l’aubergiste une bonne chambre avec du feu.
Tout d’abord l’aubergiste, qui était un personnage de belle prestance, avait dédaigné de nous regarder, mais les grands airs de mon maître lui en imposèrent, et une fille de service reçut l’ordre de nous conduire.
— Vite, couche-toi, me dit Vitalis pendant que la servante allumait le feu.
Je restai un moment étonné : pourquoi me coucher ? j’aimais bien mieux me mettre à table qu’au lit.
— Allons vite, répéta Vitalis.
Et je n’eus qu’à obéir.
Il y avait un édredon sur le lit, Vitalis me l’appliqua jusqu’au menton.
— Tâche d’avoir chaud, me dit-il, plus tu auras chaud mieux cela vaudra.
Il me semblait que Joli-Cœur avait beaucoup plus que moi besoin de chaleur, car je n’avais nullement froid.
Pendant que je restais immobile sous l’édredon, pour tâcher d’avoir chaud, Vitalis au grand étonnement de la servante, tournait et retournait le pauvre petit Joli-Cœur, comme s’il voulait le faire rôtir.
— As-tu chaud ? me demanda Vitalis après quelques instants.
— J’étouffe.
— C’est justement ce qu’il faut.
Et venant à moi vivement, il mit Joli-Cœur dans mon lit, en me recommandant de le tenir bien serré contre ma poitrine.
La pauvre petite bête, qui était ordinairement si rétive lorsqu’on lui imposait quelque chose qui lui déplaisait, semblait résignée à tout.
Elle se tenait collée contre moi, sans faire un mouvement ; elle n’avait plus froid, son corps était brûlant.
Mon maître était descendu à la cuisine ; bientôt il remonta portant un bol de vin chaud et sucré.
Il voulut faire boire quelques cuillerées de ce breuvage à Joli-Cœur, mais celui-ci ne put pas desserrer les dents.
Avec ses yeux brillants il nous regardait tristement comme pour nous prier de ne pas le tourmenter.
En même temps il sortait un de ses bras du lit et nous le tendait.
Je me demandais ce que signifiait ce geste qu’il répétait à chaque instant, quand Vitalis me l’expliqua.
Avant que je fusse entré dans la troupe, Joli-Cœur avait eu une fluxion de poitrine et on l’avait saigné au bras ; à ce moment, se sentant de nouveau malade, il nous tendait le bras pour qu’on le saignât encore et le guérît comme on l’avait guéri la première fois.
N’était-ce pas touchant ?
Non-seulement Vitalis fut touché, mais encore il fut inquiété.
Il était évident que le pauvre Joli-Cœur était malade, et même il fallait qu’il se sentît bien malade pour refuser le vin sucré qu’il aimait tant.
— Bois le vin, dit Vitalis, et reste au lit, je vais aller chercher un médecin.
Il faut avouer que moi aussi j’aimais bien le vin sucré, et de plus j’avais une terrible faim ; je ne me fis donc pas donner cet ordre deux fois, et après avoir vidé le bol, je me replaçai sous l’édredon, où la chaleur du vin aidant, je faillis étouffer.
Notre maître ne fut pas longtemps sorti ; bientôt il revint amenant avec lui un monsieur à lunettes d’or, — le médecin.
Craignant que ce puissant personnage ne voulût pas se déranger pour un singe, Vitalis n’avait pas dit pour quel malade il l’appelait ; aussi, me voyant dans le lit rouge comme une pivoine qui va ouvrir, le médecin vint à moi, et m’ayant posé la main sur le front :
— Congestion, dit-il.
Et il secoua la tête d’un air qui n’annonçait rien de bon.
Il était temps de le détromper, ou bien il allait peut-être me saigner.
— Ce n’est pas moi qui suis malade, dis-je.
— Comment, pas malade ? Cet enfant délire.
Sans répondre, je soulevai un peu la couverture, et montrant Joli-Cœur qui avait posé son petit bras autour de mon cou :
— C’est lui qui est malade, dis-je.
Le médecin avait reculé de deux pas en se tournant vers Vitalis :
— Un singe ! criait-il, comment, c’est pour un singe que vous m’avez dérangé et par un temps pareil !
Je crus qu’il allait sortir indigné.
Mais c’était un habile homme que notre maître et qui ne perdait pas facilement la tête. Poliment et avec ses grands airs il arrêta le médecin. Puis il lui expliqua la situation : comment nous avions été surpris par la neige, et comment par la peur des loups, Joli-Cœur s’était sauvé sur un chêne où le froid l’avait glacé.
— Sans doute le malade n’était qu’un singe ; mais quel singe de génie ! et de plus un camarade, un ami pour nous ! Comment confier un comédien aussi remarquable aux soins d’un simple vétérinaire ! Tout le monde sait que les vétérinaires de village ne sont que des ânes. Tandis que tout le monde sait aussi que les médecins sont tous, à des degrés divers, des hommes de science ; si bien que dans le moindre village on est certain de trouver le savoir et la générosité en allant sonner à la porte du médecin. Enfin, bien que le singe ne soit qu’un animal, selon les naturalistes, il se rapproche tellement de l’homme que ses maladies sont celles de celui-ci. N’est-il pas intéressant, au point de vue de la science et de l’art, d’étudier par où ces maladies se ressemblent ou ne se ressemblent pas ?
Ce sont d’adroits flatteurs que les Italiens ; le médecin abandonna bientôt la porte pour se rapprocher du lit.
Pendant que notre maître parlait, Joli-Cœur qui avait sans doute deviné que ce personnage à lunettes était un médecin, avait plus de dix fois sorti son petit bras, pour l’offrir à la saignée.
— Voyez comme ce singe est intelligent, il sait que vous êtes médecin, et il vous tend le bras pour que vous tâtiez son pouls.
Cela acheva de décider le médecin.
— Au fait, dit-il, le cas est peut-être curieux.
Il était, hélas ! fort triste pour nous, et bien inquiétant : le pauvre M. Joli-Cœur était menacé d’une fluxion de poitrine.
Ce petit bras qu’il avait tendu si souvent, fut pris par le médecin, et la lancette s’enfonça dans sa veine, sans qu’il poussât le plus petit gémissement.
Il savait que cela devait le guérir.
Puis après la saignée vinrent les sinapismes, les cataplasmes, les potions et les tisanes.
Bien entendu, je n’étais pas resté dans le lit ; j’étais devenu garde-malade sous la direction de Vitalis.
Le pauvre petit Joli-Cœur aimait mes soins et il me récompensait par un doux sourire : son regard était devenu vraiment humain.
Lui naguère si vif, si pétulant, si contrariant, toujours en mouvement pour nous jouer quelque mauvais tour, était maintenant là, d’une tranquillité et d’une docilité exemplaires.
Il semblait qu’il avait besoin qu’on lui témoignât de l’amitié, demandant même celle de Capi qui tant de fois avait été sa victime.
Comme un enfant gâté, il voulait nous avoir tous auprès de lui, et lorsque l’un de nous sortait, il se fâchait.
Sa maladie suivait la marche de toutes les fluxions de poitrine, c’est-à-dire que la toux s’était bientôt établie, le fatiguant beaucoup par les secousses qu’elle imprimait à son pauvre petit corps.
J’avais cinq sous pour toute fortune, je les employai à acheter du sucre d’orge pour Joli-Cœur.
Malheureusement j’aggravai son mal au lieu de le soulager.
Avec l’attention qu’il apportait à tout, il ne lui fallut pas longtemps pour observer que je lui donnais un morceau de sucre d’orge toutes les fois qu’il toussait.
Alors il s’empressa de profiter de cette observation, et il se mit à tousser à chaque instant, afin d’avoir plus souvent le remède qu’il aimait tant, si bien que ce remède au lieu de le guérir le rendit plus malade.
Quand je m’aperçus de sa ruse, je supprimai bien entendu le sucre d’orge, mais il ne se découragea pas : il commençait par m’implorer de ses yeux suppliants ; puis quand il voyait que ses prières étaient inutiles, il s’asseyait sur son séant, et courbé en deux, une main posée sur son ventre, il toussait de toutes ses forces, sa face se colorait, les veines de son front se distendaient, les larmes coulaient de ses yeux, et il finissait par suffoquer, non plus en jouant la comédie, mais pour tout de bon.
Mon maître ne m’avait jamais fait part de ses affaires, et c’était d’une façon incidente que j’avais appris qu’il avait dû vendre sa montre pour m’acheter ma peau de mouton, mais dans les circonstances difficiles que nous traversions, il crut devoir s’écarter de cette règle.
Un matin, en revenant de déjeuner, tandis que j’étais resté auprès de Joli-Cœur que nous ne laissions pas seul, il m’apprit que l’aubergiste avait demandé le paiement de ce que nous devions, si bien qu’après ce paiement, il ne lui restait plus que cinquante sous.
Que faire ?
Naturellement je ne trouvai pas de réponse à cette question.
Pour lui, il ne voyait qu’un moyen de sortir d’embarras, c’était de donner une représentation le soir même.
Une représentation sans Zerbino, sans Dolce, sans Joli-Cœur ! cela me paraissait impossible.
Mais nous n’étions pas dans une position à nous arrêter découragés devant une impossibilité : il fallait à tout prix soigner Joli-Cœur et le sauver : le médecin, les médicaments, le feu, la chambre, nous obligeaient à faire une recette immédiate d’au moins quarante francs pour payer l’aubergiste qui, voyant la couleur de notre argent, nous ouvrirait un nouveau crédit.
Quarante francs dans ce village, par ce froid, et avec les ressources dont nous disposions, quel tour de force !
Cependant mon maître, sans s’attarder aux réflexions, s’occupa activement à le réaliser.
Tandis que je gardais notre malade, il trouva une salle de spectacle dans les halles, car une représentation en plein air était impossible par le froid qu’il faisait ; il composa et colla des affiches ; il arrangea un théâtre avec quelques planches, et bravement il dépensa ses cinquante sous à acheter des chandelles qu’il coupa par le milieu, afin de doubler son éclairage.
Par la fenêtre de la chambre, je le voyais aller et venir dans la neige, passer et repasser devant notre auberge, et ce n’était pas sans angoisse que je me demandais quel serait le programme de cette représentation.
Je fus bientôt fixé à ce sujet, car le tambour du village, coiffé d’un képi rouge, s’arrêta devant l’auberge, et après un magnifique roulement, donna lecture de ce programme.
Ce qu’il était, on l’imaginera facilement lorsqu’on saura que Vitalis avait prodigué les promesses les plus extravagantes : il était question « d’un artiste célèbre dans l’univers entier, » — c’était Capi, — et « d’un jeune chanteur qui était un prodige, » — le prodige, c’était moi.
Mais la partie la plus intéressante de ce boniment était celle qui disait qu’on ne fixait pas le prix des places et qu’on s’en rapportait à la générosité des spectateurs, qui ne payeraient qu’après avoir vu, entendu et applaudi.
Cela me parut bien hardi, car nous applaudirait-on ? Capi méritait vraiment d’être célèbre. Mais moi je n’avais nullement la conviction d’être un prodige.
En entendant le tambour, Capi avait aboyé joyeusement, et Joli-Cœur s’était à demi soulevé, quoiqu’il fût très-mal en ce moment : tous deux, je le crois bien, avaient deviné qu’il s’agissait de notre représentation.
Cette idée, qui s’était présentée à mon esprit, me fut bientôt confirmée par la pantomime de Joli-Cœur : il voulut se lever et je dus le retenir de force ; alors il me demanda son costume de général anglais, l’habit et le pantalon rouge galonnés d’or, le chapeau à claque avec son plumet.
Il joignait les mains, il se mettait à genoux pour mieux me supplier.
Quand il vit qu’il n’obtenait rien de moi par la prière, il essaya de la colère, puis enfin des larmes.
Il était certain que nous aurions bien de la peine à le décider à renoncer à son idée de reprendre son rôle le soir, et je pensai que dans ces conditions le mieux était de lui cacher notre départ.
Malheureusement quand Vitalis, qui ignorait ce qui s’était passé en son absence, rentra, sa première parole fut pour me dire de préparer ma harpe et tous les accessoires nécessaires à notre représentation.
À ces mots bien connus de lui, Joli-Cœur recommença ses supplications, les adressant cette fois à son maître ; il eût pu parler qu’il n’eût assurément pas mieux exprimé par le langage articulé ses désirs qu’il ne le faisait par les sons différents qu’il poussait, par les contractions de sa figure et par la mimique de tout son corps ; c’étaient de vraies larmes qui mouillaient ses joues, et c’étaient de vrais baisers ceux qu’il appliquait sur les mains de Vitalis.
— Tu veux jouer ? dit celui-ci.
— Oui, oui, cria toute la personne de Joli-Cœur.
— Mais tu es malade, pauvre petit Joli-Cœur !
— Plus malade ! cria-t-il non moins expressivement.
C’était vraiment chose touchante de voir l’ardeur que ce pauvre petit malade, qui n’avait plus que le souffle, mettait dans ses supplications, et les mines ainsi que les poses qu’il prenait pour nous décider ; mais lui accorder ce qu’il demandait, c’eût été le condamner à une mort certaine.
L’heure était venue de nous rendre aux halles ; j’arrangeai un bon feu dans la cheminée avec de grosses bûches qui devaient durer longtemps ; j’enveloppai bien dans sa couverture le pauvre petit Joli-Cœur qui pleurait à chaudes larmes, et qui m’embrassait tant qu’il pouvait, puis nous partîmes.
En cheminant dans la neige, mon maître m’expliqua ce qu’il attendait de moi.
Il ne pouvait pas être question de nos pièces ordinaires, puisque nos principaux comédiens manquaient, mais nous devions, Capi et moi, donner tout ce que nous avions de zèle et de talent. Il s’agissait de faire une recette de quarante francs.
Quarante francs ! c’était bien là le terrible.
Tout avait été préparé par Vitalis, et il ne s’agissait plus que d’allumer les chandelles ; mais c’était un luxe que nous ne devions nous permettre que quand la salle serait à peu près garnie, car il fallait que notre illumination ne finît pas avant la représentation.
Pendant que nous prenions possession de notre théâtre, le tambour parcourait une dernière fois les rues du village, et nous entendions les roulements de sa caisse qui s’éloignaient ou se rapprochaient selon le caprice des rues.
Après avoir terminé la toilette de Capi et la mienne, j’allai me poster derrière un pilier pour voir l’arrivée de la compagnie.
Bientôt les roulements du tambour se rapprochèrent et j’entendis dans la rue une vague rumeur.
Elle était produite par les voix d’une vingtaine de gamins qui suivaient le tambour en marquant le pas.
Sans suspendre sa batterie, le tambour vint se placer entre deux lampions allumés à l’entrée de notre théâtre, et le public n’eut plus qu’à occuper ses places en attendant que le spectacle commençât.
Hélas ! qu’il était lent à venir, et cependant à la porte, le tambour continuait ses ra et ses fla avec une joyeuse énergie ; tous les gamins du village étaient je pense installés ; mais ce n’étaient pas les gamins qui nous feraient une recette de quarante francs ; il nous fallait des gens importants à la bourse bien garnie et à la main facile à s’ouvrir. Enfin mon maître décida que nous devions commencer, bien que la salle fût loin d’être remplie ; mais nous ne pouvions attendre davantage, poussés que nous étions par la terrible question des chandelles.
Ce fut à moi de paraître le premier sur le théâtre, et en m’accompagnant de ma harpe je chantai deux chansonnettes. Pour être sincère je dois déclarer que les applaudissements que je recueillis furent assez rares.
Je n’ai jamais eu un bien grand amour-propre du comédien, mais dans cette circonstance, la froideur du public me désola. Assurément si je ne lui plaisais pas, il n’ouvrirait pas sa bourse. Ce n’était pas pour la gloire que je chantais, c’était pour le pauvre Joli-Cœur. Ah ! comme j’aurais voulu le toucher, ce public, l’enthousiasmer, lui faire perdre la tête ; mais autant que je pouvais voir dans cette halle pleine d’ombres bizarres, il me semblait que je l’intéressais fort peu et qu’il ne m’acceptait pas comme un prodige.
Capi fut plus heureux ; on l’applaudit à plusieurs reprises, et à pleines mains.
La représentation continua ; grâce à Capi elle se termina au milieu des bravos, non-seulement on claquait des mains, mais encore on trépignait des pieds.
Le moment décisif était arrivé. Pendant que sur la scène, accompagné par Vitalis, je dansais un pas espagnol, Capi, la sébile à la gueule, parcourait tous les rangs de l’assemblée.
Ramasserait-il les quarante francs ? c’était la question qui me serrait le cœur, tandis que je souriais au public avec mes mines les plus agréables.
J’étais à bout de souffle et je dansais toujours, car je ne devais m’arrêter que lorsque Capi serait revenu : il ne se pressait point, et quand on ne lui donnait pas, il frappait des petits coups de patte sur la poche qui ne voulait pas s’ouvrir.
Enfin je le vis apparaître, et j’allais m’arrêter, quand Vitalis me fit signe de continuer.
Je continuai et me rapprochant de Capi, je vis que la sébile n’était pas pleine, il s’en fallait de beaucoup.
À ce moment Vitalis qui, lui aussi, avait jugé la recette, se leva :
— Je crois pouvoir dire, sans nous flatter, que nous avons exécuté notre programme ; cependant, comme nos chandelles vivent encore, je vais, si la société le désire, lui chanter quelques airs ; Capi fera une nouvelle tournée, et les personnes qui n’avaient pas pu trouver l’ouverture de leur poche, à son premier passage, seront peut-être plus souples et plus adroites cette fois ; je les avertis de se préparer à l’avance.
Bien que Vitalis eût été mon professeur je ne l’avais jamais entendu vraiment chanter, ou tout au moins comme il chanta ce soir-là.
Il choisit deux airs que tout le monde connaît, mais que moi je ne connaissais pas alors, la romance de Joseph : « À peine au sortir de l’enfance, » et celle de Richard Cœur-de-Lion : « Ô Richard, ô mon roi ! »
Je n’étais pas à cette époque en état de juger si l’on chantait bien ou mal, avec art ou sans art, mais ce que je puis dire c’est le sentiment que sa façon de chanter provoqua en moi ; dans le coin de la scène où je m’étais retiré, je fondis en larmes.
À travers le brouillard qui obscurcissait mes yeux, je vis une jeune dame qui occupait le premier banc, applaudir de toutes ses forces. Je l’avais déjà remarquée, car ce n’était point une paysanne, comme celles qui composaient le public : c’était une vraie dame, jeune, belle et que, à son manteau de fourrure, j’avais jugée être la plus riche du village ; elle avait près d’elle un enfant qui, lui aussi, avait beaucoup applaudi Capi ; son fils sans doute, car il avait une grande ressemblance avec elle.
Après la première romance, Capi avait recommencé sa quête, et j’avais vu avec surprise que la belle dame n’avait rien mis dans la sébile.
Quand mon maître eut achevé l’air de Richard, elle me fit un signe de main, et je m’approchai d’elle.
— Je voudrais parler à votre maître, me dit-elle.
Cela m’étonna un peu que cette belle dame voulût parler à mon maître. Elle aurait mieux fait, selon moi, de mettre son offrande dans la sébile ; cependant j’allai transmettre ce désir ainsi exprimé à Vitalis, et pendant ce temps Capi revint près de nous.
La seconde quête avait été encore moins productive que la première.
— Que me veut cette dame ? demanda Vitalis.
— Vous parler.
— Je n’ai rien à lui dire.
— Elle n’a rien donné à Capi ; elle veut peut-être lui donner maintenant.
— Alors, c’est à Capi d’aller à elle et non à moi.
Cependant il se décida, mais en prenant Capi avec lui.
Je les suivis.
Pendant ce temps un domestique portant une lanterne et une couverture, était venu se placer près de la dame et de l’enfant.
Vitalis s’était approché et avait salué, mais froidement.
— Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, dit la dame, mais j’ai voulu vous féliciter.
Vitalis s’inclina sans répliquer un seul mot.
— Je suis musicienne, continua la dame, c’est vous dire combien je suis sensible à un grand talent comme le vôtre.
Un grand talent chez mon maître, chez Vitalis, le chanteur des rues, le montreur de bêtes : je restai stupéfait.
— Il n’y a pas de talent chez un vieux bonhomme tel que moi, dit Vitalis.
— Ne croyez pas que je sois poussée par une curiosité indiscrète, dit la dame.
— Mais je serais tout prêt à satisfaire cette curiosité ; vous avez été surprise, n’est-ce pas, d’entendre chanter à peu près un montreur de chiens ?
— Émerveillée.
— C’est bien simple cependant ; je n’ai pas toujours été ce que je suis en ce moment ; autrefois, dans ma jeunesse, il y a longtemps, j’ai été… oui, j’ai été le domestique d’un grand chanteur, et par imitation, comme un perroquet, je me suis mis à répéter quelques airs que mon maître étudiait devant moi ; voilà tout.
La dame ne répondit pas, mais elle regarda assez longuement Vitalis, qui se tenait devant elle dans une attitude embarrassée.
— Au revoir, monsieur, dit-elle en appuyant sur le mot monsieur, qu’elle prononça avec une étrange intonation ; au revoir, et encore une fois laissez-moi vous remercier de l’émotion que je viens de ressentir.
Puis, se baissant vers Capi, elle mit dans la sébile une pièce d’or.
Je croyais que Vitalis allait reconduire cette dame, mais il n’en fit rien, et quand elle se fut éloignée de quelques pas, je l’entendis murmurer à mi-voix deux ou trois jurons italiens.
— Mais elle a donné un louis à Capi, dis-je.
Je crus qu’il allait m’allonger une taloche ; cependant il arrêta sa main levée.
— Un louis, dit-il, comme s’il sortait d’un rêve, ah ! oui, c’est vrai, pauvre Joli-Cœur, je l’oubliais, allons le rejoindre.
Notre ménage fut vite fait, et nous ne tardâmes point à rentrer à l’auberge.
Je montai l’escalier le premier et j’entrai dans la chambre en courant ; le feu n’était pas éteint, mais il ne donnait plus de flamme.
J’allumai vivement une chandelle et je cherchai Joli-Cœur, surpris de ne pas l’entendre.
Il était couché sur sa couverture, tout de son long, il avait revêtu son uniforme de général, et il paraissait dormir.
Je me penchai sur lui pour lui prendre doucement la main sans le réveiller.
Cette main était froide.
À ce moment, Vitalis entrait dans la chambre.
Je me tournai vers lui.
— Joli-Cœur est froid !
Vitalis se pencha près de moi.
— Hélas ! dit-il, il est mort. Cela devait arriver. Vois-tu, Rémi, j’ai été coupable de t’enlever à madame Milligan. Je suis puni. Zerbino, Dolce. Aujourd’hui Joli-Cœur. Ce n’est pas la fin.
XVI
ENTRÉE À PARIS
Nous étions encore bien éloignés de Paris.
Il fallut nous mettre en route par les chemins couverts de neige et marcher du matin au soir, contre le vent du nord qui nous soufflait au visage.
Comme elles furent tristes ces longues étapes ! Vitalis marchait en tête, je venais derrière lui, et Capi marchait sur mes talons.
Nous avancions ainsi à la file sans échanger un seul mot durant des heures, le visage bleui par la bise, les pieds mouillés, l’estomac vide ; et les gens que nous croisions s’arrêtaient pour nous regarder défiler.
Évidemment des idées bizarres leur passaient par l’esprit : où donc ce grand vieillard conduisait-il cet enfant et ce chien ?
Le silence m’était extrêmement douloureux : j’aurais eu besoin de parler, de m’étourdir ; mais Vitalis ne me répondait que par quelques mots brefs, lorsque je lui adressais la parole, et encore sans se retourner.
Heureusement Capi était plus expansif, et souvent en marchant je sentais une langue humide et chaude se poser sur ma main ; c’était Capi qui me léchait pour me dire :
— Tu sais, je suis là, moi Capi, moi ton ami.
Et alors, je le caressais doucement sans m’arrêter.
Il paraissait aussi heureux de mon témoignage d’affection que je l’étais moi-même du sien ; nous nous comprenions, nous nous aimions.
Pour moi, c’était un soutien, et pour lui, j’en suis sûr, c’en était un aussi : le cœur d’un chien n’est pas moins sensible que celui d’un enfant.
Ces caresses consolaient si bien Capi, qu’elles lui faisaient, je crois, oublier quelquefois la mort de ses camarades ; la force de l’habitude reprenait le dessus, et tout à coup il s’arrêtait sur la route pour voir venir sa troupe, comme au temps où il en était le caporal, et où il devait fréquemment la passer en revue. Mais cela ne durait que quelques secondes ; la mémoire se réveillait en lui, et se rappelant brusquement pourquoi cette troupe ne venait pas, il nous dépassait rapidement, et regardait Vitalis en le prenant à témoin qu’il n’était pas en faute ; si Dolce, si Zerbino ne venaient pas, c’était qu’ils ne devaient plus venir. Il faisait cela avec des yeux si expressifs, si parlants, si pleins d’intelligence, que nous en avions le cœur serré.
Cela n’était pas de nature à égayer notre route, et cependant nous aurions eu bien besoin de distraction, moi au moins.
Partout sur la campagne s’étalait le blanc linceul de la neige ; point de soleil au ciel, mais un jour fauve et pâle ; point de mouvement dans les champs, point de paysans au travail ; point de hennissements de chevaux, point de beuglements de bœufs ; mais seulement le croassement des corneilles qui, perchées au plus haut des branches dénudées criaient la faim sans trouver sur la terre une place où descendre pour chercher quelques vers ; dans les villages point de maisons ouvertes, mais le silence et la solitude ; le froid est âpre, on reste au coin de l’âtre, ou bien l’on travaille dans les étables et les granges fermées.
Et nous sur la route raboteuse ou glissante nous allons droit devant nous, sans nous arrêter, et sans autre repos que le sommeil de la nuit dans une écurie ou dans une bergerie ; avec un morceau de pain bien mince, hélas ! pour notre repas du soir qui est à la fois notre dîner et notre souper : quand nous avons la bonne chance d’être envoyés à la bergerie nous nous trouvons heureux, la chaleur des moutons nous défendra contre le froid ; et puis c’est la saison où les brebis allaitent leurs agneaux et les bergers me permettent quelquefois de téter une brebis qui a beaucoup de lait : nous ne disons pas que nous mourons presque de faim, mais Vitalis, avec son adresse ordinaire, sait insinuer « que le petit aime beaucoup le lait de brebis, parce que dans son enfance il a été habitué à en boire, de sorte que ça lui rappelle son pays. » Cette fable ne réussit pas toujours. Mais c’est une bonne soirée quand elle est bien accueillie. Assurément oui, j’aime beaucoup le lait de brebis, et quand j’en ai bu je me sens le lendemain plus dispos et plus fort.
Les kilomètres s’ajoutèrent aux kilomètres, les étapes aux étapes ; nous approchâmes de Paris et quand même les bornes plantées le long de la route ne m’en auraient pas averti, je m’en serais aperçu à la circulation qui était devenue plus active, et aussi à la couleur de la neige couvrant le chemin qui était beaucoup plus sale que dans les plaines de la Champagne.
Chose étonnante, au moins pour moi, la campagne ne me parut pas plus belle, les villages ne furent pas autres que ceux que nous avions traversés quelques jours auparavant. J’avais tant de fois entendu parler des merveilles de Paris, que je m’étais naïvement figuré que ces merveilles devaient s’annoncer au loin par quelque chose d’extraordinaire. Je ne savais pas au juste ce que je devais attendre, et n’osais pas le demander, mais enfin j’attendais des prodiges : des arbres d’or, des rues bordées de palais de marbre, et dans ces rues des habitants vêtus d’habits de soie : cela m’eût paru tout naturel.
Si attentif que je fusse à chercher les arbres d’or, je remarquai néanmoins que les gens qui nous rencontraient ne nous regardaient plus : sans doute ils étaient trop pressés pour cela, ou bien ils étaient peut-être habitués à des spectacles autrement douloureux que celui que nous pouvions offrir.
Cela n’était guère rassurant.
Qu’allions-nous faire à Paris ? et surtout dans l’état de misère où nous nous trouvions ?
C’était la question que je me posais avec anxiété et qui bien souvent occupait mon esprit pendant ces longues marches.
J’aurais bien voulu interroger Vitalis, mais je n’osais pas, tant il se montrait sombre, et, dans ses communications, bref.
Un jour enfin il daigna prendre place à côté de moi, et, à la façon dont il me regarda, je sentis que j’allais apprendre ce que j’avais tant de fois désiré connaître.
C’était un matin, nous avions couché dans une ferme, à peu de distance d’un gros village, qui, disaient les plaques bleues de la route, se nommait Boissy-Saint-Léger. Nous étions partis de bonne heure, c’est-à-dire à l’aube, et après avoir longé les murs d’un parc, et traversé dans sa longueur ce village de Boissy-Saint-Léger, nous avions, du haut d’une côte, aperçu devant nous un grand nuage de vapeurs noires qui planaient au-dessus d’une ville immense, dont on ne distinguait que quelques monuments élevés.
J’ouvrais les yeux pour tâcher de me reconnaître au milieu de cette confusion de toits, de clochers, de tours, qui se perdaient dans des brumes et dans des fumées, quand Vitalis, ralentissant le pas, vint se placer près de moi.
— Voilà donc notre vie changée, me dit-il, comme s’il continuait une conversation entamée depuis longtemps déjà, dans quatre heures nous serons à Paris.
— Ah ! c’est Paris qui s’étend là-bas ?
— Mais sans doute.
Au moment même où Vitalis me disait que c’était Paris que nous avions devant nous, un rayon de lumière se dégagea du ciel, et j’aperçus rapide comme un éclair, un miroitement doré.
Décidément je ne m’étais pas trompé ; j’allais trouver des arbres d’or.
Vitalis continua :
— À Paris nous allons nous séparer.
Instantanément la nuit se fit, je ne vis plus les arbres d’or.
Je tournai les yeux vers Vitalis. Lui-même me regarda, et la pâleur de mon visage, le tremblement de mes lèvres, lui dirent ce qui se passait en moi.
— Te voilà inquiet, dit-il, peiné aussi je crois bien.
— Nous séparer ! dis-je enfin après que le premier moment du saisissement fut passé.
— Pauvre petit !
Ce mot et surtout le ton dont il fut prononcé me firent monter les larmes aux yeux : il y avait si longtemps que je n’avais entendu une parole de sympathie.
— Ah ! vous êtes bon, m’écriai-je.
— C’est toi qui es bon, un bon garçon, un brave petit cœur. Vois-tu, il y a des moments dans la vie où l’on est disposé à reconnaître ces choses-là et à se laisser attendrir. Quand tout va bien, on suit son chemin sans trop penser à ceux qui vous accompagnent, mais quand tout va mal, quand on se sent dans une mauvaise voie, surtout quand on est vieux, c’est-à-dire sans foi dans le lendemain, on a besoin de s’appuyer sur ceux qui vous entourent et on est heureux de les trouver près de soi. Que moi je m’appuie sur toi, cela te paraît étonnant, n’est-ce pas vrai ? Et pourtant cela est ainsi. Et rien que par cela que tu as les yeux humides en m’écoutant, je me sens soulagé. Car moi aussi, mon petit Rémi, j’ai de la peine.
C’est seulement plus tard, quand j’ai eu quelqu’un à aimer, que j’ai senti et éprouvé la justesse de ces paroles.
— Le malheur est, continua Vitalis, qu’il faille toujours se séparer précisément à l’heure où l’on voudrait au contraire se rapprocher.
— Mais, dis-je timidement, vous ne voulez pas m’abandonner dans Paris ?
— Non, certes ; je ne veux pas t’abandonner, crois-le bien. Que ferais-tu à Paris, tout seul, pauvre garçon ? Et puis, je n’ai pas le droit de t’abandonner, dis-toi bien cela. Le jour où je n’ai pas voulu te remettre aux soins de cette brave dame qui voulait se charger de toi et t’élever comme son fils, j’ai contracté l’obligation de t’élever moi-même de mon mieux. Par malheur, les circonstances me sont contraires. Je ne puis rien pour toi en ce moment, et voilà pourquoi je pense à nous séparer, non pour toujours, mais pour quelques mois, afin que nous puissions vivre chacun de notre côté pendant les derniers mois de la mauvaise saison. Nous allons arriver à Paris dans quelques heures. Que veux-tu que nous y fassions avec une troupe réduite au seul Capi ?
En entendant prononcer son nom, le chien vint se camper devant nous, et, ayant porté la main à son oreille pour faire le salut militaire, il la posa sur son cœur comme s’il voulait nous dire que nous pouvions compter sur son dévouement.
Dans la situation où nous nous trouvions, cela ne calma pas notre émotion.
Vitalis s’arrêta un moment pour lui passer la main sur la tête.
— Toi aussi, dit-il, tu es un brave chien ; mais, hélas ! on ne vit pas de bonté dans le monde ; il en faut pour le bonheur de ceux qui nous entourent, mais il faut aussi autre chose, et cela nous ne l’avons point. Que veux-tu que nous fassions avec le seul Capi ? Tu comprends bien, n’est-ce pas, que nous ne pouvons pas maintenant donner des représentations.
— Il est vrai.
— Les gamins se moqueraient de nous, nous jetteraient des trognons de pommes et nous ne ferions pas vingt sous de recette par jour ; veux-tu que nous vivions tous les trois avec vingt sous qui par les journées de pluie, de neige ou de grand froid se réduiront à rien ?
— Mais ma harpe ?
— Si j’avais deux enfants comme toi, cela irait peut-être, mais un vieux comme moi avec un enfant de ton âge, c’est une mauvaise affaire. Je ne suis pas encore assez vieux. Si j’étais plus cassé, ou bien si j’étais aveugle… Mais par malheur je suis ce que je suis, c’est-à-dire non en état d’inspirer la pitié, et à Paris pour émouvoir la compassion des gens pressés qui vont à leurs affaires il faut être dans un état bien lamentable. Encore faut-il n’avoir pas honte de faire appel à la charité publique, et cela je ne le pourrais jamais. Il nous faut autre chose. Voici donc à quoi j’ai pensé, et ce que j’ai décidé. Je te donnerai jusqu’à la fin de l’hiver à un padrone qui t’enrôlera avec d’autres enfants pour jouer de la harpe.
En parlant de ma harpe, ce n’était pas à une pareille conclusion que j’avais songé.
Vitalis ne me laissa pas le temps d’interrompre.
— Pour moi, dit-il en poursuivant, je donnerai des leçons de harpe, de piva, de violon aux enfants italiens qui travaillent dans les rues de Paris. Je suis connu dans Paris, où je suis resté plusieurs fois, et d’où je venais quand je suis arrivé dans ton village ; je n’ai qu’à demander des leçons pour en trouver plus que je n’en puis donner. Nous vivrons, mais chacun de notre côté. Puis en même temps que je donnerai mes leçons, je m’occuperai à instruire deux chiens pour remplacer Zerbino et Dolce. Je pousserai leur éducation, et au printemps nous pourrons nous remettre en route tous les deux, mon petit Rémi, pour ne plus nous quitter, car la fortune n’est pas toujours mauvaise à ceux qui ont le courage de lutter. C’est justement du courage que je te demande en ce moment, et aussi de la résignation. Plus tard, les choses iront mieux : ce n’est qu’un moment à passer. Au printemps nous reprendrons notre existence libre. Je te conduirai en Allemagne, en Angleterre. Voilà que tu deviens plus grand et que ton esprit s’ouvre. Je t’apprendrai bien des choses et je ferai de toi un homme. J’ai pris cet engagement devant madame Milligan. Je le tiendrai. C’est en vue de ces voyages que j’ai déjà commencé à t’apprendre l’anglais ; le français, l’italien, c’est déjà quelque chose pour un enfant de ton âge ; sans compter que te voilà vigoureux. Tu verras, mon petit Rémi, tu verras, tout n’est pas perdu.
Cette combinaison était peut-être ce qui convenait le mieux à notre condition présente. Et quand maintenant j’y songe, je reconnais que mon maître avait fait le possible pour sortir de notre fâcheuse situation. Mais les pensées de la réflexion ne sont pas les mêmes que celles du premier mouvement.
Dans ce qu’il me disait je ne voyais que deux choses :
Notre séparation.
Et le padrone.
Dans nos courses à travers les villages et les villes j’en avais rencontré plusieurs, de ces padrones qui mènent les enfants qu’ils ont engagés deci delà, à coups de bâton.
Ils ne ressemblaient en rien à Vitalis, durs, injustes, exigeants, ivrognes, l’injure et la grossièreté à la bouche, la main toujours levée.
Je pouvais tomber sur un de ces terribles patrons.
Et puis, quand même le hasard m’en donnerait un bon, c’était encore un changement.
Après ma nourrice, Vitalis.
Après Vitalis, un autre.
Est-ce que ce serait toujours ainsi ?
Est-ce que je ne trouverais jamais personne à aimer pour toujours ?
Peu à peu j’en étais venu à m’attacher à Vitalis comme à un père.
Je n’aurai donc jamais de père.
Jamais de famille.
Toujours seul au monde.
Toujours perdu sur cette vaste terre, où je ne pouvais me fixer nulle part.
J’aurais eu bien des choses à répondre, et les paroles me montaient du cœur aux lèvres, mais je les refoulai.
Mon maître m’avait demandé du courage et de la résignation, je voulais lui obéir et ne pas augmenter son chagrin.
Déjà, d’ailleurs, il n’était plus à mes côtés, et comme s’il avait peur d’entendre ce qu’il prévoyait que j’allais répondre, il avait repris sa marche à quelques pas en avant.
Je le suivis, et nous ne tardâmes pas à arriver à une rivière que nous traversâmes sur un pont boueux, comme je n’en avais jamais vu ; la neige, noire comme du charbon pilé, recouvrait la chaussée d’une couche mouvante dans laquelle on enfonçait jusqu’à la cheville.
Au bout de ce pont se trouvait un village aux rues étroites, puis, après ce village, la campagne recommençait, mais non la campagne encombrée de maisons à l’aspect misérable.
Sur la route les voitures se suivaient et se croisaient maintenant sans interruption. Je me rapprochai de Vitalis et marchai à sa droite, tandis que Capi se tenait le nez sur nos talons.
Bientôt la campagne cessa et nous nous trouvâmes dans une rue dont on ne voyait pas le bout ; de chaque côté, au loin, des maisons, mais pauvres, sales, et bien moins belles que celles de Bordeaux, de Toulouse et de Lyon.
La neige avait été mise en tas de place en place, et sur ces tas noirs et durs on avait jeté des cendres, des légumes pourris, des ordures de toute sorte, l’air était chargé d’odeurs fétides, les enfants qui jouaient devant les portes avaient la mine pâle ; à chaque instant passaient de lourdes voitures qu’ils évitaient avec beaucoup d’adresse et sans paraître en prendre souci.
— Où donc sommes-nous ? demandai-je à Vitalis.
— À Paris, mon garçon.
— À Paris !…
Était-ce possible, c’était là Paris.
Où donc étaient mes maisons de marbre ?
Où donc étaient mes passants vêtus d’habits de soie ?
Comme la réalité était laide et misérable !
C’était là ce Paris que j’avais si vivement souhaité voir.
C’était là que j’allais passer l’hiver, séparé de Vitalis… et de Capi.
XVII
UN PADRONE DE LA RUE DE LOURCINE
Bien que tout ce qui nous entourait me parût horrible, j’ouvris les yeux et j’oubliai presque la gravité de ma situation pour regarder autour de moi.
Plus nous avancions dans Paris, moins ce que j’apercevais répondait à mes rêveries enfantines et à mes espérances imaginatives : les ruisseaux gelés exhalaient une odeur de plus en plus infecte ; la boue, mêlée de neige et de glaçons, était de plus en plus noire, et là où elle était liquide, elle sautait sous les roues des voitures en plaques épaisses qui allaient se coller contre les devantures et les vitres des maisons occupées par des boutiques pauvres et malpropres.
Décidément, Paris ne valait pas Bordeaux.
Après avoir marché assez longtemps dans une large rue moins misérable que celles que nous venions de traverser, et où les boutiques devenaient plus grandes et plus belles à mesure que nous descendions, Vitalis tourna à droite, et bientôt nous nous trouvâmes dans un quartier tout à fait misérable : les maisons hautes et noires semblaient se rejoindre par le haut ; le ruisseau non gelé coulait au milieu de la rue, et sans souci des eaux puantes qu’il roulait, une foule compacte piétinait sur le pavé gras. Jamais je n’avais vu des figures aussi pâles que celles des gens qui composaient cette foule ; jamais non plus je n’avais vu hardiesse pareille à celle des enfants qui allaient et venaient au milieu des passants ; dans des cabarets, qui étaient nombreux, il y avait des hommes et des femmes qui buvaient debout devant des comptoirs d’étain en criant très-fort.
Au coin d’une maison je lus le nom de la rue de Lourcine.
Vitalis, qui paraissait savoir où il allait, écartait doucement les groupes qui gênaient son passage, et je le suivais de près.
— Prends garde de me perdre, m’avait-il dit.
Mais la recommandation était inutile, je marchais sur ses talons, et pour plus de sûreté, je tenais dans ma main un des coins de sa veste.
Après avoir traversé une grande cour et un passage, nous arrivâmes dans une sorte de puits sombre et verdâtre où assurément le soleil n’avait jamais pénétré. Cela était encore plus laid et plus effrayant que tout ce que j’avais vu jusqu’alors.
— Garofoli est-il chez lui ? demanda Vitalis à un homme qui accrochait des chiffons contre la muraille, en s’éclairant d’une lanterne.
— Je ne sais pas, montez voir vous-même : vous savez où, au haut de l’escalier, la porte en face.
— Garofoli est le padrone dont je t’ai parlé, me dit-il en montant l’escalier dont les marches couvertes d’une croûte de terre étaient glissantes comme si elles eussent été creusées dans une glaise humide : c’est ici qu’il demeure.
La rue, la maison, l’escalier, n’étaient pas de nature à me remonter le cœur. Que serait le maître ?
L’escalier avait quatre étages ; Vitalis, sans frapper, poussa la porte qui faisait face au palier, et nous nous trouvâmes dans une large pièce, une sorte de vaste grenier. Au milieu un grand espace vide, et tout autour une douzaine de lits. Les murs et le plafond étaient d’une couleur indéfinissable ; autrefois ils avaient été blancs, mais la fumée, la poussière, les saletés de toute sorte avaient noirci le plâtre qui, par places, était creusé ou troué ; à côté d’une tête dessinée au charbon, on avait sculpté des fleurs et des oiseaux.
— Garofoli, dit Vitalis en entrant, êtes-vous dans quelque coin ? je ne vois personne ; répondez-moi, je vous prie ; c’est Vitalis qui vous parle.
En effet, la chambre paraissait déserte autant qu’on en pouvait juger par la clarté d’un quinquet accroché à la muraille, mais à la voix de mon maître une voix faible et dolente, une voix d’enfant répondit :
— Le signor Garofoli est sorti ; il ne rentrera que dans deux heures.
En même temps celui qui nous avait répondu se montra : c’était un enfant d’une dizaine d’années ; il s’avança vers nous en se traînant, et je fus si vivement frappé de son aspect étrange que je le vois encore devant moi ; il n’avait pour ainsi dire pas de corps et sa tête grosse et disproportionnée semblait immédiatement posée sur ses jambes, comme dans ces dessins comiques qui ont été à la mode il y a quelques années ; cette tête avait une expression profonde de douleur et de douceur, avec la résignation dans les yeux et la désespérance dans sa physionomie générale. Ainsi bâti, il ne pouvait pas être beau, cependant il attirait le regard et le retenait par la sympathie et un certain charme qui se dégageait de ses grands yeux mouillés et tendres comme ceux d’un chien, et de ses lèvres parlantes.
— Es-tu bien certain qu’il reviendra dans deux heures ? demanda Vitalis.
— Bien certain, signor ; c’est le moment du dîner et jamais personne autre que lui ne sert le dîner.
— Eh bien, s’il rentre avant, tu lui diras que Vitalis reviendra dans deux heures.
— Dans deux heures, oui, signor.
Je me disposais à suivre mon maître lorsque celui-ci m’arrêta.
— Reste ici, dit-il, tu te reposeras ; je reviendrai.
Et comme j’avais fait un mouvement d’effroi.
— Je t’assure que je reviendrai.
J’aurais mieux aimé, malgré ma fatigue, suivre Vitalis, mais quand il avait commandé j’avais l’habitude d’obéir ; je restai donc.
Lorsqu’on n’entendit plus le bruit des pas lourds de mon maître dans l’escalier, l’enfant qui avait écouté, l’oreille penchée vers la porte, se retourna vers moi.
— Vous êtes du pays ? me dit-il en italien.
Depuis que j’étais avec Vitalis j’avais appris assez d’italien pour comprendre à peu près tout ce qui se disait en cette langue, mais je ne la parlais pas encore assez bien pour m’en servir volontiers.
— Non, répondis-je en français.
— Ah ! fit-il tristement en fixant sur moi ses grands yeux, tant pis, j’aurais aimé que vous fussiez du pays.
— De quel pays ?
— De Lucca ; vous m’auriez peut-être donné des nouvelles.
— Je suis Français.
— Ah ! tant mieux.
— Vous aimez mieux les Français que les Italiens ?
— Non, et ce n’est pas pour moi que je dis tant mieux, c’est pour vous ; parce que si vous étiez Italien, vous viendriez ici probablement pour être au service du signor Garofoli ; et l’on ne dit pas tant mieux à ceux qui entrent au service du signor padrone.
Ces paroles n’étaient pas de nature à me rassurer.
— Il est méchant ?
L’enfant ne répondit pas à cette interrogation directe, mais le regard qu’il fixa sur moi fut d’une effrayante éloquence. Puis, comme s’il ne voulait pas continuer une conversation sur ce sujet, il me tourna le dos et se dirigea vers une grande cheminée qui occupait l’extrémité de la pièce.
Un bon feu de bois de démolition brûlait dans cette cheminée, et devant ce feu bouillait une grande marmite en fonte.
Je m’approchai alors de la cheminée pour me chauffer, et je remarquai que cette marmite avait quelque chose de particulier que tout d’abord je n’avais pas vu. Le couvercle, surmonté d’un tube étroit par lequel s’échappait la vapeur, était fixé à la marmite, d’un côté par une charnière, et d’un autre par un cadenas.
J’avais compris que je ne devais pas faire de questions indiscrètes sur Garofoli, mais sur la marmite ?…
— Pourquoi donc est-elle fermée au cadenas ?
— Pour que je ne puisse pas prendre une tasse de bouillon. C’est moi qui suis chargé de faire la soupe, mais le maître n’a pas confiance en moi.
Je ne pus m’empêcher de sourire.
— Vous riez, continua-t-il tristement, parce que vous croyez que je suis gourmand. À ma place vous le seriez peut-être tout autant. Il est vrai que ce n’est pas gourmand que je suis, mais affamé, et l’odeur de la soupe qui s’échappe par ce tube me rend ma faim plus cruelle encore.
— Le signor Garofoli vous laisse donc mourir de faim ?
— Si vous entrez ici, à son service, vous saurez qu’on ne meurt pas de faim, seulement on en souffre. Moi surtout, parce que c’est une punition.
— Une punition ! mourir de faim.
— Oui ; au surplus, je peux vous conter ça ; si Garofoli devient votre maître, mon exemple pourra vous servir. Le signor Garofoli est mon oncle et il m’a pris avec lui par charité. Il faut vous dire que ma mère est veuve, et, comme vous pensez bien, elle n’est pas riche. Quand Garofoli vint au pays l’année dernière pour prendre des enfants, il proposa à ma mère de m’emmener. Ça lui coûtait à ma mère, de me laisser aller ; mais vous savez, quand il le faut ; et il le fallait, parce que nous étions six enfants à la maison et que j’étais l’aîné. Garofoli aurait mieux aimé prendre avec lui mon frère Leonardo qui vient après moi, parce que Leonardo est beau, tandis que moi je suis laid. Et pour gagner de l’argent, il ne faut pas être laid ; ceux qui sont laids ne gagnent que des coups ou des mauvaises paroles. Mais ma mère ne voulut pas donner Leonardo : « C’est Mattia qui est l’aîné, dit-elle, c’est à Mattia de partir, puisqu’il faut qu’il en parte un ; c’est le bon Dieu qui l’a désigné, je n’ose pas changer la règle du bon Dieu. » Me voilà donc parti avec mon oncle Garofoli ; vous pensez que ç’a été dur de quitter la maison, ma mère qui pleurait, ma petite sœur Christina, qui m’aimait bien parce qu’elle était la dernière et que je la portais toujours dans mes bras ; et puis aussi mes frères, mes camarades et le pays.
Je savais ce qu’il y avait de dur dans ces séparations, et je n’avais pas oublié le serrement de cœur qui m’avait étouffé quand pour la dernière fois j’avais aperçu la coiffe blanche de mère Barberin.
Le petit Mattia continua son récit :
— J’étais tout seul avec Garofoli, continua Mattia, en quittant la maison, mais au bout de huit jours nous étions une douzaine, et l’on se mit en route pour la France. Ah ! elle a été bien longue la route pour moi et pour les camarades, qui eux aussi étaient tristes. Enfin, on arriva à Paris ; nous n’étions plus que onze parce qu’il y en avait un qui était resté à l’hôpital de Dijon. À Paris on fit un choix parmi nous ; ceux qui étaient forts furent placés chez des fumistes ou des maîtres ramoneurs ; ceux qui n’étaient pas assez solides pour un métier allèrent chanter ou jouer de la vielle dans les rues. Bien entendu, je n’étais pas assez fort pour travailler, et il paraît que j’étais trop laid pour faire de bonnes journées en jouant de la vielle. Alors Garofoli me donna deux petites souris blanches que je devais montrer sous les portes, dans les passages, et il taxa ma journée à trente sous. « Autant de sous qui te manqueront le soir, me dit-il, autant de coups de bâton pour toi. » Trente sous, c’est dur à ramasser ; mais les coups de bâton, c’est dur aussi à recevoir, surtout quand c’est Garofoli qui les administre. Je faisais donc tout ce que je pouvais pour ramasser ma somme ; mais, malgré ma peine, je n’y parvenais pas souvent. Presque toujours mes camarades avaient leurs sous en rentrant ; moi, je ne les avais presque jamais. Cela redoublait la colère de Garofoli. « Comment donc s’y prend cet imbécile de Mattia ? » disait-il. Il y avait un autre enfant qui, comme moi, montrait des souris blanches et qui avait été taxé à quarante sous, que tous les soirs il rapportait. Plusieurs fois, je sortis avec lui pour voir comment il s’y prenait et par où il était plus adroit que moi. Alors je compris pourquoi il obtenait si facilement les quarante sous et moi si difficilement mes trente. Quand un monsieur et une dame nous donnaient, la dame disait toujours : « À celui qui est gentil, pas à celui qui est si laid. » Celui qui était laid, c’était moi. Je ne sortis plus avec mon camarade, parce que si c’est triste de recevoir des coups de bâton à la maison, c’est encore plus triste de recevoir des mauvaises paroles dans la rue, devant tout le monde. Vous ne savez pas cela, vous, parce qu’on ne vous a jamais dit que vous étiez laid ; mais moi… Enfin, Garofoli voyant que les coups n’y faisaient rien, employa un autre moyen. « Pour chaque sou qui te manquera, je te retiendrai une pomme de terre à ton souper, me dit-il. Puisque ta peau est dure aux coups, ton estomac sera peut-être tendre à la faim. » Est-ce que les menaces vous ont jamais fait faire quelque chose, vous ?
— Dame, c’est selon.
— Moi, jamais ; d’ailleurs je ne pouvais faire plus que ce que j’avais fait jusque-là ; et je ne pouvais pas dire à ceux à qui je tendais la main : « Si vous ne me donnez pas un sou, je n’aurai pas de pommes de terre ce soir ». Les gens qui donnent aux enfants ne se décident pas par ces raisons-là.
— Et par quelles raisons se décident-ils ? on donne pour faire plaisir.
— Ah bien ! vous êtes encore jeune, vous ; on donne pour se faire plaisir à soi-même et non aux autres ; on donne à un enfant parce qu’il est gentil, et ça c’est la meilleure des raisons ; on lui donne pour l’enfant qu’on a perdu ou bien pour l’enfant qu’on désire ; on lui donne parce qu’on a bien chaud, tandis que lui tremble de froid sous une porte cochère. Oh ! je connais toutes ces manières-là ; j’ai eu le temps de les étudier ; tenez, il fait froid aujourd’hui, n’est-ce pas ?
— Très-froid.
— Eh bien ! allez vous mettre sous une porte et tendez la main à un monsieur que vous verrez venir rapidement tassé dans un petit paletot, vous me direz ce qu’il vous donnera ; tendez-la, au contraire, à un monsieur qui marchera doucement, enveloppé dans un gros pardessus ou dans des fourrures, et vous aurez peut-être une pièce blanche. Après un mois ou six semaines de ce régime-là, je n’avais pas engraissé ; j’étais devenu pâle, si pâle, que souvent j’entendais dire autour de moi : « Voilà un enfant qui va mourir de faim. » Alors la souffrance fit ce que la beauté n’avait pas voulu faire : elle me rendit intéressant et me donna des yeux ; les gens du quartier me prirent en pitié, et si je ne ramassais pas beaucoup plus de sous, je ramassai tantôt un morceau de pain, tantôt une soupe. Ce fut mon bon temps ; je n’avais plus de coups de bâton, et si j’étais privé de pommes de terre au souper, cela m’importait peu quand j’avais eu quelque chose pour mon dîner. Mais un jour Garofoli me vit chez une fruitière mangeant une assiettée de soupe, et il comprit pourquoi je supportais sans me plaindre la privation des pommes de terre. Alors il décida que je ne sortirais plus et que je resterais à la chambrée pour préparer la soupe et faire le ménage. Mais comme en préparant la soupe je pouvais en manger, il inventa cette marmite : tous les matins avant de sortir, il met dans la marmite la viande et des légumes, il ferme le couvercle au cadenas, et je n’ai plus qu’à faire bouillir le pot ; je sens l’odeur du bouillon, et c’est tout ; quant à en prendre, vous comprenez que par ce petit tube si étroit c’est impossible. C’est depuis que je suis à la cuisine que je suis devenu si pâle ; l’odeur du bouillon, ça ne nourrit pas, ça augmente la faim, voilà tout. Est-ce que je suis bien pâle ? Comme je ne sors plus, je ne l’entends pas dire, et il n’y a pas de miroir ici.
Je n’étais pas alors un esprit très-expérimenté, cependant je savais qu’il ne faut pas effrayer ceux qui sont malades en leur disant qu’on les trouve malades.
— Vous ne me paraissez pas plus pâle qu’un autre, répondis-je.
— Je vois bien que vous me dites ça pour me rassurer, mais cela me ferait plaisir d’être très-pâle, parce que cela signifierait que je suis très-malade et je voudrais être tout à fait malade.
Je le regardai avec stupéfaction.
— Vous ne me comprenez pas, dit-il, avec un sourire, c’est pourtant bien simple. Quand on est très-malade on vous soigne ou on vous laisse mourir. Si on me laisse mourir ça sera fini, je n’aurai plus faim, je n’aurai plus de coups ; et puis l’on dit que ceux qui sont morts vivent dans le ciel ; alors de dedans le ciel je verrais maman là-bas, au pays, et en parlant au bon Dieu je pourrais peut-être empêcher ma sœur Christina d’être malheureuse : en le priant bien. Si au contraire on me soigne, on m’enverra à l’hôpital et je serais content d’aller à l’hôpital.
J’avais l’effroi instinctif de l’hôpital et bien souvent en chemin, quand accablé de fatigue je m’étais senti malaise, je n’avais eu qu’à penser à l’hôpital pour me retrouver aussitôt disposé à marcher ; je fus étonné d’entendre Mattia parler ainsi :
— Si vous saviez comme on est bien à l’hôpital, dit-il, en continuant ; j’y ai déjà été, à Sainte-Eugénie ; il y a là un médecin, un grand blond, qui a toujours du sucre d’orge dans sa poche, c’est du cassé parce que le cassé coûte moins cher, mais il n’en est pas moins bon pour cela : et puis les sœurs vous parlent doucement : « Fais cela, mon petit ; tire la langue, pauvre petit. » Moi j’aime qu’on me parle doucement, ça me donne envie de pleurer ; et quand j’ai envie de pleurer ça me rend tout heureux. C’est bête, n’est-ce pas ? Mais maman me parlait toujours doucement. Les sœurs parlent comme parlait maman, et si ce n’est pas les mêmes paroles, c’est la même musique. Et puis, quand on commence à être mieux, du bon bouillon, du vin. Quand j’ai commencé à me sentir sans forces ici, parce que je ne mangeais pas, j’ai été content ; je me suis dit : « Je vais être malade et Garofoli m’enverra à l’hôpital. » Ah ! bien oui, malade ; assez malade pour souffrir moi-même, mais pas assez pour gêner Garofoli ; alors il m’a gardé. C’est étonnant comme les malheureux ont la vie dure. Par bonheur, Garofoli n’a pas perdu l’habitude de m’administrer des corrections, à moi comme aux autres il faut dire, si bien qu’il y a huit jours il m’a donné un bon coup de bâton sur la tête. Pour cette fois j’espère que l’affaire est dans le sac ; j’ai la tête enflée ; vous voyez bien là cette grosse bosse blanche, il disait hier que c’était peut-être une tumeur ; je ne sais pas ce que c’est qu’une tumeur, mais à la façon dont il en parlait, je crois que c’est grave ; toujours est-il que je souffre beaucoup ; j’ai des élancements sous les cheveux plus douloureux que dans des crises de dents ; ma tête est lourde comme si elle pesait cent livres ; j’ai des éblouissements, des étourdissements, et la nuit, en dormant, je ne peux m’empêcher de gémir et de crier. Alors je crois que d’ici deux ou trois jours cela va le décider à m’envoyer à l’hôpital ; parce que, vous comprenez, un moutard qui crie la nuit, ça gêne les autres, et Garofoli n’aime pas à être gêné. Quel bonheur qu’il m’ait donné ce coup de bâton ! Voyons, là, franchement, est-ce que je suis bien pâle ?
Disant cela il vint se placer en face de moi et me regarda les yeux dans les yeux. Je n’avais plus les mêmes raisons pour me taire, cependant je n’osais pas répondre sincèrement et lui dire quelle sensation effrayante me produisaient ses grands yeux brûlants, ses joues caves et ses lèvres décolorées.
— Je crois que vous êtes assez malade pour entrer à l’hôpital.
— Enfin !
Et de sa jambe traînante, il essaya une révérence. Mais presque aussitôt, se dirigeant vers la table il commença à l’essuyer.
— Assez causé, dit-il, Garofoli va rentrer et rien ne serait prêt ; puisque vous trouvez que j’ai ce qu’il me faut de coups pour entrer à l’hospice, ce n’est plus la peine d’en récolter de nouveaux : ceux-là seraient perdus ; et maintenant ceux que je reçois me paraissent plus durs que ceux que je recevais il y a quelques mois. Ils sont bons, n’est-ce pas, ceux qui disent qu’on s’habitue à tout.
Tout en parlant il allait clopin-clopant, autour de la table, mettant les assiettes et les couverts en place. Je comptai vingt assiettes, c’était donc vingt enfants que Garofoli avait sous sa direction ; comme je ne voyais que douze lits on devait coucher deux ensemble. Quels lits ! pas de draps, mais des couvertures rousses qui devaient avoir été achetées dans une écurie, alors qu’elles n’étaient plus assez chaudes pour les chevaux.
— Est-ce que c’est partout comme ici ? dis-je épouvanté.
— Où, partout ?
— Partout chez ceux qui ont des enfants.
— Je ne sais pas, je ne suis jamais allé ailleurs ; seulement, vous, tâchez d’aller ailleurs.
— Où cela ?
— Je ne sais pas ; n’importe où, vous serez mieux qu’ici.
N’importe où ; c’était vague ; et dans tous les cas comment m’y prendre pour changer la décision de Vitalis ?
Comme je réfléchissais sans rien trouver bien entendu, la porte s’ouvrit et un enfant entra ; il tenait un violon sous son bras, et dans sa main libre, il portait un gros morceau de bois de démolition. Ce morceau, pareil à ceux que j’avais vu mettre dans la cheminée, me fit comprendre où Garofoli prenait sa provision, et le prix qu’elle lui coûtait.
— Donne-moi ton morceau de bois, dit Mattia en allant au-devant du nouveau venu.
Mais celui-ci, au lieu de donner ce morceau de bois à son camarade, le passa derrière son dos.
— Ah ! mais non, dit-il.
— Donne, la soupe sera meilleure.
— Si tu crois que je l’ai apporté pour la soupe : je n’ai que trente-six sous, je compte sur lui pour que Garofoli ne me fasse pas payer trop cher les quatre sous qui me manquent.
— Il n’y a pas de morceau qui tienne ; tu les payeras, va ; chacun son tour.
Mattia dit cela méchamment, comme s’il était heureux de la correction qui attendait son camarade. Je fus surpris de cet éclair de dureté dans une figure si douce ; c’est plus tard seulement que j’ai compris qu’à vivre avec les méchants on peut devenir méchant soi-même.
C’était l’heure de la rentrée de tous les élèves de Garofoli ; après l’enfant au morceau de bois il en arriva un autre, puis après celui-là dix autres encore. Chacun en entrant allait accrocher son instrument à un clou au-dessus de son lit ; celui-ci un violon, celui-là une harpe, un autre une flûte, ou une piva ; ceux qui n’étaient pas musiciens mais simplement montreurs de bêtes fourraient dans une cage leurs marmottes ou leurs cochons de Barbarie.
Un pas plus lourd résonna dans l’escalier, je sentis que c’était Garofoli ; et je vis entrer un petit homme à figure fiévreuse, à démarche hésitante ; il ne portait point le costume italien, mais il était habillé d’un paletot gris.
Son premier coup d’œil fut pour moi, un coup d’œil qui me fit froid au cœur.
— Qu’est-ce que c’est que ce garçon ? dit-il.
Mattia lui répondit vivement et poliment en lui donnant les explications dont Vitalis l’avait chargé.
— Ah ! Vitalis est à Paris, dit-il, que me veut-il ?
— Je ne sais pas, répondit Mattia.
— Ce n’est pas à toi que je parle, c’est à ce garçon.
— Le padrone va venir, dis-je, sans oser répondre franchement, il vous expliquera lui-même ce qu’il désire.
— Voilà un petit qui connaît le prix des paroles ; tu n’es pas Italien ?
— Non, je suis Français.
Deux enfants s’étaient approchés de Garofoli aussitôt qu’il était entré, et tous deux se tenaient près de lui attendant qu’il eût fini de parler. Que lui voulaient-ils ? J’eus bientôt réponse à cette question que je me posais avec curiosité.
L’un lui prit son feutre et alla le placer délicatement sur un lit, l’autre lui approcha aussitôt une chaise ; à la gravité, au respect avec lesquels ils accomplissaient ces actes si simples de la vie, on eût dit deux enfants de chœur s’empressant religieusement autour de l’officiant ; par là je vis à quel point Garofoli était craint, car assurément ce n’était pas la tendresse qui les faisait agir ainsi et s’empresser.
Lorsque Garofoli fut assis, un autre enfant lui apporta vivement une pipe bourrée de tabac et en même temps un quatrième lui présenta une allumette allumée.
— Elle sent le soufre, animal ! cria-t-il lorsqu’il l’eut approchée de sa pipe ; et il la jeta dans la cheminée.
Le coupable s’empressa de réparer sa faute en allumant une nouvelle allumette qu’il laissa brûler assez longtemps avant de l’offrir à son maître.
Mais celui-ci ne l’accepta pas.
— Pas toi, imbécile, dit-il en le repoussant durement, — puis se tournant vers un autre enfant avec un sourire qui certainement était une insigne faveur :
— Riccardo, une allumette, mon mignon ?
Et le mignon s’empressa d’obéir.
— Maintenant, dit Garofoli lorsqu’il fut installé et que sa pipe commença à brûler, à nos comptes, mes petits anges ; Mattia, le livre ?
C’était vraiment grande bonté à Garofoli de daigner parler, car ses élèves épiaient si attentivement ses désirs ou ses intentions, qu’ils les devinaient avant que celui-ci les exprimât.
Il n’avait pas demandé son livre de comptes que Mattia posait devant lui un petit registre crasseux.
Garofoli fit un signe et l’enfant qui lui avait présenté l’allumette non désoufrée s’approcha.
— Tu me dois un sou d’hier, tu m’as promis de me le rendre aujourd’hui, combien m’apportes-tu ?
L’enfant hésita longtemps avant de répondre ; il était pourpre.
— Il me manque un sou.
— Ah ! il te manque ton sou, et tu me dis cela tranquillement.
— Ce n’est pas le sou d’hier, c’est un sou pour aujourd’hui.
— Alors c’est deux sous ? tu sais que je n’ai jamais vu ton pareil.
— Ce n’est pas ma faute.
— Pas de niaiseries, tu connais la règle : défais ta veste, deux coups pour hier, deux coups pour aujourd’hui ; et en plus pas de pommes de terre pour ton audace ; Riccardo, mon mignon, tu as bien gagné cette récréation par ta gentillesse ; prends les lanières.
Riccardo était l’enfant qui avait apporté la bonne allumette avec tant d’empressement ; il décrocha de la muraille un fouet à manche court se terminant par deux lanières en cuir avec de gros nœuds. Pendant ce temps, celui auquel il manquait un sou défaisait sa veste et laissait tomber sa chemise de manière à être nu jusqu’à la ceinture.
— Attends un peu, dit Garofoli avec un mauvais sourire, tu ne seras peut-être pas seul, et c’est toujours un plaisir d’avoir de la compagnie, et puis Riccardo n’aura pas besoin de s’y reprendre à plusieurs reprises.
Debout devant leur maître, les enfants se tenaient immobiles ; à cette plaisanterie cruelle, ils se mirent tous ensemble à rire d’un rire forcé.
— Celui qui a ri le plus fort, dit Garofoli, est, j’en suis certain, celui auquel il manque le plus. Qui a ri fort ?
Tous désignèrent celui qui était arrivé le premier apportant un morceau de bois.
— Allons, toi, combien te manque-t-il ? demanda Garofoli.
— Ce n’est pas ma faute.
— Désormais, celui qui répondra : « ce n’est pas ma faute, » recevra un coup de lanière en plus de ce qui lui est dû ; combien te manque-t-il ?
— J’ai apporté un morceau de bois, ce beau morceau-là ?
— Ça c’est quelque chose ; mais va chez le boulanger et demande-lui du pain en échange de ton morceau de bois, t’en donnera-t-il ? Combien te manque-t-il de sous ; voyons, parle donc.
— J’ai fait trente-six sous.
— Il te manque quatre sous, misérable gredin, quatre sous ! et tu reparais devant moi ! Riccardo, tu es un heureux coquin, mon mignon, tu vas bien t’amuser : bas la veste !
— Mais, le morceau de bois ?
— Je te le donne pour dîner.
Cette stupide plaisanterie fit rire tous les enfants qui n’étaient pas condamnés.
Pendant cet interrogatoire il était survenu une dizaine d’enfants : tous vinrent, à tour de rôle, rendre leurs comptes ; avec deux déjà condamnés aux lanières, il s’en trouva trois autres qui n’avaient point leur chiffre.
— Ils sont donc cinq brigands qui me volent et me pillent ! s’écria Garofoli d’une voix gémissante ; voilà ce que c’est d’être trop généreux ; comment voulez-vous que je paye la bonne viande et les bonnes pommes de terre que je vous donne, si vous ne voulez pas travailler ? Vous aimez mieux jouer ; il faudrait pleurer avec les jobards, et vous aimez mieux rire entre vous ; croyez-vous donc qu’il ne vaut pas mieux faire semblant de pleurer en tendant la main, que de pleurer pour de bon en tendant le dos. Allons, à bas les vestes !
Riccardo se tenait le fouet à la main et les cinq patients étaient rangés à côté de lui.
— Tu sais, Riccardo, dit Garofoli, que je ne te regarde pas parce que ces corrections me font mal, mais je t’entends, et au bruit je jugerai bien la force des coups : vas-y de tout cœur, mon mignon, c’est pour ton pain que tu travailles.
Et il se tourna le nez vers le feu, comme s’il lui était impossible de voir cette exécution. Pour moi, oublié dans un coin, je frémissais d’indignation et aussi de peur. C’était l’homme qui allait devenir mon maître ; si je ne rapportais pas les trente ou les quarante sous qu’il lui plairait d’exiger de moi, il me faudrait tendre le dos à Riccardo. Ah ! je comprenais maintenant comment Mattia pouvait parler de la mort si tranquillement et avec un sentiment d’espérance.
Le premier claquement du fouet frappant sur la peau me fit jaillir les larmes des yeux. Comme je me croyais oublié, je ne me contraignis point, mais, je me trompais. Garofoli m’observait à la dérobée ; j’en eus bientôt la preuve.
— Voilà un enfant qui a bon cœur, dit-il en me désignant du doigt ; il n’est pas comme vous, brigands, qui riez du malheur de vos camarades et de mon chagrin ; que n’est-il de vos camarades ; il vous servirait d’exemple !
Ce mot me fit trembler de la tête aux pieds : leur camarade !
Au deuxième coup de fouet le patient poussa un gémissement lamentable, au troisième un cri déchirant.
Garofoli leva la main, Riccardo resta le fouet suspendu.
Je crus qu’il voulait faire grâce ; mais ce n’était pas de grâce qu’il s’agissait.
— Tu sais combien les cris me font mal, dit doucement Garofoli en s’adressant à sa victime, tu sais que si le fouet te déchire la peau, tes cris me déchirent le cœur ; je te préviens donc que pour chaque cri, tu auras un nouveau coup de fouet : et ce sera ta faute ; pense à ne pas me rendre malade de chagrin ; si tu avais un peu de tendresse pour moi, un peu de reconnaissance, tu te tairais : Allons, Riccardo !
Celui-ci leva le bras et les lanières cinglèrent le dos du malheureux.
— Mamma ! mamma ! cria celui-ci.
Heureusement je n’en vis point davantage, la porte de l’escalier s’ouvrit et Vitalis entra.
Un coup d’œil lui fit comprendre ce que les cris qu’il avait entendus en montant l’escalier lui avaient déjà dénoncé, il courut sur Riccardo et lui arracha le fouet de la main ; puis se retournant vivement vers Garofoli, il se posa devant lui les bras croisés.
Tout cela s’était passé si rapidement, que Garofoli resta un moment stupéfait, mais bientôt se remettant et reprenant son sourire doucereux :
— N’est-ce pas, dit-il, que c’est terrible ; cet enfant n’a pas de cœur.
— C’est une honte ! s’écria Vitalis.
— Voilà justement ce que je dis, interrompit Garofoli.
— Pas de grimaces, continua mon maître avec force, vous savez bien que ce n’est pas à cet enfant que je parle, mais à vous ; oui, c’est une honte, une lâcheté de martyriser ainsi des enfants qui ne peuvent pas se défendre.
— De quoi vous mêlez-vous, vieux fou ? dit Garofoli changeant de ton.
— De ce qui regarde la police.
— La police, s’écria Garofoli en se levant, vous me menacez de la police, vous ?
— Oui, moi, répondit mon maître sans se laisser intimider par la fureur du padrone.
— Écoutez, Vitalis, dit celui-ci en se calmant et en prenant un ton moqueur, il ne faut pas faire le méchant, et me menacer de causer, parce que, de mon côté, je pourrais bien causer aussi. Et alors qui est-ce qui ne serait pas content ? Bien sûr je n’irai rien dire à la police, vos affaires ne la regardent pas. Mais il y en a d’autres qu’elles intéressent, et si j’allais répéter à ceux-là ce que je sais, si je disais seulement un nom, un seul nom, qui est-ce qui serait obligé d’aller cacher sa honte ?
Mon maître resta un moment sans répondre. Sa honte ? J’étais stupéfait. Avant que je fusse revenu de la surprise dans laquelle m’avaient jeté ces étranges paroles, il m’avait pris par la main.
— Suis-moi.
Et il m’entraîna vers la porte.
— Eh bien ! dit Garofoli en riant, sans rancune, mon vieux ; vous vouliez me parler ?
— Je n’ai plus rien à vous dire.
Et sans une seule parole, sans se retourner, il descendit l’escalier me tenant toujours par la main. Avec quel soulagement je le suivais ! j’échappais donc à Garofoli ; si j’avais osé, j’aurais embrassé Vitalis.
XVIII
LES CARRIÈRES DE GENTILLY
Tant que nous fûmes dans la rue où il y avait du monde, Vitalis marcha sans rien dire, mais bientôt nous nous trouvâmes dans une ruelle déserte ; alors il s’assit sur une borne et passa à plusieurs reprises sa main sur son front, ce qui chez lui était un signe d’embarras.
— C’est peut-être beau d’écouter la générosité, dit-il, comme s’il se parlait à lui-même, mais avec cela nous voilà sur le pavé de Paris, sans un sou dans la poche et sans un morceau de pain dans l’estomac. As-tu faim ?
— Je n’ai rien mangé depuis le petit croûton que vous m’avez donné ce matin.
— Eh bien ! mon pauvre enfant, tu es exposé à te coucher ce soir sans dîner ; encore si nous savions où coucher !
— Vous comptiez donc coucher chez Garofoli ?
— Je comptais que toi tu y coucherais, et comme pour ton hiver il m’eût donné une vingtaine de francs, j’étais tiré d’affaire pour le moment. Mais en voyant comment il traite les enfants, je n’ai pas été maître de moi. Tu n’avais pas envie de rester avec lui, n’est-ce pas ?
— Oh ! vous êtes bon.
— Peut-être le cœur du jeune homme n’est-il pas tout à fait mort dans le vieux vagabond. Par malheur, le vagabond avait bien calculé, et le jeune homme a tout dérangé. Maintenant où aller ?
Il était tard déjà, et le froid, qui s’était amolli durant la journée, était redevenu âpre et glacial ; le vent soufflait du nord, la nuit serait dure.
Vitalis resta longtemps assis sur la borne, tandis que nous nous tenions immobiles devant lui, Capi et moi, attendant qu’il eût pris une décision. Enfin, il se leva.
— Où allons-nous ?
— À Gentilly, tâcher de trouver une carrière où j’ai couché autrefois. Es-tu fatigué ?
— Je me suis reposé chez Garofoli.
— Le malheur est que je ne me suis pas reposé, moi, et que je n’en peux plus. Enfin, il faut aller. En avant, mes enfants !
C’était son mot de bonne humeur pour les chiens et pour moi ; mais ce soir-là il le dit tristement.
Nous voilà donc en route dans les rues de Paris ; la nuit est noire et le gaz, dont le vent fait vaciller la flamme dans les lanternes, éclaire mal la chaussée ; nous glissons à chaque pas sur un ruisseau gelé ou sur une nappe de glace qui a envahi les trottoirs ; Vitalis me tient par la main et Capi est sur nos talons. De temps en temps seulement il reste en arrière pour chercher dans un tas d’ordures s’il ne trouvera pas un os ou une croûte, car la faim lui tenaille aussi l’estomac ; mais les ordures sont prises en un bloc de glace et sa recherche est vaine ; l’oreille basse, il nous rejoint.
Après les grandes rues, des ruelles ; après ces ruelles, d’autres grandes rues ; nous marchons toujours, et les rares passants que nous rencontrons semblent nous regarder avec étonnement : est-ce notre costume, est-ce notre démarche fatiguée qui frappent l’attention ? Les sergents de ville que nous croisons tournent autour de nous et s’arrêtent pour nous suivre de l’œil.
Cependant, sans prononcer une seule parole, Vitalis s’avance courbé en deux ; malgré le froid, sa main brûle la mienne ; il me semble qu’il tremble. Parfois, quand il s’arrête pour s’appuyer une minute sur mon épaule, je sens tout son corps agité d’une secousse convulsive.
D’ordinaire je n’osais pas trop l’interroger, mais cette fois je manquai à ma règle ; j’avais d’ailleurs comme un besoin de lui dire que je l’aimais ou tout au moins que je voulais faire quelque chose pour lui.
— Vous êtes malade ! dis-je dans un moment d’arrêt.
— Je le crains ; en tous cas, je suis fatigué ; ces jours de marche ont été trop longs pour mon âge, et le froid de cette nuit est trop rude pour mon vieux sang ; il m’aurait fallu un bon lit, un souper dans une chambre close et devant un bon feu. Mais tout ça c’est un rêve : en avant, les enfants !
En avant ! nous étions sortis de la ville ou tout au moins des maisons ; et nous marchions tantôt entre une double rangée de murs, tantôt en pleine campagne, nous marchions toujours. Plus de passants, plus de sergents de ville, plus de lanternes ou de becs de gaz ; seulement de temps en temps une fenêtre éclairée çà et là et au-dessus de nos têtes, le ciel d’un bleu sombre avec de rares étoiles. Le vent qui soufflait plus âpre et plus rude nous collait nos vêtements sur le corps : il nous frappait heureusement dans le dos, mais comme l’emmanchure de ma veste était décousue, il entrait par ce trou et me glissait le long du bras, ce qui était loin de me réchauffer.
Bien qu’il fît sombre et que des chemins se croisassent à chaque pas, Vitalis marchait comme un homme qui sait où il va et qui est parfaitement sûr de sa route ; aussi je le suivais sans crainte de nous perdre, n’ayant d’autre inquiétude que celle de savoir si nous n’allions pas arriver enfin à cette carrière.
Mais tout à coup il s’arrêta.
— Vois-tu un bouquet d’arbres ? me dit-il.
— Je ne vois rien.
— Tu ne vois pas une masse noire ?
Je regardai de tous les côtés avant de répondre ; nous devions être au milieu d’une plaine, car mes yeux se perdirent dans des profondeurs sombres sans que rien les arrêtât, ni arbres ni maisons ; le vide autour de nous ; pas d’autre bruit que celui du vent sifflant ras de terre dans les broussailles invisibles.
— Ah ! si j’avais tes yeux ! dit Vitalis, mais je vois trouble, regarde là-bas.
Il étendit la main droit devant lui, puis comme je ne répondais pas, car je n’osais pas dire que je ne voyais rien, il se remit en marche.
Quelques minutes se passèrent en silence, puis il s’arrêta de nouveau et me demanda encore si je ne voyais pas de bouquet d’arbres. Je n’avais plus la même sécurité que quelques instants auparavant, et un vague effroi fit trembler ma voix quand je répondis que je ne voyais rien.
— C’est ta peur qui te fait danser les yeux, dit Vitalis.
— Je vous assure que je ne vois pas d’arbres.
— Pas de grande roue ?
— On ne voit rien.
— Nous sommes-nous trompés !
Je n’avais pas à répondre, je ne savais ni où nous étions, ni où nous allions.
— Marchons encore cinq minutes, et si nous ne voyons pas les arbres nous reviendrons en arrière ; je me serai trompé de chemin.
Maintenant que je comprenais que nous pouvions être égarés, je ne me sentais plus de forces. Vitalis me tira par le bras.
— Eh bien !
— Je ne peux plus marcher.
— Et moi, crois-tu que je peux te porter ? si je me tiens encore debout c’est soutenu par la pensée que si nous nous asseyons nous ne nous relèverons pas et mourrons là de froid. Allons !
Je le suivis.
— Le chemin a-t-il des ornières profondes ?
— Il n’en a pas du tout.
— Il faut retourner sur nos pas.
Le vent qui nous soufflait dans le dos, nous frappa à la face et si rudement, qu’il me suffoqua : j’eus la sensation d’une brûlure.
Nous n’avancions pas bien rapidement en venant, mais en retournant nous marchâmes plus lentement encore.
— Quand tu verras des ornières, préviens-moi, dit Vitalis ; le bon chemin doit être à gauche, avec une tête d’épine au carrefour.
Pendant un quart d’heure, nous avançâmes ainsi luttant contre le vent ; dans le silence morne de la nuit, le bruit de nos pas résonnait sur la terre durcie : bien que pouvant à peine mettre une jambe devant l’autre, c’était moi maintenant qui traînais Vitalis. Avec quelle anxiété je sondais le côté gauche de la route !
Une petite étoile rouge brilla tout à coup dans l’ombre.
— Une lumière, dis-je en étendant la main.
— Où cela ?
Vitalis regarda, mais bien que la lumière scintillât à une distance qui ne devait pas être très-grande, il ne vit rien. Par là je compris que sa vue était affaiblie, car d’ordinaire elle était longue et perçante la nuit.
— Que nous importe cette lumière, dit-il, c’est une lampe qui brûle sur la table d’un travailleur ou bien près du lit d’un mourant, nous ne pouvons pas aller frapper à cette porte. Dans la campagne, pendant la nuit, nous pourrions demander l’hospitalité, mais aux environs de Paris on ne donne pas l’hospitalité. Il n’y a pas de maisons pour nous. Allons !
Pendant quelques minutes encore nous marchâmes, puis il me sembla apercevoir un chemin qui coupait le nôtre, et au coin de ce chemin un corps noir qui devait être la tête d’épine. Je lâchai la main de Vitalis pour avancer plus vite. Ce chemin était creusé par de profondes ornières.
— Voilà l’épine ; il y a des ornières.
— Donne-moi la main, nous sommes sauvés, la carrière est à cinq minutes d’ici ; regarde bien, tu dois voir le bouquet d’arbres.
Il me sembla voir une masse sombre, et je dis que je reconnaissais les arbres.
L’espérance nous rendit l’énergie, mes jambes furent moins lourdes, la terre fut moins dure à mes pieds.
Cependant les cinq minutes annoncées par Vitalis me parurent éternelles.
— Il y a plus de cinq minutes que nous sommes dans le bon chemin, dit-il en s’arrêtant.
— C’est ce qui me semble.
— Où vont les ornières ?
— Elles continuent droit.
— L’entrée de la carrière doit être à gauche, nous aurons passé devant sans la voir ; dans cette nuit épaisse rien n’est plus facile ; pourtant nous aurions dû comprendre aux ornières que nous allions trop loin.
— Je vous assure que les ornières n’ont pas tourné à gauche.
— Enfin, rebroussons toujours sur nos pas.
Une fois encore nous revînmes en arrière.
— Vois-tu le bouquet d’arbres ?
— Oui, là, à gauche.
— Et les ornières ?
— Il n’y en a pas.
— Est-ce que je suis aveugle ? dit Vitalis en passant la main sur ses yeux, marchons droit sur les arbres et donne-moi la main.
— Il y a une muraille.
— C’est un amas de pierres.
— Non, je vous assure que c’est une muraille.
Ce que je disais était facile à vérifier, nous n’étions qu’à quelques pas de la muraille. Vitalis franchit ces quelques pas, et comme s’il ne s’en rapportait pas à ses yeux, il appliqua les deux mains contre l’obstacle que j’appelais une muraille et qu’il appelait, lui, un amas de pierres.
— C’est bien un mur ; les pierres sont régulièrement rangées et je sens le mortier : où donc est l’entrée ? cherche les ornières.
Je me baissai sur le sol et suivis la muraille jusqu’à son extrémité sans rencontrer la moindre ornière : puis revenant vers Vitalis je continuai ma recherche du côté opposé. Le résultat fut le même : partout un mur : nulle part une ouverture dans ce mur, ou sur la terre un chemin, un sillon, une trace quelconque indiquant une entrée.
— Je ne trouve rien que la neige.
La situation était terrible ; sans doute mon maître s’était égaré et ce n’était pas là que se trouvait la carrière qu’il cherchait.
Quand je lui eus dit que je ne trouvais pas les ornières, mais seulement la neige, il resta un moment sans répondre, puis appliquant de nouveau ses mains contre le mur, il le parcourut d’un bout à l’autre. Capi qui ne comprenait rien à cette manœuvre, aboyait avec impatience.
Je marchais derrière Vitalis.
— Faut-il chercher plus loin ?
— Non, la carrière est murée.
— Murée ?
— On a fermé l’ouverture, et il est impossible d’entrer.
— Mais alors ?
— Que faire, n’est-ce pas ? je n’en sais rien ; mourir ici.
— Oh ! maître.
— Oui, tu ne veux pas mourir toi, tu es jeune, la vie te tient : eh bien ! marchons, peux-tu marcher ?
— Mais vous ?
— Quand je ne pourrai plus, je tomberai comme un vieux cheval.
— Où aller ?
— Rentrer dans Paris ; quand nous rencontrerons des sergents de ville nous nous ferons conduire au poste de police ; j’aurais voulu éviter cela ; mais je ne veux pas te laisser mourir de froid ; allons, mon petit Rémi, allons, mon enfant, du courage !
Et nous reprîmes en sens contraire la route que nous avions déjà parcourue. Quelle heure était-il ? Je n’en avais aucune idée. Nous avions marché longtemps, bien longtemps et lentement. Minuit, une heure du matin peut-être. Le ciel était toujours du même bleu sombre, sans lune, avec de rares étoiles qui paraissaient plus petites qu’à l’ordinaire. Le vent, loin de se calmer, avait redoublé de force ; il soulevait des tourbillons de poussière neigeuse sur le bord de la route et nous la fouettait au visage. Les maisons devant lesquelles nous passions étaient closes et sans lumière : il me semblait que si les gens qui dormaient là chaudement dans leurs draps avaient su combien nous avions froid, ils nous auraient ouvert leur porte.
En marchant vite nous aurions pu réagir contre le froid, mais Vitalis n’avançait plus qu’à grand’peine en soufflant ; sa respiration était haute et haletante comme s’il avait couru. Quand je l’interrogeais, il ne me répondait pas, et de la main, lentement, il me faisait signe qu’il ne pouvait pas parler.
De la campagne nous étions revenus en ville, c’est-à-dire que nous marchions entre des murs au haut desquels çà et là se balançait un réverbère avec un bruit de ferraille.
Vitalis s’arrêta : je compris qu’il était à bout.
— Voulez-vous que je frappe à l’une de ces portes ? dis-je.
— Non, on ne nous ouvrirait pas ; ce sont des jardiniers, des maraîchers qui demeurent là ; ils ne se lèvent pas la nuit. Marchons toujours.
Mais il avait plus de volonté que de forces. Après quelques pas il s’arrêta encore.
— Il faut que je me repose un peu, dit-il, je n’en puis plus.
Une porte s’ouvrait dans une palissade, et au-dessus de cette palissade se dressait un grand tas de fumier monté droit, comme on en voit si souvent dans les jardins des maraîchers ; le vent, en soufflant sur le tas, avait desséché le premier lit de paille et il en avait éparpillé une assez grande épaisseur dans la rue, au pied même de la palissade.
— Je vais m’asseoir là, dit Vitalis.
— Vous disiez que si nous nous asseyions, nous serions pris par le froid et ne pourrions plus nous relever.
Sans me répondre, il me fit signe de ramasser la paille contre la porte, et il se laissa tomber sur cette litière plutôt qu’il ne s’y assit ; ses dents claquaient et tout son corps tremblait.
— Apporte encore de la paille, me dit-il, le tas de fumier nous met à l’abri du vent.
À l’abri du vent, cela était vrai, mais non à l’abri du froid. Lorsque j’eus amoncelé tout ce que je pus ramasser de paille, je vins m’asseoir près de Vitalis.
— Tout contre moi, dit-il, et mets Capi sur toi, il te passera un peu de sa chaleur.
Vitalis était un homme d’expérience, qui savait que le froid, dans les conditions où nous étions, pouvait devenir mortel. Pour qu’il s’exposât à ce danger, il fallait qu’il fût anéanti.
Il l’était réellement. Depuis quinze jours, il s’était couché chaque soir ayant fait plus que force, et cette dernière fatigue arrivant après toutes les autres, le trouvait trop faible pour la supporter, épuisé par une longue suite d’efforts, par les privations et par l’âge.
Eut-il conscience de son état ? Je ne l’ai jamais su. Mais au moment où ayant ramené la paille sur moi, je me serrais contre lui, je sentis qu’il se penchait sur mon visage et qu’il m’embrassait. C’était la seconde fois ; ce fut, hélas ! la dernière.
Un petit froid empêche le sommeil chez les gens qui se mettent au lit en tremblant, un grand froid prolongé frappe d’engourdissement et de stupeur ceux qu’il saisit en plein air. Ce fut là notre cas.
À peine m’étais-je blotti contre Vitalis que je fus anéanti et que mes yeux se fermèrent. Je fis effort pour les ouvrir, et, comme je n’y parvenais pas, je me pinçai le bras fortement ; mais ma peau était insensible, et ce fut à peine si, malgré toute la bonne volonté que j’y mettais, je pus me faire un peu de mal. Cependant la secousse me rendit jusqu’à un certain point la conscience de la vie. Vitalis, le dos appuyé contre la porte, haletait péniblement, par des saccades courtes et rapides. Dans mes jambes, appuyé contre ma poitrine, Capi dormait déjà. Au-dessus de notre tête, le vent soufflait toujours et nous couvrait de brins de paille qui tombaient sur nous comme des feuilles sèches qui se seraient détachées d’un arbre. Dans la rue, personne, près de nous, au loin, tout autour de nous, un silence de mort.
Ce silence me fit peur ; peur de quoi ? je ne m’en rendis pas compte ; mais une peur vague, mêlée d’une tristesse qui m’emplit les yeux de larmes. Il me sembla que j’allais mourir là.
Et la pensée de la mort me reporta à Chavanon. Pauvre maman Barberin ! mourir sans la revoir, sans revoir notre maison, mon jardinet. Et, par je ne sais quelle extravagance d’imagination, je me retrouvai dans ce jardinet : le soleil brillait, gai et chaud ; les jonquilles ouvraient leurs fleurs d’or, les merles chantaient dans les buissons, et, sur la haie d’épine, mère Barberin étendait le linge qu’elle venait de laver au ruisseau qui chantait sur les cailloux.
Brusquement mon esprit quitta Chavanon, pour rejoindre le Cygne : Arthur dormait dans son lit ; madame Milligan était éveillée et comme elle entendait le vent souffler elle se demandait où j’étais par ce grand froid.
Puis mes yeux se fermèrent de nouveau, mon cœur s’engourdit, il me sembla que je m’évanouissais.
XIX
LISE
Quand je me réveillai j’étais dans un lit ; la flamme d’un grand feu éclairait la chambre où j’étais couché.
Je regardai autour de moi.
Je ne connaissais pas cette chambre.
Je ne connaissais pas non plus les figures qui m’entouraient : un homme en veste grise et en sabots jaunes ; trois ou quatre enfants dont une petite fille de cinq ou six ans qui fixait sur moi des yeux étonnés ; ces yeux étaient étranges, ils parlaient.
Je me soulevai.
On s’empressa autour de moi.
— Vitalis ? dis-je.
— Il demande son père, dit une jeune fille qui paraissait l’aînée des enfants.
— Ce n’est pas mon père, c’est mon maître ; où est-il ? Où est Capi ?
Vitalis eût été mon père, on eût pris sans doute des ménagements pour me parler de lui ; mais comme il n’était que mon maître, on jugea qu’il n’y avait qu’à me dire simplement la vérité, et voici ce qu’on m’apprit.
La porte dans l’embrasure de laquelle nous nous étions blottis était celle d’un jardinier. Vers deux heures du matin, ce jardinier avait ouvert cette porte pour aller au marché, et il nous avait trouvés couchés sous notre couverture de paille. On avait commencé par nous dire de nous lever, afin de laisser passer la voiture ; puis, comme nous ne bougions ni l’un ni l’autre, et que Capi seul répondait en aboyant pour nous défendre, on nous avait pris par le bras pour nous secouer. Nous n’avions pas bougé davantage. Alors on avait pensé qu’il se passait quelque chose de grave. On avait apporté une lanterne : le résultat de l’examen avait été que Vitalis était mort, mort de froid, et que je ne valais pas beaucoup mieux que lui. Cependant, comme grâce à Capi couché sur ma poitrine, j’avais conservé un peu de chaleur au cœur, j’avais résisté et je respirais encore. On m’avait alors porté dans la maison du jardinier et l’on m’avait couché dans le lit d’un des enfants qu’on avait fait lever. J’étais resté là six heures, à peu près mort ; puis la circulation du sang s’était rétablie, la respiration avait repris de la force, et je venais de m’éveiller.
Si engourdi, si paralysé que je fusse de corps et d’intelligence, je me trouvai cependant assez éveillé pour comprendre dans toute leur étendue les paroles que je venais d’entendre. Vitalis mort !
C’était l’homme à la veste grise, c’est-à-dire le jardinier qui me faisait ce récit, et pendant qu’il parlait, la petite fille au regard étonné ne me quittait pas des yeux. Quand son père eut dit que Vitalis était mort, elle comprit sans doute, elle sentit par une intuition rapide le coup que cette nouvelle me portait, car quittant vivement son coin elle s’avança vers son père, lui posa une main sur le bras et me désigna de l’autre main en faisant entendre un son étrange qui n’était point la parole humaine mais quelque chose comme un soupir doux et compatissant.
D’ailleurs le geste était si éloquent qu’il n’avait pas besoin d’être appuyé par des mots ; je sentis dans ce geste et dans le regard qui l’accompagnait une sympathie instinctive, et pour la première fois depuis ma séparation d’avec Arthur j’éprouvai un sentiment indéfinissable de confiance et de tendresse, comme au temps où mère Barberin me regardait avant de m’embrasser. Vitalis était mort, j’étais abandonné, et cependant il me sembla que je n’étais point seul, comme s’il eût été encore là près de moi.
— Eh bien, oui, ma petite Lise, dit le père en se penchant vers sa fille, ça lui fait de la peine, mais il faut bien lui dire la vérité, si ce n’est pas nous, ce seront les gens de la police.
Et il continua à me raconter comment on avait été prévenir les sergents de ville, et comment Vitalis avait été emporté par eux tandis qu’on m’installait, moi, dans le lit d’Alexis, son fils aîné.
— Et Capi ? dis-je, lorsqu’il eut cessé de parler.
— Capi !
— Oui, le chien ?
— Je ne sais pas, il a disparu.
— Il a suivi le brancard, dit l’un des enfants.
— Tu l’as vu, Benjamin ?
— Je crois bien, il marchait sur les talons des porteurs, la tête basse, et de temps en temps il sautait sur le brancard, puis quand on le faisait descendre, il poussait un cri plaintif, comme un hurlement étouffé.
Pauvre Capi ! lui qui tant de fois avait suivi, en bon comédien, l’enterrement pour rire de Zerbino, en prenant une mine de pleureur, en poussant des soupirs qui faisaient se pâmer les enfants les plus sombres…
Le jardinier et ses enfants me laissèrent seul, et sans trop savoir ce que je faisais, et surtout ce que j’allais faire, je me levai.
Ma harpe avait été déposée aux pieds du lit sur lequel on m’avait couché, je passai la bandoulière autour de mon épaule, et j’entrai dans la pièce où le jardinier était entré avec ses enfants. Il fallait bien partir, pour aller où ?… je n’en avais pas conscience, mais je sentais que je devais partir… et je partais.
Dans le lit, en me réveillant, je ne m’étais pas trouvé trop mal à mon aise, courbaturé seulement, avec une insupportable chaleur à la tête ; mais, quand je fus sur mes jambes, il me sembla que j’allais tomber, et je fus obligé de me retenir à une chaise. Cependant, après un moment de repos, je poussai la porte et me retrouvai en présence du jardinier et de ses enfants.
Ils étaient assis devant une table, auprès d’un feu qui flambait dans une haute cheminée, et en train de manger une bonne soupe aux choux.
L’odeur de la soupe me porta au cœur et me rappela brutalement que je n’avais pas dîné la veille ; j’eus une sorte de défaillance et je chancelai. Mon malaise se traduisit sur mon visage.
— Est-ce que tu te trouves mal, mon garçon ! demanda le jardinier d’une voix compatissante.
Je répondis qu’en effet je ne me sentais pas bien, et que si on voulait le permettre je resterais assis un moment auprès du feu.
Mais ce n’était plus de chaleur que j’avais besoin, c’était de nourriture ; le feu ne me remit pas, et le fumet de la soupe, le bruit des cuillers dans les assiettes, le clappement de langue de ceux qui mangeaient, augmentèrent encore ma faiblesse.
Si j’avais osé, comme j’aurais demandé une assiettée de soupe, mais Vitalis ne m’avait pas appris à tendre la main, et la nature ne m’avait pas créé mendiant ; je serais plutôt mort de faim que de dire « j’ai faim ». Pourquoi, je n’en sais trop rien ? si ce n’est parce que je n’ai jamais voulu demander que ce que je pouvais rendre.
La petite fille au regard étrange, celle qui ne parlait pas et que son père avait appelée Lise, était en face de moi, et au lieu de manger elle me regardait sans baisser ou détourner les yeux. Tout à coup elle se leva de table, et prenant son assiette qui était pleine de soupe, elle me l’apporta et me la mit sur les genoux.
Faiblement, car je n’avais plus de voix pour parler, je fis un geste de la main pour la remercier, mais son père ne m’en laissa pas le temps.
— Accepte, mon garçon, dit-il, ce que Lise donne est bien donné ; et si le cœur t’en dit, après celle-là une autre.
Si le cœur m’en disait ! L’assiette de soupe fut engloutie en quelques secondes. Quand je reposai ma cuiller, Lise, qui était restée devant moi me regardant fixement, poussa un petit cri qui n’était plus un soupir cette fois, mais une exclamation de contentement. Puis, me prenant l’assiette, elle la tendit à son père pour qu’il la remplît, et quand elle fut pleine, elle me la rapporta avec un sourire si doux, si encourageant que, malgré ma faim, je restai un moment sans penser à prendre l’assiette.
Comme la première fois, la soupe disparut promptement ; ce n’était plus un sourire qui plissait les lèvres des enfants me regardant, mais un vrai rire qui leur épanouissait la bouche et les lèvres.
— Eh bien ! mon garçon, dit le jardinier, tu es une jolie cuiller.
Je me sentis rougir jusqu’aux cheveux ; mais après un moment je crus qu’il valait mieux avouer la vérité que de me laisser accuser de gloutonnerie, et je répondis que je n’avais pas dîné la veille.
— Et déjeuné ?
— Pas déjeuné non plus.
— Et ton maître ?
— Il n’avait pas mangé plus que moi.
— Alors il est mort autant de faim que de froid.
La soupe m’avait rendu la force ; je me levai pour partir.
— Où veux-tu aller ? dit le père.
— Partir.
— Où vas-tu ?
— Je ne sais pas.
— Tu as des amis à Paris ?
— Non.
— Des gens de ton pays ?
— Personne.
— Où est ton garni ?
— Nous n’avions pas de logement ; nous sommes arrivés hier.
— Qu’est-ce que tu veux faire ?
— Jouer de la harpe, chanter mes chansons et gagner ma vie.
— Où cela ?
— À Paris.
— Tu ferais mieux de retourner dans ton pays, chez tes parents ; où demeurent tes parents ?
— Je n’ai pas de parents.
— Tu disais que le vieux à barbe blanche n’était pas ton père ?
— Je n’ai pas de père.
— Et ta mère ?
— Je n’ai pas de mère.
— Tu as bien un oncle, une tante, des cousins, des cousines, quelqu’un.
— Non, personne.
— D’où viens-tu ?
— Mon maître m’avait acheté au mari de ma nourrice. Vous avez été bon pour moi, je vous en remercie bien de tout cœur, et, si vous voulez, je reviendrai dimanche pour vous faire danser en jouant de la harpe, si cela vous amuse.
En parlant, je m’étais dirigé vers la porte ; mais j’avais fait à peine quelques pas que Lise, qui me suivait, me prit par la main et me montra ma harpe en souriant.
Il n’y avait pas à se tromper.
— Vous voulez que je joue ?
Elle fit un signe de tête, et frappa joyeusement des mains.
— Eh bien, oui, dit le père, joue-lui quelque chose.
Je pris ma harpe et, bien que je n’eusse pas le cœur à la danse ni à la gaîté, je me mis à jouer une valse, ma bonne, celle que j’avais bien dans les doigts ; ah ! comme j’aurais voulu jouer aussi bien que Vitalis et faire plaisir à cette petite fille qui me remuait si doucement le cœur avec ses yeux !
Tout d’abord elle m’écouta en me regardant fixement, puis elle marqua la mesure avec ses pieds ; puis bientôt, comme si elle était entraînée par la musique, elle se mit à tourner dans la cuisine, tandis que ses deux frères et sa sœur aînée restaient tranquillement assis : elle ne valsait pas, bien entendu, et elle ne faisait pas les pas ordinaires, mais elle tournoyait gracieusement avec un visage épanoui.
Assis près de la cheminée, son père ne la quittait pas des yeux, il paraissait tout ému et il battait des mains. Quand la valse fut finie et que je m’arrêtai, elle vint se camper gentiment en face de moi et me fit une belle révérence. Puis, tout de suite frappant ma harpe d’un doigt, elle fit un signe qui voulait dire « encore ».
J’aurais joué pour elle toute la journée avec plaisir ; mais son père dit que c’était assez parce qu’il ne voulait pas qu’elle se fatiguât à tourner.
Alors au lieu de jouer un air de valse ou de danse, je chantai ma chanson napolitaine que Vitalis m’avait apprise :
Quanta sospire m’aje fatto jettare.
M’arde stocore comm’a na cannela
Cette chanson était pour moi ce qu’a été le « Des chevaliers de ma patrie » de Robert le Diable pour Nourrit, et le « Suivez-moi » de Guillaume Tell pour Duprez, c’est-à-dire mon morceau par excellence, celui dans lequel j’étais habitué à produire mon plus grand effet : l’air en est doux et mélancolique, avec quelque chose de tendre qui remue le cœur.
Aux premières mesures, Lise vint se placer en face de moi, ses yeux fixés sur les miens, remuant les lèvres comme si mentalement elle répétait mes paroles, puis quand l’accent de la chanson devint plus triste, elle recula doucement de quelques pas, si bien qu’à la dernière strophe elle se jeta en pleurant sur les genoux de son père.
— Assez, dit celui-ci.
— Est-elle bête ! dit un de ses frères, celui qui s’appelait Benjamin, elle danse et puis tout de suite elle pleure.
— Pas si bête que toi ! elle comprend, dit la sœur aînée, en se penchant sur elle pour l’embrasser.
Pendant que Lise se jetait sur les genoux de son père, j’avais mis ma harpe sur mon épaule et je m’étais dirigé du côté de la porte.
— Où vas-tu ? me dit-il.
— Je pars.
— Tu tiens donc bien à ton métier de musicien ?
— Je n’en ai pas d’autre.
— Les grands chemins ne te font pas peur ?
— Je n’ai pas de maison.
— Cependant la nuit que tu viens de passer a dû te donner à réfléchir ?
— Bien certainement, j’aimerais mieux un bon lit et le coin du feu.
— Le veux-tu, le coin du feu et le bon lit, avec le travail bien entendu ? Si tu veux rester, tu travailleras, tu vivras avec nous. Tu comprends, n’est-ce pas, que ce n’est pas la fortune que je te propose, ni la fainéantise. Si tu acceptes, il y aura pour toi de la peine à prendre, du mal à te donner, il faudra se lever matin, piocher dur dans la journée, mouiller de sueur le pain que tu gagneras. Mais le pain sera assuré, tu ne seras plus exposé à coucher à la belle étoile comme la nuit dernière, et peut-être à mourir abandonné au coin d’une borne ou au fond d’un fossé ; le soir tu trouveras ton lit prêt et en mangeant ta soupe tu auras la satisfaction de l’avoir gagnée, ce qui la rend bonne, je t’assure. Et puis enfin si tu es un bon garçon, et j’ai dans l’idée quelque chose qui me dit que tu en es un, tu auras en nous une famille.
Lise s’était retournée, et à travers ses larmes elle me regardait en souriant.
Surpris par cette proposition, je restai un moment indécis, ne me rendant pas bien compte de ce que j’entendais.
Alors Lise, quittant son père, vint à moi, et, me prenant par la main, me conduisit devant une gravure enluminée qui était accrochée à la muraille ; cette gravure représentait un petit Saint-Jean vêtu d’une peau de mouton.
Du geste elle fit signe à son père et à ses frères de regarder la gravure, et en même temps, ramenant la main vers moi, elle lissa ma peau de mouton et montra mes cheveux qui, comme ceux de Saint-Jean, étaient séparés au milieu du front et tombaient sur mes épaules en frisant.
Je compris qu’elle trouvait que je ressemblais au Saint-Jean et sans trop savoir pourquoi cela me fit plaisir et en même temps me toucha doucement.
— C’est vrai, dit le père, qu’il ressemble au Saint-Jean.
Lise frappa des mains en riant.
— Eh bien, dit le père en revenant à sa proposition, cela te va-t-il mon garçon ?
Une famille !
J’aurais donc une famille ! Ah ! combien de fois déjà ce rêve tant caressé s’était-il évanoui : mère Barberin, madame Milligan, Vitalis, tous, les uns après les autres m’avaient manqué.
Je ne serais plus seul.
Ma position était affreuse : je venais de voir mourir un homme avec lequel je vivais depuis plusieurs années et qui avait été pour moi presque un père ; en même temps j’avais perdu mon compagnon, mon camarade, mon ami, mon bon et cher Capi que j’aimais tant et qui, lui aussi, m’avait pris en si grande amitié, et cependant quand le jardinier me proposa de rester chez lui un sentiment de confiance me raffermit le cœur.
Tout n’était donc pas fini pour moi : la vie pouvait recommencer.
Et ce qui me touchait, bien plus que le pain assuré dont on me parlait, c’était cet intérieur que je voyais si uni, cette vie de famille qu’on me promettait.
Ces garçons seraient mes frères.
Cette jolie petite Lise serait ma sœur.
Dans mes rêves enfantins j’avais plus d’une fois imaginé que je retrouverais mon père et ma mère, mais je n’avais jamais pensé à des frères et à des sœurs.
Et voilà qu’ils s’offraient à moi.
Ils ne l’étaient pas réellement, cela était vrai, de par la nature, mais ils pourraient le devenir de par l’amitié : pour cela il n’y avait qu’à les aimer (ce à quoi j’étais tout disposé), et à me faire aimer d’eux, ce qui ne devait pas être difficile, car ils paraissaient tous remplis de bonté.
Vivement je dépassai la bandoulière de ma harpe de dessus mon épaule.
— Voilà une réponse, dit le père en riant, et une bonne, on voit qu’elle est agréable pour toi. Accroche ton instrument à ce clou, mon garçon, et le jour où tu ne te trouveras pas bien avec nous, tu le reprendras pour t’envoler ; seulement tu auras soin de faire comme les hirondelles et les rossignols, tu choisiras ta saison pour te mettre en route.
La maison à la porte de laquelle nous étions venus nous abattre dépendait de la Glacière ; et le jardinier qui l’occupait se nommait Acquin. Au moment où l’on me reçut dans cette maison, la famille se composait de cinq personnes : le père qu’on appelait père Pierre ; deux garçons, Alexis et Benjamin, et deux filles, Étiennette, l’aînée, et Lise, la plus jeune des enfants.
Lise était muette, mais non muette de naissance ; c’est-à-dire que le mutisme n’était point chez elle la conséquence de la surdité. Pendant deux ans elle avait parlé, puis tout à coup, un peu avant d’atteindre sa quatrième année, elle avait perdu l’usage de la parole. Cet accident, survenu à la suite de convulsions, n’avait heureusement pas atteint son intelligence, qui s’était au contraire développée avec une précocité extraordinaire ; non-seulement elle comprenait tout, mais encore elle disait, elle exprimait tout. Dans les familles pauvres et même dans beaucoup d’autres familles, il arrive trop souvent que l’infirmité d’un enfant est pour lui une cause d’abandon ou de répulsion. Mais cela ne s’était pas produit pour Lise, qui, par sa gentillesse et sa vivacité, son humeur douce et sa bonté expansive, avait échappé à cette fatalité. Ses frères la supportaient sans lui faire payer son malheur ; son père ne voyait que par elle ; sa sœur aînée Étiennette l’adorait.
Autrefois le droit d’aînesse était un avantage dans les familles nobles ; aujourd’hui, dans les familles d’ouvriers, c’est quelquefois hériter d’une lourde responsabilité que naître la première. Madame Acquin était morte un an après la naissance de Lise, et depuis ce jour Étiennette, qui avait alors deux années seulement de plus que son frère aîné, était devenue la mère de famille. Au lieu d’aller à l’école, elle avait dû rester à la maison, préparer la nourriture, coudre un bouton ou une pièce aux vêtements de son père ou de ses frères, et porter Lise dans ses bras ; on avait oublié qu’elle était fille, qu’elle était sœur, et l’on avait vite pris l’habitude de ne voir en elle qu’une servante, et une servante avec laquelle on ne se gênait guère, car on savait bien qu’elle ne quitterait pas la maison et ne se fâcherait jamais.
À porter Lise sur ses bras, à traîner Benjamin par la main, à travailler toute la journée, se levant tôt pour faire la soupe du père avant son départ pour la halle, se couchant tard pour remettre tout en ordre après le souper, à laver le linge des enfants au lavoir, à arroser l’été quand elle avait un instant de répit, à quitter son lit la nuit pour étendre les paillassons pendant l’hiver, quand la gelée prenait tout à coup, Étiennette n’avait pas eu le temps d’être une enfant, de jouer, de rire. À quatorze ans, sa figure était triste et mélancolique comme celle d’une vieille fille de trente-cinq ans, cependant avec un rayon de douceur et de résignation.
Il n’y avait pas cinq minutes que j’avais accroché ma harpe au clou qui m’avait été désigné, et que j’étais en train de raconter comment nous avions été surpris par le froid et la fatigue en revenant de Gentilly, où nous avions espéré coucher dans une carrière, quand j’entendis un grattement à la porte qui ouvrait sur le jardin, et en même temps un aboiement plaintif.
— C’est Capi ! dis-je en me levant vivement.
Mais Lise me prévint ; elle courut à la porte et l’ouvrit.
Le pauvre Capi s’élança d’un bond contre moi, et, quand je l’eus pris dans mes bras, il se mit à me lécher la figure en poussant des petits cris de joie : tout son corps tremblait.
— Et Capi ? dis-je.
Ma question fut comprise.
— Eh bien, Capi restera avec toi.
Comme s’il comprenait, le chien sauta à terre et, mettant la patte droite sur son cœur, il salua. Cela fit beaucoup rire les enfants, surtout Lise, et pour les amuser je voulus que Capi leur jouât une pièce de son répertoire, mais lui ne voulut pas m’obéir et sautant sur mes genoux, il recommença à m’embrasser ; puis, descendant, il se mit à me tirer par la manche de ma veste.
— Il veut que je sorte.
— Pour te mener auprès de ton maître.
Les hommes de police qui avaient emporté Vitalis avaient dit qu’ils avaient besoin de m’interroger et qu’ils viendraient dans la journée, quand je serais réchauffé et réveillé. C’était bien long, bien incertain de les attendre. J’étais anxieux d’avoir des nouvelles de Vitalis. Peut-être n’était-il pas mort comme on l’avait cru ? Je n’étais pas mort, moi. Il pouvait comme moi, être revenu à la vie.
Voyant mon inquiétude et devinant sa cause, le père m’emmena au bureau du commissaire, où l’on m’adressa questions sur questions, auxquelles je ne répondis que quand on m’eut assuré que Vitalis était mort. Ce que je savais était bien simple, je le racontai. Mais le commissaire voulut en apprendre davantage, et il m’interrogea longuement sur Vitalis et sur moi.
Sur moi je répondis que je n’avais plus de parents et que Vitalis m’avait loué moyennant une somme d’argent qu’il avait payée d’avance au mari de ma nourrice.
— Et maintenant ? me dit le commissaire.
À ce mot, le père intervint.
— Nous nous chargerons de lui, si vous voulez bien nous le confier.
Non-seulement le commissaire voulut bien me confier au jardinier, mais encore il le félicita pour sa bonne action.
Il fallait maintenant répondre au sujet de Vitalis, et cela m’était assez difficile, car je ne savais rien ou presque rien.
Il y avait cependant un point mystérieux dont j’aurais pu parler : c’était ce qui c’était passé lors de notre dernière représentation, quand Vitalis avait chanté de façon à provoquer l’admiration et l’étonnement de la dame ; il y avait aussi les menaces de Garofoli, mais je me demandais si je ne devais pas garder le silence à ce sujet.
Ce que mon maître avait si soigneusement caché durant sa vie, devait-il être révélé après sa mort ?
Mais il n’est pas facile à un enfant de cacher quelque chose à un commissaire de police qui connaît son métier, car ces gens-là ont une manière de vous interroger qui vous perd bien vite quand vous essayez de vous échapper.
Ce fut ce qui m’arriva.
En moins de cinq minutes le commissaire m’eut fait dire ce que je voulais cacher et ce que lui tenait à savoir.
— Il n’y a qu’à le conduire chez ce Garofoli, dit-il à un agent ; une fois dans la rue de Lourcine, il reconnaîtra la maison ; vous monterez avec lui et vous interrogerez ce Garofoli.
Nous nous mîmes tous les trois en route : l’agent, le père et moi.
Comme l’avait dit le commissaire, il me fut facile de reconnaître la maison, et nous montâmes au quatrième étage. Je ne vis pas Mattia qui sans doute était entré à l’hôpital. En apercevant un agent de police et en me reconnaissant, Garofoli pâlit ; certainement il avait peur.
Mais il se rassura bien vite quand il apprit de la bouche de l’agent ce qui nous amenait chez lui.
— Ah ! le pauvre vieux est mort, dit-il.
— Vous le connaissiez ?
— Parfaitement.
— Eh bien ! dites-moi ce que vous savez.
— C’est bien simple. Son nom n’était point Vitalis ; il s’appelait Carlo Balzani, et si vous aviez vécu, il y a trente-cinq ou quarante ans, en Italie, ce nom suffirait seul pour vous dire ce qu’était l’homme dont vous vous inquiétez. Carlo Balzani était à cette époque le chanteur le plus fameux de toute l’Italie, et ses succès sur nos grandes scènes ont été célèbres : il a chanté partout, à Naples, à Rome, à Milan, à Venise, à Florence, à Londres, à Paris. Mais il est venu un jour où la voix s’est perdue ; alors, ne pouvant plus être le roi des artistes, il n’a pas voulu que sa gloire fût amoindrie en la compromettant sur des théâtres indignes de sa réputation. Il a abdiqué son nom de Carlo Balzani et il est devenu Vitalis, se cachant de tous ceux qui l’avaient connu dans son beau temps. Cependant il fallait vivre ; il a essayé de plusieurs métiers et n’a pas réussi, si bien que de chute en chute, il s’est fait montreur de chiens savants. Mais dans sa misère, la fierté lui était restée, et il serait mort de honte si le public avait pu apprendre que le brillant Carlo Balzani était devenu le pauvre Vitalis. Un hasard m’avait rendu maître de ce secret.
C’était donc là l’explication du mystère qui m’avait tant intrigué.
Pauvre Carlo Balzani. Cher Vitalis !
XX
JARDINIER
On devait enterrer mon maître le lendemain, et le père m’avait promis de me conduire à l’enterrement.
Mais le lendemain je ne pus me lever, car je fus pris dans la nuit d’une grande fièvre qui débuta par un frisson suivi d’une bouffée de chaleur ; il me semblait que j’avais le feu dans la poitrine et que j’étais malade comme Joli-Cœur, après sa nuit passée sur l’arbre, dans la neige.
En réalité, j’avais une violente inflammation, c’est-à-dire une fluxion de poitrine causée par le refroidissement que j’avais éprouvé dans la nuit où mon pauvre maître avait péri.
Ce fut cette fluxion de poitrine qui me mit à même d’apprécier la bonté de la famille Acquin, et surtout les qualités de dévouement d’Étiennette.
Bien que chez les pauvres gens on soit ordinairement peu disposé à appeler les médecins, je fus pris d’une façon si violente et si effrayante, qu’on fit pour moi une exception à cette règle, qui est de nature autant que d’habitude. Le médecin, appelé, n’eut pas besoin d’un long examen et d’un récit détaillé pour voir quelle était ma maladie ; tout de suite il déclara qu’on devait me porter à l’hospice.
C’était, en effet, le plus simple et le plus facile. Cependant cet avis ne fut pas adopté par le père.
— Puisqu’il est venu tomber à notre porte, dit-il, et non à celle de l’hospice, c’est que nous devons le garder.
Le médecin avait combattu avec toutes sortes de bonnes paroles ce raisonnement fataliste, mais sans l’ébranler. On devait me garder, on m’avait gardé.
Et à toutes ses occupations, Étiennette avait ajouté celle de garde-malade, me soignant doucement, méthodiquement, comme l’eût fait une sœur de Saint-Vincent de Paul, sans jamais une impatience ou un oubli. Quand elle était obligée de m’abandonner pour les travaux de la maison, Lise la remplaçait, et bien des fois, dans ma fièvre, j’ai vu celle-ci aux pieds de mon lit, fixant sur moi ses grands yeux inquiets. L’esprit troublé par le délire, je croyais qu’elle était mon ange gardien, et je lui parlais comme j’aurais parlé à un ange, en lui disant mes espérances et mes désirs. C’est depuis ce moment que je me suis habitué à la considérer, malgré moi, comme un être idéal, entouré d’une sorte d’auréole, que j’étais tout surpris de voir vivre de notre vie quand je m’attendais au contraire à la voir s’envoler avec de grandes ailes blanches.
Ma maladie fut longue et douloureuse, avec plusieurs rechutes qui eussent découragé peut-être des parents, mais qui ne lassèrent ni la patience ni le dévouement d’Étiennette. Pendant plusieurs nuits, il fallut me veiller, car j’avais la poitrine prise de manière à croire que j’allais étouffer d’un moment à l’autre, et ce furent Alexis et Benjamin qui, alternativement, se remplacèrent auprès de mon lit. Enfin, la convalescence arriva ; mais, comme la maladie fut longue, capricieuse, et il me fallut attendre que le printemps commençât à reverdir les prairies de la Glacière pour sortir de la maison.
Alors Lise, qui ne travaillait point, prit la place d’Étiennette et ce fut elle qui me promena sur les bords de la Bièvre. Vers midi, quand le soleil était dans son plein, nous partions, et nous tenant par la main nous nous en allions doucement suivis de Capi. Le printemps fut doux et beau cette année-là, ou tout au moins il m’en est resté un doux et beau souvenir, ce qui est la même chose.
C’est un quartier peu connu des Parisiens que celui qui se trouve entre la Maison-Blanche et la Glacière ; on sait vaguement qu’il y a quelque part par là une petite vallée, mais comme la rivière qui l’arrose est la Bièvre, on dit et l’on croit que cette vallée est un des endroits les plus sales et les plus tristes de la banlieue de Paris. Il n’en est rien cependant, et l’endroit vaut mieux que sa réputation. La Bièvre, que l’on juge trop souvent par ce qu’elle est devenue industriellement dans le faubourg Saint-Marcel, et non par ce qu’elle était naturellement à Verrières ou à Rungis, coule là, ou tout au moins coulait là au temps dont je parle, sous un épais couvert de saules et de peupliers, et sur ses bords s’étendent de vertes prairies qui montent doucement jusqu’à des petits coteaux couronnés de maisons et de jardins ; l’herbe est fraîche et drue au printemps, les pâquerettes émaillent d’étoiles blanches son tapis d’émeraude, et dans les saules qui feuillissent, dans les peupliers dont les bourgeons sont enduits d’une résine visqueuse, les oiseaux, le merle, la fauvette, le pinson voltigent en disant par leurs chants qu’on est encore à la campagne et non déjà à la ville.
Ce fut ainsi que je vis cette petite vallée, — qui depuis a bien changé, — et l’impression qu’elle m’a laissée est vivace dans mon souvenir comme au jour où je la reçus. Si j’étais peintre je vous dessinerais le rideau de peupliers sans oublier un seul arbre, — et les gros saules avec les groseillers épineux qui verdissaient sur leurs têtes, les racines implantées dans leur tronc pourri, — et les glacis des fortifications sur lesquels nous faisions de si belles glissades en nous lançant sur un seul pied, — et la Butte-aux-Cailles avec son moulin à vent ; — et la cour Sainte-Hélène avec sa population de blanchisseuses ; et les tanneries qui salissent et infectent les eaux de la rivière, — et la ferme Sainte-Anne, où de pauvres fous qui cultivent la terre passent à côté de vous souriant d’un sourire idiot, les membres ballants, la bouche mi-ouverte montrant un bout de langue, avec une vilaine grimace.
Dans nos promenades, Lise naturellement ne parlait pas, mais chose étonnante, nous n’avions pas besoin de paroles, nous nous regardions et nous nous comprenions si bien avec nos yeux que j’en venais à ne plus lui parler moi-même.
À la longue les forces me revinrent et je pus m’employer aux travaux du jardin : j’attendais ce moment avec impatience, car j’avais hâte de faire pour les autres ce que les autres faisaient pour moi, de travailler pour eux et de leur rendre, dans la mesure de mes forces, ce qu’ils m’avaient donné. Je n’avais jamais travaillé, car si pénibles que soient les longues marches, elles ne sont pas un travail continu qui demande la volonté et l’application, mais il me semblait que je travaillerais bien, au moins courageusement, à l’exemple de ceux que je voyais autour de moi.
C’était la saison où les giroflées commencent à arriver sur les marchés de Paris, et la culture du père Acquin était à ce moment celle des giroflées ; notre jardin en était rempli ; il y en avait des rouges, des blanches, des violettes disposées par couleurs, séparées sous les châssis, de sorte qu’il y avait des lignes toutes blanches et d’autres à côté toutes rouges, ce qui était très-joli ; et le soir, avant que les châssis fussent refermés, l’air était embaumé par le parfum de toutes ces fleurs.
La tâche qu’on me donna, la proportionnant à mes forces encore bien faibles, consista à lever les panneaux vitrés le matin, quand la gelée était passée, et à les refermer le soir avant qu’elle arrivât ; dans la journée je devais les ombrer avec du paillis que je jetais dessus pour préserver les plantes d’un coup de soleil. Cela n’était ni bien difficile, ni bien pénible, mais cela était assez long, car j’avais plusieurs centaines de panneaux à remuer deux fois par jour et à surveiller pour les ombrer ou les découvrir selon l’ardeur du soleil.
Pendant ce temps, Lise restait auprès du manège qui servait à élever l’eau nécessaire aux arrosages, et quand la vieille Cocotte, fatiguée de tourner, les yeux encapuchonnés dans son masque de cuir, ralentissait le pas, elle l’excitait en faisant claquer un petit fouet ; un des frères renversait les seaux que faisait monter ce manège, et l’autre aidait son père ; ainsi chacun avait son poste, et personne ne perdait son temps.
J’avais vu les paysans travailler dans mon village, mais je n’avais aucune idée de l’application, du courage et de l’intensité avec lesquels travaillent les jardiniers des environs de Paris, qui, debout bien avant que le soleil paraisse, au lit bien tard après qu’il est couché, se dépensent tout entiers et peinent tant qu’ils ont de forces durant cette longue journée ; j’avais vu aussi cultiver la terre, mais je n’avais aucune idée de ce qu’on peut lui faire produire par le travail, en ne lui laissant pas de repos : je fus à bonne école chez le père Acquin.
On ne m’employa pas toujours aux châssis ; les forces me vinrent, et j’eus aussi la satisfaction de pouvoir mettre quelque chose dans la terre, et la satisfaction beaucoup plus grande encore de le voir pousser : c’était mon ouvrage à moi, ma chose, ma création, et cela me donnait comme un sentiment de fierté ; j’étais donc propre à quelque chose, je le prouvais, et, ce qui m’était plus doux encore, je le sentais : cela, je vous assure, paye de bien des peines.
Malgré les fatigues que cette vie nouvelle m’imposa, je m’habituai bien vite à cette existence laborieuse qui ressemblait si peu à mon existence vagabonde de bohémien. Au lieu de courir en liberté comme autrefois, n’ayant d’autre peine que d’aller droit devant moi sur les grandes routes, il fallait maintenant rester enfermé entre les quatre murs d’un jardin, et du matin au soir travailler rudement, la chemise mouillée sur le dos, les arrosoirs au bout des bras et les pieds nus dans les sentiers boueux ; mais autour de moi chacun travaillait tout aussi rudement ; les arrosoirs du père étaient plus lourds que les miens, et sa chemise était plus mouillée de sueur que les nôtres. C’est un grand soulagement dans la peine que l’égalité. Et puis je rencontrais là ce que je croyais avoir perdu à jamais : la vie de la famille. Je n’étais plus seul, je n’étais plus l’enfant abandonné ; j’avais mon lit à moi, j’avais ma place à moi à la table qui nous réunissait tous. Si durant la journée quelquefois Alexis ou Benjamin m’envoyaient une taloche, la main retombée je n’y pensais plus, pas plus qu’ils ne pensaient à celles que je leur rendais ; et le soir, tous autour de la soupe, nous nous retrouvions amis et frères.
Pour être vrai, il faut dire que tout ne nous était pas travail et fatigue ; nous avions aussi nos heures de repos et de plaisir, courtes, bien entendu, mais précisément par cela même plus délicieuses.
Le dimanche, dans l’après-midi, on se réunissait sous un petit berceau de vignes qui touchait la maison ; j’allais prendre ma harpe au clou où elle restait accrochée pendant toute la semaine, et je faisais danser les deux frères et les deux sœurs. Ni les uns ni les autres n’avaient appris à danser, mais Alexis et Benjamin avaient été une fois à un bal de noces aux Mille-Colonnes, et ils en avaient rapporté des souvenirs plus ou moins exacts de ce qu’est la contredanse ; c’étaient ces souvenirs qui les guidaient. Quand ils étaient las de danser, ils me faisaient chanter mon répertoire, et ma chanson napolitaine produisait toujours son irrésistible effet sur Lise.
Jamais je n’ai chanté la dernière strophe sans voir ses yeux mouillés.
Alors, pour la distraire, je jouais une pièce bouffonne avec Capi. Pour lui aussi ces dimanches étaient des jours de fête ; ils lui rappelaient le passé, et quand il avait fini son rôle, il l’eût volontiers recommencé.
Deux années s’écoulèrent ainsi, et comme le père m’emmenait souvent avec lui au marché, au quai aux Fleurs, à la Madeleine, au Château-d’Eau, ou bien chez les fleuristes à qui nous portions nos plantes, j’en arrivai petit à petit à connaître Paris et à comprendre que si ce n’était pas une ville de marbre et d’or comme je l’avais imaginé, ce n’était point davantage une ville de boue comme mon entrée par Charenton et le quartier Mouffetard me l’avait fait croire un peu trop vite.
Je vis les monuments, j’entrai dans quelques-uns, je me promenai le long des quais, sur les boulevards, dans le jardin du Luxembourg, dans celui des Tuileries, aux Champs-Élysées. Je vis des statues. Je restai en admiration devant le mouvement des foules. Je me fis une sorte d’idée de ce qu’était l’existence d’une grande capitale.
Heureusement mon éducation ne se fit point seulement par les yeux et selon les hasards de mes promenades ou de mes courses à travers Paris. Avant de s’établir jardinier à son compte « le père » avait travaillé aux pépinières du Jardin des Plantes, et là il s’était trouvé en contact avec des gens de science et d’étude dont le frottement lui avait donné la curiosité de lire et d’apprendre. Pendant plusieurs années il avait employé ses économies à acheter des livres et ses quelques heures de loisir à lire ces livres. Mais lorsqu’il s’était marié et que les enfants étaient arrivés, les heures de loisir avaient été rares ; il avait fallu avant tout gagner le pain de chaque jour ; les livres avaient été abandonnés, mais ils n’avaient été ni perdus, ni vendus ; et on les avait gardés dans une armoire. Le premier hiver que je passai dans la famille Acquin fut très-long, et les travaux de jardinage se trouvèrent sinon suspendus, au moins ralentis pendant plusieurs mois. Alors pour occuper les soirées que nous passions au coin du feu, les vieux livres furent tirés de l’armoire et distribués entre nous. C’étaient pour la plupart des ouvrages sur la botanique et l’histoire des plantes avec quelques récits de voyages. Alexis et Benjamin n’avaient point hérité des goûts de leur père pour l’étude, et régulièrement tous les soirs, après avoir ouvert leur volume, ils s’endormaient sur la troisième ou la quatrième page. Pour moi, moins disposé au sommeil ou plus curieux, je lisais jusqu’au moment où nous devions nous coucher : les premières leçons de Vitalis n’avaient point été perdues ; et en me disant cela, en me couchant je pensais à lui avec attendrissement.
Mon désir d’apprendre rappela au père le temps où il prenait deux sous sur son déjeuner pour acheter des livres, et à ceux qui étaient dans l’armoire il en ajouta quelques autres qu’il me rapporta de Paris. Les choix étaient faits par le hasard ou les promesses du titre, mais enfin c’étaient toujours des livres, et, s’ils mirent alors un peu de désordre dans mon esprit sans direction, ce désordre s’effaça plus tard et ce qu’il y avait de bon en eux me resta et m’est resté ; tant il est vrai que toute lecture profite.
Lise ne savait pas lire, mais en me voyant plongé dans les livres aussitôt que j’avais une heure de liberté, elle eut la curiosité de savoir ce qui m’intéressait si vivement. Tout d’abord elle voulut me prendre ces livres qui m’empêchaient de jouer avec elle ; puis, voyant que malgré tout je revenais à eux, elle me demanda de les lui lire. Ce fut un nouveau lien entre nous. Repliée sur elle-même, l’intelligence toujours aux aguets, n’étant point occupée par les frivolités ou les niaiseries de la conversation, elle devait trouver dans la lecture ce qu’elle trouva en effet : une distraction et une nourriture.
Combien d’heures nous avons passées ainsi : elle assise devant moi, ne me quittant pas des yeux, moi lisant. Souvent je m’arrêtais en rencontrant des mots ou des passages que je ne comprenais pas et je la regardais. Alors nous restions quelquefois longtemps à chercher ; puis quand nous ne trouvions pas, elle me faisait signe de continuer avec un geste qui voulait dire « plus tard ». Je lui appris aussi à dessiner, c’est-à-dire à ce que j’appelais dessiner. Cela fut long, difficile, mais enfin j’en vins à peu près à bout. Sans doute j’étais un assez pauvre maître. Mais nous nous entendions, et le bon accord du maître et de l’élève vaut souvent mieux que le talent. Quelle joie quand elle traça quelques traits où l’on pouvait reconnaître ce qu’elle avait voulu faire ! Le père Acquin m’embrassa :
— Allons, dit-il en riant, j’aurais pu faire une plus grande bêtise que de te prendre. Lise te payera cela plus tard.
Plus tard, c’est-à-dire quand elle parlerait, car on n’avait point renoncé à lui rendre la parole, seulement les médecins avaient dit que pour le moment il n’y avait rien à faire et qu’il fallait attendre une crise.
Plus tard était aussi le geste triste qu’elle me faisait quand je lui chantais des chansons. Elle avait voulu que je lui apprisse à jouer de la harpe et très-vite ses doigts s’étaient habitués à imiter les miens. Mais naturellement elle n’avait pas pu apprendre à chanter, et cela la dépitait. Bien des fois j’ai vu des larmes dans ses yeux qui me disaient son chagrin. Mais dans sa bonne et douce nature le chagrin ne persistait pas : elle s’essuyait les yeux et avec un sourire résigné, elle me faisait son geste : plus tard.
Adopté par le père Acquin et traité en frère par les enfants, je serais probablement resté à jamais à la Glacière sans une catastrophe qui tout à coup vint une fois encore changer ma vie ; car il était dit que je ne pourrais pas rester longtemps heureux, et que quand je me croirais le mieux assuré du repos, ce serait justement l’heure où je serais rejeté de nouveau, par des événements indépendants de ma volonté, dans ma vie aventureuse.
XXI
LA FAMILLE DISPERSÉE
Il y avait des jours où me trouvant seul et réfléchissant, je me disais :
— Tu es trop heureux mon garçon, ça ne durera pas.
Comment me viendrait le malheur, je ne le prévoyais pas, mais j’étais à peu près certain que, d’un côté ou de l’autre, il me viendrait.
Cela me rendait assez souvent triste, mais d’un autre côté cela avait de bon que pour éviter ce malheur, je m’appliquais à faire de mon mieux ce que je faisais, me figurant que ce serait par ma faute, que je serais frappé.
Ce ne fut point par ma faute, mais si je me trompai sur ce point, je ne devinai que trop juste quant au malheur.
J’ai dit que le père cultivait les giroflées : c’est une culture assez facile et que les jardiniers des environs de Paris réussissent à merveille, témoin les grosses plantes trapues garnies de fleurs du haut en bas qu’ils apportent sur les marchés aux mois d’avril et de mai. La seule habileté nécessaire au jardinier qui cultive les giroflées, est celle qui consiste à choisir des plantes à fleurs doubles, car le monde repousse les fleurs simples. Or, comme les graines qu’on sème donnent dans une proportion à peu près égale des plantes simples et des plantes doubles, il y a un intérêt important à ne garder que les plantes doubles ; sans cela on serait exposé à soigner chèrement cinquante pour cent de plantes qu’il faudrait jeter au moment de les voir fleurir, c’est-à-dire après un an de culture. Ce choix se nomme l’essimplage et il se fait à l’inspection de certains caractères qui se montrent dans les feuilles et dans le port de la plante. Peu de jardiniers savent pratiquer cette opération de l’essimplage et même c’est un secret qui s’est conservé dans quelques familles. Quand les cultivateurs de giroflées ont besoin de faire leur choix de plantes doubles, ils s’adressent à ceux de leurs confrères qui possèdent ce secret, et ceux-ci « vont en ville », ni plus ni moins que des médecins ou des experts, donner leur consultation.
Le père était un des plus habiles essimpleurs de Paris ; aussi au moment où doit se faire cette opération, toutes ses journées étaient-elles prises. C’était alors pour nous et particulièrement pour Étiennette notre mauvais temps, car entre confrères on ne se visite pas sans boire un litre, quelquefois deux, quelquefois trois, et quand il avait ainsi visité deux ou trois jardiniers, il rentrait à la maison la figure rouge, la parole embarrassée et les mains tremblantes.
Jamais Étiennette ne se couchait sans qu’il fût rentré, même quand il rentrait tard, très-tard.
Alors quand j’étais éveillé, ou quand le bruit qu’il faisait me réveillait, j’entendais de ma chambre leur conversation.
— Pourquoi n’es-tu pas couchée ? disait le père.
— Parce que j’ai voulu voir si tu n’avais besoin de rien.
— Ainsi mademoiselle Gendarme me surveille !
— Si je ne veillais pas, à qui parlerais-tu ?
— Tu veux voir si je marche droit ; eh bien ! regarde, je parie que je vais à la porte des enfants sans quitter ce rang de pavés.
Un bruit de pas inégaux retentissait dans la cuisine, puis il se faisait un silence.
— Lise va bien ? disait-il.
— Oui, elle dort ; si tu voulais ne pas faire de bruit.
— Je ne fais pas de bruit, je marche droit, il faut bien que je marche droit puisque les filles accusent leur père. Qu’est-ce qu’elle a dit en ne me voyant pas rentrer pour souper ?
— Rien ; elle a regardé ta place.
— Ah ! elle a regardé ma place.
— Oui.
— Plusieurs fois ? Est-ce qu’elle a regardé plusieurs fois ?
— Souvent.
— Et qu’est-ce qu’elle disait ?
— Ses yeux disaient que tu n’étais pas là.
— Alors elle te demandait pourquoi je n’étais pas là, et tu lui disais que j’étais avec les amis.
— Non, elle ne me demandait rien, et je ne lui disais rien : elle savait bien où tu étais.
— Elle le savait, elle savait que… Elle s’est bien endormie ?
— Non ; il y a un quart d’heure seulement que le sommeil l’a prise, elle voulait t’attendre.
— Et toi, qu’est-ce que tu voulais ?
— Je voulais qu’elle ne te vît pas rentrer.
Puis après un moment de silence :
— Tiennette, tu es une bonne fille ; écoute, demain je vais chez Louisot, eh bien ! je te jure, tu entends bien, je te jure de rentrer pour souper ; je ne veux plus que tu m’attendes, et je ne veux pas que Lise s’endorme tourmentée.
Mais les promesses, les serments ne servaient pas toujours et il n’en rentrait pas moins tard, une fois qu’il acceptait un verre de vin. À la maison, Lise était toute-puissante, dehors elle était oubliée.
— Vois-tu, disait-il, on boit un coup sans y penser, parce qu’on ne peut pas refuser les amis ; on boit le second parce qu’on a bu le premier, et l’on est bien décidé à ne pas boire le troisième ; mais boire donne soif. Et puis, le vin vous monte à la tête ; on sait que quand on est lancé on oublie les chagrins ; on ne pense plus aux créanciers ; on voit tout éclairé par le soleil ; on sort de sa peau pour se promener dans un autre monde, le monde où l’on désirait aller. Et l’on boit. Voilà.
Il faut dire que cela n’arrivait pas souvent. D’ailleurs la saison de l’essimplage n’était pas longue, et quand cette saison était passée le père n’ayant plus de motifs pour sortir, ne sortait plus. Il n’était pas homme à aller au cabaret tout seul, ni par paresse à perdre son temps.
La saison des giroflées terminée, nous préparions d’autres plantes, car il est de règle qu’un jardinier ne doit pas avoir une seule place de son jardin vide : aussitôt que des plantes sont vendues d’autres doivent les remplacer.
L’art pour un jardinier qui travaille en vue du marché est d’apporter ses fleurs sur le marché au moment où il a chance d’en tirer le plus haut prix. Or, ce moment est celui des grandes fêtes de l’année : la Saint-Pierre, la Sainte-Marie, la Saint-Louis, car le nombre est considérable de ceux qui s’appellent Pierre, Marie, Louis ou Louise et par conséquent le nombre est considérable aussi des pots de fleurs ou des bouquets qu’on vend ces jours-là et qui sont destinés à souhaiter la fête à un parent ou à un ami. Tout le monde a vu la veille de ces fêtes les rues de Paris pleines de fleurs, non-seulement dans les boutiques ou sur les marchés, mais encore sur les trottoirs, au coin des rues, sur les marches des maisons, partout où l’on peut disposer un étalage.
Le père Acquin, après sa saison de giroflées, travaillait en vue des grandes fêtes du mois de juillet et du mois d’août, surtout du mois d’août, dans lequel se trouve la Sainte-Marie et la Saint-Louis, et pour cela nous préparions des milliers de reines-marguerites, des fuchsias, des lauriers-roses tout autant que nos châssis et nos serres pouvaient en contenir : il fallait que toutes ces plantes arrivassent à floraison au jour dit, ni trop tôt, elles auraient été passées au moment de la vente, ni trop tard, elles n’auraient pas encore été en fleurs. On comprend que cela exige un certain talent, car on n’est pas maître du soleil, ni du temps, qui est plus ou moins beau. Le père Acquin était passé maître dans cet art, et jamais ses plantes n’arrivaient trop tôt ni trop tard. Mais aussi que de soins, que de travail !
Au moment où j’en suis arrivé de mon récit, notre saison s’annonçait comme devant être excellente ; nous étions au 5 août et toutes nos plantes étaient à point : dans le jardin, en plein air, les reines-marguerites montraient leurs corolles prêtes à s’épanouir, et dans les serres ou sous les châssis dont le verre était soigneusement blanchi au lait de chaux pour tamiser la lumière, fuchsias et lauriers-roses commençaient à fleurir : ils formaient de gros buissons ou des pyramides garnies de boutons du haut en bas, le coup d’œil était superbe ; et, de temps en temps, je voyais le père se frotter les mains avec contentement.
— La saison sera bonne, disait-il à ses fils.
Et en riant tout bas, il faisait le compte de ce que la vente de toutes ces fleurs lui rapporterait.
On avait rudement travaillé pour en arriver là et sans prendre une heure de congé, même le dimanche ; cependant tout étant à point et en ordre, il fut décidé que pour notre récompense nous irions tous dîner ce dimanche 5 août à Arcueil chez un des amis du père, jardinier comme lui ; Capi lui-même serait de la partie. On travaillerait jusqu’à trois ou quatre heures, puis quand tout serait fini, on fermerait la porte à clef, et l’on s’en irait gaiement, on arriverait à Arcueil, vers cinq ou six heures, puis après dîner on reviendrait tout de suite pour ne pas se coucher trop tard et être au travail le lundi de bonne heure, frais et dispos.
Quelle joie !
Il fut fait ainsi qu’il avait été décidé, et quelques minutes avant quatre heures, le père tournait la clef dans la serrure de la grande porte.
— En route tout le monde ! dit-il joyeusement.
— En avant, Capi !
Et prenant Lise par la main, je me mis à courir avec elle accompagné par les aboiements joyeux de Capi qui sautait autour de nous. Peut-être croyait-il que nous nous en allions pour longtemps sur les grands chemins, ce qui lui aurait mieux plu que de rester à la maison, où il s’ennuyait, car il ne m’était pas toujours possible de m’occuper de lui, — ce qu’il aimait par-dessus tout.
Nous étions tous endimanchés et superbes avec nos beaux habits à manger du rôti. Il y avait des gens qui se retournaient pour nous voir passer. Je ne sais pas ce que j’étais moi-même, mais Lise, avec son chapeau de paille, sa robe bleue et ses bottines de toile grise était bien la plus jolie petite fille qu’on puisse voir, la plus vivante ; c’était la grâce dans la vivacité ; ses yeux, ses narines frémissantes, ses épaules, ses bras, ses mains, tout en elle parlait et disait son plaisir.
Le temps passa si vite que je n’en eus pas conscience ; tout ce que je sais, c’est que comme nous arrivions à la fin du dîner, l’un de nous remarqua que le ciel s’emplissait de nuages noirs du côté du couchant, et comme notre table était servie en plein air sous un gros sureau, il nous fut facile de constater qu’un orage se préparait.
— Les enfants, il faut se dépêcher de rentrer à la Glacière.
À ce mot, il y eut une exclamation générale :
— Déjà !
Lise ne dit rien, mais elle fit des gestes de dénégation et de protestation.
— Si le vent s’élève, dit le père, il peut chavirer les panneaux : en route !
Il n’y avait pas à répliquer davantage ; nous savions tous que les panneaux vitrés sont la fortune des jardiniers, et que si le vent casse les verres, c’est la ruine pour eux.
— Je pars en avant, dit le père ; viens avec moi, Benjamin, et toi aussi Alexis, nous prendrons le pas accéléré. Rémi viendra en arrière avec Étiennette et Lise.
Et sans en dire davantage ils partirent à grands pas, tandis que nous les suivions moins vite, réglant notre marche, Étiennette et moi, sur celle de Lise.
Il ne s’agissait plus de rire, et nous ne courions plus, nous ne gambadions plus.
Le ciel devenait de plus en plus noir et l’orage arrivait rapidement précédé par des nuages de poussière que le vent, qui s’était élevé, entraînait en gros tourbillons. Quand on se trouvait pris dans un de ces tourbillons il fallait s’arrêter, tourner le dos au vent, et se boucher les yeux avec les deux mains car on était aveuglé ; si l’on respirait on sentait dans sa bouche un goût de cailloux.
Le tonnerre roulait dans le lointain et ses grondements se rapprochaient rapidement se mêlant à des éclats stridents.
Étiennette et moi nous avions pris Lise par la main, et nous la tirions après nous, mais elle avait peine à nous suivre, et nous ne marchions pas aussi vite que nous aurions voulu.
Arriverions-nous avant l’orage ?
Le père, Benjamin et Alexis, arriveraient-ils ?
Pour eux, la question était de toute autre importance ; pour nous, il s’agissait simplement de n’être pas mouillés, pour eux de mettre les châssis à l’abri de la destruction, c’est-à-dire de les fermer pour que le vent ne pût pas les prendre en dessous et les culbuter pêle-mêle.
Les fracas du tonnerre étaient de plus en plus répétés, et les nuages s’étaient tellement épaissis qu’il faisait presque nuit ; quand le vent les entr’ouvrait, on apercevait çà et là dans leurs tourbillons noirs des profondeurs cuivrées. Évidemment ces nuages allaient crever d’un instant à l’autre.
Chose étrange, au milieu des éclats du tonnerre nous entendîmes un bruit formidable qui arrivait sur nous, et qui était inexplicable : il semblait que c’était un régiment de cavaliers qui se précipitaient pour fuir l’orage : mais cela était absurde ; comment des cavaliers seraient-ils venus dans ce quartier ?
Tout à coup la grêle se mit à tomber ; quelques grêlons d’abord qui nous frappèrent au visage, puis presque instantanément, une vraie avalanche ; il fallut nous jeter sous une grande porte.
Et alors nous vîmes tomber l’averse de grêle la plus terrible qu’on puisse imaginer ; en un instant la rue fut couverte d’une couche blanche comme en plein hiver ; les grêlons étaient gros comme des œufs de pigeon et en tombant ils produisaient un tapage assourdissant au milieu duquel éclataient de temps en temps des bruits de vitres cassées ; avec les grêlons qui glissaient des toits dans la rue tombaient toutes sortes de choses, des morceaux de tuiles, des plâtras, des ardoises broyées, surtout des ardoises qui faisaient des tas noirs au milieu de la blancheur de la grêle.
— Hélas ! les panneaux ! s’écria Étiennette.
C’était aussi la pensée qui m’était venue à l’esprit.
— Peut-être le père sera-t-il arrivé à temps ?
— Quand même ils seraient arrivés avant la grêle, jamais ils n’auront eu le temps de couvrir les panneaux avec les paillassons ; tout va être perdu.
— On dit que la grêle ne tombe que par places.
— Nous sommes trop près de la maison pour qu’elle nous ait épargnés ; si elle tombe sur le jardin comme ici, le pauvre père va être ruiné ; oh ! mon Dieu, il comptait tant sur la vente, et il avait tant besoin de cet argent !
Sans bien connaître le prix des choses j’avais bien souvent entendu dire que les panneaux vitrés coûtaient 15 ou 1,800 francs le cent, et je compris tout de suite quel désastre ce pouvait être pour nous, si la grêle avait brisé nos cinq ou six cents panneaux, sans parler des serres ni des plantes.
J’aurais voulu interroger Étiennette, mais c’était à peine si nous pouvions nous entendre tant le tapage produit par les grêlons était assourdissant ; et puis, à vrai dire, Étiennette ne paraissait pas disposée à parler ; elle regardait tomber la grêle avec une figure désolée, comme doit l’être celle des gens qui voient brûler leur maison.
Cette terrible averse ne dura pas longtemps, cinq ou six minutes peut-être, et elle cessa tout à coup comme tout à coup elle avait commencé : le nuage fila sur Paris et nous pûmes sortir de dessous notre grande porte. Dans la rue, les grêlons durs et ronds roulaient sous les pieds comme les galets de la mer, et il y en avait une telle épaisseur que les pieds enfonçaient dedans jusqu’à la cheville.
Lise, ne pouvant marcher dans cette grêle glacée, avec ses bottines de toile, je la pris sur mon dos ; son visage si gai en venant, était maintenant navré, des larmes roulaient dans ses yeux.
Nous ne tardâmes pas à arriver à la maison dont la grande porte était restée ouverte ; nous entrâmes vivement dans le jardin.
Quel spectacle ! tout était brisé, haché : panneaux, fleurs, morceaux de verre, grêlons formaient un mélange, un fouillis sans forme ; de ce jardin si beau, si riche le matin, rien ne restait que ces débris sans nom.
Où était le père ?
Nous le cherchâmes, ne le voyant nulle part, et nous arrivâmes ainsi à la grande serre dont pas une vitre n’était restée intacte : il était assis, affaissé pour mieux dire, sur un escabeau au milieu des débris qui couvraient le sol, Alexis et Benjamin près de lui immobiles.
— Oh ! mes pauvres enfants ! s’écria-t-il en levant la tête à notre approche, qui lui avait été signalée par le bruit du verre que nous écrasions sous nos pas, oh ! mes pauvres enfants !
Et, prenant Lise dans ses bras, il se mit à pleurer sans ajouter un mot.
Qu’aurait-il dit ?
C’était un désastre ; mais, si grand qu’il fût aux yeux, il était plus terrible encore par ses conséquences.
Bientôt j’appris par Étiennette et par les garçons combien le désespoir du père était justifié. Il y avait dix ans que le père avait acheté ce jardin et avait bâti lui-même cette maison. Celui qui lui avait vendu le terrain lui avait aussi prêté de l’argent pour acheter le matériel nécessaire à son métier de fleuriste. Le tout était payable ou remboursable, en quinze ans, par annuités. Jusqu’à cette époque, le père avait pu payer régulièrement ces annuités, à force de travail et de privations. Ces payements réguliers étaient d’autant plus indispensables, que son créancier n’attendait qu’une occasion, c’est-à-dire qu’un retard, pour reprendre terrain, maison, matériel, en gardant, bien entendu, les dix annuités qu’il avait déjà reçues : c’était même là, paraît-il, sa spéculation, et c’était parce qu’il espérait bien qu’en quinze ans, il arriverait un jour où le père ne pourrait pas payer, qu’il avait risqué cette spéculation, pour lui sans danger, — tandis qu’elle en était pleine, au contraire, pour son débiteur.
Ce jour était enfin venu, grâce à la grêle.
Maintenant qu’allait-il se passer ?
Nous ne restâmes pas longtemps dans l’incertitude, et le lendemain du jour où le père devait payer son annuité avec le produit de la vente des plantes, nous vîmes entrer à la maison un monsieur en noir, qui n’avait pas l’air trop poli et qui nous donna un papier timbré sur lequel il écrivit quelques mots dans une ligne restée en blanc.
C’était un huissier.
Et depuis ce jour il revint à chaque instant, si bien qu’il finit par connaître nos noms.
— Bonjour Rémi, disait-il ; bonjour Alexis, cela va bien, mademoiselle Étiennette ?
Et il nous donnait son papier timbré, en souriant, comme à des amis.
— Au revoir, les enfants !
— Au diable ?
Le père ne restait plus à la maison, il courait la ville. Où allait-il ? je n’en sais rien, car lui qui autrefois était si communicatif, il ne disait plus un mot. Il allait chez les gens d’affaires, sans doute devant les tribunaux.
Et à cette pensée je me sentais effrayé ; Vitalis aussi avait paru devant les tribunaux et je savais ce qui en était résulté.
Pour le père, le résultat se fit beaucoup plus attendre et une partie de l’hiver s’écoula ainsi ; comme nous n’avions pas pu, bien entendu, réparer nos serres et faire vitrer nos panneaux, nous cultivions le jardin en légumes et en fleurs qui ne demandaient pas d’abri ; cela ne serait pas d’un grand produit, mais enfin cela serait toujours quelque chose, et puis c’était du travail.
Un soir le père rentra plus accablé encore que de coutume.
— Les enfants, dit-il, c’est fini.
Je voulus sortir, car je compris qu’il allait se passer quelque chose de grave, et, comme il s’adressait à ses enfants, il me semblait que je ne devais pas écouter.
Mais d’un geste il me retint :
— N’es-tu pas de la famille, dit-il, et quoique tu ne sois pas bien âgé pour entendre ce que j’ai à te dire, tu as déjà été assez éprouvé par le malheur pour le comprendre : les enfants, je vas vous quitter.
Il n’y eut qu’une exclamation, qu’un cri de douleur.
Lise sauta dans ses bras et l’embrassa en pleurant.
— Oh ! vous pensez bien que ce n’est pas volontairement qu’on abandonne des bons enfants comme vous, une chère petite comme Lise.
Et il la serra sur son cœur.
— Mais j’ai été condamné à payer et comme je n’ai pas l’argent, on va tout vendre ici, puis comme ce ne sera pas assez, on me mettra en prison, où je resterai cinq ans ; ne pouvant pas payer avec mon argent je payerai avec mon corps, avec ma liberté.
Nous nous mîmes tous à pleurer.
— Oui, c’est bien triste, dit-il, mais il n’y a pas à aller contre la loi, et c’est la loi ; il paraît qu’autrefois elle était encore plus dure, m’a dit mon avocat, et que quand un débiteur ne pouvait pas payer ses créanciers, ceux-ci avaient le droit de mettre son corps en morceaux et de se le partager en autant de parties qu’ils le voulaient ; moi on me met simplement en prison, et j’y serai sans doute dans quelques jours, j’y serai pour cinq ans. Que deviendrez-vous pendant ce temps-là ? Voilà le terrible.
Il se fit un silence ; je ne sais ce qu’il fut pour les autres enfants, mais pour moi il fut affreux.
— Vous pensez bien que je n’ai pas été sans réfléchir à cela ; et voilà ce que j’ai décidé pour ne pas vous laisser seuls et abandonnés après que j’aurai été arrêté.
Un peu d’espérance me revint.
— Rémi va écrire à ma sœur Catherine Suriot, à Dreuzy, dans la Nièvre ; il va lui expliquer la position et la prier de venir ; avec Catherine qui ne perd pas facilement la tête, et qui connaît les affaires, nous déciderons le meilleur.
C’était la première fois que j’écrivais une lettre, ce fut un pénible, un cruel début.
Bien que les paroles du père fussent vagues, elles contenaient pourtant une espérance, et dans la position où nous étions, c’était déjà beaucoup que d’espérer.
Quoi ?
Nous ne le voyions pas ; mais nous espérions ; Catherine allait arriver et c’était une femme qui connaissait les affaires ; cela suffisait à des enfants simples et ignorants tels que nous.
Pour ceux qui connaissent les affaires, il n’y a plus de difficultés en ce monde.
Cependant elle n’arriva pas aussi tôt que nous l’avions imaginé, et les gardes du commerce, c’est-à-dire les gens qui arrêtent les débiteurs, arrivèrent avant elle.
Le père allait justement s’en aller chez un de ses amis, lorsqu’en sortant dans la rue, il les trouva devant lui ; je l’accompagnais, en une seconde nous fûmes entourés. Mais le père ne voulait pas se sauver, il pâlit comme s’il allait se trouver mal et demanda aux gardes d’une voix faible à embrasser ses enfants.
— Il ne faut pas vous désoler, mon brave, dit l’un d’eux, la prison pour dettes n’est pas si terrible que ça et on y trouve de bons garçons.
Nous rentrâmes à la maison, entourés des gardes du commerce.
J’allai chercher les garçons dans le jardin.
Quand nous revînmes, le père tenait dans ses bras Lise, qui pleurait à chaudes larmes.
Alors un des gardes lui parla à l’oreille, mais je n’entendis pas ce qu’il lui dit.
— Oui, répondit le père, vous avez raison, il le faut.
Et se levant brusquement, il posa Lise à terre, mais elle se cramponna à lui, et ne voulut pas lâcher sa main.
Alors il embrassa Étiennette, Alexis et Benjamin.
Je me tenais dans un coin, les yeux obscurcis par les larmes, il m’appela :
— Et toi, Rémi, ne viens-tu pas m’embrasser, n’es-tu pas mon enfant ?
Nous étions éperdus.
— Restez là, dit le père d’un ton de commandement, je vous l’ordonne.
Et vivement il sortit après avoir mis la main de Lise dans celle d’Étiennette.
J’aurais voulu le suivre, et je me dirigeai vers la porte, mais Étiennette me fit signe de m’arrêter.
Où aurais-je été ? Qu’aurais-je fait ?
Nous restâmes anéantis au milieu de notre cuisine ; nous pleurions tous et personne d’entre nous ne trouvait un mot à dire.
Quel mot ?
Nous savions bien que cette arrestation devait se faire un jour ou l’autre, mais nous avions cru qu’alors Catherine serait là, et Catherine c’était la défense.
Mais Catherine n’était pas là.
Elle arriva cependant une heure environ après le départ du père, et elle nous trouva tous dans la cuisine sans que nous eussions échangé une parole. Celle qui jusqu’à ce moment nous avait soutenus était à son tour écrasée ; Étiennette si forte, si vaillante pour lutter, était maintenant aussi faible que nous ; elle ne nous encourageait plus, sans volonté, sans direction, toute à sa douleur qu’elle ne refoulait que pour tâcher de consoler celle de Lise. Le pilote était tombé à la mer, et nous enfants, désormais sans personne au gouvernail, sans phare pour nous guider, sans rien pour nous conduire au port, sans même savoir s’il y avait un port pour nous, nous restions perdus au milieu de l’océan de la vie, ballottés au caprice du vent, incapables d’un mouvement ou d’une idée, l’effroi dans l’esprit, la désespérance dans le cœur.
C’était une maîtresse femme que la tante Catherine, femme d’initiative et de volonté ; elle avait été nourrice à Paris, pendant dix ans, à cinq reprises différentes ; elle connaissait les difficultés de ce monde, et comme elle le disait elle-même, elle savait se retourner.
Ce fut un soulagement pour nous de l’entendre nous commander et de lui obéir, nous avions retrouvé une indication, nous étions replacés debout sur nos jambes.
Pour une paysanne sans éducation, comme sans fortune, c’était une lourde responsabilité qui lui tombait sur les bras, et bien faite pour inquiéter les plus braves ; une famille d’orphelins dont l’aîné n’avait pas seize ans et dont la plus jeune était muette. Que faire de ces enfants ? Comment s’en charger quand on avait bien du mal à vivre soi-même ?
Le père d’un des enfants qu’elle avait nourris était notaire ; elle l’alla consulter, et ce fut avec lui, d’après ses conseils et ses soins, que notre sort fut arrêté. Puis ensuite elle alla s’entendre avec le père à la prison, et huit jours après son arrivée à Paris, sans nous avoir une seule fois parlé de ses démarches et de ses intentions, elle nous fit part de la décision qui avait été prise.
Comme nous étions trop jeunes pour continuer à travailler seuls, chacun des enfants s’en irait chez des oncles et des tantes qui voulaient bien les prendre :
Lise chez tante Catherine dans le Morvan.
Alexis chez un oncle qui était mineur à Varses, dans les Cévennes.
Benjamin chez un autre oncle qui était jardinier à Saint-Quentin.
Et Étiennette chez une tante qui était mariée dans la Charente au bord de la mer, à Esnandes.
J’écoutais ces dispositions, attendant qu’on en vînt à moi. Mais comme la tante Catherine avait cessé de parler, je m’avançai :
— Et moi ? dis-je.
— Toi, mais tu n’es pas de la famille.
— Je travaillerai pour vous.
— Tu n’es pas de la famille.
— Demandez à Alexis, à Benjamin si je n’ai pas du courage à l’ouvrage.
— Et à la soupe aussi, n’est-il pas vrai ?
— Si, si, il est de la famille, dirent-ils tous.
Lise s’avança et joignit les mains devant sa tante avec un geste qui en disait plus que de longs discours.
— Ma pauvre petite, dit la tante Catherine, je te comprends bien, tu veux qu’il vienne avec toi ; mais vois-tu dans la vie, on ne fait pas ce qu’on veut. Toi tu es ma nièce, et quand nous allons arriver à la maison, si l’homme dit une parole de travers, ou fait la mine pour se tasser à table, je n’aurai qu’un mot à répondre : « Elle est de la famille, qui donc en aura pitié si ce n’est nous ? » Et ce que je te dis là pour nous, est tout aussi vrai pour l’oncle de Saint-Quentin, pour celui de Varses, pour la tante d’Esnandes. On accepte ses parents, on n’accueille pas les étrangers ; le pain est mince rien que pour la seule famille, il n’y en a pas pour tout le monde.
Je sentis bien qu’il n’y avait rien à faire, rien à ajouter. Ce qu’elle disait n’était que trop vrai. « Je n’étais pas de la famille. » Je n’avais rien à réclamer ; demander, c’était mendier. Et cependant, est-ce que je les aurais mieux aimés si j’avais été de leur famille ? Alexis, Benjamin n’étaient-ils pas mes frères, Étiennette, Lise n’étaient-elles pas mes sœurs ? Je ne les aimais donc pas assez ? Et Lise ne m’aimait donc pas autant qu’elle aimait Benjamin ou Alexis ?
La tante Catherine ne différait jamais l’exécution de ses résolutions : elle nous prévint que notre séparation aurait lieu le lendemain, et là-dessus elle nous envoya coucher.
À peine étions-nous dans notre chambre que tout le monde m’entoura, et que Lise se jeta sur moi en pleurant. Alors je compris que malgré le chagrin de se séparer c’était à moi qu’ils pensaient, c’était moi qu’ils plaignaient, et je sentis que j’étais bien leur frère. Alors une idée se fit jour dans mon esprit troublé, ou plus justement, car il faut dire le bien comme le mal, une inspiration du cœur me monta du cœur dans l’esprit.
— Écoutez, leur dis-je, je vois bien que si vos parents ne veulent pas de moi, vous me faites de votre famille, vous.
— Oui, dirent-ils tous les trois, tu seras toujours notre frère.
Lise, qui ne pouvait pas parler, ratifia ces mots en me serrant la main et en me regardant si profondément que les larmes me montèrent aux yeux.
— Eh bien ! oui, je le serai, et je vous le prouverai.
— Où veux-tu te placer ? dit Benjamin.
— Il y a une place chez Pernuit : veux-tu que j’aille la demander demain matin pour toi ? dit Étiennette.
— Je ne veux pas me placer ; en me plaçant, je resterais à Paris ; je ne vous verrais plus. Je vais reprendre ma peau de mouton, je vais décrocher ma harpe du clou où le père l’avait mise, et j’irai de Saint-Quentin à Varses, de Varses à Esnandes, d’Esnandes à Dreuzy ; je vous verrai tous, les uns après les autres, et ainsi, par moi, vous serez toujours ensemble. Je n’ai pas oublié mes chansons et mes airs de danse ; je gagnerai ma vie.
À la satisfaction qui parut sur toutes les figures, je vis que mon idée réalisait leurs propres inspirations, et, dans mon chagrin, je me sentis tout heureux. Longtemps on parla de notre projet, de notre séparation, de notre réunion, du passé, de l’avenir. Puis Étiennette voulut que chacun s’allât mettre au lit ; mais personne ne dormit bien cette nuit-là et moi moins bien encore que les autres peut-être.
Le lendemain, dès le petit matin, Lise m’emmena dans le jardin, et je compris qu’elle avait quelque chose à me dire.
— Tu veux me parler ?
Elle fit un signe affirmatif.
— Tu as du chagrin de nous séparer ; tu n’as pas besoin de me le dire, je le vois dans tes yeux et le sens dans mon cœur.
Elle fit signe que ce n’était pas de cela qu’il était question.
— Dans quinze jours, je serai à Dreuzy.
Elle secoua la tête.
— Tu ne veux pas que j’aille à Dreuzy ?
Pour nous comprendre, c’était généralement par interrogations que je procédais, et elle répondait par un signe négatif ou affirmatif.
Elle me dit qu’elle voulait que je vienne à Dreuzy ; mais, étendant la main dans trois directions différentes, elle me fit comprendre que je devais, avant, aller voir ses deux frères et sa sœur.
— Tu veux que j’aille avant à Varses, à Esnandes et à Saint-Quentin ?
Elle sourit, heureuse d’avoir été comprise.
— Pourquoi ? Moi je voudrais te voir la première.
Alors de ses mains, de ses lèvres et surtout de ses yeux parlants elle me fit comprendre pourquoi elle me faisait cette demande ; je vous traduis ce qu’elle m’expliqua :
— Pour que j’aie des nouvelles d’Étiennette, d’Alexis et de Benjamin, il faut que tu commences par les voir : tu viendras alors à Dreuzy et tu me répéteras ce que tu as vu, ce qu’ils t’ont dit.
Chère Lise !
Ils devaient partir à huit heures du matin, et la tante Catherine avait demandé un grand fiacre pour les conduire tous d’abord à la prison embrasser le père, puis ensuite chacun avec leur paquet au chemin de fer où ils devaient s’embarquer.
À sept heures, Étiennette à son tour m’emmena dans le jardin.
— Nous allons nous séparer, dit-elle ; je voudrais te laisser un souvenir, prends cela ; c’est une ménagère ; tu trouveras là dedans du fil, des aiguilles, et aussi mes ciseaux, que mon parrain m’a donnés ; en chemin, tu auras besoin de tout cela, car je ne serai pas là pour te remettre une pièce ou te coudre un bouton. En te servant de mes ciseaux, tu penseras à nous.
Pendant qu’Étiennette me parlait, Alexis rôdait autour de nous ; lorsqu’elle fut rentrée dans la maison, tandis que je restais tout ému dans le jardin, il s’approcha de moi :
— J’ai deux pièces de cent sous, dit-il ; si tu veux en accepter une, ça me fera plaisir.
De nous cinq, Alexis était le seul qui eût le sentiment de l’argent, et nous nous moquions toujours de son avarice ; il amassait sou à sou et prenait un véritable bonheur à avoir des pièces de dix sous et de vingt sous neuves, qu’il comptait sans cesse dans sa main en les faisant reluire au soleil et en les écoutant chanter.
Son offre me remua le cœur : je voulus refuser, mais il insista et me glissa dans la main une belle pièce brillante ; par là je sentis que son amitié pour moi devait être bien forte puisqu’elle l’emportait sur son amitié pour son petit trésor.
Benjamin ne m’oublia pas davantage, et il voulut aussi me faire un cadeau ; il me donna son couteau et en échange il exigea un sou « parce que les couteaux coupent l’amitié. »
L’heure marchait vite ; encore un quart d’heure, encore cinq minutes et nous allions être séparés : Lise ne penserait-elle pas à moi ?
Au moment où le roulement de la voiture se fit entendre, elle sortit de la chambre de tante Catherine et me fit signe de la suivre dans le jardin.
— Lise ! appela tante Catherine.
Mais Lise, sans répondre, continua son chemin en se hâtant.
Dans les jardins des fleuristes et des maraîchers, tout est sacrifié à l’utilité, et la place n’est point donnée aux plantes de fantaisie ou d’agrément. Cependant dans notre jardin, il y avait un gros rosier de Bengale qu’on n’avait point arraché parce qu’il était dans un coin perdu.
Lise se dirigea vers ce rosier auquel elle coupa une branche, puis se tournant vers moi, elle divisa en deux ce rameau qui portait deux petits boutons près d’éclore et m’en donna un.
Ah ! que le langage des lèvres est peu de chose comparé à celui des yeux ! que les mots sont froids et vides comparés aux regards !
— Lise ! Lise ! cria la tante.
Déjà les paquets étaient sur le fiacre.
Je pris ma harpe et j’appelai Capi, qui, à la vue de l’instrument et de mon ancien costume, qui n’avait rien d’effrayant pour lui, sautait de joie, comprenant sans doute que nous allions nous remettre en route et qu’il pourrait sauter, courir en liberté, ce qui, pour lui, était plus amusant que de rester enfermé.
Le moment des adieux était venu. La tante Catherine l’abrégea ; elle fit monter Étiennette, Alexis et Benjamin, et me dit de lui donner Lise sur ses genoux.
Puis, comme je restais abasourdi, elle me repoussa doucement et ferma la portière.
— En route, dit-elle.
Et la voiture partit.
À travers mes larmes, je vis la tête de Lise se pencher par la glace baissée et sa main m’envoyer un baiser. Puis la voiture tourna rapidement le coin de la rue, et je ne vis plus qu’un tourbillon de poussière.
C’était fini.
Appuyé sur ma harpe, Capi à mes pieds, je restai assez longtemps à regarder machinalement la poussière qui retombait doucement dans la rue.
Un voisin avait été chargé de fermer la maison et d’en garder les clefs pour le propriétaire ; il me tira de mon anéantissement et me rappela à la réalité.
— Vas-tu rester là ? me dit-il.
— Non, je pars.
— Où vas-tu ?
— Droit devant moi.
Sans doute, il eut un mouvement de pitié, car me tendant la main :
— Si tu veux rester, dit-il, je te garderai, mais sans gages parce que tu n’es pas assez fort ; plus tard, je ne dis pas.
Je le remerciai.
— À ton goût, ce que j’en disais c’était pour toi ; bon voyage !
Et il s’en alla.
La voiture était partie ; la maison était fermée.
Je passai la bandoulière de ma harpe sur mon épaule : ce mouvement que j’avais fait si souvent autrefois provoqua l’attention de Capi ; il se leva, attachant sur mon visage ses yeux brillants.
— Allons, Capi !
Il avait compris ; il sauta devant moi en aboyant.
Je détournai les yeux de cette maison, où j’avais vécu deux ans, où j’avais cru vivre toujours et je les portai devant moi.
Le soleil était haut à l’horizon, le ciel pur, le temps chaud ; cela ne ressemblait guère à la nuit glaciale dans laquelle j’étais tombé de fatigue et d’épuisement au pied de ce mur.
Ces deux années n’avaient donc été qu’une halte ; il me fallait reprendre ma route.
Mais cette halte avait été bienfaisante.
Elle m’avait donné la force.
Et ce qui valait mieux encore que la force que je sentais dans mes membres, c’était l’amitié que je me sentais dans le cœur.
Je n’étais plus seul au monde.
Dans la vie j’avais un but : être utile et faire plaisir à ceux que j’aimais et qui m’aimaient.
Une existence nouvelle s’ouvrait devant moi.
En avant !
DEUXIÈME PARTIE
I
EN AVANT
En avant !
Le monde était ouvert devant moi, et je pouvais tourner mes pas du côté du nord ou du sud, de l’ouest ou de l’est, selon mon caprice.
Bien que n’étant qu’un enfant, j’étais mon maître.
Hélas ! c’était là ce qu’il y avait de triste dans ma position.
Il y a bien des enfants, n’est-ce pas, qui se disent tout bas : « Ah ! si je pouvais faire ce qui me plaît ; si j’étais libre ; si j’étais mon maître ! » et qui aspirent avec impatience au jour bienheureux où ils auront cette liberté… de faire des sottises.
Moi je me disais : « Ah ! si j’avais quelqu’un pour me conseiller, pour me diriger. »
C’est qu’entre ces enfants et moi il y avait une différence… terrible.
Si ces enfants font des sottises, ils ont derrière eux quelqu’un pour leur tendre la main quand ils tombent, ou pour les ramasser quand ils sont à terre ; tandis que moi, je n’avais personne ; si je tombais, je devais aller jusqu’au bas ; et une fois là me ramasser tout seul, si je n’étais pas cassé.
Et j’avais assez d’expérience pour comprendre que je pouvais très-bien me casser ; — ce qui me faisait peur, j’en conviens.
Malgré ma jeunesse, j’avais été assez éprouvé par le malheur pour être plus circonspect et plus prudent que ne le sont ordinairement les enfants de mon âge ; c’était un avantage que j’avais payé cher.
Aussi avant de me lancer sur la route qui m’était ouverte, je voulus aller voir celui qui, en ces dernières années, avait été un père pour moi : si la tante Catherine ne m’avait pas pris avec les enfants pour aller lui dire adieu, je pouvais bien, je devais bien tout seul aller l’embrasser.
Sans avoir jamais été à la prison pour dettes, j’en avais assez entendu parler en ces derniers temps, pour être certain de la trouver. Je suivrais le chemin de la Madeleine que je connaissais bien, et là je demanderais ma route. Puisque tante Catherine et les enfants avaient pu voir leur père, on me permettrait bien de le voir aussi sans doute. Moi aussi, j’étais ou plutôt j’avais été son enfant, il m’avait aimé !
Je n’osai pas traverser tout Paris avec Capi sur mes talons. Qu’aurais-je répondu aux sergents de ville s’ils m’avaient parlé ? De toutes les peurs qui m’avaient été inspirées par l’expérience, celle de la police était la plus grande : je n’avais pas oublié Toulouse. J’attachai Capi avec une corde, ce qui parut le blesser très-vivement dans son amour-propre de chien instruit et bien élevé ; puis, le tenant en laisse, nous nous mîmes tous deux en route pour la prison de Clichy.
Il y a des choses tristes en ce monde et dont la vue porte à des réflexions lugubres ; je n’en connais pas de plus laide et de plus triste qu’une porte de prison : cela donne froid au cœur plus qu’une porte de tombeau ; les morts sur lesquels une pierre est scellée ne sentent plus ; les prisonniers, eux, sont enterrés vivants.
Je m’arrêtai un moment avant d’oser entrer dans la prison de Clichy, comme si j’avais peur qu’on m’y gardât et que la porte, cette affreuse porte, refermée sur moi, ne se rouvrît plus.
Je m’imaginais qu’il était difficile de sortir d’une prison ; mais je ne savais pas qu’il était difficile aussi d’y entrer. Je l’appris à mes dépens.
Enfin, comme je ne me laissai ni rebuter ni renvoyer, je finis par arriver auprès de celui que je venais voir.
On me fit entrer dans un parloir où il n’y avait ni grilles ni barreaux, comme je croyais, et bientôt après le père arriva, sans être chargé de chaînes.
— Je t’attendais, mon petit Rémi, me dit-il, et j’ai grondé Catherine de ne pas t’avoir amené avec les enfants.
Depuis le matin, j’étais triste et accablé ; cette parole me releva.
— Dame Catherine n’a pas voulu me prendre avec elle.
— Cela n’était pas possible, mon pauvre garçon, on ne fait pas ce qu’on veut en ce monde ; je suis sûr que tu aurais bien travaillé pour gagner ta vie ; mais Suriot, mon beau-frère, n’aurait pas pu te donner du travail ; il est éclusier au canal du Nivernais, et les éclusiers, tu le sais, n’embauchent pas des ouvriers jardiniers. Les enfants m’ont dit que tu voulais reprendre ton métier de chanteur. Tu as donc oublié que tu as failli mourir de froid et de faim à notre porte ?
— Non, je ne l’ai pas oublié.
— Et alors tu n’étais pas tout seul, tu avais un maître pour te guider ; c’est bien grave, mon garçon, ce que tu veux entreprendre, à ton âge, seul, par les grands chemins.
— J’ai Capi.
Comme toujours, en entendant son nom, Capi répondit par un aboiement qui voulait dire : « Présent ! si vous avez besoin de moi, me voici. »
— Oui ! Capi est un bon chien ; mais ce n’est qu’un chien. Comment gagneras-tu ta vie ?
— En chantant et en faisant jouer la comédie à Capi.
— Capi ne peut pas jouer la comédie tout seul.
— Je lui apprendrai des tours d’adresse ; n’est-ce pas, Capi, que tu apprendras tout ce que je voudrai ?
Il mit sa patte sur sa poitrine.
— Enfin, mon garçon, si tu étais sage, tu te placerais ; tu es déjà bon ouvrier, cela vaudrait mieux que de courir les chemins, ce qui est un métier de paresseux.
— Je ne suis pas paresseux, vous le savez bien, et vous ne m’avez jamais entendu me plaindre que j’avais trop d’ouvrage. Chez vous j’aurais travaillé tant que j’aurais pu et je serais resté toujours avec vous ; mais je ne veux pas me placer chez les autres.
Je dis sans doute ces derniers mots d’une façon particulière, car le père me regarda un moment sans répondre.
— Tu nous as raconté, dit-il enfin, que Vitalis, alors que tu ne savais pas qui il était, t’étonnait bien souvent par la façon dont il regardait les gens, et par ses airs de monsieur qui semblaient dire qu’il était lui-même un monsieur ; sais-tu que toi aussi, tu as de ces façons-là et de ces airs qui semblent dire que tu n’es pas un pauvre diable. Tu ne veux pas servir chez les autres ? Enfin, mon garçon, tu as peut-être raison, et ce que je t’en disais, c’était seulement pour ton bien, pas pour autre chose, crois-le. Il me semble que je devais te parler comme je l’ai fait. Mais tu es ton maître puisque tu n’as pas de parents et puisque je ne puis pas te servir de père plus longtemps. Un pauvre malheureux comme moi n’a pas le droit de parler haut.
Tout ce que le père venait de me dire m’avait terriblement troublé, et d’autant plus que je me l’étais déjà dit moi-même, sinon dans les mêmes termes, au moins à peu près.
Oui, cela était grave de m’en aller tout seul par les grands chemins, je le sentais, je le voyais, et quand on avait, comme moi, pratiqué la vie errante, quand on avait passé des nuits comme celle où nos chiens avaient été dévorés par les loups, ou bien encore comme celle des carrières de Gentilly ; quand on avait souffert du froid et de la faim comme j’en avais souffert ; quand on s’était vu chassé de village en village, sans pouvoir gagner un sou, comme cela m’était arrivé pendant que Vitalis était en prison, on savait quels étaient les dangers et quelles étaient les misères de cette existence vagabonde, où ce n’est pas seulement le lendemain qui n’est jamais assuré, mais où c’est même l’heure présente qui est incertaine et précaire.
Mais si je renonçais à cette existence, je n’avais qu’une ressource et le père lui-même venait de me l’indiquer, — me placer ; et je ne voulais pas me placer. Cela était peut-être d’une fierté bien mal entendue dans ma position ; mais j’avais eu un maître à qui j’avais été vendu, et bien que celui-là eût été bon pour moi, je n’en voulais pas d’autre ; cela était chez moi une idée fixe.
Et puis ce qui était tout aussi décisif pour ma résolution, je ne pouvais renoncer à cette existence de liberté et de voyages sans manquer à ma promesse envers Étiennette, Alexis, Benjamin et Lise ; c’est-à-dire sans les abandonner. En réalité, Étiennette, Alexis et Benjamin pouvaient se passer de moi, ils s’écriraient ; mais Lise ! Lise ne savait pas écrire, la tante Catherine n’écrivait pas non plus. Lise resterait donc perdue si je l’abandonnais. Que penserait-elle de moi ? Une seule chose : que je ne l’aimais plus, elle qui m’avait témoigné tant d’amitié, elle par qui j’avais été si heureux. Cela n’était pas possible.
— Vous ne voulez donc pas que je vous donne des nouvelles des enfants ? dis-je.
— Ils m’ont parlé de cela ; mais ce n’est pas à nous que je pense en t’engageant à renoncer à ta vie de musicien des rues ; il ne faut jamais penser à soi avant de penser aux autres.
— Justement, père ; et vous voyez bien que c’est vous qui m’indiquez ce que je dois faire : si je renonçais à l’engagement que j’ai pris, par peur des dangers dont vous parlez, je penserais à moi, je ne penserais pas à vous, je ne penserais pas à Lise.
Il me regarda encore, mais plus longuement ; puis tout à coup me prenant les deux mains :
— Tiens, garçon, il faut que je t’embrasse pour cette parole-là, tu as du cœur, et c’est bien vrai que ce n’est pas l’âge qui le donne.
Nous étions seuls dans le parloir, assis sur un banc à côté l’un de l’autre, je me jetai dans ses bras, ému, fier aussi d’entendre dire que j’avais du cœur.
— Je ne te dirai plus qu’un mot, reprit le père : à la garde de Dieu, mon cher garçon !
Et tous deux nous restâmes pendant quelques instants silencieux ; mais le temps avait marché et le moment de nous séparer était venu.
Tout à coup le père fouilla dans la poche de son gilet et en retira une grosse montre en argent, qui était retenue dans une boutonnière par une petite lanière en cuir.
— Il ne sera pas dit que nous nous serons séparés sans que tu emportes un souvenir de moi. Voici ma montre, je te la donne. Elle n’a pas grande valeur, car tu comprends que si elle en avait, je l’aurais vendue. Elle ne marche pas non plus très-bien, et elle a besoin de temps en temps d’un bon coup de pouce. Mais enfin, c’est tout ce que je possède présentement, et c’est pour cela que je te la donne.
Disant cela, il me la mit dans la main ; puis, comme je voulais me défendre d’accepter un si beau cadeau, il ajouta tristement :
— Tu comprends que je n’ai pas besoin de savoir l’heure ici ; le temps n’est que trop long ; je mourrais à le compter. Adieu, mon petit Rémi ; embrasse-moi encore un coup ; tu es un brave garçon : souviens-toi qu’il faut l’être toujours.
Et je crois qu’il me prit par la main pour me conduire à la porte de sortie : mais ce qui se passa alors, ce qui se dit entre nous, je n’en ai pas gardé souvenir ; j’étais trop troublé, trop ému.
Quand je pense à cette séparation, ce que je retrouve dans ma mémoire, c’est le sentiment de stupidité et d’anéantissement qui me prit tout entier quand je fus dans la rue.
Je crois que je restai longtemps, très-longtemps dans la rue devant la porte de la prison, sans pouvoir me décider à tourner mes pas à droite ou à gauche, et j’y serais peut-être demeuré jusqu’à la nuit, si ma main n’avait tout à coup, par hasard, rencontré dans ma poche un objet rond et dur.
Machinalement et sans trop savoir ce que je faisais, je le palpai : ma montre !
Instantanément chagrins, inquiétudes, angoisses, tout fut oublié, je ne pensai plus qu’à ma montre. J’avais une montre, une montre à moi, dans ma poche, à laquelle je pouvais regarder l’heure ! Et je la tirai de ma poche pour voir quelle heure il était : midi. Cela n’avait aucune importance pour moi qu’il fût midi ou dix heures, ou deux heures, mais je fus très-heureux pourtant qu’il fût midi. Pourquoi ? J’aurais été bien embarrassé de le dire ; mais cela était. Ah ! midi, déjà midi. Je savais qu’il était midi, ma montre me l’avait dit ; quelle affaire ! Et il me sembla qu’une montre c’était une sorte de confident à qui l’on demandait conseil et avec qui l’on pouvait s’entretenir.
— Quelle heure est-il, mon amie la montre ? —
— Midi, mon cher Rémi. — Ah ! midi, alors je dois faire ceci et cela, n’est-ce pas ? — Mais certainement. — Tu as bien fait de me le rappeler, sans toi je l’oubliais. — Je suis là pour que tu n’oublies pas. Avec Capi et ma montre j’avais maintenant à qui parler.
Ma montre ! Voilà deux mots agréables à prononcer. J’avais eu si grande envie d’avoir une montre, et je m’étais toujours si bien convaincu moi-même que je n’en pourrais jamais avoir une ! Et cependant voilà que dans ma poche il y en avait une qui faisait tic-tac. Elle ne marchait pas très-bien, disait le père. Cela n’avait pas d’importance. Elle marchait, cela suffisait. Elle avait besoin d’un bon coup de pouce. Je lui en donnerais et de vigoureux encore, sans les lui épargner, et si les coups de pouce ne suffisaient pas, je la démonterais moi-même. Voilà qui serait intéressant : je verrais ce qu’il y avait dedans et ce qui la faisait marcher. Elle n’avait qu’à se bien tenir : je la conduirais sévèrement.
Je m’étais si bien laissé emporter par la joie que je ne m’apercevais pas que Capi était presque aussi joyeux que moi ; il me tirait par la jambe de mon pantalon et il jappait de temps en temps. Enfin ses jappements, de plus en plus forts, m’arrachèrent à mon rêve.
— Que veux-tu, Capi ?
Il me regarda, et, comme j’étais trop troublé pour le comprendre, après quelques secondes d’attente, il se dressa contre moi et posa sa patte contre ma poche, celle où était ma montre.
Il voulait savoir l’heure « pour la dire à l’honorable société », comme au temps où il travaillait avec Vitalis.
Je la lui montrai ; il la regarda assez longtemps, comme s’il cherchait à se rappeler, puis, se mettant à frétiller de la queue, il aboya douze fois ; il n’avait pas oublié. Ah ! comme nous allions gagner de l’argent avec notre montre ! C’était un tour de plus sur lequel je n’avais pas compté.
Comme tout cela se passait dans la rue vis-à-vis la porte de la prison, il y avait des gens qui nous regardaient curieusement et même qui s’arrêtaient.
Si j’avais osé j’aurais donné une représentation tout de suite, mais la peur des sergents de ville m’en empêcha.
D’ailleurs il était midi, c’était le moment de me mettre en route.
— En avant !
Je donnai un dernier regard, un dernier adieu à la prison, derrière les murs de laquelle le pauvre père allait rester enfermé, tandis que moi j’irais librement où je voudrais, et nous partîmes.
L’objet qui m’était le plus utile pour mon métier c’était une carte de France ; je savais qu’on en vendait sur les quais, et j’avais décidé que j’en achèterais une : je me dirigeai donc vers les quais.
En passant sur la place du Carrousel mes yeux se portèrent machinalement sur l’horloge du château des Tuileries, et l’idée me vint de voir si ma montre et le château marchaient ensemble, ainsi que cela devait être. Ma montre marquait midi et demi, et l’horloge du château une heure. Qui des deux allait trop lentement ? J’eus envie de donner un coup de pouce à ma montre, mais la réflexion me retint : rien ne prouvait que c’était ma montre qui était dans son tort, ma belle et chère montre ; et il se pouvait très-bien que ce fût l’horloge du château des rois qui battît la breloque. Là-dessus je remis ma montre dans ma poche en me disant que pour ce que j’avais à faire, mon heure était la bonne heure !
Il me fallut longtemps pour trouver une carte, au moins comme j’en voulais une, c’est-à-dire collée sur toile, se pliant et ne coûtant pas plus de vingt sous, ce qui pour moi était une grosse somme ; enfin j’en trouvai une si jaunie que le marchand ne me la fit payer que soixante-quinze centimes.
Maintenant je pouvais sortir de Paris, — ce que je me décidai à faire au plus vite.
J’avais deux routes à prendre ; celle de Fontainebleau par la barrière d’Italie, ou bien celle d’Orléans par Montrouge : en somme, l’une m’était tout aussi indifférente que l’autre, et le hasard fit que je choisis celle de Fontainebleau.
Comme je montais la rue Mouffetard dont le nom que je venais de lire sur une plaque bleue m’avait rappelé tout un monde de souvenirs : Garofoli, Mattia, Riccardo, la marmite avec son couvercle fermé au cadenas, le fouet aux lanières de cuir et enfin Vitalis, mon pauvre et bon maître, qui était mort pour ne pas m’avoir loué au padrone de la rue de Lourcine, il me sembla, en arrivant à l’église Saint-Médard, reconnaître dans un enfant appuyé contre le mur de l’église le petit Mattia : c’était bien la même grosse tête, les mêmes yeux mouillés, les mêmes lèvres parlantes, le même air doux et résigné, la même tournure comique ; mais chose étrange, si c’était lui, il n’avait pas grandi.
Je m’approchai pour le mieux examiner ; il n’y avait pas à en douter, c’était lui ; il me reconnut aussi, car son pâle visage s’éclaira d’un sourire.
— C’est vous, dit-il, qui êtes venu chez Garofoli avec le vieux à barbe blanche avant que j’entre à l’hôpital ? Ah ! comme j’avais mal dans la tête, ce jour-là.
— Et Garofoli est toujours votre maître ?
Il regarda autour de lui avant de répondre ; alors baissant la voix :
— Garofoli est en prison ; on l’a arrêté parce qu’il a fait mourir Orlando pour l’avoir trop battu.
Cela me fit plaisir de savoir Garofoli en prison, et pour la première fois j’eus la pensée que les prisons, qui m’inspiraient tant d’horreur, pouvaient être utiles.
— Et les enfants ? dis-je.
— Ah ! je ne sais pas, je n’étais pas là quand Garofoli a été arrêté. Quand je suis sorti de l’hôpital, Garofoli, voyant que je n’étais pas bon à battre sans que ça me rende malade, a voulu se débarrasser de moi, et il m’a loué pour deux ans, payés d’avance, au cirque Gassot. Vous connaissez le cirque Gassot ? Non. Eh bien ! ce n’est pas un grand, grand cirque, mais c’est pourtant un cirque. Ils avaient besoin d’un enfant pour la dislocation et Garofoli me loua au père Gassot. Je suis resté avec lui jusqu’à lundi dernier, et puis on m’a renvoyé parce que j’ai la tête trop grosse maintenant pour entrer dans la boîte, et aussi trop sensible. Alors je suis venu de Gisors où est le cirque pour rejoindre Garofoli, mais je n’ai trouvé personne, la maison était fermée, et un voisin m’a raconté ce que je viens de vous dire : Garofoli est en prison. Alors je suis venu là, ne sachant où aller, et ne sachant que faire.
— Pourquoi n’êtes-vous pas retourné à Gisors ?
— Parce que le jour où je partais de Gisors pour venir à Paris à pied, le cirque partait pour Rouen ; et comment voulez-vous que j’aille à Rouen ? c’est trop loin, et je n’ai pas d’argent ; je n’ai pas mangé depuis hier midi.
Je n’étais pas riche, mais je l’étais assez pour ne pas laisser ce pauvre enfant mourir de faim ; comme j’aurais béni celui qui m’aurait tendu un morceau de pain quand j’errais aux environs de Toulouse, affamé comme Mattia l’était en ce moment !
— Restez là, lui dis-je.
Et je courus chez un boulanger dont la boutique faisait le coin de la rue ; bientôt je revins avec une miche de pain que je lui offris ; il se jeta dessus et la dévora.
— Et maintenant, lui dis-je, que voulez-vous faire ?
— Je ne sais pas.
— Il faut faire quelque chose.
— J’allais tâcher de vendre mon violon quand vous m’avez parlé, et je l’aurais déjà vendu si cela ne me faisait pas chagrin de m’en séparer : mon violon, c’est ma joie et ma consolation ; quand je suis trop triste, je cherche un endroit où je serai seul, et je joue pour moi ; alors je vois toutes sortes de belles choses dans le ciel, c’est bien plus beau que dans les rêves, ça se suit.
— Alors pourquoi ne jouez-vous pas du violon dans les rues ?
— J’en ai joué, personne ne m’a donné.
Je savais ce que c’était que de jouer sans que personne mît la main à la poche.
— Et vous ? demanda Mattia, que faites-vous maintenant ?
Je ne sais quel sentiment de vantardise enfantine m’inspira :
— Mais je suis chef de troupe, dis-je.
En réalité cela était vrai puisque j’avais une troupe composée de Capi, mais cette vérité frisait de près la fausseté.
— Oh ! si vous vouliez ? dit Mattia.
— Quoi ?
— M’enrôler dans votre troupe.
Alors la sincérité me revint.
— Mais voilà toute ma troupe, dis-je en montrant Capi.
— Eh bien ? qu’importe, nous serons deux. Ah ! je vous en prie, ne m’abandonnez pas ; que voulez-vous que je devienne ? il ne me reste qu’à mourir de faim.
Mourir de faim ! Tous ceux qui entendent ce cri ne le comprennent pas de la même manière et ne le perçoivent pas à la même place. Moi ce fut au cœur qu’il me résonna : je savais ce que c’était que de mourir de faim.
— Je sais travailler, continua Mattia ; d’abord je joue du violon, et puis je me disloque, je danse à la corde, je passe dans les cerceaux, je chante ; vous verrez, je ferai ce que vous voudrez, je serai votre domestique, je vous obéirai, je ne vous demande pas d’argent, la nourriture seulement ; si je fais mal vous me battrez, ça sera convenu ; tout ce que je vous demande c’est que vous ne me battiez pas sur la tête, ça aussi sera convenu, parce que j’ai la tête trop sensible depuis que Garofoli m’a tant frappé dessus.
En entendant le pauvre Mattia parler ainsi j’avais envie de pleurer. Comment lui dire que je ne pouvais pas le prendre dans ma troupe ? Mourir de faim ! Mais avec moi n’avait-il pas autant de chances de mourir faim que tout seul ?
Ce fut ce que je lui expliquai ; mais il ne voulut pas m’entendre.
— Non, dit-il, à deux on ne meurt pas de faim, on se soutient, on s’aide, celui qui a donne à celui qui n’a pas.
Ce mot trancha mes hésitations : puisque j’avais, je devais l’aider.
— Alors, c’est entendu ! lui dis-je.
Instantanément il me prit la main et me la baisa, et cela me remua le cœur si doucement, que des larmes me montèrent aux yeux.
— Venez avec moi, lui dis-je, mais pas comme domestique, comme camarade.
Et remontant la bretelle de ma harpe sur mon épaule :
— En avant ! lui dis-je.
Au bout d’un quart d’heure, nous sortions de Paris.
Les hâles du mois de mars avaient séché la route, et sur la terre durcie on marchait facilement.
L’air était doux, le soleil d’avril brillait dans un ciel bleu sans nuages.
Quelle différence avec la journée de neige où j’étais entré dans ce Paris, après lequel j’avais si longtemps aspiré comme après la terre promise !
Le long des fossés de la route l’herbe commençait à pousser, et çà et là elle était émaillée de fleurs de pâquerettes et de fraisiers qui tournaient leurs corolles du côté du soleil.
Quand nous longions des jardins, nous voyions les thyrses des lilas rougir au milieu de la verdure tendre du feuillage, et si une brise agitait l’air calme, il nous tombait sur la tête, de dessus le chaperon des vieux murs, des pétales de ravenelles jaunes.
Dans les jardins, dans les buissons de la route, dans les grands arbres, partout, on entendait des oiseaux qui chantaient joyeusement, et devant nous des hirondelles rasaient la terre, à la poursuite de moucherons invisibles.
Notre voyage commençait bien, et c’était avec confiance que j’allongeais le pas sur la route sonore : Capi, délivré de sa laisse, courait autour de nous, aboyant après les voitures, aboyant après les tas de cailloux, aboyant partout et pour rien, si ce n’est pour le plaisir d’aboyer, ce qui, pour les chiens, doit être analogue au plaisir de chanter pour les hommes.
Près de moi, Mattia marchait sans rien dire, réfléchissant sans doute, et moi je ne disais rien non plus pour ne pas le déranger et aussi parce que j’avais moi-même à réfléchir.
Où allions-nous ainsi de ce pas délibéré ?
À vrai dire, je ne le savais pas trop, et même je ne le savais pas du tout.
Devant nous.
Mais après ?
J’avais promis à Lise de voir ses frères et Étiennette avant elle, mais je n’avais pas pris d’engagement à propos de celui que je devais voir le premier : Benjamin, Alexis ou Étiennette ? Je pouvais commencer par l’un ou par l’autre, à mon choix, c’est-à-dire par les Cévennes, la Charente ou la Picardie.
De ce que j’étais sorti par le sud de Paris il résultait nécessairement que ce ne serait pas Benjamin qui aurait ma première visite, mais il me restait le choix entre Alexis et Étiennette.
J’avais eu une raison qui m’avait décidé à me diriger tout d’abord vers le sud et non vers le nord : c’était le désir de voir mère Barberin.
Si depuis longtemps je n’ai pas parlé d’elle, il ne faut pas en conclure que je l’avais oubliée, comme un ingrat.
De même il ne faut pas conclure non plus que j’étais un ingrat, de ce que je ne lui avais pas écrit depuis que j’étais séparé d’elle.
Combien de fois j’avais eu cette pensée de lui écrire pour lui dire : « Je pense à toi et je t’aime toujours de tout mon cœur » ; mais la peur de Barberin, et une peur horrible, m’avait retenu. Si Barberin me retrouvait au moyen de ma lettre, s’il me reprenait ; si de nouveau il me vendait à un autre Vitalis, qui ne serait pas Vitalis ? Sans doute il avait le droit de faire tout cela. Et à cette pensée j’aimais mieux m’exposer à être accusé d’ingratitude par mère Barberin, plutôt que de courir la chance de retomber sous l’autorité de Barberin, soit qu’il usât de cette autorité pour me vendre, soit qu’il voulût me faire travailler sous ses ordres. J’aurais mieux aimé mourir, — mourir de faim, — plutôt que d’affronter un pareil danger, dont l’idée seule me rendait lâche.
Mais si je n’avais pas osé écrire à mère Barberin, il me semblait qu’étant libre d’aller où je voulais, je pouvais tenter de la voir. Et même depuis que j’avais engagé Mattia « dans ma troupe » je me disais que cela pouvait être assez facile. J’envoyais Mattia en avant, tandis que je restais prudemment en arrière ; il entrait chez mère Barberin et la faisait causer sous un prétexte quelconque ; si elle était seule il lui racontait la vérité, venait m’avertir, et je rentrais dans la maison où s’était passée mon enfance pour me jeter dans les bras de ma mère nourrice ; si au contraire Barberin était au pays, il demandait à mère Barberin de se rendre à un endroit désigné et là, je l’embrassais.
C’était ce plan que je bâtissais tout en marchant, et cela me rendait silencieux, car ce n’était pas trop de toute mon attention, de toute mon application pour examiner une question d’une telle importance.
En effet, je n’avais pas seulement à voir si je pouvais aller embrasser mère Barberin, mais j’avais encore à chercher si sur notre route nous trouverions des villes ou des villages dans lesquels nous aurions chance de faire des recettes.
Pour cela le mieux était de consulter ma carte.
Justement, nous étions en ce moment en pleine campagne et nous pouvions très-bien faire une halte sur un tas de cailloux, sans craindre d’être dérangés.
— Si vous voulez, dis-je à Mattia, nous allons nous reposer un peu.
— Voulez-vous que nous parlions ?
— Vous avez quelque chose à me dire ?
— Je voudrais vous prier de me dire tu.
— Je veux bien, nous nous dirons tu.
— Vous oui, mais moi non.
— Toi comme moi, je te l’ordonne et si tu ne m’obéis pas, je tape.
— Bon, tape, mais pas sur la tête.
Et il se mit à rire d’un bon rire franc et doux en montrant toutes ses dents, dont la blancheur éclatait au milieu de son visage hâlé.
Nous nous étions assis, et dans mon sac j’avais pris ma carte, que j’étalai sur l’herbe. Je fus assez longtemps à m’orienter ; mais enfin je finis par tracer mon itinéraire : Corbeil, Fontainebleau, Montargis, Gien, Bourges, Saint-Amand, Montluçon. Il était donc possible d’aller à Chavanon, et si nous avions un peu de chance, il était possible aussi de ne pas mourir de faim en route.
— Qu’est-ce que c’est que cette chose-là ? demanda Mattia en montrant ma carte.
Je lui expliquai ce que c’était qu’une carte et à quoi elle servait, en employant à peu près les mêmes termes que Vitalis, lorsqu’il m’avait donné ma première leçon de géographie.
Il m’écouta avec attention, les yeux sur les miens.
— Mais alors, dit-il, il faut savoir lire ?
— Sans doute : tu ne sais donc pas lire ?
— Non.
— Veux-tu apprendre ?
— Oh ! oui, je voudrais bien.
— Eh bien, je t’apprendrai.
— Est-ce que sur la carte on peut trouver la route de Gisors à Paris ?
— Certainement, cela est très-facile.
Et je la lui montrai.
Mais tout d’abord il ne voulut pas croire ce que je lui disais quand d’un mouvement du doigt je vins de Gisors à Paris.
— J’ai fait la route à pied, dit-il, il y a bien plus loin que cela.
Alors je lui expliquai de mon mieux, ce qui ne veut pas dire très-clairement, comment on marque les distances sur les cartes ; il m’écouta, mais il ne parut pas convaincu de la sûreté de ma science.
Comme j’avais débouclé mon sac, l’idée me vint de passer l’inspection de ce qu’il contenait, étant bien aise d’ailleurs de montrer mes richesses à Mattia, et j’étalai tout sur l’herbe.
J’avais trois chemises en toile, trois paires de bas, cinq mouchoirs, le tout en très-bon état, et une paire de souliers un peu usés.
Mattia fut ébloui.
— Et toi, qu’as-tu ? lui demandai-je.
— J’ai mon violon, et ce que je porte sur moi.
— Eh bien ! lui dis-je, nous partagerons comme cela se doit puisque nous sommes camarades : tu auras deux chemises, deux paires de bas et trois mouchoirs ; seulement comme il est juste que nous partagions tout, tu porteras mon sac pendant une heure et moi pendant une autre.
Mattia voulut refuser, mais j’avais déjà pris l’habitude du commandement, qui, je dois le dire, me paraissait très-agréable, et je lui défendis de répliquer.
J’avais étalé sur mes chemises la ménagère d’Étiennette, et aussi une petite boîte dans laquelle était placée la rose de Lise ; il voulut ouvrir cette boîte, mais je ne lui permis pas, je la remis dans mon sac sans même l’ouvrir.
— Si tu veux me faire un plaisir, lui dis-je, tu ne toucheras jamais à cette boîte, c’est un cadeau.
— Bien, dit-il, je te promets de n’y toucher jamais.
Depuis que j’avais repris ma peau de mouton et ma harpe, il y avait une chose qui me gênait beaucoup, — c’était mon pantalon. Il me semblait qu’un artiste ne devait pas porter un pantalon long ; pour paraître en public il fallait des culottes courtes avec des bas sur lesquels s’entre-croisaient des rubans de couleur. Des pantalons, c’était bon pour un jardinier, mais maintenant j’étais un artiste !…
Lorsqu’on a une idée et qu’on est maître de sa volonté, on ne tarde pas à la réaliser. J’ouvris la ménagère d’Étiennette et je pris ses ciseaux.
— Pendant que je vais arranger mon pantalon, dis-je à Mattia, tu devrais bien me montrer comment tu joues du violon.
— Oh ! je veux bien.
Et prenant son violon il se mit à jouer.
Pendant ce temps j’enfonçai bravement la pointe de mes ciseaux dans mon pantalon un peu au dessous du genou et je me mis à couper le drap.
C’était cependant un beau pantalon en drap gris comme mon gilet et ma veste, et que j’avais été bien joyeux de recevoir quand le père me l’avait donné ; mais je ne croyais pas l’abîmer en le taillant ainsi, bien au contraire.
Tout d’abord, j’avais écouté Mattia en coupant mon pantalon, mais bientôt je cessai de faire fonctionner mes ciseaux et je fus tout oreilles : Mattia jouait presque aussi bien que Vitalis.
— Et qui donc t’a appris le violon ? lui dis-je en l’applaudissant.
— Personne, un peu tout le monde, et surtout moi seul en travaillant.
— Et qui t’a enseigné la musique ?
— Je ne la sais pas ; je joue ce que j’ai entendu jouer.
— Je te l’enseignerai, moi.
— Tu sais donc tout ?
— Il faut bien puisque je suis chef de troupe.
On n’est pas artiste sans avoir un peu d’amour-propre ; je voulus montrer à Mattia que moi aussi j’étais musicien.
Je pris ma harpe et tout de suite pour frapper un grand coup, je lui chantai ma fameuse chanson :
Et alors, comme cela se devait entre artistes, Mattia me paya les compliments que je venais de lui adresser, par ses applaudissements : il avait un grand talent, j’avais un grand talent, nous étions dignes l’un de l’autre.
Mais nous ne pouvions pas rester ainsi à nous féliciter l’un l’autre, il fallait après avoir fait de la musique pour nous, pour notre plaisir, en faire pour notre souper et pour notre coucher.
Je bouclai mon sac, et Mattia à son tour le mit sur ses épaules.
En avant sur la route poudreuse : maintenant il fallait s’arrêter au premier village qui se trouverait sur notre route et donner une représentation : « Débuts de la troupe Rémi ».
— Apprends-moi ta chanson, dit Mattia, nous la chanterons ensemble, et je pense que je pourrai bientôt t’accompagner sur mon violon ; cela sera très-joli.
Certainement cela serait très-joli et il faudrait véritablement « que l’honorable société » eût un cœur de pierre pour ne pas nous combler de gros sous.
Ce malheur nous fut épargné. Comme nous arrivions à un village qui se trouve après Villejuif, nous préparant à chercher une place convenable pour notre représentation, nous passâmes devant la grande porte d’une ferme, dont la cour était pleine de gens endimanchés, qui portaient tous des bouquets noués avec des flots de rubans et attachés, pour les hommes, à la boutonnière de leur habit, pour les femmes à leur corsage : il ne fallait pas être bien habile pour deviner que c’était une noce.
L’idée me vint que ces gens seraient peut-être satisfaits d’avoir des musiciens pour les faire danser, et aussitôt j’entrai dans la cour suivi de Mattia et de Capi, puis, mon feutre à la main, et avec un grand salut (le salut noble de Vitalis), je fis ma proposition à la première personne que je trouvai sur mon passage.
C’était un gros garçon, dont la figure rouge comme brique était encadrée dans un grand col raide qui lui sciait les oreilles ; il avait l’air bon enfant et placide.
Il ne me répondit pas ; mais, se tournant tout d’une pièce vers les gens de la noce, car sa redingote en beau drap luisant le gênait évidemment aux entournures, il fourra deux de ses doigts dans sa bouche et tira de cet instrument un si formidable coup de sifflet, que Capi en fut effrayé.
— Ohé ! les autres, cria-t-il, qui que vous pensez d’une petite air de musique ? v’là des artistes qui nous arrivent.
— Oui, oui, la musique ! la musique ! crièrent des voix d’hommes et de femmes.
— En place pour le quadrille !
Et, en quelques minutes, les groupes de danseurs se formèrent au milieu de la cour ; ce qui fit fuir les volailles épouvantées.
— As-tu joué des quadrilles ? demandai-je à Mattia en italien et à voix basse, car j’étais assez inquiet.
— Oui.
Et il m’en indiqua un sur son violon ; le hasard permit que je le connusse. Nous étions sauvés.
On avait sorti une charrette de dessous un hangar ; on la posa sur ses chambrières, et on nous fit monter dedans.
Bien que nous n’eussions jamais joué ensemble, Mattia et moi, nous ne nous tirâmes pas trop mal de notre quadrille. Il est vrai que nous jouions pour des oreilles qui n’étaient heureusement ni délicates, ni difficiles.
— Un de vous sait-il jouer du cornet à piston ? nous demanda le gros rougeaud.
— Oui, moi, dit Mattia, mais je n’en ai pas.
— Je vas aller vous en chercher un, parce que le violon c’est joli, mais c’est fadasse.
— Tu joues donc aussi du cornet à piston ? demandai-je à Mattia en parlant toujours italien.
— Et de la trompette à coulisse et de la flûte, et de tout ce qui se joue.
Décidément il était précieux, Mattia.
Bientôt le cornet à piston fut apporté, et nous recommençâmes à jouer des quadrilles, des polkas, des valses, surtout des quadrilles.
Nous jouâmes ainsi jusqu’à la nuit sans que les danseurs nous laissassent respirer : cela n’était pas bien grave pour moi, mais cela l’était beaucoup plus pour Mattia, chargé de la partie pénible, et fatigué d’ailleurs par son voyage et les privations. Je le voyais de temps en temps pâlir comme s’il allait se trouver mal, cependant il jouait toujours, soufflant tant qu’il pouvait dans son embouchure.
Heureusement je ne fus pas seul à m’apercevoir de sa pâleur, la mariée la remarqua aussi.
— Assez, dit-elle, le petit n’en peut plus ; maintenant la main à la bourse pour les musiciens.
— Si vous vouliez, dis-je en sautant à bas de la voiture, je ferais faire la quête par notre caissier.
Et je jetai mon chapeau à Capi qui le prit dans sa gueule.
On applaudit beaucoup la grâce avec laquelle il savait saluer lorsqu’on lui avait donné, mais ce qui valait mieux pour nous, on lui donna beaucoup ; comme je le suivais, je voyais les pièces blanches tomber dans le chapeau ; le marié mit la dernière et ce fut une pièce de cinq francs.
Quelle fortune ! Ce ne fut pas tout. On nous invita à manger à la cuisine, et on nous donna à coucher dans une grange. Le lendemain quand nous quittâmes cette maison hospitalière, nous avions un capital de vingt-huit francs.
— C’est à toi que nous les devons, mon petit Mattia, dis-je à mon camarade, tout seul je n’aurais pas formé un orchestre.
Et alors le souvenir d’une parole qui m’avait été dite par le père Acquin quand j’avais commencé à donner des leçons à Lise me revient à la mémoire, me prouvant qu’on est toujours récompensé de ce qu’on fait de bien.
— J’aurais pu faire une plus grande bêtise que de te prendre dans ma troupe.
Avec vingt-huit francs dans notre poche, nous étions des grands seigneurs, et lorsque nous arrivâmes à Corbeil, je pus, sans trop d’imprudence, me livrer à quelques acquisitions que je jugeais indispensables : d’abord un cornet à piston qui me coûta trois francs chez un marchand de ferraille ; pour cette somme, il n’était ni neuf ni beau, mais enfin récuré et soigné il ferait notre affaire ; puis ensuite des rubans rouges pour nos bas ; et enfin un vieux sac de soldat pour Mattia, car il était moins fatigant d’avoir toujours sur les épaules un sac léger, que d’en avoir de temps en temps un lourd ; nous nous partagerions également ce que nous portions avec nous, et nous serions plus alertes.
Quand nous quittâmes Corbeil, nous étions vraiment en bon état ; nous avions, toutes nos acquisitions payées, trente francs dans notre bourse, car nos représentations avaient été fructueuses ; notre répertoire était réglé de telle sorte que nous pouvions rester plusieurs jours dans le même pays sans trop nous répéter ; enfin nous nous entendions si bien, Mattia et moi, que nous étions déjà ensemble comme deux frères.
— Tu sais, disait-il quelquefois en riant, un chef de troupe comme toi qui ne cogne pas, c’est trop beau.
— Alors, tu es content ?
— Si je suis content ! c’est-à-dire que voilà le premier temps de ma vie, depuis que j’ai quitté le pays, que je ne regrette pas l’hôpital.
Cette situation prospère m’inspira des idées ambitieuses.
Après avoir quitté Corbeil, nous nous étions dirigés sur Montargis, en route pour aller chez mère Barberin.
Aller chez mère Barberin pour l’embrasser c’était m’acquitter de ma dette de reconnaissance envers elle, mais c’était m’en acquitter bien petitement et à trop bon marché.
Si je lui portais quelque chose.
Maintenant que j’étais riche, je lui devais un cadeau.
Quel cadeau lui faire ?
Je ne cherchai pas longtemps.
Il y en avait un qui plus que tout la rendrait heureuse, non-seulement dans l’heure présente, mais pour toute sa vieillesse, — une vache, qui remplaçât la pauvre Roussette.
Quelle joie pour mère Barberin, si je pouvais lui donner une vache, et aussi quelle joie pour moi !
Avant d’arriver à Chavanon j’achetais une vache et Mattia, la conduisant par la longe, la faisait entrer dans la cour de mère Barberin. Bien entendu, Barberin n’était pas là. — Madame Barberin, disait Mattia, voici une vache que je vous amène. — Une vache ! vous vous trompez, mon garçon. — Et elle soupirait. — Non, madame, vous êtes bien madame Barberin, de Chavanon ? Eh bien ! c’est chez madame Barberin que le prince (comme dans les contes de fées) m’a dit de conduire cette vache qu’il vous offre. — Quel prince ? — Alors je paraissais, je me jetais dans les bras de mère Barberin, et après nous être bien embrassés, nous faisions des crêpes et des beignets, qui étaient mangés par nous trois et non par Barberin, comme en ce jour de mardi-gras où il était revenu pour renverser notre poêle et mettre notre beurre dans sa soupe à l’oignon.
Quel beau rêve ! Seulement, pour le réaliser, il fallait pouvoir acheter une vache.
Combien cela coûtait-il, une vache ? Je n’en avais aucune idée ; cher, sans doute, très-cher, mais encore ?
Ce que je voulais, ce n’était pas une trop grande, une trop grosse vache. D’abord parce que plus les vaches sont grosses, plus leur prix est élevé ; puis ensuite, plus les vaches sont grandes, plus il leur faut de nourriture, et je ne voulais pas que mon cadeau devînt une cause d’embarras pour mère Barberin.
L’essentiel pour le moment c’était donc de connaître le prix des vaches, ou plutôt d’une vache telle que j’en voulais une.
Heureusement, cela n’était pas difficile pour moi, et dans notre vie sur les grands chemins, dans nos soirées à l’auberge, nous nous trouvions en relations avec des conducteurs et des marchands de bestiaux : il était donc bien simple de leur demander le prix des vaches.
Mais la première fois que j’adressai ma question à un bouvier, dont l’air brave homme m’avait tout d’abord attiré, on me répondit en me riant au nez.
Le bouvier se renversa ensuite sur sa chaise en donnant de temps en temps de formidables coups de poing sur la table ; puis il appela l’aubergiste.
— Savez-vous ce que me demande ce petit musicien ? Combien coûte une vache, pas trop grande, pas trop grosse, enfin une bonne vache. Faut-il qu’elle soit savante ?
Et les rires recommencèrent ; mais je ne me laissai pas démonter.
— Il faut qu’elle donne du bon lait et qu’elle ne mange pas trop.
— Faut-il qu’elle se laisse conduire à la corde sur les grands chemins comme votre chien ?
Après avoir épuisé toutes ses plaisanteries, déployé suffisamment son esprit, il voulut bien me répondre sérieusement et même entrer en discussion avec moi.
— Il avait justement mon affaire, une vache douce, donnant beaucoup de lait, un lait qui était une crème, et ne mangeant presque pas ; si je voulais lui allonger quinze pistoles sur la table, autrement dit cinquante écus, la vache était à moi.
Autant j’avais eu de mal à le faire parler tout d’abord, autant j’eus de mal à le faire taire quand il fut en train.
Enfin nous pûmes aller nous coucher et je rêvai à ce que cette conversation venait de m’apprendre.
Quinze pistoles ou cinquante écus, cela faisait cent cinquante francs ; et j’étais loin d’avoir une si grosse somme.
Était-il impossible de la gagner ? Il me sembla que non, et que si la chance de nos premiers jours nous accompagnait je pourrais, sou à sou, réunir ces cent cinquante francs. Seulement il faudrait du temps.
Alors une nouvelle idée germa dans mon cerveau : si au lieu d’aller tout de suite à Chavanon, nous allions d’abord à Varses, cela nous donnerait ce temps qui nous manquerait en suivant la route directe.
Il fallait donc aller à Varses tout d’abord et ne voir mère Barberin qu’au retour : assurément alors j’aurais mes cent cinquante francs et nous pourrions jouer ma féerie : la Vache du prince.
Le matin, je fis part de mon idée à Mattia, qui ne manifesta aucune opposition.
— Allons à Varses, dit-il, les mines, c’est peut-être curieux, je serai bien aise d’en voir une.
II
UNE VILLE NOIRE
La route est longue de Montargis à Varses, qui se trouve au milieu des Cévennes, sur le versant de la montagne incliné vers la Méditerranée : cinq ou six cents kilomètres en ligne droite ; plus de mille pour nous à cause des détours qui nous étaient imposés par notre genre de vie. Il fallait bien chercher des villes et des grosses bourgades pour donner des représentations fructueuses.
Nous mîmes près de trois mois à faire ces mille kilomètres, mais quand nous arrivâmes aux environs de Varses, j’eus la joie, comptant mon argent, de constater que nous avions bien employé notre temps : dans ma bourse en cuir j’avais cent vingt-huit francs d’économies ; il ne me manquait plus que vingt-deux francs pour acheter la vache de mère Barberin.
Mattia était presque aussi content que moi, et il n’était pas médiocrement fier d’avoir contribué pour sa part à gagner une pareille somme : il est vrai que cette part était considérable et que sans lui, surtout sans son cornet à piston, nous n’aurions jamais amassé 128 francs, Capi et moi.
De Varses à Chavanon nous gagnerions bien certainement les 22 francs qui nous manquaient.
Varses où nous arrivions était, il y a une centaine d’années, un pauvre village perdu dans les montagnes et connu seulement par cela qu’il avait souvent servi de refuge aux Enfants de Dieu, commandés par Jean Cavalier. Sa situation au milieu des montagnes en avait fait un point important dans la guerre des Camisards ; mais cette situation même avait par contre fait sa pauvreté. Vers 1750, un vieux gentilhomme qui avait la passion des fouilles, découvrit à Varses des mines de charbon de terre, et depuis ce temps, Varses est devenu un des bassins houillers qui, avec Alais, Saint-Gervais, Bessèges approvisionnent le Midi et tendent à disputer le marché de la Méditerranée aux charbons anglais. Lorsqu’il avait commencé ses recherches, tout le monde s’était moqué de lui, et lorsqu’il était parvenu à une profondeur de 150 mètres sans avoir rien trouvé, on avait fait des démarches actives pour qu’il fût enfermé comme fou, sa fortune devant s’engloutir dans ces fouilles insensées : Varses renfermait dans son territoire des mines de fer ; on n’y trouvait pas, on n’y trouverait jamais du charbon de terre. Sans répondre, et pour se soustraire aux criailleries, le vieux gentilhomme s’était établi dans son puits et n’en était plus sorti ; il y mangeait, il y couchait, et il n’avait à subir ainsi que les doutes des ouvriers qu’il employait avec lui ; à chaque coup de pioche ceux-ci haussaient les épaules, mais excités par la foi de leur maître, ils donnaient un nouveau coup de pioche et le puits descendait. À 200 mètres, on trouva une couche de houille : le vieux gentilhomme ne fut plus un fou, ce fut un homme de génie ; du jour au lendemain, la métamorphose fut complète.
Aujourd’hui Varses est une ville de 12,000 habitants qui a devant elle un grand avenir industriel et qui pour le moment est avec Alais et Bessèges l’espérance du Midi.
Ce qui fait et ce qui fera la fortune de Varses est ce qui se trouve sous la terre et non ce qui est au-dessus. À la surface, en effet, l’aspect est triste et désolé ; des causses, des garrigues, c’est-à-dire la stérilité, pas d’arbres, si ce n’est çà et là des châtaigniers, des mûriers et quelques oliviers chétifs, pas de terre végétale, mais partout des pierres grises ou blanches ; là seulement où la terre ayant un peu de profondeur se laisse pénétrer par l’humidité, surgit une végétation active qui tranche agréablement avec la désolation des montagnes.
De cette dénudation résultent de terribles inondations, car lorsqu’il pleut l’eau court sur les pentes dépouillées comme elle courrait sur une rue pavée, et les ruisseaux ordinairement à sec roulent alors des torrents qui gonflent instantanément les rivières des vallons et les font déborder : en quelques minutes on voit le niveau de l’eau monter dans le lit des rivières de trois, quatre, cinq mètres et même plus.
Varses est bâti à cheval sur une de ces rivières nommée la Divonne, qui reçoit elle-même dans l’intérieur de la ville deux petits torrents : le ravin de la Truyère et celui de Saint-Andéol. Ce n’est point une belle ville, ni propre, ni régulière ; les wagons chargés de minerai de fer ou de houille qui circulent du matin au soir sur des rails au milieu des rues sèment continuellement une poussière rouge et noire qui, par les jours de pluie, forme une boue liquide et profonde comme la fange d’un marais ; par les jours de soleil et de vent, ce sont au contraire des tourbillons aveuglants qui roulent dans la rue et s’élèvent au-dessus de la ville. Du haut en bas, les maisons sont noires, noires par la boue et la poussière, qui de la rue monte jusqu’à leurs toits ; noires par la fumée des fours et des fourneaux qui de leurs toits descend jusqu’à la rue : tout est noir, le sol, le ciel et jusqu’aux eaux que roule la Divonne. Et cependant les gens qui circulent dans les rues sont encore plus noirs que ce qui les entoure : les chevaux noirs, les voitures noires, les feuilles des arbres noires ; c’est à croire qu’un nuage de suie s’est abattu pendant une journée sur la ville ou qu’une inondation de bitume l’a recouverte jusqu’au sommet des toits. Les rues n’ont point été faites pour les voitures ni pour les passants, mais pour les chemins de fer et les wagons des mines : partout sur le sol des rails et des plaques tournantes ; au-dessus de la tête des ponts volants, des courroies, des arbres de transmission qui tournent avec des ronflements assourdissants ; les vastes bâtiments près desquels on passe tremblent jusque dans leurs fondations, et, si l’on regarde par les portes ou les fenêtres, on voit des masses de fonte en fusion qui circulent comme d’immenses bolides, des marteaux-pilons qui lancent autour d’eux des pluies d’étincelles, et partout, toujours des pistons de machines à vapeur qui s’élèvent et s’abaissent régulièrement. Pas de monuments, pas de jardins, pas de statues sur les places ; tout se ressemble et a été bâti sur le même modèle, le cube : les églises, le tribunal, les écoles, des cubes percés de plus ou moins de fenêtres, selon les besoins.
Quand nous arrivâmes aux environs de Varses, il était deux ou trois heures de l’après-midi, et un soleil radieux brillait dans un ciel pur ; mais à mesure que nous avancions le jour s’obscurcit ; entre le ciel et la terre s’était interposé un épais nuage de fumée qui se traînait lourdement en se déchirant aux hautes cheminées ; depuis plus d’une heure, nous entendions de puissants ronflements, un mugissement semblable à celui de la mer avec des coups sourds, — les ronflements étaient produits par les ventilateurs, les coups sourds par les martinets et les pilons.
Je savais que l’oncle d’Alexis était ouvrier mineur à Varses, qu’il travaillait à la mine de la Truyère, mais c’était tout ; demeurait-il à Varses même ou aux environs ? Je l’ignorais.
En entrant dans Varses, je demandai où se trouvait la mine de la Truyère, et l’on m’envoya sur la rive gauche de la Divonne, dans un petit vallon traversé par le ravin qui a donné son nom à la mine.
Si l’aspect de la ville est peu séduisant, l’aspect de ce vallon est tout à fait lugubre ; un cirque de collines dénudées, sans arbres, sans herbes, avec de longues traînées de pierres grises que coupent seulement çà et là quelques rayons de terre rouge ; à l’entrée de ce vallon, les bâtiments servant à l’exploitation de la mine, des hangars, des écuries, des magasins, des bureaux, et les cheminées de la machine à vapeur ; puis tout autour des amas de charbon et de pierres.
Comme nous approchions des bâtiments, une jeune femme à l’air égaré, aux cheveux flottants sur les épaules et traînant par la main un petit enfant, vint au-devant de nous, et m’arrêta.
— Voulez-vous m’indiquer un chemin frais ? dit-elle.
Je la regardai stupéfait.
— Un chemin avec des arbres, de l’ombrage, puis à côté un petit ruisseau qui fasse clac, clac, clac sur les cailloux, et dans le feuillage des oiseaux qui chantent.
Et elle se mit à siffler un air gai.
— Vous n’avez pas rencontré ce chemin, continua-t-elle, en voyant que je ne répondais pas, mais sans paraître remarquer mon étonnement, c’est dommage. Alors c’est qu’il est loin encore. Est-ce à droite, est-ce à gauche ? Dis-moi cela, mon garçon. Je cherche et ne trouve pas.
Elle parlait avec une volubilité extraordinaire en gesticulant d’une main, tandis que de l’autre elle flattait doucement la tête de son enfant.
— Je te demande ce chemin parce que je suis sûre d’y rencontrer Marius. Tu as connu Marius ? Non. Eh bien, c’est le père de mon enfant. Alors quand il a été brûlé dans la mine par le grisou, il s’est retiré dans ce chemin frais ; il ne se promène plus maintenant que dans des chemins frais, c’est bon pour ses brûlures. Lui il sait trouver ces chemins, moi je ne sais pas ; voilà pourquoi je ne l’ai pas rencontré depuis six mois. Six mois, c’est long quand on s’aime. Six mois, six mois !
Elle se tourna vers les bâtiments de la mine et montrant avec une énergie sauvage les cheminées de la machine qui vomissaient des torrents de fumée :
— Travail sous terre, s’écria-t-elle, travail du diable ! enfer, rends-moi mon père, mon frère Jean, rends-moi Marius ; malédiction, malédiction !
Puis revenant à moi :
— Tu n’es pas du pays, n’est-ce pas ? ta peau de mouton, ton chapeau disent que tu viens de loin : va dans le cimetière, compte une, deux, trois, une, deux trois, tous morts dans la mine.
Alors saisissant son enfant et le pressant dans ses bras :
— Tu n’auras pas mon petit Pierre, jamais !… l’eau est douce, l’eau est fraîche. Où est le chemin ? Puisque tu ne sais pas, tu es donc aussi bête que les autres qui me rient au nez. Alors pourquoi me retiens-tu ? Marius m’attend.
Elle me tourna le dos et se mit à marcher à grands pas en sifflant son air gai.
Je compris que c’était une folle qui avait perdu son mari tué par une explosion de feu grisou, ce terrible danger, et à l’entrée de cette mine, dans ce paysage désolé, sous ce ciel noir, la rencontre de cette pauvre femme, folle de douleur, nous rendit tout tristes.
On nous indiqua l’adresse de l’oncle Gaspard ; il demeurait à une petite distance de la mine, dans une rue tortueuse et escarpée qui descendait de la colline à la rivière.
Quand je le demandai, une femme, qui était adossée à la porte, causant avec une de ses voisines, adossée à une autre porte, me répondit qu’il ne rentrerait qu’à six heures, après le travail.
— Qu’est-ce que vous lui voulez ? dit-elle.
— Je veux voir Alexis.
Alors elle me regarda de la tête aux pieds, et elle regarda Capi.
— Vous êtes Rémi ? dit-elle. Alexis nous a parlé de vous ; il vous attendait. Quel est celui-ci ?
Elle montra Mattia.
— C’est mon camarade.
C’était la tante d’Alexis. Je crus qu’elle allait nous engager à entrer et à nous reposer, car nos jambes poudreuses et nos figures hâlées par le soleil, criaient haut notre fatigue ; mais elle n’en fit rien et me répéta simplement que si je voulais revenir à six heures, je trouverais Alexis, qui était à la mine.
Je n’avais pas le cœur à demander ce qu’on ne m’offrait pas ; je la remerciai de sa réponse, et nous allâmes par la ville, à la recherche d’un boulanger, car nous avions grand’faim, n’ayant pas mangé depuis le petit matin, et encore une simple croûte qui nous était restée sur notre dîner de la veille. J’étais honteux aussi de cette réception, car je sentais que Mattia se demandait ce qu’elle signifiait. À quoi bon faire tant de lieues ?
Il me sembla que Mattia allait avoir une mauvaise idée de mes amis, et que quand je lui parlerais de Lise, il ne m’écouterait plus avec la même sympathie. Et je tenais beaucoup à ce qu’il eût d’avance de la sympathie et de l’amitié pour Lise.
La façon dont nous avions été accueillis ne m’engageait pas à revenir à la maison, nous allâmes un peu avant six heures attendre Alexis à la sortie de la mine.
L’exploitation des mines de la Truyère se fait par trois puits qu’on nomme puits Saint-Julien, puits Sainte-Alphonsine et puits Saint-Pancrace ; car c’est un usage dans les houillères de donner assez généralement un nom de saint aux puits d’extraction, d’aérage ou d’exhaure, c’est-à-dire d’épuisement ; ce saint étant choisi sur le calendrier le jour où l’on commence le fonçage, sert non-seulement à baptiser les puits, mais encore à rappeler les dates. Ces trois puits ne servent point à la descente et au remontage des ouvriers dans les travaux. Cette descente et ce remontage se font par une galerie qui débouche à côté de la lampisterie et qui aboutit au premier niveau de l’exploitation, d’où il communique avec toutes les parties de la mine. Par là on a voulu parer aux accidents qui arrivent trop souvent dans les puits lorsqu’un câble casse ou qu’une tonne accroche un obstacle et précipite les hommes dans un trou d’une profondeur de deux ou trois cents mètres ; en même temps on a cherché aussi à éviter les brusques transitions auxquelles sont exposés les ouvriers qui, d’une profondeur de deux cents mètres où la température est égale et chaude, passent brusquement, lorsqu’ils sont remontés par la machine, à une température inégale et gagnent ainsi des pleurésies et des fluxions de poitrine.
Prévenu que c’était par cette galerie que devaient sortir les ouvriers, je me postai avec Mattia et Capi devant son ouverture, et, quelques minutes après que six heures eurent sonné je commençai à apercevoir vaciller, dans les profondeurs sombres de la galerie, des petits points lumineux qui grandirent rapidement. C’étaient les mineurs qui, la lampe à la main, remontaient au jour, leur travail fini.
Ils s’avançaient lentement, avec une démarche pesante, comme s’ils souffraient dans les genoux, ce que je m’expliquai plus tard, lorsque j’eus moi-même parcouru les escaliers et les échelles qui conduisent au dernier niveau ; leur figure était noire comme celles des ramoneurs, leurs habits et leurs chapeaux étaient couverts de poussière de charbon et de plaques de boue mouillée. En passant devant la lampisterie chacun entrait et accrochait sa lampe à un clou.
Bien qu’attentif, je ne vis point Alexis sortir et s’il ne m’avait pas sauté au cou, je l’aurais laissé passer sans le reconnaître, tant il ressemblait peu maintenant, noir des pieds à la tête, au camarade qui autrefois courait dans les sentiers de notre jardin, sa chemise propre retroussée jusqu’aux coudes et son col entr’ouvert laissant voir sa peau blanche.
— C’est Rémi, dit-il, en se tournant vers un homme d’une quarantaine d’années qui marchait près de lui et qui avait une bonne figure franche comme celle du père Acquin ; ce qui n’avait rien d’étonnant puisqu’ils étaient frères.
Je compris que c’était l’oncle Gaspard.
— Nous t’attendions depuis longtemps déjà, me dit-il avec bonhomie.
— Le chemin est long de Paris à Varses.
— Et tes jambes sont courtes, dit-il en riant.
Capi, heureux de retrouver Alexis, lui témoignait sa joie en tirant sur la manche de sa veste à pleines dents.
Pendant ce temps, j’expliquai à l’oncle Gaspard que Mattia était mon camarade et mon associé, un bon garçon que j’avais connu autrefois, que j’avais retrouvé et qui jouait du cornet à piston comme personne.
— Et voilà M. Capi, dit l’oncle Gaspard ; c’est demain dimanche, quand vous serez reposés, vous nous donnerez une représentation ; Alexis dit que c’est un chien plus savant qu’un maître d’école ou qu’un comédien.
Autant je m’étais senti gêné devant la tante Gaspard, autant je me trouvai à mon aise avec l’oncle : décidément c’était bien le digne frère « du père ».
— Causez ensemble, garçons, vous devez en avoir long à vous dire ; pour moi, je vais causer avec ce jeune homme qui joue si bien du cornet à piston.
Pour une semaine entière ; encore eût-elle été trop courte. Alexis voulait savoir comment s’était fait mon voyage, et moi, de mon côté, j’étais pressé d’apprendre comment il s’habituait à sa nouvelle vie, si bien qu’occupés tous les deux à nous interroger, nous ne pensions pas à nous répondre.
Nous marchions doucement, et les ouvriers qui regagnaient leur maison nous dépassaient ; ils allaient en une longue file qui tenait la rue entière, tous noirs de cette même poussière qui recouvrait le sol d’une couche épaisse.
Lorsque nous fûmes près d’arriver, l’oncle Gaspard se rapprocha de nous :
— Garçons, dit-il, vous allez souper avec nous.
Jamais invitation ne me fit plus grand plaisir, car tout en marchant, je me demandais si, arrivés à la porte, il ne faudrait pas nous séparer, l’accueil de la tante ne m’ayant pas donné bonne espérance.
— Voilà Rémi, dit-il, en entrant dans la maison, et son ami.
— Je les ai déjà vus tantôt.
— Eh bien, tant mieux, la connaissance est faite ; ils vont souper avec nous.
J’étais certes bien heureux de souper avec Alexis, c’est-à-dire de passer la soirée auprès de lui, mais pour être sincère, je dois dire que j’étais heureux aussi de souper. Depuis notre départ de Paris, nous avions mangé à l’aventure, une croûte ici, une miche là, mais rarement un vrai repas, assis sur une chaise, avec de la soupe dans une assiette. Avec ce que nous gagnions, nous étions, il est vrai, assez riches pour nous payer des festins dans de bonnes auberges, mais il fallait bien faire des économies pour la vache du prince, et Mattia était si bon garçon qu’il était presque aussi heureux que moi à la pensée d’acheter notre vache.
Ce bonheur d’un festin ne nous fut pas donné ce soir-là ; je m’assis devant une table, sur une chaise, mais on ne nous servit pas de soupe. Les compagnies de mines ont pour le plus grand nombre établi des magasins d’approvisionnement dans lesquels leurs ouvriers trouvent à prix de revient tout ce qui leur est nécessaire pour les besoins de la vie. Les avantages de ces magasins sautent aux yeux : l’ouvrier y trouve des produits de bonne qualité et à bas prix, qu’on lui fait payer en retenant le montant de sa dépense sur sa paye de quinzaine, et par ce moyen il est préservé des crédits des petits marchands de détail qui le ruineraient, il ne fait pas de dettes. Seulement, comme toutes les bonnes choses, celle-là a son mauvais côté ; à Varses, les femmes des ouvriers n’ont pas l’habitude de travailler pendant que leurs maris sont descendus dans la mine ; elles font leur ménage, elles vont les unes chez les autres, boire le café ou le chocolat qu’on a pris au magasin d’approvisionnement, elles causent, elles bavardent, et quand le soir arrive, c’est-à-dire le moment où l’homme sort de la mine pour rentrer souper, elles n’ont point eu le temps de préparer ce souper ; alors elles courent au magasin et en rapportent de la charcuterie. Cela n’est pas général, bien entendu, mais cela se produit fréquemment. Et ce fut pour cette raison que nous n’eûmes pas de soupe : la tante Gaspard avait bavardé. Du reste, c’était chez elle une habitude, et j’ai vu plus tard que son compte au magasin se composait surtout de deux produits : d’une part, café et chocolat ; d’autre part, charcuterie. L’oncle était un homme facile, qui aimait surtout la tranquillité ; il mangeait sa charcuterie et ne se plaignait pas, ou bien s’il faisait une observation, c’était tout doucement.
— Si je ne deviens pas biberon, disait-il en tendant son verre, c’est que j’ai de la vertu ; tâche donc de nous faire une soupe pour demain.
— Et le temps ?
— Il est donc plus court sur la terre que dessous ?
— Et qui est-ce qui vous raccommodera ? vous dévastez tout.
Alors regardant ses vêtements souillés de charbon et déchirés çà et là :
— Le fait est que nous sommes mis comme des princes.
Notre souper ne dura pas longtemps.
— Garçon, me dit l’oncle Gaspard, tu coucheras avec Alexis.
Puis, s’adressant à Mattia :
— Et toi, si tu veux venir dans le fournil, nous allons voir à te faire un bon lit de paille et de foin.
La soirée et une bonne partie de la nuit ne furent point employées par Alexis et par moi à dormir.
L’oncle Gaspard était piqueur, c’est-à-dire qu’au moyen d’un pic, il abattait le charbon dans la mine ; Alexis était son rouleur, c’est-à-dire qu’il poussait, qu’il roulait sur des rails dans l’intérieur de la mine, depuis le point d’extraction jusqu’à un puits, un wagon nommé benne, dans lequel on entassait le charbon abattu ; arrivée à ce puits, la benne était accrochée à un câble qui, tiré par la machine, la montait jusqu’en haut.
Bien qu’il ne fût que depuis peu de temps mineur, Alexis avait déjà cependant l’amour et la vanité de sa mine : c’était la plus belle, la plus curieuse du pays ; il mettait dans son récit l’importance d’un voyageur qui arrive d’une contrée inconnue et qui trouve des oreilles attentives pour l’écouter.
D’abord on suivait une galerie creusée dans le roc, et, après avoir marché pendant dix minutes, on trouvait un escalier droit et rapide ; puis, au bas de cet escalier une échelle en bois, puis un autre escalier, puis une autre échelle, et alors on arrivait au premier niveau, à une profondeur de cinquante mètres. Pour atteindre le second niveau, à quatre-vingt-dix mètres, et le troisième à deux cents mètres, c’était le même système d’échelles et d’escaliers. C’était à ce troisième niveau qu’Alexis travaillait, et, pour atteindre à la profondeur de son chantier, il avait à faire trois fois plus de chemin que n’en font ceux qui montent aux tours de Notre-Dame de Paris.
Mais si la montée et la descente sont faciles dans les tours de Notre-Dame, où l’escalier est régulier et éclairé, il n’en était pas de même dans la mine, où les marches, creusées suivant les accidents du roc, sont tantôt hautes, tantôt basses, tantôt larges, tantôt étroites. Point d’autre lumière que celle de la lampe qu’on porte à la main, et sur le sol, une boue glissante que mouille sans cesse l’eau qui filtre goutte à goutte, et parfois vous tombe froide sur le visage.
Deux cents mètres à descendre, c’est long, mais ce n’était pas tout, il fallait, par les galeries, gagner les différents paliers et se rendre au lieu du travail ; or le développement complet des galeries de la Truyère, était de 35 à 40 kilomètres. Naturellement on ne devait pas parcourir ces 40 kilomètres, mais quelquefois cependant la course était fatigante, car on marchait dans l’eau qui, filtrant par les fentes du roc, se réunit en ruisseau au milieu du chemin et coule ainsi jusqu’à des puisards, où des machines d’épuisement la prennent pour la verser au dehors.
Quand ces galeries traversaient des roches solides, elles étaient tout simplement des souterrains ; mais quand elles traversaient des terrains ébouleux ou mouvants, elles étaient boisées au plafond et des deux côtés avec des troncs de sapin travaillés à la hache, parce que les entailles faites à la scie amènent une prompte pourriture. Bien que ces troncs d’arbres fussent disposés de manière à résister aux poussées du terrain, souvent cette poussée était tellement forte que les bois se courbaient et que les galeries se rétrécissaient ou s’affaissaient au point qu’on ne pouvait plus y passer qu’en rampant. Sur ces bois croissaient des champignons et des flocons légers et cotonneux, dont la blancheur de neige tranchait avec le noir du terrain ; la fermentation des arbres dégageait une odeur d’essence ; et sur les champignons, sur les plantes inconnues, sur la mousse blanche, on voyait des mouches, des araignées, des papillons, qui ne ressemblent pas aux individus de même espèce qu’on rencontre à l’air. Il y avait aussi des rats qui couraient partout et des chauves-souris cramponnées aux boisages par leurs pieds, la tête en bas.
Ces galeries se croisaient, et çà et là, comme à Paris, il y avait des places et des carrefours ; il y en avait de belles et de larges comme les boulevards, d’étroites et de basses comme les rues du quartier Saint-Marcel ; seulement toute cette ville souterraine était beaucoup moins bien éclairée que les villes durant la nuit, car il n’y avait point de lanternes ou de becs de gaz, mais simplement les lampes que les mineurs portent avec eux. Si la lumière manquait souvent, le bruit disait toujours qu’on n’était pas dans le pays des morts ; dans les chantiers d’abatage, on entendait les détonations de la poudre dont le courant d’air vous apportait l’odeur et la fumée ; dans les galeries on entendait le roulement des wagons ; dans les puits, le frottement des cages d’extraction contre les guides, et par-dessus tout le grondement de la machine à vapeur installée au second niveau.
Mais où le spectacle était tout à fait curieux, c’était dans les remontées, c’est-à-dire dans les galeries tracées dans la pente du filon ; c’était là qu’il fallait voir les piqueurs travailler à moitié nus à abattre le charbon, couchés sur le flanc ou accroupis sur les genoux. De ces remontées la houille descendait dans les niveaux d’où on la roulait jusqu’aux puits d’extraction.
C’était là l’aspect de la mine aux jours de travail, mais il y avait aussi les jours d’accidents. Deux semaines après son arrivée à Varses, Alexis avait été témoin d’un de ces accidents et en avait failli être victime ; une explosion de grisou. Le grisou est un gaz qui se forme naturellement dans les houillères et qui éclate aussitôt qu’il est en contact avec une flamme. Rien n’est plus terrible que cette explosion qui brûle et renverse tout sur son passage ; on ne peut lui comparer que l’explosion d’une poudrière pleine de poudre ; aussitôt que la flamme d’une lampe ou d’une allumette est en contact avec le gaz, l’inflammation éclate instantanément dans toutes les galeries, elle détruit tout dans la mine, même dans les puits d’extraction ou d’aérage dont elle enlève les toitures ; la température est quelquefois portée si haut que le charbon dans la mine se transforme en coke.
Une explosion de grisou avait ainsi tué six semaines auparavant une dizaine d’ouvriers ; et la veuve de l’un de ces ouvriers était devenue folle ; je compris que c’était celle qu’en arrivant j’avais rencontrée avec son enfant cherchant « un chemin frais ».
Contre ces explosions on employait toutes les précautions : il était défendu de fumer, et souvent les ingénieurs en faisant leur ronde forçaient les ouvriers à leur souffler dans le nez pour voir ceux qui avaient manqué à la défense. C’était aussi pour prévenir ces terribles accidents qu’on employait des lampes Davy, du nom d’un grand savant anglais qui les a inventées : ces lampes étaient entourées d’une toile métallique d’un tissu assez fin pour ne pas laisser passer la flamme à travers ses mailles, de sorte que la lampe portée dans une atmosphère explosive, le gaz brûle à l’intérieur de la lampe, mais l’explosion ne se propage point au dehors.
Tout ce qu’Alexis me raconta surexcita vivement ma curiosité, qui était déjà grande en arrivant à Varses, de descendre dans la mine, mais quand j’en parlai le lendemain à l’oncle Gaspard, il me répondit que c’était impossible, parce qu’on ne laissait pénétrer dans la mine que ceux qui y travaillent.
— Si tu veux te faire mineur, ajouta-t-il en riant, c’est facile, et alors tu pourras te satisfaire. Au reste, le métier n’est pas plus mauvais qu’un autre, et si tu as peur de la pluie et du tonnerre, c’est celui qui te convient ; en tous cas il vaut mieux que celui de chanteur de chansons sur les grands chemins. Tu resteras avec Alexis. Est-ce dit, garçon ? On trouvera aussi à employer Mattia, mais pas à jouer du cornet à piston par exemple !
Ce n’était pas pour rester à Varses que j’y étais venu, et je m’étais imposé une autre tâche, un autre but, que de pousser toute la journée une benne dans le deuxième ou le troisième niveau de la Truyère.
Il fallut donc renoncer à satisfaire ma curiosité, et je croyais que je partirais sans en savoir plus long que ne m’en avaient appris les récits d’Alexis ou les réponses arrachées tant bien que mal à l’oncle Gaspard, quand par suite de circonstances dues au hasard, je fus à même d’apprendre dans toutes leurs horreurs, de sentir dans toutes leurs épouvantes les dangers auxquels sont exposés les mineurs.
III
ROULEUR
Le métier de mineur n’est point insalubre, et à part quelques maladies causées par la privation de l’air et de la lumière, qui à la longue appauvrit le sang, le mineur est aussi bien portant que le paysan qui habite un pays sain ; encore a-t-il sur celui-ci l’avantage d’être à l’abri des intempéries des saisons, de la pluie, du froid ou de l’excès de chaleur.
Pour lui le grand danger se trouve dans les éboulements, les explosions et les inondations ; puis aussi dans les accidents résultant de son travail, de son imprudence ou de sa maladresse.
La veille du jour fixé pour mon départ, Alexis rentra avec la main droite fortement contusionnée par un gros bloc de charbon sous lequel il avait eu la maladresse de la laisser prendre : un doigt était à moitié écrasé ; la main entière était meurtrie.
Le médecin de la compagnie vint le visiter et le panser : son état n’était pas grave, la main guérirait, le doigt aussi ; mais il fallait du repos.
L’oncle Gaspard avait pour caractère de prendre la vie comme elle venait, sans chagrin comme sans colère, il n’y avait qu’une chose qui pouvait le faire se départir de sa bonhomie ordinaire : — un empêchement à son travail.
Quand il entendit dire qu’Alexis était condamné au repos pour plusieurs jours, il poussa les hauts cris : qui roulerait sa benne pendant ces jours de repos ? il n’avait personne pour remplacer Alexis ; s’il s’agissait de le remplacer tout à fait il trouverait bien quelqu’un, mais pendant quelques jours seulement cela était en ce moment impossible ; on manquait d’hommes, ou tout au moins d’enfants.
Il se mit cependant en course pour chercher un rouleur, mais il rentra sans en avoir trouvé un.
Alors il recommença ses plaintes : il était véritablement désolé, car il se voyait, lui aussi, condamné au repos, et sa bourse ne lui permettait pas sans doute de se reposer.
Voyant cela et comprenant les raisons de sa désolation ; d’autre part, sentant que c’était presque un devoir en pareille circonstance de payer à ma manière l’hospitalité qui nous avait été donnée, je lui demandai si le métier de rouleur était difficile.
— Rien n’est plus facile ; il n’y a qu’à pousser un wagon qui roule sur des rails.
— Il est lourd, ce wagon ?
— Pas trop lourd, puisqu’Alexis le poussait bien.
— C’est juste ! Alors si Alexis le poussait bien, je pourrais le pousser aussi.
— Toi, garçon ?
Et il se mit à rire aux éclats ; mais bientôt reprenant son sérieux :
— Bien sûr que tu le pourrais si tu le voulais.
— Je le veux, puisque cela peut vous servir.
— Tu es un bon garçon et c’est dit : demain tu descendras avec moi dans la mine ; c’est vrai que tu me rendras service ; mais cela te sera peut-être utile à toi-même ; si tu prenais goût au métier, cela vaudrait mieux que de courir les grands chemins ; il n’y a pas de loups à craindre dans la mine.
Que ferait Mattia pendant que je serais dans la mine ? je ne pouvais pas le laisser à la charge de l’oncle Gaspard.
Je lui demandai s’il ne voulait pas s’en aller tout seul avec Capi donner des représentations dans les environs, et il accepta tout de suite.
— Je serai très-content de te gagner tout seul de l’argent pour la vache, dit-il en riant.
Depuis trois mois, depuis que nous étions ensemble et qu’il vivait en plein air, Mattia ne ressemblait plus au pauvre enfant chétif et chagrin que j’avais retrouvé appuyé contre l’église Saint-Médard, mourant de faim, et encore moins à l’avorton que j’avais vu pour la première fois dans le grenier de Garofoli, soignant le pot-au-feu et prenant de temps en temps sa tête endolorie dans ses deux mains.
Il n’avait plus mal à la tête, Mattia ; il n’était plus chagrin, il n’était même plus chétif : c’était le grenier de la rue de Lourcine qui l’avait rendu triste, le soleil et le plein air, en lui donnant la santé, lui avaient donné la gaîté.
Pendant notre voyage il avait été la bonne humeur et le rire, prenant tout par le bon côté, s’amusant de tout, heureux d’un rien, tournant au bon ce qui était mauvais. Que serais-je devenu sans lui ? Combien de fois la fatigue et la mélancolie ne m’eussent-elles pas accablé ?
Cette différence entre nous deux tenait sans doute à notre caractère et à notre nature, mais aussi à notre origine, à notre race.
Il était Italien et il avait une insouciance, une amabilité, une facilité pour se plier aux difficultés sans se fâcher ou se révolter, que n’ont pas les gens de mon pays, plus disposés à la résistance et à la lutte.
— Quel est donc ton pays ? me direz-vous, tu as donc un pays ?
Il sera répondu à cela plus tard ; pour le moment j’ai voulu dire seulement que Mattia et moi nous ne nous ressemblions guère, ce qui fait que nous nous accordions si bien ; même quand je le faisais travailler pour apprendre ses notes et pour apprendre à lire. La leçon de musique, il est vrai, avait toujours marché facilement, mais pour la lecture il n’en avait pas été de même, et des difficultés auraient très-bien pu s’élever entre nous, car je n’avais ni la patience ni l’indulgence de ceux qui ont l’habitude de l’enseignement. Cependant ces difficultés ne surgirent jamais, et même quand je fus injuste, ce qui m’arriva plus d’une fois, Mattia ne se fâcha point.
Il fut donc entendu que pendant que je descendrais le lendemain dans la mine, Mattia s’en irait donner des représentations musicales et dramatiques, de manière à augmenter notre fortune ; et Capi à qui j’expliquai cet arrangement, parut le comprendre.
Le lendemain matin on me donna les vêtements de travail d’Alexis.
Après avoir une dernière fois recommandé à Mattia et à Capi d’être bien sages dans leur expédition, je suivis l’oncle Gaspard.
— Attention, dit-il, en me remettant ma lampe, marche dans mes pas, et en descendant les échelles, ne lâche jamais un échelon sans auparavant en bien tenir un autre.
Nous nous enfonçâmes dans la galerie ; lui marchant le premier, moi sur ses talons.
— Si tu glisses dans les escaliers, continua-t-il, ne te laisse pas aller, retiens-toi, le fond est loin et dur.
Je n’avais pas besoin de ces recommandations pour être ému, car ce n’est pas sans un certain trouble qu’on quitte la lumière pour entrer dans la nuit, la surface de la terre pour ses profondeurs. Je me retournai instinctivement en arrière, mais déjà nous avions pénétré assez avant dans la galerie, et le jour au bout de ce long tube noir n’était plus qu’un globe blanc comme la lune dans un ciel sombre et sans étoiles. J’eus honte de ce mouvement machinal, qui n’eut que la durée d’un éclair, et je me remis bien vite à emboîter le pas.
— L’escalier, dit-il bientôt.
Nous étions devant un trou noir, et dans sa profondeur insondable pour mes yeux, je voyais des lumières se balancer, grandes à l’entrée, plus petites jusqu’à n’être plus que des points, à mesure qu’elles s’éloignaient. C’étaient les lampes des ouvriers qui étaient entrés avant nous dans la mine : le bruit de leur conversation, comme un sourd murmure, arrivait jusqu’à nous porté par un air tiède qui nous soufflait au visage : cet air avait une odeur que je respirais pour la première fois, c’était quelque chose comme un mélange d’éther et d’essence.
Après l’escalier, les échelles, après les échelles un autre escalier.
— Nous voilà au premier niveau, dit-il.
Nous étions dans une galerie en plein cintre, avec des murs droits ; ces murs étaient en maçonnerie. La voûte était un peu plus élevée que la hauteur d’un homme ; cependant il y avait des endroits où il fallait se courber pour passer, soit que la voûte supérieure se fût abaissée, soit que le sol se fût soulevé.
— C’est la poussée du terrain, me dit-il. Comme la montagne a été partout creusée et qu’il y a des vides, les terres veulent descendre, et, quand elles pèsent trop, elles écrasent les galeries.
Sur le sol étaient des rails de chemins de fer et sur le côté de la galerie coulait un petit ruisseau.
— Ce ruisseau se réunit à d’autres qui, comme lui, reçoivent les eaux des infiltrations ; ils vont tous tomber dans un puisard. Cela fait mille ou douze cents mètres d’eau que la machine doit jeter tous les jours dans la Divonne. Si elle s’arrêtait, la mine ne tarderait pas à être inondée. Au reste en ce moment, nous sommes précisément sous la Divonne.
Et, comme j’avais fait un mouvement involontaire, il se mit à rire aux éclats.
— À cinquante mètres de profondeur, il n’y a pas de danger qu’elle te tombe dans le cou.
— S’il se faisait un trou ?
— Ah bien ! oui, un trou. Les galeries passent et repassent dix fois sous la rivière ; il y a des mines où les inondations sont à craindre, mais ce n’est pas ici ; c’est bien assez du grisou et des éboulements, des coups de mine.
Lorsque nous fûmes arrivés sur le lieu de notre travail, l’oncle Gaspard me montra ce que je devais faire, et lorsque notre benne fut pleine de charbon, il la poussa avec moi pour m’apprendre à la conduire jusqu’au puits et à me garer sur les voies de garage lorsque je rencontrerais d’autres rouleurs venant à ma rencontre.
Il avait eu raison de le dire, ce n’était pas là un métier bien difficile, et en quelques heures, si je n’y devins pas habile, j’y devins au moins suffisant. Il me manquait l’adresse et l’habitude, sans lesquelles on ne réussit jamais dans aucun métier, et j’étais obligé de les remplacer, tant bien que mal, par plus d’efforts, ce qui donnait pour résultat moins de travail utile et plus de fatigue.
Heureusement j’étais aguerri contre la fatigue par la vie que j’avais menée depuis plusieurs années et surtout par mon voyage de trois mois ; je ne me plaignis donc pas, et l’oncle Gaspard déclara que j’étais un bon garçon qui ferait un jour un bon mineur.
Mais si j’avais eu grande envie de descendre dans la mine, je n’avais aucune envie d’y rester ; j’avais eu la curiosité, je n’avais pas de vocation.
Il faut pour vivre de la vie souterraine, des qualités particulières que je n’avais pas ; il faut aimer le silence, la solitude, le recueillement. Il faut rester de longues heures, de longs jours l’esprit replié sur lui-même sans échanger une parole ou recevoir une distraction. Or j’étais très-mal doué de ce côté-là, ayant vécu de la vie vagabonde, toujours chantant et marchant ; je trouvais tristes et mélancoliques les heures pendant lesquelles je poussais mon wagon dans les galeries sombres, n’ayant d’autre lumière que celle de ma lampe, n’entendant d’autre bruit que le roulement lointain des bennes, le clapotement de l’eau dans les ruisseaux, et çà et là les coups de mine, qui en éclatant dans ce silence de mort, le rendaient plus lourd et plus lugubre encore.
Comme c’est déjà un travail de descendre dans la mine et d’en sortir, on y reste toute la journée de douze heures et l’on ne remonte pas pour prendre ses repas à la maison ; on mange sur le chantier.
À côté du chantier de l’oncle Gaspard j’avais pour voisin un rouleur qui, au lieu d’être un enfant comme moi et comme les autres rouleurs, était au contraire un vieux bonhomme à barbe blanche ; quand je parle de barbe blanche il faut entendre qu’elle l’était le dimanche, le jour du grand lavage, car pendant la semaine elle commençait par être grise le lundi pour devenir tout à fait noire le samedi. Enfin il avait près de soixante ans. Autrefois, au temps de sa jeunesse, il avait été boiseur, c’est-à-dire charpentier, chargé de poser et d’entretenir les bois qui forment les galeries ; mais dans un éboulement il avait eu trois doigts écrasés ce qui l’avait forcé de renoncer à son métier. La compagnie au service de laquelle il travaillait lui avait fait une petite pension, car cet accident lui était arrivé en sauvant trois de ses camarades. Pendant quelques années il avait vécu de cette pension. Puis la compagnie ayant fait faillite, il s’était trouvé sans ressources, sans état, et il était alors entré à la Truyère comme rouleur. On le nommait le magister, autrement dit le maître d’école, parce qu’il savait beaucoup de choses que les piqueurs et même les maîtres mineurs ne savent pas, et parce qu’il en parlait volontiers, tout fier de sa science.
Pendant les heures des repas nous fîmes connaissance, et bien vite, il me prit en amitié ; j’étais questionneur enragé, il était causeur ; nous devînmes inséparables. Dans la mine, où généralement on parle peu, on nous appela les bavards.
Les récits d’Alexis ne m’avaient pas appris tout ce que je voulais savoir, et les réponses de l’oncle Gaspard ne m’avaient pas non plus satisfait, car lorsque je lui demandais :
— Qu’est-ce que le charbon de terre ?
Il me répondait toujours :
— C’est du charbon qu’on trouve dans la terre.
Cette réponse de l’oncle Gaspard sur le charbon de terre et celles du même genre qu’il m’avait faites n’étaient point suffisantes pour moi, Vitalis m’ayant appris à me contenter moins facilement. Quand je posai la même question au magister il me répondit tout autrement.
— Le charbon de terre, me dit-il, n’est rien autre chose que du charbon de bois : au lieu de mettre dans nos cheminées des arbres de notre époque que des hommes comme toi et moi ont transformés en charbon, nous y mettons des arbres poussés dans des forêts très-anciennes et qui ont été transformés en charbon par les forces de la nature, je veux dire par des incendies, des volcans, des tremblements de terre naturels.
Et comme je le regardais avec étonnement.
— Nous n’avons pas le temps de causer de cela aujourd’hui, dit-il, il faut pousser la benne, mais c’est demain dimanche, viens me voir ; je t’expliquerai ça à la maison ; j’ai là des morceaux de charbon et de roche que j’ai ramassés depuis trente ans et qui te feront comprendre par les yeux ce que tu entendras par les oreilles. Ils m’appellent en riant le magister, mais le magister, tu le verras, est bon à quelque chose ; la vie de l’homme n’est pas toute entière dans ses mains, elle est aussi dans sa tête. Comme toi et à ton âge j’étais curieux ; je vivais dans la mine, j’ai voulu connaître ce que je voyais tous les jours ; j’ai fait causer les ingénieurs quand ils voulaient bien me répondre, et j’ai lu. Après mon accident j’avais du temps à moi, je l’ai employé à apprendre : quand on a des yeux pour regarder et que sur ces yeux on pose des lunettes que vous donnent les livres, on finit par voir bien des choses. Maintenant je n’ai pas grand temps pour lire et je n’ai pas d’argent pour acheter des livres, mais j’ai encore des yeux et je les tiens ouverts. Viens demain, je serais content de t’apprendre à regarder autour de toi. On ne sait pas ce qu’une parole qui tombe dans une oreille fertile peut faire germer. C’est pour avoir conduit dans les mines de Bessèges un grand savant nommé Brongniart et l’avoir entendu parler pendant ses recherches, que l’idée m’est venue d’apprendre et qu’aujourd’hui j’en sais un peu plus long que nos camarades. À demain.
Le lendemain j’annonçai à l’oncle Gaspard que j’allais voir le magister.
— Ah ! ah ! dit-il en riant, il a trouvé à qui causer ; vas-y, mon garçon, puisque le cœur t’en dit ; après tout, tu croiras ce que tu voudras ; seulement, si tu apprends quelque chose avec lui, n’en sois pas plus fier pour ça ; s’il n’était pas fier, le magister serait un bon homme.
Le magister ne demeurait point, comme la plupart des mineurs, dans l’intérieur de la ville, mais à une petite distance, à un endroit triste et pauvre qu’on appelle les Espétagues, parce qu’aux environs se trouvent de nombreuses excavations creusées par la nature dans le flanc de la montagne. Il habitait là chez une vieille femme, veuve d’un mineur tué dans un éboulement. Elle lui sous-louait une espèce de cave dans laquelle il avait établi son lit à la place la plus sèche, ce qui ne veut pas dire qu’elle le fût beaucoup, car sur les pieds du bois de lit poussaient des champignons ; mais pour un mineur habitué à vivre les pieds dans l’humidité et à recevoir toute la journée sur le corps des gouttes d’eau, c’était là un détail sans importance. Pour lui, la grande affaire, en prenant ce logement, avait été d’être près des cavernes de la montagne dans lesquelles il allait faire des recherches, et surtout de pouvoir disposer à son gré sa collection de morceaux de houille, de pierres marquées d’empreintes, et de fossiles.
Il vint au-devant de moi quand j’entrai, et d’une voix heureuse :
— Je t’ai commandé une biroulade, dit-il, parce que si la jeunesse a des oreilles et des yeux, elle a aussi un gosier, de sorte que le meilleur moyen d’être de ses amis, c’est de satisfaire le tout en même temps.
La biroulade est un festin de châtaignes rôties qu’on mouille de vin blanc, et qui est en grand honneur dans les Cévennes.
— Après la biroulade, continua le magister, nous causerons et tout en causant je te montrerai ma collection.
Il dit ce mot ma collection d’un ton qui justifiait le reproche que lui faisaient ses camarades, et jamais assurément conservateur d’un muséum n’y mit plus de fierté. Au reste cette collection paraissait très-riche, au moins autant que j’en pouvais juger, et elle occupait tout le logement, rangée sur des planches et des tables pour les petits échantillons, posée sur le sol pour les gros. Depuis vingt ans, il avait réuni tout ce qu’il avait trouvé de curieux dans ses travaux, et comme les mines du bassin de la Cère et de la Divonne sont riches en végétaux fossiles, il avait là des exemplaires rares qui eussent fait le bonheur d’un géologue et d’un naturaliste.
Il avait au moins autant de hâte à parler que moi j’en avais à l’écouter ; aussi la biroulade fut-elle promptement expédiée.
— Puisque tu as voulu savoir, me dit-il, ce que c’était que le charbon de terre, écoute, je vais te l’expliquer à peu près et en peu de mots, pour que tu sois en état de regarder ma collection, qui te l’expliquera mieux que moi, car bien qu’on m’appelle le magister, je ne suis pas un savant, hélas ! il s’en faut de tout. La terre que nous habitons n’a pas toujours été ce qu’elle est maintenant ; elle a passé par plusieurs états qui ont été modifiés par ce qu’on nomme les révolutions du globe. Il y a eu des époques où notre pays a été couvert de plantes qui ne croissent maintenant que dans les pays chauds : ainsi les fougères en arbres. Puis il est venu une révolution, et cette végétation a été remplacée par une autre tout à fait différente, laquelle à son tour a été remplacée par une nouvelle ; et ainsi de suite toujours pendant des milliers, des millions d’années peut-être. C’est cette accumulation de plantes et d’arbres, qui en se décomposant et en se superposant a produit les couches de houille. Ne sois pas incrédule, je vais te montrer tout à l’heure dans ma collection quelques morceaux de charbon, et surtout une grande quantité de morceaux de pierre pris aux bancs que nous nommons le mur ou le toit, et qui portent tous les empreintes de ces plantes, qui se sont conservées là comme les plantes se conservent entre les feuilles de papier d’un herbier. La houille est donc formée, ainsi que je te le disais, par une accumulation de plantes et d’arbres ; ce n’est donc que du bois décomposé et comprimé. Comment s’est formée cette accumulation, vas-tu me demander ? Cela, c’est plus difficile à expliquer, et je crois même que les savants ne sont pas encore arrivés à l’expliquer très-bien, puisqu’ils ne sont pas d’accord entre eux. Les uns croient que toutes ces plantes charriées par les eaux ont formé d’immenses radeaux sur les mers qui sont venus s’échouer çà et là poussés par les courants. D’autres disent que les bancs de charbon sont dus à l’accumulation paisible de végétaux qui, se succédant les uns aux autres, ont été enfouis au lieu même où ils avaient poussé. Et là-dessus, les savants ont fait des calculs qui donnent le vertige à l’esprit : ils ont trouvé qu’un hectare de bois en forêt étant coupé et étant étendu sur la terre ne donnait qu’une couche de bois ayant à peine huit millimètres d’épaisseur ; transformée en houille, cette couche de bois ne donnerait que 2 millimètres. Or il y a, enfouies dans la terre, des couches de houille qui ont 20 et 30 mètres d’épaisseur. Combien a-t-il fallu de temps pour que ces couches se forment ? Tu comprends bien, n’est-ce pas, qu’une futaie ne pousse pas en un jour ; il lui faut environ une centaine d’années pour se développer. Pour former une couche de houille de 30 mètres d’épaisseur, il faut donc une succession de 5,000 futaies poussant à la même place, c’est-à-dire 500,000 ans. C’est déjà un chiffre bien étonnant, n’est-ce pas ? cependant il n’est pas exact, car les arbres ne se succèdent pas avec cette régularité, ils mettent plus de cent ans à pousser et à mourir, et quand une espèce remplace une autre il faut une série de transformations et de révolutions pour que cette couche de plantes décomposées soit en état d’en nourrir une nouvelle. Tu vois donc que 500,000 années ne sont rien et qu’il en faut sans doute beaucoup plus encore. Combien ? Je n’en sais rien, et ce n’est pas à un homme comme moi de le chercher. Tout ce que j’ai voulu, c’était te donner une idée de ce qu’est le charbon de terre afin que tu sois en état de regarder ma collection. Maintenant, allons la voir.
La visite dura jusqu’à la nuit, car à chaque morceau de pierre, à chaque empreinte de plante, le magister recommença ses explications, si bien qu’à la fin je commençai à comprendre à peu près ce qui, tout d’abord, m’avait si fort étonné.
IV
L’INONDATION
Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes dans la mine.
— Eh bien ! dit l’oncle Gaspard, as-tu été content du garçon, magister ?
— Mais oui, il a des oreilles, et j’espère que bientôt il aura des yeux.
— En attendant, qu’il ait aujourd’hui des bras ! dit l’oncle Gaspard.
Et il me remit un coin pour l’aider à détacher un morceau de houille qu’il avait entamé par dessous ; car les piqueurs se font aider par les rouleurs.
Comme je venais de rouler ma benne au puits Sainte-Alphonsine pour la troisième fois, j’entendis du côté du puits un bruit formidable, un grondement épouvantable et tel que je n’avais jamais rien entendu de pareil depuis que je travaillais dans la mine. Était-ce un éboulement, un effondrement général ? J’écoutai ; le tapage continuait en se répercutant de tous côtés. Qu’est-ce que cela voulait dire ? Mon premier sentiment fut l’épouvante, et je pensai à me sauver en gagnant les échelles ; mais on s’était déjà moqué de moi si souvent pour mes frayeurs, que la honte me fit rester. C’était une explosion de mine ; une benne qui tombait dans le puits ; peut-être tout simplement des remblais qui descendaient par les couloirs.
Tout à coup un peloton de rats me passa entre les jambes en courant comme un escadron de cavalerie qui se sauve ; puis il me sembla entendre un frôlement étrange contre le sol et les parois de la galerie avec un clapotement d’eau. L’endroit où je m’étais arrêté étant parfaitement sec, ce bruit d’eau était inexplicable.
Je pris ma lampe pour regarder, et la baissai sur le sol.
C’était bien l’eau ; elle venait du côté du puits, remontant la galerie. Ce bruit formidable, ce grondement, étaient donc produits par une chute d’eau qui se précipitait dans la mine.
Abandonnant ma benne sur les rails, je courus au chantier.
— Oncle Gaspard, l’eau est dans la mine !
— Encore des bêtises !
— Il s’est fait un trou sous la Divonne ; sauvons-nous !
— Laisse-moi tranquille !
— Écoutez donc.
Mon accent était tellement ému que l’oncle Gaspard resta le pic suspendu pour écouter ; le même bruit continuait toujours plus fort, plus sinistre. Il n’y avait pas à s’y tromper, c’était l’eau qui se précipitait.
— Cours vite, me cria-t-il, l’eau est dans la mine.
Tout en criant : « l’eau est dans la mine », l’oncle Gaspard avait saisi sa lampe, car c’est toujours là le premier geste d’un mineur, il se laissa glisser dans la galerie.
Je n’avais pas fait dix pas que j’aperçus le magister qui descendait aussi dans la galerie pour se rendre compte du bruit qui l’avait frappé.
— L’eau dans la mine ! cria l’oncle Gaspard.
— La Divonne a fait un trou, dis-je.
— Es-tu bête.
— Sauve-toi ! cria le magister.
Le niveau de l’eau s’était rapidement élevé dans la galerie ; elle montait maintenant jusqu’à nos genoux, ce qui ralentissait notre course.
Le magister se mit à courir avec nous et tous trois nous criions en passant devant les chantiers :
— Sauvez-vous ! l’eau est dans la mine !
Le niveau de l’eau s’élevait avec une rapidité furieuse ; heureusement nous n’étions pas très-éloignés des échelles, sans quoi nous n’aurions jamais pu les atteindre. Le magister y arriva le premier, mais il s’arrêta :
— Montez d’abord, dit-il, moi je suis le plus vieux, et puis j’ai la conscience tranquille.
Nous n’étions pas dans les conditions à nous faire des politesses ; l’oncle Gaspard passa le premier, je le suivis, et le magister vint derrière, puis après lui, mais à un assez long intervalle, quelques ouvriers qui nous avaient rejoints.
Jamais les quarante mètres qui séparent le deuxième niveau du premier, ne furent franchis avec pareille rapidité. Mais avant d’arriver au dernier échelon un flot d’eau nous tomba sur la tête et noya nos lampes. C’était une cascade.
— Tenez bon ! cria l’oncle Gaspard.
Lui, le magister et moi nous nous cramponnâmes assez solidement aux échelons pour résister, mais ceux qui venaient derrière nous furent entraînés, et bien certainement si nous avions eu plus d’une dizaine d’échelons à monter encore nous aurions, comme eux, été précipités, car instantanément la cascade était devenue une avalanche.
Arrivés au premier niveau nous n’étions pas sauvés, car nous avions encore cinquante mètres à franchir avant de sortir, et l’eau était aussi dans cette galerie ; nous étions sans lumière, nos lampes éteintes.
— Nous sommes perdus, dit le magister d’une voix presque calme, fais ta prière, Rémi.
Mais au même instant, dans la galerie, parurent sept ou huit lampes qui accouraient vers nous ; l’eau nous arrivait déjà aux genoux, sans nous baisser nous la touchions de la main. Ce n’était pas une eau tranquille, mais un torrent, un tourbillon qui entraînait tout sur son passage et faisait tournoyer des pièces de bois comme des plumes.
Les hommes qui accouraient sur nous, et dont nous avions aperçu les lampes, voulaient suivre la galerie et gagner ainsi les échelles et les escaliers qui se trouvaient près de là ; mais devant pareil torrent c’était impossible : comment le refouler, comment même résister à son impulsion et aux pièces de boisage qu’il charriait.
Le même mot qui avait échappé au magister, leur échappa aussi :
— Nous sommes perdus !
Ils étaient arrivés jusqu’à nous.
— Par là, oui, cria le magister qui seul entre nous paraissait avoir gardé quelque raison, notre seul refuge est aux vieux travaux.
Les vieux travaux étaient une partie de la mine abandonnée depuis longtemps et où personne n’allait, mais que le magister, lui, avait souvent visitée lorsqu’il était à la recherche de quelque curiosité.
— Retournez sur vos pas, cria-t-il, et donnez-moi une lampe, que je vous conduise.
D’ordinaire quand il parlait on lui riait au nez ou bien on lui tournait le dos en haussant les épaules, mais les plus forts avaient perdu leur force, dont ils étaient si fiers, et à la voix de ce vieux bonhomme dont ils se moquaient cinq minutes auparavant, tous obéirent ; instinctivement toutes les lampes lui furent tendues.
Vivement il en saisit une d’une main, et m’entraînant de l’autre, il prit la tête de notre troupe. Comme nous allions dans le même sens que le courant nous marchions assez vite.
Je ne savais où nous allions, mais l’espérance m’était revenue.
Après avoir suivi la galerie pendant quelques instants, je ne sais si ce fut durant quelques minutes ou quelques secondes, car nous n’avions plus la notion du temps, il s’arrêta.
— Nous n’aurons pas le temps, cria-t-il, l’eau monte trop vite.
En effet, elle nous gagnait à grands pas : des genoux elle m’était arrivée aux hanches, des hanches à la poitrine.
— Il faut nous jeter dans une remontée, dit le magister.
— Et après ?
— La remontée ne conduit nulle part.
Se jeter dans la remontée, c’était prendre en effet un cul-de-sac ; mais nous n’étions pas en position d’attendre et de choisir ; il fallait ou prendre la remontée et avoir ainsi quelques minutes devant soi, c’est-à-dire l’espérance de se sauver, ou continuer la galerie avec la certitude d’être engloutis, submergés avant quelques secondes.
Le magister à notre tête nous nous engageâmes donc dans la remontée. Deux de nos camarades voulurent pousser dans la galerie et ceux-là, nous ne les revîmes jamais.
Alors reprenant conscience de la vie, nous entendîmes un bruit qui assourdissait nos oreilles depuis que nous avions commencé à fuir et que cependant nous n’avions pas encore entendu : des éboulements, des tourbillonnements et des chutes d’eau, des éclats des boisages, des explosions d’air comprimé ; c’était dans toute la mine un vacarme épouvantable qui nous anéantit.
— C’est le déluge.
— La fin du monde.
— Mon Dieu ! ayez pitié de nous !
Depuis que nous étions dans la remontée, le magister n’avait pas parlé, car son âme était au-dessus des plaintes inutiles.
— Les enfants, dit-il, il ne faut pas nous fatiguer ; si nous restons ainsi cramponnés des pieds et des mains nous ne tarderons pas à nous épuiser ; il faut nous creuser des points d’appui dans le schiste.
Le conseil était juste, mais difficile à exécuter, car personne n’avait emporté un pic ; tous nous avions nos lampes, aucun de nous n’avait un outil.
— Avec les crochets de nos lampes, continua le magister.
Et chacun se mit à entamer le sol avec le crochet de sa lampe ; la besogne était malaisée, la remontée étant très-inclinée et glissante. Mais quand on sait que si l’on glisse on trouvera la mort au bas de la glissade, cela donne des forces et de l’adresse. En moins de quelques minutes nous eûmes tous creusé un trou de manière à y poser notre pied.
Cela fait, on respira un peu et l’on se reconnut. Nous étions sept : le magister, moi près de lui, l’oncle Gaspard, trois piqueurs nommés Pagès, Compeyrou et Bergounhoux, et un rouleur, Carrory ; les autres ouvriers avaient disparu dans la galerie.
Les bruits dans la mine continuaient avec la même violence : il n’y a pas de mots pour rendre l’intensité de cet horrible tapage, et les détonations du canon se mêlant au tonnerre et à des éboulements n’en eussent pas produit un plus formidable.
Effarés, affolés d’épouvante, nous nous regardions, cherchant dans les yeux de notre voisin des explications que notre esprit ne nous donnait pas.
— C’est le déluge, disait l’un.
— La fin du monde.
— Un tremblement de terre.
— Le génie de la mine, qui se fâche et veut se venger.
— Une inondation par l’eau amoncelée dans les vieux travaux.
— Un trou que s’est creusé la Divonne.
Cette dernière hypothèse était de moi. Je tenais à mon trou.
Le magister n’avait rien dit ; et il nous regardait les uns après les autres, haussant les épaules, comme s’il eût discuté la question en plein jour, sous l’ombrage d’un mûrier en mangeant un oignon.
— Pour sûr c’est une inondation, dit-il enfin et le dernier, alors que chacun eut émis son avis.
— Causée par un tremblement de terre.
— Envoyée par le génie de la mine.
— Venue des vieux travaux.
— Tombée de la Divonne par un trou.
Chacun allait répéter ce qu’il avait déjà dit.
— C’est une inondation, continua le magister.
— Eh bien, après ? d’où vient-elle, dirent en même temps plusieurs voix.
— Je n’en sais rien, mais quant au génie de la mine, c’est des bêtises ; quant aux vieux travaux, ça ne serait possible que si le troisième niveau seul avait été inondé, mais le second l’est et le premier aussi : vous savez bien que l’eau ne remonte pas et qu’elle descend toujours.
— Le trou.
— Il ne se fait pas de trous comme ça, naturellement.
— Le tremblement de terre.
— Je ne sais pas.
— Alors si vous ne savez pas, ne parlez pas.
— Je sais que c’est une inondation et c’est déjà quelque chose, une inondation qui vient d’en haut.
— Pardi ! ça se voit, l’eau nous a suivis.
Et comme une sorte de sécurité nous était venue depuis que nous étions à sec et que l’eau ne montait plus, on ne voulut plus écouter le magister.
— Ne fais donc pas le savant, puisque tu n’en sais pas plus que nous.
L’autorité que lui avait donnée sa fermeté dans le danger était déjà perdue. Il se tut sans insister.
Pour dominer le vacarme, nous parlions à pleine voix et cependant notre voix était sourde.
— Parle un peu, me dit le magister.
— Que voulez-vous que je dise ?
— Ce que tu voudras, parle seulement, dis les premiers mots venus.
Je prononçai quelques paroles.
— Bon, plus doucement maintenant. C’est cela. Bien.
— Perds-tu la tête, eh magister ! dit Pagès.
— Deviens-tu fou de peur ?
— Crois-tu que tu es mort ?
— Je crois que l’eau ne nous gagnera pas ici, et que si nous mourons, au moins nous ne serons pas noyés.
— Ça veut dire, magister ?
— Regarde ta lampe.
— Eh bien, elle brûle.
— Comme d’habitude ?
— Non ; la flamme est plus vive, mais courte.
— Est-ce qu’il y a du grisou ?
— Non, dit le magister, cela non plus n’est pas à craindre ; pas plus de danger par le grisou que par l’eau qui maintenant ne montera pas d’un pied.
— Ne fais donc pas le sorcier.
— Je ne fais pas le sorcier : nous sommes dans une cloche d’air et c’est l’air comprimé qui empêche l’eau de monter ; la remontée fermée à son extrémité fait pour nous ce que fait la cloche à plongeur : l’air refoulé par les eaux s’est amoncelé dans cette galerie et maintenant il résiste à l’eau et la refoule.
En entendant le magister nous expliquer que nous étions dans une sorte de cloche à plongeur où l’eau ne pouvait pas monter jusqu’à nous, parce que l’air l’arrêtait, il y eut des murmures d’incrédulité.
— En voilà une bêtise ! est-ce que l’eau n’est pas plus forte que tout ?
— Oui, dehors, librement ; mais quand tu jettes ton verre, la gueule en bas, dans un seau plein, est-ce que l’eau va jusqu’au fond de ton verre ? Non, n’est-ce pas, il reste un vide. Eh bien ! ce vide est maintenu par l’air. Ici, c’est la même chose ; nous sommes au fond du verre, l’eau ne viendra pas jusqu’à nous.
— Ça, je le comprends, dit l’oncle Gaspard, et j’ai dans l’idée, maintenant, que vous aviez tort, vous autres, de vous moquer si souvent du magister ; il sait des choses que nous ne savons pas.
— Nous sommes donc sauvés ! dit Carrory.
— Sauvés ? je n’ai pas dit ça. Nous ne serons pas noyés, voilà ce que je vous promets. Ce qui nous sauve, c’est que la remontée étant fermée, l’air ne peut pas s’échapper ; mais c’est précisément ce qui nous sauve qui nous perd en même temps ; l’air ne peut pas sortir : il est emprisonné. Mais nous aussi nous sommes emprisonnés, nous ne pouvons pas sortir.
— Quand l’eau va baisser…
— Va-t-elle baisser ? je n’en sais rien : pour savoir ça il faudrait savoir comment elle est venue, et qui est-ce qui peut le dire ?
— Puisque tu dis que c’est une inondation ?
— Eh bien ! après ? c’est une inondation, ça c’est sûr ; mais d’où vient-elle ? est-ce la Divonne qui a débordé jusqu’aux puits, est-ce un orage, est-ce une source qui a crevé, est-ce un tremblement de terre ? Il faudrait être dehors, pour dire ça, et par malheur nous sommes dedans.
— Peut-être que la ville est emportée ?
— Peut-être…
Il y eut un moment de silence et d’effroi.
Le bruit de l’eau avait cessé, seulement, de temps en temps, on entendait à travers la terre des détonations sourdes et l’on ressentait comme des secousses.
— La mine doit être pleine, dit le magister, l’eau ne s’y engouffre plus.
— Et Marius ! s’écria Pagès avec désespoir.
Marius, c’était son fils, piqueur comme lui, qui travaillait à la mine, dans le troisième niveau. Jusqu’à ce moment, le sentiment de la conservation personnelle, toujours si tyrannique, l’avait empêché de penser à son fils ; mais le mot du magister : « la mine est pleine » l’avait arraché à lui-même.
— Marius ! Marius ! cria-t-il avec un accent déchirant ; Marius !
Rien ne répondit, pas même l’écho ; la voix assourdie ne sortit pas de notre cloche.
— Il aura trouvé une remontée, dit le magister ; cent cinquante hommes noyés, ce serait trop horrible ; le bon Dieu ne le voudra pas.
Il me sembla qu’il ne disait pas cela d’une voix convaincue. Cent cinquante hommes au moins étaient descendus le matin dans la mine : combien avaient pu remonter par les puits ou trouver un refuge, comme nous ! Tous nos camarades perdus, noyés, morts. Personne n’osa plus dire un mot.
Mais dans une situation comme la nôtre, ce n’est pas la sympathie et la pitié qui dominent les cœurs ou dirigent les esprits.
— Eh bien ! et nous, dit Bergounhoux, après un moment de silence, qu’est-ce que nous allons faire ?
— Que veux-tu faire ?
— Il n’y a qu’à attendre, dit le magister.
— Attendre quoi ?
— Attendre ; veux-tu percer les quarante ou cinquante mètres qui nous séparent du jour avec ton crochet de lampe ?
— Mais nous allons mourir de faim.
— Ce n’est pas là qu’est le plus grand danger.
— Voyons, magister, parle, tu nous fais peur ; où est le danger, le grand danger ?
— La faim, on peut lui résister ; j’ai lu que des ouvriers, surpris comme nous par les eaux, dans une mine, étaient restés vingt-quatre jours sans manger : il y a bien des années de cela, c’était du temps des guerres de religion ; mais ce serait hier, ce serait la même chose. Non, ce n’est pas la faim qui me fait peur.
— Qu’est-ce qui te tourmente, puisque tu dis que les eaux ne peuvent pas monter ?
— Vous sentez-vous des lourdeurs dans la tête, des bourdonnements ; respirez-vous facilement ? moi, non.
— Moi, j’ai mal à la tête.
— Moi, le cœur me tourne.
— Moi, les tempes me battent.
— Moi, je suis tout bête.
— Eh bien ! c’est là qu’est le danger présentement. Combien de temps pouvons-nous vivre dans cet air ? Je n’en sais rien. Si j’étais un savant au lieu d’être un ignorant, je vous le dirais. Tandis que je ne le sais pas. Nous sommes à une quarantaine de mètres sous terre, et, probablement, nous avons trente-cinq ou quarante mètres d’eau au-dessus de nous : cela veut dire que l’air subit une pression de quatre ou cinq atmosphères. Comment vit-on dans cet air comprimé ? voilà ce qu’il faudrait savoir et ce que nous allons apprendre à nos dépens, peut-être.
Je n’avais aucune idée de ce que c’était que l’air comprimé, et précisément pour cela, peut-être, je fus très-effrayé des paroles du magister ; mes compagnons me parurent aussi très-affectés de ces paroles ; ils n’en savaient pas plus que moi, et, sur eux comme sur moi, l’inconnu produisit son effet inquiétant.
Pour le magister, il ne perdait pas la conscience de notre situation désespérée, et quoiqu’il la vit nettement dans toute son horreur, il ne pensait qu’aux moyens à prendre pour organiser notre défense.
— Maintenant, dit-il, il s’agit de nous arranger pour rester ici sans danger de rouler à l’eau.
— Nous avons des trous.
— Croyez-vous que vous n’allez pas vous fatiguer de rester dans la même position ?
— Tu crois donc que nous allons rester ici longtemps ?
— Est-ce que je sais !
— On va venir à notre secours.
— C’est certain, mais pour venir à notre secours, il faut pouvoir. Combien de temps s’écoulera, avant qu’on commence notre sauvetage ? Ceux-là seuls qui sont sur la terre, peuvent le dire. Nous qui sommes dessous, il faut nous arranger pour y être le moins mal possible, car si l’un de nous glisse, il est perdu.
— Il faut nous attacher tous ensemble.
— Et des cordes ?
— Il faut nous tenir par la main.
— M’est avis que le mieux est de nous creuser des paliers comme dans un escalier ; nous sommes sept, sur deux paliers nous pourrons tenir tous ; quatre se placeront sur le premier, trois sur le second.
— Avec quoi creuser ?
— Nous n’avons pas de pics.
— Avec nos crochets de lampes dans le poussier, avec nos couteaux dans les parties dures.
— Jamais nous ne pourrons.
— Ne dis donc pas cela, Pagès ; dans notre situation on peut tout pour sauver sa vie ; si le sommeil prenait l’un de nous comme nous sommes en ce moment, celui-là serait perdu.
Par son sang-froid et sa décision, le magister avait pris sur nous une autorité qui, d’instant en instant, devenait plus puissante ; c’est là ce qu’il y a de grand et de beau dans le courage, il s’impose ; d’instinct nous sentions que sa force morale luttait contre la catastrophe qui avait anéanti la nôtre, et nous attendions notre secours de cette force.
On se mit au travail, car il était évident que le creusement de ces deux paliers était la première chose à faire ; il fallait nous établir, sinon commodément, du moins de manière à ne pas rouler dans le gouffre qui était à nos pieds. Quatre lampes étaient allumées, elles donnaient assez de clarté pour nous guider.
— Choisissons des endroits où le creusement ne soit pas trop difficile, dit le magister.
— Écoutez, dit l’oncle Gaspard, j’ai une proposition à vous faire : si quelqu’un a la tête à lui, c’est le magister ; quand nous perdions la raison il a conservé la sienne ; c’est un homme, il a du cœur aussi. Il a été piqueur comme nous, et sur bien des choses il en sait plus que nous. Je demande qu’il soit chef de poste et qu’il dirige le travail.
— Le magister ! interrompit Carrory qui était une espèce de brute, une bête de trait, sans autre intelligence que celle qui lui était nécessaire pour rouler sa benne, pourquoi pas moi ? si on prend un rouleur, je suis rouleur comme lui.
— Ce n’est pas un rouleur qu’on prend, animal ; c’est un homme ; et, de nous tous, c’est lui qui est le plus homme.
— Vous ne disiez pas cela hier.
— Hier, j’étais aussi bête que toi et je me moquais du magister comme les autres, pour ne pas reconnaître qu’il en savait plus que nous. Aujourd’hui je lui demande de nous commander. Voyons, magister, qu’est-ce que tu veux que je fasse ? J’ai de bons bras, tu sais bien. Et vous, les autres ?
— Voyons, magister, on t’obéit.
— Et on t’obéira.
— Écoutez, dit le magister, puisque vous voulez que je sois chef de poste, je veux bien ; mais c’est à condition qu’on fera ce que je dirai. Nous pouvons rester ici longtemps, plusieurs jours ; je ne sais pas ce qui se passera : nous serons là comme des naufragés sur un radeau, dans une situation plus terrible même, car sur un radeau, au moins, on a l’air et le jour : on respire et l’on voit ; quoi qu’il arrive il faut, si je suis chef de poste, que vous m’obéissiez.
— On obéira, dirent toutes les voix.
— Si vous croyez que ce que je demande est juste, oui, on obéira ; mais si vous ne le croyez pas ?
— On le croira.
— On sait bien que tu es un honnête homme, magister.
— Et un homme de courage.
— Et un homme qui en sait long.
— Il ne faut pas te souvenir des moqueries, magister.
Je n’avais pas alors l’expérience que j’ai acquise plus tard, et j’étais dans un grand étonnement de voir combien ceux-là même qui, quelques heures auparavant, n’avaient pas assez de plaisanteries pour accabler le magister, lui reconnaissaient maintenant des qualités : je ne savais pas comme les circonstances peuvent tourner les opinions et les sentiments de certains hommes.
— C’est juré ? dit le magister.
— Juré, répondîmes-nous tous ensemble.
Alors on se mit au travail : tous, nous avions des couteaux dans nos poches, de bons couteaux, le manche solide, la lame résistante.
— Trois entameront la remontée, dit le magister, les trois plus forts ; et les plus faibles : Rémi, Carrory, Pagès et moi, nous rangerons les déblais.
— Non, pas toi, interrompit Compayrou qui était un colosse, il ne faut pas que tu travailles, magister, tu n’es pas assez solide ; tu es l’ingénieur : les ingénieurs ne travaillent pas des bras.
Tout le monde appuya l’avis de Compayrou, disant que puisque le magister était notre ingénieur, il ne devait pas travailler ; on avait si bien senti l’utilité de la direction du magister que volontiers on l’eût mis dans du coton pour le préserver des dangers et des accidents : c’était notre pilote.
Le travail que nous avions à faire eût été des plus simples si nous avions eu des outils, mais avec des couteaux il était long et difficile. Il fallait en effet établir deux paliers en les creusant dans le schiste, et afin de n’être pas exposés à dévaler sur la pente de la remontée, il fallait que ces paliers fussent assez larges pour donner de la place à quatre d’entre nous sur l’un, et à trois sur l’autre. Ce fut pour obtenir ce résultat que ces travaux furent entrepris.
Deux hommes creusaient le sol dans chaque chantier et le troisième faisait descendre les morceaux de schiste. Le magister, une lampe à la main, allait de l’un à l’autre chantier.
En creusant, on trouva dans la poussière quelques morceaux de boisage qui avaient été ensevelis là et qui furent très-utiles pour retenir nos déblais et les empêcher de rouler jusqu’en bas.
Après trois heures de travail sans repos, nous avions creusé une planche sur laquelle nous pouvions nous asseoir.
— Assez pour le moment, commanda le magister, plus tard nous élargirons la planche de manière à pouvoir nous coucher ; il ne faut pas user inutilement nos forces, nous en aurons besoin.
On s’installa, le magister, l’oncle Gaspard, Carrory et moi sur le palier inférieur, les trois piqueurs sur le plus élevé.
— Il faut ménager nos lampes, dit le magister, qu’on les éteigne donc et qu’on n’en laisse brûler qu’une.
Les ordres étaient exécutés au moment même où ils étaient transmis. On allait donc éteindre les lampes inutiles lorsque le magister fit un signe pour qu’on s’arrêtât.
— Une minute, dit-il, un courant d’air peut éteindre notre lampe ; ce n’est guère probable, cependant il faut compter sur l’impossible, qu’est-ce qui a des allumettes pour la rallumer ?
Bien qu’il soit sévèrement défendu d’allumer du feu dans la mine, presque tous les ouvriers ont des allumettes dans leurs poches ; aussi comme il n’y avait pas là d’ingénieur pour constater l’infraction au règlement, à la demande : « qui a des allumettes ? » quatre voix répondirent : Moi.
— Moi aussi j’en ai, continua le magister, mais elles sont mouillées.
C’était le cas des autres, car chacun avait ses allumettes dans son pantalon et nous avions trempé dans l’eau jusqu’à la poitrine ou jusqu’aux épaules.
Carrory qui avait la compréhension lente et la parole plus lente encore répondit enfin :
— Moi aussi j’ai des allumettes.
— Mouillées ?
— Je ne sais pas, elles sont dans mon bonnet.
— Alors, passe ton bonnet.
Au lieu de passer son bonnet, comme on le lui demandait, un bonnet de loutre qui était gros comme un turban de turc de foire, Carrory nous passa une boîte d’allumettes ; grâce à la position qu’elles avaient occupée pendant notre immersion elles avaient échappé à la noyade.
— Maintenant, soufflez les lampes, commanda le magister.
Une seule lampe resta allumée, qui éclaira à peine notre cage.
V
DANS LA REMONTÉE
Le silence s’était fait dans la mine ; aucun bruit ne parvenait plus jusqu’à nous ; à nos pieds l’eau était immobile, sans une ride ou un murmure ; la mine était pleine comme l’avait dit le magister, et l’eau, après avoir envahi toutes les galeries depuis le plancher jusqu’au toit, nous murait dans notre prison plus solidement, plus hermétiquement qu’un mur de pierre. Ce silence lourd, impénétrable, ce silence de mort était plus effrayant, plus stupéfiant que ne l’avait été l’effroyable vacarme que nous avions entendu au moment de l’irruption des eaux ; nous étions au tombeau, enterrés vifs, et trente ou quarante mètres de terre pesaient sur nos cœurs.
Le travail occupe et distrait : le repos nous donna la sensation de notre situation, et chez tous, même chez le magister, il y eut un moment d’anéantissement.
Tout à coup je sentis sur ma main tomber des gouttes chaudes. C’était Carrory qui pleurait silencieusement.
Au même instant des soupirs éclatèrent sur le palier supérieur et une voix murmura à plusieurs reprises :
— Marius, Marius !
C’était Pagès qui pensait à son fils…
L’air était lourd à respirer ; j’étais oppressé et j’avais des bourdonnements dans les oreilles.
Soit que le magister sentît moins péniblement que nous cet anéantissement, soit qu’il voulût réagir contre et nous empêcher de nous y abandonner, il rompit le silence :
— Maintenant, dit-il, il faut voir un peu ce que nous avons de provisions.
— Tu crois donc que nous devons rester longtemps emprisonnés ? interrompit l’oncle Gaspard.
— Non, mais il faut prendre ses précautions ; qui est-ce qui a du pain ?
Personne ne répondit.
— Moi, dis-je, j’ai une croûte dans ma poche.
— Quelle poche ?
— La poche de mon pantalon.
— Alors ta croûte est de la bouillie. Montre cependant.
Je fouillai dans ma poche où j’avais mis le matin une belle croûte cassante et dorée ; j’en tirai une espèce de panade que j’allais jeter avec désappointement quand le magister arrêta ma main.
— Garde ta soupe, dit-il, si mauvaise qu’elle soit, tu la trouveras bientôt bonne.
Ce n’était pas là un pronostic très-rassurant ; mais nous n’y fîmes pas attention ; c’est plus tard que ces paroles me sont revenues et m’ont prouvé que dès ce moment le magister avait pleine conscience de notre position, et que s’il ne prévoyait pas, par le menu, les horribles souffrances que nous aurions à supporter, au moins il ne se faisait pas illusion sur les facilités de notre sauvetage.
— Personne n’a plus de pain ? dit-il.
On ne répondit pas.
— Cela est fâcheux, continua-t-il.
— Tu as donc faim ? interrompit Compayrou.
— Je ne parle pas pour moi, mais pour Rémi et Carrory : le pain aurait été pour eux.
— Et pourquoi ne pas le partager entre nous tous, dit Bergounhoux, ce n’est pas juste : nous sommes tous égaux devant la faim.
— Pour lors s’il y avait eu du pain nous nous serions fâchés. Vous aviez promis pourtant de m’obéir ; mais je vois que vous ne m’obéirez qu’après discussion et que si vous jugez que j’ai raison.
— Il aurait obéi !
— C’est-à-dire qu’il y aurait peut-être eu bataille. Eh bien ! il ne faut pas qu’il y ait bataille, et pour cela je vais vous expliquer pourquoi le pain aurait été pour Rémi et pour Carrory. Ce n’est pas moi qui ai fait cette règle, c’est la loi : la loi qui a dit que quand plusieurs personnes mouraient dans un accident, c’était jusqu’à soixante ans la plus âgée qui serait présumée avoir survécu, ce qui revient à dire que Rémi et Carrory, par leur jeunesse, doivent opposer moins de résistance à la mort que Pagès et Compayrou.
— Toi, magister, tu as plus de soixante ans.
— Oh ! moi je ne compte pas, d’ailleurs je suis habitué à ne pas me gaver de nourriture.
— Par ainsi, dit Carrory après un moment de réflexion, le pain aurait donc été pour moi si j’en avais eu ?
— Pour toi et pour Rémi.
— Si je n’avais pas voulu le donner ?
— On te l’aurait pris, n’as-tu pas juré d’obéir ?
Il resta assez longtemps silencieux, puis tout à coup sortant une miche de son bonnet :
— Tenez, en voilà un morceau.
— C’est donc le bonnet inépuisable que le bonnet de Carrory ?
— Passez le bonnet, dit le magister.
Carrory voulut défendre sa coiffure ; on la lui enleva de force et on la passa au magister.
Celui-ci demanda la lampe et regarda ce qui se trouvait dans le retroussis du bonnet. Alors, quoique nous ne fussions assurément pas dans une situation gaie, nous eûmes une seconde de détente.
Il y avait dans ce bonnet : une pipe, du tabac, une clef, un morceau de saucisson, un noyau de pêche percé en sifflet, des osselets en os de mouton, trois noix fraîches, un oignon : c’est-à-dire que c’était un garde-manger et un garde-meuble.
— Le pain et le saucisson seront partagés entre toi et Rémi, ce soir.
— Mais j’ai faim, répliqua Carrory d’une voix dolente ; j’ai faim tout de suite.
— Tu auras encore plus faim ce soir.
— Quel malheur que ce garçon n’ait pas eu de montre dans son garde-meuble ! Nous saurions l’heure ; la mienne est arrêtée.
— La mienne aussi, pour avoir trempé dans l’eau.
Cette idée de montre nous rappela à la réalité. Quelle heure était-il ? Depuis combien de temps étions-nous dans la remontée ? On se consulta, mais sans tomber d’accord. Pour les uns, il était midi ; pour les autres six heures du soir, c’est-à-dire que pour ceux-ci nous étions enfermés depuis plus de dix heures et pour ceux-là depuis moins de cinq. Ce fut là que commença notre différence d’appréciation, différence qui se renouvela souvent et arriva à des écarts considérables.
Nous n’étions pas en disposition de parler pour ne rien dire. Lorsque la discussion sur le temps fut épuisée, chacun se tut et parut se plonger dans ses réflexions.
Quelles étaient celles de mes camarades ? Je n’en sais rien ; mais si j’en juge par les miennes elles ne devaient pas être gaies.
Malgré l’esprit de décision du magister, je n’étais pas du tout rassuré sur notre délivrance. J’avais peur de l’eau, peur de l’ombre, peur de la mort ; le silence m’anéantissait ; les parois incertaines de la remontée m’écrasaient comme si de tout leur poids elles m’eussent pesé sur le corps. Je ne reverrais donc plus Lise, ni Étiennette, ni Alexis, ni Benjamin ? qui les rattacherait les uns aux autres après moi ? Je ne verrais donc plus Arthur, ni madame Milligan, ni Mattia ? Pourrait-on jamais faire comprendre à Lise que j’étais mort pour elle ? Et mère Barberin, pauvre mère Barberin ! Mes pensées s’enchaînaient ainsi toutes plus lugubres les unes que les autres ; et quand je regardais mes camarades pour me distraire et que je les voyais tout aussi accablés, tout aussi anéantis que moi, je revenais à mes réflexions plus triste et plus sombre encore. Eux cependant ils étaient habitués à la vie de la mine, et par là, ils ne souffraient pas du manque d’air, de soleil, de liberté ; la terre ne pesait pas sur eux.
Tout à coup, au milieu du silence, la voix de l’oncle Gaspard s’éleva :
— M’est avis, dit-il, qu’on ne travaille pas à notre sauvetage.
— Pourquoi penses-tu ça ?
— Nous n’entendons rien.
— Toute la ville est détruite, c’était un tremblement de terre.
— Ou bien dans la ville on croit que nous sommes tous perdus et qu’il n’y a rien à faire pour nous.
— Alors nous sommes donc abandonnés ?
— Pourquoi pensez-vous cela de vos camarades ? interrompit le magister, ce n’est pas juste de les accuser. Vous savez bien que quand il y a des accidents les mineurs ne s’abandonnent pas les uns les autres ; et que vingt hommes, cent hommes se feraient plutôt tuer que de laisser un camarade sans secours. Vous savez cela, hein ?
— C’est vrai.
— Si c’est vrai, pourquoi voulez-vous qu’on nous abandonne ?
— Nous n’entendons rien.
— Il est vrai que nous n’entendons rien. Mais ici pouvons-nous entendre ? Qui sait cela ? pas moi. Et puis encore quand nous pourrions entendre, et qu’il serait prouvé qu’on ne travaille pas, cela prouverait-il en même temps qu’on nous abandonne ? Est-ce que nous savons comment la catastrophe est arrivée ? Si c’est un tremblement de terre, il y a du travail dans la ville pour ceux qui ont échappé. Si c’est seulement une inondation, comme j’en ai l’idée, il faut savoir dans quel état sont les puits. Peut-être se sont-ils effondrés ? la galerie de la lampisterie a pu s’écrouler. Il faut le temps d’organiser le sauvetage. Je ne dis pas que nous serons sauvés, mais je suis sûr qu’on travaille à nous sauver.
Il dit cela d’un ton énergique qui devait convaincre les plus incrédules et les plus effrayés.
Cependant Bergounhoux répliqua :
— Et si l’on nous croit tous morts ?
— On travaille tout de même, mais si tu as peur de cela, prouvons-leur que nous sommes vivants ; frappons contre la paroi aussi fort que nous pourrons ; vous savez comme le son se transmet à travers la terre ; si l’on nous entend, on saura qu’il faut se hâter, et notre bruit servira à diriger les recherches.
Sans attendre davantage, Bergounhoux, qui était chaussé de grosses bottes, se mit à frapper avec force comme pour le rappel des mineurs, et ce bruit, l’idée surtout qu’il éveillait en nous, nous tira de notre engourdissement. Allait-on nous entendre ? Allait-on nous répondre ?
— Voyons, magister, dit l’oncle Gaspard, si l’on nous entend, qu’est-ce qu’on va faire pour venir à notre secours ?
— Il n’y a que deux moyens, et je suis sûr que les ingénieurs vont les employer tous deux : percer des descentes pour venir à la rencontre de notre remontée, et épuiser l’eau.
— Oh ! percer des descentes !
— Ah ! épuiser l’eau !
Ces deux interruptions ne déroutèrent pas le magister.
— Nous sommes à quarante mètres de profondeur, n’est-ce pas ? en perçant six ou huit mètres par jour, c’est sept ou huit jours pour arriver jusqu’à nous.
— On ne peut pas percer six mètres par jour.
— En travail ordinaire non, mais pour sauver des camarades on peut bien des choses.
— Jamais nous ne pourrions vivre huit jours : pensez donc, magister, huit jours !
— Eh bien, et l’eau ? Comment l’épuiser ?
— L’eau, je ne sais pas ; il faudrait savoir ce qu’il en est tombé dans la mine, 200,000 mètres cubes, 300,000 mètres, je n’en sais rien. Mais pour venir jusqu’à nous, il n’est pas nécessaire d’épuiser tout ce qui est tombé, nous sommes au premier niveau. Et comme on va organiser les trois puits à la fois avec deux bennes, cela fera six bennes de 25 hectolitres chaque, qui puiseront l’eau ; c’est-à-dire que 150 hectolitres d’un même coup seront versés dehors. Vous voyez que cela peut aller encore assez vite.
Une discussion confuse s’engagea sur les moyens les meilleurs à employer ; mais ce qui pour moi résulta de cette discussion, c’est qu’en supposant une réunion extraordinaire de circonstances favorables, nous devions rester au moins huit jours dans notre sépulcre.
Huit jours ! le magister nous avait parlé d’ouvriers qui étaient restés engloutis vingt-quatre jours. Mais c’était un récit, et nous c’était la réalité. Lorsque cette idée se fut emparée de mon esprit, je n’entendis plus un seul mot de la conversation. Huit jours !
Je ne sais depuis combien de temps j’étais accablé sous cette idée, lorsque la discussion s’arrêta.
— Écoutez donc, dit Carrory, qui précisément par cela qu’il était assez près de la brute avait les facultés de l’animal plus développées que nous tous.
— Quoi donc ?
— On entend quelque chose dans l’eau.
— Tu auras fait rouler une pierre.
— Non, c’est un bruit sourd.
Nous écoutâmes.
J’avais l’oreille fine, mais pour les bruits de la vie et de la terre ; je n’entendis rien. Mes camarades qui, eux, avaient l’habitude des bruits de la mine furent plus heureux que moi.
— Oui, dit le magister, il se passe quelque chose dans l’eau.
— Quoi, magister ?
— Je ne sais pas.
— L’eau qui tombe.
— Non, le bruit n’est pas continuel, il est par secousses et régulier.
— Par secousses et régulier, nous sommes sauvés, enfants ! c’est le bruit des bennes d’épuisement dans les puits.
— Les bennes d’épuisement…
Tous en même temps, d’une même voix, nous répétâmes ces deux mots, et comme si nous avions été touchés par une commotion électrique, nous nous levâmes.
Nous n’étions plus à quarante mètres sous terre, l’air n’était plus comprimé, les parois de la remontée ne nous pressaient plus, nos bourdonnements d’oreilles avaient cessé, nous respirions librement, nos cœurs battaient dans nos poitrines.
Carrory me prit la main, et me la serrant fortement :
— Tu es un bon garçon, dit-il.
— Mais, non, c’est toi.
— Je te dis que c’est toi.
— Tu as le premier entendu les bennes.
Mais il voulut à toute force que je fusse un bon garçon ; il y avait en lui quelque chose comme l’ivresse du buveur. Et de fait n’étions-nous pas ivres d’espérance.
Hélas ! cette espérance ne devait pas se réaliser de sitôt, ni pour nous tous.
Avant de revoir la chaude lumière du soleil, avant d’entendre le bruit du vent dans les feuilles, nous devions rester là pendant de longues et cruelles journées, souffrant toutes les souffrances, nous demandant avec angoisse si jamais nous verrions cette lumière et si jamais il nous serait donné d’entendre cette douce musique.
Mais pour vous raconter cette effroyable catastrophe des mines de la Truyère, telle qu’elle a eu lieu, je dois vous dire maintenant comment elle s’était produite, et quels moyens les ingénieurs employaient pour nous sauver.
Lorsque nous étions descendus dans la mine, le lundi matin, le ciel était couvert de nuages sombres et tout annonçait un orage. Vers sept heures cet orage avait éclaté accompagné d’un véritable déluge : les nuages qui traînaient bas s’étaient engagés dans la vallée tortueuse de la Divonne et, pris dans ce cirque de collines, ils n’avaient pas pu s’élever au-dessus ; tout ce qu’ils renfermaient de pluie, ils l’avaient versé sur la vallée ; ce n’était pas une averse, c’était une cataracte, un déluge. En quelques minutes les eaux de la Divonne et des affluents avaient gonflé, ce qui se comprend facilement, car sur un sol de pierre, l’eau n’est pas absorbée, mais suivant la pente du terrain, elle roule jusqu’à la rivière. Subitement les eaux de la Divonne coulèrent à pleins bords dans son lit escarpé, et celles des torrents de Saint-Andéol et de la Truyère débordèrent. Refoulées par la crue de la Divonne, les eaux du ravin de la Truyère ne trouvèrent pas à s’écouler, et alors elles s’épanchèrent sur le terrain qui recouvre les mines. Ce débordement s’était fait d’une façon presque instantanée, mais les ouvriers du dehors occupés au lavage du minerai, forcés par l’orage de se mettre à l’abri, n’avaient couru aucun danger. Ce n’était pas la première fois qu’une inondation arrivait à la Truyère, et comme les ouvertures des trois puits étaient à des hauteurs où les eaux ne pouvaient pas monter, on n’avait d’autre inquiétude que de préserver les amas de bois qui se trouvaient préparés pour servir au boisage des galeries.
C’était à ce soin que s’occupait l’ingénieur de la mine, lorsque tout à coup il vit les eaux tourbillonner et se précipiter dans un gouffre qu’elles venaient de se creuser. Ce gouffre se trouvait sur l’affleurement d’une couche de charbon.
Il n’a pas besoin de longues réflexions pour comprendre ce qui vient de se passer : les eaux se sont précipitées dans la mine et le plan de la couche leur sert de lit ; elles baissent au dehors : la mine va être inondée, elle va se remplir ; les ouvriers vont être noyés.
Il court au puits Saint-Julien et donne des ordres pour qu’on le descende. Mais prêt à mettre le pied dans la benne, il s’arrête. On entend dans l’intérieur de la mine un tapage épouvantable : c’est le torrent des eaux.
— Ne descendez pas, disent les hommes qui l’entourent en voulant le retenir.
Mais il se dégage de leur étreinte, et prenant sa montre dans son gilet :
— Tiens, dit-il en la remettant à l’un de ces hommes, tu donneras ma montre à ma fille, si je ne reviens pas.
Puis, s’adressant à ceux qui dirigent la manœuvre des bennes :
— Descendez, dit-il.
La benne descend ; alors, levant la tête vers celui auquel il a remis sa montre :
— Tu lui diras que son père l’embrasse.
La benne est descendue. L’ingénieur appelle. Cinq mineurs arrivent. Il les fait monter dans la benne. Pendant qu’ils sont enlevés, il pousse de nouveaux cris, mais inutilement : ses cris sont couverts par le bruit des eaux et des effondrements.
Cependant les eaux arrivent dans la galerie et à ce moment l’ingénieur aperçoit des lampes. Il court vers elles ayant de l’eau jusqu’aux genoux et ramène trois hommes encore. La benne est redescendue, il les fait placer dedans et veut retourner au-devant des lumières qu’il aperçoit. Mais les hommes qu’il a sauvés l’enlèvent de force et le tirent avec eux dans la benne en faisant le signal de remonter. Il est temps, les eaux ont tout envahi.
Ce moyen de sauvetage est impossible. Il faut recourir à un autre. Mais lequel ? Autour de lui il n’a presque personne. Cent cinquante ouvriers sont descendus, puisque cent cinquante lampes ont été distribuées le matin ; trente lampes seulement ont été rapportées à la lampisterie, c’est cent vingt hommes qui sont restés dans la mine. Sont-ils morts, sont-ils vivants, ont-ils pu trouver un refuge ? Ces questions se posent avec une horrible angoisse dans son esprit épouvanté.
Au moment où l’ingénieur constate que cent vingt hommes sont enfermés dans la mine, des explosions ont lieu au dehors à différents endroits ; des terres, des pierres sont lancées à une grande hauteur ; les maisons tremblent comme si elles étaient secouées par un tremblement de terre. Ce phénomène s’explique pour l’ingénieur : les gaz et l’air refoulés par les eaux se sont comprimés dans les remontées sans issues, et là où la charge de terre est trop faible, au-dessus des affleurements, ils font éclater l’écorce de la terre comme les parois d’une chaudière. La mine est pleine : la catastrophe est consommée.
Cependant la nouvelle s’est répandue dans Varses ; de tous côtés la foule arrive à la Truyère, des travailleurs, des curieux, les femmes, les enfants des ouvriers engloutis. Ceux-ci interrogent, cherchent, demandent. Et comme on ne peut rien leur répondre, la colère se mêle à la douleur. On cache la vérité. C’est la faute de l’ingénieur. À mort l’ingénieur, à mort ! Et l’on se prépare à envahir les bureaux où l’ingénieur penché sur le plan, sourd aux clameurs, cherche dans quels endroits les ouvriers ont pu se réfugier et par où il faut commencer le sauvetage.
Heureusement les ingénieurs des mines voisines sont accourus à la tête de leurs ouvriers, et avec eux les ouvriers de la ville. On peut contenir la foule, on lui parle. Mais que peut-on lui dire ? Cent vingt hommes manquent. Où sont-ils ?
— Mon père ?
— Où est mon mari ?
— Rendez-moi mon fils ?
Les voix sont brisées, les questions sont étranglées par les sanglots. Que répondre à ces enfants, à ces femmes, à ces mères ?
Un seul mot ; celui des ingénieurs réunis en conseil : « Nous allons chercher, nous allons faire l’impossible. »
Et le travail de sauvetage commence. Trouvera-t-on un seul survivant parmi ces cent vingt hommes ? Le doute est puissant, l’espérance est faible. Mais peu importe. En avant !
Les travaux de sauvetage sont organisés comme le magister l’avait prévu. Des bennes d’épuisement sont installées dans les trois puits, et elles ne s’arrêteront plus ni jour ni nuit, jusqu’au moment où la dernière goutte d’eau sera versée dans la Divonne.
En même temps on commence à creuser des galeries. Où va-t-on ? on ne sait trop, un peu au hasard ; mais on va. Il y a eu divergence dans le conseil des ingénieurs sur l’utilité de ces galeries qu’on doit diriger à l’aventure, dans l’incertitude où l’on est sur la position des ouvriers encore vivants ; mais l’ingénieur de la mine espère que des hommes auront pu se réfugier dans les vieux travaux, où l’inondation n’aura pas pu les atteindre, et il veut qu’un percement direct, à partir du jour, soit conduit vers ces vieux travaux, ne dût-on sauver personne.
Ce percement est mené sur une largeur aussi étroite que possible, afin de perdre moins de temps, et un seul piqueur est à l’avancement ; le charbon qu’il abat est enlevé au fur et à mesure, dans des corbeilles qu’on se passe en faisant la chaîne ; aussitôt que le piqueur est fatigué il est remplacé par un autre.
Ainsi sans repos et sans relâche, le jour comme la nuit, se poursuivent simultanément ces doubles travaux : l’épuisement et le percement.
Si le temps est long pour ceux qui du dehors travaillent à notre délivrance, combien plus long encore l’est-il pour nous, impuissants et prisonniers, qui n’avons qu’à attendre sans savoir si l’on arrivera à nous assez tôt pour nous sauver !
Le bruit des bennes d’épuisement ne nous maintint pas longtemps dans la fièvre de joie qu’il nous avait tout d’abord donnée. La réaction se fit avec la réflexion. Nous n’étions pas abandonnés, on s’occupait de notre sauvetage, c’était là l’espérance ; l’épuisement se ferait-il assez vite ? c’était là l’angoisse.
Aux tourments de l’esprit se joignaient d’ailleurs maintenant les tourments du corps. La position dans laquelle nous étions obligés de nous tenir sur notre palier était des plus fatigantes ; nous ne pouvions plus faire de mouvements pour nous dégourdir, et nos douleurs de tête étaient devenues vives et gênantes.
De nous tous Carrory était le moins affecté.
— J’ai faim, disait-il de temps en temps, magister, je voudrais bien le pain.
À la fin le magister se décida à nous passer un morceau de la miche sortie du bonnet de loutre.
— Ce n’est pas assez, dit Carrory.
— Il faut que la miche dure longtemps.
Les autres auraient partagé notre repas avec plaisir, mais ils avaient juré d’obéir, et ils tenaient leur serment.
— S’il nous est défendu de manger, il nous est permis de boire, dit Compayrou.
— Pour ça, tout ce que tu voudras, nous avons l’eau à discrétion.
— Épuise la galerie.
Pagès voulut descendre, mais le magister ne le permit pas.
— Tu ferais ébouler un déblai ; Rémi est plus léger et plus adroit, il descendra et nous passera l’eau.
— Dans quoi ?
— Dans ma botte.
On me donna une botte et je me préparai à me laisser glisser jusqu’à l’eau.
— Attends un peu, dit le magister, que je te donne la main.
— N’ayez pas peur, quand je tomberais, cela ne ferait rien, je sais nager.
— Je veux te donner la main.
Au moment où le magister se penchait, il partit en avant, et soit qu’il eût mal calculé son mouvement, soit que son corps fût engourdi par l’inaction, soit enfin que le charbon eût manqué sous son poids, il glissa sur la pente de la remontée et s’engouffra dans l’eau sombre la tête la première. La lampe qu’il tenait pour m’éclairer roula après lui et disparut aussi. Instantanément nous fûmes plongés dans la nuit noire, et un cri s’échappa de toutes nos poitrines en même temps.
Par bonheur j’étais déjà en position de descendre, je me laissai aller sur le dos et j’arrivai dans l’eau une seconde à peine après le magister.
Dans mes voyages avec Vitalis j’avais appris assez à nager et à plonger pour me trouver aussi bien à mon aise dans l’eau que sur la terre ferme ; mais comment se diriger dans ce trou sombre ?
Je n’avais pas pensé à cela quand je m’étais laissé glisser, je n’avais pensé qu’au magister qui allait se noyer, et avec l’instinct du terre-neuve je m’étais jeté à l’eau.
Où chercher ? De quel côté étendre le bras ? Comment plonger ?
C’était ce que je me demandais quand je me sentis saisir à l’épaule par une main crispée et je fus entraîné sous l’eau. Un bon coup de pied me fit remonter à la surface : la main ne m’avait pas lâché.
— Tenez-moi bien, magister, et appuyez en levant la tête, vous êtes sauvé.
Sauvés ! nous ne l’étions ni l’un ni l’autre, car je ne savais de quel côté nager : une idée me vint.
— Parlez donc, vous autres, m’écriai-je.
— Où es-tu, Rémi ?
C’était la voix de l’oncle Gaspard ; elle m’indiqua ma direction. Il fallait se diriger sur la gauche.
— Allumez une lampe.
Presque aussitôt une flamme parut ; je n’avais que le bras à allonger pour toucher le bord, je me cramponnai d’une main à un morceau de charbon, et j’attirai le magister.
Pour lui il était grand temps, car il avait bu et la suffocation commençait déjà : je lui maintins la tête hors de l’eau et il revint bien vite à lui.
L’oncle Gaspard et Carrory, penchés en avant, tendaient vers nous leurs bras, tandis que Pagès, descendu de son palier sur le nôtre, nous éclairait. Le magister pris d’une main par l’oncle Gaspard, de l’autre par Carrory fut hissé jusqu’au palier, pendant que je le poussais par derrière. Puis quand il fut arrivé, je remontai à mon tour.
Déjà il avait retrouvé sa pleine connaissance.
— Viens ici, me dit-il, que je t’embrasse, tu m’as sauvé la vie.
— Vous avez déjà sauvé la nôtre.
— Avec tout ça, dit Carrory, qui n’était point de nature à se laisser prendre par les émotions pas plus qu’à oublier ses petites affaires, — ma botte est perdue, et je n’ai pas bu.
— Je vais te la chercher, ta botte.
Mais on m’arrêta.
— Je te le défends, dit le magister.
— Eh bien ! qu’on m’en donne une autre, que je rapporte à boire, au moins.
— Je n’ai plus soif, dit Compayrou.
— Pour boire à la santé du magister.
Et je me laissai glisser une seconde fois, mais moins vite que la première et avec plus de précaution.
Échappés à la noyade, nous eûmes le désagrément, le magister et moi, d’être mouillés des pieds à la tête. Tout d’abord nous n’avions pas pensé à cet ennui, mais le froid de nos vêtements trempés nous le rappela bientôt.
— Il faut passer une veste à Rémi, dit le magister.
Mais personne ne répondit à cet appel, qui, s’adressant à tous, n’obligeait ni celui-ci, ni celui-là.
— Personne ne parle ?
— Moi, j’ai froid, dit Carrory.
— Eh bien, et nous qui sommes mouillés, nous avons chaud !
— Il ne fallait pas tomber à l’eau, vous autres.
— Puisqu’il en est ainsi, dit le magister, on va tirer au sort qui donnera une partie de ses vêtements. Je voulais bien m’en passer. Mais maintenant je demande l’égalité.
Comme nous avions déjà été tous mouillés, moi jusqu’au cou et les plus grands jusqu’aux hanches, changer de vêtements n’était pas une grande faveur ; cependant le magister tint à ce que ce changement s’exécutât, et favorisé par le sort, j’eus la veste de Compayrou ; or, Compayrou ayant des jambes aussi longues que tout mon corps, sa veste était sèche. Enveloppé dedans, je ne tardai pas à me réchauffer.
Après cet incident désagréable qui nous avait un moment secoués, l’anéantissement nous reprit bientôt, et avec lui les idées de mort.
Sans doute ces idées pesaient plus lourdement sur mes camarades que sur moi, car tandis qu’ils restaient éveillés, dans un anéantissement stupide, je finis par m’endormir.
Mais la place n’était pas favorable et j’étais exposé à rouler dans l’eau. Alors le magister voyant le danger que je courais, me prit la tête sous son bras. Il ne me tenait pas serré bien fort, mais assez pour m’empêcher de tomber, et j’étais là comme un enfant sur les genoux de sa mère. C’était non-seulement un homme à la tête solide, mais encore un bon cœur. Quand je m’éveillais à moitié, il changeait seulement de position son bras engourdi, puis aussitôt il reprenait son immobilité, et à mi-voix il me disait :
— Dors, garçon, n’aie pas peur, je te tiens ; dors, petit.
Et je me rendormais sans avoir peur, car je sentais bien qu’il ne me lâcherait pas.
Le temps s’écoulait et toujours régulièrement nous entendions les bennes plonger dans l’eau.
VI
SAUVETAGE
Notre position était devenue insupportable sur notre palier trop étroit ; il fut décidé qu’on élargirait ce palier, et chacun se mit à la besogne. À coups de couteau on recommença à fouiller dans le charbon et à faire descendre les déblais.
Comme nous avions maintenant un point d’appui solide sous les pieds, ce travail fut plus facile, et l’on arriva à entamer assez la veine pour agrandir notre prison.
Ce fut un grand soulagement quand nous pûmes nous étendre de tout notre long sans rester assis, les jambes ballantes.
Bien que la miche de Carrory nous eût été étroitement mesurée, nous en avions vu le bout. Au reste, le dernier morceau nous avait été distribué à temps pour venir jusqu’à nous. Car, lorsque le magister nous l’avait donné, il avait été facile de comprendre, aux regards des piqueurs, qu’ils ne souffriraient pas une nouvelle distribution sans demander, et, si on ne la leur donnait pas, sans prendre leur part.
On en vint à ne plus parler pour ainsi dire, et autant nous avions été loquaces au commencement de notre captivité, autant nous fûmes silencieux quand elle se prolongea.
Les deux seuls sujets de nos conversations roulaient éternellement sur les deux mêmes questions : quels moyens on employait pour venir à nous, et depuis combien de temps nous étions emprisonnés.
Mais ces conversations n’avaient plus l’ardeur des premiers moments ; si l’un de nous disait un mot, souvent ce mot n’était pas relevé, ou alors qu’il l’était, c’était simplement en quelques paroles brèves ; on pouvait varier du jour à la nuit, du blanc au noir, sans pour cela susciter la colère ou la simple contradiction.
— C’est bon, on verra.
Étions-nous ensevelis depuis deux jours ou depuis six ? On verrait quand le moment de la délivrance serait venu. Mais ce moment viendrait-il ? Pour moi, je commençais à en douter fortement.
Au reste je n’étais pas le seul, et parfois, il échappait des observations à mes camarades, qui prouvaient que le doute les envahissait aussi.
— Ce qui me console, si je reste ici, dit Bergounhoux, c’est que la compagnie fera une rente à ma femme et à mes enfants ; au moins ils ne seront pas à la charité.
Assurément, le magister s’était dit qu’il entrait dans ses fonctions de chef non-seulement de nous défendre contre les accidents de la catastrophe, mais encore de nous protéger contre nous-mêmes. Aussi, quand l’un de nous paraissait s’abandonner, intervenait-il aussitôt par une parole réconfortante.
— Tu ne resteras pas plus que nous ici : les bennes fonctionnent, l’eau baisse.
— Où baisse-t-elle ?
— Dans les puits.
— Et dans la galerie ?
— Ça viendra ; il faut attendre.
— Dites donc, Bergounhoux, interrompit Carrory avec l’à-propos et la promptitude qui caractérisaient toutes ses observations, si la compagnie fait faillite comme celle du magister, c’est votre femme qui sera volée !
— Veux-tu te taire, imbécile, la compagnie est riche.
— Elle était riche quand elle avait la mine, mais maintenant que la mine est sous l’eau. Tout de même si j’étais dehors, au lieu d’être ici, je serais content.
— Parce que ?
— Pourquoi donc qu’ils étaient fiers, les directeurs et les ingénieurs ? ça leur apprendra. Si l’ingénieur était descendu, ça serait drôle, pas vrai ? monsieur l’ingénieur, faut-il porter votre boussole ?
— Si l’ingénieur était descendu, tu resterais ici, grande bête, et nous aussi.
— Ah ! vous autres, vous savez, il ne faut pas vous gêner, mais moi, j’ai autre chose à faire ; mes châtaignons, qui est-ce qui les sécherait ? Je demande que l’ingénieur remonte alors ; c’était pour rire. Salut, monsieur l’ingénieur !
À l’exception du magister qui cachait ses sentiments et de Carrory qui ne sentait pas grand’chose, nous ne parlions plus de délivrance, et c’étaient toujours les mots de mort et d’abandon qui du cœur nous montaient aux lèvres.
— Tu as beau dire, magister, les bennes ne tireront jamais assez d’eau.
— Je vous ai pourtant déjà fait le calcul plus de vingt fois ; un peu de patience.
— Ce n’est pas le calcul qui nous tirera d’ici.
Cette réflexion était de Pagès.
— Qui alors ?
— Le bon Dieu.
— Possible ; puisque c’est lui qui nous y a mis, répliqua le magister, il peut bien nous en tirer.
— Lui et la sainte Vierge ; c’est sur eux que je compte et pas sur les ingénieurs. Tout à l’heure en priant la sainte Vierge, j’ai senti comme un souffle à l’oreille et une voix qui me disait : « Si tu veux vivre en bon chrétien à l’avenir, tu seras sauvé. » Et j’ai promis.
— Est-il bête avec sa sainte Vierge, s’écria Bergounhoux en se soulevant.
Pagès était catholique, Bergounhoux était calviniste ; si la sainte Vierge a toute puissance pour des catholiques elle n’est rien pour les calvinistes, qui ne la reconnaissent point, pas plus qu’ils ne reconnaissent les autres intermédiaires qui se placent entre Dieu et l’homme, le pape, les saints et les anges.
Dans tout autre pays l’observation de Pagès n’eût pas soulevé de discussion, mais en pleines Cévennes, dans une ville où les querelles religieuses ont toutes les violences qu’elles avaient au dix-septième siècle, alors que la moitié des habitants se battait contre l’autre moitié, — cette observation, pas plus que la réponse de Bergounhoux, ne pouvaient passer sans querelles.
Tous deux en même temps s’étaient levés, et sur leur étroit palier, ils se défiaient, prêts à en venir aux mains.
Mettant son pied sur l’épaule de l’oncle Gaspard, le magister escalada la remontée et se jeta entre eux.
— Si vous voulez vous battre, dit-il, attendez que vous soyez sortis.
— Et si nous ne sortons pas ? répliqua Bergounhoux.
— Alors il sera prouvé que tu avais raison et que Pagès avait tort, puisque à sa prière il a été répondu qu’il sortirait.
Cette réponse avait le mérite de satisfaire les deux adversaires.
— Je sortirai, dit Pagès.
— Tu ne sortiras pas, répondit Bergounhoux.
— Ce n’est pas la peine de vous quereller, puisque bientôt vous saurez à quoi vous en tenir.
— Je sortirai.
— Tu ne sortiras pas.
La dispute heureusement apaisée par l’adresse du magister se calma, mais nos idées avaient pris une teinte sombre que rien ne pouvait éclaircir.
— Je crois que je sortirai, dit Pagès, après un moment de silence, mais si nous sommes ici c’est bien sûr parce qu’il y a parmi nous des méchants que Dieu veut punir.
Disant cela il lança un regard significatif à Bergounhoux, mais celui-ci au lieu de se fâcher confirma les paroles de son adversaire.
— Cela c’est certain, dit-il, Dieu veut donner à l’un de nous l’occasion d’expier et de racheter une faute. Est-ce Pagès, est-ce moi ? je ne sais pas. Pour moi tout ce que je peux dire, c’est que je paraîtrais devant Dieu la conscience plus tranquille si je m’étais conduit en meilleur chrétien en ces derniers temps ; je lui demande pardon de mes fautes de tout mon cœur.
Et se mettant à genoux il se frappa la poitrine.
— Pour moi, s’écria Pagès, je ne dis pas que je n’ai pas des péchés sur la conscience et je m’en confesse à vous tous ; mais mon bon ange et saint Jean, mon patron, savent bien que je n’ai jamais péché volontairement, je n’ai jamais fait de tort à personne.
Je ne sais si c’était l’influence de cette prison sombre, la peur de la mort, la faiblesse du jeûne, la clarté mystérieuse de la lampe qui éclairait à peine cette scène étrange, mais j’éprouvais une émotion profonde en écoutant cette confession publique, et comme Pagès et Bergounhoux j’étais prêt à me mettre à genoux pour me confesser avec eux.
Tout à coup derrière moi un sanglot éclata et m’étant retourné, je vis l’immense Compayrou qui se jetait à deux genoux sur la terre. Depuis quelques heures il avait abandonné le palier supérieur pour prendre sur le nôtre, la place de Carrory, et il était mon voisin.
— Le coupable, s’écria-t-il, n’est ni Pagès ni Bergounhoux ; c’est moi. C’est moi que le bon Dieu punit, mais je me repens, je me repens. Voilà la vérité, écoutez-la : si je sors, je jure de réparer le mal, si je ne sors pas, vous le réparerez, vous autres. Il y a un an, Rouquette a été condamné à cinq ans de prison pour avoir volé une montre dans la chambre de la mère Vidal. Il est innocent. C’est moi qui ai fait le coup. La montre est cachée sous mon lit, en levant le troisième carreau à gauche on la trouvera.
— À l’eau ! à l’eau ! s’écrièrent en même temps Pagès et Bergounhoux.
Assurément s’ils avaient été sur notre palier ils auraient poussé Compayrou dans le gouffre ; mais avant qu’il leur fût possible de descendre le magister eut le temps d’intervenir encore.
— Voulez-vous donc qu’il paraisse devant Dieu avec ce crime sur la conscience ? s’écria-t-il, laissez-le se repentir.
— Je me repens, je me repens, répéta Compayrou, plus faible qu’un enfant malgré sa force d’hercule.
— À l’eau ! répétèrent Bergounhoux et Pagès.
— Non ! s’écria le magister.
Et alors il se mit à leur parler, en leur disant des paroles de justice et de modération. Mais eux, sans vouloir rien entendre, menaçaient toujours de descendre.
— Donne-moi ta main, dit le magister en s’approchant de Compayrou.
— Ne le défends pas, magister.
— Je le défendrai ; et si vous voulez le jeter à l’eau, vous m’y jetterez avec lui.
— Eh bien, non ! dirent-ils enfin, nous ne le pousserons pas à l’eau ; mais c’est à une condition : tu vas le laisser dans le coin ; personne ne lui parlera, personne ne fera attention à lui.
— Ça, c’est juste, dit le magister, il n’a que ce qu’il mérite.
Après ces paroles du magister qui étaient pour ainsi dire un jugement condamnant Compayrou, nous nous tassâmes tous les trois les uns contre les autres, l’oncle Gaspard, le magister et moi, laissant un vide entre nous et le malheureux affaissé sur le charbon.
Pendant plusieurs heures, je pense, il resta là accablé, sans faire un mouvement, répétant seulement de temps en temps :
— Je me repens.
Et alors Pagès ou Bergounhoux lui criaient :
— Il est trop tard : tu te repens parce que tu as peur, lâche. C’était il y a six mois, il y a un an que tu devais te repentir.
Il haletait péniblement, et sans leur répondre d’une façon directe, il répétait :
— Je me repens, je me repens.
La fièvre l’avait pris, car tout son corps tressautait et l’on entendait ses dents claquer.
— J’ai soif, dit-il, donnez-moi la botte.
Il n’y avait plus d’eau dans la botte ; je me levai pour en aller chercher ; mais Pagès qui m’avait vu, me cria d’arrêter, et au même instant l’oncle Gaspard me retint par le bras.
— On a juré de ne pas s’occuper de lui.
Pendant quelques instants, il répéta encore qu’il avait soif ; puis, voyant que nous ne voulions pas lui donner à boire, il se leva pour descendre lui-même.
— Il va entraîner les déblais, cria Pagès.
— Laissez-lui au moins sa liberté, dit le magister.
Il m’avait vu descendre en me laissant glisser sur le dos ; il voulut en faire autant ; mais j’étais léger, tandis qu’il était lourd ; souple, tandis qu’il était une masse inerte. À peine se fut-il mis sur le dos que le charbon s’effondra sous lui, et sans qu’il pût se retenir de ses jambes écartées et de ses bras qui battaient le vide, il glissa dans le trou noir. L’eau jaillit jusqu’à nous, puis elle se referma et ne se rouvrit plus.
Je me penchai en avant, mais l’oncle Gaspard et le magister me retinrent chacun par un bras.
— Nous sommes sauvés, s’écrièrent Bergounhoux et Pagès, nous sortirons d’ici.
Tremblant d’épouvante, je me rejetai en arrière ; j’étais glacé d’horreur, à moitié mort.
— Ce n’était pas un honnête homme, dit l’oncle Gaspard.
Le magister ne parlait pas, mais bientôt il murmura entre ses dents :
— Après tout il nous diminuait notre portion d’oxygène.
Ce mot que j’entendais pour la première fois me frappa, et après un moment de réflexion, je demandai au magister ce qu’il avait voulu dire :
— Une chose injuste et égoïste, garçon, et que je regrette.
— Mais quoi ?
— Nous vivons de pain et d’air ; le pain, nous n’en avons pas ; l’air, nous n’en sommes guère plus riches, car celui que nous consommons ne se renouvelle pas ; j’ai dit en le voyant disparaître qu’il ne nous mangerait plus une partie de notre air respirable ; et cette parole, je me la reprocherai toute ma vie.
— Allons donc, dit l’oncle Gaspard, il n’avait pas volé son sort.
— Maintenant, tout va bien marcher, dit Pagès en frappant avec ses deux pieds contre la paroi de la remontée.
Si tout ne marcha pas bien et vite comme l’espérait Pagès, ce ne fut pas la faute des ingénieurs et des ouvriers qui travaillaient à notre sauvetage.
La descente qu’on avait commencé à creuser avait été continuée sans une minute de repos. Mais le travail était difficile.
Le charbon à travers lequel on se frayait un passage était ce que les mineurs appellent nerveux, c’est-à-dire très-dur, et comme un seul piqueur pouvait travailler à cause de l’étroitesse de la galerie, on était obligé de relayer souvent ceux qui prenaient ce poste, tant ils mettaient d’ardeur à la besogne les uns et les autres.
En même temps l’aérage de cette galerie se faisait mal : on avait, à mesure qu’on avançait, placé des tuyaux en fer-blanc dont les joints étaient lutés avec de la terre glaise, mais bien qu’un puissant ventilateur à bras envoyât de l’air dans ces tuyaux, les lampes ne brûlaient que devant l’orifice du tuyau.
Tout cela retardait le percement, et le septième jour depuis notre engloutissement on n’était encore arrivé qu’à une profondeur de vingt mètres. Dans les conditions ordinaires, cette percée eût demandé plus d’un mois, mais avec les moyens dont on disposait et l’ardeur déployée, c’était peu.
Il fallait d’ailleurs tout le noble entêtement de l’ingénieur pour continuer ce travail, car de l’avis unanime il était malheureusement inutile. Tous les mineurs engloutis avaient péri. Il n’y avait désormais qu’à continuer l’épuisement au moyen des bennes, et un jour ou l’autre on retrouverait tous les cadavres. Alors de quelle importance était-il d’arriver quelques heures plus tôt ou quelques heures plus tard ?
C’était là l’opinion des gens compétents aussi bien que du public ; les parents eux-mêmes, les femmes, les mères avaient pris le deuil. Personne ne sortirait plus vivant de la Truyère.
Sans ralentir les travaux d’épuisement qui marchaient sans autres interruptions que celles qui résultaient des avaries dans les appareils, l’ingénieur, en dépit des critiques universelles et des observations de ses confrères ou de ses amis, faisait continuer la descente.
Il y avait en lui l’obstination qui fit trouver un nouveau monde à Colomb.
— Encore un jour, mes amis, disait-il aux ouvriers, et, si demain nous n’avons rien de nouveau, nous renoncerons ; je vous demande pour vos camarades ce que je demanderais pour vous, si vous étiez à leur place.
La foi qui l’animait passait dans le cœur de ses ouvriers, qui arrivaient ébranlés par les bruits de la ville et qui partaient partageant ses convictions.
Et avec un ensemble, une activité admirables la descente se creusait.
D’un autre côté, il fallait boiser le passage de la lampisterie qui s’était éboulé dans plusieurs endroits, et ainsi, par tous les moyens possibles, il s’efforçait d’arracher à la mine son terrible secret et ses victimes, si elle en renfermait encore de vivantes.
Le septième jour, dans un changement de poste, le piqueur qui arrivait pour entamer le charbon crut entendre un léger bruit, comme des coups frappés faiblement ; au lieu d’abaisser son pic il le tint levé et colla son oreille au charbon. Puis croyant se tromper, il appela un de ses camarades pour écouter avec lui. Tous deux restèrent silencieux et après un moment, un son faible, répété à intervalles réguliers, parvint jusqu’à eux.
Aussitôt la nouvelle courut de bouche en bouche, rencontrant plus d’incrédulité que de foi, et parvint à l’ingénieur, qui se précipita dans la galerie.
Enfin, il avait donc eu raison ! il y avait là des hommes vivants que sa foi allait sauver.
Plusieurs personnes l’avaient suivi, il écarta les mineurs et il écouta, mais il était si ému, si tremblant qu’il n’entendit rien.
— Je n’entends pas, dit-il, désespérément.
— C’est l’esprit de la mine, dit un ouvrier, il veut nous jouer un mauvais tour et il frappe pour nous tromper.
Mais les deux piqueurs qui avaient entendu les premiers soutinrent qu’ils ne s’étaient pas trompés et que des coups avaient répondu à leurs coups. C’étaient des hommes d’expérience vieillis dans le travail des mines et dont la parole avait de l’autorité.
L’ingénieur fit sortir ceux qui l’avaient suivi et même tous les ouvriers qui faisaient la chaîne pour porter les déblais, ne gardant auprès de lui que les deux piqueurs.
Alors ils frappèrent un appel à coups de pic fortement assénés et également espacés, puis retenant leur respiration ils se collèrent contre le charbon.
Après un moment d’attente, ils reçurent dans le cœur une commotion profonde : des coups faibles, précipités, rythmés avaient répondu aux leurs.
— Frappez encore à coups espacés pour être bien certains que ce n’est point la répercussion de vos coups.
Les piqueurs frappèrent, et aussitôt les mêmes coups rythmés qu’ils avaient entendus, c’est-à-dire le rappel des mineurs, répondirent aux leurs.
Le doute n’était plus possible : des hommes étaient vivants, et l’on pouvait les sauver.
La nouvelle traversa la ville comme une traînée de poudre et la foule accourut à la Truyère, plus grande encore peut-être, plus émue que le jour de la catastrophe. Les femmes, les enfants, les mères, les parents des victimes arrivèrent tremblants, rayonnants d’espérance dans leurs habits de deuil.
Combien étaient vivants ? Beaucoup peut-être. Le vôtre sans doute, le mien assurément.
On voulait embrasser l’ingénieur.
Mais lui impassible contre la joie comme il l’avait été contre le doute et la raillerie, ne pensait qu’au sauvetage ; et pour écarter les curieux aussi bien que les parents, il demandait des soldats à la garnison pour défendre les abords de la galerie et garder la liberté du travail.
Les sons perçus étaient si faibles qu’il était impossible de déterminer la place précise d’où ils venaient. Mais l’indication cependant était suffisante pour dire que des ouvriers échappés à l’inondation se trouvaient dans une des trois remontées de la galerie plate des vieux travaux. Ce n’est plus une descente qui ira au devant des prisonniers, mais trois, de manière à arriver aux trois remontées. Lorsqu’on sera plus avancé et qu’on entendra mieux, on abandonnera les descentes inutiles pour concentrer tous les efforts sur la bonne.
Le travail reprend avec plus d’ardeur que jamais, et c’est à qui des compagnies voisines enverra à la Truyère ses meilleurs piqueurs.
À l’espérance résultant du creusement des descentes se joint celle d’arriver par la galerie, car l’eau baisse dans le puits.
Lorsque dans notre remontée nous entendîmes l’appel frappé par l’ingénieur, l’effet fut le même que lorsque nous avions entendu les bennes d’épuisement tomber dans les puits.
— Sauvés !
Ce fut un cri de joie qui s’échappa de nos bouches, et sans réfléchir nous crûmes qu’on allait nous donner la main.
Puis, comme pour les bennes d’épuisement, après l’espérance revint le désespoir.
Le bruit des pics annonçait que les travailleurs étaient bien loin encore. Vingt mètres, trente mètres peut-être. Combien faudrait-il pour percer ce massif ? Nos évaluations variaient : un mois, une semaine, six jours. Comment attendre un mois, une semaine, six jours ? Lequel d’entre nous vivrait encore dans six jours ? Combien de jours déjà avions-nous vécu sans manger ?
Seul, le magister parlait encore avec courage, mais à la longue notre abattement le gagnait, et à la longue aussi la faiblesse abattait sa fermeté.
Si nous pouvions boire à satiété, nous ne pouvions pas manger, et la faim était devenue si tyrannique, que nous avions essayé de manger du bois pourri émietté dans l’eau.
Carrory, qui était le plus affamé d’entre nous, avait coupé la botte qui lui restait, et continuellement il mâchait des morceaux de cuir.
En voyant jusqu’où la faim pouvait entraîner mes camarades, j’avoue que je me laissai aller à un sentiment de peur, qui, s’ajoutant à mes autres frayeurs, me mettait mal à l’aise. J’avais entendu Vitalis raconter souvent des histoires de naufrage, car il avait beaucoup voyagé sur mer, au moins autant que sur terre, et parmi ces histoires, il y en avait une qui, depuis que la faim nous tourmentait, me revenait sans cesse pour s’imposer à mon esprit : dans cette histoire, des matelots avaient été jetés sur un îlot de sable où ne se trouvait pas la moindre nourriture, et ils avaient tué le mousse pour le manger. Je me demandais, en entendant mes compagnons crier la faim, si pareil sort ne m’était pas réservé, et si, sur notre îlot de charbon, je ne serais pas tué aussi pour être mangé. Dans le magister et l’oncle Gaspard, j’étais sûr de trouver des défenseurs ; mais Pagès, Bergounhoux et Carrory, Carrory surtout, avec ses grandes dents blanches qu’il aiguisait sur ses morceaux de bottes, ne m’inspiraient aucune confiance.
Sans doute, ces craintes étaient folles ; mais dans la situation où nous étions, ce n’était pas la sage et froide raison qui dirigeait notre esprit ou notre imagination.
Ce qui augmentait encore nos terreurs, c’était l’absence de lumière. Successivement, nos lampes étaient arrivées à la fin de leur huile. Et lorsqu’il n’en était plus resté que deux, le magister avait décidé qu’elles ne seraient allumées que dans les circonstances où la lumière serait indispensable. Nous passions donc maintenant tout notre temps dans l’obscurité.
Non-seulement cela était lugubre, mais encore cela était dangereux, car si nous faisions un mouvement maladroit, nous pouvions rouler dans l’eau.
Depuis la mort de Compayrou nous n’étions plus que trois sur chaque palier et cela nous donnait un peu plus de place : l’oncle Gaspard était à un coin, le magister à un autre et moi au milieu d’eux.
À un certain moment, comme je sommeillais à moitié, je fus tout surpris d’entendre le magister parler à mi-voix comme s’il rêvait haut.
Je m’éveillai et j’écoutai.
— Il y a des nuages, disait-il, c’est une belle chose que les nuages. Il y a des gens qui ne les aiment pas ; moi je les aime. Ah ! ah ! nous aurons du vent, tant mieux, j’aime aussi le vent.
Rêvait-il ? Je le secouai par le bras, mais il continua :
— Si vous voulez me donner une omelette de six œufs, non de huit ; mettez-en douze, je la mangerai bien en rentrant.
— L’entendez-vous, oncle Gaspard ?
— Oui, il rêve.
— Mais non, il est éveillé.
— Il dit des bêtises.
— Je vous assure qu’il est éveillé.
— Hé ! magister ?
— Tu veux venir souper avec moi, Gaspard ? Viens, seulement je t’annonce un grand vent.
— Il perd la tête, dit l’oncle Gaspard ; c’est la faim et la fièvre.
— Non, il est mort, dit Bergounhoux, c’est son âme qui parle ; vous voyez bien qu’il est ailleurs. Où est le vent, magister, est-ce le mistral ?
— Il n’y a pas de mistral dans les enfers, s’écria Pagès, et le magister est aux enfers ; tu ne voulais pas me croire quand je te disais que tu irais.
Qui les prenait donc, avaient-ils tous perdu la raison ? Devenaient-ils fous ? Mais alors ils allaient se battre, se tuer. Que faire ?
— Voulez-vous boire, magister ?
— Non, merci, je boirai en mangeant mon omelette.
Pendant assez longtemps ils parlèrent tous les trois ensemble sans se répondre, et, au milieu de leurs paroles incohérentes, revenaient toujours les mots « manger, sortir, ciel, vent. »
Tout à coup l’idée me vint d’allumer la lampe. Elle était posée à côté du magister avec les allumettes, je la pris.
À peine eut-elle jeté sa flamme qu’ils se turent.
Puis après un moment de silence ils demandèrent ce qui se passait exactement, comme s’ils sortaient d’un rêve.
— Vous aviez le délire, dit l’oncle Gaspard.
— Qui ça ?
— Toi, magister, Pagès et Bergounhoux ; vous disiez que vous étiez dehors et qu’il faisait du vent.
De temps en temps nous frappions contre la paroi pour dire à nos sauveurs que nous étions vivants, et nous entendions leurs pics saper sans repos le charbon. Mais c’était bien lentement que leurs coups augmentaient de puissance, ce qui disait qu’ils étaient encore loin.
Quand la lampe fut allumée je descendis chercher de l’eau dans la botte, et il me sembla que les eaux avaient baissé dans le trou de quelques centimètres.
— Les eaux baissent.
— Mon Dieu !
Et une fois encore nous eûmes un transport d’espérance.
On voulait laisser la lampe allumée pour voir la marche de l’abaissement, mais le magister s’y opposa.
Alors je crus qu’une révolte allait éclater. Mais le magister ne demandait jamais rien sans nous donner de bonnes raisons.
— Nous aurons besoin des lampes plus tard ; si nous les usons tout de suite pour rien, comment ferons-nous quand elles nous seront nécessaires ? Et puis croyez-vous que vous ne mourrez pas d’impatience à voir l’eau baisser insensiblement ? Car il ne faut pas vous attendre à ce qu’elle va baisser tout d’un coup. Nous serons sauvés, prenez donc courage. Nous avons encore treize allumettes. On s’en servira toutes les fois que vous le demanderez.
La lampe fut éteinte. Nous avions tous bu abondamment ; le délire ne nous reprit pas. Et pendant de longues heures, des journées peut-être, nous restâmes immobiles, n’ayant pour soutenir notre vie que le bruit des pics qui creusaient la descente et celui des bennes dans les puits.
Insensiblement, ces bruits devenaient de plus en plus forts ; l’eau baissait, et l’on se rapprochait de nous. Mais arriverait-on à temps ? Si le travail de nos sauveurs augmentait utilement d’instant en instant, notre faiblesse d’instant en instant aussi devenait plus grande, plus douloureuse : faiblesse de corps, faiblesse d’esprit. Depuis le jour de l’inondation, mes camarades n’avaient pas mangé. Et ce qu’il y avait de plus terrible encore, nous n’avions respiré qu’un air qui ne se renouvelant pas devenait de jour en jour moins respirable et plus malsain. Heureusement, à mesure que les eaux avaient baissé, la pression atmosphérique avait diminué, car si elle était restée celle des premières heures, nous serions morts assurément asphyxiés. Aussi de toutes les manières si nous avons été sauvés, l’avons-nous dû à la promptitude avec laquelle le sauvetage a été commandé et organisé.
Le bruit des pics et des bennes était d’une régularité absolue comme celle d’un balancier d’horloge ; et chaque interruption de poste nous donnait de fiévreuses émotions. Allait-on nous abandonner, ou rencontrait-on des difficultés insurmontables ? Pendant une de ces interruptions un bruit formidable s’éleva, un ronflement, un soufflement puissant.
— Les eaux tombent dans la mine, s’écria Carrory.
— Ce n’est pas l’eau, dit le magister.
— Qu’est-ce ?
— Je ne sais pas ; mais ce n’est pas l’eau.
Bien que le magister nous eût donné de nombreuses preuves de sa sagacité et de sa sûreté d’intuition, on ne le croyait que s’il appuyait ses paroles de raisons démonstratives. Avouant qu’il ne connaissait pas la cause de ce bruit (qui, nous l’avons su plus tard, était celui d’un ventilateur à engrenages, monté pour envoyer de l’air aux travailleurs), on revint avec une épouvante folle à l’idée de l’inondation.
— Allume la lampe.
— C’est inutile.
— Allume, allume !
Il fallut qu’il obéît, car toutes les voix s’étaient réunies dans cet ordre.
La clarté de la lampe nous fit voir que l’eau n’avait pas monté et qu’elle descendait plutôt.
— Vous voyez bien, dit le magister.
— Elle va monter ; cette fois il faut mourir.
— Eh bien, autant en finir tout de suite, je n’en peux plus.
— Donne la lampe, magister, je veux écrire un papier pour ma femme et les enfants.
— Écris pour moi.
— Pour moi aussi.
C’était Bergounhoux qui avait demandé la lampe pour écrire avant de mourir à sa femme et à ses enfants ; il avait dans sa poche un morceau de papier et un bout de crayon ; il se prépara à écrire.
— Voilà ce que je veux dire :
« Nous Gaspard, Pagès, le magister, Carrory et Rémi, enfermés dans la remontée, nous allons mourir.
« Moi, Bergounhoux, je demande à Dieu qu’il serve d’époux à la veuve et de père aux orphelins : je leur donne ma bénédiction. »
— Toi, Gaspard ?
« Gaspard donne ce qu’il a à son neveu Alexis. »
« Pagès recommande sa femme et ses enfants au bon Dieu, à la sainte Vierge et à la compagnie. »
— Toi, magister ?
— Je n’ai personne, dit le magister tristement, personne ne me pleurera.
— Toi, Carrory ?
— Moi, s’écria Carrory, je recommande qu’on vende mes châtaignes avant de les roussir.
— Notre papier n’est pas pour ces bêtises-là.
— Ce n’est pas une bêtise.
— N’as-tu personne à embrasser ? ta mère ?
— Ma mère, elle héritera de moi.
— Et toi, Rémi ?
« Rémi donne Capi et sa harpe à Mattia ; il embrasse Alexis et lui demande d’aller trouver Lise, et, en l’embrassant, de lui rendre une rose séchée qui est dans sa veste. »
— Nous allons tous signer.
— Moi, je vais faire une croix, dit Pagès.
— Maintenant, dit Bergounhoux, quand le papier eût été signé par tous, je demande qu’on me laisse mourir tranquille, sans me parler. Adieu, les camarades.
Et quittant son palier, il vint sur le nôtre nous embrasser tous les trois, remonta sur le sien, embrassa Pagès et Carrory, puis, ayant fait un amas de poussier, il posa sa tête dessus, s’étendit tout de son long et ne bougea plus.
Les émotions de la lettre et cet abandon de Bergounhoux ne nous mirent pas le courage au cœur.
Cependant les coups de pic étaient devenus plus distincts, et bien certainement on s’était approché de nous de manière à nous atteindre bientôt peut-être.
Ce fut ce que le magister nous expliqua pour nous rendre un peu de force.
— S’ils étaient si près que tu crois, on les entendrait crier, et on ne les entend pas, pas plus qu’ils ne nous entendent nous-mêmes.
— Ils peuvent être à quelques mètres à peine et ne pas entendre nos voix ; cela dépend de la nature du massif qu’elles ont à traverser.
— Ou de la distance.
Cependant les eaux baissaient toujours, et nous eûmes bientôt une preuve qu’elles n’atteignaient plus le toit des galeries.
Nous entendîmes un grattement sur le schiste de la remontée et l’eau clapota comme si des petits morceaux de charbon avaient tombé dedans.
On alluma la lampe, et nous vîmes des rats qui couraient au bas de la remontée. Comme nous ils avaient trouvé un refuge dans une cloche d’air, et lorsque les eaux avaient baissé, ils avaient abandonné leur abri pour chercher de la nourriture. S’ils avaient pu venir jusqu’à nous c’est que l’eau n’emplissait plus les galeries dans toute leur hauteur.
Ces rats furent pour notre prison ce qu’a été la colombe pour l’arche de Noé : la fin du déluge.
— Bergounhoux, dit le magister en se haussant jusqu’au palier supérieur, reprends courage.
Et il lui expliqua comment les rats annonçaient notre prochaine délivrance.
Mais Bergounhoux ne se laissa pas entraîner.
— S’il faut passer encore de l’espérance au désespoir, j’aime mieux ne pas espérer ; j’attends la mort, si c’est le salut qui vient, béni soit Dieu.
Je voulus descendre au bas de notre remontée pour bien voir les progrès de la baisse des eaux. Ces progrès étaient sensibles et maintenant il y avait un grand vide entre l’eau et le toit de la galerie.
— Attrape-nous des rats, me cria Carrory, que nous les mangions.
Mais pour attraper les rats il eût fallu plus agile que moi.
Pourtant l’espérance m’avait ranimé et le vide dans la galerie m’inspirait une idée qui me tourmentait. Je remontai à notre palier.
— Magister, j’ai une idée : puisque les rats circulent dans la galerie, c’est qu’on peut passer ; je vais aller en nageant jusqu’aux échelles et appeler : on viendra nous chercher ; ce sera plus vite fait que par la descente.
— Je te le défends !
— Mais, magister, je nage comme vous marchez et suis dans l’eau comme une anguille.
— Et le mauvais air ?
— Puisque les rats passent, l’air ne sera pas plus mauvais pour moi qu’il n’est pour eux.
— Vas-y, Rémi, cria Pagès, je te donnerai ma montre.
— Gaspard, qu’est-ce que vous en dites ? demanda le magister.
— Rien ; s’il croit pouvoir aller aux échelles qu’il y aille, je n’ai pas le droit de l’en empêcher.
— Et s’il se noie ?
— Et s’il se sauve au lieu de mourir ici en attendant ?
Un moment le magister resta à réfléchir, puis me prenant la main :
— Tu as du cœur, petit, fais comme tu veux ; je crois que c’est l’impossible que tu essayes, mais ce n’est pas la première fois que l’impossible réussit. Embrasse-nous.
Je l’embrassai ainsi que l’oncle Gaspard, puis ayant quitté mes vêtements, je descendis dans l’eau.
— Vous crierez toujours, dis-je avant de me mettre à nager, votre voix me guidera.
Quel était le vide sous le toit de la galerie ? Était-il assez grand pour me mouvoir librement ? C’était là la question.
Après quelques brasses, je trouvai que je pouvais nager en allant doucement de peur de me cogner la tête : l’aventure que je tentais était donc possible. Au bout, était-ce la délivrance, était-ce la mort ?
Je me retournai et j’aperçus la lueur de la lampe que reflétaient les eaux noires : là j’avais un phare.
— Vas-tu bien ? criait le magister.
— Oui.
Et j’avançais avec précaution.
De notre remontée aux échelles la difficulté était dans la direction à suivre, car je savais qu’à un endroit, qui n’était pas bien éloigné, il y avait une rencontre de galeries. Il ne fallait pas se tromper dans l’obscurité, sous peine de se perdre. Pour me diriger, le toit et les parois de la galerie n’étaient pas suffisants, mais j’avais sur le sol un guide plus sûr, c’étaient les rails. En les suivant, j’étais certain de trouver les échelles.
De temps en temps, je laissais descendre mes pieds, et après avoir rencontré les tiges de fer, je me redressais doucement. Les rails sous mes pieds, les voix de mes camarades derrière moi, je n’étais pas perdu.
L’affaiblissement des voix d’un côté, le bruit plus fort des bennes d’épuisement d’un autre me disaient que j’avançais. Enfin je reverrais donc la lumière du jour, et par moi mes camarades allaient être sauvés ! Cela soutenait mes forces.
Avançant droit au milieu de la galerie, je n’avais qu’à me mettre droit pour rencontrer le rail, et le plus souvent je me contentais de le toucher du pied. Dans un de ces mouvements ne l’ayant pas trouvé avec le pied, je plongeai pour le chercher avec les mains, mais inutilement ; j’allai d’une paroi à l’autre de la galerie, je ne trouvai rien.
Je m’étais trompé.
Je restai immobile pour me reconnaître et réfléchir ; les voix de mes camarades ne m’arrivaient plus que comme un très-faible murmure à peine perceptible. Lorsque j’eus respiré et pris une bonne provision d’air, je plongeai de nouveau, mais sans être plus heureux que la première fois. Pas de rails.
J’avais pris la mauvaise galerie sans m’en apercevoir, il fallait revenir en arrière.
Mais comment ? mes camarades ne criaient plus, ou ce qui était la même chose, je ne les entendais pas.
Je restai un moment paralysé par une poignante angoisse, ne sachant de quel côté me diriger. J’étais donc perdu, dans cette nuit noire, sous cette lourde voûte, dans cette eau glacée.
Mais tout à coup le bruit des voix reprit et je sus par où je devais me tourner.
Après être revenu d’une douzaine de brasses en arrière, je plongeai et retrouvai le rail. C’était donc là qu’était la bifurcation. Je cherchai la plaque, je ne la trouvai pas ; je cherchai les ouvertures qui devaient être dans la galerie ; à droite comme à gauche je rencontrai la paroi. Où était le rail ?
Je le suivis jusqu’au bout ; il s’interrompait brusquement.
Alors je compris que le chemin de fer avait été arraché, bouleversé par le tourbillon des eaux et que je n’avais plus de guide.
Dans ces conditions, mon projet devenait impossible, et je n’avais plus qu’à revenir sur mes pas.
J’avais déjà parcouru la route, je savais qu’elle était sans danger, je nageai rapidement pour regagner la remontée : les voix me guidaient.
À mesure que je me rapprochais il me semblait que ces voix étaient plus assurées, comme si mes camarades avaient pris de nouvelles forces.
Je fus bientôt à l’entrée de la remontée et je criai à mon tour.
— Arrive, arrive, me dit le magister.
— Je n’ai pas trouvé le passage.
— Cela ne fait rien ; la descente avance, ils entendent nos cris, nous entendons les leurs ; nous allons nous parler bientôt.
Rapidement j’escaladai la remontée et j’écoutai. En effet les coups de pic étaient beaucoup plus forts ; et les cris de ceux qui travaillaient à notre délivrance nous arrivaient faibles encore, mais cependant déjà bien distincts.
Après le premier mouvement de joie, je m’aperçus que j’étais glacé, mais, comme il n’y avait pas de vêtements chauds à me donner pour me sécher on m’enterra jusqu’au cou dans le charbon menu, qui conserve toujours une certaine chaleur, et l’oncle Gaspard avec le magister se serrèrent contre moi. Alors je leur racontai mon exploration et comment j’avais perdu les rails.
— Tu as osé plonger ?
— Pourquoi pas ? malheureusement, je n’ai rien trouvé.
Mais, ainsi que l’avait dit le magister cela importait peu maintenant ; car, si nous n’étions pas sauvés par la galerie nous allions l’être par la descente.
Les cris devinrent assez distincts pour espérer qu’on allait entendre les paroles.
En effet, nous entendîmes bientôt ces trois mots prononcés lentement :
— Combien êtes-vous ?
De nous tous c’était l’oncle Gaspard qui avait la parole la plus forte et la plus claire. On le chargea de répondre.
— Six !
Il y eut un moment de silence. Sans doute au dehors ils avaient espéré un plus grand nombre.
— Dépêchez-vous, cria l’oncle Gaspard, nous sommes à bout.
— Vos noms ?
Il dit nos noms :
— Bergounhoux, Pagès, le magister, Carrory, Rémi, Gaspard.
Dans notre sauvetage, ce fut là, pour ceux qui étaient au dehors, le moment le plus poignant. Quand ils avaient su qu’on allait bientôt communiquer avec nous, tous les parents, tous les amis des mineurs engloutis étaient accourus, et les soldats avaient grand’peine à les contenir au bout de la galerie.
Quand l’ingénieur annonça que nous n’étions que six, il y eut un douloureux désappointement, mais avec une espérance encore pour chacun, car parmi ces six pouvait, devait se trouver celui qu’on attendait.
Il répéta nos noms.
Hélas ! sur cent vingt mères ou femmes, il y en eut quatre seulement qui virent leurs espérances réalisées. Que de douleurs, que de larmes !
Nous de notre côté nous pensions aussi à ceux qui avaient dû être sauvés.
— Combien ont été sauvés ? demanda l’oncle Gaspard.
On ne répondit pas.
— Demande où est Marius, dit Pagès.
La demande fut faite ; comme la première, elle resta sans réponse.
— Ils n’ont pas entendu.
— Dis plutôt qu’ils ne veulent pas répondre.
Il y avait une question qui me tourmentait.
— Demandez donc depuis combien de temps nous sommes là.
— Depuis quatorze jours.
Quatorze jours ! Celui de nous qui dans ses évaluations avait été le plus haut avait parlé de cinq ou six jours.
— Vous ne resterez pas longtemps maintenant. Prenez courage. Ne parlons plus, cela retarde le travail. Encore quelques heures.
Ce furent, je crois, les plus longues de notre captivité, en tous cas de beaucoup les plus douloureuses. Chaque coup de pic nous semblait devoir être le dernier ; puis, après ce coup, il en venait un autre, et après cet autre un autre encore.
De temps en temps les questions reprenaient.
— Avez-vous faim ?
— Oui, très-faim.
— Pouvez-vous attendre ? si vous êtes trop faibles, on va faire un trou de sonde et vous envoyer du bouillon, mais cela va retarder votre délivrance ; si vous pouvez attendre vous serez plus promptement en liberté.
— Nous attendrons, dépêchez-vous.
Le fonctionnement des bennes ne s’était pas arrêté une minute, et l’eau baissait, toujours régulièrement.
— Annonce que l’eau baisse, dit le magister.
— Nous le savons ; soit par la descente, soit par la galerie ; on va venir à vous… bientôt.
Les coups de pic devinrent moins forts. Évidemment on s’attendait d’un moment à l’autre à faire une percée, et comme nous avions expliqué notre position, on craignait de causer un éboulement qui, nous tombant sur la tête, pourrait nous blesser, nous tuer, ou nous précipiter dans l’eau, pêle-mêle avec les déblais.
Le magister nous explique qu’il y a aussi à craindre l’expansion de l’air, qui, aussitôt qu’un trou sera percé, va se précipiter comme un boulet de canon et tout renverser. Il faut donc nous tenir sur nos gardes et veiller sur nous comme les piqueurs veillent sur eux.
L’ébranlement causé au massif par les coups de pic détachait dans le haut de la remontée des petits morceaux de charbon qui roulaient sur la pente et allaient tomber dans l’eau.
Chose bizarre, plus le moment de notre délivrance approchait, plus nous étions faibles : pour moi je ne pouvais pas me soutenir, et couché dans mon charbon menu, il m’était impossible de me soulever sur le bras ; je tremblais et cependant je n’avais plus froid.
Enfin, quelques morceaux plus gros se détachèrent et roulèrent entre nous : l’ouverture était faite au haut de la remontée : nous fûmes aveuglés par la clarté des lampes.
Mais instantanément, nous retombâmes dans l’obscurité ; le courant d’air, un courant d’air terrible, une trombe entraînant avec elle des morceaux de charbon et des débris de toutes sortes, les avait soufflées.
— C’est le courant d’air, n’ayez pas peur, on va les rallumer au dehors. Attendez un peu.
Attendre ! Encore attendre !
Mais au même instant un grand bruit se fit dans l’eau de la galerie, et m’étant retourné, j’aperçus une forte clarté qui marchait sur l’eau clapoteuse.
— Courage ! courage ! criait-on.
Et pendant que par la descente on arrivait à donner la main aux hommes du palier supérieur, on venait à nous par la galerie.
L’ingénieur était en tête ; ce fut lui qui le premier escalada la remontée, et je fus dans ses bras avant d’avoir pu dire un mot.
Il était temps, le cœur me manqua.
Cependant j’eus conscience qu’on m’emportait ; puis, quand nous fûmes sortis de la galerie plate, qu’on m’enveloppait dans des couvertures.
Je fermai les yeux, mais bientôt j’éprouvai comme un éblouissement qui me força à les ouvrir.
C’était le jour. Nous étions en plein air.
En même temps, un corps blanc se jeta sur moi : c’était Capi, qui, d’un bond, s’était élancé dans les bras de l’ingénieur et me léchait la figure. En même temps, je sentis qu’on me prenait la main droite et qu’on m’embrassait. — Rémi ! dit une voix faible (c’était celle de Mattia). Je regardai autour de moi, et alors j’aperçus une foule immense qui s’était tassée sur deux rangs, laissant un passage au milieu de la masse. Toute cette foule était silencieuse, car on avait recommandé de ne pas nous émouvoir par des cris ; mais son attitude, ses regards parlaient pour ses lèvres.
Au premier rang, il me sembla apercevoir des surplis blancs et des ornements dorés qui brillaient au soleil. C’était le clergé de Varses qui était venu à l’entrée de la mine prier pour notre délivrance.
Quand nous parûmes, il se mit à genoux sur la poussière, car pendant ces quatorze jours, la terre mouillée par l’orage avait eu le temps de sécher.
Vingt bras se tendirent pour me prendre, mais l’ingénieur ne voulut pas me céder et, fier de son triomphe, heureux et superbe, il me porta jusqu’aux bureaux où des lits avaient été préparés pour nous recevoir.
Deux jours après je me promenais dans les rues de Varses suivi de Mattia, d’Alexis, de Capi, et tout le monde sur mon passage s’arrêtait pour me regarder.
Il y en avait qui venaient à moi et me serraient la main avec des larmes dans les yeux.
Et il y en avait d’autres qui détournaient la tête. Ceux-là étaient en deuil et se demandaient amèrement pourquoi c’était l’enfant orphelin qui avait été sauvé, tandis que le père de famille, le fils étaient encore dans la mine, misérables cadavres charriés, ballottés par les eaux.
Mais parmi ceux qui m’arrêtaient ainsi il y en avait qui étaient tout à fait gênants, ils m’invitaient à dîner ou bien à entrer au café.
— Tu nous raconteras ce que tu as éprouvé, disaient-ils.
Et je remerciais sans accepter, car il ne me convenait point d’aller ainsi raconter mon histoire à des indifférents, qui croyaient me payer avec un dîner ou un verre de bière.
D’ailleurs j’aimais mieux écouter que raconter, et j’écoutais Alexis, j’écoutais Mattia qui me disaient ce qui s’était passé sur terre pendant que nous étions sous terre.
— Quand je pensais que c’était pour moi que tu étais mort, disait Alexis, ça me cassait bras et jambes, car je te croyais bien mort.
— Moi, je n’ai jamais cru que tu étais mort, disait Mattia, je ne savais pas si tu sortirais vivant de la mine et si l’on arriverait à temps pour te sauver, mais je croyais que tu ne t’étais pas laissé noyer, de sorte que si les travaux de sauvetage marchaient assez vite on te trouverait quelque part. Alors, tandis qu’Alexis se désolait et te pleurait, moi je me donnais la fièvre en me disant : « Il n’était pas mort, mais il va peut-être mourir. » Et j’interrogeais tout le monde : « Combien peut-on vivre de temps sans manger ? Quand aura-t-on épuisé l’eau ? Quand la galerie sera-t-elle percée ? » Mais personne ne me répondait comme je voulais. Quand on vous a demandé vos noms et que l’ingénieur après Carrory, a crié Rémi, je me suis laissé aller sur la terre en pleurant, et alors on m’a un peu marché sur le corps, mais je ne l’ai pas senti tant j’étais heureux.
Je fus très-fier de voir que Mattia avait une telle confiance en moi qu’il ne voulait pas croire que je pouvais mourir.
VII
UNE LEÇON DE MUSIQUE
Je m’étais fait des amis dans la mine : de pareilles angoisses supportées en commun unissent les cœurs ; on souffre, on espère ensemble, on ne fait qu’un.
L’oncle Gaspard ainsi que le magister particulièrement m’avaient pris en grande affection ; et bien que l’ingénieur n’eût point partagé notre emprisonnement, il s’était attaché à moi comme à un enfant qu’on a arraché à la mort ; il m’avait invité chez lui et, pour sa fille, j’avais dû faire le récit de tout ce qui nous était arrivé pendant notre long ensevelissement dans la remontée.
Tout le monde voulait me garder à Varses.
— Je te trouverai un piqueur, me disait l’oncle Gaspard, et nous ne nous quitterons plus.
— Si tu veux un emploi dans les bureaux, me disait l’ingénieur, je t’en donnerai un.
L’oncle Gaspard trouvait tout naturel que je retournasse dans la mine, où il allait bientôt redescendre lui-même avec l’insouciance de ceux qui sont habitués à braver chaque jour le danger, mais moi qui n’avais pas son insouciance ou son courage, je n’étais nullement disposé à reprendre le métier de rouleur. C’était très-beau une mine, très-curieux, j’étais heureux d’en avoir vu une, mais je l’avais assez vue, et je ne me sentais pas la moindre envie de retourner dans une remontée.
À cette pensée seule, j’étouffais. Je n’étais décidément pas fait pour le travail sous terre ; la vie en plein air, avec le ciel sur la tête, même un ciel neigeux, me convenait mieux. Ce fut ce que j’expliquai à l’oncle Gaspard et au magister, qui furent, celui-ci surpris, celui-là peiné de mes mauvaises dispositions à l’égard du travail des mines ; Carrory, que je rencontrai, me dit que j’étais un capon.
Avec l’ingénieur, je ne pouvais pas répondre que je ne voulais plus travailler sous terre, puisqu’il m’offrait de m’employer dans ses bureaux et de m’instruire si je voulais être attentif à ses leçons ; j’aimai mieux lui raconter la vérité entière, ce que je fis.
— Et puis, tu aimes la vie en plein air, dit-il, l’aventure et la liberté ; je n’ai pas le droit de te contrarier, mon garçon, suis ton chemin.
Cela était vrai que j’aimais la vie en plein air, je ne l’avais jamais mieux senti que pendant mon emprisonnement dans la remontée ; ce n’est pas impunément qu’on s’habitue à aller où l’on veut, à faire ce que l’on veut, à être son maître.
Pendant qu’on essayait de me retenir à Varses, Mattia avait paru sombre et préoccupé ; je l’avais questionné ; il m’avait toujours répondu qu’il était comme à son ordinaire ; et ce ne fut que quand je lui dis que nous partirions dans trois jours qu’il m’avoua la cause de cette tristesse en me sautant au cou.
— Alors tu ne m’abandonneras pas ? s’écria-t-il.
Sur ce mot je lui allongeai une bonne bourrade, pour lui apprendre à douter de moi, et aussi un peu pour cacher l’émotion qui m’avait étreint le cœur en entendant ce cri d’amitié.
Car c’était l’amitié seule qui avait provoqué ce cri et non l’intérêt. Mattia n’avait pas besoin de moi pour gagner sa vie, il était parfaitement capable de la gagner tout seul.
À vrai dire même, il avait pour cela des qualités natives que je ne possédais pas au même degré que lui, il s’en fallait de beaucoup. D’abord il était bien plus apte que moi à jouer de tous les instruments, à chanter, à danser, à remplir tous les rôles. Et puis il savait encore bien mieux que moi engager « l’honorable société, » comme disait Vitalis, à mettre la main à la poche. Rien que par son sourire, ses yeux doux, ses dents blanches, son air ouvert, il touchait les cœurs les moins sensibles à la générosité, et sans rien demander il inspirait aux gens l’envie de donner ; on avait plaisir à lui faire plaisir. Cela était si vrai que, pendant sa courte expédition avec Capi, tandis que je me faisais rouleur, il avait trouvé le moyen d’amasser dix-huit francs, ce qui était une somme considérable.
Cent vingt-huit francs que nous avions en caisse et dix-huit francs gagnés par Mattia, cela faisait un total de cent quarante-six francs ; il ne manquait donc plus que quatre francs pour acheter la vache du prince.
Bien que je ne voulusse pas travailler aux mines, ce ne fut pas sans chagrin que je quittai Varses, car il fallut me séparer d’Alexis, de l’oncle Gaspard et du magister ; mais c’était ma destinée de me séparer de ceux que j’aimais et qui me témoignaient de l’affection.
En avant !
La harpe sur l’épaule et le sac au dos, nous voilà de nouveau sur les grands chemins avec Capi joyeux qui se roule dans la poussière.
J’avoue que ce ne fut pas sans un sentiment de satisfaction, lorsque nous fûmes sortis de Varses, que je frappai du pied la route sonore, qui retentissait autrement que le sol boueux de la mine : le bon soleil, les beaux arbres !
Avant notre départ, nous avions, Mattia et moi, longuement discuté notre itinéraire, car je lui avais appris à lire sur les cartes et il ne s’imaginait plus que les distances n’étaient pas plus longues pour les jambes qui font une route, que pour le doigt qui sur une carte va d’une ville à une autre. Après avoir bien pesé le pour et le contre, nous avions décidé qu’au lieu de nous diriger directement sur Ussel et de là sur Chavanon, nous passerions par Clermont, ce qui n’allongerait pas beaucoup notre route et ce qui nous donnerait l’avantage d’exploiter les villes d’eaux, à ce moment pleines de malades, Saint-Nectaire, le Mont-Dore, Royat, la Bourboule. Pendant que je faisais le métier de rouleur, Mattia dans son excursion avait rencontré un montreur d’ours qui se rendait à ces villes d’eaux, où, avait-il dit, on pouvait gagner de l’argent. Or Mattia voulait gagner de l’argent, trouvant que cent cinquante francs pour acheter une vache, ce n’était pas assez. Plus nous aurions d’argent, plus la vache serait belle, plus la vache serait belle, plus mère Barberin serait contente, et plus mère Barberin serait contente, plus nous serions heureux de notre côté.
Il fallait donc nous diriger vers Clermont.
En venant de Paris à Varses, j’avais commencé l’instruction de Mattia, lui apprenant à lire et lui enseignant aussi les premiers éléments de la musique ; de Varses à Clermont, je continuai mes leçons.
Soit que je ne fusse pas un très-bon professeur, — ce qui est bien possible, — soit que Mattia ne fût pas un bon élève, — ce qui est possible aussi, — toujours est-il qu’en lecture les progrès furent lents et difficiles, ainsi que je l’ai déjà dit.
Mattia avait beau s’appliquer et coller ses yeux sur le livre, il lisait toutes sortes de choses fantaisistes qui faisaient plus d’honneur à son imagination qu’à son attention.
Alors quelquefois l’impatience me prenait et, frappant sur le livre, je m’écriais avec colère que décidément il avait la tête trop dure.
Sans se fâcher, il me regardait avec ses grands yeux doux, et souriant :
— C’est vrai, disait-il, je ne l’ai tendre que quand on cogne dessus : Garofoli, qui n’était pas bête, avait tout de suite trouvé cela.
Comment rester en colère devant une pareille réponse ? Je riais et nous reprenions la leçon.
Mais en musique les mêmes difficultés ne s’étaient pas présentées, et dès le début Mattia avait fait des progrès étonnants, et si remarquables, que bien vite il en était arrivé à m’étonner par ses questions ; puis après m’avoir étonné, il m’avait embarrassé, et enfin il m’avait plus d’une fois interloqué au point que j’étais resté court.
Et j’avoue que cela m’avait vexé et mortifié ; je prenais au sérieux mon rôle de professeur, et je trouvais humiliant que mon élève m’adressât des questions auxquelles je ne savais que répondre ; il me semblait que c’était jusqu’à un certain point tricher.
Et il ne me les épargnait pas les questions, mon élève :
— Pourquoi n’écrit-on pas la musique sur la même clef ?
— Pourquoi emploie-t-on les dièses en montant et les bémols en descendant ?
— Pourquoi la première et la dernière mesure d’un morceau ne contiennent-elles pas toujours le nombre de temps régulier ?
— Pourquoi accorde-t-on un violon sur certaines notes plutôt que sur d’autres ?
À cette dernière question j’avais dignement répondu que le violon n’étant pas mon instrument, je ne m’étais jamais occupé de savoir comment on devait ou l’on ne devait pas l’accorder, et Mattia n’avait eu rien à répliquer.
Mais cette manière de me tirer d’affaire n’avait pas été de mise avec des questions comme celles qui se rapportaient aux clefs ou aux bémols : cela s’appliquait tout simplement à la musique, à la théorie de la musique ; j’étais professeur de musique, professeur de solfège, je devais répondre ou je perdais, je le sentais bien, mon autorité et mon prestige ; or, j’y tenais beaucoup à mon autorité et à mon prestige.
Alors, quand je ne savais pas ce qu’il y avait à répondre, je me tirais d’embarras comme l’oncle Gaspard, quand lui demandant ce que c’était que le charbon de terre, il me disait avec assurance : c’est du charbon qu’on trouve dans la terre.
Avec non moins d’assurance, je répondais à Mattia, lorsque je n’avais rien à lui répondre :
— Cela est ainsi, parce que cela doit être ainsi ; c’est une loi.
Mattia n’était pas d’un caractère à s’insurger contre une loi, seulement il avait une façon de me regarder en ouvrant la bouche et en écarquillant les yeux, qui ne me rendait pas du tout fier de moi.
Il y avait trois jours que nous avions quitté Varses, lorsqu’il me posa précisément une question de ce genre : au lieu de répondre à son pourquoi : « Je ne sais pas, » je répondis noblement : « Parce que cela est. »
Alors il parut préoccupé, et de toute la journée je ne pus pas lui tirer une parole, ce qui avec lui était bien extraordinaire, car il était toujours disposé à bavarder et à rire.
Je le pressai si bien qu’il finit par parler.
— Certainement, dit-il, tu es un bon professeur, et je crois bien que personne ne m’aurait enseigné comme toi ce que j’ai appris ; cependant…
Il s’arrêta.
— Quoi cependant ?
— Cependant, il y a peut-être des choses que tu ne sais pas ; cela arrive aux plus savants, n’est-ce pas ? Ainsi, quand tu me réponds : « Cela est, parce que cela est, » il y aurait peut-être d’autres raisons à donner que tu ne donnes pas parce qu’on ne te les a pas données à toi-même. Alors, raisonnant de cette façon, je me suis dit que si tu voulais, nous pourrions peut-être acheter, oh ! pas cher, un livre où se trouveraient les principes de la musique.
— Cela est juste.
— N’est-ce pas ? Je pensais bien que cela te paraîtrait juste, car enfin tu ne peux pas savoir tout ce qu’il y a dans les livres, puisque tu n’as pas appris dans les livres.
— Un bon maître vaut mieux que le meilleur livre.
— Ce que tu dis là m’amène à te parler de quelque chose encore : si tu voulais, j’irais demander une leçon à un vrai maître, une seule, et alors il faudrait bien qu’il me dise tout ce que je ne sais pas.
— Pourquoi n’as-tu pas pris cette leçon auprès d’un vrai maître pendant que tu étais seul ?
— Parce que les vrais maîtres se font payer et je n’aurais pas voulu prendre le prix de cette leçon sur ton argent.
J’étais blessé que Mattia me parlât ainsi d’un vrai maître, mais ma sotte vanité ne tint pas contre ces derniers mots.
— Tu es un trop bon garçon, lui dis-je, mon argent est ton argent, puisque tu le gagnes comme moi, mieux que moi, bien souvent ; tu prendras autant de leçons que tu voudras, et je les prendrai avec toi.
Puis j’ajoutai bravement cet aveu de mon ignorance :
— Comme cela je pourrai, moi aussi, apprendre ce que je ne sais pas.
Le maître, le vrai maître qu’il nous fallait, ce n’était pas un ménétrier de village, mais un artiste, un grand artiste, comme on en trouve seulement dans les villes importantes. La carte me disait qu’avant d’arriver à Clermont, la ville la plus importante qui se trouvait sur notre route était Mende. Mende était-elle vraiment une ville importante, c’était ce que je ne savais pas, mais comme le caractère dans lequel son nom était écrit sur la carte lui donnait cette importance, je ne pouvais que croire ma carte.
Il fut donc décidé que ce serait à Mende que nous ferions la grosse dépense d’une leçon de musique ; car bien que nos recettes fussent plus que médiocres dans ces tristes montagnes de la Lozère, où les villages sont rares et pauvres, je ne voulais pas retarder davantage la joie de Mattia.
Après avoir traversé dans toute son étendue le causse Méjean, qui est bien le pays le plus désolé et le plus misérable du monde, sans bois, sans eaux, sans cultures, sans villages, sans habitants, sans rien de ce qui est la vie, mais avec d’immenses et mornes solitudes qui ne peuvent avoir de charmes que pour ceux qui les parcourent rapidement en voiture, nous arrivâmes enfin à Mende.
Comme il était nuit depuis quelques heures déjà, nous ne pouvions aller ce soir-là même prendre notre leçon ; d’ailleurs nous étions morts de fatigue.
Cependant Mattia était si pressé de savoir si Mende, qui ne lui avait nullement paru la ville importante dont je lui avais parlé, possédait un maître de musique, que tout en soupant je demandai à la maîtresse de l’auberge où nous étions descendus, s’il y avait dans la ville un bon musicien qui donnât des leçons de musique.
Elle nous répondit qu’elle était bien surprise de notre question ; nous ne connaissions donc pas M. Espinassous ?
— Nous venons de loin, dis-je.
— De bien loin, alors ?
— De l’Italie, répondit Mattia.
Alors son étonnement se dissipa, et elle parut admettre que, venant de si loin, nous pussions ne pas connaître M. Espinassous ; mais bien certainement si nous étions venus seulement de Lyon ou de Marseille, elle n’aurait pas continué de répondre à des gens assez mal éduqués pour n’avoir pas entendu parler de M. Espinassous.
— J’espère que nous sommes bien tombés, dis-je à Mattia en italien.
Et les yeux de mon associé s’allumèrent. Assurément, M. Espinassous allait répondre le pied levé à toutes ses questions ; ce ne serait pas lui qui resterait embarrassé pour expliquer les raisons qui voulaient qu’on employât les bémols en descendant et les dièses en montant.
Une crainte me vint : un artiste aussi célèbre consentirait-il à donner une leçon à de pauvres misérables tels que nous ?
— Et il est très-occupé, M. Espinassous ? dis-je.
— Oh ! oui ! je le crois bien qu’il est occupé ; comment ne le serait-il pas ?
— Croyez-vous qu’il voudra nous recevoir demain matin ?
— Bien sûr ; il reçoit tout le monde, quand on a de l’argent dans la poche, s’entend.
Comme c’était ainsi que nous l’entendions nous aussi, nous fûmes rassurés, et avant de nous endormir nous discutâmes longuement, malgré la fatigue, toutes les questions que nous poserions le lendemain à cet illustre professeur.
Après avoir fait une toilette soignée, c’est-à-dire une toilette de propreté, la seule que nous pussions nous permettre puisque nous n’avions pas d’autres vêtements que ceux que nous portions sur notre dos, nous prîmes nos instruments, Mattia son violon, moi ma harpe, et nous nous mîmes en route pour nous rendre chez M. Espinassous.
Capi avait, comme de coutume, voulu venir avec nous, mais nous l’avions attaché dans l’écurie de l’aubergiste, ne croyant pas qu’il était convenable de se présenter avec un chien chez le célèbre musicien de Mende.
Quand nous fûmes arrivés devant la maison qui nous avait été indiquée comme étant celle du professeur, nous crûmes que nous nous étions trompés, car à la devanture de cette maison se balançaient deux petits plats à barbe en cuivre, ce qui n’a jamais été l’enseigne d’un maître de musique.
Comme nous restions à regarder cette devanture qui avait tout l’air d’être celle d’un barbier, une personne vint à passer, et nous l’arrêtâmes pour lui demander où demeurait M. Espinassous.
— Là, dit-elle, en nous indiquant la boutique du barbier.
Après tout, pourquoi un professeur de musique n’aurait-il pas demeuré chez un barbier ?
Nous entrâmes : la boutique était divisée en deux parties égales ; dans celle de droite, sur des planches, se trouvaient des brosses, des peignes, des pots de pommade, des savons ; dans celle de gauche, sur un établi et contre le mur étaient posés ou accrochés des instruments de musique, des violons, des cornets à piston, des trompettes à coulisse.
— Monsieur Espinassous ? demanda Mattia.
Un petit homme vif et frétillant comme un oiseau, qui était en train de raser un paysan assis dans un fauteuil, répondit d’une voix de basse-taille :
— C’est moi.
Je lançai un coup d’œil à Mattia pour lui dire que le barbier-musicien n’était pas l’homme qu’il nous fallait pour nous donner notre leçon, et que ce serait jeter notre argent par la fenêtre que de s’adresser à lui ; mais au lieu de me comprendre et de m’obéir, Mattia alla s’asseoir sur une chaise, et d’un air délibéré :
— Est-ce que vous voudrez bien me couper les cheveux quand vous aurez rasé monsieur ? dit-il.
— Certainement, jeune homme, et je vous raserai aussi si vous voulez.
— Je vous remercie, dit Mattia, pas aujourd’hui, quand je repasserai.
J’étais ébahi de l’assurance de Mattia ; il me lança un coup d’œil à la dérobée pour me dire d’attendre un moment avant de me fâcher.
Bientôt Espinassous eut fini de raser son paysan, et, la serviette à la main, il vint pour couper les cheveux de Mattia.
— Monsieur, dit Mattia pendant qu’on lui nouait la serviette autour du cou, nous avons une discussion, mon camarade et moi, et comme nous savons que vous êtes un célèbre musicien, nous pensons que vous voudrez bien nous donner votre avis sur ce qui nous embarrasse.
— Dites un peu ce qui vous embarrasse, jeunes gens.
Je compris où Mattia tendait à arriver : d’abord il voulait voir si ce perruquier-musicien était capable de répondre à ses questions, puis au cas où ses réponses seraient satisfaisantes, il voulait se faire donner sa leçon de musique pour le prix d’une coupe de cheveux ; décidément il était malin, Mattia.
— Pourquoi, demanda Mattia, accorde-t-on un violon sur certaines notes et pas sur d’autres ?
Je crus que ce perruquier, qui précisément à ce moment même était en train de passer le peigne dans la longue chevelure de Mattia, allait faire une réponse dans le genre des miennes : et je riais déjà tout bas quand il prit la parole :
— La seconde corde à gauche de l’instrument devant donner le la au diapason normal, les autres cordes doivent être accordées de façon à ce qu’elles donnent les notes de quinte en quinte, c’est-à-dire sol, quatrième corde ; ré, troisième corde ; la, deuxième corde ; mi, première corde ou chanterelle.
Ce ne fut pas moi qui ris, ce fut Mattia ; se moquait-il de ma mine ébahie ? était-il simplement joyeux de savoir ce qu’il avait voulu apprendre ? toujours est-il qu’il riait aux éclats.
Pour moi je restais bouche ouverte à regarder ce perruquier qui tout en tournant autour de Mattia et faisant claquer ses ciseaux, débitait ce petit discours, qui me paraissait prodigieux.
— Eh bien, dit-il en s’arrêtant tout à coup devant moi, je crois bien que ce n’était pas mon petit client qui avait tort.
Tant que dura la coupe de ses cheveux Mattia ne tarit pas en questions, et à tout ce qu’on lui demanda le barbier répondit avec la même facilité et la même sûreté que pour le violon.
Mais après avoir ainsi répondu, il en vint à interroger lui-même et bientôt il sut à quelle intention nous étions venus chez lui.
Alors il se mit à rire aux éclats :
— Voilà de bons petits gamins, disait-il, sont-ils drôles.
Puis il voulut que Mattia, qui évidemment était bien plus drôle que moi, lui jouât un morceau ; et Mattia prenant bravement son violon se mit à exécuter une valse.
— Et tu ne sais pas une note de musique ! s’écriait le perruquier en claquant des mains et en tutoyant Mattia comme s’il le connaissait depuis longtemps.
J’ai dit qu’il y avait des instruments posés sur un établi et d’autres qui étaient accrochés contre le mur. Mattia ayant terminé son morceau de violon prit une clarinette.
— Je joue aussi de la clarinette, dit-il, et du cornet à piston.
— Allons, joue, s’écria Espinassous.
Et Mattia joua ainsi un morceau sur chacun de ces instruments.
— Ce gamin est un prodige, criait Espinassous ; si tu veux rester avec moi, je ferai de toi un grand musicien ; tu entends, un grand musicien ! le matin, tu raseras la pratique avec moi, et tout le reste de la journée je te ferai travailler ; et ne crois pas que je ne sois pas un maître capable de t’instruire parce que je suis perruquier ; il faut vivre, manger, boire, dormir, et voilà à quoi le rasoir est bon ; pour faire la barbe aux gens, Jasmin n’en est pas moins le plus grand poëte de France ; Agen a Jasmin, Mende a Espinassous.
En entendant la fin de ce discours, je regardai Mattia. Qu’allait-il répondre ? Est-ce que j’allais perdre mon ami, mon camarade, mon frère, comme j’avais perdu successivement tous ceux que j’avais aimés ? Mon cœur se serra. Cependant je ne m’abandonnai pas à ce sentiment. La situation ressemblait jusqu’à un certain point à celle où je m’étais trouvé avec Vitalis quand madame Milligan avait demandé à me garder près d’elle : je ne voulus pas avoir à m’adresser les mêmes reproches que Vitalis.
— Ne pense qu’à toi, Mattia, dis-je d’une voix émue.
Mais il vint vivement à moi et me prenant la main :
— Quitter mon ami ! je ne pourrais jamais. Je vous remercie, monsieur.
Espinassous insista en disant que quand Mattia aurait fait sa première éducation, on trouverait le moyen de l’envoyer à Toulouse, puis à Paris au Conservatoire ; mais Mattia répondit toujours :
— Quitter Rémi, jamais !
— Eh bien, gamin, je veux faire quelque chose pour toi, dit Espinassous, je veux te donner un livre où tu apprendras ce que tu ignores.
Et il se mit à chercher dans des tiroirs : après un temps assez long, il trouva ce livre qui avait pour titre : Théorie de la musique ; il était bien vieux, bien usé, bien fripé, mais qu’importait.
Alors, prenant une plume, il écrivit sur la première page : « Offert à l’enfant qui, devenu un artiste, se souviendra du perruquier de Mende. »
Je ne sais s’il y avait alors à Mende d’autres professeurs de musique que le barbier Espinassous, mais voilà celui que j’ai connu et que nous n’avons jamais oublié, Mattia ni moi.
VIII
LA VACHE DU PRINCE
J’aimais bien Mattia quand nous arrivâmes à Mende ; mais quand nous sortîmes de cette ville, je l’aimais encore plus. Est-il rien de meilleur, rien de plus doux pour l’amitié que de sentir avec certitude que l’on est aimé de ceux qu’on aime ?
Et quelle plus grande preuve Mattia pouvait-il me donner de son affection que de refuser, comme il l’avait fait, la proposition d’Espinassous, c’est-à-dire la tranquillité, la sécurité, le bien-être, l’instruction dans le présent et la fortune dans l’avenir, pour partager mon existence aventureuse et précaire, sans avenir et peut-être même sans lendemain.
Je n’avais pas pu lui dire devant Espinassous l’émotion que son cri : « Quitter mon ami ! » avait provoquée en moi ; mais quand nous fûmes sortis, je lui pris la main et, la lui serrant :
— Tu sais, lui dis-je, que c’est entre nous à la vie et à la mort ?
Il se mit à sourire en me regardant avec ses grands yeux.
— Je savais ça avant aujourd’hui, dit-il.
Mattia, qui jusqu’alors avait très-peu mordu à la lecture, fit des progrès surprenants le jour où il lut dans la Théorie de la musique de Kuhn. Malheureusement je ne pus pas le faire travailler autant que j’aurais voulu et qu’il le désirait lui-même, car nous étions obligés de marcher du matin au soir, faisant de longues étapes pour traverser au plus vite ces pays de la Lozère et de l’Auvergne, qui sont peu hospitaliers pour des chanteurs et des musiciens. Sur ces pauvres terres, le paysan qui gagne peu n’est pas disposé à mettre la main à la poche ; il écoute avec un air placide tant qu’on veut bien jouer ; mais quand il prévoit que la quête va commencer, il s’en va ou il ferme sa porte.
Enfin, par Saint-Flour et Issoire, nous arrivâmes aux villages d’eaux qui étaient le but de notre expédition, et il se trouva par bonheur que les renseignements du montreur d’ours étaient vrais : à la Bourboule, au Mont-Dore surtout, nous fîmes de belles recettes.
Pour être juste, je dois dire que ce fut surtout à Mattia que nous les dûmes, à son adresse, à son tact. Pour moi, quand je voyais des gens assemblés, je prenais ma harpe et me mettais à jouer de mon mieux, il est vrai, mais avec une certaine indifférence. Mattia ne procédait pas de cette façon primitive ; quant à lui, il ne suffisait pas que des gens fussent rassemblés pour qu’il se mît tout de suite à jouer. Avant de prendre son violon ou son cornet à piston, il étudiait son public et il ne lui fallait pas longtemps pour voir s’il jouerait ou s’il ne jouerait pas, et surtout ce qu’il devait jouer.
À l’école de Garofoli, qui exploitait en grand la charité publique, il avait appris dans toutes ses finesses l’art si difficile de forcer la générosité ou la sympathie des gens ; et la première fois que je l’avais rencontré dans son grenier de la rue de Lourcine, il m’avait bien étonné en m’expliquant les raisons pour lesquelles les passants se décident à mettre la main à la poche ; mais il m’étonna bien plus encore quand je le vis à l’œuvre.
Ce fut dans les villes d’eaux qu’il déploya toute son adresse, et pour le public parisien, son ancien public qu’il avait appris à connaître et qu’il retrouvait là.
— Attention, me disait-il, quand nous voyions venir à nous une jeune dame en deuil dans les allées du Capucin, c’est du triste qu’il faut jouer, tâchons de l’attendrir et de la faire penser à celui qu’elle a perdu : si elle pleure, notre fortune est faite.
Et nous nous mettions à jouer avec des mouvements si ralentis, que c’était à fendre le cœur.
Il y a dans les promenades aux environs du Mont-Dore des endroits qu’on appelle des salons, ce sont des groupes d’arbres, des quinconces sous l’ombrage desquels les baigneurs vont passer quelques heures en plein air ; Mattia étudiait le public de ces salons, et c’était d’après ses observations que nous arrangions notre répertoire.
Quand nous apercevions un malade assis mélancoliquement sur une chaise, pâle, les yeux vitreux, les joues caves, nous nous gardions bien d’aller nous camper brutalement devant lui, pour l’arracher à ses tristes pensées. Nous nous mettions à jouer loin de lui comme si nous jouions pour nous seuls et en nous appliquant consciencieusement ; du coin de l’œil nous l’observions ; s’il nous regardait avec colère, nous nous en allions ; s’il paraissait nous écouter avec plaisir, nous nous rapprochions, et Capi pouvait présenter hardiment sa sébile, il n’avait pas à craindre d’être renvoyé à coup de pied.
Mais c’était surtout près des enfants que Mattia obtenait ses succès les plus fructueux ; avec son archet il leur donnait des jambes pour danser et avec son sourire il les faisait rire même quand ils étaient de mauvaise humeur. Comment s’y prenait-il ? Je n’en sais rien. Mais les choses étaient ainsi : il plaisait, on l’aimait.
Le résultat de notre campagne fut vraiment merveilleux ; toutes nos dépenses payées, nous eûmes assez vite gagné soixante-huit francs.
Soixante-huit francs et cent quarante-six que nous avions en caisse cela faisait deux cent quatorze francs ; l’heure était venue de nous diriger sans plus tarder vers Chavanon en passant par Ussel où, nous avait-on dit, devait se tenir une foire importante pour les bestiaux.
Une foire, c’était notre affaire ; nous allions pouvoir acheter enfin cette fameuse vache dont nous parlions si souvent et pour laquelle nous avions fait de si rudes économies.
Jusqu’à ce moment, nous n’avions eu que le plaisir de caresser notre rêve et de le faire aussi beau que notre imagination nous le permettait : notre vache serait blanche, c’était le souhait de Mattia ; elle serait rousse, c’était le mien en souvenir de notre pauvre Roussette ; elle serait douce, elle aurait plusieurs seaux de lait ; tout cela était superbe et charmant.
Mais maintenant, il fallait de la rêverie passer à l’exécution et c’était là que l’embarras commençait.
Comment choisir notre vache avec la certitude qu’elle aurait réellement toutes les qualités dont nous nous plaisions à la parer ? Cela était grave. Quelle responsabilité ! Je ne savais pas à quels signes on reconnaît une bonne vache, et Mattia était aussi ignorant que moi.
Ce qui redoublait notre inquiétude c’étaient les histoires étonnantes dont nous avions entendu le récit dans les auberges, depuis que nous nous étions mis en tête la belle idée d’acheter une vache. Qui dit maquignon de chevaux ou de vaches, dit artisan de ruses et de tromperies. Combien de ces histoires nous étaient restées dans la mémoire pour nous effrayer : un paysan achète à la foire une vache qui a la plus belle queue que jamais vache ait eue, avec une pareille queue elle pourra s’émoucher jusqu’au bout du nez, ce qui, tout le monde le sait, est un grand avantage ; il rentre chez lui triomphant, car il n’a pas payé cher cette vache extraordinaire ; le lendemain matin il va la voir, elle n’a plus de queue du tout ; celle qui pendait derrière elle si noblement avait été collée à un moignon ; c’était un chignon, une queue postiche. Un autre en achète une qui a des cornes fausses ; un autre quand il veut traire sa vache s’aperçoit qu’elle a eu la mamelle soufflée et qu’elle ne donnera pas deux verres de lait en vingt-quatre heures. Il ne faut pas que pareilles mésaventures nous arrivent.
Pour la fausse queue, Mattia ne craint rien ; il se suspendra de tout son poids à la queue de toutes les vaches dont nous aurons envie, et il tirera si fort sur ces queues que si elles sont collées elles se détacheront. Pour les mamelles soufflées, il a aussi un moyen tout aussi sûr, qui est de les piquer avec une grosse et longue épingle.
Sans doute cela serait infaillible, surtout si la queue était fausse et si la mamelle était soufflée ; mais si sa queue était vraie, ne serait-il pas à craindre qu’elle envoyât un bon coup de pied dans le ventre ou dans la tête de celui qui tirerait dessus ; et n’agirait-elle pas encore de même sous une piqûre s’enfonçant dans sa chair ?
L’idée de recevoir un coup de pied calme l’imagination de Mattia, et nous restons livrés à nos incertitudes : ce serait vraiment terrible d’offrir à mère Barberin une vache qui ne donnerait pas de lait ou qui n’aurait pas de cornes.
Dans les histoires qui nous avaient été contées, il y en avait une dans laquelle un vétérinaire jouait un rôle terrible, au moins à l’égard du marchand de vaches. Si nous prenions un vétérinaire pour nous aider, sans doute cela nous serait une dépense, mais combien elle nous rassurerait.
Au milieu de notre embarras, nous nous arrêtâmes à ce parti, qui, sous tous les rapports, paraissait le plus sage, et nous continuâmes alors gaiement notre route.
La distance n’est pas longue du Mont-Dore à Ussel ; nous mîmes deux jours à faire la route, encore arrivâmes-nous de bonne heure à Ussel.
J’étais là dans mon pays pour ainsi dire : c’était à Ussel que j’avais paru pour la première fois en public dans le Domestique de M. Joli-Cœur, ou le Plus bête des deux n’est pas celui qu’on pense, et c’était à Ussel aussi que Vitalis m’avait acheté ma première paire de souliers, ces souliers à clous qui m’avaient rendu si heureux.
Pauvre Joli-Cœur, il n’était plus là avec son bel habit rouge de général anglais, et Zerbino avec la gentille Dolce manquaient aussi.
Pauvre Vitalis, je l’avais perdu et je ne le reverrais plus marchant la tête haute, la poitrine cambrée, marquant le pas des deux bras et des deux pieds en jouant une valse sur son fifre perçant.
Sur six que nous étions alors deux seulement restaient debout : Capi et moi ; cela rendit mon entrée à Ussel toute mélancolique ; malgré moi je m’imaginais que j’allais apercevoir le feutre de Vitalis au coin de chaque rue et que j’allais entendre l’appel qui tant de fois avait retenti à mes oreilles : « En avant ! »
La boutique du fripier où Vitalis m’avait conduit pour m’habiller en artiste vint heureusement chasser ces tristes pensées : je la retrouvai telle que je l’avais vue lorsque j’avais descendu ses trois marches glissantes. À la porte se balançait le même habit galonné sur les coutures, qui m’avait ravi d’admiration, et dans la montre je retrouvai les mêmes vieux fusils avec les mêmes vieilles lampes.
Je voulus aussi montrer la place où j’avais débuté, en jouant le rôle du domestique de M. Joli-Cœur, c’est-à-dire le plus bête des deux : Capi se reconnut et frétilla de la queue.
Après avoir déposé nos sacs et nos instruments à l’auberge où j’avais logé avec Vitalis, nous nous mîmes à la recherche d’un vétérinaire.
Quand celui-ci eut entendu notre demande il commença par nous rire au nez.
— Mais il n’y a pas de vaches savantes dans le pays, dit-il.
— Ce n’est pas une vache qui sache faire des tours qu’il nous faut, c’en est une qui donne du bon lait.
— Et qui ait une vraie queue, ajouta Mattia, que l’idée d’une queue collée tourmentait beaucoup.
— Enfin, monsieur le vétérinaire, nous venons vous demander de nous aider de votre science pour nous empêcher d’être volés par les marchands de vaches.
Je dis cela en tâchant d’imiter les airs nobles que Vitalis prenait si bien lorsqu’il voulait faire la conquête des gens.
— Et pourquoi diable voulez-vous une vache ? demanda le vétérinaire.
En quelques mots, j’expliquai ce que je voulais faire de cette vache.
— Vous êtes de bons garçons, dit-il, je vous accompagnerai demain matin sur le champ de foire, et je vous promets que la vache que je vous choisirai n’aura pas une queue postiche.
— Ni des cornes fausses ? dit Mattia.
— Ni des cornes fausses.
— Ni la mamelle soufflée ?
— Ce sera une belle et bonne vache ; mais pour acheter il faut être en état de payer ?
Sans répondre, je dénouai un mouchoir dans lequel était enfermé notre trésor.
— C’est parfait, venez me prendre demain matin à sept heures.
— Et combien vous devrons-nous, monsieur le vétérinaire ?
— Rien du tout ; est-ce que je veux prendre de l’argent à de bons enfants comme vous !
Je ne savais comment remercier ce brave homme, mais Mattia eut une idée.
— Monsieur, est-ce que vous aimez la musique ? demanda-t-il.
— Beaucoup, mon garçon.
— Et vous vous couchez de bonne heure ?
Cela était assez incohérent, cependant le vétérinaire voulut bien répondre :
— Quand neuf heures sonnent.
— Merci, monsieur, à demain matin sept heures.
J’avais compris l’idée de Mattia.
— Tu veux donner un concert au vétérinaire ? dis-je.
— Justement : une sérénade quand il va se coucher ; ça se fait pour ceux qu’on aime.
— Tu as eu là une bonne idée, rentrons à l’auberge et travaillons les morceaux de notre concert ; on peut ne pas se gêner avec le public qui paye, mais quand on paye soi-même il faut faire de son mieux.
À neuf heures moins deux ou trois minutes nous étions devant la maison du vétérinaire, Mattia avec son violon, moi avec ma harpe : la rue était sombre, car la lune devant se lever vers neuf heures on avait jugé bon de ne pas allumer les réverbères, les boutiques étaient déjà fermées, et les passants étaient rares.
Au premier coup de neuf heures nous partîmes en mesure : et dans cette rue étroite, silencieuse, nos instruments résonnèrent comme dans la salle la plus sonore : les fenêtres s’ouvrirent et nous vîmes apparaître des têtes encapuchonnées de bonnets, de mouchoirs et de foulards : d’une fenêtre à l’autre on s’interpellait avec surprise.
Notre ami le vétérinaire demeurait dans une maison qui, à l’un de ses angles, avait une gracieuse tourelle : une des fenêtres de cette tourelle s’ouvrit et il se pencha pour voir qui jouait ainsi.
Sans doute il nous reconnut et il comprit notre intention, car de sa main il nous fit signe de nous taire :
— Je vais vous ouvrir la porte, dit-il, vous jouerez dans le jardin.
Et presque aussitôt cette porte nous fut ouverte.
— Vous êtes de braves garçons, dit-il en nous donnant à chacun une bonne poignée de main, mais vous êtes aussi des étourdis ; vous n’avez donc point pensé que le sergent de ville pouvait vous arrêter pour tapage nocturne sur la voie publique !
Notre concert recommença dans le jardin qui n’était pas bien grand, mais très-coquet avec un berceau couvert de plantes grimpantes.
Comme le vétérinaire était marié et qu’il avait plusieurs enfants, nous eûmes bientôt un public autour de nous ; on alluma des chandelles sous le berceau et nous jouâmes jusqu’après dix heures ; quand un morceau était fini, on nous applaudissait, et on nous en demandait un autre.
Si le vétérinaire ne nous avait pas mis à la porte, je crois bien, que sur la demande des enfants, nous aurions joué une bonne partie de la nuit.
— Laissez-les aller au lit, dit-il, il faut qu’ils soient ici demain matin à sept heures.
Mais il ne nous laissa pas aller sans nous offrir une collation qui nous fut très-agréable ; alors, pour remerciements, Capi joua quelques-uns de ses tours les plus drôles, ce qui fit la joie des enfants ; il était près de minuit quand nous partîmes.
La ville d’Ussel si tranquille le soir était le lendemain matin pleine de tapage et de mouvement ; avant le lever du jour nous avions entendu dans notre chambre un bruit incessant de charrettes roulant sur le pavé et se mêlant aux hennissements des chevaux, aux meuglements des vaches, aux bêlements des moutons, aux cris des paysans qui arrivaient pour la foire.
Quand nous descendîmes, la cour de notre auberge était déjà encombrée de charrettes enchevêtrées les unes dans les autres, et des voitures qui arrivaient descendaient des paysans endimanchés qui prenaient leurs femmes dans leurs bras pour les mettre à terre ; alors tout le monde se secouait, les femmes défripaient leurs jupes.
Dans la rue tout un flot mouvant se dirigeait vers le champ de foire ; comme il n’était encore que six heures, nous eûmes envie d’aller passer en revue les vaches qui étaient déjà arrivées et de faire notre choix à l’avance.
Ah ! les belles vaches ! Il y en avait de toutes les couleurs et de toutes les tailles, les unes grasses, les autres maigres, celles-ci avec leurs veaux, celles-là traînant à terre leur mamelle pleine de lait ; sur le champ de foire se trouvaient aussi des chevaux qui hennissaient, des juments qui léchaient leurs poulains, des porcs gras qui se creusaient des trous dans la terre, des cochons de lait qui hurlaient comme si on les écorchait vifs, des moutons, des poules, des oies ; mais que nous importait ! nous n’avions d’yeux que pour les vaches qui subissaient notre examen en clignant les paupières et en remuant lentement la mâchoire, ruminant placidement leur repas de la nuit, sans se douter qu’elles ne mangeraient plus l’herbe des pâturages où elles avaient été élevées.
Après une demi-heure de promenade, nous en avions trouvé dix-sept qui nous convenaient tout à fait, celle-ci pour telle qualité, celle-là pour telle autre, trois parce qu’elles étaient rousses, deux parce qu’elles étaient blanches ; ce qui bien entendu souleva une discussion entre Mattia et moi.
À sept heures nous trouvâmes le vétérinaire qui nous attendait et nous revînmes avec lui au champ de foire en lui expliquant de nouveau quelles qualités nous exigions dans la vache que nous allions acheter.
Elles se résumaient en deux mots : donner beaucoup de lait et manger peu.
— En voici une qui doit être bonne, dit Mattia en désignant une vache blanchâtre.
— Je crois que celle-là est meilleure, dis-je en montrant une rousse.
Le vétérinaire nous mit d’accord en ne s’arrêtant ni à l’une ni à l’autre, mais en allant à une troisième : c’était une petite vache aux jambes grêles, rouge de poil, avec les oreilles et les joues brunes, les yeux bordés de noir et un cercle blanchâtre autour du mufle.
— Voilà une vache du Rouergue qui est justement ce qu’il vous faut, dit-il.
Un paysan à l’air chétif la tenait par la longe ; ce fut à lui que le vétérinaire s’adressa pour savoir combien il voulait vendre sa vache.
— Trois cents francs.
Déjà cette petite vache alerte et fine, maligne de physionomie avait fait notre conquête, les bras nous tombèrent du corps.
Trois cents francs : ce n’était pas du tout notre affaire ; je fis un signe au vétérinaire pour lui dire que nous devions passer à une autre ; il m’en fit un pour me dire au contraire que nous devions persévérer.
Alors une discussion s’engagea entre lui et le paysan : il offrit 150 francs ; le paysan diminua 10 francs. Le vétérinaire monta à 170 ; le paysan descendit à 280.
Mais arrivées à ce point, les choses ne continuèrent pas ainsi, ce qui nous avait donné bonne espérance : au lieu d’offrir, le vétérinaire commença à examiner la vache en détail : elle avait les jambes faibles, le cou trop court, les cornes trop longues ; elle manquait de poumons, la mamelle n’était pas bien conformée.
Le paysan répondit que, puisque nous nous y connaissions si bien, il nous donnerait sa vache pour deux cent cinquante francs, afin qu’elle fût en bonnes mains.
Là-dessus la peur nous prit, nous imaginant tous deux que c’était une mauvaise vache.
— Allons en voir d’autres, dis-je.
Sur ce mot le paysan faisant un effort, diminua de nouveau dix francs.
Enfin, de diminution en diminution il arriva à deux cent dix francs, mais il y resta.
D’un coup de coude le vétérinaire nous avait fait comprendre que tout ce qu’il disait n’était pas sérieux et que la vache, loin d’être mauvaise, était excellente ; mais deux cent dix francs, c’était une grosse somme pour nous.
Pendant ce temps Mattia tournant par derrière la vache lui avait arraché un long poil à la queue et la vache lui avait détaché un coup de pied.
Cela me décida.
— Va pour deux cent dix francs, dis-je, croyant tout fini.
Et j’étendis la main pour prendre la longe, mais le paysan ne me la céda pas.
— Et les épingles de la bourgeoise ? dit-il.
Une nouvelle discussion s’engagea et finalement nous tombâmes d’accord sur vingt sous d’épingles. Il nous restait donc trois francs.
De nouveau j’avançai la main, le paysan me la prit et me la serra fortement en ami.
Justement parce que j’étais un ami, je n’oublierais pas le vin de la fille.
Le vin de la fille nous coûta dix sous.
Pour la troisième fois je voulus prendre la longe, mais mon ami le paysan m’arrêta :
— Vous avez apporté un licou ? me dit-il, je vends la vache, je ne vends pas son licou.
Cependant comme nous étions amis il voulait bien me céder ce licou pour trente sous, ce n’était pas cher.
Il nous fallait un licou pour conduire notre vache, j’abandonnai les trente sous, calculant qu’il nous en resterait encore vingt.
Je comptai donc les deux cent treize francs et pour la quatrième fois j’étendis la main.
— Où donc est votre longe ? demanda le paysan, je vous ai vendu le licou, je vous ai pas vendu la longe.
La longe nous coûta vingt sous, nos vingt derniers sous.
Et lorsqu’ils furent payés la vache nous fut enfin livrée avec son licou et sa longe.
Nous avions une vache, mais nous n’avions plus un sou, pas un seul pour la nourrir et nous nourrir nous-mêmes.
— Nous allons travailler, dit Mattia, les cafés sont pleins de monde, en nous divisant nous pouvons jouer dans tous, nous aurons une bonne recette ce soir.
Et après avoir conduit notre vache dans l’écurie de notre auberge où nous l’attachâmes avec plusieurs nœuds, nous nous mîmes à travailler chacun de notre côté, et le soir quand nous fîmes le compte de notre recette, je trouvai que celle de Mattia était de quatre francs cinquante centimes et la mienne de trois francs.
Avec sept francs cinquante centimes nous étions riches.
Mais la joie d’avoir gagné ces sept francs cinquante était bien petite comparée à la joie que nous éprouvions d’en avoir dépensé deux cent quatorze.
Nous décidâmes la fille de cuisine à traire notre vache, et nous soupâmes avec son lait : jamais nous n’en avions bu d’aussi bon, Mattia déclara qu’il était sucré et qu’il sentait la fleur d’oranger, comme celui qu’il avait bu à l’hôpital, mais bien meilleur.
Et dans notre enthousiasme nous allâmes embrasser notre vache sur son mufle noir ; sans doute elle fut sensible à cette caresse, car elle nous lécha la figure de sa langue rude.
— Tu sais qu’elle embrasse, s’écria Mattia ravi.
Pour comprendre le bonheur que nous éprouvions à embrasser notre vache et à être embrassés par elle, il faut se rappeler que ni Mattia ni moi, nous n’étions gâtés par les embrassades : notre sort n’était pas celui des enfants choyés, qui ont à se défendre contre les caresses de leurs mères ; et tous deux cependant nous aurions bien aimé à nous faire caresser.
Le lendemain matin nous étions levés avec le soleil, et tout de suite nous nous mettions en route pour Chavanon.
Comme j’étais reconnaissant à Mattia du concours qu’il m’avait prêté, car sans lui je n’aurais jamais amassé cette grosse somme de deux cent quatorze francs, j’avais voulu lui donner le plaisir de conduire notre vache, et il n’avait pas été médiocrement heureux de la tirer par la longe, tandis que je marchais derrière elle. Ce fut seulement quand nous fûmes sortis de la ville que je vins prendre place à côté de lui, pour causer comme à l’ordinaire et surtout pour regarder ma vache : jamais je n’en avais vu une aussi belle.
Et de vrai elle avait fort bon air, marchant lentement en se balançant, en se prélassant comme une bête qui a conscience de sa valeur.
Maintenant je n’avais plus besoin de regarder ma carte à chaque instant comme je le faisais depuis notre départ de Paris : je savais où j’allais, et bien que plusieurs années se fussent écoulées depuis que j’avais passé là avec Vitalis, je retrouvais tous les accidents de la route.
Mon intention, pour ne pas fatiguer notre vache, et aussi pour ne pas arriver trop tard à Chavanon, était d’aller coucher dans le village où j’avais passé ma première nuit de voyage avec Vitalis, dans ce lit de fougère, où le bon Capi voyant mon chagrin était venu s’allonger près de moi et avait mis sa patte dans ma main pour me dire qu’il serait mon ami. De là nous partirions le lendemain matin pour arriver de bonne heure chez mère Barberin.
Mais le sort qui, jusque-là nous avait été si favorable, se mit contre nous et changea nos dispositions.
Nous avions décidé de partager notre journée de marche en deux parts, et de la couper par notre déjeuner, surtout par le déjeuner de notre vache qui consisterait en herbe des fossés de la route qu’elle paîtrait.
Vers dix heures, ayant trouvé un endroit où l’herbe était verte et épaisse, nous mîmes les sacs à bas, et nous fîmes descendre notre vache dans le fossé.
Tout d’abord je voulus la tenir par la longe, mais elle se montra si tranquille, et surtout si appliquée à paître, que bientôt je lui entortillai la longe autour des cornes, et m’assis près d’elle pour manger mon pain.
Naturellement nous eûmes fini de manger bien avant elle ; alors après l’avoir admirée pendant assez longtemps, ne sachant plus que faire, nous nous mîmes à jouer aux billes Mattia et moi, car il ne faut pas croire que nous étions deux petits bonshommes graves et sérieux, ne pensant qu’à gagner de l’argent : si nous menions une vie qui n’est point ordinairement celle des enfants de notre âge, nous n’en avions pas moins les goûts et les idées de notre jeunesse, c’est-à-dire que nous aimions à jouer aux jeux des enfants, et que nous ne laissions point passer une journée sans faire une partie de billes, de balle ou de saut de mouton. Tout à coup, sans raison bien souvent, Mattia me disait : « Jouons-nous ? » Alors, en un tour de main, nous nous débarrassions de nos sacs, de nos instruments, et sur la route nous nous mettions à jouer ; et plus d’une fois, si je n’avais pas eu ma montre pour me rappeler l’heure, nous aurions joué jusqu’à la nuit ; mais elle me disait que j’étais chef de troupe, qu’il fallait travailler, gagner de l’argent pour vivre ; et alors je repassais sur mon épaule endolorie la bretelle de ma harpe : en avant !
Nous eûmes fini de jouer avant que la vache eût fini de paître, et quand elle nous vit venir à elle, elle se mit à tondre l’herbe à grands coups de langue, comme pour nous dire qu’elle avait encore faim.
— Attendons un peu, dit Mattia.
— Tu ne sais donc pas qu’une vache mange toute la journée ?
— Un tout petit peu.
Tout en attendant, nous reprîmes nos sacs et nos instruments.
— Si je lui jouais un petit air de cornet à piston ? dit Mattia qui restait difficilement en repos ; nous avions une vache dans le cirque Gassot, et elle aimait la musique.
Et sans en demander davantage, Mattia se mit à jouer une fanfare de parade.
Aux premières notes, notre vache leva la tête ; puis tout à coup, avant que j’eusse pu me jeter à ses cornes pour prendre sa longe, elle partit au galop.
Et aussitôt nous partîmes après elle, galopant aussi de toutes nos forces en l’appelant.
Je criai à Capi de l’arrêter, mais on ne peut pas avoir tous les talents : un chien de conducteur de bestiaux eût sauté au nez de notre vache ; Capi, qui était un savant, lui sauta aux jambes.
Bien entendu cela ne l’arrêta pas, tout au contraire, et nous continuâmes notre course, elle en avant, nous en arrière.
Tout en courant j’appelais Mattia : « Stupide bête » ; et lui, sans s’arrêter, me criait d’une voix haletante : « Tu cogneras, je l’ai mérité. »
C’était deux kilomètres environ avant d’arriver à un gros village que nous nous étions arrêtés pour manger, et c’était vers ce village que notre vache galopait. Elle entra dans ce village naturellement avant nous, et comme la route était droite, nous pûmes voir, malgré la distance, que des gens lui barraient le passage et s’emparaient d’elle.
Alors nous ralentîmes un peu notre course : notre vache ne serait pas perdue ; nous n’aurions qu’à la réclamer aux braves gens qui l’avaient arrêtée, et ils nous la rendraient.
À mesure que nous avancions, le nombre des gens augmentait autour de notre vache, et quand nous arrivâmes enfin près d’elle, il y avait là une vingtaine d’hommes, de femmes ou d’enfants qui discutaient en nous regardant venir.
Je m’étais imaginé que je n’avais qu’à réclamer ma vache, mais au lieu de me la donner, on nous entoura et l’on nous posa question sur question : « D’où venions-nous, où avions-nous eu cette vache ? »
Nos réponses étaient aussi simples que faciles ; cependant elles ne persuadèrent pas ces gens, et deux ou trois voix s’élevèrent pour dire que nous avions volé cette vache qui nous avait échappé, et qu’il fallait nous mettre en prison en attendant que l’affaire s’éclaircît.
L’horrible frayeur que le mot de prison m’inspirait me troubla et nous perdit : je pâlis, je balbutiai, et comme notre course avait rendu ma respiration haletante, je fus incapable de me défendre.
Sur ces entrefaites, un gendarme arriva ; en quelques mots on lui conta notre affaire, et comme elle ne lui parut pas nette, il déclara qu’il allait mettre notre vache en fourrière et nous en prison : on verrait plus tard.
Je voulus protester, Mattia voulut parler, le gendarme nous imposa durement silence ; et me rappelant la scène de Vitalis avec l’agent de police de Toulouse, je dis à Mattia de se taire et de suivre monsieur le gendarme.
Tout le village nous fit cortège jusqu’à la mairie où se trouvait la prison : on nous entourait, on nous pressait, on nous poussait, on nous bourrait, on nous injuriait, et je crois bien que sans le gendarme, qui nous protégeait, on nous aurait lapidés comme si nous étions de grands coupables, des assassins ou des incendiaires. Et cependant nous n’avions commis aucun crime. Mais les foules sont souvent ainsi, elles ont un plaisir sauvage à se ruer sur les malheureux, sans savoir ce qu’ils ont fait, s’ils sont coupables ou innocents.
En arrivant à la prison, j’eus un moment d’espérance : le gardien de la mairie qui était aussi geôlier et garde champêtre, ne voulut pas tout d’abord nous recevoir. Je me dis que c’était là un brave homme. Mais le gendarme insista, et le geôlier céda ; passant devant nous, il ouvrit une porte qui fermait en dehors avec une grosse serrure et deux verrous : je vis alors pourquoi il avait fait difficulté pour nous recevoir tout d’abord : c’était parce qu’il avait mis sa provision d’oignons sécher dans la prison, en les étalant sur le plancher. On nous fouilla ; on nous prit notre argent, nos couteaux, nos allumettes, et pendant ce temps, le geôlier amassa vivement tous ses oignons dans un coin. Alors on nous laissa et la porte se referma sur nous avec un bruit de ferraille vraiment tragique.
Nous étions en prison. Pour combien de temps ?
Comme je me posais cette question, Mattia vint se mettre devant moi et baissant la tête :
— Cogne, dit-il, cogne sur la tête, tu ne frapperas jamais assez fort pour ma bêtise.
— Tu as fait la bêtise, et j’ai laissé la faire, j’ai été aussi bête que toi.
— J’aimerais mieux que tu cognes, j’aurais moins de chagrin : notre pauvre vache, la vache du prince !
Et il se mit à pleurer.
Alors ce fut à moi de le consoler en lui expliquant que notre position n’était pas bien grave, nous n’avions rien fait, et il ne nous serait pas difficile de prouver que nous avions acheté notre vache, le bon vétérinaire d’Ussel serait notre témoin.
— Et si l’on nous accuse d’avoir volé l’argent avec lequel nous avons payé notre vache, comment prouverons-nous que nous l’avons gagné ? tu vois bien que quand on est malheureux, on est coupable de tout.
Mattia avait raison, je ne savais que trop bien qu’on est dur aux malheureux ; les cris qui venaient de nous accompagner jusqu’à la prison ne le prouvaient-ils pas encore ?
— Et puis, dit Mattia en continuant de pleurer, quand nous sortirons de cette prison, quand on nous rendrait notre vache, est-il certain que nous trouverons mère Barberin ?
— Pourquoi ne la trouverions-nous pas ?
— Depuis le temps que tu l’as quittée, elle a pu mourir.
Je fus frappé au cœur par cette crainte : c’était vrai que mère Barberin avait pu mourir, car bien que n’étant pas d’un âge où l’on admet facilement l’idée de la mort, je savais par expérience qu’on peut perdre ceux qu’on aime ; n’avais-je pas perdu Vitalis ? Comment cette idée ne m’était-elle pas venue déjà.
— Pourquoi ne m’as-tu pas dit cela plus tôt ? demandai-je.
— Parce que, quand je suis heureux, je n’ai que des idées gaies dans ma tête stupide, tandis que quand je suis malheureux je n’ai que des idées tristes. Et j’étais si heureux à la pensée d’offrir ta vache à ta mère Barberin que je ne voyais que le contentement de mère Barberin, je ne voyais que le nôtre et j’étais ébloui, comme grisé.
— Ta tête n’est pas plus stupide que la mienne, mon pauvre Mattia, car je n’ai pas eu d’autres idées que les tiennes ; comme toi aussi j’ai été ébloui et grisé.
— Ah ! ah ! la vache du prince ! s’écria Mattia en pleurant, il est beau le prince !
Puis tout à coup se levant brusquement en gesticulant :
— Si mère Barberin était morte, et si l’affreux Barberin était vivant, s’il nous prenait notre vache, s’il te prenait toi-même ?
Assurément c’était l’influence de la prison qui nous inspirait ces tristes pensées, c’étaient les cris de la foule, c’était le gendarme, c’était le bruit de la serrure et des verrous quand on avait fermé la porte sur nous.
Mais ce n’était pas seulement à nous que Mattia pensait, c’était aussi à notre vache.
— Qui va lui donner à manger ? qui va la traire ?
Plusieurs heures se passèrent dans ces tristes pensées, et plus le temps marchait, plus nous nous désolions.
J’essayai cependant de réconforter Mattia en lui expliquant qu’on allait venir nous interroger.
— Eh bien ; que dirons-nous ?
— La vérité.
— Alors on va te remettre entre les mains de Barberin, ou bien si mère Barberin est seule chez elle, on va l’interroger aussi pour savoir si nous ne mentons pas, nous ne pourrons donc plus lui faire notre surprise.
Enfin notre porte s’ouvrit avec un terrible bruit de ferraille et nous vîmes entrer un vieux monsieur à cheveux blancs dont l’air ouvert et bon nous rendit tout de suite l’espérance.
— Allons, coquins, levez-vous, dit le geôlier, et répondez à M. le juge de paix.
— C’est bien, c’est bien, dit le juge de paix en faisant signe au geôlier de le laisser seul, je me charge d’interroger celui-là, — il me désigna du doigt, — emmenez l’autre et gardez-le ; je l’interrogerai ensuite.
Je crus que dans ces conditions je devais avertir Mattia de ce qu’il avait à répondre.
— Comme moi, monsieur le juge de paix, dis-je, il vous racontera la vérité, toute la vérité.
— C’est bien, c’est bien, interrompit vivement le juge de paix comme s’il voulait me couper la parole.
Mattia sortit, mais avant il eut le temps de me lancer un rapide coup d’œil pour me dire qu’il m’avait compris.
— On vous accuse d’avoir volé une vache, me dit le juge de paix en me regardant dans les deux yeux.
Je répondis que nous avions acheté cette vache à la foire d’Ussel, et je nommai le vétérinaire qui nous avait assistés dans cet achat.
— Cela sera vérifié.
— Je l’espère, car ce sera cette vérification qui prouvera notre innocence.
— Et dans quelle intention avez-vous acheté une vache ?
— Pour la conduire à Chavanon et l’offrir à la femme qui a été ma mère nourrice, en reconnaissance de ses soins et en souvenir de mon affection pour elle.
— Et comment se nomme cette femme ?
— Mère Barberin.
— Est-ce la femme d’un ouvrier maçon qui, il y a quelques années, a été estropié à Paris ?
— Oui, monsieur le juge de paix.
— Cela aussi sera vérifié.
Mais je ne répondis pas à cette parole comme je l’avais fait pour le vétérinaire d’Ussel.
Voyant mon embarras, le juge de paix me pressa de questions et je dus répondre que s’il interrogeait mère Barberin le but que nous nous étions proposé se trouvait manqué : il n’y avait plus de surprise.
Cependant au milieu de mon embarras j’éprouvais une vive satisfaction : puisque le juge de paix connaissait mère Barberin et qu’il s’informerait auprès d’elle de la vérité ou de la fausseté de mon récit, cela prouvait que mère Barberin était toujours vivante.
J’en éprouvai bientôt une plus grande encore ; au milieu de ces questions le juge de paix me dit que Barberin était retourné à Paris depuis quelque temps.
Cela me rendit si joyeux que je trouvai des paroles persuasives pour le convaincre que la déposition du vétérinaire devait suffire pour prouver que nous n’avions pas volé notre vache.
— Et où avez-vous eu l’argent nécessaire pour acheter cette vache ?
C’était là la question qui avait si fort effrayé Mattia quand il avait prévu qu’elle nous serait adressée.
— Nous l’avons gagné.
— Où ? Comment ?
J’expliquai comment, depuis Paris jusqu’à Varses et depuis Varses jusqu’au Mont-Dore, nous l’avions gagné et amassé sou à sou.
— Et qu’alliez-vous faire à Varses ?
Cette question m’obligea à un nouveau récit ; quand le juge de paix entendit que j’avais été enseveli dans la mine de la Truyère, il m’arrêta et d’une voix toute adoucie, presque amicale :
— Lequel de vous deux est Rémi ? dit-il.
— Moi, monsieur le juge de paix.
— Qui le prouve ? Tu n’as pas de papiers, m’a dit le gendarme.
— Non, monsieur le juge de paix.
— Allons, raconte-moi comment est arrivée la catastrophe de Varses ; j’en ai lu le récit dans les journaux, si tu n’es pas vraiment Rémi, tu ne me tromperas pas ; je t’écoute, fais donc attention.
Le tutoiement du juge de paix m’avait donné du courage : je voyais bien qu’il ne nous était pas hostile.
Quand j’eus achevé mon récit, le juge de paix me regarda longuement avec des yeux doux et attendris. Je m’imaginais qu’il allait me dire qu’il nous rendait la liberté, mais il n’en fut rien : sans m’adresser la parole, il me laissa seul. Sans doute il allait interroger Mattia pour voir si nos deux récits s’accorderaient.
Je restai assez longtemps livré à mes réflexions, mais à la fin le juge de paix revint avec Mattia.
— Je vais faire prendre des renseignements à Ussel, dit-il, et si comme je l’espère ils confirment vos récits, demain on vous mettra en liberté.
— Et notre vache ? demanda Mattia.
— On vous la rendra.
— Ce n’est pas cela que je voulais dire, répliqua Mattia, qui va lui donner à manger, qui va la traire ?
— Sois tranquille, gamin.
Mattia aussi était rassuré.
— Si on trait notre vache, dit-il en souriant, est-ce qu’on ne pourrait pas nous donner le lait ? cela serait bien bon pour notre souper.
Aussitôt que le juge de paix fut parti, j’annonçai à Mattia les deux grandes nouvelles qui m’avaient fait oublier que nous étions en prison : mère Barberin vivante, et Barberin à Paris.
— La vache du prince fera son entrée triomphale, dit Mattia.
Et dans sa joie il se mit à danser en chantant ; je lui pris les mains, entraîné par sa gaîté, et Capi qui jusqu’alors était resté dans un coin triste et inquiet, vint se placer au milieu de nous debout sur ses deux pattes de derrière ; alors nous nous livrâmes à une si belle danse que le concierge effrayé, — pour ses oignons probablement, — vint voir si nous ne nous révoltions pas.
Il nous engagea à nous taire, mais il ne nous adressa pas la parole brutalement comme lorsqu’il était entré avec le juge de paix.
Par là nous comprîmes que notre position n’était pas mauvaise, et bientôt nous eûmes la preuve que nous ne nous étions pas trompés, car il ne tarda pas à rentrer, nous apportant une grande terrine toute pleine de lait, — le lait de notre vache, — mais ce n’était pas tout, avec la terrine, il nous donna un gros pain blanc et un morceau de veau froid qui, nous dit-il, nous était envoyé par M. le juge de paix.
Jamais prisonniers n’avaient été si bien traités ; alors en mangeant le veau et en buvant le lait je revins de mes idées sur les prisons ; décidément elles valaient mieux que je ne me l’étais imaginé.
Ce fut aussi le sentiment de Mattia :
— Dîner et coucher sans payer, dit-il en riant, en voilà une chance !
Je voulus lui faire une peur.
— Et si le vétérinaire était mort tout à coup, lui dis-je, qui témoignerait pour nous ?
— On n’a de ces idées-là que quand on est malheureux, dit-il sans se fâcher, et ce n’est vraiment pas le moment.
IX
MÈRE BARBERIN
Notre nuit sur le lit de camp ne fut pas mauvaise, nous en avions passé de moins agréables à la belle étoile.
— J’ai rêvé de l’entrée de la vache, me dit Mattia.
— Et moi aussi.
À huit heures du matin notre porte s’ouvrit, et nous vîmes entrer le juge de paix, suivi de notre ami le vétérinaire qui avait voulu venir lui-même nous mettre en liberté.
Quant au juge de paix, sa sollicitude pour deux prisonniers innocents ne se borna pas seulement au dîner qu’il nous avait offert la veille ; il me remit un beau papier timbré :
— Vous avez été des fous, me dit-il amicalement, de vous embarquer ainsi sur les grands chemins ; voici un passe-port que je vous ai fait délivrer par le maire, ce sera votre sauvegarde désormais. Bon voyage, les enfants.
Et il nous donna une poignée de main ; quant au vétérinaire il nous embrassa.
Nous étions entrés misérablement dans ce village, nous en sortîmes triomphalement, menant notre vache par la longe et marchant la tête haute, en regardant par-dessus nos épaules les paysans qui se tenaient sur leurs portes.
— Je ne regrette qu’une chose, dit Mattia, c’est que le gendarme qui a jugé bon de nous arrêter ne soit pas là pour nous voir passer.
— Le gendarme a eu tort, mais nous aussi nous avons eu tort de croire que ceux qui étaient malheureux n’avaient rien à attendre de bon.
— C’est parce que nous n’étions pas tout à fait malheureux que nous avons eu du bon ; quand on a cinq francs dans sa poche, on n’est pas tout à fait malheureux.
— Tu pouvais dire cela hier, aujourd’hui cela ne t’est pas permis ; tu vois qu’il y a de braves gens en ce monde.
Nous avions reçu une trop belle leçon pour avoir l’idée d’abandonner la longe de notre vache ; elle était douce, notre vache, cela était vrai, mais aussi peureuse.
Nous ne tardâmes pas à atteindre le village où j’avais couché avec Vitalis ; de là nous n’avions plus qu’une grande lande à traverser pour arriver à la côte qui descend à Chavanon.
En passant par la rue de ce village et justement devant la maison où Zerbino avait volé une croûte, une idée me vint que je m’empressai de communiquer à Mattia.
— Tu sais que je t’ai promis des crêpes chez mère Barberin ; mais, pour faire des crêpes, il faut du beurre, de la farine et des œufs.
— Cela doit être joliment bon.
— Je crois bien que c’est bon, tu verras ; ça se roule et on s’en met plein la bouche ; mais il n’y a peut-être pas de beurre, ni de farine chez mère Barberin, car elle n’est pas riche ; si nous lui en portions ?
— C’est une fameuse idée.
— Alors, tiens la vache, surtout ne la lâche pas ; je vais entrer chez cet épicier et acheter du beurre et de la farine. Quant aux œufs, si la mère Barberin n’en a pas, elle en empruntera ; car nous pourrions les casser en route.
J’entrai dans l’épicerie où Zerbino avait volé sa croûte et j’achetai une livre de beurre, ainsi que deux livres de farine ; puis nous reprîmes notre marche.
J’aurais voulu ne pas presser notre vache, mais j’avais si grande hâte d’arriver que malgré moi j’allongeais le pas.
Encore dix kilomètres, encore huit, encore six : chose curieuse, la route me paraissait plus longue en me rapprochant de mère Barberin, que le jour où je m’étais éloigné d’elle, et cependant, ce jour-là, il tombait une pluie froide dont j’avais gardé le souvenir.
Mais j’étais tout ému, tout fiévreux, et à chaque instant je regardais l’heure à ma montre.
— N’est-ce pas un beau pays ? disais-je à Mattia.
— Ce ne sont pas les arbres qui gênent la vue.
— Quand nous descendrons la côte vers Chavanon, tu en verras des arbres, et des beaux, des chênes, des châtaigniers.
— Avec des châtaignes ?
— Parbleu ! Et puis, dans la cour de mère Barberin il y a un poirier crochu sur lequel on joue au cheval, qui donne des poires grosses comme ça ; et bonnes : tu verras.
Et pour chaque chose que je lui décrivais, c’était là mon refrain : Tu verras. De bonne foi je m’imaginais que je conduisais Mattia dans un pays de merveilles. Après tout, n’en était-ce pas un pour moi ? C’était là que mes yeux s’étaient ouverts à la lumière. C’était là que j’avais eu le sentiment de la vie, là que j’avais été si heureux ; là que j’avais été aimé. Et toutes ces impressions de mes premières joies, rendues plus vives par le souvenir des souffrances de mon existence aventureuse, me revenaient, se pressant tumultueusement dans mon cœur et dans ma tête à mesure que nous approchions de mon village. Il semblait que l’air natal avait un parfum qui me grisait : je voyais tout en beau.
Et, gagné par cette griserie, Mattia retournait aussi, mais en imagination seulement, hélas ! dans le pays où il était né.
— Si tu venais à Lucca, disait-il, je t’en montrerais aussi des belles choses ; tu verrais.
— Mais nous irons à Lucca quand nous aurons vu Étiennette, Lise et Benjamin.
— Tu veux bien venir à Lucca ?
— Tu es venu avec moi chez mère Barberin, j’irai avec toi voir ta mère et ta petite sœur Cristina, que je porterai dans mes bras si elle n’est pas trop grande ; elle sera ma sœur aussi.
— Oh ! Rémi !
Et il n’en put pas dire davantage tant il était ému.
En parlant ainsi et en marchant toujours à grands pas, nous étions arrivés au haut de la colline où commence la côte qui par plusieurs lacets conduit à Chavanon, en passant devant la maison de mère Barberin.
Encore quelques pas, et nous touchions à l’endroit où j’avais demandé à Vitalis la permission de m’asseoir sur le parapet pour regarder la maison de mère Barberin, que je pensais ne jamais revoir.
— Prends la longe, dis-je à Mattia.
Et d’un bond je sautai sur le parapet ; rien n’avait changé dans notre vallée ; elle avait toujours le même aspect ; entre ses deux bouquets d’arbres, j’aperçus le toit de la maison de mère Barberin.
— Qu’as-tu donc ? demanda Mattia.
— Là, là.
Il vint près de moi, mais sans monter sur le parapet dont notre vache se mit à brouter l’herbe.
— Suis ma main, lui dis-je ; voilà la maison de mère Barberin, voilà mon poirier, là était mon jardin.
Mattia, qui ne regardait pas avec ses souvenirs comme moi, ne voyait pas grand’chose, mais il n’en disait rien.
À ce moment, un petit flocon de fumée jaune s’éleva au-dessus de la cheminée, et, comme le vent ne soufflait pas, elle monta droit dans l’air le long du flanc de la colline.
— Mère Barberin est chez elle, dis-je.
Une légère brise passa dans les arbres, et, abattant la colonne de fumée, elle nous la jeta dans le visage : cette fumée sentait les feuilles de chêne.
Alors tout à coup je sentis les larmes m’emplir les yeux et, sautant à bas du parapet, j’embrassai Mattia. Capi se jeta sur moi, et, le prenant dans mes bras, je l’embrassai aussi.
— Descendons vite, dis-je.
— Si mère Barberin est chez elle, comment allons-nous arranger notre surprise ? demanda Mattia.
— Tu vas entrer seul, tu diras que tu lui amènes une vache de la part du prince, et quand elle te demandera de quel prince il s’agit, je paraîtrai.
— Quel malheur que nous ne puissions pas faire une entrée en musique : voilà qui serait joli !
— Mattia, pas de bêtises.
— Sois tranquille, je n’ai pas envie de recommencer, mais c’est égal, si cette sauvage-là aimait la musique, une fanfare aurait été joliment en situation.
Comme nous arrivions à l’un des coudes de la route qui se trouvait juste au-dessus de la maison de mère Barberin, nous vîmes une coiffe blanche apparaître dans la cour : c’était mère Barberin, elle ouvrit la barrière et sortant sur la route, elle se dirigea du côté du village.
Nous étions arrêtés et je l’avais montrée à Mattia.
— Elle s’en va, dit-il, et notre surprise ?
— Nous allons en inventer une autre.
— Laquelle ?
— Je ne sais pas.
— Si tu l’appelais ?
La tentation fut vive, cependant j’y résistai ; je m’étais pendant plusieurs mois fait la fête d’une surprise, je ne pouvais pas y renoncer ainsi tout à coup.
Nous ne tardâmes pas à arriver devant la barrière de mon ancienne maison, et nous entrâmes comme j’entrais autrefois.
Connaissant bien les habitudes de mère Barberin, je savais que la porte ne serait fermée qu’à la clenche et que nous pourrions entrer dans la maison ; mais avant tout il fallait mettre notre vache à l’étable. J’allai donc voir dans quel état était cette étable, et je la trouvai telle qu’elle était autrefois, encombrée seulement de fagots. J’appelai Mattia et après avoir attaché notre vache devant l’auge, nous nous occupâmes à entasser vivement ces fagots dans un coin, ce qui ne fut pas long, car elle n’était pas bien abondante la provision de bois de mère Barberin.
— Maintenant, dis-je à Mattia, nous allons entrer dans la maison, je m’installerai au coin du feu pour que mère Barberin me trouve là ; comme la barrière grincera lorsqu’elle la poussera pour rentrer, tu auras le temps de te cacher derrière le lit avec Capi, et elle ne verra que moi ; crois-tu qu’elle sera surprise !
Les choses s’arrangèrent ainsi. Nous entrâmes dans la maison, et j’allai m’asseoir dans la cheminée, à la place où j’avais passé tant de soirées d’hiver. Comme je ne pouvais pas couper mes longs cheveux, je les cachai sous le col de ma veste, et, me pelotonnant je me fis tout petit pour ressembler autant que possible au Rémi, au petit Rémi de mère Barberin.
De ma place je voyais la barrière, et il n’y avait pas à craindre que mère Barberin nous arrivât sur le dos à l’improviste.
Ainsi installé, je pus regarder autour de moi. Il me sembla que j’avais quitté la maison la veille seulement : rien n’était changé, tout était à la même place, et le papier avec lequel un carreau cassé par moi avait été raccommodé n’avait pas été remplacé, bien que terriblement enfumé et jauni.
Si j’avais osé quitter ma place j’aurais eu plaisir à voir de près chaque objet, mais comme mère Barberin pouvait survenir d’un moment à l’autre, il me fallait rester en observation.
Tout à coup j’aperçus une coiffe blanche, en même temps la hart qui soutenait la barrière craqua.
— Cache-toi vite, dis-je à Mattia.
Je me fis de plus en plus petit.
La porte s’ouvrit : du seuil mère Barberin m’aperçut.
— Qui est là ? dit-elle.
Je la regardai sans répondre, et de son côté elle me regarda aussi.
Tout à coup ses mains furent agitées par un tremblement :
— Mon Dieu, murmura-t-elle, mon Dieu, est-ce possible, Rémi !
Je me levai et courant à elle, je la pris dans mes bras.
— Maman !
— Mon garçon, c’est mon garçon !
Il nous fallut plusieurs minutes pour nous remettre et pour nous essuyer les yeux.
— Bien sûr, dit-elle, que si je n’avais pas toujours pensé à toi je ne t’aurais pas reconnu ; es-tu changé, grandi, forci !
Un reniflement étouffé me rappela que Mattia était caché derrière le lit, je l’appelai ; il se releva.
— Celui-là c’est Mattia, dis-je, mon frère.
— Ah ! tu as donc retrouvé tes parents ? s’écria mère Barberin.
— Non, je veux dire que c’est mon camarade, mon ami, et voilà Capi, mon camarade aussi et mon ami ; salue la mère de ton maître, Capi !
Capi se dressa sur ses deux pattes de derrière et ayant mis une de ses pattes de devant sur son cœur il s’inclina gravement, ce qui fit beaucoup rire mère Barberin et sécha ses larmes.
Mattia, qui n’avait pas les mêmes raisons que moi pour s’oublier, me fit un signe pour me rappeler notre surprise.
— Si tu voulais, dis-je à mère Barberin, nous irions un peu dans la cour ; c’est pour voir le poirier crochu dont j’ai souvent parlé à Mattia.
— Nous pouvons aussi aller voir ton jardin, car je l’ai gardé tel que tu l’avais arrangé, pour que tu le retrouves quand tu reviendrais, car j’ai toujours cru et contre tous que tu reviendrais.
— Et les topinambours que j’avais plantés, les as-tu trouvés bons ?
— C’était donc toi qui m’avais fait cette surprise, je m’en suis doutée : tu as toujours aimé à faire des surprises.
Le moment était venu.
— Et l’étable à vache, dis-je, a-t-elle changé depuis le départ de la pauvre Roussette, qui était comme moi et qui ne voulait pas s’en aller ?
— Non, bien sûr, j’y mets mes fagots.
Comme nous étions justement devant l’étable mère Barberin en poussa la porte, et instantanément notre vache, qui avait faim, et qui croyait sans doute qu’on lui apportait à manger, se mit à meugler.
— Une vache, une vache dans l’étable ! s’écria mère Barberin.
Alors n’y tenant plus, Mattia et moi, nous éclatâmes de rire.
Mère Barberin nous regarda bien étonnée, mais c’était une chose si invraisemblable que l’installation de cette vache dans l’étable, que malgré nos rires, elle ne comprit pas.
— C’est une surprise, dis-je, une surprise que nous te faisons, et elle vaut bien celle des topinambours, n’est-ce pas ?
— Une surprise, répéta-t-elle, une surprise !
— Je n’ai pas voulu revenir les mains vides chez mère Barberin, qui a été si bonne pour son petit Rémi, l’enfant abandonné ; alors, en cherchant ce qui pourrait être le plus utile, j’ai pensé que ce serait une vache pour remplacer la Roussette, et à la foire d’Ussel nous avons acheté celle-là avec l’argent que nous avons gagné, Mattia et moi.
— Oh ! le bon enfant, le cher garçon ! s’écria mère Barberin en m’embrassant.
Puis nous entrâmes dans l’étable pour que mère Barberin pût examiner notre vache, qui maintenant était sa vache. À chaque découverte que mère Barberin faisait, elle poussait des exclamations de contentement et d’admiration :
— Quelle belle vache !
Tout à coup elle s’arrêta et me regardant :
— Ah çà ! tu es donc devenu riche ?
— Je crois bien, dit Mattia en riant, il nous reste cinquante-huit sous.
Et mère Barberin répéta son refrain, mais avec une variante :
— Les bons garçons !
Cela me fut une douce joie de voir qu’elle pensait à Mattia, et qu’elle nous réunissait dans son cœur.
Pendant ce temps, notre vache continuait de meugler.
— Elle demande qu’on veuille bien la traire, dit Mattia.
Sans en écouter davantage je courus à la maison chercher le seau de fer-blanc bien récuré, dans lequel on trayait autrefois la Roussette et que j’avais vu accroché à sa place ordinaire, bien que depuis longtemps il n’y eût plus de vache à l’étable chez mère Barberin. En revenant je l’emplis d’eau, afin qu’on pût laver la mamelle de notre vache, qui était pleine de poussière.
Quelle satisfaction pour mère Barberin quand elle vit son seau aux trois quarts rempli d’un beau lait mousseux.
— Je crois qu’elle donnera plus de lait que la Roussette, dit-elle.
— Et quel bon lait, dit Mattia, il sent la fleur d’oranger.
Mère Barberin regarda Mattia avec curiosité, se demandant bien manifestement ce que c’était que la fleur d’oranger.
— C’est une bonne chose qu’on boit à l’hôpital quand on est malade, dit Mattia qui aimait à ne pas garder ses connaissances pour lui tout seul.
La vache traite, on la lâcha dans la cour pour qu’elle pût paître, et nous rentrâmes à la maison où, en venant chercher le seau, j’avais préparé sur la table, en belle place, notre beurre et notre farine.
Quand mère Barberin aperçut cette nouvelle surprise elle recommença ses exclamations, mais je crus que la franchise m’obligeait à les interrompre :
— Celle-là, dis-je, est pour nous au moins autant que pour toi ; nous mourons de faim et nous avons envie de manger des crêpes ; te rappelles-tu comment nous avons été interrompus le dernier mardi-gras que j’ai passé ici, et comment le beurre que tu avais emprunté pour me faire des crêpes a servi à fricasser des oignons dans la poêle : cette fois, nous ne serons pas dérangés.
— Tu sais donc que Barberin est à Paris ? demanda mère Barberin.
— Oui.
— Et sais-tu aussi ce qu’il est allé faire à Paris ?
— Non.
— Cela a de l’intérêt pour toi.
— Pour moi ? dis-je effrayé.
Mais avant de répondre, mère Barberin regarda Mattia comme si elle n’osait parler devant lui.
— Oh ! tu peux parler devant Mattia, dis-je, je t’ai expliqué qu’il était un frère pour moi, tout ce qui m’intéresse l’intéresse aussi.
— C’est que cela est assez long à expliquer, dit-elle.
Je vis qu’elle avait de la répugnance à parler, et ne voulant pas la presser devant Mattia de peur qu’elle refusât, ce qui, me semblait-il, devait peiner celui-ci, je décidai d’attendre pour savoir ce que Barberin était allé faire à Paris.
— Barberin doit-il revenir bientôt ? demandai-je.
— Oh ! non, bien sûr.
— Alors rien ne presse, occupons-nous des crêpes, tu me diras plus tard ce qu’il y a d’intéressant pour moi dans ce voyage de Barberin à Paris ; puisqu’il n’y a pas à craindre qu’il revienne fricasser ses oignons dans notre poêle, nous avons tout le temps à nous. As-tu des œufs ?
— Non, je n’ai plus de poules.
— Nous ne t’avons pas apporté d’œufs parce que nous avions peur de les casser. Ne peux-tu pas aller en emprunter ?
Elle parut embarrassée et je compris qu’elle avait peut-être emprunté trop souvent pour emprunter encore.
— Il vaut mieux que j’aille en acheter moi-même, dis-je, pendant ce temps tu prépareras la pâte avec le lait ; j’en trouverai chez Soquet, n’est-ce pas ? J’y cours. Dis à Mattia de casser ta bourrée, il casse très-bien le bois, Mattia.
Chez Soquet j’achetai non-seulement une douzaine d’œufs, mais encore un petit morceau de lard.
Quand je revins, la farine était délayée avec le lait, et il n’y avait plus qu’à mêler les œufs à la pâte ; il est vrai qu’elle n’aurait pas le temps de lever, mais nous avions trop grande faim pour attendre ; si elle était un peu lourde, nos estomacs étaient assez solides pour ne pas se plaindre.
— Ah ça ! dit mère Barberin tout en battant vigoureusement la pâte, puisque tu es si bon garçon, comment se fait-il que tu ne m’aies jamais donné de tes nouvelles ? Sais-tu que je t’ai cru mort bien souvent, car je me disais, si Rémi était encore de ce monde, il écrirait bien sûr à sa mère Barberin.
— Elle n’était pas toute seule, mère Barberin, il y avait avec elle un père Barberin qui était le maître de la maison, et qui l’avait bien prouvé en me vendant un jour quarante francs à un vieux musicien.
— Il ne faut pas parler de ça, mon petit Rémi.
— Ce n’est pas pour me plaindre, c’est pour t’expliquer comment je n’ai pas osé t’écrire ; j’avais peur, si on me découvrait, qu’on me vendît de nouveau, et je ne voulais pas être vendu. Voilà pourquoi quand j’ai perdu mon pauvre vieux maître, qui était un brave homme, je ne t’ai pas écrit.
— Ah ! il est mort, le vieux musicien ?
— Oui, et je l’ai bien pleuré, car si je sais quelque chose aujourd’hui, si je suis en état de gagner ma vie, c’est à lui que je le dois. Après lui j’ai trouvé des braves gens aussi pour me recueillir et j’ai travaillé chez eux ; mais si je t’avais écrit : « Je suis jardinier à la Glacière, » ne serait-on pas venu m’y chercher, ou bien n’aurait-on pas demandé de l’argent à ces braves gens ? je ne voulais ni l’un ni l’autre.
— Oui, je comprends cela.
— Mais cela ne m’empêchait pas de penser à toi, et quand j’étais malheureux, cela m’est arrivé quelquefois, c’était mère Barberin que j’appelais à mon secours. Le jour où j’ai été libre de faire ce que je voulais, je suis venu l’embrasser, pas tout de suite, cela est vrai, mais on ne fait pas ce qu’on veut, et, j’avais une idée qu’il n’était pas facile de mettre à exécution. Il fallait la gagner, notre vache, avant de te l’offrir et l’argent ne tombait pas dans notre poche en belles pièces de cent sous. Il a fallu en jouer des airs, tout le long du chemin, des gais, des tristes, il a fallu marcher, suer, peiner, se priver ! mais plus on avait de peine, plus on était content, n’est-il pas vrai, Mattia ?
— On comptait l’argent tous les soirs, non-seulement celui qu’on avait gagné dans la journée, mais celui qu’on avait déjà pour voir s’il n’avait pas doublé.
— Ah ! les bons enfants, les bons garçons !
Tout en parlant, tandis que mère Barberin battait la pâte pour nos crêpes et que Mattia cassait la bourrée, je mettais les assiettes, les fourchettes, les verres sur la table, et j’allais à la fontaine emplir la cruche d’eau.
Quand je revins la terrine était pleine d’une belle bouillie jaunâtre, et mère Barberin frottait avec un bouchon de foin vigoureusement la poêle à frire ; dans la cheminée flambait un beau feu clair que Mattia entretenait en y mettant des branches brin à brin ; assis sur son séant dans un coin de l’âtre, Capi regardait ces préparatifs d’un œil attendri, et comme il se brûlait, de temps en temps il levait une patte, tantôt l’une, tantôt l’autre, avec un petit cri ; la violente clarté de la flamme pénétrait jusque dans les coins les plus sombres et je voyais danser les personnages peints sur les rideaux d’indienne du lit, qui si souvent dans mon enfance m’avaient fait peur la nuit, lorsque je m’éveillais par un beau clair de lune.
Mère Barberin mit la poêle au feu, et ayant pris un morceau de beurre au bout de son couteau elle le fit glisser dans la poêle, où il fondit aussitôt.
— Ça sent bon, s’écria Mattia qui se tenait le nez au-dessus du feu sans peur de se brûler.
Le beurre commença à grésiller :
— Il chante, cria Mattia, oh ! il faut que je l’accompagne.
Pour Mattia tout devait se faire en musique ; il prit son violon et doucement en sourdine il se mit à plaquer des accords sur la chanson de la poêle, ce qui fit rire mère Barberin aux éclats.
Mais le moment était trop solennel pour s’abandonner à une gaieté intempestive, avec la cuiller à pot mère Barberin a plongé dans la terrine d’où elle retire la pâte qui coule en longs fils blancs ; elle verse la pâte dans la poêle, et le beurre qui se retire devant cette blanche inondation la frange d’un cercle roux.
À mon tour, je me penche en avant : mère Barberin donne une tape sur la queue de la poêle, puis d’un coup de main elle fait sauter la crêpe au grand effroi de Mattia ; mais il n’y a rien à craindre ; après avoir été faire une courte promenade dans la cheminée, la crêpe retombe dans la poêle sens dessus dessous, montrant sa face rissolée.
Je n’ai que le temps de prendre une assiette et la crêpe glisse dedans.
Elle est pour Mattia qui se brûle les doigts, les lèvres, la langue et le gosier ; mais qu’importe, il ne pense pas à sa brûlure.
— Ah ! que c’est bon ! dit-il la bouche pleine.
C’est à mon tour de tendre mon assiette et de me brûler ; mais, pas plus que Mattia je ne pense à la brûlure.
La troisième crêpe est rissolée, et Mattia avance la main, mais Capi pousse un formidable jappement ; il réclame son tour, et comme c’est justice, Mattia lui offre la crêpe au grand scandale de mère Barberin, qui a pour les bêtes l’indifférence des gens de la campagne, et qui ne comprend pas qu’on donne à un chien « un manger de chrétien. » Pour la calmer, je lui explique que Capi est un savant, et que d’ailleurs il a gagné une part de la vache ; et puis, c’est notre camarade, il doit donc manger comme nous, avec nous, puisqu’elle a déclaré qu’elle ne toucherait pas aux crêpes avant que notre terrible faim ne soit calmée.
Il fallut longtemps avant que cette faim et surtout notre gourmandise fussent satisfaites ; cependant il arriva un moment où nous déclarâmes, d’un commun accord, que nous ne mangerions plus une seule crêpe avant que mère Barberin en eût mangé quelques-unes.
Et alors, ce fut à notre tour de vouloir faire les crêpes nous-mêmes : au mien d’abord, à celui de Mattia ensuite ; mettre le beurre, verser la pâte était assez facile, mais ce que nous n’avions pas c’était le coup de main pour faire sauter la crêpe ; j’en mis une dans les cendres, et Mattia en reçut une autre toute brûlante sur la main.
Quand la terrine fut enfin vidée, Mattia qui s’était très-bien aperçu que mère Barberin ne voulait point parler devant lui, « de ce qui avait de l’intérêt pour moi, » déclara qu’il avait envie de voir un peu comment se conduisait la vache dans la cour, et sans rien écouter, il nous laissa en tête-à-tête, mère Barberin et moi.
Si j’avais attendu jusqu’à ce moment, ce n’était cependant pas sans une assez vive impatience, et il avait vraiment fallu tout l’intérêt que je portais à la confection des crêpes pour ne pas me laisser absorber par ma préoccupation.
Si Barberin était à Paris c’était, me semblait-il, pour retrouver Vitalis et se faire payer par celui-ci les années échues pour mon loyer. Je n’avais donc rien à voir là dedans. Vitalis étant mort, il ne pouvait pas payer, et ce n’était pas à moi qu’on pouvait réclamer quelque chose. Mais si Barberin ne pouvait pas me réclamer d’argent, il pouvait me réclamer moi-même, et ayant mis la main sur moi, il pouvait aussi me placer n’importe où, chez n’importe qui, à condition qu’on lui payerait une certaine somme. Or, cela m’intéressait, et même m’intéressait beaucoup, car j’étais bien décidé à tout faire avant de me résigner à subir l’autorité de l’affreux Barberin ; s’il le fallait, je quitterais la France, je m’en irais en Italie avec Mattia, en Amérique, au bout du monde.
Raisonnant ainsi, je me promis d’être circonspect avec mère Barberin, non pas que j’imaginasse avoir à me défier d’elle, la chère femme, je savais combien elle m’aimait, combien elle m’était dévouée ; mais elle tremblait devant son mari, je l’avais bien vu, et, sans le vouloir, si je causais trop, elle pouvait répéter ce que j’avais dit, et fournir ainsi à Barberin le moyen de me rejoindre, c’est-à-dire de me reprendre. Cela ne serait pas au moins par ma faute, je me tiendrais sur mes gardes.
Quand Mattia fut sorti, j’interrogeai mère Barberin.
— Maintenant que nous sommes seuls, me diras-tu en quoi le voyage de Barberin à Paris est intéressant pour moi ?
— Bien sûr, mon enfant, et avec plaisir encore.
Avec plaisir ! je fus stupéfait.
Avant de continuer, mère Barberin regarda du côté de la porte.
Rassurée elle revint vers moi et à mi-voix, avec le sourire sur le visage :
— Il paraît que ta famille te cherche.
— Ma famille !
— Oui, ta famille, mon Rémi.
— J’ai une famille, moi ? J’ai une famille, mère Barberin, moi l’enfant abandonné !
— Il faut croire que ce n’a pas été volontairement qu’on t’a abandonné, puisque maintenant on te cherche.
— Qui me cherche ? Oh ! mère Barberin, parle, parle vite, je t’en prie.
Puis tout à coup, il me sembla que j’étais fou, et je m’écriai :
— Mais non, c’est impossible, c’est Barberin qui me cherche.
— Oui, sûrement, mais pour ta famille.
— Non, pour lui, pour me reprendre, pour me revendre, mais il ne me reprendra pas.
— Oh ! mon Rémi, comment peux-tu penser que je me prêterais à cela ?
— Il veut te tromper, mère Barberin.
— Voyons, mon enfant, sois raisonnable, écoute ce que j’ai à te dire et ne te fais point ainsi des frayeurs.
— Je me souviens.
— Écoute ce que j’ai entendu moi-même : cela tu le croiras, n’est-ce pas ? Il y aura lundi prochain un mois, j’étais à travailler dans le fournil quand un homme ou pour mieux dire un monsieur entra dans la maison, où se trouvait Barberin à ce moment. — C’est vous qui vous nommez Barberin ? dit le monsieur qui parlait avec l’accent de quelqu’un qui ne serait pas de notre pays. — Oui, répondit Jérôme, c’est moi. — C’est vous qui avez trouvé un enfant à Paris, avenue de Breteuil, et qui vous êtes chargé de l’élever ? — Oui. — Où est cet enfant présentement, je vous prie ? — Qu’est-ce que ça vous fait, je vous prie, répondit Jérôme.
Si j’avais douté de la sincérité de mère Barberin, j’aurais reconnu à l’amabilité de cette réponse de Barberin, qu’elle me rapportait bien ce qu’elle avait entendu.
— Tu sais, continua-t-elle, que de dedans le fournil on entend ce qui se dit ici, et puis il était question de toi, ça me donnait envie d’écouter. Alors comme pour mieux entendre je m’approchais, je marchai sur une branche qui se cassa. — Nous ne sommes donc pas seuls ? dit le monsieur. — C’est ma femme, répondit Jérôme. — Il fait bien chaud ici, dit le monsieur, si vous vouliez nous sortirions pour causer. Ils s’en allèrent tous deux, et ce fut seulement trois ou quatre heures après que Jérôme revint tout seul. Tu t’imagines combien j’étais curieuse de savoir ce qui s’était dit entre Jérôme et ce monsieur qui était peut-être ton père, mais Jérôme ne répondit pas à tout ce que je lui demandai. Il me dit seulement que ce monsieur n’était pas ton père, mais qu’il faisait des recherches pour te retrouver de la part de ta famille.
— Et où est ma famille ! Quelle est-elle ? Ai-je un père ? une mère ?
— Ce fut ce que je demandai comme toi, à Jérôme. Il me dit qu’il n’en savait rien. Puis il ajouta qu’il allait partir pour Paris afin de retrouver le musicien auquel il t’avait loué, et qui lui avait donné son adresse à Paris rue de Lourcine chez un autre musicien appelé Garofoli. J’ai bien retenu tous les noms, retiens-les toi-même.
— Je les connais, sois tranquille : et depuis son départ, Barberin ne t’a rien fait savoir ?
— Non, sans doute il cherche toujours : le monsieur lui avait donné cent francs en cinq louis d’or et depuis il lui aura donné sans doute d’autre argent. Tout cela et aussi les beaux langes dans lesquels tu étais enveloppé lorsqu’on t’a trouvé, est la preuve que tes parents sont riches ; quand je t’ai vu là au coin de la cheminée j’ai cru que tu les avais retrouvés, et c’est pour cela que j’ai cru que ton camarade était ton vrai frère.
À ce moment, Mattia passa devant la porte, je l’appelai :
— Mattia ; mes parents me cherchent, j’ai une famille, une vraie famille.
Mais, chose étrange, Mattia ne parut pas partager ma joie et mon enthousiasme.
Alors je lui fis le récit de ce que mère Barberin venait de me rapporter.
X
L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE FAMILLE
Je dormis peu cette nuit-là ; et cependant combien de fois, en ces derniers temps, m’étais-je fait fête de coucher dans mon lit d’enfant où j’avais passé tant de bonnes nuits, autrefois, sans m’éveiller, blotti dans mon coin, les couvertures tirées jusqu’au menton ; combien de fois aussi lorsque j’avais été obligé de coucher à la belle étoile (qui n’avait pas toujours été belle, hélas !), avais-je regretté cette bonne couverture, glacé par le froid de la nuit, ou transpercé jusqu’aux os par la rosée du matin.
Aussitôt que je fus couché, je m’endormis, car j’étais fatigué de ma journée et aussi de la nuit passée dans la prison, mais je ne tardai pas à me réveiller en sursaut, et alors il me fut impossible de retrouver le sommeil : j’étais trop agité, trop enfiévré.
Ma famille !
Quand le sommeil m’avait gagné, c’était à cette famille que j’avais pensé, et pendant le court espace de temps que j’avais dormi, j’avais rêvé famille, père, mère, frères, sœurs ; en quelques minutes, j’avais vécu avec ceux que je ne connaissais pas encore et que j’avais vus en ce moment pour la première fois ; chose curieuse, Mattia, Lise, mère Barberin, madame Milligan, Arthur, étaient de ma famille, et mon père était Vitalis, il était ressuscité, et il était très-riche ; pendant que nous avions été séparés, il avait eu le temps de retrouver Zerbino et Dolce, qui n’avaient pas été mangés par les loups, comme nous l’avions cru.
Il n’est personne, je crois, qui n’ait eu de ces hallucinations où, dans un court espace de temps, on vit des années entières et où l’on parcourt bien souvent d’incommensurables distances ; tout le monde sait comme, au réveil, subsistent fortes et vivaces les sensations qu’on a éprouvées.
Je revis en m’éveillant tous ceux dont je venais de rêver, comme si j’avais passé la soirée avec eux, et tout naturellement il me fut bien impossible de me rendormir.
Peu à peu cependant les sensations de l’hallucination perdirent de leur intensité, mais la réalité s’imposa à mon esprit pour me tenir encore bien mieux éveillé.
Ma famille me cherchait, mais pour la retrouver c’était à Barberin que je devais m’adresser.
Cette pensée seule suffisait pour assombrir ma joie ; j’aurais voulu que Barberin ne fût pas mêlé à mon bonheur. Je n’avais pas oublié ses paroles à Vitalis lorsqu’il m’avait vendu à celui-ci, et bien souvent je me les étais répétées : « Il y aura du profit pour ceux qui auront élevé cet enfant : si je n’avais pas compté là-dessus, je ne m’en serais jamais chargé. » Cela avait, depuis cette époque, entretenu mes mauvais sentiments à l’égard de Barberin.
Ce n’était pas par pitié que Barberin m’avait ramassé dans la rue, ce n’était pas par pitié non plus qu’il s’était chargé de moi, c’était tout simplement parce que j’étais enveloppé dans de beaux langes, c’était parce qu’il y aurait profit un jour à me rendre à mes parents ; ce jour n’étant pas venu assez vite au gré de son désir, il m’avait vendu à Vitalis ; maintenant il allait me vendre à mon père.
Quelle différence entre le mari et la femme ; ce n’était pas pour l’argent qu’elle m’avait aimée, mère Barberin. Ah ! comme j’aurais voulu trouver un moyen pour que ce fût elle qui eût le profit et non Barberin !
Mais j’avais beau chercher, me tourner et me retourner dans mon lit, je ne trouvais rien et toujours je revenais à cette idée désespérante que ce serait Barberin qui me ramènerait à mes parents, que ce serait lui qui serait remercié, récompensé.
Enfin il fallait bien en passer par là, puisqu’il était impossible de faire autrement, ce serait à moi plus tard, quand je serais riche, de bien marquer la différence que j’établissais dans mon cœur entre la femme et le mari, ce serait à moi de remercier et de récompenser mère Barberin.
Pour le moment je n’avais qu’à m’occuper de Barberin, c’est-à-dire que je devais le chercher et le trouver, car il n’était pas de ces maris qui ne font point un pas sans dire à leur femme où ils vont et où l’on pourra s’adresser si l’on a besoin d’eux ; tout ce que mère Barberin savait, c’était que son homme était à Paris ; depuis son départ il n’avait point écrit, pas plus qu’il n’avait envoyé de ses nouvelles par quelque compatriote, quelque maçon revenant au pays : ces attentions amicales n’étaient point dans ses habitudes.
Où était-il, où logeait-il ? elle ne le savait pas précisément et de façon à pouvoir lui adresser une lettre, mais il n’y avait qu’à le chercher chez deux ou trois logeurs du quartier Mouffetard dont elle connaissait les noms, et on le trouverait certainement chez l’un ou chez l’autre.
Je devais donc partir pour Paris et chercher moi-même celui qui me cherchait.
Assurément c’était pour moi une joie bien grande, bien inespérée d’avoir une famille ; cependant cette joie dans les conditions où elle m’arrivait, n’était pas sans un mélange d’ennuis et même de chagrin.
J’avais espéré que nous pourrions passer plusieurs jours tranquilles, heureux, auprès de mère Barberin, jouer à mes anciens jeux avec Mattia, et voilà que le lendemain même, nous devions nous remettre en route.
En partant de chez mère Barberin, je devais aller au bord de la mer, à Esnandes, voir Étiennette, — il me fallait donc maintenant renoncer à ce voyage et ne point embrasser cette pauvre Étiennette qui avait été si bonne et si affectueuse pour moi.
Après avoir vu Étiennette je devais aller à Dreuzy, dans la Nièvre, pour donner à Lise des nouvelles de son frère et de sa sœur, — il me fallait donc aussi renoncer à Lise comme j’aurais renoncé à Étiennette.
Ce fut à agiter ces pensées que je passai ma nuit presque tout entière, me disant tantôt que je ne devais abandonner ni Étiennette ni Lise, tantôt au contraire que je devais courir à Paris aussi vite que possible pour retrouver ma famille.
Enfin je m’endormis sans m’être arrêté à aucune résolution, et cette nuit, qui, m’avait-il semblé, devait être la meilleure des nuits, fut la plus agitée et la plus mauvaise dont j’aie gardé le souvenir.
Le matin, lorsque nous fûmes tous les trois réunis, mère Barberin, Mattia et moi, autour de l’âtre où sur un feu clair chauffait le lait de notre vache, nous tînmes conseil.
Que devais-je faire ?
Et je racontai mes angoisses, mes irrésolutions de la nuit.
— Il faut aller tout de suite à Paris, dit mère Barberin, tes parents te cherchent, ne retarde pas leur joie.
Et elle développa cette idée en l’appuyant de bien des raisons, qui à mesure qu’elle les expliquait me paraissaient toutes meilleures les unes que les autres.
— Alors nous allons partir pour Paris, dis-je, c’est entendu.
Mais Mattia ne montra aucune approbation pour cette résolution, tout au contraire.
— Tu trouves que nous ne devons pas aller à Paris, lui dis-je, pourquoi ne donnes-tu pas tes raisons comme mère Barberin a donné les siennes ?
Il secoua la tête.
— Tu me vois assez tourmenté pour ne pas hésiter à m’aider.
— Je trouve, dit-il enfin, que les nouveaux ne doivent pas faire oublier les anciens : jusqu’à ce jour ta famille c’était Lise, Étiennette, Alexis et Benjamin, qui avaient été des sœurs et des frères pour toi, qui t’avaient aimé ; mais voilà une nouvelle famille qui se présente, que tu ne connais pas, qui n’a rien fait pour toi que te déposer dans la rue, et tout à coup tu abandonnes ceux qui ont été bons pour ceux qui ont été mauvais ; je trouve que cela n’est pas juste.
— Il ne faut pas dire que les parents de Rémi l’ont abandonné, interrompit mère Barberin ; on leur a peut-être pris leur enfant qu’ils pleurent et qu’ils attendent, qu’ils cherchent depuis ce jour.
— Je ne sais pas cela, mais je sais que le père Acquin a ramassé Rémi mourant au coin de sa porte, qu’il l’a soigné comme son enfant, et que Alexis, Benjamin, Étiennette et Lise l’ont aimé comme leur frère, et je dis que ceux qui l’ont accueilli ont bien au moins autant de droits à son amitié que ceux qui, volontairement ou involontairement, l’ont perdu. Chez le père Acquin et chez ses enfants, l’amitié a été volontaire ; ils ne devaient rien à Rémi.
Mattia prononça ces paroles comme s’il était fâché contre moi, sans me regarder, sans regarder mère Barberin. Cela me peina, mais cependant sans que le chagrin de me voir ainsi blâmé m’empêchât de sentir toute la force de ce raisonnement. D’ailleurs j’étais dans la situation de ces gens irrésolus qui se rangent bien souvent du côté de celui qui a parlé le dernier.
— Mattia a raison, dis-je, et ce n’était pas le cœur léger que je me décidais à aller à Paris sans avoir vu Étiennette et Lise.
— Mais tes parents ! insista mère Barberin.
Il fallait se prononcer ; j’essayai de tout concilier.
— Nous n’irons pas voir Étiennette, dis-je, parce que ce serait un trop long détour ; d’ailleurs Étiennette sait lire et écrire, nous pouvons donc nous entendre avec elle par lettre ; mais avant d’aller à Paris nous passerons par Dreuzy pour voir Lise ; si cela nous retarde, le retard ne sera pas considérable ; et puis Lise ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire et c’est pour elle surtout que j’ai entrepris ce voyage ; je lui parlerai d’Alexis et en demandant à Étiennette de m’écrire à Dreuzy je lui lirai cette lettre.
— Bon, dit Mattia en souriant.
Il fut convenu que nous partirions le lendemain, et je passai une partie de la journée à écrire une longue lettre à Étiennette, en lui expliquant pourquoi je n’allais pas la voir comme j’en avais eu l’intention.
Et le lendemain, une fois encore, j’eus à supporter la tristesse des adieux ; mais au moins je ne quittai pas Chavanon comme je l’avais fait avec Vitalis ; je pus embrasser mère Barberin et lui promettre de revenir la voir bientôt avec mes parents ; toute notre soirée, la veille du départ, fut employée à discuter ce que je lui donnerais : rien ne serait trop beau pour elle ; n’allais-je pas être riche ?
— Rien ne vaudra pour moi ta vache, mon petit Rémi, me dit-elle, et avec toutes tes richesses tu ne pourras me rendre plus heureuse que tu ne l’as fait avec ta pauvreté.
Notre pauvre petite vache, il fallut aussi nous séparer d’elle ; Mattia l’embrassa plus de dix fois sur le mufle, ce qui parut lui être agréable, car à chaque baiser elle allongeait sa grande langue.
Nous voilà de nouveau sur les grands chemins, le sac au dos, Capi en avant de nous ; nous marchons à grands pas ou, plus justement, de temps en temps sans trop savoir ce que je fais, poussé à mon insu par la hâte d’arriver à Paris, j’allonge le pas.
Mais Mattia, après m’avoir suivi un moment, me dit que, si nous allons ainsi, nous ne tarderons pas à être à bout de forces, et alors je ralentis ma marche, puis bientôt de nouveau je l’accélère.
— Comme tu es pressé ! me dit Mattia d’un air chagrin.
— C’est vrai, et il me semble que tu devrais l’être aussi, car ma famille sera ta famille.
Il secoua la tête.
Je fus dépité et peiné de voir ce geste que j’avais déjà remarqué plusieurs fois depuis qu’il était question de ma famille.
— Ne sommes-nous pas frères ?
— Oh ! entre nous bien sûr, et je ne doute pas de toi, je suis ton frère aujourd’hui, je le serai demain, cela je le crois, je le sens.
— Eh bien ?
— Eh bien ! pourquoi veux-tu que je sois le frère de tes frères si tu en as, le fils de ton père et de ta mère ?
— Est-ce que si nous avions été à Lucca je n’aurais pas été le frère de ta sœur Cristina ?
— Oh ! oui, bien sûr.
— Alors pourquoi ne serais-tu pas le frère de mes frères et de mes sœurs si j’en ai ?
— Parce que ce n’est pas la même chose, pas du tout, pas du tout.
— En quoi donc ?
— Je n’ai pas été emmailloté dans des beaux langes, moi, dit Mattia.
— Qu’est-ce que cela fait ?
— Cela fait beaucoup, cela fait tout, tu le sais comme moi. Tu serais venu à Lucca, et je vois bien maintenant que tu n’y viendras jamais ; tu aurais été reçu par des pauvres gens, mes parents, qui n’auraient eu rien à te reprocher, puisqu’ils auraient été plus pauvres que toi. Mais si les beaux langes disent vrai, comme le pense mère Barberin et comme cela doit être, tes parents sont riches ; ils sont peut-être des personnages ! Alors comment veux-tu qu’ils accueillent un pauvre petit misérable comme moi ?
— Que suis-je donc moi-même, si ce n’est un misérable ?
— Présentement, mais demain tu seras leur fils, et moi je serai toujours le misérable que je suis aujourd’hui ; on t’enverra au collège : on te donnera des maîtres, et moi je n’aurai qu’à continuer ma route tout seul, en me souvenant de toi, comme, je l’espère, tu te souviendras de moi aussi.
— Oh ! mon cher Mattia, comment peux-tu parler ainsi ?
— Je parle comme je pense, o mio caro, et voilà pourquoi je ne peux pas être joyeux de ta joie : pour cela, pour cela seulement, parce que nous allons être séparés, et que j’avais cru, je m’étais imaginé, bien des fois même j’avais rêvé que nous serions toujours ensemble, comme nous sommes. Oh ! pas comme nous sommes en ce moment, de pauvres musiciens des rues ; nous aurions travaillé tous les deux ; nous serions devenus de vrais musiciens, jouant devant un vrai public, sans nous quitter jamais.
— Mais cela sera, mon petit Mattia ; si mes parents sont riches, ils le seront pour toi comme pour moi, s’ils m’envoient au collège, tu y viendras avec moi ; nous ne nous quitterons pas, nous travaillerons ensemble, nous serons toujours ensemble, nous grandirons, nous vivrons ensemble comme tu le désires et comme je le désire aussi, tout aussi vivement que toi, je t’assure.
— Je sais bien que tu le désires, mais tu ne seras plus ton maître comme tu l’es maintenant.
— Voyons, écoute-moi : si mes parents me cherchent, cela prouve, n’est-ce pas, qu’ils s’intéressent à moi, alors ils m’aiment ou ils m’aimeront ; s’ils m’aiment ils ne me refuseront pas ce que je leur demanderai. Et ce que je leur demanderai ce sera de rendre heureux ceux qui ont été bons pour moi, qui m’ont aimé quand j’étais seul au monde, mère Barberin, le père Acquin qu’on fera sortir de prison, Étiennette, Alexis, Benjamin, Lise et toi ; Lise qu’ils prendront avec eux, qu’on instruira, qu’on guérira, et toi qu’on mettra au collège avec moi, si je dois aller au collège. Voilà comment les choses se passeront, — si mes parents sont riches, et tu sais bien que je serais très-content qu’ils fussent riches.
— Et moi, je serais très-content qu’ils fussent pauvres.
— Tu es bête !
— Peut-être bien.
Et sans en dire davantage, Mattia appela Capi ; l’heure était arrivée de nous arrêter pour déjeuner ; il prit le chien dans ses bras, et s’adressant à lui comme s’il avait parlé à une personne qui pouvait le comprendre et lui répondre :
— N’est-ce pas, vieux Capi, que toi aussi tu aimerais mieux que les parents de Rémi fussent pauvres ?
En entendant mon nom, Capi comme toujours poussa un aboiement de satisfaction, et il mit sa patte droite sur sa poitrine.
— Avec des parents pauvres, nous continuons notre existence libre, tous les trois ; nous allons où nous voulons, et nous n’avons d’autres soucis que de satisfaire « l’honorable société. »
— Ouah, ouah.
— Avec des parents riches, au contraire, Capi est mis à la cour, dans une niche, et probablement à la chaîne, une belle chaîne en acier, mais enfin une chaîne, parce que les chiens ne doivent pas entrer dans la maison des riches.
J’étais jusqu’à un certain point fâché que Mattia me souhaitât des parents pauvres, au lieu de partager le rêve qui m’avait été inspiré par mère Barberin et que j’avais si promptement et si pleinement adopté ; mais d’un autre côté j’étais heureux de voir enfin et de comprendre le sentiment qui avait provoqué sa tristesse, — c’était l’amitié, c’était la peur de la séparation, et ce n’était que cela ; je ne pouvais donc pas lui tenir rigueur de ce qui, en réalité, était un témoignage d’attachement et de tendresse. Il m’aimait, Mattia, et, ne pensant qu’à notre affection, il ne voulait pas qu’on nous séparât.
Si nous n’avions pas été obligés de gagner notre pain quotidien, j’aurais, malgré Mattia, continué de forcer le pas, mais il fallait jouer dans les gros villages qui se trouvaient sur notre route, et en attendant que mes riches parents eussent partagé avec nous leurs richesses, nous devions nous contenter des petits sous que nous ramassions difficilement çà et là, au hasard.
Nous mîmes donc plus de temps que je n’aurais voulu à nous rendre de la Creuse dans la Nièvre, c’est-à-dire de Chavanon à Dreuzy, en passant par Aubusson, Montluçon, Moulins et Decize.
D’ailleurs, en plus du pain quotidien, nous avions encore une autre raison qui nous obligeait à faire des recettes aussi grosses que possible. Je n’avais pas oublié ce que mère Barberin m’avait dit quand elle m’avait assuré qu’avec toutes mes richesses je ne pourrais jamais la rendre plus heureuse que je ne l’avais fait avec ma pauvreté, et je voulais que ma petite Lise fût heureuse comme l’avait été mère Barberin. Assurément je partagerais ma richesse avec Lise, cela ne faisait pas de doute, au moins pour moi, mais en attendant, mais avant que je fusse riche, je voulais porter à Lise un cadeau acheté avec l’argent que j’aurais gagné, — le cadeau de la pauvreté.
Ce fut une poupée que nous achetâmes à Decize et qui, par bonheur, coûtait moins cher qu’une vache.
De Decize à Dreuzy nous n’avions plus qu’à nous hâter, ce que nous fîmes, car à l’exception de Châtillon-en-Bazois nous ne trouvions sur notre route que de pauvres villages, où les paysans n’étaient pas disposés à prendre sur leur nécessaire, pour être généreux avec des musiciens dont ils n’avaient pas souci.
À partir de Châtillon nous suivîmes les bords du canal, et ces rives boisées, cette eau tranquille, ces péniches qui s’en allaient doucement traînées par des chevaux me reportèrent au temps heureux où, sur le Cygne avec madame Milligan et Arthur, j’avais ainsi navigué sur un canal. Où était-il maintenant le Cygne ? Combien de fois lorsque nous avions traversé ou longé un canal avais-je demandé si l’on avait vu passer un bateau de plaisance qui, par sa verandah, par son luxe d’aménagement, ne pouvait être confondu avec aucun autre. Sans doute madame Milligan était retournée en Angleterre, avec son Arthur guéri. C’était là le probable, c’était là ce qu’il était sensé de croire, et cependant plus d’une fois, côtoyant les bords de ce canal du Nivernais, je me demandai en apercevant de loin un bateau traîné par des chevaux, si ce n’était pas le Cygne qui venait vers nous.
Comme nous étions à l’automne, nos journées de marche étaient moins longues que dans l’été, et nous prenions nos dispositions pour arriver autant que possible dans les villages où nous devions coucher, avant que la nuit fût tout à fait tombée. Cependant bien que nous eussions forcé le pas, surtout dans la fin de notre étape, nous n’entrâmes à Dreuzy qu’à la nuit noire.
Pour arriver chez la tante de Lise, nous n’avions qu’à suivre le canal, puisque le mari de tante Catherine, qui était éclusier, demeurait dans une maison bâtie à côté même de l’écluse dont il avait la garde ; cela nous épargna du temps, et nous ne tardâmes pas à trouver cette maison, située à l’extrémité du village, dans une prairie plantée de hauts arbres qui de loin paraissaient flotter dans le brouillard.
Mon cœur battait fort en approchant de cette maison dont la fenêtre était éclairée par la réverbération d’un grand feu qui brûlait dans la cheminée, en jetant de temps en temps des nappes de lumière rouge, qui illuminaient notre chemin.
Lorsque nous fûmes tout près de la maison, je vis que la porte et la fenêtre étaient fermées, mais par cette fenêtre qui n’avait ni volets ni rideaux, j’aperçus Lise à table, à côté de sa tante, tandis qu’un homme, son oncle sans doute, placé devant elle, nous tournait le dos.
— On soupe, dit Mattia, c’est le bon moment.
Mais je l’arrêtai de la main sans parler, tandis que de l’autre je faisais signe à Capi de rester derrière moi silencieux.
Puis dépassant la bretelle de ma harpe, je me préparai à jouer.
— Ah ! oui, dit Mattia à voix basse, une sérénade, c’est une bonne idée.
— Non pas toi, moi tout seul.
Et je jouai les premières notes de ma chanson napolitaine, mais sans chanter, pour que ma voix ne me trahît pas.
En jouant, je regardais Lise : elle leva vivement la tête, et je vis ses yeux lancer comme un éclair.
Je chantai.
Alors, elle sauta à bas de sa chaise, et courut vers la porte ; je n’eus que le temps de donner ma harpe à Mattia, Lise était dans mes bras.
On nous fit entrer dans la maison, puis après que tante Catherine m’eut embrassé, elle mit deux couverts sur la table.
Mais alors, je la priai d’en mettre un troisième.
— Si vous voulez bien, dis-je, nous avons une petite camarade avec nous.
Et de mon sac, je tirai notre poupée, que j’assis sur la chaise qui était à côté de celle de Lise.
Le regard que Lise me jeta, je ne l’ai jamais oublié, et je le vois encore.
XI
BARBERIN
Si je n’avais pas eu hâte d’arriver à Paris, je serais resté longtemps, très-longtemps avec Lise ; nous avions tant de choses à nous dire, et nous pouvions nous en dire si peu avec le langage que nous employions.
Lise avait à me raconter son installation à Dreuzy, comment elle avait été prise en grande amitié par son oncle et sa tante, qui, des cinq enfants qu’ils avaient eus, n’en avaient plus un seul, malheur trop commun dans les familles de la Nièvre, où les femmes abandonnent leurs propres enfants pour être nourrices à Paris ; — comment ils la traitaient comme leur vraie fille ; comment elle vivait dans leur maison, quelles étaient ses occupations, quels étaient ses jeux et ses plaisirs : la pêche, les promenades en bateau, les courses dans les grands bois, qui prenaient presque tout son temps, puisqu’elle ne pouvait pas aller à l’école.
Et moi, de mon côté, j’avais à lui dire tout ce qui m’était arrivé depuis notre séparation, comment j’avais failli périr dans la mine où Alexis travaillait, et comment, en arrivant chez ma nourrice, j’avais appris que ma famille me cherchait, ce qui m’avait empêché d’aller voir Étiennette comme je le désirais.
Bien entendu, ce fut ma famille qui tint la grande place dans mon récit, ma famille riche, et je répétai à Lise ce que j’avais déjà dit à Mattia, insistant surtout sur mes espérances de fortune qui, se réalisant, nous permettraient à tous d’être heureux : son père, ses frères, elle, surtout elle.
Lise, qui n’avait point acquis la précoce expérience de Mattia, et qui, heureusement pour elle, n’avait point été à l’école des élèves de Garofoli, était toute disposée à admettre que ceux qui étaient riches n’avaient qu’à être heureux en ce monde, et que la fortune était un talisman qui, comme dans les contes de fées, donnait instantanément tout ce qu’on pouvait désirer. — N’était-ce point parce que son père était pauvre, qu’il avait été mis en prison, et que la famille avait été dispersée ! Que ce fût moi qui fusse riche, que ce fût elle, peu importait ; c’était même chose, au moins quant au résultat ; nous étions tous heureux, et elle n’avait souci que de cela : tous réunis, tous heureux.
Ce n’était pas seulement à nous entretenir devant l’écluse, au bruit de l’eau qui se précipitait par les vannes, que nous passions notre temps, c’était encore à nous promener tous les trois, Lise, Mattia et moi ; ou plus justement tous les cinq, car M. Capi et mademoiselle la poupée étaient de toutes nos promenades.
Mes courses à travers la France avec Vitalis pendant plusieurs années et avec Mattia en ces derniers mois m’avaient fait parcourir bien des pays : je n’en avais vu aucun d’aussi curieux que celui au milieu duquel nous nous trouvions en ce moment ; des bois immenses, de belles prairies, des rochers, des collines, des cavernes, des cascades écumantes, des étangs tranquilles, et dans la vallée étroite, aux coteaux escarpés de chaque côté le canal, qui se glissait en serpentant. C’était superbe : on n’entendait que le murmure des eaux, le chant des oiseaux ou la plainte du vent dans les grands arbres. Il est vrai que j’avais trouvé aussi quelques années auparavant que la vallée de la Bièvre était jolie. Je ne voudrais donc pas qu’on me crût trop facilement sur parole. Ce que je veux dire, c’est que partout où je me suis promené avec Lise, où nous avons joué ensemble, le pays m’a paru posséder des beautés et un charme, que d’autres plus favorisés peut-être n’avaient pas à mes yeux : j’ai vu ce pays avec Lise et il est resté dans mon souvenir éclairé par ma joie.
Le soir nous nous asseyions devant la maison quand il ne faisait pas trop humide, devant la cheminée quand le brouillard était épais, et pour le plus grand plaisir de Lise, je lui jouais de la harpe. Mattia aussi jouait du violon ou du cornet à piston, mais Lise préférait la harpe, ce qui ne me rendait pas peu fier ; au moment de nous séparer pour aller nous coucher, Lise me demandait ma chanson napolitaine, et je la lui chantais.
Cependant, malgré tout, il fallut quitter Lise et ce pays pour se remettre en route.
Mais pour moi ce fut sans trop de chagrin ; j’avais si souvent caressé mes rêves de richesses, que j’en étais arrivé à croire, non pas que je serais riche un jour, mais que j’étais riche déjà, et que je n’avais qu’à former un souhait pour pouvoir le réaliser dans un avenir prochain, très-prochain, presque immédiat.
Mon dernier mot à Lise (mot non parlé bien entendu mais exprimé) fera mieux que de longues explications comprendre combien sincère j’étais dans mon illusion.
— Je viendrai te chercher dans une voiture à quatre chevaux, lui dis-je.
Et elle me crut, si bien que de la main elle fit signe de claquer les chevaux : elle voyait assurément la voiture, tout comme je la voyais moi-même.
Cependant avant de faire en voiture la route de Paris à Dreuzy, il fallut faire à pied celle de Dreuzy à Paris ; et sans Mattia je n’aurais eu d’autre souci que d’allonger les étapes, me contentant de gagner le strict nécessaire pour notre vie de chaque jour ; à quoi bon prendre de la peine maintenant, nous n’avions plus ni vache, ni poupée à acheter, et pourvu que nous eussions notre pain quotidien, ce n’était pas à moi à porter de l’argent à mes parents.
Mais Mattia ne se laissait pas toucher par les raisons que je lui donnais pour justifier mon opinion.
— Gagnons ce que nous pouvons gagner, disait-il en m’obligeant à prendre ma harpe. Qui sait si nous trouverons Barberin tout de suite ?
— Si nous ne le trouvons pas à midi, nous le trouverons à deux heures ; la rue Mouffetard n’est pas si longue.
— Et s’il ne demeure plus rue Mouffetard ?
— Nous irons là où il demeure.
— Et s’il est retourné à Chavanon ; il faudra lui écrire, attendre sa réponse ; pendant ce temps-là, de quoi vivrons-nous, si nous n’avons rien dans nos poches ? On dirait vraiment que tu ne connais point Paris. Tu as donc oublié les carrières de Gentilly ?
— Non.
— Eh bien, moi, je n’ai pas non plus oublié le mur de l’église Saint-Médard, contre lequel je me suis appuyé pour ne pas tomber quand je mourais de faim. Je ne veux pas avoir faim à Paris.
— Nous dînerons mieux en arrivant chez mes parents.
— Ce n’est pas parce que j’ai bien déjeuné que je ne dîne pas ; mais quand je n’ai ni déjeuné ni dîné je ne suis pas à mon aise et je n’aime pas ça ; travaillons donc comme si nous avions une vache à acheter pour tes parents.
C’était là un conseil plein de sagesse ; j’avoue cependant que je ne chantai plus comme lorsqu’il s’agissait de gagner des sous pour la vache de la mère Barberin, ou pour la poupée de Lise.
— Comme tu seras paresseux quand tu seras riche ! disait Mattia.
À partir de Corbeil, nous retrouvâmes la route que nous avions suivie six mois auparavant quand nous avions quitté Paris pour aller à Chavanon, et avant d’arriver à Villejuif, nous entrâmes dans la ferme où nous avions donné le premier concert de notre association en faisant danser une noce. Le marié et la mariée nous reconnurent et ils voulurent que nous les fissions danser encore. On nous donna à souper et à coucher.
Ce fut de là que nous partîmes le lendemain matin pour faire notre rentrée dans Paris : il y avait juste six mois et quatorze jours que nous en étions sortis.
Mais la journée du retour ne ressemblait guère à celle du départ : le temps était gris et froid ; plus de soleil au ciel, plus de fleurs, plus de verdure sur les bas-côtés de la route ; le soleil d’été avait accompli son œuvre, puis étaient venus les premiers brouillards de l’automne ; ce n’était plus des fleurs de giroflées qui du haut des murs nous tombaient maintenant sur la tête, c’étaient des feuilles desséchées qui se détachaient des arbres jaunis.
Mais qu’importait la tristesse du temps ! nous avions en nous une joie intérieure qui n’avait pas besoin d’excitation étrangère.
Quand je dis nous, cela n’est pas exact, c’était en moi qu’il y avait de la joie et en moi seul.
Pour Mattia, à mesure que nous approchions de Paris, il était de plus en plus mélancolique, et souvent il marchait durant des heures entières sans m’adresser la parole.
Jamais il ne m’avait dit la cause de cette tristesse, et moi, m’imaginant qu’elle tenait uniquement à ses craintes de séparation, je n’avais pas voulu lui répéter ce que je lui avais expliqué plusieurs fois : c’est-à-dire que mes parents ne pouvaient pas avoir la pensée de nous séparer.
Ce fut seulement quand nous nous arrêtâmes pour déjeuner, avant d’arriver aux fortifications, que, tout en mangeant son pain, assis sur une pierre, il me dit ce qui le préoccupait si fort.
— Sais-tu à qui je pense au moment d’entrer à Paris ?
— À qui ?
— Oui à qui ; c’est à Garofoli. S’il était sorti de prison ? Quand on m’a dit qu’il était en prison, je n’ai pas eu l’idée de demander pour combien de temps ; il peut donc être en liberté, maintenant, et revenu dans son logement de la rue de Lourcine. C’est rue Mouffetard que nous devons chercher Barberin, c’est-à-dire dans le quartier même de Garofoli, à sa porte. Que se passera-t-il si par hasard il nous rencontre ? il est mon maître, il est mon oncle. Il peut donc me reprendre avec lui, sans qu’il me soit possible de lui échapper. Tu avais peur de retomber sous la main de Barberin, tu sens combien j’ai peur de retomber sous celle de Garofoli. Oh ! ma pauvre tête ! Et puis la tête ce ne serait rien encore à côté de la séparation ; nous ne pourrions plus nous voir ; et cette séparation par ma famille, serait autrement terrible que par la tienne. Certainement Garofoli voudrait te prendre avec lui et te donner l’instruction qu’il offre à ses élèves avec accompagnement de fouet ; mais toi, tu ne voudrais pas venir, et moi je ne voudrais pas de ta compagnie. Tu n’as jamais été battu, toi !
L’esprit emporté par mon espérance, je n’avais pas pensé à Garofoli ; mais tout ce que Mattia venait de me dire était possible et je n’avais pas besoin d’explication pour comprendre à quel danger nous étions exposés.
— Que veux-tu ? lui demandai-je, veux-tu ne pas entrer dans Paris ?
— Je crois que si je n’allais pas dans la rue Mouffetard, ce serait assez pour échapper à la mauvaise chance de rencontrer Garofoli.
— Eh bien, ne viens pas rue Mouffetard, j’irai seul, et nous nous retrouverons quelque part ce soir, à 7 heures.
L’endroit convenu entre Mattia et moi pour nous retrouver fut le bout du pont de l’Archevêché, du côté du chevet de Notre-Dame ; et les choses ainsi arrangées nous nous remîmes en route pour entrer dans Paris.
Arrivés à la place d’Italie nous nous séparâmes, émus tous deux comme si nous ne devions plus nous revoir, et tandis que Mattia et Capi descendaient vers le Jardin des Plantes, je me dirigeai vers la rue Mouffetard, qui n’était qu’à une courte distance.
C’était la première fois depuis six mois que je me trouvais seul sans Mattia, sans Capi près de moi, et, dans ce grand Paris, cela me produisait une pénible sensation.
Mais je ne devais pas me laisser abattre par ce sentiment : n’allais-je pas retrouver Barberin, et par lui ma famille ?
J’avais écrit sur un papier les noms et les adresses des logeurs chez lesquels je devais trouver Barberin ; mais cela avait été une précaution superflue, je n’avais oublié ni ces noms ni ces adresses, et je n’eus pas besoin de consulter mon papier : Pajot, Barrabaud et Chopinet.
Ce fut Pajot que je rencontrai le premier sur mon chemin en descendant la rue Mouffetard. J’entrai assez bravement dans une gargote qui occupait le rez-de-chaussée d’une maison meublée ; mais ce fut d’une voix tremblante que je demandai Barberin.
— Qu’est-ce que c’est que Barberin ?
— Barberin de Chavanon.
Et je fis le portrait de Barberin, ou tout au moins du Barberin que j’avais vu quand il était revenu de Paris : visage rude, air dur, la tête inclinée sur l’épaule droite.
— Nous n’avons pas ça ! connais pas !
Je remerciai et j’allai un peu plus loin chez Barrabaud ; celui-là, à la profession de logeur en garni joignait celle de fruitier.
Je posai de nouveau ma question.
Tout d’abord j’eus du mal à me faire écouter ; le mari et la femme étaient occupés, l’un à servir une pâtée verte, qu’il coupait avec une sorte de truelle et qui, disait-il, était des épinards ; l’autre était en discussion avec une pratique pour un sou rendu en moins. Enfin ayant répété trois fois ma demande, j’obtins une réponse.
— Ah ! oui, Barberin… Nous avons eu ça dans le temps ; il y a au moins quatre ans.
— Cinq, dit la femme, même qu’il nous doit une semaine ; où est-il, ce coquin-là ?
C’était justement ce que je demandais.
Je sortis désappointé et jusqu’à un certain point inquiet : je n’avais plus que Chopinet ; à qui m’adresser, si celui-là ne savait rien ? où chercher Barberin ?
Comme Pajot, Chopinet était restaurateur, et lorsque j’entrai dans la salle où il faisait la cuisine et où il donnait à manger, plusieurs personnes étaient attablées.
J’adressai mes questions à Chopinet lui-même qui, une cuiller à la main, était en train de tremper des soupes à ses pratiques.
— Barberin, me répondit-il, il n’est plus ici.
— Et où est-il ? demandai-je en tremblant.
— Ah ! je ne sais pas.
J’eus un éblouissement ; il me sembla que les casseroles dansaient sur le fourneau.
— Où puis-je le chercher ? dis-je.
— Il n’a pas laissé son adresse.
Ma figure trahit sans doute ma déception d’une façon éloquente et touchante, car l’un des hommes qui mangeaient à une table placée près du fourneau, m’interpella.
— Qu’est-ce que tu lui veux, à Barberin ? me demanda-t-il.
Il m’était impossible de répondre franchement et de raconter mon histoire.
— Je viens du pays, son pays, Chavanon, et je viens lui donner des nouvelles de sa femme ; elle m’avait dit que je le trouverais ici.
— Si vous savez où est Barberin, dit le maître d’hôtel en s’adressant à celui qui m’avait interrogé, vous pouvez le dire à ce garçon qui ne lui veut pas de mal, bien sûr, n’est-ce pas, garçon ?
— Oh ! non, monsieur !
L’espoir me revint.
— Barberin doit loger maintenant à l’hôtel du Cantal, passage d’Austerlitz : il y était il y a trois semaines.
Je remerciai et sortis, mais avant d’aller au passage d’Austerlitz qui, je le pensais, était au bout du pont d’Austerlitz, je voulus savoir des nouvelles de Garofoli pour les porter à Mattia.
J’étais précisément tout près de la rue de Lourcine ; je n’eus que quelques pas à faire pour trouver la maison où j’étais venu avec Vitalis : comme le jour où nous nous y étions présentés pour la première fois, un vieux bonhomme, le même vieux bonhomme, accrochait des chiffons contre la muraille verdâtre de la cour ; c’était à croire qu’il n’avait fait que cela depuis que je l’avais vu.
— Est-ce que M. Garofoli est revenu ? demandai-je.
Le vieux bonhomme me regarda et se mit à tousser sans me répondre : il me sembla que je devais laisser comprendre que je savais où était Garofoli, sans quoi je n’obtiendrais rien de ce vieux chiffonnier.
— Il est toujours là-bas ? dis-je en prenant un air fin, il doit s’ennuyer.
— Possible, mais le temps passe tout de même.
— Peut-être pas aussi vite pour lui que pour nous.
Le bonhomme voulut bien rire de cette plaisanterie, ce qui lui donna une terrible quinte.
— Est-ce que vous savez quand il doit revenir ? dis-je lorsque la toux fut apaisée.
— Trois mois.
Garofoli en prison pour trois mois encore, Mattia pouvait respirer ; car avant trois mois mes parents auraient bien trouvé le moyen de mettre le terrible padrone dans l’impossibilité de rien entreprendre contre son neveu.
Si j’avais eu un moment d’émotion cruelle chez Chopinet, l’espérance maintenant m’était revenue ; j’allais trouver Barberin à l’hôtel du Cantal.
Sans plus tarder je me dirigeai vers le passage d’Austerlitz, plein d’espérance et de joie et par suite de ces sentiments sans doute, tout disposé à l’indulgence pour Barberin.
Après tout, il n’était peut-être pas aussi méchant qu’il en avait l’air : sans lui je serais très-probablement mort de froid et de faim dans l’avenue de Breteuil ; il est vrai qu’il m’avait enlevé à mère Barberin pour me vendre à Vitalis, mais il ne me connaissait pas, et dès lors il ne pouvait pas avoir de l’amitié pour un enfant qu’il n’avait pas vu, et puis il était poussé par la misère, qui fait faire tant de mauvaises choses. Présentement il me cherchait, il s’occupait de moi, et si je retrouvais mes parents, c’était à lui que je le devais : cela méritait mieux que la répulsion que je nourrissais contre lui depuis le jour où j’avais quitté Chavanon, le poignet pris dans la main de Vitalis. Envers lui aussi je devrais me montrer reconnaissant : si ce n’était point un devoir d’affection et de tendresse comme pour mère Barberin, en tout cas c’en était un de conscience.
En traversant le Jardin des Plantes, la distance n’est pas longue de la rue de Lourcine au passage d’Austerlitz, je ne tardai pas à arriver devant l’hôtel du Cantal, qui n’avait d’un hôtel que le nom, étant en réalité un misérable garni. Il était tenu par une vieille femme à la tête tremblante et à moitié sourde.
Lorsque je lui eus adressé ma question ordinaire, elle mit sa main en cornet derrière son oreille et elle me pria de répéter ce que je venais de lui demander.
— J’ai l’ouïe un peu dure, dit-elle à voix basse.
— Je voudrais voir Barberin, Barberin de Chavanon, il loge chez vous, n’est-ce pas ?
Sans me répondre elle leva ses deux bras en l’air par un mouvement si brusque que son chat endormi sur elle sauta à terre épouvanté.
— Hélas ! hélas ! dit-elle.
Puis me regardant avec un tremblement de tête plus fort :
— Seriez-vous le garçon ? demanda-t-elle.
— Quel garçon ?
— Celui qu’il cherchait.
Qu’il cherchait. En entendant ce mot, j’eus le cœur serré.
— Barberin ! m’écriai-je.
— Défunt, c’est défunt Barberin qu’il faut dire.
Je m’appuyai sur ma harpe.
— Il est donc mort ? dis-je en criant assez haut pour me faire entendre, mais d’une voix que l’émotion rendait rauque.
— Il y a huit jours, à l’hôpital Saint-Antoine.
Je restai anéanti ; mort Barberin ! et ma famille, comment la trouver maintenant, où la chercher ?
— Alors vous êtes le garçon ? continua la vieille femme, celui qu’il cherchait pour le rendre à sa riche famille ?
L’espérance me revint, je me cramponnai à cette parole :
— Vous savez ?… dis-je.
— Je sais ce qu’il racontait, ce pauvre homme : qu’il avait trouvé et élevé un enfant, que maintenant la famille qui avait perdu cet enfant, dans le temps, voulait le reprendre, et que lui il était à Paris pour le chercher.
— Mais la famille ? demandai-je d’une voix haletante, ma famille ?
— Pour lors, c’est donc bien vous le garçon ? ah ! c’est vous, c’est bien vous !
Et tout en branlant la tête, elle me regarda en me dévisageant.
Mais je l’arrachai à son examen.
— Je vous en prie, madame, dites-moi ce que vous savez.
— Mais je ne sais pas autre chose que ce que je viens de vous raconter, mon garçon, je veux dire mon jeune monsieur.
— Ce que Barberin vous a dit, qui se rapporte à ma famille ? Vous voyez mon émotion, madame, mon trouble, mes angoisses.
Sans me répondre elle leva de nouveau les bras au ciel :
— En v’là une histoire !
En ce moment une femme qui avait la tournure d’une servante entra dans la pièce où nous nous trouvions ; alors la maîtresse de l’hôtel du Cantal m’abandonnant s’adressa à cette femme :
— En v’là une histoire ! Ce jeune garçon, ce jeune monsieur que tu vois, c’est celui de qui Barberin parlait, il arrive, et Barberin n’est plus là, en v’là… une histoire !
— Barberin ne vous a donc jamais parlé de ma famille ? dis-je.
— Plus de vingt fois, plus de cent fois, une famille riche.
— Où demeure cette famille, comment se nomme-t-elle ?
— Ah ! voilà. Barberin ne m’a jamais parlé de ça. Vous comprenez, il en faisait mystère ; il voulait que la récompense fût pour lui tout seul, comme de juste, et puis c’était un malin.
Hélas ! oui, je comprenais ; je ne comprenais que trop ce que la vieille femme venait de me dire : Barberin en mourant avait emporté le secret de ma naissance.
Je n’étais donc arrivé si près du but que pour le manquer. Ah ! mes beaux rêves ! mes espérances !
— Et vous ne connaissez personne à qui Barberin en aurait dit plus qu’à vous ? demandai-je à la vieille femme.
— Pas si bête, Barberin, de se confier à personne ; il était bien trop méfiant pour ça.
— Et vous n’avez jamais vu quelqu’un de ma famille venir le trouver ?
— Jamais.
— Des amis à lui, à qui il aurait parlé de ma famille ?
— Il n’avait pas d’amis.
Je me pris la tête à deux mains ; mais j’eus beau chercher, je ne trouvai rien pour me guider ; d’ailleurs j’étais si ému, si troublé, que j’étais incapable de suivre mes idées.
— Il a reçu une lettre une fois, dit la vieille femme après avoir longuement réfléchi, une lettre chargée.
— D’où venait-elle ?
— Je ne sais pas ; le facteur la lui a donnée à lui-même, je n’ai pas vu le timbre.
— On peut sans doute retrouver cette lettre ?
— Quand il a été mort, nous avons cherché dans ce qu’il avait laissé ici ; ah ! ce n’était pas par curiosité bien sûr, mais seulement pour avertir sa femme ; nous n’avons rien trouvé ; à l’hôpital non plus, on n’a trouvé dans ses vêtements aucun papier, et, s’il n’avait pas dit qu’il était de Chavanon, on n’aurait pas pu avertir sa femme.
— Mère Barberin est donc avertie ?
— Pardi !
Je restai assez longtemps sans trouver une parole. Que dire ? Que demander ? Ces gens m’avaient dit ce qu’ils savaient. Ils ne savaient rien. Et bien évidemment ils avaient tout fait pour apprendre ce que Barberin avait tenu à leur cacher.
Je remerciai et me dirigeai vers la porte.
— Et où allez-vous comme ça ? me demanda la vieille femme.
— Rejoindre mon ami.
— Ah ! vous avez un ami ?
— Mais oui.
— Il demeure à Paris ?
— Nous sommes arrivés à Paris ce matin.
— Eh bien, vous savez, si vous n’avez pas un hôtel, vous pouvez loger ici ; vous y serez bien, je peux m’en vanter, et dans une maison honnête ; faites attention que si votre famille vous cherche, fatiguée de ne pas avoir des nouvelles de Barberin, c’est ici qu’elle s’adressera et non ailleurs ; alors vous serez là pour la recevoir ; c’est un avantage, ça ; où vous trouverait-elle si vous n’étiez pas ici ? ce que j’en dis c’est dans votre intérêt : quel âge a-t-il votre ami ?
— Il est un peu plus jeune que moi.
— Pensez donc ! deux jeunesses sur le pavé de Paris ; on peut faire de si mauvaises connaissances ; il y a des hôtels qui sont si mal fréquentés ; ce n’est pas comme ici, où l’on est tranquille ; mais c’est le quartier qui veut ça.
Je n’étais pas bien convaincu que le quartier fût favorable à la tranquillité ; en tous cas, l’hôtel du Cantal était une des plus sales et des plus misérables maisons qu’il fût possible de voir, et dans ma vie de voyages et d’aventures, j’en avais vu cependant de bien misérables ; mais la proposition de cette vieille femme était à considérer. D’ailleurs ce n’était pas le moment de me montrer difficile, et je n’avais pas ma famille, ma riche famille, pour aller loger avec elle dans les beaux hôtels du boulevard, ou dans sa belle maison, si elle habitait Paris. À l’hôtel du Cantal notre dépense ne serait pas trop grosse, et maintenant nous devions penser à la dépense. Ah ! comme Mattia avait eu raison de vouloir gagner de l’argent, dans notre voyage de Dreuzy à Paris ! que ferions-nous si nous n’avions pas dix-sept francs dans notre poche ?
— Combien nous louerez-vous une chambre pour mon ami et pour moi, demandai-je ?
— Dix sous par jour ; est-ce trop cher ?
— Eh bien, nous reviendrons ce soir, mon ami et moi.
— Rentrez de bonne heure, Paris est mauvais la nuit.
Avant de rentrer il fallait rejoindre Mattia et j’avais encore plusieurs heures devant moi, avant le moment fixé pour notre rendez-vous. Ne sachant que faire, je m’en allai tristement au Jardin des Plantes m’asseoir sur un banc, dans un coin isolé. J’avais les jambes brisées et l’esprit perdu.
Ma chute avait été si brusque, si inattendue, si rude ! J’épuiserais donc tous les malheurs les uns après les autres, et chaque fois que j’étendrais la main pour m’établir solidement dans une bonne position, la branche que j’espérais saisir casserait sous mes doigts pour me laisser tomber ; — et toujours ainsi.
N’était-ce point une fatalité que Barberin fût mort au moment où j’avais besoin de lui, et, que dans un esprit de gain il eût caché à tous le nom et l’adresse de la personne, — mon père sans doute, — qui lui avait donné mission de faire des recherches pour me retrouver.
Comme j’étais à réfléchir ainsi tristement, les yeux gonflés de larmes, dans mon coin, sous l’abri d’un arbre vert qui m’enveloppait de son ombre, un monsieur et une dame suivis d’un enfant qui traînait une petite voiture, vinrent s’asseoir sur un banc, en face de moi : alors ils appelèrent l’enfant, qui lâchant sa petite voiture, courut à eux, les bras ouverts ; le père le reçut, puis l’ayant embrassé dans les cheveux, avec de gros baisers qui sonnèrent, il le passa à la mère qui à son tour l’embrassa à plusieurs reprises, à la même place et de la même manière, pendant que l’enfant riait aux éclats, en tapotant les joues de ses parents avec ses petites mains grasses à fossettes.
Alors, voyant cela, ce bonheur des parents et cette joie de l’enfant, malgré moi, je laissai couler mes larmes ; je n’avais pas été embrassé ainsi ; maintenant m’était-il permis d’espérer que je le serais jamais ?
Une idée me vint ; je pris ma harpe et me mis à jouer tout doucement une valse pour l’enfant qui marqua la mesure avec ses petits pieds. Le monsieur s’approcha de moi, et me tendit une petite pièce blanche ; mais poliment je la repoussai.
— Non, monsieur, je vous en prie, donnez-moi la joie d’avoir fait plaisir à votre enfant, qui est si joli.
Il me regarda alors avec attention ; mais à ce moment survint un gardien, qui malgré les protestations du monsieur, m’enjoignit de sortir au plus vite, si je ne voulais pas être mis en prison pour avoir joué dans le jardin.
Je repassai la bretelle de ma harpe sur mon épaule, et je m’en allai en tournant souvent la tête pour regarder le monsieur et la dame, qui fixaient sur moi leurs yeux attendris.
Comme il n’était pas encore l’heure de me rendre sur le pont de l’Archevêché pour retrouver Mattia, j’errai sur les quais en regardant la rivière couler.
La nuit vint ; on alluma les becs de gaz ; alors je me dirigeai vers l’église Notre-Dame dont les deux tours se détachaient en noir sur le couchant empourpré. Au chevet de l’église je trouvai un banc pour m’asseoir, ce qui me fut doux, car j’avais les jambes brisées, comme si j’avais fait une très-longue marche, et là je repris mes tristes réflexions. Jamais je ne m’étais senti si accablé, si las. En moi, autour de moi, tout était lugubre ; dans ce grand Paris plein de lumière, de bruit et de mouvement, je me sentais plus perdu que je ne l’aurais été au milieu des champs ou des bois.
Les gens qui passaient devant moi se retournaient quelquefois pour me regarder ; mais que m’importait leur curiosité ou leur sympathie ; ce n’était pas l’intérêt des indifférents que j’avais espéré.
Je n’avais qu’une distraction, c’était de compter les heures qui sonnaient tout autour de moi : alors je calculais combien de temps à attendre encore avant de pouvoir reprendre force et courage dans l’amitié de Mattia : quelle consolation c’était pour moi de penser que j’allais bientôt voir ses bons yeux si doux et si gais.
Un peu avant sept heures j’entendis un aboiement joyeux ; presque aussitôt dans l’ombre j’aperçus un corps blanc arriver sur moi ; avant que j’eusse pu réfléchir, Capi avait sauté sur mes genoux et il me léchait les mains à grands coups de langue ; je le serrai dans mes bras et l’embrassai sur le nez.
Mattia ne tarda pas à paraître :
— Eh bien ? cria-t-il de loin.
— Barberin est mort.
Il se mit à courir pour arriver plus vite près de moi ; en quelques paroles pressées je lui racontai ce que j’avais fait, et ce que j’avais appris.
Alors il montra un chagrin qui me fut bien doux au cœur et je sentis que s’il craignait tout de ma famille pour lui, il n’en désirait pas moins, sincèrement, pour moi, que je trouvasse mes parents.
Par de bonnes paroles affectueuses il tâcha de me consoler et surtout de me convaincre qu’il ne fallait pas désespérer.
— Si tes parents ont bien trouvé Barberin, ils s’inquiéteront de ne pas entendre parler de lui ; ils chercheront ce qu’il est devenu et tout naturellement ils arriveront à l’hôtel du Cantal ; allons donc à l’hôtel du Cantal, c’est quelques jours de retard, voilà tout.
C’était déjà ce que m’avait dit la vieille femme à la tête branlante, cependant dans la bouche de Mattia ces paroles prirent pour moi une tout autre importance : évidemment il ne s’agissait que d’un retard ; comme j’avais été enfant de me désoler et de désespérer !
Alors, me sentant un peu plus calme, je racontai à Mattia ce que j’avais appris sur Garofoli.
— Encore trois mois ! s’écria-t-il.
Et il se mit à danser un pas au milieu de la rue, en chantant.
Puis, tout à coup s’arrêtant et venant à moi :
— Comme la famille de celui-ci n’est pas la même chose que la famille de celui-là ! voilà que tu te désolais parce que tu avais perdu la tienne, et moi voilà que je chante parce que la mienne est perdue.
— Un oncle, ce n’est pas la famille, c’est-à-dire un oncle comme Garofoli ; si tu avais perdu ta sœur Cristina, danserais-tu ?
— Oh ! ne dis pas cela.
— Tu vois bien.
Par les quais nous gagnâmes le passage d’Austerlitz, et comme mes yeux n’étaient plus aveuglés par l’émotion, je pus voir combien est belle la Seine, le soir, lorsqu’elle est éclairée par la pleine lune qui met çà et là des paillettes d’argent sur ses eaux éblouissantes comme un immense miroir mouvant.
Si l’hôtel du Cantal était une maison honnête, ce n’était pas une belle maison, et quand nous nous trouvâmes avec une petite chandelle fumeuse, dans un cabinet sous les toits, et si étroit que l’un de nous était obligé de s’asseoir sur le lit quand l’autre voulait se tenir debout, je ne pus m’empêcher de penser que ce n’était pas dans une chambre de ce genre que j’avais espéré coucher. Et les draps en coton jaunâtre, combien peu ils ressemblaient aux beaux langes dont mère Barberin m’avait tant parlé.
La miche de pain graissée de fromage d’Italie que nous eûmes pour notre souper, ne ressembla pas non plus au beau festin que je m’étais imaginé pouvoir offrir à Mattia.
Mais enfin, tout n’était pas perdu ; il n’y avait qu’à attendre.
Et ce fut avec cette pensée que je m’endormis.
XII
RECHERCHES
Le lendemain matin, je commençai ma journée par écrire à mère Barberin pour lui faire part de ce que j’avais appris, et ce ne fut pas pour moi un petit travail.
Comment lui dire tout sèchement que son mari était mort ? Elle avait de l’affection pour son Jérôme ; ils avaient vécu durant de longues années ensemble, et elle serait peinée si je ne prenais pas part à son chagrin.
Enfin, tant bien que mal, et avec des assurances d’affection sans cesse répétées, j’arrivai au bout de mon papier. Bien entendu, je lui parlai de ma déception et de mes espérances présentes. À vrai dire, ce fut surtout de cela que je parlai. Au cas où ma famille lui écrirait pour avoir des nouvelles de Barberin, je la priais de m’avertir aussitôt, et surtout de me transmettre l’adresse qu’on lui donnerait en me l’envoyant à Paris, à l’hôtel du Cantal.
Ce devoir accompli, j’en avais un autre à remplir envers le père de Lise, et celui-là aussi m’était pénible, — au moins sous un certain rapport. Lorsqu’à Dreuzy j’avais dit à Lise que ma première sortie à Paris serait pour aller voir son père en prison, je lui avais expliqué que si mes parents étaient riches comme je l’espérais, je leur demanderais de payer ce que le père devait, de sorte que je n’irais à la prison que pour le faire sortir et l’emmener avec moi. Cela entrait dans le programme des joies que je m’étais tracé. Le père Acquin d’abord, mère Barberin ensuite, puis Lise, puis Étiennette, puis Alexis, puis Benjamin. Quant à Mattia, on ne faisait pour lui que ce qu’on faisait pour moi-même, et il était heureux de ce qui me rendait heureux. Quelle déception d’aller à la prison les mains vides et de revoir le père, en étant tout aussi incapable de lui rendre service que lorsque je l’avais quitté et de lui payer ma dette de reconnaissance !
Heureusement j’avais de bonnes paroles à lui apporter, ainsi que les baisers de Lise et d’Alexis, et sa joie paternelle adoucirait mes regrets ; j’aurais toujours la satisfaction d’avoir fait quelque chose pour lui, en attendant plus.
Mattia, qui avait une envie folle de voir une prison, m’accompagna ; d’ailleurs, je tenais à ce qu’il connût celui qui, pendant plus de deux ans, avait été un père pour moi.
Comme je savais maintenant le moyen à employer pour entrer dans la prison de Clichy, nous ne restâmes pas longtemps devant sa grosse porte, comme j’y étais resté la première fois que j’étais venu.
On nous fit entrer dans un parloir et bientôt le père arriva ; de la porte, il me tendit les bras.
— Ah ! le bon garçon, dit-il en m’embrassant, le brave Rémi !
Tout de suite je lui parlai de Lise et d’Alexis, puis comme je voulais lui expliquer pourquoi je n’avais pas pu aller chez Étiennette, il m’interrompit :
— Et tes parents ? dit-il.
— Vous savez donc ?
Alors il me raconta qu’il avait eu la visite de Barberin quinze jours auparavant.
— Il est mort, dis-je.
— En voilà un malheur !
Il m’expliqua comment Barberin s’était adressé à lui pour savoir ce que j’étais devenu : en arrivant à Paris, Barberin s’était rendu chez Garofoli, mais bien entendu il ne l’avait pas trouvé ; alors il avait été le chercher très-loin, en province, dans la prison où Garofoli était enfermé, et celui-ci lui avait appris qu’après la mort de Vitalis, j’avais été recueilli par un jardinier nommé Acquin ; Barberin était revenu à Paris, à la Glacière, et là il avait su que ce jardinier était détenu à Clichy. Il était venu à la prison, et le père lui avait dit comment je parcourais la France, de sorte que si l’on ne pouvait pas savoir au juste où je me trouvais en ce moment, il était certain qu’à une époque quelconque je passerais chez l’un de ses enfants. Alors il m’avait écrit lui-même à Dreuzy, à Varses, à Esnandes et à Saint-Quentin ; si je n’avais pas trouvé sa lettre à Dreuzy, c’est que j’en étais déjà parti sans doute lorsqu’elle y était arrivée.
— Et Barberin, que vous a-t-il dit de ma famille ? demandai-je.
— Rien, ou tout au moins peu de chose : tes parents avaient découvert chez le commissaire de police du quartier des Invalides que l’enfant abandonné avenue de Breteuil avait été recueilli par un maçon de Chavanon, nommé Barberin, et ils étaient venus te chercher chez lui ; ne te trouvant pas, ils lui avaient demandé de les aider dans leurs recherches.
— Il ne vous a pas dit leur nom, il ne vous a pas parlé de leur pays ?
— Quand je lui ai posé ces questions, il m’a dit qu’il m’expliquerait cela plus tard ; alors je n’ai pas insisté, comprenant bien qu’il faisait mystère du nom de tes parents de peur qu’on diminuât le gain qu’il espérait tirer d’eux ; comme j’ai été un peu ton père, il s’imaginait, ton Barberin, que je voulais me faire payer ; aussi je l’ai envoyé promener, et depuis je ne l’ai pas revu ; je ne me doutais guère qu’il était mort. De sorte que tu sais que tu as des parents, mais par suite des calculs de ce vieux grigou, tu ne sais ni qui ils sont, ni où ils sont.
Je lui expliquai quelle était notre espérance, et il la confirma par toutes sortes de bonnes raisons :
— Puisque tes parents ont bien su découvrir Barberin à Chavanon, puisque Barberin a bien su découvrir Garofoli et me découvrir moi-même ici, on te trouvera bien à l’hôtel du Cantal ; restes-y donc.
Ces paroles me furent douces, et elles me rendirent toute ma gaieté : le reste de notre temps se passa à parler de Lise, d’Alexis et de mon ensevelissement dans la mine.
— Quel terrible métier ! dit-il, quand je fus arrivé au bout de mon récit, et c’est celui de mon pauvre Alexis ; ah ! comme il était plus heureux à cultiver les giroflées.
— Cela reviendra, dis-je.
— Dieu t’entende, mon petit Rémi !
La langue me démangea pour lui dire que mes parents le feraient bientôt sortir de prison, mais je pensai à temps qu’il ne convenait point de se vanter à l’avance des joies que l’on se proposait de faire, et je me contentai de l’assurer que bientôt il serait en liberté avec tous ses enfants autour de lui.
— En attendant ce beau moment, me dit Mattia lorsque nous fûmes dans la rue, mon avis est que nous ne perdions pas notre temps et que nous gagnions de l’argent.
— Si nous avions employé moins de temps à gagner de l’argent en venant de Chavanon à Dreuzy et de Dreuzy à Paris, nous serions arrivés assez tôt à Paris pour voir Barberin.
— Cela c’est vrai, et je me reproche assez moi-même de t’avoir retardé, pour que tu ne me le reproches pas, toi.
— Ce n’est pas un reproche, mon petit Mattia, je t’assure ; sans toi je n’aurais pas pu donner à Lise sa poupée, et sans toi nous serions en ce moment sur le pavé de Paris, sans un sou pour manger.
— Eh bien alors, puisque j’ai eu raison de vouloir gagner de l’argent, faisons comme si j’avais encore raison dans ce moment : d’ailleurs nous n’avons rien de mieux à faire qu’à chanter et à jouer notre répertoire ; attendons pour nous promener que nous ayons ta voiture, cela sera moins fatigant ; à Paris je suis chez moi et je connais les bons endroits.
Il les connaissait si bien, les bons endroits, places publiques, cours particulières, cafés, que le soir nous comptâmes avant de nous coucher une recette de quatorze francs.
Alors, en m’endormant, je me répétai un mot que j’avais entendu dire souvent à Vitalis, que la fortune n’arrive qu’à ceux qui n’en ont pas besoin. Assurément une si belle recette était un signe certain que d’un instant à l’autre, mes parents allaient arriver.
J’étais si bien convaincu de la sûreté de mes pressentiments, que le lendemain je serais volontiers resté toute la journée à l’hôtel ; mais Mattia me força à sortir ; il me força aussi à jouer, à chanter, et ce jour-là nous fîmes encore une recette de onze francs.
— Si nous ne devions pas devenir riches bientôt par tes parents, disait Mattia, en riant, nous nous enrichirions nous-mêmes et seuls, ce qui serait joliment beau.
Trois jours se passèrent ainsi sans que rien de nouveau se produisît et sans que la femme de l’hôtel répondît autre chose à mes questions toujours les mêmes que son éternel refrain : « Personne n’est venu demander Barberin et je n’ai pas reçu de lettre pour vous ou pour Barberin » ; mais le quatrième jour enfin elle me tendit une lettre.
C’était la réponse de mère Barberin, ou plus justement la réponse que mère Barberin m’avait fait écrire, puisqu’elle ne savait elle-même ni lire ni écrire.
Elle me disait qu’elle avait été prévenue de la mort de son homme, et que peu de temps auparavant elle avait reçu de celui-ci une lettre qu’elle m’envoyait, pensant qu’elle pouvait m’être utile, puisqu’elle contenait des renseignements sur ma famille.
— Vite, vite, s’écria Mattia, lisons la lettre de Barberin.
Ce fut la main tremblante et le cœur serré que j’ouvris cette lettre :
« Je suis à l’hôpital, si malade que je crois que je ne me relèverai pas. Si j’en avais la force, je te dirais comment le mal m’est arrivé ; mais ça ne servirait à rien ; il vaut mieux aller au plus pressé. C’est donc pour te dire que si je n’en réchappe pas, tu devras écrire à Greth and Galley, Green-square, Lincoln’s-Inn, à Londres ; ce sont des gens de loi chargés de retrouver Rémi. Tu leur diras que seule tu peux leur donner des nouvelles de l’enfant, et tu auras soin de te faire bien payer ces nouvelles ; il faut que cet argent te fasse vivre heureuse dans ta vieillesse. Tu sauras ce que Rémi est devenu en écrivant à un nommé Acquin, ancien jardinier, maintenant détenu à la prison de Clichy à Paris. Fais écrire toutes tes lettres par M. le curé, car dans cette affaire il ne faut se fier à personne. N’entreprends rien avant de savoir si je suis mort.
« Je t’embrasse une dernière fois.
Je n’avais pas lu le dernier mot de cette lettre que Mattia se leva en faisant un saut.
— En avant pour Londres ! cria-t-il.
J’étais tellement surpris de ce que je venais de lire, que je regardai Mattia sans bien comprendre ce qu’il disait.
— Puisque la lettre de Barberin dit que ce sont des gens de loi anglais qui sont chargés de te retrouver, continua-t-il, cela signifie, n’est-ce pas, que tes parents sont Anglais.
— Mais…
— Cela t’ennuie, d’être Anglais ?
— J’aurais voulu être du même pays que Lise et les enfants.
— Moi j’aurais voulu que tu fusses Italien.
— Si je suis Anglais, je serai du même pays qu’Arthur et madame Milligan.
— Comment, si tu es Anglais ? mais cela est certain ; si tes parents étaient Français ils ne chargeraient point, n’est-ce pas, des gens de loi anglais de rechercher en France l’enfant qu’ils ont perdu. Puisque tu es Anglais, il faut aller en Angleterre. C’est le meilleur moyen de te rapprocher de tes parents.
— Si j’écrivais à ces gens de loi ?
— Pourquoi faire ? On s’entend bien mieux en parlant qu’en écrivant. Quand nous sommes arrivés à Paris, nous avions 17 francs ; nous avons fait un jour 14 francs de recette, puis 11, puis 9, cela donne 51 francs, sur quoi nous avons dépensé 8 francs ; il nous reste donc 43 francs, c’est plus qu’il en faut pour aller à Londres ; on s’embarque à Boulogne sur des bateaux qui vous portent à Londres, et cela ne coûte pas cher.
— Tu n’as pas été à Londres ?
— Tu sais bien que non ; seulement nous avions au cirque Gassot deux clowns qui étaient Anglais, ils m’ont souvent parlé de Londres et ils m’ont aussi appris bien des mots anglais pour que nous puissions parler ensemble sans que la mère Gassot, qui était curieuse comme une chouette, entendît ce que nous disions ; lui en avons-nous baragouiné des sottises anglaises en pleine figure sans qu’elle pût se fâcher. Je te conduirai à Londres.
— Moi aussi, j’ai appris l’anglais avec Vitalis.
— Oui, mais depuis trois ans tu as dû l’oublier, tandis que moi je le sais encore : tu verras. Et puis ce n’est pas seulement parce que je pourrais te servir que j’ai envie d’aller avec toi à Londres, et pour être franc, il faut que je te dise que j’ai encore une autre raison.
— Laquelle ?
— Si tes parents venaient te chercher à Paris, ils pourraient très-bien ne pas vouloir m’emmener avec toi, tandis que quand je serai en Angleterre ils ne pourront pas me renvoyer.
Une pareille supposition me paraissait blessante pour mes parents, mais enfin il était possible, à la rigueur, qu’elle fût raisonnable ; n’eût-elle qu’une chance de se réaliser, c’était assez de cette chance unique pour que je dusse accepter l’idée de partir tout de suite pour Londres avec Mattia.
— Partons, lui dis-je.
— Tu veux bien ?
En deux minutes nos sacs furent bouclés et nous descendîmes prêts à partir.
Quand elle nous vit ainsi équipés, la maîtresse d’hôtel poussa les hauts cris :
— Le jeune monsieur, — c’était moi le monsieur, — n’attendait donc pas ses parents ? cela serait bien plus sage ; et puis les parents verraient comme le jeune monsieur avait été bien soigné.
Mais ce n’était pas cette éloquence qui pouvait me retenir : après avoir payé notre nuit, je me dirigeai vers la rue où Mattia et Capi m’attendaient.
— Mais votre adresse ? dit la vieille.
Au fait il était peut-être sage de laisser mon adresse, je l’écrivis sur son livre.
— À Londres ! s’écria-t-elle, deux jeunesses à Londres ! par les grands chemins ! sur la mer !
Avant de nous mettre en route pour Boulogne, il fallait aller faire nos adieux au père.
Mais ils ne furent pas tristes ; le père fut heureux d’apprendre que j’allais bientôt retrouver ma famille, et moi j’eus plaisir à lui dire et à lui répéter que je ne tarderais pas à revenir avec mes parents pour le remercier.
— À bientôt, mon garçon, et bonne chance ! si tu ne reviens pas aussi tôt que tu le voudrais, écris-moi.
— Je reviendrai.
Ce jour-là nous allâmes sans nous arrêter jusqu’à Moisselles où nous couchâmes dans une ferme, car il importait de ménager notre argent pour la traversée ; Mattia avait dit qu’elle ne coûtait pas cher ; mais encore à combien montait ce pas cher ?
Tout en marchant, Mattia m’apprenait des mots anglais, car j’étais fortement préoccupé par une question qui m’empêchait de me livrer à la joie : mes parents comprendraient-ils le français ou l’italien ? Comment nous entendre s’ils ne parlaient que l’anglais ? Comme cela nous gênerait ! Que dirais-je à mes frères et à mes sœurs, si j’en avais ? Ne resterais-je point un étranger à leurs yeux tant que je ne pourrais m’entretenir avec eux ? Quand j’avais pensé à mon retour dans la maison paternelle, et bien souvent depuis mon départ de Chavanon, je m’étais tracé ce tableau, je n’avais jamais imaginé que je pourrais être ainsi paralysé dans mon élan. Il me faudrait longtemps sans doute avant de savoir l’anglais, qui me paraissait une langue difficile.
Nous mîmes huit jours pour faire le trajet de Paris à Boulogne, car nous nous arrêtâmes un peu dans les principales villes qui se trouvèrent sur notre passage : Beauvais, Abbeville, Montreuil-sur-Mer, afin de donner quelques représentations et de reconstituer notre capital.
Quand nous arrivâmes à Boulogne nous avions encore trente-deux francs dans notre bourse, c’est-à-dire beaucoup plus qu’il ne fallait pour payer notre passage.
Comme Mattia n’avait jamais vu la mer, notre première promenade fut pour la jetée : pendant quelques minutes il resta les yeux perdus dans les profondeurs vaporeuses de l’horizon, puis, faisant claquer sa langue, il déclara que c’était laid, triste et sale.
Une discussion s’engagea alors entre nous, car nous avions bien souvent parlé de la mer et je lui avais toujours dit que c’était la plus belle chose qu’on pût voir ; je soutins mon opinion.
— Tu as peut-être raison quand la mer est bleue comme tu racontes que tu l’as vue à Cette, dit Mattia, mais quand elle est comme cette mer, toute jaune et verte avec un ciel gris, et, de gros nuages sombres, c’est laid, très-laid, et ça ne donne pas envie d’aller dessus.
Nous étions le plus souvent d’accord, Mattia et moi, ou bien il acceptait mon sentiment, ou bien je partageais le sien, mais cette fois je persistai dans mon idée, et je déclarai même que cette mer verte, avec ses profondeurs vaporeuses et ses gros nuages que le vent poussait confusément, était bien plus belle qu’une mer bleue sous un ciel bleu.
— C’est parce que tu es Anglais que tu dis cela, répliqua Mattia, et tu aimes cette vilaine mer parce qu’elle est celle de ton pays.
Le bateau de Londres partait le lendemain à quatre heures du matin ; à trois heures et demie nous étions à bord et nous nous installions de notre mieux, à l’abri d’un amas de caisses qui nous protégeaient un peu contre une bise du nord humide et froide.
À la lueur de quelques lanternes fumeuses, nous vîmes charger le navire : les poulies grinçaient, les caisses qu’on descendait dans la cale craquaient et les matelots, de temps en temps, lançaient quelques mots avec un accent rauque ; mais ce qui dominait le tapage, c’était le bruissement de la vapeur qui s’échappait de la machine en petits flocons blancs. Une cloche tinta, des amarres tombèrent dans l’eau ; nous étions en route ; en route pour mon pays.
J’avais souvent dit à Mattia qu’il n’y avait rien de si agréable qu’une promenade en bateau : on glissait doucement sur l’eau sans avoir conscience de la route qu’on faisait, c’était vraiment charmant, — un rêve.
En parlant ainsi je songeais au Cygne et à notre voyage sur le canal du Midi ; mais la mer ne ressemble pas à un canal. À peine étions-nous sortis de la jetée que le bateau sembla s’enfoncer dans la mer, puis il se releva, s’enfonça encore au plus profond des eaux, et ainsi quatre ou cinq fois de suite par de grands mouvements comme ceux d’une immense balançoire ; alors, dans ces secousses, la vapeur s’échappait de la cheminée avec un bruit strident, puis tout à coup une sorte de silence se faisait, et l’on n’entendait plus que les roues qui frappaient l’eau, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, selon l’inclinaison du navire.
— Elle est jolie, ta glissade ! me dit Mattia.
Et je n’eus rien à lui répondre, ne sachant pas alors ce que c’était qu’une barre.
Mais ce ne fut pas seulement la barre qui imprima ces mouvements de roulis et de tangage au navire, ce fut aussi la mer qui, au large, se trouva être assez grosse.
Tout à coup Mattia, qui depuis assez longtemps ne parlait plus, se souleva brusquement.
— Qu’as-tu donc ? lui dis-je.
— J’ai que ça danse trop et que j’ai mal au cœur.
— C’est le mal de mer.
— Pardi, je le sens bien !
Et après quelques minutes il courut s’appuyer sur le bord du navire.
Ah ! le pauvre Mattia, comme il fut malade ; j’eus beau le prendre dans mes bras et appuyer sa tête contre ma poitrine, cela ne le guérit point ; il gémissait, puis de temps en temps se levant vivement, il courait s’accouder sur le bord du navire, et ce n’était qu’après quelques minutes qu’il revenait se blottir contre moi.
Alors, chaque fois qu’il revenait ainsi, il me montrait le poing, et, moitié riant, moitié colère, il disait :
— Oh ! ces Anglais, ça n’a pas de cœur.
— Heureusement.
Quand le jour se leva, un jour pâle, vaporeux et sans soleil, nous étions en vue de hautes falaises blanches, et çà et là on apercevait des navires immobiles et sans voiles. Peu à peu le roulis diminua et notre navire glissa sur l’eau tranquille presque aussi doucement que sur un canal. Nous n’étions plus en mer, et de chaque côté, tout au loin, on apercevait des rives boisées, ou plus justement on les devinait à travers les brumes du matin : nous étions entrés dans la Tamise.
— Nous voici en Angleterre, dis-je à Mattia.
Mais il reçut mal cette bonne nouvelle, et s’étalant de tout son long sur le pont :
— Laisse-moi dormir, répondit-il.
Comme je n’avais pas été malade pendant la traversée, je ne me sentais pas envie de dormir ; j’arrangeai Mattia pour qu’il fût le moins mal possible, et montant sur les caisses, je m’assis sur les plus élevées avec Capi entre mes jambes.
De là, je dominais la rivière et je voyais tout son cours de chaque côté, en amont, en arrière ; à droite s’étalait un grand banc de sable que l’écume frangeait d’un cordon blanc, et à gauche il semblait qu’on allait entrer de nouveau dans la mer.
Mais ce n’était là qu’une illusion, les rives bleuâtres ne tardèrent pas à se rapprocher, puis à se montrer plus distinctement jaunes et vaseuses.
Au milieu du fleuve se tenait toute une flotte de navires à l’ancre au milieu desquels couraient des vapeurs, des remorqueurs qui déroulaient derrière eux de longs rubans de fumée noire.
Que de navires ! que de voiles ! Je n’avais jamais imaginé qu’une rivière pût être aussi peuplée, et si la Garonne m’avait surpris la Tamise m’émerveilla. Plusieurs de ces navires étaient en train d’appareiller et dans leur mâture on voyait des matelots courir çà et là sur des échelles de corde qui, de loin, paraissaient fines comme des fils d’araignée.
Derrière lui, notre bateau laissait un sillage écumeux au milieu de l’eau jaune, sur laquelle flottaient des débris de toutes sortes, des planches, des bouts de bois, des cadavres d’animaux tout ballonnés, des bouchons, des herbes ; de temps en temps un oiseau aux grandes ailes s’abattait sur ces épaves, puis aussitôt il se relevait, pour s’envoler avec un cri perçant, sa pâture dans le bec.
Pourquoi Mattia voulait-il dormir ? Il ferait bien mieux de se réveiller : c’était là un spectacle curieux qui méritait d’être vu.
À mesure que notre vapeur remonta le fleuve, ce spectacle devint de plus en plus curieux, de plus en plus beau : ce n’était plus seulement les navires à voiles ou à vapeur qu’il était intéressant de suivre des yeux, les grands trois-mâts, les énormes steamers revenant des pays lointains, les charbonniers tout noirs, les barques chargées de paille ou de foin qui ressemblaient à des meules de fourrages emportées par le courant, les grosses tonnes rouges, blanches, noires, que le flot faisait tournoyer ; c’était encore ce qui se passait, ce qu’on apercevait sur les deux rives, qui maintenant se montraient distinctement avec tous leurs détails, leurs maisons coquettement peintes, leurs vertes prairies, leurs arbres que la serpe n’a jamais ébranchés, et çà et là des ponts d’embarquement s’avançant au-dessus de la vase noire, des signaux de marée, des pieux verdâtres et gluants.
Je restai ainsi longtemps, les yeux grands ouverts, ne pensant qu’à regarder, qu’à admirer.
Mais voilà que sur les deux rives de la Tamise les maisons se tassent les unes à côté des autres, en longues files rouges, l’air s’obscurcit ; la fumée et le brouillard se mêlent sans qu’on sache qui l’emporte en épaisseur du brouillard ou de la fumée, puis, au lieu d’arbres ou de bestiaux dans les prairies, c’est une forêt de mâts qui surgit tout à coup : les navires sont dans les prairies.
N’y tenant plus, je dégringole de mon observatoire et je vais chercher Mattia : il est réveillé et le mal de mer étant guéri, il n’est plus de méchante humeur, de sorte qu’il veut bien monter avec moi sur mes caisses ; lui aussi est ébloui et il se frotte les yeux : çà et là des canaux viennent de prairies déboucher dans le fleuve, et ils sont pleins aussi de navires.
Malheureusement le brouillard et la fumée s’épaississent encore ; on ne voit plus autour de soi que par échappées ; et plus on avance, moins on voit clair.
Enfin le navire ralentit sa marche, la machine s’arrête, des câbles sont jetés à terre ; nous sommes à Londres et nous débarquons au milieu de gens qui nous regardent, mais qui ne nous parlent pas.
— Voilà le moment de te servir de ton anglais, mon petit Mattia.
Et Mattia, qui ne doute de rien, s’approche d’un gros homme à barbe rousse pour lui demander poliment, le chapeau à la main, le chemin de Green square.
Il me semble que Mattia est bien longtemps à s’expliquer avec son homme qui, plusieurs fois, lui fait répéter les mêmes mots, mais je ne veux pas paraître douter du savoir de mon ami.
Enfin il revient :
— C’est très-facile, dit-il, il n’y a qu’à longer la Tamise ; nous allons suivre les quais.
Mais il n’y a pas de quais à Londres, ou plutôt il n’y en avait pas à cette époque, les maisons s’avançaient jusque dans la rivière ; nous sommes donc obligés de suivre des rues qui nous paraissent longer la rivière.
Elles sont bien sombres, ces rues, bien boueuses, bien encombrées de voitures, de caisses, de ballots, de paquets de toute espèce, et c’est difficilement que nous parvenons à nous faufiler au milieu de ces embarras sans cesse renaissants. J’ai attaché Capi avec une corde et je le tiens sur mes talons ; il n’est qu’une heure et pourtant le gaz est allumé dans les magasins, il pleut de la suie.
Vu sous cet aspect, Londres ne produit pas sur nous le même sentiment que la Tamise.
Nous avançons et de temps en temps Mattia demande si nous sommes loin encore de Lincoln’s Inn : il me rapporte que nous devons passer sous une grande porte qui barrera la rue que nous suivons. Cela me paraît bizarre, mais je n’ose pas lui dire que je crois qu’il se trompe.
Cependant il ne s’est point trompé et nous arrivons enfin à une arcade qui enjambe par-dessus la rue avec deux petites portes latérales : c’est Temple-Bar. De nouveau nous demandons notre chemin et l’on nous répond de tourner à droite.
Alors nous ne sommes plus dans une grande rue pleine de mouvement et de bruit ; nous nous trouvons au contraire, dans des petites ruelles silencieuses qui s’enchevêtrent les unes dans les autres, et il nous semble que nous tournons sur nous-mêmes sans avancer comme dans un labyrinthe.
Tout à coup au moment où nous nous croyons perdus, nous nous trouvons devant un petit cimetière plein de tombes, dont les pierres sont noires comme si on les avait peintes avec de la suie ou du cirage : c’est Green square.
Pendant que Mattia interroge une ombre qui passe, je m’arrête pour tâcher d’empêcher mon cœur de battre, je ne respire plus et je tremble.
Puis je suis Mattia et nous nous arrêtons devant une plaque en cuivre sur laquelle nous lisons : Greth and Galley.
Mattia s’avance pour tirer la sonnette, mais j’arrête son bras.
— Qu’as-tu ? me dit-il, comme tu es pâle.
— Attends un peu que je reprenne courage.
Il sonne et nous entrons.
Je suis tellement troublé, que je ne vois pas très-distinctement autour de moi ; il me semble que nous sommes dans un bureau et que deux ou trois personnes penchées sur des tables écrivent à la lueur de plusieurs becs de gaz qui brûlent en chantant.
C’est à l’une de ces personnes que Mattia s’adresse, car bien entendu je l’ai chargé de porter la parole. Dans ce qu’il dit reviennent plusieurs fois les mots de boy, family et Barberin ; je comprends qu’il explique que je suis le garçon que ma famille a chargé Barberin de retrouver. Le nom de Barberin produit de l’effet : on nous regarde, et celui à qui Mattia parlait se lève pour nous ouvrir une porte.
Nous entrons dans une pièce pleine de livres et de papiers : un monsieur est assis devant un bureau, et un autre en robe et en perruque, tenant à la main plusieurs sacs bleus, s’entretient avec lui.
En peu de mots, celui qui nous précède explique qui nous sommes, et alors les deux messieurs nous regardent de la tête aux pieds.
— Lequel de vous est l’enfant élevé par Barberin ? dit en français le monsieur assis devant le bureau.
En entendant parler français, je me sens rassuré et j’avance d’un pas :
— Moi, monsieur.
— Où est Barberin ?
— Il est mort.
Les deux messieurs se regardent un moment, puis celui qui a une perruque sur la tête sort en emportant ses sacs.
— Alors, comment êtes-vous venus ? demande le monsieur qui avait commencé à m’interroger.
— À pied jusqu’à Boulogne et de Boulogne à Londres en bateau ; nous venons de débarquer.
— Barberin vous avait donné de l’argent ?
— Nous n’avons pas vu Barberin.
— Alors comment avez-vous su que vous deviez venir ici ?
Je fis aussi court que possible le récit qu’on me demandait.
J’avais hâte de poser à mon tour quelques questions, une surtout qui me brûlait les lèvres, mais je n’en eus pas le temps.
Il fallut que je racontasse comment j’avais été élevé par Barberin, comment j’avais été vendu par celui-ci à Vitalis, comment à la mort de mon maître j’avais été recueilli par la famille Acquin, enfin comment le père ayant été mis en prison pour dettes, j’avais repris mon ancienne existence de musicien ambulant.
À mesure que je parlais, le monsieur prenait des notes et il me regardait d’une façon qui me gênait : il faut dire que son visage était dur, avec quelque chose de fourbe dans le sourire.
— Et quel est ce garçon, dit-il, en désignant Mattia du bout de sa plume de fer, comme s’il voulait lui darder une flèche.
— Un ami, un camarade, un frère.
— Très-bien ; simple connaissance faite sur les grands chemins, n’est-ce pas ?
— Le plus tendre, le plus affectueux des frères.
— Oh ! Je n’en doute pas.
Le moment me parut venu de poser enfin la question qui depuis le commencement de notre entretien m’oppressait.
— Ma famille, monsieur, habite l’Angleterre ?
— Certainement elle habite Londres ; au moins en ce moment.
— Alors je vais la voir ?
— Dans quelques instants vous serez près d’elle. Je vais vous faire conduire.
Il sonna.
— Encore un mot, monsieur, je vous prie : J’ai un père ?
Ce fut à peine si je pus prononcer ce mot.
— Non-seulement un père, mais une mère, des frères, des sœurs.
— Ah ! monsieur.
Mais la porte en s’ouvrant coupa mon effusion : je ne pus que regarder Mattia les yeux pleins de larmes.
Le monsieur s’adressa en anglais à celui qui entrait et je crus comprendre qu’il lui disait de nous conduire.
Je m’étais levé.
— Ah ! j’oubliais, dit le monsieur, votre nom est Driscoll, c’est le nom de votre père.
Malgré sa mauvaise figure je crois que je lui aurais sauté au cou s’il m’en avait donné le temps ; mais de la main il nous montra la porte et nous sortîmes.
XIII
LA FAMILLE DRISCOLL
Le clerc qui devait me conduire chez mes parents était un vieux petit bonhomme ratatiné, parcheminé, ridé, vêtu d’un habit noir râpé et lustré, cravaté de blanc ; lorsque nous fûmes dehors il se frotta les mains frénétiquement en faisant craquer les articulations de ses doigts et de ses poignets, secoua ses jambes comme s’il voulait envoyer au loin ses bottes éculées et levant le nez en l’air, il aspira fortement le brouillard à plusieurs reprises, avec la béatitude d’un homme qui a été enfermé.
— Il trouve que ça sent bon, me dit Mattia en italien.
Le vieux bonhomme nous regarda, et sans nous parler, il nous fit « psit, psit », comme s’il s’était adressé à des chiens, ce qui voulait dire que nous devions marcher sur ses talons et ne pas le perdre.
Nous ne tardâmes pas à nous trouver dans une grande rue encombrée de voitures ; il en arrêta au passage une dont le cocher au lieu d’être assis sur son siège derrière son cheval, était perché en l’air derrière et tout au haut d’une sorte de capote de cabriolet ; je sus plus tard que cette voiture s’appelait un cab.
Il nous fit monter dans cette voiture qui n’était pas close par devant, et au moyen d’un petit judas ouvert dans la capote il engagea un dialogue avec le cocher ; plusieurs fois le nom de Bethnal-Green fut prononcé et je pensai que c’était le nom du quartier dans lequel demeuraient mes parents ; je savais que green en anglais veut dire vert et cela me donna l’idée que ce quartier devait être planté de beaux arbres, ce qui tout naturellement me fut très-agréable ; cela ne ressemblerait point aux vilaines rues de Londres si sombres et si tristes que nous avions traversées en arrivant ; c’était très-joli une maison dans une grande ville, entourée d’arbres.
La discussion fut assez longue entre notre conducteur et le cocher ; tantôt c’était l’un qui se haussait au judas pour donner des explications, tantôt c’était l’autre qui semblait vouloir se précipiter de son siège par cette étroite ouverture pour dire qu’il ne comprenait absolument rien à ce qu’on lui demandait.
Mattia et moi nous étions tassés dans un coin avec Capi entre mes jambes, et, en écoutant cette discussion, je me disais qu’il était vraiment bien étonnant qu’un cocher ne parût pas connaître un endroit aussi joli que devait l’être Bethnal-Green ; il y avait donc bien des quartiers verts à Londres ? Cela était assez étonnant, car d’après ce que nous avions déjà vu, j’aurais plutôt cru à de la suie.
Nous roulons assez vite dans des rues larges, puis dans des rues étroites, puis dans d’autres rues larges, mais sans presque rien voir autour de nous, tant le brouillard qui nous enveloppe est opaque ; il commence à faire froid, et cependant nous éprouvons un sentiment de gêne dans la respiration comme si nous étouffions. Quand je dis nous, il s’agit de Mattia et de moi, car notre guide paraît au contraire se trouver à son aise ; en tout cas, il respire l’air fortement, la bouche ouverte, en reniflant, comme s’il était pressé d’emmagasiner une grosse provision d’air dans ses poumons, puis, de temps en temps, il continue à faire craquer ses mains et à détirer ses jambes. Est-ce qu’il est resté pendant plusieurs années sans remuer et sans respirer ?
Malgré l’émotion qui m’enfièvre à la pensée que dans quelques instants, dans quelques secondes peut-être, je vais embrasser mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, j’ai grande envie de voir la ville que nous traversons : n’est-ce pas ma ville, ma patrie ?
Mais, j’ai beau ouvrir les yeux, je ne vois rien ou presque rien, si ce n’est les lumières rouges du gaz qui brûlent dans le brouillard, comme dans un épais nuage de fumée ; c’est à peine si on aperçoit les lanternes des voitures que nous croisons, et, de temps en temps nous nous arrêtons court, pour ne pas accrocher ou pour ne pas écraser des gens qui encombrent les rues.
Nous roulons toujours ; il y a déjà bien longtemps que nous sommes sortis de chez Greth and Galley ; cela me confirme dans l’idée que mes parents demeurent à la campagne ; bientôt sans doute nous allons quitter les rues étroites pour courir dans les champs.
Comme nous nous tenons la main, Mattia et moi, cette pensée que je vais retrouver mes parents me fait serrer la sienne ; il me semble qu’il est nécessaire de lui exprimer que je suis son ami, en ce moment même, plus que jamais et pour toujours.
Mais au lieu d’arriver dans la campagne, nous entrons dans des rues plus étroites, et nous entendons le sifflet des locomotives.
Alors je prie Mattia de demander à notre guide si nous n’allons pas enfin arriver chez mes parents ; la réponse de Mattia est désespérante : il prétend que le clerc de Greth and Galley a dit qu’il n’était jamais venu dans ce quartier de voleurs. Sans doute Mattia se trompe, il ne comprend pas ce qu’on lui a répondu. Mais il soutient que thieves, le mot anglais dont le clerc s’est servi, signifie bien voleurs en français, et qu’il en est sûr. Je reste un moment déconcerté, puis je me dis que si le clerc a peur des voleurs, c’est que justement nous allons entrer dans la campagne, et que le mot green qui se trouve après Bethnal, s’applique bien à des arbres et à des prairies. Je communique cette idée à Mattia, et la peur du clerc nous fait beaucoup rire : comme les gens qui ne sont pas sortis des villes sont bêtes !
Mais rien n’annonce la campagne : l’Angleterre n’est donc qu’une ville de pierre et de boue qui s’appelle Londres ? Cette boue nous inonde dans notre voiture, elle jaillit jusque sur nous en plaques noires ; une odeur infecte nous enveloppe depuis assez longtemps déjà ; tout cela indique que nous sommes dans un vilain quartier, le dernier sans doute, avant d’arriver dans les prairies de Bethnal-Green. Il me semble que nous tournons sur nous-mêmes, et de temps en temps notre cocher ralentit sa marche, comme s’il ne savait plus où il est. Tout à coup, il s’arrête enfin brusquement, et notre judas s’ouvre.
Alors une conversation ou plus justement une discussion, s’engage : Mattia me dit qu’il croit comprendre que notre cocher ne veut pas aller plus loin, parce qu’il ne connaît pas son chemin ; il demande des indications au clerc de Greth and Galley, et celui-ci continue à répondre qu’il n’est jamais venu dans ce quartier de voleurs : j’entends le mot thieves.
Assurément, ce n’est pas là Bethnal-Green.
Que va-t-il se passer ?
La discussion continue par le judas, et c’est avec une égale colère que le cocher et le clerc s’envoient leurs répliques par ce trou.
Enfin, le clerc après avoir donné de l’argent au cocher qui murmure, descend du cab, et de nouveau, il nous fait « psit, psit » ; il est clair que nous devons descendre à notre tour.
Nous voilà dans une rue fangeuse, au milieu du brouillard ; une boutique est brillamment illuminée, et le gaz reflété par des glaces, par des dorures et par des bouteilles taillées à facettes, se répand dans la rue, où il perce le brouillard jusqu’au ruisseau : c’est une taverne, ou mieux ce que les Anglais nomment un gin palace, un palais dans lequel on vend de l’eau-de-vie de genièvre et aussi des eaux-de-vie de toutes sortes, qui, les unes comme les autres, ont pour même origine l’alcool de grain ou de betterave.
— Psit ! psit ! fait notre guide.
Et nous entrons avec lui dans ce gin palace. Décidément, nous avons eu tort de croire que nous étions dans un misérable quartier ; je n’ai jamais vu rien de plus luxueux ; partout des glaces et des dorures, le comptoir est en argent. Cependant, les gens qui se tiennent debout devant ce comptoir ou appuyés de l’épaule contre les murailles ou contre les tonneaux, sont déguenillés, quelques-uns n’ont pas de souliers, et leurs pieds nus qui ont pataugé dans la boue des cloaques, sont aussi noirs que s’ils avaient été cirés avec un cirage qui n’aurait pas encore eu le temps de sécher.
Sur ce beau comptoir en argent, notre guide se fait servir un verre d’une liqueur blanche qui sent bon, et, après l’avoir vidé d’un trait avec l’avidité qu’il mettait, quelques instants auparavant, à avaler le brouillard, il engage une conversation avec l’homme aux bras nus jusqu’au coude qui l’a servi.
Il n’est pas bien difficile de deviner qu’il demande son chemin, et je n’ai pas besoin d’interroger Mattia.
De nouveau nous cheminons sur les talons de notre guide ; maintenant la rue est si étroite que malgré le brouillard nous voyons les maisons qui la bordent de chaque côté ; des cordes sont tendues en l’air de l’une à l’autre de ces maisons, et çà et là des linges et des haillons pendent à ces cordes. Assurément ce n’est pas pour sécher qu’ils sont là.
Où allons-nous ? Je commence à être inquiet, et de temps en temps Mattia me regarde ; cependant il ne m’interroge pas.
De la rue nous sommes passés dans une ruelle, puis dans une cour, puis dans une ruelle encore ; les maisons sont plus misérables que dans le plus misérable village de France ; beaucoup sont en planches comme des hangars ou des étables, et cependant ce sont bien des maisons ; des femmes tête nue, et des enfants grouillent sur les seuils.
Quand une faible lueur nous permet de voir un peu distinctement autour de nous, je remarque que ces femmes sont pâles, leurs cheveux d’un blond de lin pendent sur leurs épaules ; les enfants sont presque nus et les quelques vêtements qu’ils ont sur le dos sont en guenilles : dans une ruelle, nous trouvons des porcs qui farfouillent dans le ruisseau stagnant, d’où se dégage une odeur fétide.
Notre guide ne tarde pas à s’arrêter ; assurément il est perdu ; mais à ce moment vient à nous un homme vêtu d’une longue redingote bleue et coiffé d’un chapeau garni de cuir verni ; autour de son poignet, est passé un galon noir et blanc ; un étui est suspendu à sa ceinture ; c’est un homme de police, un policeman.
Une conversation s’engage, et bientôt nous nous remettons en route, précédés du policeman ; nous traversons des ruelles, des cours, des rues tortueuses ; il me semble que çà et là des maisons sont effondrées.
Enfin nous nous arrêtons dans une cour dont le milieu est occupé par une petite mare.
— Red lion court, dit le policeman.
Ces mots que j’ai entendu prononcer plusieurs fois déjà signifient : « Cour du Lion-Rouge », m’a dit Mattia.
Pourquoi nous arrêtons-nous ? Il est impossible que nous soyons à Bethnal-Green ; est-ce que c’est dans cette cour que demeurent mes parents ? Mais alors ?…
Je n’ai pas le temps d’examiner ces questions qui passent devant mon esprit inquiet ; le policeman a frappé à la porte d’une sorte de hangar en planches et notre guide le remercie ; nous sommes donc arrivés.
Mattia, qui ne m’a pas lâché la main, me la serre, et je serre la sienne.
Nous nous sommes compris : l’angoisse qui étreint mon cœur étreint le sien aussi.
J’étais tellement troublé que je ne sais trop comment la porte à laquelle le policeman avait frappé nous fut ouverte, mais à partir du moment où nous fûmes entrés dans une vaste pièce qu’éclairaient une lampe et un feu de charbon de terre brûlant dans une grille, mes souvenirs me reviennent.
Devant ce feu, dans un fauteuil en paille qui avait la forme d’une niche de saint, se tenait immobile comme une statue un vieillard à barbe blanche, la tête couverte d’un bonnet noir ; en face l’un de l’autre, mais séparés par une table, étaient assis un homme et une femme ; l’homme avait quarante ans environ, il était vêtu d’un costume de velours gris, sa physionomie était intelligente mais dure ; la femme, plus jeune de cinq ou six ans, avait des cheveux blonds qui pendaient sur un châle à carreaux blancs et noirs croisé autour de sa poitrine ; ses yeux n’avaient pas de regard et l’indifférence ou l’apathie était empreinte sur son visage qui avait dû être beau, comme dans ses gestes indolents ; dans la pièce se trouvaient quatre enfants, deux garçons et deux filles, tous blonds, d’un blond de lin comme leur mère ; l’aîné des garçons paraissait être âgé de onze ou douze ans ; la plus jeune des petites filles avait trois ans à peine, elle marchait en se traînant à terre.
Je vis tout cela d’un coup d’œil et avant que notre guide, le clerc de Greth and Galley, eût achevé de parler.
Que dit-il ? Je l’entendis à peine et je ne le compris pas du tout ; le nom de Driscoll, mon nom m’avait dit l’homme d’affaires, frappa seulement mon oreille.
Tous les yeux s’étaient tournés vers Mattia et vers moi, même ceux du vieillard immobile ; seule la petite fille prêtait attention à Capi.
— Lequel de vous deux est Rémi ? demanda en français l’homme au costume de velours gris.
Je m’avançai d’un pas.
— Moi, dis-je.
— Alors, embrasse ton père, mon garçon.
Quand j’avais pensé à ce moment, je m’étais imaginé que j’éprouverais un élan qui me pousserait dans les bras de mon père ; je ne trouvai pas cet élan en moi. Cependant je m’avançai et j’embrassai mon père.
— Maintenant, me dit-il, voilà ton grand-père, ta mère, tes frères et tes sœurs.
J’allai à ma mère tout d’abord et la pris dans mes bras ; elle me laissa l’embrasser, mais elle-même elle ne m’embrassa point, elle me dit seulement deux ou trois paroles que je ne compris pas.
— Donne une poignée de main à ton grand-père, me dit mon père, et vas-y doucement : il est paralysé.
Je donnai aussi la main à mes deux frères et à ma sœur aînée ; je voulus prendre la petite dans mes bras, mais comme elle était occupée à flatter Capi, elle me repoussa.
Tout en allant ainsi de l’un à l’autre, j’étais indigné contre moi-même : eh quoi ! je ne ressentais pas plus de joie à me retrouver enfin dans ma famille ; j’avais un père, une mère, des frères, des sœurs, j’avais un grand-père, j’étais réuni à eux et je restais froid ; j’avais attendu ce moment avec une impatience fiévreuse, j’avais été fou de joie en pensant que moi aussi j’allais avoir une famille, des parents à aimer, qui m’aimeraient, et je restais embarrassé, les examinant tous curieusement, et ne trouvant rien en mon cœur à leur dire, pas une parole de tendresse. J’étais donc un monstre ? Je n’étais donc pas digne d’avoir une famille ?
Si j’avais trouvé mes parents dans un palais au lieu de les trouver dans un hangar, n’aurais-je pas éprouvé pour eux ces sentiments de tendresse que quelques heures auparavant je ressentais en mon cœur pour un père et une mère que je ne connaissais pas, et que je ne pouvais pas exprimer à un père et à une mère que je voyais ?
Cette idée m’étouffa de honte : revenant devant ma mère, je la pris de nouveau dans mes bras et je l’embrassai à pleines lèvres : sans doute elle ne comprit pas ce qui provoquait cet élan, car au lieu de me rendre mes baisers, elle me regarda de son air indolent, puis s’adressant à son mari, mon père, en haussant doucement les épaules, elle lui dit quelques mots que je ne compris pas, mais qui firent rire celui-ci : cette indifférence d’une part et d’autre part ce rire me serrèrent le cœur à le briser, il me semblait que cette effusion de tendresse ne méritait pas qu’on la reçût ainsi.
Mais on ne me laissa pas le temps de me livrer à mes impressions.
— Et celui-là, demanda mon père en désignant Mattia, quel est-il ?
J’expliquai quels liens m’attachaient à Mattia, et je le fis en m’efforçant de mettre dans mes paroles un peu de l’amitié que j’éprouvais, et aussi en tâchant d’expliquer la reconnaissance que je lui devais.
— Bon, dit mon père, il a voulu voir du pays.
J’allais répondre ; Mattia me coupa la parole :
— Justement, dit-il.
— Et Barberin ? demanda mon père. Pourquoi donc n’est-il pas venu ?
J’expliquai que Barberin était mort, ce qui avait été une grande déception pour moi lorsque nous étions arrivés à Paris, après avoir appris à Chavanon par mère Barberin que mes parents me cherchaient.
Alors mon père traduisit à ma mère ce que je venais de dire et je crus comprendre que celle-ci répondit que c’était très-bon ou très-bien ; en tous cas elle prononça à plusieurs reprises les mots well et good que je connaissais. Pourquoi était-il bon et bien que Barberin fût mort ? ce fut ce que je me demandai sans trouver de réponse à cette question.
— Tu ne sais pas l’anglais ? me demanda mon père.
— Non ; je sais seulement le français et aussi l’italien pour l’avoir appris avec un maître à qui Barberin m’avait loué.
— Vitalis ?
— Vous avez su…
— C’est Barberin qui m’a dit son nom, lorsqu’il y a quelque temps je me suis rendu en France pour te chercher. Mais tu dois être curieux de savoir comment nous ne t’avons pas cherché pendant treize ans, et comment tout à coup nous avons eu l’idée d’aller trouver Barberin.
— Oh ! oui, très-curieux, je vous assure, bien curieux.
— Alors viens là auprès du feu, je vais te conter cela.
En entrant j’avais déposé ma harpe contre la muraille, je débouclai mon sac et pris la place qui m’était indiquée.
Mais comme j’étendais mes jambes crottées et mouillées devant le feu, mon grand-père cracha de mon côté sans rien dire, à peu près comme un vieux chat en colère ; je n’eus pas besoin d’autre explication pour comprendre que je le gênais, et je retirai mes jambes.
— Ne fais pas attention, dit mon père, le vieux n’aime pas qu’on se mette devant son feu, mais si tu as froid chauffe-toi ; il n’y a pas besoin de se gêner avec lui.
Je fus abasourdi d’entendre parler ainsi de ce vieillard à cheveux blancs ; il me semblait que si l’on devait se gêner avec quelqu’un, c’était précisément avec lui ; je tins donc mes jambes sous ma chaise.
— Tu es notre fils aîné, me dit mon père, et tu es né un an après mon mariage avec ta mère. Quand j’épousai ta mère, il y avait une jeune fille qui croyait que je la prendrais pour femme, et à qui ce mariage inspira une haine féroce contre celle qu’elle considérait comme sa rivale. Ce fut pour se venger que le jour juste où tu atteignais tes six mois, elle te vola et t’emporta en France, à Paris, où elle t’abandonna dans la rue. Nous fîmes toutes les recherches possibles, mais cependant sans aller jusqu’à Paris, car nous ne pouvions pas supposer qu’on t’avait porté si loin. Nous ne te retrouvâmes point, et nous te croyions mort et perdu à jamais, lorsqu’il y a trois mois, cette femme, atteinte d’une maladie mortelle, révéla, avant de mourir, la vérité. Je partis aussitôt pour la France et j’allai chez le commissaire de police du quartier dans lequel tu avais été abandonné. Là on m’apprit que tu avais été adopté par un maçon de la Creuse, celui-là même qui t’avait trouvé, et aussitôt je me rendis à Chavanon. Barberin me dit qu’il t’avait loué à Vitalis, un musicien ambulant et que tu parcourais la France avec celui-ci. Comme je ne pouvais pas rester en France et me mettre à la poursuite de Vitalis, je chargeai Barberin de ce soin et lui donnai de l’argent pour venir à Paris. En même temps je lui recommandais d’avertir les gens de loi qui s’occupent de mes affaires, MM. Greth et Galley, quand il t’aurait retrouvé. Si je ne lui donnai point mon adresse ici, c’est que nous n’habitons Londres que dans l’hiver ; pendant la belle saison nous parcourons l’Angleterre et l’Écosse pour notre commerce de marchands ambulants avec nos voitures et notre famille. Voilà, mon garçon, comment tu as été retrouvé, et comment après treize ans, tu reprends ici ta place, dans la famille. Je comprends que tu sois un peu effarouché car tu ne nous connais pas, et tu n’entends pas ce que nous disons de même que tu ne peux pas te faire entendre ; mais j’espère que tu t’habitueras vite.
Oui sans doute, je m’habituerais vite ; n’était-ce pas tout naturel puisque j’étais dans ma famille, et que ceux avec qui j’allais vivre étaient mes père et mère, mes frères et sœurs ?
Les beaux langes n’avaient pas dit vrai ; pour mère Barberin, pour Lise, pour le père Acquin, pour ceux qui m’avaient secouru c’était un malheur ; je ne pourrais pas faire pour eux ce que j’avais rêvé, car des marchands ambulants, alors surtout qu’ils demeurent dans un hangar, ne doivent pas être bien riches ; mais pour moi qu’importait après tout : j’avais une famille et c’était un rêve d’enfant de s’imaginer que la fortune serait ma mère : tendresse vaut mieux que richesse : ce n’était pas d’argent que j’avais besoin, c’était d’affection.
Pendant que j’écoutais le récit de mon père, n’ayant des yeux et des oreilles que pour lui, on avait dressé le couvert sur la table : des assiettes à fleurs bleues, et dans un plat en métal un gros morceau de bœuf cuit au four avec des pommes de terre tout autour.
— Avez-vous faim, les garçons ? nous demanda mon père en s’adressant à Mattia et à moi.
Pour toute réponse, Mattia montra ses dents blanches.
— Eh bien, mettons-nous à table, dit mon père.
Mais avant de s’asseoir, il poussa le fauteuil de mon grand-père jusqu’à la table. Puis prenant place lui-même le dos au feu, il commença à couper le roast-beef et il nous en servit à chacun une belle tranche accompagnée de pommes de terre.
Quoique je n’eusse pas été élevé dans des principes de civilité, ou plutôt pour dire vrai, bien que je n’eusse pas été élevé du tout, je remarquai que mes frères et ma sœur aînée mangeaient le plus souvent avec leurs doigts, qu’ils trempaient dans la sauce et qu’ils léchaient sans que mon père ni ma mère parussent s’en apercevoir ; quant à mon grand-père, il n’avait d’attention que pour son assiette, et la seule main dont il pût se servir allait continuellement de cette assiette à sa bouche ; quand il laissait échapper un morceau de ses doigts tremblants mes frères se moquaient de lui.
Le souper achevé, je crus que nous allions passer la soirée devant le feu ; mais mon père me dit qu’il attendait des amis, et que nous devions nous coucher ; puis, prenant une chandelle, il nous conduisit dans une remise qui tenait à la pièce où nous avions mangé : là se trouvaient deux de ces grandes voitures qui servent ordinairement aux marchands ambulants. Il ouvrit la porte de l’une et nous vîmes qu’il s’y trouvait deux lits superbes.
— Voilà vos lits, dit-il ; dormez bien.
Telle fut ma réception dans ma famille, — la famille Driscoll.
XIV
PÈRE ET MÈRE HONORERAS
Mon père en se retirant, nous avait laissé la chandelle, mais il avait fermé en dehors la porte de notre voiture : nous n’avions donc qu’à nous coucher ; ce que nous fîmes au plus vite, sans bavarder comme nous en avions l’habitude tous les soirs, et sans nous raconter nos impressions de cette journée si remplie.
— Bonsoir, Rémi, me dit Mattia.
— Bonsoir, Mattia.
Mattia n’avait pas plus envie de parler que je n’en avais envie moi-même, et je fus heureux de son silence.
Mais n’avoir pas envie de parler n’est pas avoir envie de dormir ; la chandelle éteinte, il me fut impossible de fermer les yeux, et je me mis à réfléchir à tout ce qui venait de se passer, en me tournant et me retournant dans mon étroite couchette.
Tout en réfléchissant, j’entendais Mattia, qui occupait la couchette placée au-dessus de la mienne, s’agiter et se tourner aussi, ce qui prouvait qu’il ne dormait pas mieux que moi.
— Tu ne dors pas ? lui dis-je à voix basse.
— Non, pas encore.
— Es-tu mal ?
— Non, je te remercie, je suis très-bien, au contraire, seulement tout tourne autour de moi, comme si j’étais encore sur la mer, et la voiture s’élève et s’enfonce, en roulant de tous côtés.
Était-ce seulement le mal de mer qui empêchait Mattia de s’endormir ? les pensées qui le tenaient éveillé n’étaient-elles pas les mêmes que les miennes ? Il m’aimait assez, et nous étions assez étroitement unis de cœur comme d’esprit pour qu’il sentît ce que je sentais moi-même.
Le sommeil ne vint pas, et le temps en s’écoulant, augmenta l’effroi vague qui m’oppressait : tout d’abord je n’avais pas bien compris l’impression qui dominait en moi parmi toutes celles qui se choquaient dans ma tête en une confusion tumultueuse, mais maintenant je voyais que c’était la peur. Peur de quoi ? Je n’en savais rien, mais enfin j’avais peur. Et ce n’était pas d’être couché dans cette voiture, au milieu de ce quartier misérable de Bethnal-Green que j’étais effrayé. Combien de fois dans mon existence vagabonde avais-je passé des nuits n’étant pas protégé comme je l’étais en ce moment. J’avais conscience d’être à l’abri de tout danger, et cependant j’étais épouvanté ; plus je me raidissais contre cette épouvante, moins je parvenais à me rassurer.
Les heures s’écoulèrent les unes après les autres sans que je pusse me rendre compte de l’avancement de la nuit, car il n’y avait pas aux environs d’horloges qui sonnassent : tout à coup j’entendis un bruit assez fort à la porte de la remise, qui ouvrait sur une autre rue que la cour du Lion-Rouge ; puis après plusieurs appels frappés à intervalles réguliers, une lueur pénétra dans notre voiture.
Surpris, je regardai vivement autour de moi, tandis que Capi, qui dormait contre ma couchette, se réveillait pour gronder ; je vis alors que cette lueur nous arrivait par une petite fenêtre pratiquée dans la paroi de notre voiture, contre laquelle nos lits étaient appliqués et que je n’avais pas remarquée en me couchant parce qu’elle était recouverte à l’intérieur par un rideau ; une moitié de cette fenêtre se trouvait dans le lit de Mattia, l’autre moitié dans le mien. Ne voulant pas que Capi réveillât toute la maison, je lui posai une main sur la gueule, puis je regardai au dehors.
Mon père, entré sous la remise, avait vivement et sans bruit ouvert la porte de la rue, puis il l’avait refermée de la même manière après l’entrée de deux hommes lourdement chargés de ballots qu’ils portaient sur leurs épaules.
Alors il posa un doigt sur ses lèvres et de son autre main qui tenait une lanterne sourde à volets, il montra la voiture dans laquelle nous étions couchés ; cela voulait dire qu’il ne fallait pas faire de bruit de peur de nous réveiller.
Cette attention me toucha et j’eus l’idée de lui crier qu’il n’avait pas besoin de se gêner pour moi, attendu que je ne dormais pas, mais comme ç’aurait été réveiller Mattia, qui lui dormait tranquillement sans doute, je me tus.
Mon père aida les deux hommes à se décharger de leurs ballots, puis il disparut un moment et revint bientôt avec ma mère. Pendant son absence, les hommes avaient ouvert leurs paquets ; l’un était plein de pièces d’étoffes ; dans l’autre se trouvaient des objets de bonneterie, des tricots, des caleçons, des bas, des gants.
Alors je compris ce qui tout d’abord m’avait étonné : ces gens étaient des marchands qui venaient vendre leurs marchandises à mes parents.
Mon père prenait chaque objet, l’examinait à la lumière de sa lanterne, et le passait à ma mère qui avec des petits ciseaux coupait les étiquettes, qu’elle mettait dans sa poche.
Cela me parut bizarre, de même que l’heure choisie pour cette vente me paraissait étrange.
Tout en procédant à cet examen, mon père adressait quelques paroles à voix basse aux hommes qui avaient apporté ces ballots : si j’avais su l’anglais, j’aurais peut-être entendu ces paroles, mais on entend mal ce qu’on ne comprend pas ; il n’y eut guère que le mot policemen, plusieurs fois répété, qui frappa mon oreille.
Lorsque le contenu des ballots eut été soigneusement visité, mes parents et les deux hommes sortirent de la remise pour entrer dans la maison, et de nouveau l’obscurité se fit autour de nous ; il était évident qu’ils allaient régler leur compte.
Je voulus me dire qu’il n’y avait rien de plus naturel que ce que je venais de voir, cependant je ne pus pas me convaincre moi-même, si grande que fût ma bonne volonté : pourquoi ces gens venant chez mes parents n’étaient-ils pas entrés par la cour du Lion-Rouge ? Pourquoi avait-on parlé de la police à voix basse comme si l’on craignait d’être entendu du dehors ? Pourquoi ma mère avait-elle coupé les étiquettes qui pendaient après les effets qu’elle achetait ?
Ces questions n’étaient pas faites pour m’endormir, et comme je ne leur trouvais pas de réponse, je tâchais de les chasser de mon esprit, mais c’était en vain. Après un certain temps, je vis de nouveau la lumière emplir notre voiture, et de nouveau je regardai par la fente de mon rideau ; mais cette fois ce fut malgré moi et contre ma volonté, tandis que la première j’avais été tout naturellement pour voir et savoir. Maintenant je me disais que je ne devrais pas regarder, et cependant je regardai. Je me disais qu’il vaudrait mieux sans doute ne pas savoir, et cependant je voulus voir.
Mon père et ma mère étaient seuls ; tandis que ma mère faisait rapidement deux paquets des objets apportés, mon père balayait un coin de la remise ; sous le sable sec qu’il enlevait à grands coups de balai apparut bientôt une trappe : il la leva ; puis comme ma mère avait achevé de ficeler les deux ballots il les descendit par cette trappe dans une cave dont je ne vis pas la profondeur, tandis que ma mère l’éclairait avec la lanterne ; les deux ballots descendus, il remonta, ferma la trappe et avec son balai replaça dessus le sable qu’il avait enlevé ; quand il eut achevé sa besogne il fut impossible de voir où se trouvait l’ouverture de cette trappe ; sur le sable ils avaient tous les deux semé des brins de paille comme il y en avait partout sur le sol de la remise.
Ils sortirent.
Au moment où ils fermaient doucement la porte de la maison, il me sembla que Mattia remuait dans sa couchette, comme s’il reposait sa tête sur l’oreiller.
Avait-il vu ce qui venait de se passer ?
Je n’osai le lui demander : ce n’était plus une épouvante vague qui m’étouffait ; je savais maintenant pourquoi j’avais peur : des pieds à la tête j’étais baigné dans une sueur froide.
Je restai ainsi pendant toute la nuit ; un coq, qui chanta dans le voisinage, m’annonça l’approche du matin ; alors seulement je m’endormis, mais d’un sommeil lourd et fiévreux, plein de cauchemars anxieux qui m’étouffaient.
Un bruit de serrure me réveilla, et la porte de notre voiture fut ouverte ; mais, m’imaginant que c’était mon père qui venait nous prévenir qu’il était temps de nous lever, je fermai les yeux pour ne pas le voir.
— C’est ton frère, me dit Mattia, qui nous donne la liberté ; il est déjà parti.
Nous nous levâmes alors ; Mattia ne me demanda pas si j’avais bien dormi, et je ne lui adressai aucune question ; comme il me regardait à un certain moment, je détournai les yeux.
Il fallut entrer dans la cuisine, mais mon père ni ma mère ne s’y trouvaient point ; mon grand-père était devant le feu, assis dans son fauteuil, comme s’il n’avait pas bougé depuis la veille, et ma sœur aînée, qui s’appelait Annie, essuyait la table, tandis que mon plus grand frère Allen balayait la pièce.
J’allai à eux pour leur donner la main, mais ils continuèrent leur besogne sans me répondre.
J’arrivai alors à mon grand-père, mais il ne me laissa point approcher, et comme la veille, il cracha de mon côté, ce qui m’arrêta court.
— Demande donc, dis-je à Mattia, à quelle heure je verrai mon père et ma mère ce matin.
Mattia fit ce que je lui disais, et mon grand-père en entendant parler anglais se radoucit ; sa physionomie perdit un peu de son effrayante fixité et il voulut bien répondre.
— Que dit-il ? demandai-je.
— Que ton père est sorti pour toute la journée, que ta mère dort et que nous pouvons aller nous promener.
— Il n’a dit que cela ? demandai-je, trouvant cette traduction bien courte.
Mattia parut embarrassé.
— Je ne sais pas si j’ai bien compris le reste, dit-il.
— Dis ce que tu as compris.
— Il me semble qu’il a dit que si nous trouvions une bonne occasion en ville il ne fallait pas la manquer, et puis il a ajouté, cela j’en suis sûr : « Retiens ma leçon : il faut vivre aux dépens des imbéciles. »
Sans doute mon grand-père devinait ce que Mattia m’expliquait, car à ces derniers mots il fit de sa main qui n’était pas paralysée le geste de mettre quelque chose dans sa poche et en même temps il cligna de l’œil.
— Sortons, dis-je à Mattia.
Pendant deux ou trois heures, nous nous promenâmes aux environs de la cour du Lion-Rouge, n’osant pas nous éloigner de peur de nous égarer ; et le jour Bethnal-Green me parut encore plus affreux qu’il ne s’était montré la veille dans la nuit : partout dans les maisons aussi bien que dans les gens, la misère avec ce qu’elle a de plus attristant.
Nous regardions, Mattia et moi, mais nous ne disions rien.
Tournant sur nous-mêmes, nous nous trouvâmes à l’un des bouts de notre cour et nous rentrâmes.
Ma mère avait quitté sa chambre ; de la porte je l’aperçus la tête appuyée sur la table : m’imaginant qu’elle était malade, je courus à elle pour l’embrasser, puisque je ne pouvais pas lui parler.
Je la pris dans mes bras, elle releva la tête en la balançant, puis elle me regarda, mais assurément sans me voir ; alors je respirai une odeur de genièvre qu’exhalait son haleine chaude. Je reculai. Elle laissa retomber sa tête sur ses deux bras étalés sur la table.
— Gin, dit mon grand-père.
Et il me regarda en ricanant, disant quelques mots que je ne compris pas.
Tout d’abord je restai immobile comme si j’étais privé de sentiment, puis après quelques secondes je regardai Mattia, qui lui-même me regardait avec des larmes dans les yeux.
Je lui fis un signe et de nouveau nous sortîmes.
Pendant assez longtemps nous marchâmes côte à côte, nous tenant par la main, ne disant rien et allant droit devant nous sans savoir où nous nous dirigions.
— Où donc veux-tu aller ainsi ? demanda Mattia avec une certaine inquiétude.
— Je ne sais pas ; quelque part où nous pourrons causer ; j’ai à te parler, et ici, dans cette foule, je ne pourrais pas.
En effet, dans ma vie errante, par les champs et par les bois, je m’étais habitué, à l’école de Vitalis, à ne jamais rien dire d’important quand nous nous trouvions au milieu d’une rue de ville ou de village, et lorsque j’étais dérangé par les passants je perdais tout de suite mes idées : or, je voulais parler à Mattia sérieusement en sachant bien ce que je dirais.
Au moment où Mattia me posait cette question, nous arrivions dans une rue plus large que les ruelles d’où nous sortions, et il me sembla apercevoir des arbres au bout de cette rue : c’était peut-être la campagne : nous nous dirigeâmes de ce côté. Ce n’était point la campagne, mais c’était un parc immense avec de vastes pelouses vertes et des bouquets de jeunes arbres çà et là. Nous étions là à souhait pour causer.
Ma résolution était bien prise, et je savais ce que je voulais dire :
— Tu sais que je t’aime, mon petit Mattia, dis-je à mon camarade aussitôt que nous fûmes assis dans un endroit écarté et abrité, et tu sais bien, n’est-ce pas, que c’est par amitié que je t’ai demandé de m’accompagner chez mes parents. Tu ne douteras donc pas de mon amitié, n’est-ce pas, quoi que je te demande.
— Que tu es bête ! répondit-il en s’efforçant de sourire.
— Tu voudrais rire pour que je ne m’attendrisse pas, mais cela ne fait rien, si je m’attendris ; avec qui puis-je pleurer si ce n’est avec toi ?
Et me jetant dans les bras de Mattia, je fondis en larmes ; jamais je ne m’étais senti si malheureux quand j’étais seul, perdu au milieu du vaste monde.
Après une crise de sanglots, je m’efforçai de me calmer ; ce n’était pas pour me faire plaindre par Mattia que je l’avais amené dans ce parc, ce n’était pas pour moi, c’était pour lui.
— Mattia, lui dis-je, il faut partir, il faut retourner en France.
— Te quitter, jamais !
— Je savais bien à l’avance que ce serait là ce que tu me répondrais, et je suis heureux, bien heureux, je t’assure, que tu m’aies dit que tu ne me quitterais jamais, cependant il faut me quitter, il faut retourner en France, en Italie, où tu voudras, peu importe, pourvu que tu ne restes pas en Angleterre.
— Et toi, où veux-tu aller ? où veux-tu que nous allions ?
— Moi ! Mais il faut que je reste ici, à Londres, avec ma famille ; n’est-ce pas mon devoir d’habiter près de mes parents ? Prends ce qui nous reste d’argent et pars.
— Ne dis pas cela, Rémi, s’il faut que quelqu’un parte, c’est toi, au contraire.
— Pourquoi ?
— Parce que…
Il n’acheva pas et détourna les yeux devant mon regard interrogateur.
— Mattia, réponds-moi en toute sincérité, franchement, sans ménagement pour moi, sans peur ; tu ne dormais pas cette nuit ? tu as vu ?
Il tint ses yeux baissés, et d’une voix étouffée :
— Je ne dormais pas, dit-il.
— Qu’as-tu vu ?
— Tout.
— Et as-tu compris ?
— Que ceux qui vendaient ces marchandises ne les avaient pas achetées. Ton père les a grondés d’avoir frappé à la porte de la remise et non à celle de la maison ; ils ont répondu qu’ils étaient guettés par les policemen.
— Tu vois donc bien qu’il faut que tu partes, lui dis-je.
— S’il faut que je parte, il faut que tu partes aussi, cela n’est pas plus utile pour l’un que pour l’autre.
— Quand je t’ai demandé de m’accompagner, je croyais, d’après ce que m’avait dit mère Barberin, et aussi d’après mes rêves, que ma famille pourrait nous faire instruire tous les deux, et que nous ne nous séparerions pas ; mais les choses ne sont pas ainsi ; le rêve était… un rêve ; il faut donc que nous nous séparions.
— Jamais !
— Écoute-moi bien, comprends-moi, et n’ajoute pas à mon chagrin. Si à Paris nous avions rencontré Garofoli, et si celui-ci t’avait repris, tu n’aurais pas voulu, n’est-ce pas, que je restasse avec toi, et ce que je te dis en ce moment, tu me l’aurais dit.
Il ne répondit pas.
— Est-ce vrai ? dis-moi si c’est vrai.
Après un moment de réflexion il parla :
— À ton tour écoute-moi, dit-il, écoute-moi bien : quand, à Chavanon, tu m’as parlé de ta famille qui te cherchait, cela m’a fait un grand chagrin ; j’aurais dû être heureux de savoir que tu allais retrouver tes parents, j’ai été au contraire fâché. Au lieu de penser à ta joie et à ton bonheur, je n’ai pensé qu’à moi : je me suis dit que tu aurais des frères et des sœurs que tu aimerais comme tu m’aimais, plus que moi peut-être, des frères et des sœurs riches, bien élevés, instruits, des beaux messieurs, des belles demoiselles, et j’ai été jaloux. Voilà ce qu’il faut que tu saches, voilà la vérité qu’il faut que je te confesse pour que tu me pardonnes, si tu peux me pardonner d’aussi mauvais sentiments.
— Oh ! Mattia !
— Dis, dis-moi que tu me pardonnes.
— De tout mon cœur ; j’avais bien vu ton chagrin, je ne t’en ai jamais voulu.
— Parce que tu es bête ; tu es une trop bonne bête ; il faut en vouloir à ceux qui sont méchants, et j’ai été méchant. Mais si tu me pardonnes, parce que tu es bon, moi, je ne me pardonne pas, parce que moi, je ne suis pas bon. Tu ne sais pas tout encore : je me disais : je vais avec lui en Angleterre parce qu’il faut voir ; mais quand il sera heureux, bien heureux, quand il n’aura plus le temps de penser à moi, je me sauverai, et, sans m’arrêter, je m’en irai jusqu’à Lucca pour embrasser Cristina. Mais voilà qu’au lieu d’être riche et heureux, comme nous avions cru que tu le serais, tu n’es pas riche et tu es… c’est-à-dire tu n’es pas ce que nous avions cru ; alors je ne dois pas partir, et ce n’est pas Cristina, ce n’est pas ma petite sœur que je dois embrasser, c’est mon camarade, c’est mon ami, c’est mon frère, c’est Rémi.
Disant cela, il me prit la main et me l’embrassa ; alors les larmes emplirent mes yeux, mais elles ne furent plus amères et brûlantes comme celles que je venais de verser.
Cependant, si grande que fût mon émotion, elle ne me fit pas abandonner mon idée :
— Il faut que tu partes, il faut que tu retournes en France, que tu voies Lise, le père Acquin, mère Barberin, tous mes amis, et que tu leur dises pourquoi je ne fais pas pour eux ce que je voulais, ce que j’avais rêvé, ce que j’avais promis. Tu expliqueras que mes parents ne sont pas riches comme nous avions cru, et ce sera assez pour qu’on m’excuse. Tu comprends, n’est-ce pas ? Ils ne sont pas riches, cela explique tout : ce n’est pas une honte de n’être pas riche.
— Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas riches que tu veux que je parte ; aussi je ne partirai pas.
— Mattia, je t’en prie, n’augmente pas ma peine, tu vois comme elle est grande.
— Oh ! je ne veux pas te forcer à me dire ce que tu as honte de m’expliquer. Je ne suis pas malin, je ne suis pas fin, mais si je ne comprends pas tout ce qui devait m’entrer là, — il frappa sa tête, je sens ce qui m’atteint là ; — il mit sa main sur son cœur. Ce n’est pas parce que tes parents sont pauvres que tu veux que je parte, ce n’est pas parce qu’ils ne peuvent pas me nourrir, car je ne leur serais pas à charge et je travaillerais pour eux, c’est… c’est parce que, — après ce que tu as vu cette nuit, — tu as peur pour moi.
— Mattia, ne dis pas cela.
— Tu as peur que je n’en arrive à couper les étiquettes des marchandises qui n’ont pas été achetées.
— Oh ! tais-toi, Mattia, mon petit Mattia, tais-toi !
Et je cachai entre mes mains mon visage rouge de honte.
— Eh bien ! si tu as peur pour moi, continua Mattia, moi j’ai peur pour toi, et c’est pour cela que je te dis : « Partons ensemble, retournons en France pour revoir mère Barberin, Lise et tes amis. »
— C’est impossible ! Mes parents ne te sont rien, tu ne leur dois rien ; moi, ils sont mes parents, je dois rester avec eux.
— Tes parents ! Ce vieux paralysé, ton grand-père ! cette femme, couchée sur la table, ta mère !
Je me levai vivement, et, sur le ton du commandement, non plus sur celui de la prière, je m’écriai :
— Tais-toi, Mattia, ne parle pas ainsi, je te le défends ! C’est de mon grand-père, c’est de ma mère que tu parles : je dois les honorer, les aimer.
— Tu le devrais s’ils étaient réellement tes parents ; mais s’ils ne sont ni ton grand-père, ni ton père, ni ta mère, dois-tu quand même les honorer et les aimer ?
— Tu n’as donc pas écouté le récit de mon père ?
— Qu’est-ce qu’il prouve ce récit ? Ils ont perdu un enfant du même âge que toi ; ils l’ont fait chercher et ils en ont retrouvé un du même âge que celui qu’ils avaient perdu ; voilà tout.
— Tu oublies que l’enfant qu’on leur avait volé a été abandonné avenue de Breteuil, et que c’est avenue de Breteuil que j’ai été trouvé le jour même où le leur avait été perdu.
— Pourquoi deux enfants n’auraient-ils pas été abandonnés avenue de Breteuil le même jour ? Pourquoi le commissaire de police ne se serait-il pas trompé en envoyant M. Driscoll à Chavanon ? Cela est possible.
— Cela est absurde.
— Peut-être bien ; ce que je dis, ce que j’explique peut être absurde, mais c’est parce que je le dis et l’explique mal, parce que j’ai une pauvre tête ; un autre que moi l’expliquerait mieux, et cela deviendrait raisonnable ; c’est moi qui suis absurde, voilà tout.
— Hélas ! non, ce n’est pas tout.
— Enfin tu dois faire attention que tu ne ressembles ni à ton père ni à ta mère, et que tu n’as pas les cheveux blonds, comme tes frères et sœurs qui tous, tu entends bien, tous, sont du même blond ; pourquoi ne serais-tu pas comme eux ? D’un autre côté, il y a une chose bien étonnante : comment des gens qui ne sont pas riches ont-ils dépensé tant d’argent pour retrouver un enfant ? Pour toutes ces raisons, selon moi, tu n’es pas un Driscoll ; je sais bien que je ne suis qu’une bête, on me l’a toujours dit, c’est la faute de ma tête. Mais tu n’es pas un Driscoll, et tu ne dois pas rester avec les Driscoll. Si tu veux, malgré tout, y rester, je reste avec toi ; mais tu voudras bien écrire à mère Barberin pour lui demander de nous dire au juste comment étaient tes langes ; quand nous aurons sa lettre, tu interrogeras celui que tu appelles ton père, et alors nous commencerons peut-être à voir un peu plus clair ; jusque-là je ne bouge pas, et malgré tout je reste avec toi ; s’il faut travailler, nous travaillerons ensemble.
— Mais si un jour on cognait sur la tête de Mattia ?
Il se mit à sourire tristement :
— Ce ne serait pas là le plus dur : est-ce que les coups font du mal quand on les reçoit pour son ami ?
XV
CAPI PERVERTI
Ce fut seulement à la nuit tombante que nous rentrâmes cour du Lion-Rouge : nous passâmes toute notre journée à nous promener dans ce beau parc, en causant, après avoir déjeuné d’un morceau de pain que nous achetâmes.
Mon père était de retour à la maison et ma mère était debout : ni lui, ni elle, ne nous firent d’observations sur notre longue promenade ; ce fut seulement après le souper que mon père nous dit qu’il avait à nous parler à tous deux, à Mattia et à moi, et pour cela il nous fit venir devant la cheminée, ce qui nous valut un grognement du grand-père qui décidément était féroce pour garder sa part de feu.
— Dites-moi donc un peu comment vous gagniez votre vie en France ? demanda mon père.
Je fis le récit qu’il nous demandait.
— Ainsi vous n’avez jamais eu peur de mourir de faim ?
— Jamais ; non-seulement nous avons gagné notre vie, mais encore nous avons gagné de quoi acheter une vache, dit Mattia avec assurance.
Et à son tour il raconta l’acquisition de notre vache.
— Vous avez donc bien du talent ? demanda mon père ; montrez-moi un peu de quoi vous êtes capables.
Je pris ma harpe et jouai un air, mais ce ne fut pas ma chanson napolitaine.
— Bien, bien, dit mon père, et Mattia que sait-il ?
Mattia aussi joua un morceau de violon et un autre de cornet à piston.
Ce fut ce dernier qui provoqua les applaudissements des enfants, qui nous écoutaient rangés en cercle autour de nous.
— Et Capi ? demanda mon père, de quoi joue-t-il ? Je ne pense pas que c’est pour votre seul agrément que vous traînez un chien avec vous ; il doit être en état de gagner au moins sa nourriture.
J’étais fier des talents de Capi, non-seulement pour lui, mais encore pour Vitalis ; je voulus qu’il jouât quelques-uns des tours de son répertoire, et il obtint auprès des enfants son succès accoutumé.
— Mais c’est une fortune, ce chien-là, dit mon père.
Je répondis à ce compliment en faisant l’éloge de Capi et en assurant qu’il était capable d’apprendre en peu de temps tout ce qu’on voulait bien lui montrer, même ce que les chiens ne savaient pas faire ordinairement.
Mon père traduisit mes paroles en anglais, et il me sembla qu’il y ajoutait quelques mots que je ne compris pas, mais qui firent rire tout le monde, ma mère, les enfants, et mon grand-père aussi, qui cligna de l’œil à plusieurs reprises en criant : « fine dog », ce qui veut dire beau chien ; mais Capi n’en fut pas plus fier.
— Puisqu’il en est ainsi, continua mon père, voici ce que je vous propose ; mais avant tout, il faut que Mattia dise s’il lui convient de rester en Angleterre, et s’il veut demeurer avec nous.
— Je désire rester avec Rémi, répondit Mattia, qui était beaucoup plus fin qu’il ne disait et même qu’il ne croyait, et j’irai partout où ira Rémi.
Mon père, qui ne pouvait pas deviner ce qu’il y avait de sous-entendu dans cette réponse, s’en montra satisfait.
— Puisqu’il en est ainsi, dit-il, je reviens à ma proposition : Nous ne sommes pas riches, et nous travaillons tous pour vivre ; l’été nous parcourons l’Angleterre, et les enfants vont offrir mes marchandises à ceux qui ne veulent pas se déranger pour venir jusqu’à nous ; mais l’hiver nous n’avons pas grand’chose à faire ; tant que nous serons à Londres, Rémi et Mattia pourront aller jouer de la musique dans les rues, et je ne doute pas qu’ils ne gagnent bientôt de bonnes journées, surtout quand nous approcherons des fêtes de Noël, de ce que nous appelons les waits ou veillées. Mais comme il ne faut pas faire du gaspillage en ce monde, Capi ira donner des représentations avec Allen et Ned.
— Capi ne travaille bien qu’avec moi, dis-je vivement ; car il ne pouvait pas me convenir de me séparer de lui.
— Il apprendra à travailler avec Allen et Ned, sois tranquille, et en vous divisant ainsi vous gagnerez beaucoup plus.
— Mais je vous assure qu’il ne fera rien de bon ; et d’autre part nos recettes à Mattia et à moi seront moins fortes ; nous gagnerions davantage avec Capi.
— Assez causé, me dit mon père, quand j’ai dit une chose, j’entends qu’on la fasse et tout de suite, c’est la règle de la maison, j’entends que tu t’y conformes, comme tout le monde.
Il n’y avait pas à répliquer, et je ne dis rien, mais tout bas je pensai que mes beaux rêves pour Capi se réalisaient aussi tristement que pour moi : nous allions donc être séparés ! quel chagrin pour lui et pour moi !
Nous gagnâmes notre voiture pour nous coucher, mais ce soir-là, mon père ne nous enferma point.
Comme je me couchais, Mattia, qui avait été plus de temps que moi à se déshabiller, s’approcha de mon oreille, et me parlant d’une voix étouffée :
— Tu vois, dit-il, que celui que tu appelles ton père ne tient pas seulement à avoir des enfants qui travaillent pour lui, il lui faut encore des chiens ; cela ne t’ouvre-t-il pas les yeux enfin ? demain nous écrirons à mère Barberin.
Mais le lendemain il fallut faire la leçon à Capi ; je le pris dans mes bras, et doucement, en l’embrassant souvent sur le nez, je lui expliquai ce que j’attendais de lui : pauvre chien, comme il me regardait, comme il m’écoutait.
Quand je remis sa laisse dans la main d’Allen, je recommençai mes explications, et il était si intelligent, si docile, qu’il suivit mes deux frères d’un air triste mais enfin sans résistance.
Pour Mattia et pour moi, mon père voulut nous conduire lui-même dans un quartier où nous avions chance de faire de bonnes recettes, et nous traversâmes tout Londres pour arriver dans une partie de la ville où il n’y avait que de belles maisons avec des portiques, dans des rues monumentales bordées de jardins : dans ces splendides rues aux larges trottoirs, plus de pauvres gens en guenilles et à mine famélique, mais de belles dames aux toilettes voyantes, des voitures dont les panneaux brillaient comme des glaces, des chevaux magnifiques que conduisaient de gros et gras cochers aux cheveux poudrés.
Nous ne rentrâmes que tard à la cour du Lion-Rouge, car la distance est longue du West-End à Bethnal-Green, et j’eus la joie de retrouver Capi, bien crotté mais de bonne humeur.
Je fus si content de le revoir qu’après l’avoir bien frotté avec de la paille sèche, je l’enveloppai dans ma peau de mouton et le couchai dans mon lit ; qui fut le plus heureux de lui ou de moi ? cela serait difficile à dire.
Les choses continuèrent ainsi pendant plusieurs jours ; nous partions le matin et nous ne revenions que le soir après avoir joué notre répertoire tantôt dans un quartier, tantôt dans un autre, tandis que de son côté, Capi allait donner des représentations sous la direction d’Allen et de Ned ; mais un soir, mon père me dit que le lendemain je pourrais prendre Capi avec moi, attendu qu’il garderait Allen et Ned à la maison.
Cela nous fit grand plaisir et nous nous promîmes bien, Mattia et moi, de faire une assez belle recette avec Capi, pour que désormais on nous le donnât toujours ; il s’agissait de reconquérir Capi, et nous ne nous épargnerions ni l’un ni l’autre.
Nous lui fîmes donc subir une sévère toilette le matin et, après déjeuner, nous nous mîmes en route pour le quartier où l’expérience nous avait appris « que l’honorable société mettait le plus facilement la main à la poche ». Pour cela il nous fallait traverser tout Londres de l’est à l’ouest par Old street, Holborn et Oxford street.
Par malheur pour le succès de notre entreprise depuis deux jours le brouillard ne s’était pas éclairci ; le ciel, ou ce qui tient lieu de ciel à Londres, était un nuage de vapeurs orangées, et dans les rues flottait une sorte de fumée grisâtre qui ne permettait à la vue de s’étendre qu’à quelques pas : on sortirait peu, et des fenêtres derrière lesquelles on nous écouterait, on ne verrait guère Capi ; c’était là une fâcheuse condition pour notre recette ; aussi Mattia injuriait-il le brouillard, ce maudit fog, sans se douter du service qu’il devait nous rendre à tous les trois quelques instants plus tard.
Cheminant rapidement, en tenant Capi sur nos talons par un mot que je lui disais de temps en temps, ce qui avec lui valait mieux que la plus solide chaîne, nous étions arrivés dans Holborn qui, on le sait, est une des rues les plus fréquentées et les plus commerçantes de Londres. Tout à coup je m’aperçus que Capi ne nous suivait plus. Qu’était-il devenu ? cela était extraordinaire. Je m’arrêtai pour l’attendre en me jetant dans l’enfoncement d’une allée, et je sifflai doucement, car nous ne pouvions pas voir au loin. J’étais déjà anxieux, craignant qu’il ne nous eût été volé, quand il arriva au galop, tenant dans sa gueule une paire de bas de laine et frétillant de la queue : posant ses pattes de devant contre moi il me présenta ces bas en me disant de les prendre ; il paraissait tout fier, comme lorsqu’il avait bien réussi un de ses tours les plus difficiles, et venait demander mon approbation.
Cela s’était fait en quelques secondes et je restais ébahi, quand brusquement Mattia prit les bas d’une main et de l’autre m’entraîna dans l’allée.
— Marchons vite, me dit-il, mais sans courir.
Ce fut seulement au bout de plusieurs minutes qu’il me donna l’explication de cette fuite.
— Je restais comme toi à me demander d’où venait cette paire de bas, quand j’ai entendu un homme dire : Où est-il le voleur ? le voleur c’était Capi, tu le comprends ; sans le brouillard nous étions arrêtés comme voleurs.
Je ne comprenais que trop : je restai un moment suffoqué : ils avaient fait un voleur de Capi, du bon, de l’honnête Capi !
— Rentrons à la maison, dis-je à Mattia, et tiens Capi en laisse.
Mattia ne me dit pas un mot et nous rentrâmes cour du Lion-Rouge en marchant rapidement.
Le père, la mère et les enfants étaient autour de la table occupés à plier des étoffes : je jetai la paire de bas sur la table, ce qui fit rire Allen et Ned.
— Voici une paire de bas, dis-je, que Capi vient de voler, car on a fait de Capi un voleur : je pense que ç’a été pour jouer.
Je tremblais en parlant ainsi, et cependant je ne m’étais jamais senti aussi résolu.
— Et si ce n’était pas un jeu, demanda mon père, que ferais-tu, je te prie ?
— J’attacherais une corde au cou de Capi, et quoique je l’aime bien, j’irais le noyer dans la Tamise : je ne veux pas que Capi devienne un voleur, pas plus que j’en deviendrai un moi-même ; si je pensais que cela doive arriver jamais, j’irais me noyer avec lui tout de suite.
Mon père me regarda en face et il fit un geste de colère comme pour m’assommer ; ses yeux me brûlèrent ; cependant je ne baissai pas les miens ; peu à peu son visage contracté se détendit.
— Tu as eu raison de croire que c’était un jeu, dit-il ; aussi pour que cela ne se reproduise plus, Capi désormais ne sortira qu’avec toi.
XVI
LES BEAUX LANGES ONT MENTI
À toutes mes avances, mes frères Allen et Ned n’avaient jamais répondu que par une antipathie hargneuse, et tout ce que j’avais voulu faire pour eux, ils l’avaient mal accueilli : évidemment je n’étais pas un frère à leurs yeux.
Après l’aventure de Capi, la situation se dessina nettement entre nous, et je leur signifiai, non en paroles, puisque je ne savais pas m’exprimer facilement en anglais, mais par une pantomime vive et expressive, où mes deux poings jouèrent le principal rôle, que s’ils tentaient jamais la moindre chose contre Capi, ils me trouveraient là pour le défendre ou le venger.
N’ayant pas de frères, j’aurais voulu avoir des sœurs ; mais Annie, l’aînée des filles, ne me témoignait pas de meilleurs sentiments que ses frères ; comme eux, elle avait mal reçu mes avances, et elle ne laissait point passer de jour sans me jouer quelque mauvais tour de sa façon, ce à quoi, je dois le dire, elle était fort ingénieuse.
Repoussé par Allen et par Ned, repoussé par Annie, il ne m’était resté que la petite Kate, qui avec ses trois ans était trop jeune pour entrer dans l’association de ses frères et de sa sœur ; elle avait donc bien voulu se laisser caresser par moi, d’abord parce que je lui faisais faire des tours par Capi, et plus tard, lorsque Capi me fut rendu, parce que je lui apportais les bonbons, les gâteaux, les oranges que dans nos représentations les enfants nous donnaient d’un air majestueux en nous disant : « Pour le chien ». Donner des oranges au chien, cela n’était peut-être pas très-sensé, mais je les acceptais avec reconnaissance, car elles me permettaient de gagner ainsi les bonnes grâces de miss Kate.
Ainsi de toute ma famille, cette famille pour laquelle je me sentais tant de tendresse dans le cœur lorsque j’étais débarqué en Angleterre, il n’y avait que la petite Kate qui me permettait de l’aimer ; mon grand-père continuait à cracher furieusement de mon côté toutes les fois que je l’approchais ; mon père ne s’occupait de moi que pour me demander chaque soir le compte de notre recette ; ma mère, le plus souvent n’était pas de ce monde ; Allen, Ned et Annie me détestaient, seule Kate se laissait caresser, encore n’était-ce que parce que mes poches étaient pleines.
Quelle chute !
Aussi dans mon chagrin, et bien que tout d’abord j’eusse repoussé les suppositions de Mattia, en venais-je à me dire que si vraiment j’étais l’enfant de cette famille on aurait pour moi d’autres sentiments que ceux qu’on me témoignait avec si peu de ménagement, alors que je n’avais rien fait pour mériter cette indifférence ou cette dureté.
Quand Mattia me voyait sous l’influence de ces tristes pensées, il devinait très-bien ce qui les provoquait, et alors il me disait, comme s’il se parlait à lui-même :
— Je suis curieux de voir ce que mère Barberin va te répondre.
Pour avoir cette lettre qui devait m’être adressée « poste restante », nous avions changé notre itinéraire de chaque jour, et au lieu de gagner Holborn par West-Smith-Field, nous descendions jusqu’à la poste. Pendant assez longtemps, nous fîmes cette course inutilement, mais à la fin, cette lettre si impatiemment attendue nous fut remise.
L’hôtel général des postes n’est point un endroit favorable à la lecture ; nous gagnâmes une allée dans une ruelle voisine, ce qui me donna le temps de calmer un peu mon émotion, et là enfin, je pus ouvrir la lettre de mère Barberin, c’est-à-dire la lettre qu’elle avait fait écrire par le curé de Chavanon :
« Je suis bien surprise et bien fâchée de ce que ta lettre m’apprend, car selon ce que mon pauvre Barberin m’avait toujours dit aussi bien après t’avoir trouvé avenue de Breteuil, qu’après avoir causé avec la personne qui te cherchait, je pensais que tes parents étaient dans une bonne et même dans une grande position de fortune.
« Cette idée m’était confirmée par la façon dont tu étais habillé lorsque Barberin t’a apporté à Chavanon, et qui disait bien clairement que les objets que tu portais appartenaient à la layette d’un enfant riche. Tu me demandes de t’expliquer comment étaient les langes dans lesquels tu étais emmailloté ; je peux le faire facilement car j’ai conservé tous ces objets en vue de servir à ta reconnaissance le jour où l’on te réclamerait, ce qui selon moi devait arriver certainement.
« Mais, d’abord, il faut te dire que tu n’avais pas de langes ; si je t’ai parlé quelquefois de langes, c’est par habitude et parce que les enfants de chez nous sont emmaillotés. Toi, tu n’étais pas emmailloté ; au contraire tu étais habillé ; et voici quels étaient les objets qui ont été trouvés sur toi : un bonnet en dentelle, qui n’a de particulier que sa beauté et sa richesse ; une brassière en toile fine garnie d’une petite dentelle à l’encolure et aux bras ; une couche en flanelle, des bas en laine blanche ; des chaussons en tricot blanc, avec des bouffettes de soie ; une longue robe aussi en flanelle blanche, et enfin une grande pelisse à capuchon en cachemire blanc, doublée de soie, et en dessus ornée de belles broderies.
« Tu n’avais pas de couche en toile appartenant à la même layette, parce qu’on t’avait changé chez le commissaire de police où l’on avait remplacé la couche par une serviette ordinaire.
« Enfin, il faut ajouter aussi qu’aucun de ces objets n’était marqué, mais la couche en flanelle et la brassière avaient dû l’être, car les coins où se met ordinairement la marque avaient été coupés, ce qui indiquait qu’on avait pris toutes les précautions pour dérouter les recherches.
« Voilà, mon cher Rémi, tout ce que je peux te dire. Si tu crois avoir besoin de ces objets, tu n’as qu’à me l’écrire ; je te les enverrai.
« Ne te désole pas, mon cher enfant, de ne pouvoir pas me donner tous les beaux cadeaux que tu m’avais promis ; ta vache achetée sur ton pain de chaque jour vaut pour moi tous les cadeaux du monde. J’ai du plaisir de te dire qu’elle est toujours en bonne santé ; son lait ne diminue pas, et, grâce à elle, je suis maintenant à mon aise ; je ne la vois pas sans penser à toi et à ton bon petit camarade Mattia.
« Tu me feras plaisir quand tu pourras me donner de tes nouvelles, et j’espère qu’elles seront toujours bonnes : toi si tendre et si affectueux, comment ne serais-tu pas heureux dans ta famille, avec un père, une mère, des frères et des sœurs qui vont t’aimer comme tu mérites de l’être ?
« Adieu, mon cher enfant, je t’embrasse affectueusement.
La fin de cette lettre m’avait serré le cœur : pauvre mère Barberin, comme elle était bonne pour moi ! parce qu’elle m’aimait, elle s’imaginait que tout le monde devait m’aimer comme elle.
— C’est une brave femme, dit Mattia, elle a pensé à moi ; mais quand elle m’aurait oublié, cela n’empêcherait pas que je la remercierais pour sa lettre ; avec une description aussi complète, il ne faudra pas que master Driscoll se trompe dans l’énumération des objets que tu portais lorsqu’on t’a volé.
— Il peut avoir oublié.
— Ne dis donc pas cela : est-ce qu’on oublie les vêtements qui habillaient l’enfant qu’on a perdu, le jour où on l’a perdu, puisque ce sont ces vêtements qui doivent le faire retrouver ?
— Jusqu’à ce que mon père ait répondu, ne fais pas de suppositions, je te prie.
— Ce n’est pas moi qui en fais, c’est toi qui dis qu’il peut avoir oublié.
— Enfin, nous verrons.
Ce n’était pas chose facile que de demander à mon père de me dire comment j’étais vêtu lorsque je lui avais été volé. Si je lui avais posé cette question tout naïvement, sans arrière-pensée, rien n’aurait été plus simple ; mais il n’en était pas ainsi, et c’était justement cette arrière-pensée, qui me rendait timide et hésitant.
Enfin un jour qu’une pluie glaciale nous avait fait rentrer de meilleure heure que de coutume, je pris mon courage, et je mis la conversation sur le sujet qui me causait de si poignantes angoisses.
Au premier mot de ma question, mon père me regarda en face, en me fouillant des yeux, comme il en avait l’habitude lorsqu’il était blessé par ce que je lui disais, mais je soutins son regard plus bravement que je ne l’avais espéré lorsque j’avais pensé à ce moment.
Je crus qu’il allait se fâcher et je jetai un coup d’œil inquiet du côté de Mattia, qui nous écoutait sans en avoir l’air, pour le prendre à témoin de la maladresse qu’il m’avait fait risquer ; mais il n’en fut rien ; le premier mouvement de colère passé, il se mit à sourire ; il est vrai qu’il y avait quelque chose de dur et de cruel dans ce sourire, mais enfin c’était bien un sourire.
— Ce qui m’a le mieux servi pour te retrouver, dit-il, ç’a été la description des vêtements que tu portais au moment où tu nous as été volé : un bonnet en dentelle, une brassière en toile garnie de dentelles, une couche et une robe en flanelle, des bas de laine, des chaussons en tricot, une pelisse à capuchon en cachemire blanc brodé : j’avais beaucoup compté sur la marque de ton linge F. D., c’est-à-dire Francis Driscoll qui est ton nom, mais cette marque avait été coupée par celle qui t’avait volé et qui par cette précaution espérait bien empêcher qu’on te découvrît jamais ; j’eus à produire aussi ton acte de baptême que j’avais relevé à ta paroisse, qu’on m’a rendu, et que je dois avoir encore.
Disant cela, et avec une complaisance qui était assez extraordinaire chez lui, il alla fouiller dans un tiroir et bientôt il en rapporta un grand papier marqué de plusieurs cachets qu’il me donna.
Je fis un dernier effort :
— Si vous voulez, dis-je, Mattia va me le traduire.
— Volontiers.
De cette traduction, que Mattia fit tant bien que mal, il résultait que j’étais né un jeudi deux août et que j’étais fils de Patrick Driscoll et de Margaret Grange, sa femme.
Que demander de plus ?
Cependant Mattia ne se montra pas satisfait, et le soir, quand nous fûmes retirés dans notre voiture, il se pencha encore à mon oreille comme lorsqu’il avait quelque chose de secret à me confier.
— Tout cela c’est superbe, me dit-il, mais enfin cela n’explique pas comment Patrick Driscoll, marchand ambulant, et Margaret Grange, sa femme, étaient assez riches pour donner à leur enfant des bonnets en dentelle, des brassières garnies de dentelles, et des pelisses brodées ; les marchands ambulants ne sont pas si riches que ça.
— C’est précisément parce qu’ils étaient marchands que ces vêtements pouvaient leur coûter moins cher.
Mattia secoua la tête en sifflant, puis de nouveau me parlant à l’oreille :
— Veux-tu que je te fasse part d’une idée qui ne peut pas me sortir de la tête : c’est que tu n’es pas l’enfant de master Driscoll, mais bien l’enfant volé par master Driscoll.
Je voulus répliquer, mais déjà Mattia était monté dans son lit.
XVII
L’ONCLE D’ARTHUR : — M. JAMES MILLIGAN.
Si j’avais été à la place de Mattia, j’aurais peut-être eu autant d’imagination que lui, mais dans ma position les libertés de pensée qu’il se permettait m’étaient interdites.
C’était de mon père qu’il s’agissait.
Pour Mattia, c’était de master Driscoll, comme il disait.
Et quand mon esprit voulait s’élancer à la suite de Mattia, je le retenais aussitôt d’une main que je m’efforçais d’affermir.
De master Driscoll Mattia pouvait penser tout ce qui lui passait par la tête ; pour lui, master Driscoll était un étranger à qui il ne devait rien.
À mon père, au contraire, je devais le respect.
Assurément il y avait des choses étranges dans ma situation, mais je n’avais pas la liberté de les examiner au même point de vue que Mattia.
Le doute était permis à Mattia.
À moi, il était défendu.
Et quand Mattia voulait me faire part de ses doutes, il était de mon devoir de lui imposer silence.
C’était ce que j’essayais, mais Mattia avait sa tête, et je ne parvenais pas toujours à triompher de son obstination.
— Cogne si tu veux, disait-il en se fâchant, mais écoute.
Et alors il me fallait quand même écouter ses questions :
— Pourquoi Allen, Ned, Annie et Kate avaient-ils les cheveux blonds, tandis que les miens n’étaient pas blonds ?
— Pourquoi tout le monde, dans la famille Driscoll, à l’exception de Kate, qui ne savait pas ce qu’elle faisait, me témoignait-il de mauvais sentiments, comme si j’avais été un chien galeux ?
— Comment, des gens qui n’étaient pas riches habillaient-ils leurs enfants avec des dentelles ?
À tous ces pourquoi, à tous ces comment, je n’avais qu’une bonne réponse qui était elle-même une interrogation.
— Pourquoi la famille Driscoll m’aurait-elle cherché si je n’étais pas son enfant ? Pourquoi aurait-elle donné de l’argent à Barberin et à Greth and Galley ?
À cela Mattia était obligé de répondre qu’il ne pouvait pas répondre.
Mais cependant il ne se déclarait pas vaincu.
— Parce que je ne peux pas répondre à ta question, disait-il, cela ne prouve pas que j’aie tort dans toutes celles que je te pose sans que tu y répondes toi-même. Un autre à ma place trouverait très-bien pourquoi master Driscoll t’a fait chercher et dans quel but il a dépensé de l’argent. Moi je ne le trouve pas parce que je ne suis pas malin, et parce que je ne connais rien à rien.
— Ne dis donc pas cela : tu es plein de malice au contraire.
— Si je l’étais, je t’expliquerais tout de suite ce que je ne peux pas t’expliquer, mais ce que je sens : non, tu n’es pas l’enfant de la famille Driscoll, tu ne l’es pas, tu ne peux pas l’être ; cela sera reconnu plus tard, certainement ; seulement par ton obstination à ne pas vouloir ouvrir les yeux tu retardes ce moment. Je comprends que ce que tu appelles le respect envers ta famille te retienne, mais il ne devrait pas te paralyser complètement.
— Mais que veux-tu que je fasse ?
— Je veux que nous retournions en France.
— C’est impossible.
— Parce que le devoir te retient auprès de ta famille ; mais si cette famille n’est pas la tienne, qui te retient ?
Des discussions de cette nature ne pouvaient aboutir qu’à un résultat, qui était de me rendre plus malheureux que je ne l’avais jamais été.
Quoi de plus de terrible que le doute !
Et malgré que je ne voulusse pas douter, je doutais.
Ce père était-il mon père ? cette mère était-elle ma mère ? cette famille était-elle la mienne ?
Cela était horrible à avouer, j’étais moins tourmenté, moins malheureux, lorsque j’étais seul.
Qui m’eût dit, lorsque je pleurais tristement, parce que je n’avais pas de famille, que je pleurerais désespérément parce que j’en aurais une ?
D’où me viendrait la lumière ? qui m’éclairerait ? Comment saurais-je jamais la vérité ?
Je restais devant ces questions, accablé de mon impuissance, et je me disais que je me frapperais inutilement et à jamais, en pleine nuit noire, la tête contre un mur dans lequel il n’y avait pas d’issue.
Et cependant il fallait chanter, jouer des airs de danse, et rire en faisant des grimaces, quand j’avais le cœur si profondément triste.
Les dimanches étaient mes meilleurs jours, parce que le dimanche on ne fait pas de musique dans les rues de Londres, et je pouvais alors librement m’abandonner à ma tristesse, en me promenant avec Mattia et Capi ; comme je ressemblais peu alors à l’enfant que j’étais quelques mois auparavant !
Un de ces dimanches, comme je me préparais à sortir avec Mattia, mon père me retint à la maison, en me disant qu’il aurait besoin de moi dans la journée, et il envoya Mattia se promener tout seul : mon grand-père n’était pas descendu ; ma mère était sortie avec Kate et Annie, et mes frères étaient à courir les rues ; il ne restait donc à la maison que mon père et moi.
Il y avait à peu près une heure que nous étions seuls, lorsqu’on frappa à la porte ; mon père alla ouvrir et il rentra accompagné d’un monsieur qui ne ressemblait pas aux amis qu’il recevait ordinairement : celui-là était bien réellement ce qu’en Angleterre on appelle un gentleman, c’est-à-dire un vrai monsieur, élégamment habillé et de physionomie hautaine, mais avec quelque chose de fatigué ; il avait environ cinquante ans ; ce qui me frappa le plus en lui, ce fut son sourire qui, par le mouvement des deux lèvres, découvrait toutes ses dents blanches et pointues comme celles d’un jeune chien : cela était tout à fait caractéristique, et, en le regardant, on se demandait si c’était bien un sourire qui contractait ainsi ses lèvres, ou si ce n’était pas plutôt une envie de mordre.
Tout en parlant avec mon père en anglais, il tournait à chaque instant les yeux de mon côté ; mais quand il rencontrait les miens il cessait aussitôt de m’examiner.
Après quelques minutes d’entretien, il abandonna l’anglais pour le français, qu’il parlait avec facilité et presque sans accent.
— C’est là le jeune garçon dont vous m’avez entretenu ? dit-il à mon père en me désignant du doigt ; il paraît bien portant.
— Réponds-donc, me dit mon père.
— Vous vous portez bien ? me demanda le gentleman.
— Oui, monsieur.
— Vous n’avez jamais été malade ?
— J’ai eu une fluxion de poitrine.
— Ah ! ah ! et comment cela ?
— Pour avoir couché une nuit dans la neige par un froid terrible ; mon maître, qui était avec moi, est mort de froid ; moi j’ai gagné cette fluxion de poitrine.
— Il y a longtemps ?
— Trois ans.
— Et depuis, vous ne vous êtes pas ressenti de cette maladie ?
— Non.
— Pas de fatigues, pas de lassitudes, pas de sueurs dans la nuit ?
— Non, jamais ; quand je suis fatigué, c’est que j’ai beaucoup marché, mais cela ne me rend pas malade.
— Et vous supportez la fatigue facilement ?
— Il le faut bien.
Il se leva, et vint à moi ; alors il me tâta le bras, puis il posa la main sur mon cœur, enfin il appuya sa tête dans mon dos et sur ma poitrine en me disant de respirer fort, comme si j’avais couru ; il me dit aussi de tousser.
Cela fait, il me regarda en face attentivement assez longtemps, et ce fut à ce moment que j’eus l’idée qu’il devait aimer à mordre, tant son sourire était effrayant.
Sans rien me dire, il reprit sa conversation en anglais avec mon père, puis après quelques minutes ils sortirent tous les deux, non par la porte de la rue, mais par celle de la remise.
Resté seul je me demandai ce que signifiaient les questions de ce gentleman ; voulait-il me prendre à son service ? mais alors il faudrait me séparer de Mattia et de Capi ! et puis j’étais bien décidé à n’être le domestique de personne, pas plus de ce gentleman qui me déplaisait, que d’un autre qui me plairait.
Au bout d’un certain temps, mon père rentra ; il me dit qu’ayant à sortir, il ne m’emploierait pas comme il en avait eu l’intention, et que j’étais libre d’aller me promener si j’en avais envie.
Je n’en avais aucune envie ; mais que faire dans cette triste maison ? Autant se promener que de rester à s’ennuyer.
Comme il pleuvait, j’entrai dans notre voiture pour y prendre ma peau de mouton : quelle fut ma surprise de trouver là Mattia ; j’allais lui adresser la parole ; il mit sa main sur ma bouche, puis à voix basse :
— Va ouvrir la porte de la remise, je sortirai doucement derrière toi, il ne faut pas qu’on sache que j’étais dans la voiture.
Ce fut seulement quand nous fûmes dans la rue que Mattia se décida à parler :
— Sais-tu quel est le monsieur qui était avec ton père tout à l’heure ? me dit-il. M. James Milligan, l’oncle de ton ami Arthur.
Comme je restais immobile au milieu de la rue, il me prit par le bras, et tout en marchant il continua :
— Comme je m’ennuyais à me promener tout seul dans ces tristes rues, par ce triste dimanche, je suis rentré pour dormir et je me suis couché sur mon lit, mais je n’ai pas dormi ; ton père, accompagné d’un gentleman, est entré dans la remise et j’ai entendu leur conversation sans l’écouter : « Solide comme un roc, a dit le gentleman, dix autres seraient morts, il en est quitte pour une fluxion de poitrine ! » — Alors croyant qu’il s’agissait de toi, j’ai écouté, mais la conversation a changé tout de suite de sujet. — « Comment va votre neveu ? demanda ton père. — Mieux, il en échappera encore cette fois, il y a trois mois, tous les médecins le condamnaient ; sa chère mère l’a encore sauvé par ses soins : ah ! c’est une bonne mère que madame Milligan. » — Tu penses si à ce nom j’ai prêté l’oreille. — « Alors si votre neveu va mieux, continua ton père, toutes vos précautions sont inutiles ? — Pour le moment peut-être, répondit le monsieur, mais je ne veux pas admettre qu’Arthur vive, ce serait un miracle, et les miracles ne sont plus de ce monde ; il faut qu’au jour de sa mort, je sois à l’abri de tout retour et que l’unique héritier soit moi, James Milligan. — Soyez tranquille, dit ton père, cela sera ainsi, je vous en réponds. — Je compte sur vous, » dit le gentleman. Et il ajouta quelques mots que je n’ai pas bien compris et que je te traduis à peu près, bien qu’ils paraissent ne pas avoir de sens : « À ce moment nous verrons ce que nous aurons à en faire. » Et il est sorti.
Ma première idée en écoutant ce récit fut de rentrer pour demander à mon père l’adresse de M. Milligan, afin d’avoir des nouvelles d’Arthur et de sa mère, mais je compris presque aussitôt que c’était folie : ce n’était point à un homme qui attendait avec impatience la mort de son neveu qu’il fallait demander des nouvelles de ce neveu. Et puis, d’un autre côté, n’était-il pas imprudent d’avertir M. Milligan qu’on l’avait entendu ?
Arthur était vivant, il allait mieux. Pour le moment il y avait assez de joie pour moi dans cette bonne nouvelle.
XVIII
LES NUITS DE NOËL
Nous ne parlions plus que d’Arthur, de madame Milligan et de M. James Milligan.
Où étaient Arthur et sa mère ? Où pourrions-nous bien les chercher, les retrouver ?
Les visites de M. J. Milligan nous avaient inspiré une idée et suggéré un plan dont le succès nous paraissait assuré : puisque M. J. Milligan était venu une fois cour du Lion-Rouge il était à peu près certain qu’il y reviendrait une seconde, une troisième fois ; n’avait-il pas des affaires avec mon père ? Alors quand il partirait, Mattia, qu’il ne connaissait point, le suivrait ; on saurait sa demeure ; on ferait causer ses domestiques ; et peut-être-même nous conduiraient-ils auprès d’Arthur ?
Pourquoi pas ? cela ne paraissait nullement impossible à nos imaginations.
Ce beau plan n’avait pas seulement l’avantage de devoir me faire retrouver Arthur à un moment donné, il en avait encore un autre qui, présentement, me tirait d’angoisse.
Depuis l’aventure de Capi et depuis la réponse de mère Barberin, Mattia ne cessait de me répéter sur tous les tons : « Retournons en France » ; c’était un refrain sur lequel il brodait chaque jour des variations nouvelles. À ce refrain, j’en opposais un autre, qui était toujours le même aussi : « Je ne dois pas quitter ma famille ; » mais sur cette question de devoir nous ne nous entendions pas, et c’étaient des discussions sans résultat, car nous persistions chacun dans notre sentiment : « Il faut partir. » — « Je dois rester. »
Quand à mon éternel « Je dois rester », j’ajoutai : « pour retrouver Arthur », Mattia n’eut plus rien à répliquer : il ne pouvait pas prendre parti contre Arthur : ne fallait-il pas que madame Milligan connût les dispositions de son beau-frère ?
Si nous avions dû attendre M. James Milligan, en sortant du matin au soir comme nous le faisions depuis notre arrivée à Londres, cela n’eût pas été bien intelligent, mais le moment approchait où au lieu d’aller jouer dans les rues pendant la journée, nous irions pendant la nuit, car c’est aux heures du milieu de la nuit qu’ont lieu les waits, c’est-à-dire les concerts de Noël. Alors restant à la maison pendant le jour, l’un de nous ferait bonne garde et nous arriverions bien sans doute à surprendre l’oncle d’Arthur.
— Si tu savais comme j’ai envie que tu retrouves madame Milligan, me dit un jour Mattia.
— Et pourquoi donc ?
Il hésita assez longtemps :
— Parce qu’elle a été très-bonne pour toi.
Puis il ajouta encore :
— Et aussi parce qu’elle te ferait peut-être retrouver tes parents.
— Mattia !
— Tu ne veux pas que je dise cela : je t’assure que ce n’est pas ma faute, mais il m’est impossible d’admettre une seule minute que tu es de la famille Driscoll ; regarde tous les membres de cette famille et regarde-toi un peu ; ce n’est pas seulement des cheveux filasse que je parle ; est-ce que tu as le mouvement de main du grand-père et son sourire ? as-tu eu jamais l’idée de regarder les étoffes à la lumière de la lampe comme master Driscoll ? est-ce qu’il t’est jamais arrivé de te coucher les bras étendus sur une table ? et comme Allen ou Ned, as-tu jamais appris à Capi l’art de rapporter des bas de laine qui ne sont pas perdus ? Non, mille fois non ; on est de sa famille ; et si tu avais été un Driscoll, tu n’aurais pas hésité à t’offrir des bas de laine quand tu en avais besoin et que ta poche était vide, ce qui s’est produit plus d’une fois pour toi : qu’est-ce que tu t’es offert quand Vitalis était en prison ? crois-tu qu’un Driscoll se serait couché sans souper ? Est-ce que si je n’étais pas le fils de mon père je jouerais du cornet à piston, de la clarinette, du trombone ou de n’importe quel instrument, sans jamais avoir appris : mon père était musicien, je le suis. C’est tout naturel : toi, il semble tout naturel que tu sois un gentleman, et tu en seras un quand nous aurons retrouvé madame Milligan.
— Et comment cela ?
— J’ai mon idée.
— Veux-tu la dire, ton idée ?
— Oh ! non.
— Parce que ?
— Parce que si elle est bête…
— Eh bien ?
— Elle serait trop bête si elle était fausse ; et il ne faut pas se faire des joies qui ne se réalisent pas ; il faut que l’expérience du green de ce joli Bethnal nous serve à quelque chose ; en avons-nous vu des belles prairies vertes, qui dans la réalité n’ont été que des mares fangeuses.
Je n’insistai pas, car moi aussi j’avais une idée.
Il est vrai qu’elle était bien vague, bien confuse, bien timide, bien plus bête, me disais-je, que ne pouvait l’être celle de Mattia, mais précisément par cela même je n’osais insister pour que mon camarade me dît la sienne : qu’aurais-je répondu si elle avait été la même que celle qui flottait indécise comme un rêve dans mon esprit ? Ce n’était pas alors que je n’osais pas me la formuler, que j’aurais eu le courage de la discuter avec lui.
Il n’y avait qu’à attendre, et nous attendîmes.
Tout en attendant, nous continuâmes nos courses dans Londres, car nous n’étions pas de ces musiciens privilégiés qui prennent possession d’un quartier où ils ont un public à eux appartenant : nous étions trop enfants, trop nouveaux-venus pour nous établir ainsi en maîtres, et nous devions céder la place à ceux qui savaient faire valoir leurs droits de propriété par des arguments auxquels nous n’étions pas de force à résister.
Combien de fois, au moment de faire notre recette et après avoir joué de notre mieux nos meilleurs morceaux, avions-nous été obligés de déguerpir au plus vite devant quelque formidable Écossais aux jambes nues, au jupon plissé, au plaid, au bonnet orné de plumes qui, par le son seul de sa cornemuse, nous mettait en fuite : avec son cornet à piston Mattia aurait bien couvert le bagpipe, mais nous n’étions pas de force contre le piper.
De même nous n’étions pas de force contre les bandes de musiciens nègres qui courent les rues et que les Anglais appellent des nigger-melodits ; ces faux nègres qui s’accoutrent grotesquement avec des habits à queue de morue et d’immenses cols dans lesquels leur tête est enveloppée comme un bouquet dans une feuille de papier, étaient notre terreur plus encore que les bardes écossais : aussitôt que nous les voyions arriver, ou simplement quand nous entendions leurs banjo, nous nous taisions respectueusement et nous nous en allions loin de là dans un quartier où nous espérions ne pas rencontrer une autre de leurs bandes ; ou bien nous attendions, en les regardant, qu’ils eussent fini leur charivari.
Un jour que nous étions ainsi leurs spectateurs, je vis un d’entre eux et le plus extravagant, faire des signes à Mattia ; je crus tout d’abord que c’était pour se moquer de nous et amuser le public par quelque scène grotesque dont nous serions les victimes, lorsqu’à ma grande surprise Mattia lui répondit amicalement.
— Tu le connais donc ? lui demandai-je.
— C’est Bob.
— Qui ça, Bob ?
— Mon ami Bob du cirque Gassot, un des deux clowns dont je t’ai parlé, et celui surtout à qui je dois d’avoir appris ce que je sais d’anglais.
— Tu ne l’avais pas reconnu ?
— Parbleu ! chez Gassot il se mettait la tête dans la farine et ici il se la met dans le cirage.
Lorsque la représentation des nigger-melodits fut terminée, Bob vint à nous, et à la façon dont il aborda Mattia je vis combien mon camarade savait se faire aimer : un frère n’eût pas eu plus de joie dans les yeux ni dans l’accent que cet ancien clown, « qui par suite de la dureté des temps, nous dit-il, avait été obligé de se faire itinerant-musician ». Mais il fallut bien vite se séparer ; lui pour suivre sa bande ; nous pour aller dans un quartier où il n’irait pas ; et les deux amis remirent au dimanche suivant le plaisir de se raconter ce que chacun avait fait, depuis qu’ils s’étaient séparés. Par amitié pour Mattia sans doute, Bob voulut bien me témoigner de la sympathie, et bientôt nous eûmes un ami qui, par son expérience et ses conseils, nous rendit la vie de Londres beaucoup plus facile qu’elle ne l’avait été pour nous jusqu’à ce moment. Il prit aussi Capi en grande amitié, et souvent il nous disait avec envie que s’il avait un chien comme celui-là sa fortune serait bien vite faite. Plus d’une fois aussi il nous proposa de nous associer tous les trois, c’est-à-dire tous les quatre, lui, Mattia, Capi et moi ; mais si je ne voulais pas quitter ma famille pour retourner en France voir Lise et mes anciens amis, je le voulais bien moins encore pour suivre Bob à travers l’Angleterre.
Ce fut ainsi que nous gagnâmes les approches de Noël ; alors au lieu de partir de la cour du Lion-Rouge, le matin, nous nous mettions en route tous les soirs vers huit ou neuf heures et nous gagnions les quartiers que nous avions choisis.
D’abord nous commençons par les squares et par les rues où la circulation des voitures a déjà cessé : il nous faut un certain silence pour que notre concert pénètre à travers les portes closes, pour aller réveiller les enfants dans leur lit et leur annoncer l’approche de Noël, cette fête chère à tous les cœurs anglais ; puis à mesure que s’écoulent les heures de la nuit nous descendons dans les grandes rues ; les dernières voitures portant les spectateurs des théâtres passent, et une sorte de tranquillité s’établit, succédant peu à peu au tapage assourdissant de la journée ; alors nous jouons nos airs les plus tendres, les plus doux, ceux qui ont un caractère mélancolique ou religieux, le violon de Mattia pleure, ma harpe gémit et quand nous nous taisons pendant un moment de repos, le vent nous apporte quelque fragment de musique que d’autres bandes jouent plus loin : notre concert est fini : « Messieurs et mesdames, bonne nuit et gai Noël ! »
Puis nous allons plus loin recommencer un autre concert.
Cela doit être charmant d’entendre ainsi de la musique, la nuit dans son lit, quand on est bien enveloppé dans une bonne couverture, sous un chaud édredon ; mais pour nous dans les rues il n’y a ni couverture, ni édredon : il faut jouer cependant, bien que les doigts s’engourdissent, à moitié gelés ; s’il y a des ciels de coton, où le brouillard nous pénètre de son humidité, il y a aussi des ciels d’azur et d’or où la bise du Nord nous glace jusqu’aux os ; il n’y en a pas de doux et de cléments ; ce temps de Noël nous fut cruel, et cependant pas une seule nuit pendant trois semaines nous ne manquâmes de sortir.
Combien de fois avant que les boutiques fussent tout à fait fermées, nous sommes-nous arrêtés devant les marchands de volailles, les fruitiers, les épiciers, les confiseurs : oh ! les belles oies grasses ! les grosses dindes de France ! les blancs poulets ! Voici des montagnes d’oranges et de pommes, des amas de marrons et de pruneaux ! Comme ces fruits glacés vous font venir l’eau à la bouche !
Il y aura des enfants bien joyeux, et qui tout émus de gourmandises se jetteront dans les bras de leurs parents.
Et en imagination tout en courant les rues, pauvres misérables que nous sommes, nous voyions ces douces fêtes de famille, aussi bien dans le manoir aristocratique que dans la chaumière du pauvre.
Gai Noël pour ceux qui sont aimés.
XIX
LES PEURS DE MATTIA
M. James Milligan ne parut pas cour du Lion-Rouge, ou tout au moins, malgré notre surveillance, nous ne le vîmes point.
Après les fêtes de Noël, il fallut sortir dans la journée, et nos chances diminuèrent ; nous n’avions guère plus d’espérance que dans le dimanche ; aussi restâmes-nous bien souvent à la maison, au lieu d’aller nous promener en cette journée de liberté, qui aurait pu être une journée de récréation.
Nous attendions.
Sans dire tout ce qui nous préoccupait, Mattia s’était ouvert à son ami Bob et lui avait demandé s’il n’y avait pas des moyens pour trouver l’adresse d’une dame Milligan, qui avait un fils paralysé, ou même tout simplement celle de M. James Milligan. Mais Bob avait répondu qu’il faudrait savoir quelle était cette dame Milligan et aussi quelle était la profession ou la position sociale de M. James Milligan, attendu que ce nom de Milligan était porté par un certain nombre de personnes à Londres et un plus grand nombre encore en Angleterre.
Nous n’avions pas pensé à cela. Pour nous il n’y avait qu’une madame Milligan, qui était la mère d’Arthur, et qu’un monsieur James Milligan, qui était l’oncle d’Arthur.
Alors Mattia recommença à me dire que nous devions retourner en France, et nos discussions reprirent de plus belle.
— Tu veux donc renoncer à trouver madame Milligan ? lui disais-je.
— Non, assurément, mais il n’est pas prouvé que madame Milligan soit encore en Angleterre.
— Il ne l’est pas davantage qu’elle soit en France.
— Cela me paraît probable ; puisque Arthur a été malade, sa mère a dû le conduire dans un pays où le climat est bon pour son rétablissement.
— Ce n’est pas en France seulement qu’on trouve un bon climat pour la santé.
— C’est en France qu’Arthur a guéri déjà une fois, c’est en France que sa mère a dû le conduire de nouveau, et puis je voudrais te voir partir d’ici.
Telle était ma situation, que je n’osais demander à Mattia pourquoi il voudrait me voir partir d’ici : j’avais peur qu’il me répondît ce que précisément je ne voulais pas entendre.
— J’ai peur, continuait Mattia, allons-nous-en ; tu verras qu’il nous arrivera quelque catastrophe, allons-nous-en.
Mais bien que les dispositions de ma famille n’eussent pas changé à mon égard, bien que mon grand-père continuât à cracher furieusement de mon côté, bien que mon père ne m’adressât que quelques mots de commandement, bien que ma mère n’eût jamais eu un regard pour moi, bien que mes frères fussent inépuisables à inventer de mauvais tours pour me nuire, bien qu’Annie me témoignât son aversion dans toutes les occasions, bien que Kate n’eût d’affection que pour les sucreries que je lui rapportais, je ne pouvais me décider à suivre le conseil de Mattia, pas plus que je ne pouvais le croire lorsqu’il affirmait que je n’étais pas le « fils de master Driscoll : » douter, oui je le pouvais, je ne le pouvais que trop ; mais croire fermement que j’étais ou n’étais pas un Driscoll, je ne le pouvais point.
Le temps s’écoula lentement, bien lentement, mais enfin les jours s’ajoutèrent aux jours, les semaines aux semaines, et le moment arriva où la famille devait quitter Londres pour parcourir l’Angleterre.
Les deux voitures avaient été repeintes, et on les avait chargées de toutes les marchandises qu’elles pouvaient contenir, et qu’on vendrait pendant la belle saison.
Que de choses et comme il était merveilleux qu’on pût les entasser dans ces voitures : des étoffes, des tricots, des bonnets, des fichus, des mouchoirs, des bas, des caleçons, des gilets, des boutons, du fil, du coton, de la laine à coudre, de la laine à tricoter, des aiguilles, des ciseaux, des rasoirs, des boucles d’oreilles, des bagues, des savons, des pommades, du cirage, des pierres à repasser, des poudres pour les maladies des chevaux et des chiens, des essences pour détacher, des eaux contre le mal des dents, des drogues pour faire pousser les cheveux, d’autres pour les teindre.
Et quand nous étions là nous voyions sortir de la cave des ballots qui étaient arrivés cour du Lion-Rouge, en ne venant pas directement des magasins dans lesquels on vendait ordinairement ces marchandises.
Enfin les voitures furent remplies, des chevaux furent achetés : où et comment ? je n’en sais rien, mais nous les vîmes arriver, et tout fut prêt pour le départ.
Et nous, qu’allions-nous faire ? Resterions-nous à Londres avec le grand-père qui ne quittait pas la cour du Lion-Rouge ? Serions-nous marchands comme Allen et Ned ? Ou bien accompagnerions-nous les voitures de la famille, en continuant notre métier de musiciens, et en jouant notre répertoire dans les villages, dans les villes qui se trouveraient sur notre chemin ?
Mon père ayant trouvé que nous gagnions de bonnes journées avec notre violon et notre harpe, décida que nous resterions musiciens et il nous signifia sa volonté la veille de notre départ.
— Retournons en France, me dit Mattia, et profitons de la première occasion qui se présentera pour nous sauver.
— Pourquoi ne pas faire un voyage en Angleterre ?
— Parce que je te dis qu’il nous arrivera une catastrophe.
— Nous avons chance de trouver madame Milligan en Angleterre.
— Moi je crois que nous avons beaucoup plus de chances pour cela en France.
— Enfin essayons toujours en Angleterre ; nous verrons ensuite.
— Sais-tu ce que tu mérites ?
— Non.
— Que je t’abandonne, et que je retourne tout seul en France.
— Tu as raison ; aussi je t’engage à le faire ; je sais bien que je n’ai pas le droit de te retenir ; et je sais bien que tu es trop bon de rester avec moi ; pars donc, tu verras Lise, tu lui diras…
— Si je la voyais je lui dirais que tu es bête et méchant de pouvoir penser que je me séparerai de toi quand tu es malheureux ; car tu es malheureux, très-malheureux ; qu’est-ce que je t’ai fait pour que tu aies de pareilles idées ; dis-moi ce que je t’ai fait ; rien n’est-ce pas ? eh bien, en route alors.
Nous voilà de nouveau sur les grands chemins ; mais cette fois, je ne suis plus libre d’aller où je veux, et de faire ce que bon me semble ; cependant c’est avec un sentiment de délivrance que je quitte Londres : je ne verrai plus la cour du Lion-Rouge, et cette trappe qui, malgré ma volonté, attirait mes yeux irrésistiblement. Combien de fois me suis-je réveillé la nuit en sursaut, ayant vu dans mon rêve, dans mon cauchemar une lumière rouge entrer par ma petite fenêtre ; c’est une vision, une hallucination, mais qu’importe ; j’ai vu une fois cette lumière, et c’est assez pour que je la sente toujours sur mes yeux comme une flamme brûlante.
Nous marchions derrière les voitures, et au lieu des exhalaisons puantes et malfaisantes de Bethnal-Green, nous respirons l’air pur des belles campagnes que nous traversons, et qui n’ont peut-être pas du green dans leur nom, mais qui ont du vert pour les yeux et des chants d’oiseaux pour les oreilles.
Le jour même de notre départ, je vis comment se faisait la vente de ces marchandises qui avaient coûté si peu cher : nous étions arrivés dans un gros village, et les voitures avaient été rangées sur la grande place, on avait abaissé un des côtés, formés de plusieurs panneaux, et tout l’étalage s’était présenté à la curiosité des acheteurs.
— Voyez les prix ! voyez les prix ! criait mon père ; vous n’en trouverez nulle part de pareils ; comme je ne paye jamais mes marchandises, cela me permet de les vendre bon marché ; je ne les vends pas, je les donne ; voyez les prix ! voyez les prix !
Et j’entendais des gens qui avaient regardé ces prix, dire en s’en allant :
— Il faut que ce soient là des marchandises volées.
— Il le dit lui-même.
S’ils avaient jeté les yeux de mon côté, la rougeur de mon front leur aurait appris combien étaient fondées leurs suppositions.
S’ils ne virent point cette rougeur, Mattia la remarqua, lui, et le soir il m’en parla, bien que d’ordinaire il évitât d’aborder franchement ce sujet.
— Pourras-tu toujours supporter cette honte ? me dit-il.
— Ne me parle pas de cela, si tu ne veux pas me rendre cette honte plus cruelle encore.
— Ce n’est pas cela que je veux. Je veux que nous retournions en France. Je t’ai toujours dit qu’il arriverait une catastrophe ; je te le dis encore, et je sens qu’elle ne tardera pas. Comprends donc qu’il y aura des gens de police qui, un jour ou l’autre, voudront savoir comment master Driscoll vend ses marchandises à si bas prix ; alors qu’arrivera-t-il ?
— Mattia, je t’en prie…
— Puisque tu ne veux pas voir, il faut bien que je voie pour toi ; il arrivera qu’on nous arrêtera tous, même toi, même moi, qui n’avons rien fait. Comment prouver que nous n’avons rien fait ? Comment nous défendre ? N’est-il pas vrai que nous mangeons le pain payé avec l’argent de ces marchandises ?
Cette idée ne s’était jamais présentée à mon esprit, elle me frappa comme un coup de marteau qu’on m’aurait asséné sur la tête.
— Mais nous gagnons notre pain, dis-je, en essayant de me défendre, non contre Mattia, mais contre cette idée.
— Cela est vrai, répondit Mattia, mais il est vrai aussi que nous sommes associés avec des gens qui ne gagnent pas le leur. C’est là ce qu’on verra, et l’on ne verra que cela. Nous serons condamnés comme ils le seront eux-mêmes. Cela me ferait grande peine d’être condamné comme voleur, mais combien plus encore cela m’en ferait-il que tu le fusses. Moi, je ne suis qu’un pauvre misérable, et je ne serai jamais que cela ; mais toi, quand tu auras retrouvé ta famille, ta vraie famille, quel chagrin pour elle, quelle honte pour toi, si tu as été condamné. Et puis ce n’est pas quand nous serons en prison que nous pourrons chercher ta famille et la découvrir. Ce n’est pas quand nous serons en prison que nous pourrons avertir madame Milligan de ce que M. James Milligan prépare contre Arthur. Sauvons-nous donc pendant qu’il en est temps encore.
— Sauve-toi.
— Tu dis toujours la même bêtise ; nous nous sauverons ensemble ou nous serons pris ensemble ; et quand nous le serons, ce qui ne tardera pas, tu auras la responsabilité de m’avoir entraîné avec toi, et tu verras si elle te sera légère. Si tu étais utile à ceux auprès de qui tu t’obstines à rester, je comprendrais ton obstination ; cela serait beau ; mais tu ne leur es pas du tout indispensable ; ils vivaient bien, ils vivront bien sans toi. Partons au plus vite.
— Eh bien ! laisse-moi encore quelques jours de réflexion, et puis nous verrons.
— Dépêche-toi. L’ogre sentait la chair fraîche, moi je sens le danger.
Jamais les paroles, les raisonnements, les prières de Mattia ne m’avaient si profondément troublé, et quand je me les rappelais, je me disais que l’irrésolution dans laquelle je me débattais était lâche et que je devais prendre un parti en me décidant enfin à savoir ce que je voulais.
Les circonstances firent ce que de moi-même je n’osais faire.
Il y avait plusieurs semaines déjà que nous avions quitté Londres, et nous étions arrivés dans une ville aux environs de laquelle devaient avoir lieu des courses. En Angleterre les courses de chevaux ne sont pas ce qu’elles sont en France, un simple amusement pour les gens riches qui viennent voir lutter trois ou quatre chevaux, se montrer eux-mêmes, et risquer en paris quelques louis ; elles sont une fête populaire pour la contrée, et ce ne sont point les chevaux seuls qui donnent le spectacle, sur la lande ou sur les dunes qui servent d’hippodrome, arrivent quelquefois plusieurs jours à l’avance des saltimbanques, des bohémiens, des marchands ambulants qui tiennent là une sorte de foire : nous nous étions hâtés pour prendre notre place dans cette foire, nous comme musiciens, la famille Driscoll, comme marchands.
Mais au lieu de venir sur le champ de courses, mon père s’était établi dans la ville même où sans doute il pensait faire de meilleures affaires.
Arrivés de bonne heure et n’ayant pas à travailler à l’étalage des marchandises, nous allâmes, Mattia et moi, voir le champ de course qui se trouvait situé à une assez courte distance de la ville, sur une bruyère : de nombreuses tentes étaient dressées, et de loin on apercevait çà et là des petites colonnes de fumée qui marquaient la place et les limites du champ de course : nous ne tardâmes point à déboucher par un chemin creux sur la lande aride et nue en temps ordinaire, mais où ce soir-là on voyait des hangars en planches dans lesquels s’étaient installés des cabarets et même des hôtels, des baraques, des tentes, des voitures ou simplement des bivacs[1] autour desquels se pressaient des gens en haillons pittoresques.
Comme nous passions devant un de ces feux au-dessus duquel une marmite était suspendue, nous reconnûmes notre ami Bob. Il se montra enchanté de nous voir. Il était venu aux courses avec deux de ses camarades, pour donner des représentations d’exercices de force et d’adresse, mais les musiciens sur qui ils comptaient leur avaient manqué de parole, de sorte que leur journée du lendemain au lieu d’être fructueuse comme ils l’avaient espéré, serait probablement détestable. Si nous voulions nous pouvions leur rendre un grand service : c’était de remplacer ces musiciens, la recette serait partagée entre nous cinq ; il y aurait même une part pour Capi.
Au coup d’œil que Mattia me lança je compris que ce serait faire plaisir à mon camarade d’accepter la proposition de Bob, et comme nous étions libres de faire ce que bon nous semblait, à la seule condition de rapporter une bonne recette, je l’acceptai.
Il fut donc convenu que le lendemain nous viendrions nous mettre à la disposition de Bob et de ses deux amis.
Mais en rentrant dans la ville, une difficulté se présenta quand je fis part de cet arrangement à mon père.
— J’ai besoin de Capi demain, dit-il, vous ne pourrez pas le prendre.
À ce mot, je me sentis mal rassuré ; voulait-on employer Capi à quelque vilaine besogne ? mais mon père dissipa tout de suite mes appréhensions :
— Capi a l’oreille fine, dit-il, il entend tout et fait bonne garde, il nous sera utile pour les voitures, car au milieu de cette confusion de gens on pourrait bien nous voler. Vous irez donc seuls jouer avec Bob, et si votre travail se prolonge tard dans la nuit, ce qui est probable, vous viendrez nous rejoindre à l’Auberge du Gros-Chêne où nous coucherons, car mon intention est de partir d’ici à la nuit tombante.
Cette auberge du Gros-Chêne où nous avions passé la nuit précédente, était située à une lieue de là en pleine campagne, dans un endroit désert et sinistre ; et elle était tenue par un couple dont la mine n’était pas faite pour inspirer confiance ; rien ne nous serait plus facile que de retrouver cette auberge dans la nuit ; la route était droite ; elle n’aurait d’autre ennui pour nous que d’être un peu longue après une journée de fatigue.
Mais ce n’était pas là une observation à présenter à mon père qui ne souffrait jamais la contradiction : quand il avait parlé, il fallait obéir et sans répliquer.
Le lendemain matin, après avoir été promener Capi, lui avoir donné à manger et l’avoir fait boire pour être bien sûr qu’il ne manquerait de rien, je l’attachai moi-même à l’essieu de la voiture qu’il devait garder et nous gagnâmes le champ de course, Mattia et moi.
Aussitôt arrivés nous nous mîmes à jouer et cela dura sans repos jusqu’au soir ; j’avais le bout des doigts douloureux comme s’ils étaient piqués par des milliers d’épines et Mattia avait tant soufflé dans son cornet à piston qu’il ne pouvait plus respirer : cependant il fallait jouer toujours ; Bob et ses camarades ne se lassant point de faire leurs tours, de notre côté nous ne pouvions pas nous lasser plus qu’eux. Quand vint le soir je crus que nous allions nous reposer ; mais nous abandonnâmes notre tente pour un grand cabaret en planches et là, exercices et musique reprirent de plus belle. Cela dura ainsi jusqu’après minuit ; je faisais encore un certain tapage avec ma harpe, mais je ne savais plus trop ce que je jouais et Mattia ne le savait pas mieux que moi. Vingt fois Bob avait annoncé que c’était la dernière représentation, et vingt fois nous en avions recommencé une nouvelle.
Si nous étions las, nos camarades qui dépensaient beaucoup plus de forces que nous étaient exténués, aussi avaient-ils déjà manqué plus d’un de leurs tours ; à un moment une grande perche qui servait à leurs exercices tomba sur le bout du pied de Mattia ; la douleur fut si vive, que Mattia poussa un cri ; je crus qu’il avait le pied écrasé, et nous nous empressâmes autour de lui, Bob et moi. Heureusement la blessure n’avait pas cette gravité ; il y avait contusion, et les chairs étaient déchirées, mais les os n’étaient pas brisés. Cependant Mattia ne pouvait pas marcher.
Que faire ?
Il fut décidé qu’il resterait à coucher dans la voiture de Bob, et que moi je gagnerais tout seul l’auberge du Gros-Chêne ; ne fallait-il pas que je susse où la famille Driscoll se rendait le lendemain ?
— Ne t’en va pas, me répétait Mattia, nous partirons ensemble demain.
— Et si nous ne trouvons personne à l’auberge du Gros-Chêne !
— Alors tant mieux, nous serons libres.
— Si je quitte la famille Driscoll, ce ne sera pas ainsi : d’ailleurs crois-tu qu’ils ne nous auraient pas bien vite rejoints ? où veux-tu aller avec ton pied ?
— Eh bien ! nous partirons, si tu le veux, demain ; mais ne pars pas ce soir, j’ai peur.
— De quoi ?
— Je ne sais pas, j’ai peur pour toi.
— Laisse-moi aller, je te promets de revenir demain.
— Et si l’on te retient ?
— Pour qu’on ne puisse pas me retenir, je vais te laisser ma harpe ; il faudra bien que je revienne la chercher.
Et malgré la peur de Mattia, je me mis en route n’ayant nullement peur moi-même.
De qui, de quoi, aurais-je eu peur ? Que pouvait-on demander à un pauvre diable comme moi ?
Cependant si je ne me sentais pas dans le cœur le plus léger sentiment d’effroi, je n’en étais pas moins très-ému : c’était la première fois que j’étais vraiment seul, sans Capi, sans Mattia, et cet isolement m’oppressait en même temps que les voix mystérieuses de la nuit me troublaient : la lune aussi qui me regardait avec sa face blafarde m’attristait.
Malgré ma fatigue, je marchai vite et j’arrivai à la fin à l’auberge du Gros-Chêne ; mais j’eus beau chercher nos voitures, je ne les trouvai point ; il y avait deux ou trois misérables carrioles à bâche de toile, une grande baraque en planche et deux chariots couverts d’où sortirent des cris de bêtes fauves quand j’approchai ; mais les belles voitures aux couleurs éclatantes de la famille Driscoll, je ne les vis nulle part.
En tournant autour de l’auberge, j’aperçus une lumière qui éclairait une imposte vitrée, et pensant que tout le monde n’était pas couché, je frappai à la porte : l’aubergiste à mauvaise figure que j’avais remarqué la veille, m’ouvrit lui-même, et me braqua en plein visage la lueur de sa lanterne ; je vis qu’il me reconnaissait, mais au lieu de me livrer passage, il mit sa lanterne derrière son dos, regarda autour de lui, et écouta durant quelques secondes.
— Vos voitures sont parties, dit-il, votre père a recommandé que vous le rejoigniez à Lewes sans perdre de temps, et en marchant toute la nuit. Bon voyage !
Et il me ferma la porte au nez, sans m’en dire davantage.
Depuis que j’étais en Angleterre j’avais appris assez d’anglais pour comprendre cette courte phrase ; pourtant il y avait un mot et le plus important, qui n’avait pas de sens pour moi : Louisse, avait prononcé l’aubergiste ; où était ce pays ? je n’en avais aucune idée, car j’ignorais alors que Louisse était la prononciation anglaise de Lewes, nom de ville que j’avais vu écrit sur la carte.
D’ailleurs aurais-je su où était Lewes, que je ne pouvais pas m’y rendre tout de suite en abandonnant Mattia ; je devais donc retourner au champ de course, si fatigué que je fusse.
Je me remis en marche et une heure et demie après je me couchais sur une bonne botte de paille à côté de Mattia, dans la voiture de Bob, et en quelques paroles je lui racontais ce qui s’était passé, puis je m’endormais mort de fatigue.
Quelques heures de sommeil me rendirent mes forces et le matin je me réveillai prêt à partir pour Lewes, si toutefois Mattia, qui dormait encore, pouvait me suivre.
Sortant de la voiture, je me dirigeai vers notre ami Bob qui, levé avant moi, était occupé à allumer son feu ; je le regardais, couché à quatre pattes, et soufflant de toutes ses forces sous la marmite, lorsqu’il me sembla reconnaître Capi conduit en laisse par un policeman.
Stupéfait, je restai immobile, me demandant ce que cela pouvait signifier ; mais Capi qui m’avait reconnu avait donné une forte secousse à la laisse qui s’était échappée des mains du policeman ; alors en quelques bonds il était accouru à moi et il avait sauté dans mes bras.
Le policeman s’approcha :
— Ce chien est à vous, n’est-ce pas ? me demanda-t-il.
— Oui.
— Eh bien je vous arrête.
Et sa main s’abattit sur mon bras qu’elle serra fortement.
Les paroles et le geste de l’agent de police avaient fait relever Bob ; il s’avança :
— Et pourquoi arrêtez-vous ce garçon ? demanda-t-il.
— Êtes-vous son frère ?
— Non, son ami.
— Un homme et un enfant ont pénétré cette nuit dans l’église Saint-Georges par une haute fenêtre et au moyen d’une échelle ; ils avaient avec eux ce chien pour leur donner l’éveil si on venait les déranger ; c’est ce qui est arrivé ; dans leur surprise, ils n’ont pas eu le temps de prendre le chien avec eux en se sauvant par la fenêtre, et celui-ci ne pouvant pas les suivre, a été trouvé dans l’église ; avec le chien, j’étais bien sûr de découvrir les voleurs et j’en tiens un ; où est le père, maintenant ?
Je ne sais si cette question s’adressait à Bob ou à moi ; je n’y répondis pas, j’étais anéanti.
Et cependant je comprenais ce qui s’était passé ; malgré moi je le devinais : ce n’était pas pour garder les voitures que Capi m’avait été demandé, c’était parce que son oreille était fine et qu’il pourrait avertir ceux qui seraient en train de voler dans l’église ; enfin ce n’était pas pour le seul plaisir d’aller coucher à l’auberge du Gros-Chêne, que les voitures étaient parties à la nuit tombante ; si elles ne s’étaient pas arrêtées dans cette auberge, c’était parce que le vol ayant été découvert, il fallait prendre la fuite au plus vite.
Mais ce n’était pas aux coupables que je devais penser, c’était à moi ; quels qu’ils fussent, je pouvais me défendre, et sans les accuser prouver mon innocence ; je n’avais qu’à donner l’emploi de mon temps pendant cette nuit.
Pendant que je raisonnais ainsi, Mattia, qui avait entendu l’agent ou la clameur qui s’était élevée, était sorti de la voiture et en boitant il était accouru près de moi.
— Expliquez-lui que je ne suis pas coupable, dis-je à Bob, puisque je suis resté avec vous jusqu’à une heure du matin ; ensuite j’ai été à l’auberge du Gros-Chêne où j’ai parlé à l’aubergiste, et aussitôt je suis revenu ici.
Bob traduisit mes paroles à l’agent ; mais celui-ci ne parut pas convaincu comme je l’avais espéré, tout au contraire :
— C’est à une heure un quart qu’on s’est introduit dans l’église, dit-il ; ce garçon est parti d’ici à une heure ou quelques minutes avant une heure, comme il le prétend, il a donc pu être dans l’église à une heure un quart, avec ceux qui volaient.
— Il faut plus d’un quart d’heure pour aller d’ici à la ville, dit Bob.
— Oh ! en courant, répliqua l’agent, et puis qui me prouve qu’il est parti à une heure ?
— Moi qui le jure, s’écria Bob.
— Oh ! vous, dit l’agent, faudra voir ce que vaut votre témoignage.
Bob se fâcha.
— Faites attention que je suis citoyen anglais, dit-il avec dignité.
L’agent haussa les épaules.
— Si vous m’insultez, dit Bob, j’écrirai au Times.
— En attendant j’emmène ce garçon, il s’expliquera devant le magistrat.
Mattia se jeta dans mes bras, je crus que c’était pour m’embrasser, mais Mattia faisait passer ce qui était pratique avant ce qui était sentiment.
— Bon courage, me dit-il à l’oreille, nous ne t’abandonnerons pas.
Et alors seulement il m’embrassa.
— Retiens Capi, dis-je en français à Mattia.
Mais l’agent me comprit :
— Non, non, dit-il, je garde le chien, il m’a fait trouver celui-ci, il me fera trouver les autres.
C’était la seconde fois qu’on m’arrêtait, et cependant la honte qui m’étouffa fut plus poignante encore : c’est qu’il ne s’agissait plus d’une sotte accusation comme à propos de notre vache ; si je sortais innocent de cette accusation, n’aurai-je pas la douleur de voir condamner, justement condamner, ceux dont on me croyait le complice ?
Il me fallut traverser, tenu par le policeman, la haie des curieux qui accouraient sur notre passage, mais on ne me poursuivit pas de huées et de menaces comme en France, car ceux qui venaient me regarder n’étaient point des paysans, mais des gens qui tous ou à peu près vivaient en guerre avec la police, des saltimbanques, des cabaretiers, des bohémiens, des tramps, comme disent les Anglais, c’est-à-dire des vagabonds.
La prison où l’on m’enferma, n’était point une prison pour rire comme celle que nous avions trouvée encombrée d’oignons, c’était une vraie prison avec une fenêtre grillée de gros barreaux de fer dont la vue seule tuait dans son germe toute idée d’évasion. Le mobilier se composait d’un banc pour s’asseoir, et d’un hamac pour se coucher.
Je me laissai tomber sur ce banc et j’y restai longtemps accablé, réfléchissant à ma triste condition, mais sans suite, car il m’était impossible de joindre deux idées et de passer de l’une à l’autre.
Combien le présent était terrible, combien l’avenir était effrayant !
« Bon courage, m’avait dit Mattia, nous ne t’abandonnerons pas » ; mais que pouvait un enfant comme Mattia ? que pouvait même un homme comme Bob, si celui-ci voulait bien aider Mattia ?
Quand on est en prison, on n’a qu’une idée fixe, celle d’en sortir.
Comment Mattia et Bob pouvaient-ils, en ne m’abandonnant pas et en faisant tout pour me servir, m’aider à sortir de ce cachot ?
J’allai à la fenêtre et l’ouvris pour tâter les barreaux de fer qui, en se croisant, la fermaient au dehors : ils étaient scellés dans la pierre ; j’examinai les murailles, elles avaient près d’un mètre d’épaisseur ; le sol était dallé avec de larges pierres ; la porte était recouverte d’une plaque de tôle.
Je retournai à la fenêtre ; elle donnait sur une petite cour étroite et longue, fermée à son extrémité par un grand mur qui avait au moins quatre mètres de hauteur.
Assurément on ne s’échappait pas de cette prison, même quand on était aidé par des amis dévoués. Que peut le dévouement de l’amitié contre la force des choses ? le dévouement ne perce pas les murs.
Pour moi, toute la question présentement était de savoir combien de temps je resterais dans cette prison, avant de paraître devant le magistrat qui déciderait de mon sort.
Me serait-il possible de lui démontrer mon innocence malgré la présence de Capi dans l’église ?
Et me serait-il possible de me défendre sans rejeter le crime sur ceux que je ne voulais pas, que je ne pouvais pas accuser ?
Tout était là pour moi, et c’était en cela, en cela seulement que Mattia et son ami Bob pouvaient me servir : leur rôle consistait à réunir des témoignages pour prouver qu’à une heure un quart je ne pouvais pas être dans l’église Saint-Georges ; s’ils faisaient cette preuve j’étais sauvé, malgré le témoignage muet que mon pauvre Capi porterait contre moi ; et ces témoignages, il me semblait qu’il n’était pas impossible de les trouver.
Ah ! si Mattia n’avait pas eu le pied meurtri, il saurait bien chercher, se mettre en peine, mais dans l’état où il était, pourrait-il sortir de sa voiture ? et s’il ne le pouvait pas, Bob voudrait-il le remplacer ?
Ces angoisses jointes à toutes celles que j’éprouvais ne me permirent pas de m’endormir malgré ma fatigue de la veille ; elles ne me permirent même pas de toucher à la nourriture qu’on m’apporta ; mais si je laissai les aliments de côté, je me précipitai au contraire sur l’eau, car j’étais dévoré par une soif ardente, et pendant toute la journée j’allai à ma cruche de quart d’heure en quart d’heure, buvant à longs traits, mais sans me désaltérer et sans affaiblir le goût d’amertume qui m’emplissait la bouche.
Quand j’avais vu le geôlier entrer dans ma prison, j’avais éprouvé un mouvement de satisfaction et comme un élan d’espérance, car depuis que j’étais enfermé j’étais tourmenté, enfiévré par une question que je me posais sans lui trouver une réponse :
— Quand le magistrat m’interrogerait-il ? Quand pourrais-je me défendre ?
J’avais entendu raconter des histoires de prisonniers qu’on tenait enfermés pendant des mois sans les faire passer en jugement ou sans les interroger, ce qui pour moi était tout un, et j’ignorais qu’en Angleterre il ne s’écoulait jamais plus d’un jour ou deux entre l’arrestation et la comparution publique devant un magistrat.
Cette question que je ne pouvais résoudre fut donc la première que j’adressai au geôlier qui n’avait point l’air d’un méchant homme, et il voulut bien me répondre que je comparaîtrais certainement à l’audience du lendemain.
Mais ma question lui avait suggéré l’idée de me questionner à son tour ; puisqu’il m’avait répondu, n’était-il pas juste que je lui répondisse aussi ?
— Comment donc êtes-vous entré dans l’église ? me demanda-t-il.
À ces mots je répondis par les plus ardentes protestations d’innocence ; mais il me regarda en haussant les épaules ; puis comme je continuais de lui répéter que je n’étais pas entré dans l’église, il se dirigea vers la porte et alors me regardant :
— Sont-ils vicieux ces gamins de Londres ? dit-il, à mi-voix.
Et il sortit.
Cela m’affecta cruellement : bien que cet homme ne fût pas mon juge, j’aurais voulu qu’il me crût innocent ; à mon accent, à mon regard, il aurait dû voir que je n’étais pas coupable.
Si je ne l’avais convaincu, me serait-il possible de convaincre le juge ? heureusement j’aurais des témoins qui parleraient pour moi ; et si le juge ne m’écoutait pas, au moins serait-il obligé d’écouter et de croire les témoignages qui m’innocenteraient.
Mais il me fallait ces témoignages.
Les aurais-je ?
Parmi les histoires de prisonniers que je savais, il y en avait une qui parlait des moyens qu’on employait pour communiquer avec ceux qui étaient enfermés : on cachait des billets dans la nourriture qu’on apportait du dehors.
Peut-être Mattia et Bob s’étaient-ils servis de cette ruse, et quand cette idée m’eut traversé l’esprit, je me mis à émietter mon pain, mais je ne trouvai rien dedans. Avec ce morceau de pain on m’avait apporté des pommes de terre, je les réduisis en farine ; elles ne contenaient pas le plus petit billet.
Décidément Mattia et Bob n’avaient rien à me dire, ou, ce qui était plus probable, ils ne pouvaient rien me dire.
Je n’avais donc qu’à attendre le lendemain, sans trop me désoler, si c’était possible ; mais par malheur cela ne me fut pas possible, et si vieux que je vive, je garderai, comme s’il datait d’hier, le souvenir de la terrible nuit que je passai. Ah ! comme j’avais été fou de ne pas avoir foi dans les pressentiments de Mattia et dans ses peurs !
Le lendemain matin le geôlier entra dans ma prison portant une cruche et une cuvette ; il m’engagea à faire ma toilette, si le cœur m’en disait, parce que j’allais bientôt paraître devant le magistrat, et il ajouta qu’une tenue décente était quelquefois le meilleur moyen de défense d’un accusé.
Ma toilette achevée, je voulus m’asseoir sur mon banc, mais il me fut impossible de rester en place, et je me mis à tourner dans ma cellule comme les bêtes tournent dans leur cage.
J’aurais voulu préparer ma défense et mes réponses, mais j’étais trop affolé, et au lieu de penser à l’heure présente, je pensais à toutes sortes de choses absurdes qui passaient devant mon esprit fatigué, comme les ombres d’une lanterne magique.
Le geôlier revint et me dit de le suivre ; je marchai à côté de lui et après avoir traversé plusieurs corridors nous nous trouvâmes devant une petite porte qu’il ouvrit.
— Passez, me dit-il.
Un air chaud me souffla au visage et j’entendis un bourdonnement confus : j’entrai et me trouvai dans une petite tribune ; j’étais dans la salle du tribunal.
Bien que je fusse en proie à une sorte d’hallucination et que je sentisse les artères de mon front battre comme si elles allaient éclater, en un coup d’œil jeté circulairement autour de moi j’eus une vision nette et complète de ce qui m’entourait, — la salle d’audience et les gens qui l’emplissaient.
Elle était assez grande, cette salle, haute de plafond avec de larges fenêtres ; elle était divisée en deux enceintes ; l’une réservée au tribunal, l’autre ouverte aux curieux.
Sur une estrade élevée était assis le juge, plus bas et devant lui siégeaient trois autres gens de justice qui étaient, je le sus plus tard, un greffier, un trésorier pour les amendes, et un autre magistrat qu’on nomme en France le ministère public : devant ma tribune était un personnage en robe et en perruque, mon avocat.
Comment avais-je un avocat ? D’où me venait-il ? Qui me l’avait donné ? Était-ce Mattia et Bob ? c’étaient là des questions qu’il n’était pas l’heure d’examiner. J’avais un avocat, cela suffisait.
Dans une autre tribune j’aperçus Bob lui-même, ses deux camarades, l’aubergiste du Gros-Chêne, et des gens que je ne connaissais point, puis dans une autre qui faisait face à celle-là je reconnus le policeman qui m’avait arrêté ; plusieurs personnes étaient avec lui : je compris que ces tribunes étaient celles des témoins.
L’enceinte réservée au public était pleine ; au-dessus d’une balustrade j’aperçus Mattia, nos yeux se croisèrent, s’embrassèrent, et instantanément je sentis le courage me relever : je serais défendu, c’était à moi de ne pas m’abandonner et de me défendre moi-même ; je ne fus plus écrasé par tous les regards qui étaient dardés sur moi.
Le ministère public prit la parole, et en peu de mots, — il avait l’air très-pressé, — il exposa l’affaire : un vol avait été commis dans l’église Saint-Georges ; les voleurs, un homme et un enfant, s’étaient introduits dans l’église au moyen d’une échelle et en brisant une fenêtre ; ils avaient avec eux un chien qu’ils avaient amené pour faire bonne garde et les prévenir du danger, s’il en survenait un ; un passant attardé, il était alors une heure un quart, avait été surpris de voir une faible lumière dans l’église, il avait écouté et il avait entendu des craquements ; aussitôt il avait été réveiller le bedeau ; on était revenu en nombre, mais alors le chien avait aboyé et pendant qu’on ouvrait la porte les voleurs effrayés s’étaient sauvés par la fenêtre, abandonnant leur chien, qui n’avait pas pu monter à l’échelle ; ce chien, conduit sur le champ de course par l’agent Jerry, dont on ne saurait trop louer l’intelligence et le zèle, avait reconnu son maître qui n’était autre que l’accusé présent sur ce banc ; quant au second voleur on était sur sa piste.
Après quelques considérations qui démontraient ma culpabilité, le ministère public se tut, et une voix glapissante cria : Silence !
Le juge alors, sans se tourner de mon côté, et comme s’il parlait pour lui-même, me demanda mon nom, mon âge et ma profession.
Je répondis en anglais que je m’appelais Francis Driscoll et que je demeurais chez mes parents à Londres, cour du Lion-Rouge, dans Bethnal-Green ; puis je demandai la permission de m’expliquer en français, attendu que j’avais été élevé en France et que je n’étais en Angleterre que depuis quelques mois.
— Ne croyez pas me tromper, me dit sévèrement le juge ; je sais le français.
Je fis donc mon récit en français, et j’expliquai comment il était de toute impossibilité que je fusse dans l’église à une heure, puisqu’à cette heure j’étais au champ de course et qu’à deux heures et demie j’étais à l’auberge du Gros-Chêne.
— Et où étiez-vous à une heure un quart ? demanda le juge.
— En chemin.
— C’est ce qu’il faut prouver. Vous dites que vous étiez sur la route de l’auberge du Gros-Chêne, et l’accusation soutient que vous étiez dans l’église. Parti du champ de course à une heure moins quelques minutes, vous seriez venu rejoindre votre complice sous les murs de l’église, où il vous attendait avec une échelle, et ce serait après votre vol manqué que vous auriez été à l’auberge du Gros-Chêne.
Je m’efforçai de démontrer que cela ne se pouvait pas, mais je vis que le juge n’était pas convaincu.
— Et comment expliquez-vous la présence de votre chien dans l’église ? me demanda le juge.
— Je ne l’explique pas, je ne la comprends même pas ; mon chien n’était pas avec moi, je l’avais attaché le matin sous une de nos voitures.
Il ne me convenait pas d’en dire davantage, car je ne voulais pas donner des armes contre mon père ; je regardai Mattia, il me fit signe de continuer, mais je ne continuai point.
On appela un témoin et on lui fit prêter serment sur l’Évangile, de dire la vérité sans haine et sans passion.
C’était un gros bonhomme, court, à l’air prodigieusement majestueux, malgré sa figure rouge et son nez bleuâtre ; avant de jurer il adressa une génuflexion au tribunal et il se redressa en se rengorgeant : c’était le bedeau de la paroisse Saint-Georges.
Il commença par raconter longuement combien il avait été troublé et scandalisé lorsqu’on était venu le réveiller brusquement pour lui dire qu’il y avait des voleurs dans l’église : sa première idée avait été qu’on voulait lui jouer une mauvaise farce, mais comme on ne joue pas des farces à des personnes de son caractère, il avait compris qu’il se passait quelque chose de grave ; il s’était habillé alors avec tant de hâte qu’il avait fait sauter deux boutons de son gilet ; enfin il était accouru ; il avait ouvert la porte de l’église, et il avait trouvé… qui ? ou plutôt quoi ? un chien.
Je n’avais rien à répondre à cela, mais mon avocat qui, jusqu’à ce moment, n’avait rien dit, se leva, secoua sa perruque, assura sa robe sur ses épaules et prit la parole.
— Qui a fermé la porte de l’église hier soir ? demanda-t-il.
— Moi, répondit le bedeau, comme c’était mon devoir.
— Vous en êtes sûr ?
— Quand je fais une chose, je suis sûr que je la fais.
— Et quand vous ne la faites pas ?
— Je suis sûr que je ne l’ai pas faite.
— Très-bien : alors vous pouvez jurer que vous n’avez pas enfermé le chien dont il est question dans l’église ?
— Si le chien avait été dans l’église je l’aurais vu.
— Vous avez de bons yeux ?
— J’ai des yeux comme tout le monde.
— Il y a six mois, n’êtes-vous pas entré dans un veau qui était pendu le ventre grand ouvert, devant la boutique d’un boucher.
— Je ne vois pas l’importance d’une pareille question adressée à un homme de mon caractère, s’écria le bedeau devenant bleu.
— Voulez-vous avoir l’extrême obligeance d’y répondre comme si elle était vraiment importante ?
— Il est vrai que je me suis heurté contre un animal maladroitement exposé à la devanture d’un boucher.
— Vous ne l’aviez donc pas vu ?
— J’étais préoccupé.
— Vous veniez de dîner quand vous avez fermé la porte de l’église ?
— Certainement.
— Et quand vous êtes entré dans ce veau est-ce que vous ne veniez pas de dîner ?
— Mais…
— Vous dites que vous n’aviez pas dîné ?
— Si.
— Et c’est de la petite bière ou de la bière forte que vous buvez ?
— De la bière forte.
— Combien de pintes ?
— Deux.
— Jamais plus ?
— Quelquefois trois.
— Jamais quatre ? Jamais six ?
— Cela est bien rare.
— Vous ne prenez pas de grog après votre dîner ?
— Quelquefois.
— Vous l’aimez fort ou faible ?
— Pas trop faible.
— Combien de verres en buvez-vous ?
— Cela dépend.
— Est-ce que vous êtes prêt à jurer que vous n’en prenez pas quelquefois trois et même quatre verres ?
Comme le bedeau de plus en plus bleu ne répondit pas, l’avocat se rassit et tout en s’asseyant il dit :
— Cet interrogatoire suffit pour prouver que le chien a pu être enfermé dans l’église par le témoin qui, après dîner, ne voit pas les veaux parce qu’il est préoccupé ; c’était tout ce que je désirais savoir.
Si j’avais osé j’aurais embrassé mon avocat, j’étais sauvé.
Pourquoi Capi n’aurait-il pas été enfermé dans l’église ? Cela était possible. Et s’il avait été enfermé de cette façon, ce n’était pas moi qui l’avais introduit ; je n’étais donc pas coupable, puisqu’il n’y avait que cette charge contre moi.
Après le bedeau on entendit les gens qui l’accompagnaient lorsqu’il était entré dans l’église, mais ils n’avaient rien vu, si ce n’est la fenêtre ouverte par laquelle les voleurs s’étaient envolés.
Puis on entendit mes témoins : Bob, ses camarades, l’aubergiste, qui tous donnèrent l’emploi de mon temps ; cependant un seul point ne fut point éclairci et il était capital, puisqu’il portait sur l’heure précise à laquelle j’avais quitté le champ de course.
Les interrogatoires terminés, le juge me demanda si je n’avais rien à dire, en m’avertissant que je pouvais garder le silence si je le croyais bon.
Je répondis que j’étais innocent, et que je m’en remettais à la justice du tribunal.
Alors le juge fit lire le procès-verbal des dépositions que je venais d’entendre, puis il déclara que je serais transféré dans la prison du comté pour y attendre que le grand jury décide si je serais ou ne serais pas traduit devant les assises.
Les assises !
Je m’affaissai sur mon banc ; hélas ! que n’avais-je écouté Mattia !
XX
BOB.
Ce ne fut que longtemps après que je fus réintégré dans ma prison que je trouvai une raison pour m’expliquer comment je n’avais pas été acquitté : le juge voulait attendre l’arrestation de ceux qui étaient entrés dans l’église, pour voir si je n’étais pas leur complice.
On était sur leur piste, avait dit le ministère public, j’aurais donc la douleur et la honte de paraître bientôt sur le banc des assises à côté d’eux.
Quand cela arriverait-il ? Quand serais-je transféré dans la prison du comté ? Qu’était cette prison ? Où se trouvait-elle ? Était-elle plus triste que celle dans laquelle j’étais ?
Il y avait dans ces questions de quoi occuper mon esprit, et le temps passa plus vite que la veille ; je n’étais plus sous le coup de l’impatience qui donne la fièvre ; je savais qu’il fallait attendre.
Et tantôt me promenant, tantôt m’asseyant sur mon banc, j’attendais.
Un peu avant la nuit j’entendis une sonnerie de cornet à piston et je reconnus la façon de jouer de Mattia : le bon garçon, il voulait me dire qu’il pensait à moi et qu’il veillait. Cette sonnerie m’arrivait par-dessus le mur qui faisait face à ma fenêtre : évidemment Mattia était de l’autre côté de ce mur, dans la rue, et une courte distance nous séparait, quelques mètres à peine. Par malheur les yeux ne peuvent pas percer les pierres. Mais si le regard ne passe pas à travers les murs, le son passe par-dessus. Aux sons du cornet s’étaient joints des bruits de pas, des rumeurs vagues et je compris que Mattia et Bob donnaient là sans doute une représentation.
Pourquoi avaient-ils choisi cet endroit ? Était-ce parce qu’il leur était favorable pour la recette ! Ou bien voulaient-ils me donner un avertissement ?
Tout à coup j’entendis une voix claire, celle de Mattia crier en français : « Demain matin au petit jour ! » Puis aussitôt reprit de plus belle le tapage du cornet.
Il n’y avait pas besoin d’un grand effort d’intelligence pour comprendre que ce n’était pas à son public anglais que Mattia adressait ces mots : « Demain matin au petit jour, » c’était à moi ; mais par contre il n’était pas aussi facile de deviner ce qu’ils signifiaient, et de nouveau je me posai toute une série de questions auxquelles il m’était impossible de trouver des réponses raisonnables.
Un seul fait était clair et précis : le lendemain matin au petit jour je devais être éveillé et me tenir sur mes gardes ; jusque-là je n’avais qu’à prendre patience, si je le pouvais.
Aussitôt que la nuit fut tombée, je me couchai dans mon hamac et je tâchai de m’endormir ; j’entendis plusieurs heures sonner successivement aux horloges voisines, puis à la fin le sommeil me prit et m’emporta sur ses ailes.
Quand je m’éveillai la nuit était épaisse, les étoiles brillaient dans le sombre azur, et l’on n’entendait aucun bruit ; sans doute le jour était loin encore. Je revins m’asseoir sur mon banc, n’osant pas marcher de peur d’appeler l’attention si par hasard on faisait une ronde et j’attendis. Bientôt une horloge sonna trois coups : je m’étais éveillé trop tôt ; cependant je n’osai pas me rendormir, et d’ailleurs je crois bien que quand même je l’aurais voulu, je ne l’aurais pas pu : j’étais trop fiévreux, trop angoissé.
Ma seule occupation était de compter les sonneries des horloges ; mais combien me paraissaient longues les quinze minutes qui s’écoulaient entre l’heure et le quart, entre le quart et la demie ; si longues que parfois je m’imaginais que j’avais laissé l’horloge sonner sans l’entendre ou qu’elle était détraquée.
Appuyé contre la muraille, je tenais mes yeux fixés sur la fenêtre ; il me sembla que l’étoile que je suivais perdait de son éclat et que le ciel blanchissait faiblement.
C’était l’approche du jour ; au loin des coqs chantèrent.
Je me levai, et, marchant sur la pointe des pieds, j’allai ouvrir ma fenêtre ; ce fut un travail délicat de l’empêcher de craquer, mais enfin, en m’y prenant avec douceur, et surtout avec lenteur, j’en vins à bout.
Quel bonheur que ce cachot eût été aménagé dans une ancienne salle basse dont on avait fait une prison, et qu’on se fût confié aux barreaux de fer pour garder les prisonniers, car si ma fenêtre ne s’était pas ouverte, je n’aurais pas pu répondre à l’appel de Mattia. Mais ouvrir la fenêtre n’était pas tout : les barreaux de fer restaient, les épaisses murailles aussi, et aussi la porte bardée de tôle. C’était donc folie d’espérer la liberté, et cependant je l’espérais.
Les étoiles pâlirent de plus en plus, et la fraîcheur du matin me fit grelotter ; cependant je ne quittai pas ma fenêtre, restant là, debout, écoutant, regardant, sans savoir ce que je devais regarder et écouter.
Un grand voile blanc monta au ciel, et sur la terre les objets commencèrent à se dessiner avec des formes à peu près distinctes ; c’était bien le petit jour dont Mattia m’avait parlé. J’écoutai en retenant ma respiration, je n’entendis que les battements de mon cœur dans ma poitrine.
Enfin, il me sembla percevoir un grattement contre le mur, mais comme avant je n’avais entendu aucun bruit de pas, je crus m’être trompé ; cependant j’écoutai : le grattement continua : puis tout à coup j’aperçus une tête s’élever au-dessus du mur ; tout de suite je vis que ce n’était pas celle de Mattia, et, bien qu’il fît encore sombre je reconnus Bob.
Il me vit collé contre mes barreaux.
— Chut ! dit-il faiblement.
Et de la main il me fit un signe qui me sembla signifier que je devais m’éloigner de la fenêtre. Sans comprendre, j’obéis. Alors, son autre main me parut armée d’un long tube brillant comme s’il était en verre. Il le porta à sa bouche. Je compris que c’était une sarbacane. J’entendis un soufflement, et en même temps je vis une petite boule blanche passer dans l’air pour venir tomber à mes pieds. Instantanément la tête de Bob disparut derrière le mur, et je n’entendis plus rien.
Je me précipitai sur la boule ; elle était en papier fin roulé et entassé autour d’un gros grain de plomb : il me sembla que des caractères étaient tracés sur ce papier, mais il ne faisait pas encore assez clair pour que je pusse les lire ; je devais donc attendre le jour.
Je refermai ma fenêtre avec précaution et vivement je me couchai dans mon hamac, tenant la boule de papier dans ma main.
Lentement, bien lentement pour mon impatience, l’aube jaunit, et à la fin une lueur rose glissa sur mes murailles ; je déroulai mon papier et je lus :
« Tu seras transféré demain soir dans la prison du comté : tu voyageras en chemin de fer dans un compartiment de seconde classe avec un policeman ; place-toi auprès de la portière par laquelle tu monteras ; quand vous aurez roulé pendant quarante-cinq minutes (compte-les bien) votre train ralentira sa marche pour une jonction ; ouvre alors ta portière et jette-toi à bas bravement : élance-toi, étends tes mains en avant et arrange-toi pour tomber sur les pieds ; aussitôt à terre, monte le talus de gauche, nous serons là avec une voiture et un bon cheval pour t’emmener ; ne crains rien ; deux jours après nous serons en France ; bon courage et bon espoir ; surtout élance-toi au loin en sautant et tombe sur tes pieds. »
Sauvé ! Je ne comparaîtrais pas aux assises ; je ne verrais pas ce qui s’y passerait !
Ah ! le brave Mattia, le bon Bob ! car c’était lui, j’en étais certain, qui aidait généreusement Mattia : « Nous serons là avec un bon cheval ; » ce n’était pas Mattia qui tout seul avait pu combiner cet arrangement.
Et je relus le billet : « Quarante-cinq minutes après le départ ; le talus de gauche ; tomber sur les pieds. » Certes oui, je m’élancerais bravement, dussé-je me tuer. Mieux valait mourir que de se faire condamner comme voleur.
Ah ! comme tout cela était bien inventé :
« Deux jours après nous serons en France. »
Cependant, dans mon transport de joie, j’eus une pensée de tristesse : et Capi ? Mais bien vite j’écartai cette idée. Il n’était pas possible que Mattia voulût abandonner Capi ; s’il avait trouvé un moyen pour me faire évader, il en avait trouvé un aussi certainement pour Capi.
Je relus mon billet deux ou trois fois encore, puis, l’ayant mâché, je l’avalai ; maintenant je n’avais plus qu’à dormir tranquillement ; et je m’y appliquai si bien, que je ne m’éveillai que quand le geôlier m’apporta à manger.
Le temps s’écoula assez vite et le lendemain, dans l’après-midi, un policeman que je ne connaissais pas entra dans mon cachot et me dit de le suivre : je vis avec satisfaction que c’était un homme d’environ cinquante ans qui ne paraissait pas très-souple.
Les choses purent s’arranger selon les prescriptions de Mattia, et, quand le train se mit en marche, j’étais placé près de la portière par laquelle j’étais monté ; j’allais à reculons ; le policeman était en face de moi ; nous étions seuls dans notre compartiment.
— Vous parlez anglais ? me dit-il.
— Un peu.
— Vous le comprenez ?
— À peu près, quand on ne parle pas trop vite.
— Eh bien, mon garçon, je veux vous donner un bon conseil : ne faites pas le malin avec la justice, avouez : vous vous concilierez la bienveillance de tout le monde ; rien n’est plus désagréable que d’avoir affaire à des gens qui nient contre l’évidence ; tandis qu’avec ceux qui avouent on a toutes sortes de complaisances, de bontés ; ainsi moi, vous me diriez comment les choses se sont passées, je vous donnerais bien une couronne : vous verriez comme l’argent adoucirait votre situation en prison.
Je fus sur le point de répondre que je n’avais rien à avouer, mais je compris que le mieux pour moi était de me concilier la bienveillance de ce policeman, selon son expression, et je ne répondis rien.
— Vous réfléchirez, me dit-il, en continuant, et quand en prison vous aurez reconnu la bonté de mon conseil, vous me ferez appeler, parce que, voyez-vous, il ne faut pas avouer au premier venu, il faut choisir celui qui s’intéressera à vous, et moi, vous voyez bien que je suis tout disposé à vous servir.
Je fis un signe affirmatif.
— Faites demander Dolphin ; vous retiendrez bien mon nom, n’est-ce pas ?
— Oui, monsieur.
J’étais appuyé contre la portière dont la vitre était ouverte ; je lui demandai la permission de regarder le pays que nous traversions, et comme il voulait « se concilier ma bienveillance », il me répondit que je pouvais regarder tant que je voudrais. Qu’avait-il à craindre, le train marchait à grande vitesse.
Bientôt l’air qui le frappait en face l’ayant glacé, il s’éloigna de la portière pour se placer au milieu du wagon.
Pour moi, je n’étais pas sensible au froid ; glissant doucement ma main gauche en dehors je tournai la poignée et de la droite je retins la portière.
Le temps s’écoula : la machine siffla et ralentit sa marche ; le moment était venu ; vivement je poussai la portière et sautai aussi loin que je pus ; je fus jeté dans le fossé ; heureusement mes mains que je tenais en avant portèrent contre le talus gazonné ; cependant le choc fut si violent que je roulai à terre, évanoui.
Quand je revins à moi je crus que j’étais encore en chemin de fer, car je me sentis emporté par un mouvement rapide, et j’entendis un roulement : j’étais couché sur un lit de paille.
Chose étrange ! ma figure était mouillée et sur mes joues, sur mon front, passait une caresse douce et chaude.
J’ouvris les yeux, un chien, un vilain chien jaune était penché sur moi et me léchait.
Mes yeux rencontrèrent ceux de Mattia, qui se tenait agenouillé à côté de moi.
— Tu es sauvé, me dit-il en écartant le chien et en m’embrassant.
— Où sommes-nous ?
— En voiture ; c’est Bob qui nous conduit.
— Comment cela va-t-il ? me demanda Bob en se retournant.
— Je ne sais pas ; bien, il me semble.
— Remuez les bras, remuez les jambes, cria Bob.
J’étais allongé sur de la paille, je fis ce qu’il me disait.
— Bon, dit Mattia, rien de cassé.
— Mais que s’est-il passé ?
— Tu as sauté du train, comme je te l’avais recommandé ; mais la secousse t’a étourdi et tu es tombé dans le fossé ; alors ne te voyant pas venir, Bob a dégringolé le talus tandis que je tenais le cheval, et il t’a rapporté dans ses bras. Nous t’avons cru mort. Quelle peur ! quelle douleur ! mais te voilà sauvé.
— Et le policeman ?
— Il continue sa route avec le train, qui ne s’est pas arrêté.
Je savais l’essentiel, je regardai autour de moi et j’aperçus le chien jaune qui me regardait tendrement avec des yeux qui ressemblaient à ceux de Capi ; mais ce n’était pas Capi, puisque Capi était blanc.
— Et Capi ! dis-je, où est-il ?
Avant que Mattia m’eût répondu, le chien jaune avait sauté sur moi et il me léchait en pleurant.
— Mais le voilà, dit Mattia, nous l’avons fait teindre.
Je rendis au bon Capi ses caresses, et je l’embrassai.
— Pourquoi l’as-tu teint ? dis-je.
— C’est une histoire, je vais te la conter.
Mais Bob ne permit pas ce récit.
— Conduis le cheval, dit-il à Mattia, et tiens-le bien ; pendant ce temps-là je vais arranger la voiture pour qu’on ne la reconnaisse pas aux barrières.
Cette voiture était une carriole recouverte d’une bâche en toile posée sur des cerceaux ; il allongea les cercles dans la voiture et ayant plié la bâche en quatre, il me dit de m’en couvrir ; puis, il renvoya Mattia en lui recommandant de se cacher sous la toile ; par ce moyen la voiture changeait entièrement d’aspect, elle n’avait plus de bâche et elle ne contenait qu’une personne au lieu de trois : si on courait après nous, le signalement, que les gens qui voyaient passer cette carriole donneraient, dérouterait les recherches.
— Où allons-nous ? demandai-je à Mattia lorsqu’il se fut allongé à côté de moi.
— À Littlehampton : c’est un petit port sur la mer, où Bob a un frère qui commande un bateau faisant les voyages de France pour aller chercher du beurre et des œufs en Normandie, à Isigny ; si nous nous sauvons, — et nous nous sauverons, — ce sera à Bob que nous le devrons : il a tout fait ; qu’est-ce que j’aurais pu faire pour toi, moi, pauvre misérable ! C’est Bob qui a eu l’idée de te faire sauter du train, de te souffler mon billet, et c’est lui qui a décidé ses camarades à nous prêter ce cheval ; enfin c’est lui qui va nous procurer un bateau pour passer en France, car tu dois bien croire que si tu voulais t’embarquer sur un vapeur, tu serais arrêté : tu vois qu’il fait bon avoir des amis.
— Et Capi, qui a eu l’idée de l’emmener ?
— Moi, mais c’est Bob qui a eu l’idée de le teindre en jaune pour qu’on ne le reconnaisse pas, quand nous l’avons volé à l’agent Jerry, l’intelligent Jerry comme disait le juge, qui cette fois n’a pas été trop intelligent car il s’est laissé souffler Capi sans s’en apercevoir ; il est vrai que Capi m’ayant senti, a presque tout fait, et puis Bob connaît tous les tours des voleurs de chiens.
— Et ton pied ?
— Guéri, ou à peu près, je n’ai pas eu le temps d’y penser.
Les routes d’Angleterre ne sont pas libres comme celles de France ; de place en place se trouvent des barrières où l’on doit payer une certaine somme pour passer ; quand nous arrivions à l’une de ces barrières, Bob nous disait de nous taire et de ne pas bouger, et les gardiens ne voyaient qu’une carriole conduite par un seul homme : Bob leur disait des plaisanteries et passait.
Avec son talent de clown pour se grimer, il s’était fait une tête de fermier, et ceux mêmes qui le connaissaient le mieux, lui aurait parlé sans savoir qui il était.
Nous marchions rapidement, car le cheval était bon et Bob était un habile cocher : cependant il fallait nous arrêter pour laisser souffler un peu le cheval, et pour lui donner à manger ; mais pour cela nous n’entrâmes pas dans une auberge ; Bob s’arrêta en plein bois, débrida son cheval et lui passa au cou une musette pleine d’avoine qu’il prit dans la voiture ; la nuit était noire ; il n’y avait pas grand danger d’être surpris.
Alors je pus m’entretenir avec Bob, et le remercier par quelques paroles de reconnaissance émue ; mais il ne me laissa pas lui dire tout ce que j’avais dans le cœur :
— Vous m’avez obligé, répondit-il en me donnant une poignée de main, aujourd’hui je vous oblige, chacun son tour ; et puis vous êtes le frère de Mattia ; et pour un bon garçon comme Mattia, on fait bien des choses.
Je lui demandai si nous étions éloignés de Littlehampton ; il me répondit que nous en avions encore pour plus de deux heures, et qu’il fallait nous hâter, parce que le bateau de son frère partait tous les samedis pour Isigny, et qu’il croyait que la marée avait lieu de bonne heure ; or, nous étions le vendredi.
Nous reprîmes place sur la paille, sous la bâche, et le cheval reposé partit grand train.
— As-tu peur ? me demanda Mattia.
— Oui et non ; j’ai très-peur d’être repris ; mais il me semble qu’on ne me reprendra pas : se sauver, n’est-ce pas avouer qu’on est coupable ? Voilà surtout ce qui me tourmente : que dire pour ma défense ?
— Nous avons bien pensé à cela, mais Bob a cru qu’il fallait tout faire pour que tu ne paraisses pas sur le banc des assises ; cela est si triste d’avoir passé là, même quand on est acquitté ; moi je n’ai osé rien dire, parce qu’avec mon idée fixe de t’emmener en France, j’ai peur que cette idée ne me conseille mal.
— Tu as bien fait ; et quoi qu’il arrive je n’aurai que de la reconnaissance pour vous.
— Il n’arrivera rien, va, sois tranquille. À l’arrêt du train ton policeman aura fait son rapport ; mais avant qu’on organise les recherches il s’est écoulé du temps, et nous, nous avons galopé ; et puis ils ne peuvent pas savoir que c’est à Littlehampton que nous allons nous embarquer.
Il était certain que si on n’était pas sur notre piste, nous avions la chance de nous embarquer sans être inquiétés ; mais je n’étais pas comme Mattia, assuré qu’après l’arrêt du train le policeman avait perdu du temps pour nous poursuivre ; là était le danger, et il pouvait être grand.
Cependant notre cheval, vigoureusement conduit par Bob, continuait de détaler grand train sur la route déserte ; de temps en temps seulement nous croisions quelques voitures, aucune ne nous dépassait : les villages que nous traversions étaient silencieux et rares étaient les fenêtres où se montrait une lumière attardée ; seuls quelques chiens faisaient attention à notre course rapide et nous poursuivaient de leurs aboiements ; quand après une montée un peu rapide Bob arrêtait son cheval pour le laisser souffler, nous descendions de voiture et nous nous collions la tête sur la terre pour écouter, mais Mattia lui-même, qui avait l’oreille plus fine que nous, n’entendait aucun bruit suspect ; nous voyagions au milieu de l’ombre et du silence de la nuit.
Ce n’était plus pour nous cacher que nous nous tenions sous la bâche, c’était pour nous défendre du froid, car depuis assez longtemps soufflait une bise froide ; quand nous passions la langue sur nos lèvres nous trouvions un goût de sel ; nous approchions de la mer. Bientôt nous aperçûmes une lueur qui à intervalles réguliers disparaissait, pour reparaître avec éclat, c’était un phare ; nous arrivions.
Bob arrêta son cheval et le mettant au pas il le conduisit doucement dans un chemin de traverse ; puis descendant de voiture il nous dit de rester là et de tenir le cheval ; pour lui, il allait voir si son frère n’était pas parti et si nous pouvions sans danger nous embarquer à bord du navire de celui-ci.
J’avoue que le temps pendant lequel Bob resta absent me parut long, très-long : nous ne parlions pas, et nous entendions la mer briser sur la grève à une assez courte distance avec un bruit monotone qui redoublait notre émotion ; Mattia tremblait comme je tremblais moi-même.
— C’est le froid, me dit-il à voix basse.
Était-ce bien vrai ? Le certain, c’est que quand une vache ou un mouton qui se trouvaient dans les prairies que traversait notre chemin choquaient une pierre ou heurtaient une clôture, nous étions plus sensibles au froid ou au tremblement.
Enfin, nous entendîmes un bruit de pas dans le chemin qu’avait suivi Bob. Sans doute, c’était lui qui revenait ; c’était mon sort qui allait se décider.
Bob n’était pas seul. Quand il s’approcha de nous, nous vîmes que quelqu’un l’accompagnait : c’était un homme vêtu d’une vareuse en toile cirée et coiffé d’un bonnet de laine.
— Voici mon frère, dit Bob ; il veut bien vous prendre à son bord ; il va vous conduire, et nous allons nous séparer, car il est inutile qu’on sache que je suis venu ici.
Je voulus remercier Bob, mais il me coupa la parole en me donnant une poignée de main :
— Ne parlons pas de ça, dit-il, il faut s’entr’aider, chacun son tour ; nous nous reverrons un jour ; je suis heureux d’avoir obligé Mattia.
Nous suivîmes le frère de Bob, et bientôt nous entrâmes dans les rues silencieuses de la ville, puis après quelques détours nous nous trouvâmes sur un quai, et le vent de la mer nous frappa au visage.
Sans rien dire, le frère de Bob nous désigna de la main un navire gréé en sloop ; nous comprîmes que c’était le sien ; en quelques minutes nous fûmes à bord ; alors il nous fit descendre dans une petite cabine.
— Je ne partirai que dans deux heures, dit-il, restez là et ne faites pas de bruit.
Quand il eut refermé à clef la porte de cette cabine, ce fut sans bruit que Mattia se jeta dans mes bras et m’embrassa ; il ne tremblait plus.
XXI
LE CYGNE
Après le départ du frère de Bob, le navire resta silencieux pendant quelque temps, et nous n’entendîmes que le bruit du vent dans la mâture et le clapotement de l’eau contre la carène ; mais peu à peu il s’anima ; des pas retentirent sur le pont ; on laissa tomber des cordages ; des poulies grincèrent, il y eut des enroulements et des déroulements de chaîne ; on vira au cabestan ; une voile fut hissée ; le gouvernail gémit et tout à coup le bateau s’étant incliné sur le côté gauche, un mouvement de tangage se produisit ; — nous étions en route, j’étais sauvé.
Lent et doux tout d’abord, ce mouvement de tangage ne tarda pas à devenir rapide et dur, le navire s’abaissait en roulant, et brusquement de violents coups de mer venaient frapper contre son étrave ou contre son bordage de droite.
— Pauvre Mattia ! dis-je à mon camarade en lui prenant la main.
— Cela ne fait rien, dit-il, tu es sauvé ; au reste je me doutais bien que cela serait ainsi ; quand nous étions en voiture je regardais les arbres dont le vent secouait la cime, et je me disais que sur la mer nous allions danser : ça danse.
À ce moment la porte de notre cabine fut ouverte :
— Si vous voulez monter sur le pont, nous dit le frère de Bob, il n’y a plus de danger.
— Où est-on moins malade ? demanda Mattia.
— Couché.
— Je vous remercie, je reste couché.
Et il s’allongea sur les planches.
— Le mousse va vous apporter ce qui vous sera nécessaire, dit le capitaine.
— Merci ; s’il peut n’être pas trop longtemps à venir, cela sera à propos, répondit Mattia.
— Déjà ?
— Il y a longtemps que c’est commencé.
Je voulus rester près de lui, mais il m’envoya sur le pont en me répétant :
— Cela ne fait rien, tu es sauvé ; mais c’est égal, je ne me serais jamais imaginé que cela me ferait plaisir d’avoir le mal de mer.
Arrivé sur le pont, je ne pus me tenir debout qu’en me cramponnant solidement à un cordage : aussi loin que la vue pouvait s’étendre dans les profondeurs de la nuit, on ne voyait qu’une nappe blanche d’écume, sur laquelle notre petit navire courait, incliné comme s’il allait chavirer, mais il ne chavirait point, au contraire il s’élevait légèrement, bondissant sur les vagues, porté, poussé par le vent d’ouest.
Je me retournai vers la terre ; déjà les lumières du port n’étaient plus que des points dans l’obscurité vaporeuse, et les regardant ainsi s’affaiblir et disparaître les unes après les autres, ce fut avec un doux sentiment de délivrance que je dis adieu à l’Angleterre.
— Si le vent continue ainsi, me dit le capitaine, nous n’arriverons pas tard, ce soir, à Isigny ; c’est un bon voilier que l’Éclipse.
Toute une journée de mer, et même plus d’une journée, pauvre Mattia ! et cela lui faisait plaisir d’avoir le mal de mer.
Elle s’écoula cependant, et je passai mon temps à voyager du pont à la cabine, et de la cabine au pont ; à un certain moment, comme je causais avec le capitaine, il étendit sa main dans la direction du sud-ouest, et j’aperçus une haute colonne blanche qui se dessinait sur un fond bleuâtre.
— Barfleur, me dit-il.
Je dégringolai rapidement pour porter cette bonne nouvelle à Mattia : nous étions en vue de France ; mais la distance est longue encore de Barfleur à Isigny, car il faut longer toute la presqu’île du Cotentin avant d’entrer dans la Vire et dans l’Aure.
Comme il était tard lorsque l’Éclipse accosta le quai d’Isigny, le capitaine voulut bien nous permettre de coucher à bord, et ce fut seulement le lendemain matin que nous nous séparâmes de lui, après l’avoir remercié comme il convenait.
— Quand vous voudrez revenir en Angleterre, nous dit-il, en nous donnant une rude poignée de main, l’Éclipse part d’ici tous les mardis ; à votre disposition.
C’était là une gracieuse proposition, mais que nous n’avions aucune envie d’accepter, ayant chacun nos raisons, Mattia et moi, pour ne pas traverser la mer de sitôt.
Nous débarquions en France, n’ayant que nos vêtements et nos instruments, — Mattia ayant eu soin de prendre ma harpe, que j’avais laissée dans la tente de Bob, la nuit où j’avais été à l’auberge du Gros-Chêne ; — quant à nos sacs, ils étaient restés avec leur contenu dans les voitures de la famille Driscoll ; cela nous mettait dans un certain embarras, car nous ne pouvions pas reprendre notre vie errante sans chemises et sans bas, surtout sans carte. Par bonheur, Mattia avait douze francs d’économies et en plus notre part de recette provenant de notre association avec Bob et ses camarades, laquelle s’élevait à vingt-deux shillings, ou vingt-sept francs cinquante ; cela nous constituait une fortune de près de quarante francs, ce qui était considérable pour nous. Mattia avait voulu donner cet argent à Bob pour subvenir aux frais de mon évasion, mais Bob avait répondu qu’on ne se fait pas payer les services qu’on rend par amitié, et il n’avait voulu rien recevoir.
Notre première occupation, en sortant de l’Éclipse, fut donc de chercher un vieux sac de soldat et d’acheter ensuite deux chemises, deux paires de bas, un morceau de savon, un peigne, du fil, des boutons, des aiguilles, et enfin ce qui nous était plus indispensable encore que ces objets, si utiles cependant, — une carte de France.
En effet, où aller maintenant que nous étions en France ? Quelle route suivre ? Comment nous diriger ?
Ce fut la question que nous agitâmes en sortant d’Isigny par la route de Bayeux.
— Pour moi, dit Mattia, je n’ai pas de préférence, et je suis prêt à aller à droite ou à gauche ; je ne demande qu’une chose.
— Laquelle ?
— Suivre le cours d’un fleuve, d’une rivière ou d’un canal, parce que j’ai une idée.
Comme je ne demandais pas à Mattia de me dire son idée, il continua :
— Je vois qu’il faut que je te l’explique, mon idée : quand Arthur était malade, madame Milligan le promenait en bateau, et c’est de cette façon que tu l’as rencontrée sur le Cygne.
— Il n’est plus malade.
— C’est-à-dire qu’il est mieux ; il a été très-malade, au contraire, et il n’a été sauvé que par les soins de sa mère. Alors mon idée est que pour le guérir tout à fait, madame Milligan le promène encore en bateau sur les fleuves, les rivières, les canaux qui peuvent porter le Cygne ; si bien qu’en suivant le cours de ces rivières et de ces fleuves, nous avons chance de rencontrer le Cygne.
— Qui dit que le Cygne est en France ?
— Rien : cependant, comme le Cygne ne peut pas aller sur la mer, il est à croire qu’il n’a pas quitté la France, nous avons des chances pour le trouver.
Quand nous n’en aurions qu’une, est-ce que tu n’es pas d’avis qu’il faut la risquer ? Moi je veux que nous retrouvions madame Milligan, et mon avis est que nous ne devons rien négliger pour cela.
— Mais Lise, Alexis, Benjamin, Étiennette !
— Nous les verrons en cherchant madame Milligan ; il faut donc que nous gagnions le cours d’un fleuve ou d’un canal : cherchons sur ta carte quel est le fleuve le plus près.
La carte fut étalée sur l’herbe du chemin, et nous cherchâmes le fleuve le plus voisin ; nous trouvâmes que c’était la Seine.
— Eh bien ! gagnons la Seine, dit Mattia.
— La Seine passe à Paris.
— Qu’est-ce que cela fait ?
— Cela fait beaucoup ; j’ai entendu dire à Vitalis que quand on voulait trouver quelqu’un, c’était à Paris qu’il fallait le chercher ; si la police anglaise me cherchait pour le vol de l’église Saint-Georges, je ne veux pas qu’elle me trouve : ce ne serait pas la peine d’avoir quitté l’Angleterre.
— La police anglaise peut donc te poursuivre en France ?
— Je ne sais pas ; mais si cela est, il ne faut pas aller à Paris.
— Ne peut-on pas suivre la Seine jusqu’aux environs de Paris, la quitter et la reprendre plus loin ; je ne tiens pas à voir Garofoli.
— Sans doute.
— Eh bien, faisons ainsi : nous interrogerons les mariniers, les haleurs, le long de la rivière, et comme le Cygne avec sa verandah ne ressemble pas aux autres bateaux, on l’aura remarqué s’il a passé sur la Seine ; si nous ne le trouvons pas sur la Seine, nous le chercherons sur la Loire, sur la Garonne, sur toutes les rivières de France et nous finirons bien par le trouver.
Je n’avais pas d’objections à présenter contre l’idée de Mattia ; il fut donc décidé que nous gagnerions le cours de la Seine pour le côtoyer en le remontant.
Après avoir pensé à nous, il était temps de nous occuper de Capi ; teint en jaune, Capi n’était pas pour moi Capi ; nous achetâmes du savon mou, et à la première rivière que nous trouvâmes, nous le frottâmes vigoureusement, nous relayant quand nous étions fatigués.
Mais la teinture de notre ami Bob était d’excellente qualité ; il nous fallut de nombreuses baignades, de longs savonnages ; il nous fallut surtout des semaines et des mois pour que Capi reprît sa couleur native. Heureusement la Normandie est le pays de l’eau, et chaque jour nous pûmes le laver.
Par Bayeux, Caen, Pont-l’Évêque et Pont-Audemer, nous gagnâmes la Seine à La Bouille.
Quand du haut de collines boisées et au détour d’un chemin ombreux, dont nous débouchâmes après une journée de marche, Mattia aperçut tout à coup devant lui la Seine, décrivant une large courbe au centre de laquelle nous nous trouvions, et promenant doucement ses eaux calmes et puissantes, couvertes de navires aux blanches voiles et de bateaux à vapeur, dont la fumée montait jusqu’à nous, il déclara que cette vue le réconciliait avec l’eau, et qu’il comprenait qu’on pouvait prendre plaisir à glisser sur cette tranquille rivière, au milieu de ces fraîches prairies, de ces champs bien cultivés et de ces bois sombres qui l’encadraient de verdure.
— Sois certain que c’est sur la Seine que madame Milligan a promené son fils malade, me dit-il.
— C’est ce que nous allons bientôt savoir, en faisant causer les gens du village qui est au-dessous.
Mais j’ignorais alors qu’il n’est pas facile d’interroger les Normands, qui répondent rarement d’une façon précise et qui, au contraire, interrogent eux-mêmes ceux qui les questionnent.
— C’est-y un batiau du Havre ou un batiau de Rouen que vous demandez ? — C’est-y un bachot ? — C’est-y une barquette, un chaland, une péniche ?
Quand nous eûmes bien répondu à toutes les questions qu’on nous posa, il fut à peu près certain que le Cygne n’était jamais venu à La Bouille, ou que, s’il y avait passé, c’était la nuit, de sorte que personne ne l’avait vu.
De La Bouille nous allâmes à Rouen, où nos recherches recommencèrent, mais sans meilleur résultat ; à Elbeuf, on ne put pas non plus nous parler du Cygne ; à Poses, où il y a des écluses et où par conséquent on remarque les bateaux qui passent, il en fut de même encore.
Sans nous décourager, nous avancions, questionnant toujours, mais sans grande espérance, car le Cygne n’avait pas pu partir d’un point intermédiaire ; que madame Milligan et Arthur se fussent embarqués à Quillebeuf ou à Caudebec, cela se comprenait, à Rouen mieux encore ; mais puisque nous ne trouvions pas trace de leur passage, nous devions aller jusqu’à Paris, ou plutôt au delà de Paris.
Comme nous ne marchions pas seulement pour avancer, mais qu’il nous fallait encore gagner chaque jour notre pain, il nous fallut cinq semaines pour aller d’Isigny à Charenton.
Là une question se présentait : devions-nous suivre la Seine ou bien devions-nous suivre la Marne ? C’était ce que je m’étais demandé bien souvent en étudiant ma carte, mais sans trouver de meilleures raisons pour une route plutôt que pour une autre.
Heureusement en arrivant à Charenton, nous n’eûmes pas à balancer, car à nos demandes on répondit pour la première fois qu’on avait vu un bateau qui ressemblait au Cygne ; c’était un bateau de plaisance, il avait une verandah.
Mattia fut si joyeux qu’il se mit à danser sur le quai : puis tout à coup, cessant de danser, il prit son violon et joua frénétiquement une marche triomphale.
Pendant ce temps, je continuais d’interroger le marinier qui avait bien voulu nous répondre : le doute n’était pas possible, c’était bien le Cygne ; il y avait environ deux mois qu’il avait passé à Charenton, remontant la Seine.
Deux mois ! Cela lui donnait une terrible avance sur nous. Mais qu’importait ! En marchant nous finirions toujours par le rejoindre, bien que nous n’eussions que nos jambes, tandis que lui il avait celles de deux bons chevaux.
La question de temps n’était rien : le fait capital, extraordinaire, merveilleux, c’était que le Cygne était retrouvé.
— Qui a eu raison ? criait Mattia.
Si j’avais osé j’aurais avoué que mon espérance était vive aussi, très-vive, mais je n’osais pas préciser, même pour moi seul, toutes les idées, toutes les folies qui faisaient s’envoler mon imagination.
Nous n’avons plus besoin de nous arrêter maintenant pour interroger les gens, le Cygne est devant nous ; il n’y a qu’à suivre la Seine.
Mais à Moret le Loing se jette dans la Seine, et il faut recommencer nos questions.
Le Cygne a remonté la Seine.
À Montereau il faut les reprendre encore.
Cette fois le Cygne a abandonné la Seine pour l’Yonne ; il y a un peu plus de deux mois qu’il a quitté Montereau ; il a à son bord une dame anglaise et un jeune garçon étendu sur un lit.
Nous nous rapprochons de Lise en même temps que nous suivons le Cygne, et le cœur me bat fort, quand en étudiant ma carte je me demande si après Joigny madame Milligan aura choisi le canal de Bourgogne ou celui du Nivernais.
Nous arrivons au confluent de l’Yonne et de l’Armançon, le Cygne a continué de remonter l’Yonne ; nous allons donc passer par Dreuzy et voir Lise ; elle-même nous parlera de madame Milligan et d’Arthur.
Depuis que nous courrions derrière le Cygne nous ne donnions plus grand temps à nos représentations, et Capi qui était un artiste consciencieux ne comprenait rien à notre empressement : pourquoi ne lui permettions-nous pas de rester gravement assis la sébile entre les dents devant « l’honorable société » qui tardait à mettre la main à la poche ? il faut savoir attendre.
Mais nous n’attendions plus ; aussi les recettes baissaient-elles, en même temps que ce qui nous était resté sur nos quarante francs diminuait chaque jour : loin de mettre de l’argent de côté, nous prenions sur notre capital.
— Dépêchons-nous, disait Mattia, rejoignons le Cygne.
Et je disais comme lui : dépêchons-nous.
Jamais le soir nous ne nous plaignions de la fatigue, si longue qu’eût été l’étape ; et tout au contraire nous étions d’accord pour partir le lendemain de bonne heure.
— Éveille-moi, disait Mattia, qui aimait à dormir.
Et quand je l’avais éveillé, jamais il n’était long à sauter sur ses jambes.
Pour faire des économies nous avions réduit nos dépenses, et comme il faisait chaud, Mattia avait déclaré qu’il ne voulait plus manger de viande « parce qu’en été la viande est malsaine ; » nous nous contentions d’un morceau de pain avec un œuf dur que nous nous partagions, ou bien d’un peu de beurre ; et quoique nous fussions dans le pays du vin nous ne buvions que de l’eau.
Que nous importait !
Cependant Mattia avait quelquefois des idées de gourmandise.
— Je voudrais bien que madame Milligan eût encore la cuisinière qui te faisait de si bonnes tartes aux confitures, disait-il, cela doit être joliment bon, des tartes à l’abricot.
— Tu n’en as jamais mangé ?
— J’ai mangé des chaussons aux pommes, mais je n’ai jamais mangé des tartes à l’abricot, seulement j’en ai vu. Qu’est-ce que c’est que ces petites choses blanches qui sont collées sur la confiture jaune ?
— Des amandes.
— Oh !
Et Mattia ouvrait la bouche comme pour avaler une tarte entière.
Comme l’Yonne fait beaucoup de détours entre Joigny et Auxerre, nous regagnâmes, nous qui suivions la grande route, un peu de temps sur le Cygne ; mais, à partir d’Auxerre, nous en reperdîmes, car le Cygne ayant pris le canal du Nivernais avait couru vite sur ses eaux tranquilles.
À chaque écluse nous avions de ses nouvelles, car sur ce canal où la navigation n’est pas très-active, tout le monde avait remarqué ce bateau qui ressemblait si peu à ceux qu’on voyait ordinairement.
Non-seulement on nous parlait du Cygne, mais on nous parlait aussi de madame Milligan « une dame anglaise très-bonne » et d’Arthur « un jeune garçon qui se tenait presque toujours couché dans un lit placé sur le pont, à l’abri d’une verandah garnie de verdure et de fleurs, mais qui se levait aussi quelquefois. »
Arthur était donc mieux.
Nous approchions de Dreuzy ; encore deux jours, encore un, encore quelques heures seulement.
Enfin nous apercevons les bois dans lesquels nous avons joué avec Lise à l’automne précédent, et nous apercevons aussi l’écluse avec la maisonnette de dame Catherine.
Sans nous rien dire, mais d’un commun accord, nous avons forcé le pas, Mattia et moi, nous ne marchons plus, nous courons ; Capi, qui se retrouve, a pris les devants au galop.
Il va dire à Lise que nous arrivons : elle va venir au-devant de nous.
Cependant ce n’est pas Lise que nous voyons sortir de la maison, c’est Capi qui se sauve comme si on l’avait chassé.
Nous nous arrêtons tous les deux instantanément, et nous nous demandons ce que cela peut signifier ; que s’est-il passé ? Mais cette question nous ne la formulons ni l’un ni l’autre, et nous reprenons notre marche.
Capi est revenu jusqu’à nous et il s’avance, penaud, sur nos talons.
Un homme est en train de manœuvrer une vanne de l’écluse, ce n’est pas l’oncle de Lise.
Nous allons jusqu’à la maison, une femme que nous ne connaissons pas va et vient dans la cuisine.
— Madame Suriot ? demandons-nous.
Elle nous regarde un moment avant de nous répondre, comme si nous lui posions une question absurde.
— Elle n’est plus ici, nous dit-elle à la fin.
— Et où est-elle ?
— En Égypte.
Nous nous regardons Mattia et moi interdits. En Égypte ! Nous ne savons pas au juste ce que c’est que l’Égypte, et où se trouve ce pays, mais vaguement nous pensons que c’est loin, très-loin, quelque part au delà des mers.
— Et Lise ? Vous connaissez Lise ?
— Pardi : Lise est partie en bateau avec une dame anglaise.
Lise sur le Cygne ! Rêvons-nous ?
La femme se charge de nous répondre que nous sommes dans la réalité.
— C’est vous Rémi ? me demande-t-elle.
— Oui.
— Eh bien, quand Suriot a été noyé, nous dit-elle.
— Noyé !
— Noyé dans l’écluse. Ah ! vous ne saviez pas que Suriot était tombé à l’eau et qu’étant passé sous une péniche, il était resté accroché à un clou : c’est le métier qui veut ça trop souvent. Pour lors, quand il a été noyé, Catherine s’est trouvée bien embarrassée quoiqu’elle fût une maîtresse femme. Mais que voulez-vous, quand l’argent manque, on ne peut pas le fabriquer du jour au lendemain ; et l’argent manquait. Il est vrai qu’on offrait à Catherine d’aller en Égypte pour élever les enfants d’une dame dont elle avait été la nourrice, mais ce qui la gênait c’était sa nièce, la petite Lise. Comme elle était à se demander ce qu’il fallait faire, voilà qu’un soir s’arrête à l’écluse une dame anglaise qui promenait son garçon malade. On cause. Et la dame anglaise qui cherchait un enfant pour jouer avec son fils qui s’ennuyait tout seul sur son bateau, demande qu’on lui donne Lise, en promettant de se charger d’elle, de la faire guérir, enfin de lui assurer un sort. C’était une brave dame, bien bonne, douce au pauvre monde. Catherine accepte, et tandis que Lise s’embarque sur le bateau de la dame anglaise, Catherine part pour s’en aller en Égypte. C’est mon mari qui remplace Suriot. Alors avant de partir, Lise qui ne peut pas parler quoique les médecins disent qu’elle parlera sans doute un jour, alors Lise veut que sa tante m’explique que je dois vous raconter tout cela si vous venez pour la voir. Et voilà.
J’étais tellement abasourdi, que je ne trouvai pas un mot, mais Mattia ne perdit pas la tête comme moi :
— Et où la dame anglaise allait-elle ? demanda-t-il.
— Dans le midi de la France ou bien en Suisse ; Lise devait me faire écrire pour que je vous donne son adresse, mais je n’ai pas reçu de lettre.
XXII
LES BEAUX LANGES ONT DIT VRAI
Comme je restais interdit, Mattia fit ce que je ne pensais pas à faire.
— Nous vous remercions bien, madame, dit-il.
Et me poussant doucement, il me mit hors la cuisine.
— En route, me dit-il, en avant ! Ce n’est plus seulement Arthur et madame Milligan que nous avons à rejoindre, c’est encore Lise. Comme cela se trouve bien ! Nous aurions perdu du temps à Dreuzy ; tandis que maintenant nous pouvons continuer notre chemin ; c’est ce qui s’appelle une chance. Nous en avons eu assez de mauvaises, maintenant nous en avons de bonnes ; le vent a changé. Qui sait tout ce qui va nous arriver d’heureux !
Et nous continuons notre course après le Cygne, sans perdre de temps, ne nous arrêtant juste que ce qu’il faut pour dormir et pour gagner quelques sous.
À Decize, où le canal du Nivernais débouche dans la Loire, nous demandons des nouvelles du Cygne : il a pris le canal latéral ; et c’est ce canal que nous suivons jusqu’à Digoin ; là nous prenons le canal du Centre jusqu’à Chalon.
Ma carte me dit que si par Charolles nous nous dirigions directement sur Mâcon, nous éviterions un long détour et bien des journées de marche ; mais c’est là une résolution hardie dont nous n’osons ni l’un ni l’autre nous charger après avoir discuté le pour et le contre, car le Cygne peut s’être arrêté en route et alors nous le dépassons ; il faudrait donc revenir sur nos pas, et pour avoir voulu gagner du temps, en perdre.
Nous descendons la Saône depuis Chalon jusqu’à Lyon.
C’est là qu’une difficulté vraiment sérieuse se présente : le Cygne a-t-il descendu le Rhône ou bien l’a-t-il remonté ? en d’autres termes madame Milligan a-t-elle été en Suisse ou dans le midi de la France ?
Au milieu du mouvement des bateaux qui vont et viennent sur le Rhône et sur la Saône, le Cygne peut avoir passé inaperçu : nous questionnons les mariniers, les bateliers et tous les gens qui vivent sur les quais, et à la fin nous obtenons la certitude que madame Milligan a gagné la Suisse ; nous suivons donc le cours du Rhône.
— De la Suisse on va en Italie, dit Mattia, en voilà encore une chance ; si courant après madame Milligan, nous arrivions à Lucca, comme Cristina serait contente.
Pauvre cher Mattia, il m’aide à chercher ceux que j’aime, et moi je ne fais rien pour qu’il embrasse sa petite sœur.
À partir de Lyon nous gagnons sur le Cygne, car le Rhône aux eaux rapides ne se remonte pas avec la même facilité que la Seine. À Culoz il n’a plus que six semaines d’avance sur nous ; cependant, en étudiant la carte, je doute que nous puissions le rejoindre avant la Suisse, car j’ignore que le Rhône n’est pas navigable jusqu’au lac de Genève, et nous nous imaginons que c’est sur le Cygne que madame Milligan veut visiter la Suisse, dont nous n’avons pas la carte.
Nous arrivons à Seyssel, qui est une ville divisée en deux par le fleuve au-dessus duquel est jeté un pont suspendu, et nous descendons au bord de la rivière ; quelle est ma surprise, quand de loin je crois reconnaître le Cygne.
Nous nous mettons à courir : c’est bien sa forme, c’est bien lui, et cependant il a l’air d’un bateau abandonné : il est solidement amarré derrière une sorte d’estacade qui le protège, et tout est fermé à bord ; il n’y a plus de fleurs sur la verandah.
Que s’est-il passé ? Qu’est-il arrivé à Arthur ?
Nous nous arrêtons, le cœur étouffé par l’angoisse.
Mais c’est une lâcheté, de rester ainsi immobiles ; il faut avancer, il faut savoir.
Un homme que nous interrogeons veut bien nous répondre ; c’est lui qui justement est chargé de garder le Cygne.
— La dame anglaise qui était sur le bateau avec ses deux enfants, un garçon paralysé et une petite fille muette, est en Suisse. Elle a abandonné son bateau parce qu’il ne pouvait pas remonter le Rhône plus loin. La dame et les deux enfants sont partis en calèche avec une femme de service ; les autres domestiques ont suivi avec les bagages ; elle reviendra à l’automne pour reprendre le Cygne, descendre le Rhône jusqu’à la mer, et passer l’hiver dans le Midi.
Nous respirons : aucune des craintes qui nous avaient assaillis n’était raisonnable ; nous aurions dû imaginer le bon, au lieu d’aller tout de suite au pire.
— Et où est cette dame présentement ? demanda Mattia.
— Elle est partie pour louer une maison de campagne au bord du lac de Genève, du côté de Vevey ; mais je ne sais pas au juste où ; elle doit passer là l’été.
En route pour Vevey ! À Genève nous achèterons une carte de la Suisse, et nous trouverons bien cette ville ou ce village. Maintenant le Cygne ne court plus devant nous ; et puisque madame Milligan doit passer l’été dans sa maison de campagne, nous sommes assurés de la trouver : il n’y a qu’à chercher.
Et quatre jours après avoir quitté Seyssel, nous cherchons, aux environs de Vevey, parmi les nombreuses villas, qui, à partir du lac aux eaux bleues, s’étagent gracieusement sur les pentes vertes et boisées de la montagne, laquelle est habitée par madame Milligan, avec Arthur et Lise : enfin, nous sommes arrivés ; il est temps, nous avons trois sous en poche, et nos souliers n’ont plus de semelle.
Mais Vevey n’est point un petit village comme nous l’avions tout d’abord imaginé, c’est une ville, et même plus qu’une ville ordinaire, puisqu’il s’y joint, jusqu’à Villeneuve, une suite de villages ou de faubourgs qui ne font qu’un avec elle : Blonay, Corsier, Tour-de-Peilz, Clarens, Chernex, Montreux, Veyteaux, Chillon. Quant à demander madame Milligan, ou tout simplement une dame anglaise accompagnée de son fils malade, et d’une jeune fille muette, nous reconnaissons bien vite que cela n’est pas pratique : Vevey et les bords du lac, sont habités par des Anglais et des Anglaises, comme le serait une ville de plaisance des environs de Londres.
Le mieux est donc de chercher et de visiter nous-mêmes toutes les maisons où peuvent loger les étrangers : en réalité cela n’est pas bien difficile, nous n’avons qu’à jouer notre répertoire dans toutes les rues.
En une journée nous avons parcouru tout Vevey et nous avons fait une belle recette ; autrefois, quand nous voulions amasser de l’argent pour notre vache ou la poupée de Lise, cela nous eût donné une heureuse soirée, mais maintenant ce n’est pas après l’argent que nous courons. Nulle part nous n’avons trouvé le moindre indice qui nous parlât de madame Milligan.
Le lendemain c’est aux environs de Vevey que nous continuons nos recherches, allant droit devant nous au hasard des chemins, jouant devant les fenêtres des maisons qui ont une belle apparence, que ces fenêtres soient ouvertes ou fermées ; mais le soir nous rentrons comme déjà nous étions rentrés la veille ; et cependant nous avons été du lac à la montagne et de la montagne au lac, regardant autour de nous, questionnant de temps en temps les gens que sur leur bonne mine nous jugeons disposés à nous écouter et à nous répondre.
Ce jour-là, on nous donna deux fausses joies, en nous répondant que sans savoir son nom on connaissait parfaitement la dame dont nous parlions ; une fois on nous envoya à un chalet bâti en pleine montagne, une autre fois on nous assura qu’elle demeurait au bord du lac ; c’étaient bien des dames anglaises qui habitaient le lac et la montagne, mais ce n’était point madame Milligan.
Après avoir consciencieusement visité les environs de Vevey, nous nous en éloignâmes un peu du côté de Clarens et de Montreux, fâchés du mauvais résultat de nos recherches, mais nullement découragés ; ce qui n’avait pas réussi un jour, réussirait le lendemain sans doute.
Tantôt nous marchions dans des routes bordées de murs de chaque côté, tantôt dans des sentiers tracés à travers des vignes et des vergers, tantôt dans des chemins ombragés par d’énormes châtaigniers dont l’épais feuillage interceptant l’air et la lumière ne laissait pousser sous son couvert que des mousses veloutées ; à chaque pas dans ces routes et ces chemins s’ouvrait une grille en fer ou une barrière en bois, et alors on apercevait des allées de jardin bien sablées, serpentant autour de pelouses plantées çà et là de massifs d’arbustes et de fleurs ; puis cachée dans la verdure s’élevait une maison luxueuse ou une élégante maisonnette enguirlandée de plantes grimpantes ; et presque toutes, maisons comme maisonnettes, avaient à travers les massifs d’arbres ou d’arbustes des points de vue habilement ménagés sur le lac éblouissant et son cadre de sombres montagnes.
Ces jardins faisaient souvent notre désespoir, car nous tenant à distance des maisons, ils nous empêchaient d’être entendus de ceux qui se trouvaient dans ces maisons, si nous ne jouions pas et si nous ne chantions pas de toutes nos forces, ce qui, à la longue, et répété du matin au soir, devenait fatigant.
Une après-midi nous donnions ainsi un concert en pleine rue n’ayant devant nous qu’une grille pour laquelle nous chantions, et derrière nous qu’un mur dont nous ne prenions pas souci ; j’avais chanté à tue-tête la première strophe de ma chanson napolitaine et j’allais commencer la seconde, quand tout à coup nous l’entendîmes chanter derrière nous au delà de ce mur, mais faiblement et avec une voix étrange :
Vorria arreventare no piccinotto,
Cona lancella oghi vennenno acqua.
Quelle pouvait être cette voix ?
— Arthur ? demanda Mattia.
Mais non, ce n’était pas Arthur, je ne reconnaissais pas sa voix ; et cependant Capi poussait des soupirs étouffés et donnait tous les signes d’une joie vive en sautant contre le mur.
Incapable de me contenir, je m’écriai :
— Qui chante ainsi ?
Et la voix répondit :
— Rémi !
Mon nom au lieu d’une réponse. Nous nous regardâmes interdits, Mattia et moi.
Comme nous restions ainsi stupides en face l’un de l’autre, j’aperçus derrière Mattia, au bout du mur et par-dessus une haie basse, un mouchoir blanc qui voltigeait au vent ; nous courûmes de ce côté.
Ce fut seulement en arrivant à cette haie que nous pûmes voir la personne à laquelle appartenait le bras qui agitait ce mouchoir, — Lise !
Enfin nous l’avions retrouvée, et avec elle madame Milligan et Arthur.
Mais qui avait chanté ? Ce fut la question que nous lui adressâmes en même temps, Mattia et moi, aussitôt que nous pûmes trouver une parole.
— Moi, dit-elle.
Lise chantait ! Lise parlait !
Il est vrai que j’avais mille fois entendu dire que Lise recouvrerait la parole un jour, et très-probablement sous la secousse d’une violente émotion, mais je n’aurais pas cru que cela fût possible.
Et voilà cependant que cela s’était réalisé ; voilà qu’elle parlait ; voilà que le miracle s’était accompli ; et c’était en m’entendant chanter, en me voyant revenir près d’elle, alors qu’elle pouvait me croire perdu à jamais, qu’elle avait éprouvé cette violente émotion.
À cette pensée, je fus moi-même si fortement secoué, que je fus obligé de me retenir de la main à une branche de la haie.
Mais ce n’était pas le moment de s’abandonner :
— Où est madame Milligan ? dis-je, où est Arthur ?
Lise remua les lèvres pour répondre, mais de sa bouche ne sortirent que des sons mal articulés ; alors impatientée, elle employa le langage des mains pour s’expliquer et se faire comprendre plus vite, sa langue et son esprit étant encore mal habiles à se servir de la parole.
Comme je suivais des yeux son langage, que Mattia n’entendait pas, j’aperçus au loin dans le jardin, au détour d’une allée boisée, une petite voiture longue qu’un domestique poussait : dans cette voiture se trouvait Arthur allongé, puis derrière lui venait sa mère et… je me penchai en avant pour mieux voir… et M. James Milligan ; instantanément je me baissai derrière la haie en disant à Mattia, d’une voix précipitée, d’en faire autant, sans réfléchir que M. James Milligan ne connaissait pas Mattia.
Le premier mouvement d’épouvante passé, je compris que Lise devait être interdite de notre brusque disparition. Alors me haussant un peu, je lui dis à mi-voix :
— Il ne faut pas que M. James Milligan me voie, ou il peut me faire retourner en Angleterre.
Elle leva ses deux bras par un geste effrayé.
— Ne bouge pas, dis-je en continuant, ne parle pas de nous ; demain matin à neuf heures nous reviendrons à cette place ; tâche d’être seule ; maintenant va-t’en.
Elle hésita.
— Va-t’en, je t’en prie, ou tu me perds.
En même temps nous nous jetâmes à l’abri du mur, et en courant nous gagnâmes les vignes qui nous cachèrent ; là, après le premier moment donné à la joie, nous pûmes causer et nous entendre.
— Tu sais, me dit Mattia, que je ne suis pas du tout disposé à attendre à demain pour voir madame Milligan ; pendant ce temps M. James Milligan pourrait tuer Arthur ; je vais aller voir madame Milligan tout de suite et lui dire… tout ce que nous savons ; comme M. Milligan ne m’a jamais vu, il n’y a pas de danger qu’il pense à toi et à la famille Driscoll ; ce sera madame Milligan qui décidera ensuite ce que nous devons faire.
Il était évident qu’il y avait du bon dans ce que Mattia proposait ; je le laissai donc aller en lui donnant rendez-vous dans un groupe de châtaigniers qui se trouvait à une courte distance ; là, si par extraordinaire je voyais venir M. James Milligan, je pourrais me cacher.
J’attendis longtemps, couché sur la mousse, le retour de Mattia, et plus de dix fois déjà, je m’étais demandé si nous ne nous étions pas trompés, lorsqu’enfin je le vis revenir accompagné de madame Milligan.
Je courus au-devant d’elle et lui saisissant la main qu’elle me tendait, je la baisai ; mais elle me prit dans ses bras et se penchant vers moi elle m’embrassa sur le front tendrement.
C’était la seconde fois qu’elle m’embrassait ; mais il me sembla que la première elle ne m’avait pas serré ainsi dans ses bras.
— Pauvre cher enfant ! dit-elle.
Et de ses beaux doigts blancs et doux elle écarta mes cheveux pour me regarder longuement.
— Oui… oui… murmura-t-elle.
Ces paroles répondaient assurément à sa pensée intérieure, mais dans mon émotion j’étais incapable de comprendre cette pensée ; je sentais la tendresse, les caresses des yeux de madame Milligan, et j’étais trop heureux pour chercher au delà de l’heure présente.
— Mon enfant, dit-elle, sans me quitter des yeux, votre camarade m’a rapporté des choses bien graves ; voulez-vous de votre côté me raconter ce qui touche à votre arrivée dans la famille Driscoll et aussi à la visite de M. James Milligan.
Je fis le récit qui m’était demandé, et madame Milligan ne m’interrompit que pour m’obliger à préciser quelques points importants : jamais on ne m’avait écouté avec pareille attention, ses yeux ne quittaient pas les miens.
Lorsque je me tus, elle garda le silence pendant assez longtemps en me regardant toujours, enfin elle me dit :
— Tout cela est d’une gravité extrême pour vous, pour nous tous ; nous ne devons donc agir qu’avec prudence et après avoir consulté des personnes capables de nous guider ; mais jusqu’à ce moment vous devez vous considérer comme le camarade, comme l’ami, — elle hésita un peu, — comme le frère d’Arthur, et vous devez, dès aujourd’hui, abandonner, vous et votre jeune ami, votre misérable existence ; dans deux heures vous vous présenterez donc à Territet, à l’hôtel des Alpes où je vais envoyer une personne sûre, vous retenir votre logement ; ce sera là que nous nous reverrons, car je suis obligée de vous quitter.
De nouveau elle m’embrassa et après avoir donné la main à Mattia, elle s’éloigna rapidement.
— Qu’as-tu donc raconté à madame Milligan ? demandai-je à Mattia.
— Tout ce qu’elle vient de te dire et encore beaucoup d’autres choses, ah ! la bonne dame ! la belle dame !
— Et Arthur, l’as-tu vu ?
— De loin seulement, mais assez pour trouver qu’il a l’air d’un bon garçon.
Je continuai d’interroger Mattia, mais il évita de me répondre, ou il ne le fit que d’une façon détournée ; alors nous parlâmes de choses indifférentes jusqu’au moment où, selon la recommandation de madame Milligan, nous nous présentâmes à l’hôtel des Alpes. Quoique nous eussions notre misérable costume de musiciens des rues, nous fûmes reçus par un domestique en habit noir et en cravate blanche qui nous conduisit à notre appartement : comme elle nous parut belle, notre chambre ; elle avait deux lits blancs ; les fenêtres ouvraient sur une verandah suspendue au-dessus du lac, et la vue qu’on embrassait de là était une merveille : quand nous nous décidâmes à revenir dans la chambre, le domestique était toujours immobile attendant nos ordres, et il demanda ce que nous voulions pour notre dîner qu’il allait nous faire servir sur notre verandah.
— Vous avez des tartes ? demanda Mattia.
— Tarte à la rhubarbe, tarte aux fraises, tarte aux groseilles.
— Eh bien ! Vous nous servirez de ces tartes.
— Des trois ?
— Certainement.
— Et comme entrée ? comme rôti ? comme légumes ?
À chaque offre, Mattia ouvrait les yeux, mais il ne se laissa pas déconcerter.
— Ce que vous voudrez, dit-il.
Le garçon sortit gravement.
— Je crois que nous allons dîner mieux ici que dans la famille Driscoll, dit Mattia.
Le lendemain, madame Milligan vint nous voir ; elle était accompagnée d’un tailleur et d’une lingère, qui nous prirent mesure pour des habits et des chemises.
Elle nous dit que Lise continuait à s’essayer de parler, et que le médecin avait assuré qu’elle était maintenant guérie ; puis, après avoir passé une heure avec nous, elle nous quitta, m’embrassant tendrement et donnant la main à Mattia.
Elle vint ainsi pendant quatre jours, se montrant chaque fois plus affectueuse et plus tendre pour moi, mais avec quelque chose de contraint cependant, comme si elle ne voulait pas s’abandonner à cette tendresse et la laisser paraître.
Le cinquième jour, ce fut la femme de chambre que j’avais vue autrefois sur le Cygne qui vint à sa place ; elle nous dit que madame Milligan nous attendait chez elle, et qu’une voiture était à la porte de l’hôtel pour nous conduire : c’était une calèche découverte dans laquelle Mattia s’installa sans surprise et très-noblement, comme si depuis son enfance il avait roulé carrosse ; Capi aussi grimpa sans gêne sur un des coussins.
Le trajet fut court ; il me parut très-court, car je marchais dans un rêve, la tête remplie d’idées folles ou tout au moins que je croyais folles : on nous fit entrer dans un salon, où se trouvaient madame Milligan, Arthur étendu sur un divan, et Lise.
Arthur me tendit les deux bras ; je courus à lui pour l’embrasser ; j’embrassai aussi Lise, mais ce fut madame Milligan qui m’embrassa.
— Enfin, me dit-elle, l’heure est venue où vous pouvez reprendre la place qui vous appartient.
Et comme je la regardais pour lui demander l’explication de ces paroles, elle alla ouvrir une porte, et je vis entrer mère Barberin, portant dans ses bras des vêtements d’enfant, une pelisse en cachemire blanc, un bonnet de dentelle, des chaussons de tricot.
Elle n’eut que le temps de poser ces objets sur une table, avant que je la prisse dans mes bras ; pendant que je l’embrassais, madame Milligan donna un ordre à un domestique, et je n’entendis que le nom de M. James Milligan, ce qui me fit pâlir.
— Vous n’avez rien à craindre, me dit-elle doucement, au contraire, venez ici près de moi et mettez votre main dans la mienne.
À ce moment la porte du salon s’ouvrit devant M. James Milligan, souriant et montrant ses dents pointues ; il m’aperçut et instantanément ce sourire fut remplacé par une grimace effrayante.
Madame Milligan ne lui laissa pas le temps de parler :
— Je vous ai fait appeler, dit-elle d’une voix lente, qui tremblait légèrement, pour vous présenter mon fils aîné que j’ai eu enfin le bonheur de retrouver, — elle me serra la main ; — le voici ; mais vous le connaissez déjà, puisque chez l’homme qui l’avait volé, vous avez été le voir pour vous informer de sa santé.
— Que signifie ? dit M. James Milligan, la figure décomposée.
– … Cet homme, aujourd’hui en prison pour un vol commis dans une église, a fait des aveux complets ; voici une lettre qui le constate ; il a dit comment il avait volé cet enfant, comment il l’avait abandonné à Paris, avenue de Breteuil ; enfin comment il avait pris ses précautions en coupant les marques du linge de l’enfant pour qu’on ne le découvrît pas ; voici encore ces linges qui ont été gardés par l’excellente femme qui a généreusement élevé mon fils ; voulez-vous voir cette lettre ; voulez-vous voir ces linges ?
M. James Milligan resta un moment immobile, se demandant bien certainement s’il n’allait pas nous étrangler tous ; puis il se dirigea vers la porte ; mais prêt à sortir, il se retourna :
— Nous verrons, dit-il, ce que les tribunaux penseront de cette supposition d’enfant.
Sans se troubler, madame Milligan, — maintenant je peux dire ma mère, — répondit :
— Vous pouvez nous appeler devant les tribunaux ; moi je n’y conduirai pas celui qui a été le frère de mon mari.
La porte se referma sur mon oncle ; alors je pus me jeter dans les bras que ma mère me tendait et l’embrasser pour la première fois en même temps qu’elle m’embrassait elle-même.
Quand notre émotion se fut un peu calmée, Mattia s’approcha :
— Veux-tu répéter à ta maman que j’ai bien gardé son secret ? dit-il.
— Tu savais donc tout ? dis-je.
Ce fut ma mère qui répondit :
— Quand Mattia m’eut fait son récit, je lui recommandai le silence, car si j’avais la conviction que le pauvre petit Rémi était mon fils, il me fallait des preuves certaines que l’erreur n’était pas possible. Quelle douleur pour vous, cher enfant, si après vous avoir embrassé comme mon fils, j’étais venue vous dire que nous nous étions trompés ! Ces preuves nous les avons, et c’est pour jamais maintenant que nous sommes réunis ; c’est pour jamais que vous vivrez avec votre mère, votre frère, — elle montra Lise ainsi que Mattia, — et ceux qui vous ont aimé malheureux.
XXIII
EN FAMILLE.
Les années se sont écoulées, — nombreuses, mais courtes, car elles n’ont été remplies que de belles et douces journées.
J’habite en ce moment l’Angleterre, Milligan-Park, le manoir de mes pères.
L’enfant sans famille, sans soutien, abandonné et perdu dans la vie, ballotté au caprice du hasard, sans phare pour le guider au milieu de la vaste mer où il se débat, sans port de refuge pour le recevoir, a non-seulement une mère, un frère qu’il aime, et dont il est aimé, mais encore il a des ancêtres qui lui ont laissé un nom honoré dans son pays et une belle fortune.
Le petit misérable, qui enfant a passé tant de nuits dans les granges, dans les étables, ou au coin d’un bois à la belle étoile, est maintenant l’héritier d’un vieux château historique que visitent les curieux, et que recommandent les guides.
C’est à une vingtaine de lieues à l’ouest de l’endroit où je m’embarquai, poursuivi par les gens de justice, qu’il s’élève à mi-côte dans un vallon, bien boisé malgré le voisinage de la mer. Bâti sur une sorte d’esplanade naturelle, il a la forme d’un cube, et il est flanqué d’une grosse tour ronde à chaque coin. Les deux façades, exposées au sud et à l’ouest, sont enguirlandées de glycines et de rosiers grimpants ; celles du nord et de l’est sont couvertes de lierre dont les troncs, gros comme le corps d’un homme à leur sortie de terre, attestent la vétusté, et il faut tous les soins vigilants des jardiniers pour que leur végétation envahissante ne cache point sous son vert manteau les arabesques et les rinceaux finement sculptés dans la pierre blanche du cadre et des meneaux des fenêtres. Un vaste parc l’entoure ; il est planté de vieux arbres que ni la serpe ni la hache n’ont jamais touchés, et il est arrosé de belles eaux limpides qui font ses gazons toujours verts. Dans une futaie de hêtres vénérables, des corneilles viennent percher chaque nuit, annonçant par leurs croassements le commencement et la fin du jour.
C’est ce vieux manoir de Milligan-Park que nous habitons en famille, ma mère, mon frère, ma femme et moi.
Depuis six mois que nous y sommes installés, j’ai passé bien des heures dans le chartrier où sont conservés les chartes, les titres de propriété, les papiers de la famille, penché sur une large table en chêne noircie par les ans, occupé à écrire ; ce ne sont point cependant ces chartes ni ces papiers de famille que je consulte laborieusement, c’est le livre de mes souvenirs que je feuillette et mets en ordre.
Nous allons baptiser notre premier enfant, notre fils, le petit Mattia, et à l’occasion de ce baptême, qui va réunir dans le manoir de mes pères tous ceux qui ont été mes amis des mauvais jours, je veux offrir à chacun d’eux un récit des aventures auxquelles ils ont été mêlés, comme un témoignage de gratitude pour le secours qu’ils m’ont donné ou l’affection qu’ils ont eue pour le pauvre enfant perdu. Quand j’ai achevé un chapitre, je l’envoie à Dorchester, chez le lithographe ; et ce jour même j’attends les copies autographiées de mon manuscrit pour en donner une à chacun de mes invités.
Cette réunion est une surprise que je leur fais, et que je fais aussi à ma femme, qui va voir son père, sa sœur, ses frères, sa tante qu’elle n’attend pas ; seuls ma mère et mon frère sont dans le secret : si aucune complication n’entrave nos combinaisons, tous logeront ce soir sous mon toit et j’aurai la joie de les voir autour de ma table.
Un seul manquera à cette fête, car si grande que soit la puissance de la fortune, elle ne peut pas rendre la vie à ceux qui ne sont plus. Pauvre cher vieux maître, comme j’aurais été heureux d’assurer votre repos ! Vous auriez déposé la piva, la peau de mouton et la veste de velours ; vous n’auriez plus répété : « En avant, mes enfants ! » une vieillesse honorée vous eût permis de relever votre belle tête blanche et de reprendre votre nom ; Vitalis, le vieux vagabond, fût redevenu Carlo Balzani le célèbre chanteur. Mais ce que la mort impitoyable ne m’a pas permis pour vous, je l’ai fait au moins pour votre mémoire ; et à Paris, dans le cimetière Montparnasse, ce nom de Carlo Balzani est inscrit sur la tombe que ma mère, sur ma demande, vous a élevée ; et votre buste en bronze sculpté d’après les portraits publiés au temps de votre célébrité, rappelle votre gloire à ceux qui vous ont applaudi : une copie de ce buste a été coulée pour moi ; elle est là devant moi, et en écrivant le récit de mes premières années d’épreuves, alors que la marche des événements se déroulait, mes yeux bien souvent ont cherché les vôtres. Je ne vous ai point oublié, je ne vous oublierai jamais, soyez-en sûr ; si dans cette existence périlleuse d’un enfant perdu je n’ai pas trébuché, je ne suis pas tombé, c’est à vous que je le dois, à vos leçons, à vos exemples, ô mon vieux maître ! et dans toute fête votre place sera pieusement réservée : si vous ne me voyez pas, moi je vous verrai.
Mais voici ma mère qui s’avance dans la galerie des portraits : l’âge n’a point terni sa beauté ; et je la vois aujourd’hui telle qu’elle m’est apparue pour la première fois, sous la verandah du Cygne, avec son air noble, si rempli de douceur et de bonté ; seul le voile de mélancolie alors continuellement baissé sur son visage s’est effacé.
Elle s’appuie sur le bras d’Arthur, car maintenant ce n’est plus la mère qui soutient son fils débile et chancelant, c’est le fils devenu un beau et vigoureux jeune homme, habile à tous les exercices du corps, élégant écuyer, solide rameur, intrépide chasseur qui avec une affectueuse sollicitude offre son bras à sa mère ; car contrairement au pronostic de mon oncle M. James Milligan, le miracle s’est accompli : Arthur a vécu, et il vivra.
À quelque distance derrière eux, je vois venir une vieille femme vêtue comme une paysanne française et portant sur ses bras un tout petit enfant enveloppé dans une pelisse blanche : la vieille paysanne c’est mère Barberin et l’enfant c’est le mien, c’est mon fils, le petit Mattia.
Après avoir retrouvé ma mère, j’avais voulu que mère Barberin restât près de nous, mais elle n’avait pas accepté :
— Non, m’avait-elle dit, mon petit Rémi, ma place n’est pas chez ta mère en ce moment. Tu vas avoir à travailler pour t’instruire et pour devenir un vrai monsieur par l’éducation, comme tu en es un par la naissance. Que ferais-je auprès de toi ? Ma place n’est pas dans la maison de ta vraie mère. Laisse-moi retourner à Chavanon. Mais pour cela notre séparation ne sera peut-être pas éternelle. Tu vas grandir ; tu te marieras, tu auras des enfants. Alors, si tu le veux, et si je suis encore en vie, je reviendrai près de toi pour élever tes enfants. Je ne pourrai pas être leur nourrice comme j’ai été la tienne, car je serai vieille, mais la vieillesse n’empêche pas de bien soigner un enfant ; on a l’expérience ; on ne dort pas trop. Et puis je l’aimerai, ton enfant, et ce n’est pas moi, tu peux en être certain, qui me le laisserai voler comme on t’a volé toi-même.
Il a été fait comme mère Barberin désirait ; peu de temps avant la naissance de notre enfant, on a été la chercher à Chavanon et elle a tout quitté, son village, ses habitudes, ses amis, la vache issue de la nôtre pour venir en Angleterre près de nous ; notre petit Mattia est nourri par sa mère, mais il est soigné, porté, amusé, cajolé par mère Barberin, qui déclare que c’est le plus bel enfant qu’elle ait jamais vu.
Arthur tient dans sa main un numéro du Times ; il le dépose sur ma table de travail en me demandant si je l’ai lu, et, sur ma réponse négative, il me montre du doigt une correspondance de Vienne que je traduis :
« Vous aurez prochainement à Londres la visite de Mattia ; malgré le succès prodigieux qui a accueilli la série de ses concerts ici, il nous quitte, appelé en Angleterre par des engagements auxquels il ne peut manquer. Je vous ai déjà parlé de ces concerts ; ils ont produit la plus vive sensation autant par la puissance et par l’originalité du virtuose, que par le talent du compositeur ; pour tout dire, en un mot, Mattia est le Chopin du violon. »
Je n’ai pas besoin de cet article pour savoir que le petit musicien des rues, mon camarade et mon élève, est devenu un grand artiste ; j’ai vu Mattia se développer et grandir, et si, quand nous travaillions tous trois ensemble sous la direction de notre précepteur, lui, Arthur et moi, il faisait peu de progrès en latin et en grec, il en faisait de tels en musique avec les maîtres que ma mère lui donnait, qu’il n’était pas difficile de deviner que la prédiction d’Espinassous, le perruquier-musicien de Mende, se réaliserait ; cependant, cette correspondance de Vienne me remplit d’une joie orgueilleuse comme si j’avais ma part des applaudissements dont elle est l’écho ; mais ne l’ai-je-pas réellement ? Mattia n’est-il pas un autre moi-même, mon camarade, mon ami, mon frère ? ses triomphes sont les miens, comme mon bonheur est le sien.
À ce moment, un domestique me remet une dépêche télégraphique qu’on vient d’apporter :
« C’est peut-être la traversée la plus courte, mais ce n’est pas la plus agréable ; en est-il d’agréable, d’ailleurs ? Quoi qu’il en soit, j’ai été si malade que c’est à Red-Hill seulement que je trouve la force de te prévenir ; j’ai pris Cristina en passant à Paris ; nous arriverons à Chegford à quatre heures dix minutes, envoie une voiture au-devant de nous.
En parlant de Cristina, j’avais regardé Arthur, mais il avait détourné les yeux ; ce fut seulement quand je fus arrivé à la fin de la dépêche qu’il les releva.
— J’ai envie d’aller moi-même à Chegford, dit-il, je vais faire atteler le landau.
— C’est une excellente idée ; tu seras ainsi au retour vis-à-vis de Cristina.
Sans répondre, il sortit vivement ; alors je me tournai vers ma mère.
— Vous voyez, lui dis-je, qu’Arthur ne cache pas son empressement ; cela est significatif.
— Très-significatif.
Il me sembla qu’il y avait dans le ton de ces deux mots comme une nuance de mécontentement ; alors, me levant, je vins m’asseoir près de ma mère, et, lui prenant les deux mains que je baisai :
— Chère maman, lui dis-je en français, qui était la langue dont je me servais toujours quand je voulais lui parler tendrement, en petit enfant ; chère maman, il ne faut pas être peinée parce qu’Arthur aime Cristina. Cela, il est vrai, l’empêchera de faire un beau mariage, puisqu’un beau mariage, selon l’opinion du monde, est celui qui réunit la naissance à la richesse. Mais est-ce que mon exemple ne montre pas qu’on peut être heureux, très-heureux, aussi heureux que possible, sans la naissance et la richesse dans la femme qu’on aime ? Ne veux-tu pas qu’Arthur soit heureux comme moi ? La faiblesse que tu as eue pour moi, parce que tu ne peux rien refuser à l’enfant que tu as pleuré pendant treize ans, ne l’auras-tu pas pour ton autre fils ? serais-tu donc plus indulgente pour un frère que pour l’autre ?
Elle me passa la main sur le front, et m’embrassant :
— Oh ! le bon enfant, dit-elle, le bon frère ! quels trésors d’affection il y a en toi !
— C’est que j’ai fait des économies autrefois ; mais ce n’est pas de moi qu’il s’agit, c’est d’Arthur. Dis-moi un peu où il trouvera une femme plus charmante que Cristina ? n’est-elle pas une merveille de beauté italienne ? Et l’éducation qu’elle a reçue depuis que nous avons été la chercher à Lucca, ne lui permet-elle pas de tenir sa place, et une place distinguée, dans la société la plus exigeante ?
— Tu vois dans Cristina la sœur de ton ami Mattia.
— Cela est vrai, et j’avoue sans détours que je souhaite de tout mon cœur un mariage qui fera entrer Mattia dans notre famille.
— Arthur t’a-t-il parlé de ses sentiments et de ses désirs ?
— Oui, chère maman, dis-je en souriant, il s’est adressé à moi comme au chef de la famille.
— Et le chef de la famille ?…
– … A promis de l’appuyer.
Mais ma mère m’interrompit.
— Voici ta femme, dit-elle ; nous parlerons d’Arthur plus tard.
Ma femme, vous l’avez deviné, et il n’est pas besoin que je le dise, n’est-ce pas ? ma femme, c’est la petite fille aux yeux étonnés, au visage parlant que vous connaissez, c’est Lise, la petite Lise, fine, légère, aérienne ; Lise n’est plus muette, mais elle a par bonheur conservé sa finesse et sa légèreté qui donnent à sa beauté quelque chose de céleste. Lise n’a point quitté ma mère, qui l’a fait élever et instruire sous ses yeux, et elle est devenue une belle jeune fille, la plus belle des jeunes filles, douée pour moi de toutes les qualités, de tous les mérites, de toutes les vertus, puisque je l’aime. J’ai demandé à ma mère de me la donner pour femme, et, après une vive résistance, basée sur la différence de condition, ma mère n’a pas su me la refuser, ce qui a fâché et scandalisé quelques-uns de nos parents : sur quatre qui se sont ainsi fâchés, trois sont déjà revenus, gagnés par la grâce de Lise, et le quatrième n’attend pour revenir à son tour, qu’une visite de nous dans laquelle nous lui ferons nos excuses d’être heureux, et cette visite est fixée à demain.
— Eh bien, dit Lise en entrant, que se passe-t-il donc ? on se cache de moi ; on se parle en cachette ; Arthur vient de partir pour la station de Chegford, le break a été envoyé à celle de Ferry, quel est ce mystère, je vous prie ?
Nous sourions, mais nous ne lui répondons pas.
Alors elle passe un bras autour du cou de ma mère, et l’embrassant tendrement :
— Puisque vous êtes du complot, chère mère, dit-elle, je ne suis pas inquiète, je suis sûre à l’avance que vous avez, comme toujours, travaillé pour notre bonheur, mais je n’en suis que plus curieuse.
L’heure a marché, et le break que j’ai envoyé à Ferry au-devant de la famille de Lise, doit arriver d’un instant à l’autre ; alors, voulant jouer avec cette curiosité, je prends une longue-vue qui nous sert à suivre les navires passant au large, mais, au lieu de la braquer sur la mer, je la tourne sur le chemin par où doit arriver le break.
— Regarde dans cette longue-vue, lui dis-je, et ta curiosité sera satisfaite.
Elle regarde, mais sans voir autre chose que la route blanche, puisqu’aucune voiture ne se montre encore.
Alors, à mon tour, je mets l’œil à l’oculaire :
— Comment n’as-tu rien vu dans cette lunette ? dis-je du ton de Vitalis faisant son boniment ; elle est vraiment merveilleuse : avec elle je passe au-dessus de la mer et je vais jusqu’en France ; c’est une coquette maison aux environs de Sceaux que je vois, un homme aux cheveux blancs presse deux femmes qui l’entourent : « Allons vite, dit-il, nous manquerons le train et je n’arriverai pas en Angleterre pour le baptême de mon petit-fils ; dame Catherine, hâte-toi un peu, je t’en prie, depuis dix ans que nous demeurons ensemble tu as toujours été en retard. Quoi ? que veux-tu dire, Étiennette ? voilà encore mademoiselle gendarme ! Le reproche que j’adresse à Catherine est tout amical. Est-ce que je ne sais pas que Catherine est la meilleure des sœurs, comme toi, Tiennette, tu es la meilleure des filles ? où trouve-t-on une bonne fille comme toi, qui ne se marie pas pour soigner son vieux père, continuant grande le rôle d’ange gardien qu’elle a rempli enfant, avec ses frères et sa sœur ? » Puis avant de partir il donne des instructions pour qu’on soigne ses fleurs pendant son absence : « N’oublie pas que j’ai été jardinier, dit-il à son domestique, et que je connais l’ouvrage. »
Je change la lunette de place comme si je voulais regarder d’un autre côté :
— Maintenant, dis-je, c’est un vapeur que je vois, un grand vapeur qui revient des Antilles et qui approche du Havre : à bord est un jeune homme revenant de faire un voyage d’exploration botanique dans la région de l’Amazone ; on dit qu’il rapporte tout une flore inconnue en Europe, et la première partie de son voyage, publiée par les journaux, est très-curieuse ; son nom, Benjamin Acquin, est déjà célèbre ; il n’a qu’un souci : savoir s’il arrivera en temps au Havre pour prendre le bateau de Southampton et rejoindre sa famille à Milligan-Park ; ma lunette est tellement merveilleuse qu’elle le suit ; il a pris le bateau de Southampton ; il va arriver.
De nouveau ma lunette est braquée dans une autre direction et je continue :
— Non-seulement je vois mais j’entends : deux hommes sont en wagon, un vieux et un jeune : « Comme ce voyage va être intéressant pour nous, dit le vieux. — Très-intéressant, magister. — Non-seulement, mon cher Alexis, tu vas embrasser ta famille, non-seulement nous allons serrer la main de Rémi qui ne nous oublie pas, mais encore nous allons descendre dans les mines du pays de Galles ; tu feras là de curieuses observations, et au retour tu pourras apporter des améliorations à la Truyère, ce qui donnera de l’autorité à la position que tu as su conquérir par ton travail ; pour moi, je rapporterai des échantillons et les joindrai à ma collection que la ville de Varses a bien voulu accepter. Quel malheur que Gaspard n’ait pas pu venir ! »
J’allais continuer, mais Lise s’était approchée de moi ; elle me prit la tête dans ses deux mains et par sa caresse, elle m’empêcha de parler.
— Oh la douce surprise ! dit-elle, d’une voix que l’émotion faisait trembler.
— Ce n’est pas moi qu’il faut remercier, c’est maman, qui a voulu réunir tous ceux qui ont été bons pour son fils abandonné ; si tu ne m’avais pas fermé la bouche, tu aurais appris que nous attendons aussi cet excellent Bob, devenu le plus fameux showman de l’Angleterre, et son frère qui commande toujours l’Éclipse.
À ce moment, un roulement de voiture arrive jusqu’à nous, puis presque aussitôt un second ; nous courons à la fenêtre et nous apercevons le break dans lequel Lise reconnaît son père, sa tante Catherine, sa sœur Étiennette, ses frères Alexis et Benjamin ; près d’Alexis est assis un vieillard tout blanc et voûté, c’est le magister. Du côté opposé, arrive aussi le landau découvert dans lequel Mattia et Cristina nous font des signes de mains. Puis, derrière le landau, vient un cabriolet conduit par Bob lui-même ; Bob a toute la tournure d’un gentleman, et son frère est toujours le rude marin qui nous débarqua à Isigny.
Nous descendons vivement l’escalier pour recevoir nos hôtes au bas du perron.
Le dîner nous réunit tous à la même table, et naturellement on parle du passé.
— J’ai rencontré dernièrement à Bade, dit Mattia, dans les salles de jeu, un gentleman aux dents blanches et pointues qui souriait toujours malgré sa mauvaise fortune ; il ne m’a pas reconnu, et il m’a fait l’honneur de me demander un florin pour le jouer sur une combinaison sûre ; c’était une association ; elle n’a pas été heureuse : M. James Milligan a perdu.
— Pourquoi racontez-vous cela devant Rémi, mon cher Mattia ? dit ma mère ; il est capable d’envoyer un secours à son oncle.
— Parfaitement, chère maman.
— Alors où sera l’expiation ? demanda ma mère.
— Dans ce fait que mon oncle qui a tout sacrifié à la fortune, devra son pain à ceux qu’il a persécutés et dont il a voulu la mort.
— J’ai eu des nouvelles de ses complices, dit Bob.
— De l’horrible Driscoll ? demanda Mattia.
— Non de Driscoll lui-même, qui doit être toujours au delà des mers, mais de la famille Driscoll ; madame Driscoll est morte brûlée un jour qu’elle s’est couchée dans le feu au lieu de se coucher sur la table, et Allen et Ned viennent de se faire condamner à la déportation ; ils rejoindront leur père.
— Et Kate ?
— La petite Kate soigne son grand-père toujours vivant ; elle habite avec lui la cour du Lion-Rouge ; le vieux a de l’argent, ils ne sont pas malheureux.
— Si elle est frileuse, dit Mattia en riant, je la plains ; le vieux n’aime pas qu’on approche de sa cheminée.
Et dans cette évocation du passé, chacun place son mot, tous n’avons-nous pas des souvenirs qui nous sont communs et qu’il est doux d’échanger ; c’est le lien qui nous unit.
Lorsque le dîner est terminé, Mattia s’approche de moi et me prenant à part dans l’embrasure d’une fenêtre.
— J’ai une idée, me dit-il ; nous avons fait si souvent de la musique pour des indifférents, que nous devrions bien en faire un peu pour ceux que nous aimons.
— Il n’y a donc pas de plaisir sans musique pour toi ; quand même, partout et toujours de la musique ; souviens-toi de la peur de notre vache.
— Veux-tu jouer ta chanson napolitaine ?
— Avec joie, car c’est elle qui a rendu la parole à Lise.
Et nous prenons nos instruments : dans une belle boîte doublée en velours, Mattia atteint un vieux violon qui vaudrait bien deux francs si nous voulions le vendre, et moi je retire de son enveloppe une harpe dont le bois lavé par les pluies a repris sa couleur naturelle.
On fait cercle autour de nous, mais à ce moment un chien, un caniche, Capi se présente ; il est bien vieux, le bon Capi, il est sourd, mais il a gardé une bonne vue ; du coussin sur lequel il habite il a reconnu sa harpe et il arrive en clopinant « pour la représentation, » il tient une soucoupe dans sa gueule ; il veut faire le tour « de l’honorable société » en marchant sur ses pattes de derrière, mais la force lui manque, alors il s’assied et saluant gravement « la société » il met une patte sur son cœur.
Notre chanson chantée, Capi se relève tant bien que mal « et fait la quête » ; chacun met son offrande dans la soucoupe, et Capi, émerveillé de la recette, me l’apporte. C’est la plus belle qu’il ait jamais faite, il n’y a que des pièces d’or et d’argent : — 170 francs.
Je l’embrasse sur le nez comme autrefois, quand il me consolait, et ce souvenir des misères de mon enfance me suggère une idée que j’explique aussitôt :
— Cette somme sera la première mise destinée à fonder une maison de secours et de refuge pour les petits musiciens des rues ; ma mère et moi nous ferons le reste.
— Chère madame, dit Mattia en baisant la main de ma mère, je vous demande une toute petite part dans votre œuvre : si vous le voulez bien, le produit de mon premier concert à Londres s’ajoutera à la recette de Capi.
Une page manque à mon manuscrit, c’est celle qui doit contenir ma chanson napolitaine ; Mattia, meilleur musicien que moi, écrit cette chanson, et la voici :
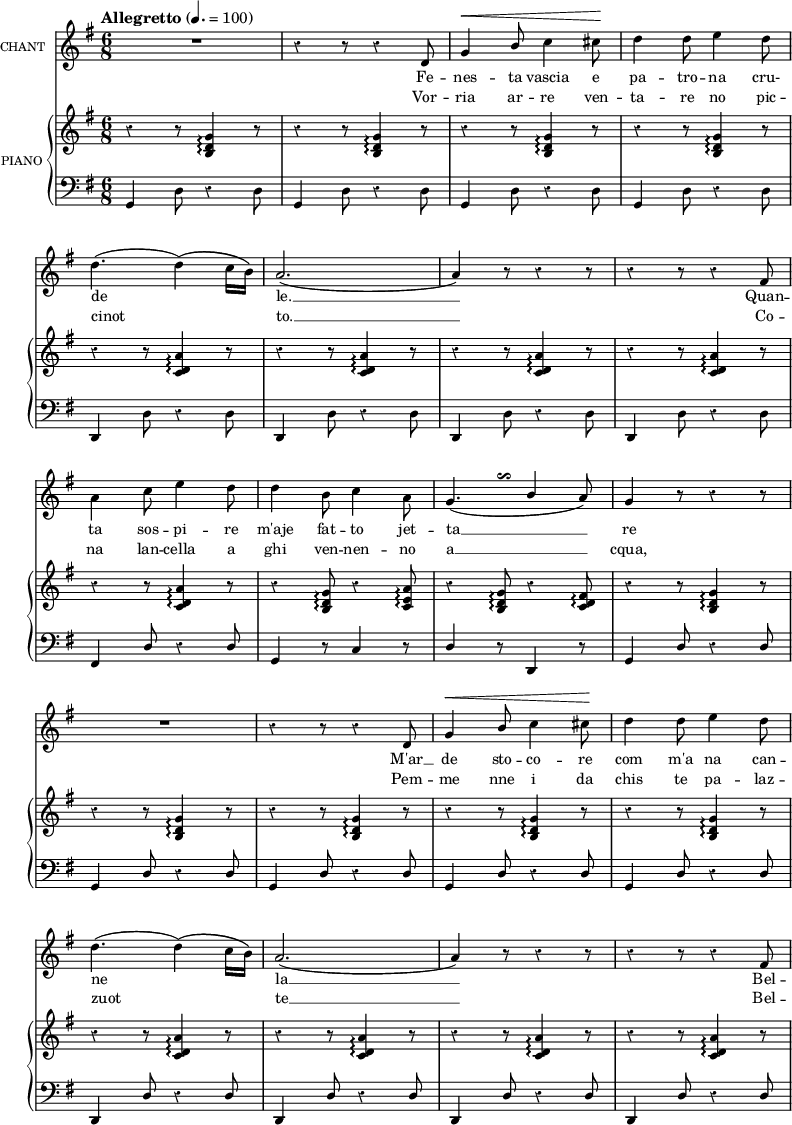
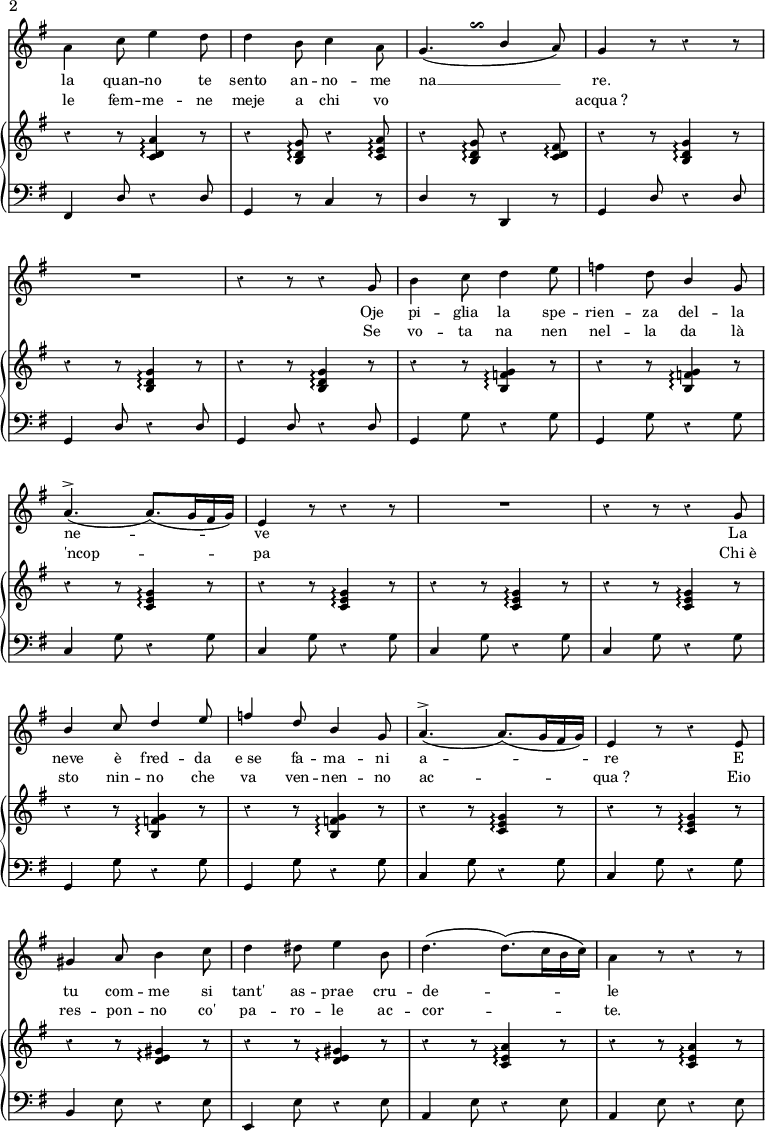

- ↑ bivac : forme vieillie de bivouac. (N.d.R.)
