Une muse et sa mère/Texte entier
DU MÊME AUTEUR
Au temps des Châtelaines, poésies, Paris, Lemerre, 1894, in-16.
Renaud de Dammartin et la Coalition de Bouvines un grand feudataire), récompensé par l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, Champion, 1898, in-8o.
Petite Histoire de Boulogne-sur-Mer, illustré, Boulogne, Société typolitho, 1899, in-8o.
La Folle Aventure, poésies, Paris, Lemerre, 1900, in-16.
Ces messieurs du cabinet, roman, Paris, Mercure de France, 1905, in 18.
Les Dauphins du Jour, roman, Paris, Mercure de France, 1906, in-18.
Les Corsaires, mémoires et documents inédits, récompensé par l’Académie des sciences morales et politiques, Paris, Mercure de France. 1908, in-8o.
Les Surprises du bachelier Pétruccio, roman, Paris, Mercure de France, 1909, in-18.
Les Parfums du coffret, poésies, Paris, Le Beffroi, 1911, in-16.
Les Corsaires dunkerquois et Jean-Bart, récompensé par l’Académie des sciences morales et politiques, illustré, Paris, Mercure de France, 1913-1914, deux volumes in-8o.
Le Drame des Flandres, un an de guerre, 1914-1915, illustré, Paris, Perrin, 1915, in-16.
En Belgique : la Zone de l’Avant, 1915-1916, Académie française, prix Monthyon, Paris, Perrin, 1918, in-16.
Dunkerque, ville héroïque, dans le passé, dans le présent, Paris, Perrin, 1918, in-16.
Les Pêches maritimes, un Tour sur le Dogger-Bank, illustré, Paris, Bossard, 1918, in-12.
Les Grands Ports français : nos trois Ports du Nord, Dunkerque, Calais, Boulogne, illustré, Paris, Dunod, 1920, in-8o.
Villes meurtries de France ; villes de Picardie, illustré, Paris-Bruxelles, Van Oest, 1920, in-12.
Marguerite Burmat-Provins, biographie critique, portr. et autogr. Paris, Sansot, 1920, in-16.
Visages de villes, avec cinquante eaux fortes orig. par Albert Lechat, préface par Emile Verhaeren, Paris, Crès, 1920, in-4o.
Critique sentimentale. Souvenirs sur les Cazin et sur Albert Lechat, illustré, Paris, Chiberre, 1922, in-12.
Vie de monsieur Duguay-Trouin, écrite de sa main, introduction et notes de Henri Malo, portr., Paris, Bossard, 1922, in-18.
Le Tendre Amour de don Luis, roman, Paris, Grasset, 1924, in-16.
La Gloire du vicomte de Launay (Delphine Gay de Girardin), Paris, Émile-Paul, in-8o.
« Il rencontra plusieurs de ces femmes dont on parlera dans l’histoire du dix-neuvième siècle, de qui l’esprit, la beauté, les amours, ne seront pas moins célèbres que celles des reines du temps passé. »
PARIS
ÉDITIONS ÉMILE-PAUL FRÈRES
100, RUE DU FAUBOURG-SAINT-HONORÉ, 100
PLACE BEAUVAU
1924
balzacien
je dédie affectueusement cette histoire
AVANT-PROPOS
Les références indiqueront le détail de la bibliographie qui a servi à établir ce volume. De nombreux documents inédits sont venus s’y ajouter, provenant de la collection Spoelberch de Lovenjoul, des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale, des archives du Théâtre-Français, de la Bibliothèque d’art et d’archéologie, et surtout d’archives privées que leurs possesseurs m’ont aimablement ouvertes. Aussi j’ai plaisir à leur exprimer tout d’abord mes remercîments et ma reconnaissance.
À ses souvenirs d’enfance qu’elle a bien voulu évoquer pour moi, Mme L. Détroyat a ajouté de gros dossiers de lettres, de notes, et une documentation iconographique et musicale très fournie. Le marquis de Girardin m’a confié d’importants documents qu’il tient de famille ou qu’il a réunis au cours de longues années de recherches. Des correspondances où j’ai relevé maints détails intéressants m’ont été communiquées par Mmes Du Manoir de Juaye et Franchet d’Esperey, MM. C. Enlart, Delaroche-Vernet et le baron Chassériau. M. Henry Prior a fait pour mon compte des fouilles fructueuses dans ses belles collections romantiques. M. L. Grasilier a trouvé dans ses cartons et m’a libéralement apporté de très curieux renseignements tirés de la série F des Archives nationales qu’il connaît si bien, et la piquante correspondance où se lit l’histoire du brave colonel de Galbois et de la sensible Amélie de X… Mme B. Paillard et M. Ernault ont avec la plus grande obligeance mis sous mes yeux les titres de propriété de la Maison rouge. M. A. Besnard a agi de même pour la maison que Sophie Gay occupa à Versailles. Je dois encore d’utiles indications à Mlle L. Vincent, auteur d’une thèse remarquable sur Georges Sand dans le Berry, à M. R. Jasinski, qui en prépare une sur Théophile Gautier, à M. de Lansac de Laborie, à MM. Pierre Dufay, Gabalda et Paul Jarry qui ont mis à ma disposition leurs belles bibliothèques sur Paris et le xixe siècle littéraire et artistique, à M. Henri Réveillez, secrétaire honoraire de la mairie de Boulogne-sur-Mer, à M. Louis Féron, ancien archiviste de la Préfecture de police, à Mlle C. Misme, bibliothécaire à la Bibliothèque d’art et d’archéologue, à M. Coüet, archiviste de la Comédie-Française, à M. Émile Blémont qui s’est fort opportunément rappelé pour moi un quatrain improvisé par Méry, à M. Brière, conservateur adjoint du Musée de Versailles, qui fut pour moi un guide sûr et averti dans cette galerie de tableaux et de portraits du xixe siècle où revivent tant de personnages de ce livre, à M. Paul-André Lemoisne, du cabinet des Estampes, et enfin à M. Marcel Bouteron, l’éminent balsacien, qui m’a fait profiter de sa profonde science des milieux littéraires du xixe siècle, et m’a donné connaissance d’un grand nombre de lettres inédites en sa possession.
À tous, encore une fois, merci.
UNE MUSE ET SA MÈRE
INTRODUCTION
J’usais encore mes culottes sur les bancs du collège de Boulogne-sur-Mer, lorsque je découvris les romantiques. Ce fut un éblouissement. Un de mes camarades, féru d’admiration pour eux, attisait mon enthousiasme. Il me récitait avec flamme des vers de Lamartine, de Hugo, de Musset, de Vigny ; il me prêtait les romans de Balzac et de Hugo. Je complétais cette documentation par des séances à la bibliothèque municipale. Je me rappelle le bibliothécaire, chauve et souriant ; cet excellent homme accueillit vers cette époque avec la plus grande bienveillance et une entière confiance un savant allemand parmi les plus cotés, qui, subrepticement, découpa les plus belles miniatures d’un des manuscrits anciens les plus rares de la bibliothèque, et les glissa dans sa serviette. On ne s’aperçut du vol qu’après son départ. On courut à ses trousses jusqu’à la gare : le train s’ébranlait quand on arriva. On télégraphia à Paris. Le savant savait l’art de se défiler, et oncques ne put-on lui mettre la main au collet. Je me rappelle encore le nez corbin chevauché par un binocle à équilibre instable, et la calotte sommant le crâne pointu de l’adjoint au bibliothécaire, homme tranquille et qui savait fort bien indiquer aux lecteurs l’emplacement du Larousse. Je prenais sur le temps de mes repas et sur celui de mon sommeil pour lire les Misérables ou ingurgiter les Burgraves. Ces derniers m’ont d’ailleurs valu une amère désillusion lorsque je les vis sur la scène du Théâtre-Français, une vingtaine d’années plus tard. Victor Hugo m’apparaissait comme un Titan, comme un dieu, et je me réjouissais à l’idée de contempler ses traits augustes, lorsque je m’installerais à Paris pour terminer mes études. Malheureusement, il ne m’attendit pas, et mourut six mois avant mon arrivée.
Je cherchais à me renseigner sur ces illustres objets de mes élans juvéniles. J’y éprouvais quelque difficulté dans le coin de province où je grandissais, d’autant plus que les nombreux travaux, mémoires, correspondances publiés depuis, de nature à satisfaire ma curiosité, demeuraient encore ensevelis dans des tiroirs secrets et fermés à triple tour. Le Ciel, par bonheur, combla cette lacune d’une manière inattendue.
Depuis que j’étais au monde, je voyais parmi les familiers de la maison une amie de ma mère, appartenant à la génération précédente, et qui s’appelait Mme Labarre. Elle avait deux grands yeux bleus souriants et doux, une bouche fine admirablement dessinée, et un fort beau front, au haut duquel une raie partageait également les bandeaux de ses cheveux blancs et soyeux ; de longues « anglaises » encadraient sa figure. Seul le nez, qui rougissait, ne s’accordait pas à l’harmonie de l’ensemble, par sa couleur sinon par sa forme ; mais on ne tardait pas à oublier cette légère disgrâce, et pour ma part je ne m’y arrêtai jamais.
Mme Labarre avait les manières distinguées, sans affectation, des personnes qui ont longtemps fréquenté le meilleur monde. Elle parlait purement, et visait à s’exprimer en un français rigoureusement correct. Elle soulevait de longues discussions sur la propriété ou l’impropriété de certains mots, et choisissait ses expressions. Elle invoquait l’usage du monde, l’autorité de l’Académie française, les décisions de Littré, et, pour la prononciation, s’en rapportait aux artistes du Théâtre-Français, qui faisaient loi. Elle parlait l’italien, vantait la musicalité de cette langue, et se flattait de la prononcer sans défaut.
L’âge modifiait peu à peu le timbre de sa voix ; ma mère me dit qu’elle fut dans sa jeunesse une cantatrice applaudie à Paris. Elle refusait habituellement de se faire entendre. Une seule fois, elle chanta dans une église ; je me rappelle un contralto magnifique, généreux et chaud, mais qui tendait à quelque raucité ; on me vanta l’excellence de la méthode, la netteté de l’articulation, la voix bien posée. Elle partageait fréquemment notre repas du soir.
J’ouvrais toutes grandes mes oreilles, et tous grands mes yeux, car ainsi l’on écouté mieux, pour ne rien perdre de sa conversation charmante, spirituelle, semée de pointes, nourrie de souvenirs, illustrée d’anecdotes dont certaines fleuraient bon le dix huitième siècle léger et libertin. Elle était l’ornement du dîner annuel que mes parents avaient institué pour la fête de sainte Cécile. Le matin, mon père, violoncelliste, se faisait entendre à une messe solennelle en musique. Au retour, je vois encore la table de la salle à manger munie de toutes ses rallonges, le linge blanc, l’argenterie brillante, les cristaux étincelants, et le grand feu de houille qui flambait dans la grille, les bouteilles vénérables que l’on chambrait, et je respire encore la bonne odeur de cuisine qui emplissait la maison et aiguisait l’appétit.
Vers une heure après-midi, un à un, les invités arrivaient, vieux amis fidèles, toujours les mêmes. Ma mémoire me représente avec netteté les traits de leurs physionomies affectueuses qui se penchaient complaisamment vers moi, en me félicitant de mes « succès » d’écolier. Ils abordaient ma mère avec des grâces surannées et touchantes. Seule, Mme Labarre n’arrivait pas. Elle avait coutume de s’attarder plus que de raison aux soins de sa toilette. Chacun était debout de bonne heure ce jour là ; la faim tenaillait les estomacs. Le rôti risquait d’être trop cuit. Mon père pestait ouvertement contre la retardataire, et finissait par courir jusque chez elle pour la ramener. Elle faisait son entrée, nullement émue, trouvant naturel qu’on l’attendît ; il semblait que cet hommage lui fût dû. Après quoi, le charme opérait, en même temps que les estomacs recevaient satisfaction ; elle brillait dans ce petit cercle de province, et cela lui rappelait des succès plus retentissants sur une scène plus considérable.
L’une après l’autre, la mort a figé les physionomies joyeuses qui entouraient ce jour-là la table familiale munie de ses rallonges. Quelle mélancolie de savoir éteints à jamais ces bons sourires dont la douceur capitonna ma première enfance et encouragea ma jeunesse ! Aujourd’hui, je reste seul à m’en souvenir, et, après moi, ces êtres et ces choses qui tinrent une telle place dans mon existence seront comme s’ils n’avaient jamais été, seront du néant.
Mme Labarre subit le sort commun : elle vieillit.
Elle ne parvint jamais à s’y résoudre. Sa situation pécuniaire empirait avec les années ; les cigales ne sont jamais prévoyantes. Dans la pauvreté, elle conserva sa belle allure. Elle dut arborer de grosses besicles ; elle devint complètement aveugle, et sourde. Dans cet état, il lui était difficile de se tenir au courant du mouvement des arts et de la littérature. Elle ne l’avouait pas. Elle se persuada que si elle ne connaissait parmi les nouveautés aucune œuvre qui retînt son attention, c’est qu’il ne s’en produisait pas.
— N’est-ce pas, mon enfant, me disait-elle, n’est-ce pas… il n’y a plus rien ? Connais-tu un poète comparable à ceux de mon temps ?… un musicien ?… un romancier ? Il n’y a plus rien !…
Je n’avais pas la cruauté de la contredire. À quoi bon ? Ne valait-il pas mieux lui laisser son illusion ?
Elle approchait de quatre-vingt-onze ans lorsqu’elle s’éteignit dans la maison de retraite où s’écoulèrent ses dernières années. Elle mourut le 6 juillet 1906. Qui était-elle ?
Je ne l’appris que par bribes. Elle était née à Paris, rue Favart, en janvier 1816. De son nom de jeune fille, elle s’appelait Antoinette Lambert ; on romantisa son prénom en celui d’Antonia lorsqu’elle se produisit en public. On connaissait son père comme harpiste et compositeur. Elle acquit rapide ment dans les salons une réputation de cantatrice. Dès 1834, Isabelle Chopin écrivait à son frère : « Oh ! Mon cher Fritz, j’apprends des études et le premier solo du concerto, qu’en dis-tu ? C’est trop de hardiesse, pas vrai ? Mais c’est dans l’espoir qu’il m’arrivera la même chose qu’à Mlle Lambert, à laquelle, en récompense, tu as joué ton concerto, ou que tu as écoutée. » Sophie Gay et Mme Émile de Girardin la prennent en affection. Elle n’a que dix neuf ans, et déjà le Mercure de France, dans son numéro du 15 avril 1835, citant les célébrités et les attractions du salon de ses protectrices, disait d’elle : « Tantôt c’est Mlle Lambert, jeune fille belle et poétique, qui charme ces soirées par une des voix les plus délicieuses et les plus expressives que l’on puisse entendre, et qui convient merveilleusement aux romances de M. Labarre. » L’année suivante, le comte Rodolphe Apponyi l’entend à une soirée donnée le 17 mars chez Mme de Girardin, où il cite la présence d’Alfred de Musset, d’Alphonse de Lamartine, de Balzac, de Hugo, de Jules Janin, d’Émile Deschamps, d’Alexandre Dumas, de Jules de Rességuier. La maîtresse de la maison, puis Lamartine, disent des vers. Antonia Lambert chante à son tour : « Plusieurs de ces romances ont été composées par Mlle Lambert, charmante jeune personne remplie de talent, et qui chante d’une manière inimitable. » Le mois suivant, le 3 avril, le comte Apponyi l’entend à nouveau à une représentation du fameux théâtre Castellane, qui venait de s’ouvrir, et où Sophie Gay fut longtemps une autorité. On joue Michel et Christine, et, dit Apponyi, « Mlle Antonia Lambert nous a charmés et enchantés par sa manière ravissante de chanter et de jouer, par son air doux, sa charmante figure ».
Mme de Girardin elle-même, dans ce roman d’une amusante fantaisie qu’elle intitula la Canne de Monsieur de Balsac, nous la montre dans tout l’éclat de sa jeunesse et de son talent. La figure de la jeune artiste apparaît singulièrement séduisante. « Savez vous à qui Clarisse ressemblait ? Connaissez-vous Mlle Antonia Lambert, cette jeune personne dont la voix est si belle, qui chante avec inspiration, comme on voudrait dire les vers ? Eh bien ! c’est elle qui peut seule donner l’idée de Clarisse. Comme elle, Clarisse était grande et svelte ; elle avait les mêmes yeux, les mêmes cheveux blonds, le même doux sourire, le même gracieux maintien, et dans les manières, ce mélange de confiance et de modestie, que donne l’union d’une extrême jeunesse et d’un grand talent. »
On ne s’étonne pas que le vin de la flatterie l’ait quelque peu grisée, ni qu’elle éprouvât quelque amertume, sur ses vieux jours, à comparer sa situation présente au souvenir des hommages que lui rendait une foule d’adorateurs, composée de ce que la société parisienne comprenait de plus élégant, de plus brillant, de plus illustre.
Elle me conta que Mme de Girardin voulut la marier à Scribe, parvenu au comble de la réputation, et fort riche : elle le trouva trop vieux, trop laid. Elle lui préféra le jeune et beau Théodore Labarre, dont elle interprétait les œuvres, avec qui elle chantait des duos, et que souvent elle inspirait. Une fort belle lithographie de H. Grévedon nous prouve que la jeune fille avait bon goût. Labarre était aussi un familier des salons de Sophie Gay et de Mme de Girardin. Dans un album de romances qu’en 1836 il publia, et dont il fit magnifiquement relier un exemplaire pour Sophie Gay, il inscrivit ce nom en tête de la Fille d’Otaïti, dont les paroles sont de Victor Hugo, et le nom de Delphine en tête du Naufragé, dont les paroles sont de A. Bétourné. L’une des romances de l’album, Mathilde, a pour auteur Mme de Girardin elle-même, qui, dans son Courrier de Paris, fait à maintes reprises l’éloge du compositeur.
Il était élève de Cousineau, de Bachsa et de Naderman qui fut professeur de chant de Mme Récamier. Harpiste de grand talent, il connut une vogue immense en France et en Angleterre, fit jouer des ballets, des drames lyriques, des opéras comiques ; parmi tant de romances sentimentales que la fraîche voix et le jeune talent de la belle Antonia Lambert faisaient valoir, sa Jeune fille aux yeux noirs et Viens dans ma nacelle firent fureur ; l’écho de leur succès retentit jusqu’à nous. Il fut directeur de l’Opéra-Comique et maître de chapelle de Napoléon III.
« Il ne la rendit pas heureuse », me disait-on. Cela signifiait évidemment qu’il la trompait, et qu’elle en souffrit. Je ne pus jamais en savoir davantage sur ce chapitre.
Un jour, allant donner une série de concerts à Londres, elle traversa Boulogne. Au retour, elle s’y arrêta, et s’y fixa. Elle devint veuve à peu près en même temps, et donna des leçons pour vivre. D’emblée, elle obtint la meilleure clientèle de la ville.
Je dus de la connaître à cet ensemble de circonstances. Tout enfant, j’éprouvai pour elle une vive affection. Mais je ne l’appréciai vraiment que vers ma quinzième année. Alors, je perçus quelques lueurs sur son passé. Du jour où je sus qu’elle avait fréquenté chez Mme de Girardin les hommes mêmes auxquels allait mon culte, je ne taris plus de questions. Malheureusement les femmes, surtout jeunes et jolies, ont une manière de juger les autres femmes, et les hommes, qui n’a rien de commun avec la rigueur critique d’une méthode strictement scientifique.
Sur les femmes, Mlle Labarre ne posait jamais qu’une question : « Est-elle jolie ? »
Il lui arriva même de le demander à propos d’une négresse, sur qui la conversation s’égara.
Quant aux hommes, je démêlai qu’elle leur mesurait son estime à l’attention qu’ils accordaient à ses charmes et à son talent. Elle était trop intelligente pour ne pas apprécier leur valeur, le cas échéant, mais alors la sympathie manquait, et l’enthousiasme. Je l’interrogeai d’abord sur Victor Hugo. Elle ne sut m’en dire autre chose sinon qu’il était brutal et peu sociable. Il avait dédaigné de lui adresser la parole, et préférait la conversation des hommes.
Elle éprouvait pour Alfred de Musset une sorte de tendresse indulgente. Elle me le décrivait physiquement pas très grand, le dos large et un peu voûté, la redingote pincée à la taille, la démarche élégante et désinvolte.
— Tiens ! disait-elle, il ressemblait exactement comme allure à M. G. P.
Je compris, lorsque je vis le portrait aux deux crayons de Franck Lamy : ses commentaires me permirent de l’interpréter, et maintenant, grâce à elle, je suis sûr que je me fais de l’aspect physique du poète une image bien proche de la vérité. Je recueillis d’elle cette anecdote, assez pénible : un soir, après le spectacle, Musset conduisit Rachel en voiture chez Mme de Girardin. Il avait bu. En route, il en éprouva l’inconvénient, et la robe de la tragédienne en supporta les conséquences. Cruellement, elle déclara, montrant sa robe :
— Je vous apporte la dernière production de notre grand poète, Alfred de Musset.
Cette autre rachète la précédente : dans un salon, Hugo, Lamartine et Musset sont réunis ; un domestique présente un billet sur un plateau. L’adresse porte : « Au plus grand poète français contemporain. » Hugo et Lamartine étendent simultanément la main ; bien entendu, Hugo s’empare du billet. Il le décachète, et lit : « Mon cher Alfred… »
Mlle Labarre ne partageait pas cette opinion. Son grand homme, son héros, son dieu, c’était Lamartine. Elle disait « Hugo », et « Alfred de Musset », mais elle articulait : « Monsieur de Lamartine ».
« Monsieur de Lamartine » était charmant, distingué, grand seigneur, et d’une politesse raffinée. Lorsqu’il lui fut présenté, il lui tourna galamment un compliment dont les termes lui demeuraient présents à la mémoire. Elle les répétait avec complaisance. Je regrette de n’avoir pas noté cette phrase assez banale, mais à chaque mot de laquelle l’intéressée attribuait la plénitude de sa signification et de sa portée. Elle savait ses vers par cœur. Sur un exemplaire des Méditations dont il lui fit hommage, le poète, de son écriture aristocratique, inscrivit une strophe. Elle conservait pieusement ce petit livre.
Elle me parlait encore de Berlioz à l’ironie mordante, à la dent dure ; de Rossini, dont elle raffolait et chantait la musique avec passion ; de Wagner, qu’elle abominait en tant qu’Allemand et dont elle détestait la musique. Je me rappelle sa fureur, un jour qu’une de ses élèves lui chanta la romance de l’Étoile sans en nommer l’auteur. Mme Labarre se récria d’admiration, mais entra dans une violente colère en apprenant qu’il s’agissait d’un fragment du Tannhäuser.
Elle me nommait Mme Pasta, Rachel ; elle riait
encore au souvenir d’Arnal. Mon imagination s’exal tait à ces entretiens sur un passé dont je subissais l’émerveillement. Sans doute, ma vieille amie éprouvait un plaisir mélancolique à revenir sur cette période brillante de son existence ; elle s’attardait volontiers à nos causeries. Ma verve poétique s’en inspira. J’écrivis un sonnet, ou quelque chose d’approchant. J’évoquais les grands poètes du romantisme ; je commençais et finissais par ce vers :
Ces hommes demi-dieux vous les avez connus !
Lorsque j’eus terminé ma lecture, Mme Labarre fondit en larmes. J’en fus bouleversé. Je protestai que je n’avais pas précisément visé un pareil résultat. Elle sourit à travers ses larmes, et m’embrassa en me disant tout le plaisir que je venais de lui procurer.
Son portrait serait incomplet si je n’ajoutais combien elle aimait à admirer, si je ne soulignais la franchise de son rire, et la finesse avec laquelle elle contait des anecdotes parfois scabreuses. Un jour où un de mes amis avait plaisanté devant elle à tort et à travers, elle le considéra d’un œil curieux, et dit, comme se parlant à elle-même :
— Ce Jacques !… Ce qu’il doit être amusant dans l’intimité !…
Sur le moment, je ne saisis pas la portée de cette réflexion d’apparence inoffensive. Plus tard, je compris. Mme Labarre s’apparentait à ces femmes délicieuses que furent nos grand’mères du siècle poudré, dont l’esprit, autant que la compétence en amour, demeurent indiscutables.
On devine l’aliment fourni à mon imagination par cette femme exceptionnelle, qui avait approché les hommes dont je faisais mes idoles. Je n’étais pas exempt de cette curiosité qui pousse tant de lecteurs à savoir comment sont faits leurs auteurs préférés, et leur manière de se comporter dans l’ordinaire de l’existence. La mienne recevait satisfaction, dans la mesure où elle n’avait à craindre aucune désillusion. Certainement, Mme Labarre m’apportait un reflet de ce que fut Mme de Girardin, un peu de l’air qui flottait autour d’elle. Elle en subit l’influence, elle l’admira, elle l’aima, elle la prit pour modèle. Elle partagea ses goûts en littérature et en art. Elle s’enthousiasma pour les mêmes génies. Sa beauté blonde supporta sans faiblir le voisinage de la tenture vert clair, redoutable aux teints de brunes, du salon où brilla la beauté blonde de Delphine.
Et peut-être, dans les correspondances où l’encre a pâli sur les papiers jaunis, dans les mémoires où le jeu des passions personnelles et celui des intérêts ont pu mettre un masque au visage de la Vérité, dans les colonnes des journaux où les contemporains ont hâtivement jeté des notations d’actualité, des allusions dont nous ne pénétrons le sens qu’à grand renfort d’érudition, peut-être les conversations de ma vieille amie m’auront-elles permis de retrouver, plus vivantes, les figures attirantes de ces fantômes évanouis, dont à près d’un siècle de distance le charme ne cesse de nous subjuguer.
I
Le sixième jour du mois de pluviôse, l’an XII de la République française, c’est-à-dire le 26 janvier 1804, un peu avant onze heures du matin, trois hommes sortaient de la maison qu’occupait, rue Saint Adalbert, à Aix-la-Chapelle, le receveur général du département de la Roër. L’un d’eux était M. le Receveur général lui-même, Jean-Sigismond Gay, un grand et solide gaillard de trente-six ans ; le col de son habit à boutons de métal lui montait à la hauteur des oreilles ; de grands revers largement décolletés découvraient son gilet blanc ; la cravate blanche engonçait le cou, non moins que le faux-col aux cornes rigides, entre lesquelles un créneau dégageait le nez et la bouche. Cette bouche était singulièrement fine, le nez bien dessiné ; deux grands yeux bleus éclairaient le visage, encadré par les boucles des cheveux ramenés en avant, et par les nageoires alors à la mode. Cette physionomie éveillait la sympathie et décelait la bonté[1].
Les deux autres personnages étaient deux sous-ordres du receveur général : le premier, Marc Antoine-Camille Raffaneau, employé à la recette générale ; le second, Claude Harent, receveur particulier de l’arrondissement d’Aix-la-Chapelle. Et tous les trois se dirigeaient vers l’hôtel de ville. Ils y déclarèrent la venue au monde, la veille, 5 pluviôse, à la même heure, d’un enfant dont le sexe « a été reconnu être femelle », dit peu galamment l’acte qu’ils contresignèrent. Le père était Sigismond Gay, la mère, sa femme, née Marie-Françoise Sophie Nichault de La Valette. Leur fille recevait de sa marraine, Delphine, marquise de Custine, les prénoms de Delphine-Gabrielle[2].
Comme la rue Saint-Adalbert se trouvait sur la paroisse de l’église Notre-Dame, l’enfant fut portée sur les fonts baptismaux de la vieille basilique impériale. Le souvenir du grand empereur d’Occident y planait toujours. Une énorme pierre portant l’inscription : Carolo magno, recouvrait le caveau qui contint sa dépouille. Un grand lustre en cuivre doré, donné par l’empereur Frédéric Ier, dominait la dalle. Là était le siège de marbre sur lequel Charlemagne avait été couronné, et sur lequel on le découvrit assis, lorsque Othon III ouvrit son tombeau.
Ce qui suggéra à Sainte-Beuve ce rapprochement piquant : « Ne voyez-vous pas déjà d’ici le siècle en perspective, avec sa prétention grandiose d’une part, et sa vocation positive de l’autre : le tombeau de Charlemagne pour décoration et fond de théâtre, et une caisse de receveur général tout à côté ?[3]».
Dans les limites du vieux palais impérial se tassaient les maisons en brique et pierre bleue de la vieille ville, la ville intérieure, toujours nantie de ses portes, de ses murailles, de ses fossés. Une autre ville, extérieure, l’entourait complètement, et tendait à se développer. Depuis une quinzaine d’années qu’avait débuté la Révolution française, Aix-la-Chapelle avait éprouvé le contre-coup des grands événements qui se déroulaient de par le monde. Bondée d’émigrés en 1793, elle vit passer la princesse de Lamballe qui se dissimulait sous le nom de comtesse d’Amboise, mais que désignaient clairement ses trois dames, la marquise de Lage, la marquise de Las Cases et Mme de Ginestous[4]. Puis ce furent les mouvements de troupes, l’avance des armées républicaines, jusqu’au jour récent où le Premier Consul fixa la ville en qualité de chef-lieu dans le cadre administratif du département de la Roër. La mode allait en faire une station thermale réputée. Des Français, des étrangers de marque y affluèrent. La femme du receveur général dépensait royalement jusqu’au dernier centime les cent mille francs que rapportait annuellement le poste de son mari. Elle était jeune, jolie, pétrie d’esprit. Ses réceptions obtinrent un tel succès que les baigneurs de Spa venaient à Aix pour y assister.
En dépit de sa jeunesse, elle avait déjà une histoire. Naguère encore, elle figurait au peloton de tête de l’escadron des plus belles femmes du Directoire, et elle publiait des romans[5].
Son père, Augustin-François Nichault de La Valette[6], financier de profession, était attaché à la maison de Monsieur ; il mourut fonctionnaire des domaines nationaux. Il épousa une femme d’une rare beauté, une Lyonnaise d’origine florentine, Antoinette-Françoise Péretti, de l’illustre famille qui donna un pape à la chrétienté. Ils eurent entre autres enfants une fille, Marie-Françoise-Sophie, née le 1er juillet 1776.
Ami des philosophes, enthousiaste de leurs principes, le financier apprend à sa fille, — elle s’en targuera plus tard, — à juger du motif qui conduit leur plume ; il les lui montre bravant toutes les puissances « pour chercher la vérité et frapper de sa lumière ceux qui s’obstinent à la méconnaître[7] ». Et, pour commencer, il la porte, bébé de deux ans, au triomphateur d’Irène. Est-ce le baiser de Voltaire qui lui donnera cet esprit endiablé dont elle ne se départira pas de toute son existence ? Dès sa première communion, elle lance un de ces mots, qui, suivant l’expression de la comtesse Merlin, ont fait de sa vie un véritable feu d’artifice : la robe longue et traînante qu’elle met pour la première fois embarrasse sa marche ; elle se retourne souvent pour la jeter en arrière ; une de ses compagnes, agacée de ce manège, dit :
— Cette Sophie est ennuyeuse avec sa tête et sa queue.
— Toi, ça ne te gênera pas, car tu n’as ni queue, ni tête[8].
Ce début promet, et la promesse sera tenue.
Sophie, à cette époque héritière bien née et bien apparentée, — elle cousine avec les Blottefière de La Viéville — est élevée dans une aristocratique pension. Elle a pour camarades des petites filles qui deviendront de grandes dames. Celle-ci, on la remarque déjà, montre une tête de Bretonne, des yeux bruns, des cheveux noirs, une taille courte ; l’ensemble du visage, que distinguent une bouche petite, un nez bien fait et un front très grand, annonce l’intelligence et la volonté. Claire-Louise Anne de Kersaint, dont le père montera sur l’échafaud, sera une des personnalités les plus en vue du monde parisien sous la Restauration, sous le nom de duchesse de Duras[9]. Théophile Gautier, qui s’y connaissait en poésie, qualifie la maîtresse de cette pension, Mme Leprince de Beaumont, de « poète de la Belle et la Bête, du Prince charmant, du Magasin des Enfants ». Ayons la sagesse de l’en croire sur parole[10]. Sophie de La Valette reçoit de cette poétesse une solide instruction, que le chevalier de Boufflers et le vicomte de Ségur complètent heureusement par des leçons de littérature et surtout de goût. Parmi les familiers de son père, elle voit encore Vergennes et Alexandre de Lameth.
Elle monte à cheval, et devient une écuyère consommée ; elle joue au billard, elle danse dans la perfection[11]. Ses parents aiment les arts et se passionnent pour la musique : un beau jour, sa mère lui découvre une voix et des dispositions musicales. On décide de lui donner des maîtres. Or son père, picciniste fervent, choisit l’Impérani, célèbre professeur italien qui a horreur de Glück ; sa mère, de goût radicalement opposé, la confie à Richer, qui a l’honneur d’enseigner la reine. Quand son père est absent, la jeune fille s’enroue à chanter Alceste, dont les notes élevées et soutenues la fatiguent. Mais son père a rencontré Piccini ; il le ramène dîner ; après le repas, Sophie ne peut évi ter de chanter les grands airs de Didon. Il lui faut inventer un prétexte pour expliquer la faiblesse de sa voix, son manque de respiration : pour rien au monde elle n’en avouerait la véritable cause, et sa mère lui lance un regard chargé de reconnaissance[12]. Candeille et Méhul lui apprennent la composition. Pour le piano, le vicomte de Ségur découvre l’oiseau rare qui le lui enseignera : un jeune Allemand, Steibelt, que ses excentricités ont mis fort à la mode, et que la haute société accueille à bras ouverts. Malheureusement, parfois Steibelt exagère. Un soir, chez Mme de Brisay, pris d’un caprice, il refuse de jouer ; le comte de Goltz, ambassadeur de Prusse, lui dit :
— Jouez tout de suite, monsieur, je vous l’ordonne.
Steibelt obéit sans barguigner. Le comte de Goltz peut le perdre, le sachant fugitif contumace de Berlin, où les juges, qui s’y trouvaient en ce temps-là, l’ont condamné pour vol. Et cette vocation étant en lui aussi forte que la vocation musicale, il vole le vicomte de Ségur, il vole son ami de Norvins, d’autres encore, et file à Londres, où il recommence ses exploits, et où on le jette en prison[13].
Il a cependant fait de Sophie de La Valette une excellente pianiste.
À quinze ans, la voici donc douée de talents remarquables, de qualités multiples que son aspect ne dément pas : jolie brune piquante, ses yeux lancent des regards pleins de feu, plus faits pour exprimer l’ardeur ou la malice que la tendresse ; sa taille souple, charmante, demeurera jusqu’à la fin « une taille et une tournure bien françaises »[14].
La Révolution ruine son père, la Révolution qui détruit tant de choses ! Cependant des habitudes, et non toujours des plus heureuses, échappent à son action : telle, dans la haute société, la mode des mariages de convenance, des mariages mal assortis. On continue à demander à un mari une fortune, un nom et un rang convenables, qui le font supporter jusqu’au jour où l’on s’aperçoit qu’il est insupportable. Alors le ménage ne va pas[15]. Sophie de La Valette va connaître cette triste expérience.
Son père compte parmi les relations de son milieu professionnel, un agent de change, dont le revenu atteint une bonne cinquantaine de mille livres : Gaspard Liottier, fils de Jean Liottier, maitre sculpteur, et de Marie-Marguerite de Ligny, elle-même fille de Jean de Ligny, sculpteur ; Marie-Marguerite de Ligny, devenue veuve, épousera en secondes noces un autre sculpteur, Gilles-Paul Cauvet. Elle avait de la suite dans les idées. Pourquoi n’a-t-elle pas fait de ses fils deux sculpteurs ? Sans doute Gaspard, le second, né le 7 septembre 1756, n’aurait-il pas gagné dans la carrière artistique la fortune qui lui advint dans la carrière financière. Avec ses cinquante mille livres de revenu, il est riche. Voilà un excellent parti pour Sophie de La Valette, ex-héritière devenue pauvre. En vérité, son futur mari a une vingtaine d’années de plus qu’elle : maigre inconvénient en regard de ses avantages pécuniaires. Amoureux, il ne laisse pas encore percer un caractère difficile. Et le 1er octobre 1791, en l’église Saint-Eustache, il conduit à l’autel la jeune fille âgée de quinze ans et trois mois, qui va devenir sa femme. Elle lui donnera trois filles : Aglaé, née le 6 décembre 1793, en pleine Terreur ; Euphémie, née le 21 septembre 1795 ; Emma-Sophie, née le 2 avril 1798, et morte en bas âge[16]. À défaut d’actes de l’état civil, ces prénoms harmonieux suffiraient à dater les personnages qui les portent. Lorsque Aglaé et Euphémie viennent au monde, on ne peut songer à les faire baptiser ; il faut attendre pour cela des temps meilleurs : la cérémonie est retardée jusqu’au 21 novembre 1798 ; on la célèbre dans un petit village du diocèse de Versailles, à Saint-Martin-de-Sevran, près Livry ; les deux baptêmes ont lieu en même temps. Sevran était la paroisse à laquelle ressortissait Fontenay-le-Bel, où les Liottier avaient leur maison de campagne.
Peu après la naissance de sa première fille, le 29 du même mois de décembre 1793, Sophie Liottier perd sa mère, âgée seulement de quarante-neuf ans, et succombant à un cancer. C’est son premier deuil. Il se mêle à tant d’autres qui alors oppressent la société française. Quelles inquiétudes tenaillent la jeune femme ! Un frère en prison, son cousin Blottefière de Viéville à l’armée de Condé, elle-même figurant sur la liste des suspects[17] ! Par bonheur, elle et les siens doublent sans autre malencontre le cap dangereux. Le 9 thermidor permet à tous de respirer, de se reprendre à vivre. On se rue au plaisir. C’est « un bruit, un mouvement perpétuel, un besoin de mettre à l’abri chacun de ses jours, comme autant de vols faits à la Parque révolutionnaire, et qu’elle pourrait bien réclamer au premier signal »[18]. Cinquante-six ans plus tard, elle se rappelle ce temps de folies[19]. « On ne saurait donner une idée de ce délire joyeux succédant à toutes les angoisses de la peur et aux cris du désespoir. Chacun semblait avoir obtenu un congé de la mort qu’il fallait employer le plus gaiement possible ; l’absence de toute vanité servait merveilleusement ce projet. Les tortures dont on sortait ne rendaient pas difficiles en plaisirs, et l’on s’amusait tout bonnement pour s’amuser, se cotisant pour subvenir aux frais d’un bal que nul n’était assez riche pour donner, où les femmes dansaient en robe de mousseline unie, n’ayant pour ceinture qu’une corde de laine, et les hommes en pantalon de nankin, sorte d’innovation alors très hardie, qui donnait à ces réunions un air de bal champêtre et en excluait tout cérémonial. En ce temps-là, la danse comptait encore parmi les arts ; ce n’était pas comme aujourd’hui le triste talent de frotter un salon en mesure. Il fallait avoir travaillé en conscience la manière de mettre les pieds en dehors, d’imiter les pas les plus gracieux sans tomber dans le ridicule d’une danse théâtrale. Et ce talent, fruit d’un bon goût et d’une exquise délicatesse, jamais femme du monde ne l’a poussé aussi loin que Mme Hamelin. »
Mme Hamelin ! on la dit créole en dépit d’une légère infiltration de sang noir. Presque laide, très brune de teint, les lèvres rouges, les dents blanches et pointues, les cils longs, les regards brûlants, les cheveux noirs magnifiques, une taille de nymphe, des mains et des pieds d’enfant. Un fort parfum d’eau de rose la précède et l’annonce. Elle lance des mots d’esprit comme des éclairs. Elle danse avec une grâce extraordinaire. « Il n’y a qu’elle qui sache me comprendre », sussurre Trénitz. Elle triomphe dans la danse du châle ; elle triomphe à l’hôtel de Longueville où l’on monte sur les banquettes pour la voir danser, où trente cercles de contredanse à seize roulent sous l’archet de Hullin, où trois cents femmes parfumées, vêtues de gaze et « déshabillées en Vénus » virent et voltent aux bras de vigoureux danseurs. La folie de la danse fait tourbillonner Paris ; on y compte six cent soixante-quatre bals, et l’on danse à l’Opéra les Maximes de La Rochefoucauld[20].
Sophie Liottier prend largement sa part de ces plaisirs. Elle connaît les bals de l’hôtel de Thélusson et de l’hôtel de Longueville, elle connaît le bal des Victimes, elle connaît l’admiration des spectateurs qui montent sur les banquettes pour mieux admirer la grâce de ses gestes et la souplesse de ses pas.
La simplicité du début ne dure pas. L’agio, un agio formidable, se donne furieusement carrière, depuis les magnats de la haute finance, les Perregaux, les Ouvrard, les Hamelin, les Hainguerlot et autres, jusqu’aux hommes du Palais-Égalité, qui font le troc des montres, des bagues et des objets les plus hétéroclites, et que surveille la police[21]. Des fortunes immenses s’élèvent. On n’a plus besoin de se cotiser pour donner un bal. Les folies prennent un autre cours. La Chaussée d’Antin se peuple de millionnaires, et la somptuosité de l’hôtel de Mme Récamier défraye la chronique. Mme Tallien se montre un soir la gorge enserrée dans une rivière de diamants. Par son mari, Sophie Liottier appartient à ce monde de la finance, et la voilà au premier rang des Merveilleuses. Elle aussi court s’approvisionner de parfums dans cette rue Montorgueil, « où l’air est de roses et le vent une haleine de tubéreuse », au fameux magasin de Provence et d’Italie. Elle achète chez Erambert ses éponges de Venise et chez Garnier la célèbre eau de Pigeon qui rafraîchit le teint. Ses comptes de fournisseurs diraient sans doute combien elle avait de perruques, ces perruques poudrées de jaune, poudrées de bleu, qui un moment font fureur. En ce temps de guillotinades, les chevelures de femmes ne manquaient pas dans le commerce. Mme Tallien en possède trente à vingt-cinq louis pièce, Mlle Lange tout autant, et Mme Hamelin dix de plus, chefs d’œuvre de Dumas, de Rey, de Duplan.
Sophie Liottier suit les concerts du théâtre Feydeau, ouverts en 1795, où Garat enthousiasme son public, et chante des romances cotées deux livres la syllabe[22]. Elle rit aux mystifications de Musson, rapin mué en Lemice-Terrieux, qui égaie ses contemporains jusqu’à ce qu’un timon de voiture l’écrase sous la porte cochère de l’hôtel des Hainguerlot, où on l’attendait pour quelque farce mirifique. Elle assiste aux séances de la Convention, puis du Conseil des Cinq-Cents ; elle en saisit les ridicules, et les note. Elle assiste en bonne place à la cérémonie du retour des drapeaux d’Italie, et aux réceptions du Directoire.
Les plus spirituelles, les plus belles, les plus élégantes parmi les Merveilleuses ouvrent leurs salons. Autour de ces déesses, la société française se reforme. Elle y tend naturellement. Ses meilleures traditions ne se sont pas perdues. La Révolution, « si féroce chez le peuple, si burlesque chez les parvenus », n’altère en rien la politesse exquise, le respect des vieux usages qui distinguent les gens « comme il faut ». Le bon ton devient le signe distinctif d’une franc-maçonnerie grâce à laquelle les grands seigneurs en carmagnole se reconnaissent. Le besoin d’oublier les dangers courus, les tourments soufferts, est un puissant conciliateur. Les gens les plus opposés d’opinions, d’intérêts, d’habitudes, se réunissent avec empressement, se supportent sans impatience. Mais après la pauvreté générale du début, qui égalisait tout, la fortune des parvenus devient un motif de combats ridicules entre l’orgueil féodal et la vanité financière. Ceux que la Révolution a ruinés rient aux dépens des nouveaux riches, aussi honteux de leur origine que fiers de leur argent. « Ainsi s’établit entre eux une sorte de commerce dont les bénéfices sont assez également partagés. Le parvenu veut briller, donner de grands repas, des fêtes, car que faire en un palais à moins que l’on n’y danse ? L’ancien propriétaire veut se divertir, et se parer encore aux yeux du monde des avantages qu’une éducation distinguée et des manières élégantes lui donnent sur l’ignorance et la grossièreté de ces Turcarets nouveaux. Ainsi l’un paie le festin dont l’autre fait l’agrément, et la gaieté gagne beaucoup à ce marché, car chacun sait que l’esprit ne s’amuse jamais mieux qu’aux dépens de la sottise[23] ».
Tandis que dans la société nouvelle la langue parlée a évolué et que l’orthographe se modifie, les hommes de cinquante ans de l’ancienne cour gardent leur prononciation. Ils disent Mahame, Mon cher aux hommes, il est maladret, il a crevé un geval pour vous aller voir. L’exil n’a pas fait tomber la poudre de la perruque des émigrés, qui arborent l’énorme cravate verte à la mode des Chouans. Les Incroyables, en habit bleu et pantalon jaune montant, zézaient avec une grâce affectée leur parler enfantin qui omet les r. Par contre, « les femmes ont des voix de crieuses de chapeaux » ; cette voix forte, ce parler bruyant, Sophie Liottier les conservera toute sa vie, et les salons de la Restauration le lui reprocheront âprement[24].
Mme Hamelin, parente de Mme Regnault de Saint-Jean-d’Angély, intime de Mmes Tallien, Junot, Fonfrède, très liée ensuite avec Hortense Allart, se montre en rivalité avec Mme Récamier. Elle mène de front ses amours avec Montrond, « la bouche de Talleyrand », et le beau Fournier-Sarlovèze, « le plus mauvais sujet de l’armée », ce qui lui vaut, à elle, d’être appelée « le plus grand polisson de France ». En attendant de se séparer de son mari et de demander des subsides à la Police, elle s’entoure de demi-patriotes, résignés à entendre leurs grands noms précédés du titre de citoyens. Mme de Staël, retour d’exil, sans souci des opinions politiques, s’attache à recruter les hommes de mérite, et l’on appelle son salon l’hôpital des partis vaincus. Émigrés, républicains, ambassadeurs, journalistes, généraux patriotes et officiers vendéens s’y coudoient. « Les royalistes, les républicains jouent ensemble sans s’aimer, sans se craindre, comme joueraient de pauvres chiens édentés avec des chats sans griffes. » Mme de Staël réserve ses mots les plus piquants pour ses anciens amis, et les questions flatteuses, les saillies brillantes pour les nouveaux élus.
— Pour vous, demande-t-elle à Théodore de Lameth, j’en suis certaine, vous n’aimez pas Brutus.
— Lequel, madame ? Celui qui a tué son fils, ou celui qui a tué son père[25] ?
Le ménage Liottier a transféré ses pénates du numéro 24 de la rue du Sentier en 1793, au 540 de la rue de Gramont en 1795, et au 342 de la rue Basse-du-Rempart en 1798. La jeune femme a ouvert son salon. Les relations de son mari dans le monde de la finance, et les siennes, lui permettent d’y grouper déjà des personnalités intéressantes. Mais ce salon n’a rien de politique ; s’il se teinte légèrement de littérature, il est avant tout voué à la musique. La maîtresse de la maison, excellente musicienne, se fait entendre dans des romances de sa composition ; elle déploie son double talent de cantatrice et de pianiste. Les plus illustres chanteurs et exécutants se font entendre chez elle : Laïs, Viotti, d’Alvimare, ancien garde du corps devenu harpiste et compositeur, que, sans craindre l’hyper bole, certains comparent à Orphée, et Garat qui, lorsqu’il la rencontrera dans un salon, voire dans une salle de concert, ne voudra chanter qu’accompagné par elle. Le compositeur Blangini, qui se glorifiera plus tard de ses amours avec Pauline Bonaparte, et dont les nocturnes, les opéras, connaissent déjà une grande vogue, évoque le souvenir de ce milieu où il rencontrait l’élite des gens d’esprit, des hommes de lettres et des artistes. La plus aimable bienveillance y accueille tous les talents, et il note « le charme inexprimable de la maîtresse de la maison »[26].
Elle entre en relations avec les personnages les plus importants de la société du Directoire. Son mari connaît Fonfrède, riche financier de Bordeaux. Mme Fonfrède donne un grand dîner en l’honneur de la reine du Directoire, l’ex-Mme de Fontenay, mariée depuis peu à Tallien ; Sophie Liottier y est conviée. Lorsqu’elle fait son entrée, elle voit Mme Tallien assise à côté de Mme Bonaparte. Elle a connu dans son enfance le belle Thérésia, mais n’ose le lui rappeler. Thérésia la surprend agréable ment en l’abordant avec sa grâce habituelle, et en lui proposant sa protection pour ceux des siens que la Révolution a étrillés. Elle la présente à Mme Bonaparte, qui se laisse encore appeler Mme Beauharnais avec une certaine complaisance. Parmi les autres convives, la pétulante Mme Hamelin parle de l’ancien régime avec le vicomte de Ségur, de chevaux avec Ouvrard, et de danse avec Trénitz.
Il ne manque plus que le général Bonaparte. Sa femme supplie qu’on ne l’attende pas.
— Il est sans doute retenu au Directoire pour affaire importante, et il serait désolé de vous faire manger un dîner réchauffé.
On lui obéit. Peu après, l’entrée du général ne produit pas plus d’effet que son absence. Il adresse quelques mots d’excuse à Mme Fonfrède qui ne répond pas ; Fonfrède lui envoie un petit salut de la main, et Mme Tallien un sourire. Seule, Mme Hamelin, l’esprit toujours sur le qui-vive, lui lance d’un bout de la table à l’autre :
— On voit assez que l’on ne se bat pas ici, général, car vous vous y faites bien attendre.
Il ne peut s’empêcher de sourire. Personne ne s’en occupe plus. À un coin de table, la conversation s’engage sur la nouvelle coiffure à cheveux courts de Mme Tallien. Mme Tallien a des amis et, sinon des ennemis, au moins des malveillants. Parmi les premiers figure ce Valmaléta qui lui dédie une poésie dans le Journal de Paris et déclare :
Doit-on être surpris si tout le monde l’aime ?
Tout le monde lui doit la vie et le bonheur.
Les seconds l’appellent l’Aspasie moderne, ou la sœur du Pot de la Révolution, parce qu’elle en soigna les malades.
— C’est dommage qu’une aussi belle femme soit à moitié chauve, dit un malveillant.
— Vous ignorez donc l’emploi qu’elle a fait de ses longs cheveux ? riposte Mme Hamelin. Vous lui devez probablement votre tête. Si, nattés en cordon les uns au bout des autres et pouvant ainsi passer par les barreaux d’une prison, ils n’avaient servi à transmettre à Tallien les lettres par lesquelles Mme de Fontenay lui demandait notre délivrance, Dieu sait ce que nous serions aujourd’hui ! Quant à moi, l’idée de ce que nous lui devons me fait trouver cette coiffure ravissante, et je prédis qu’avant un mois elle sera celle de toutes nos jolies femmes.
La mode de la Titus lui donnera raison. Assis à côté de Sophie Liottier, l’ex-marquis de Livry a observé attentivement Bonaparte, et dit à sa voisine :
— Ce jeune homme est pourtant amoureux de cette femme qui a six ans de plus que lui, ce qui, en style créole, équivaut au moins à douze, car dans nos colonies les femmes sont vieilles à trente-quatre ans.
— Je ne m’étonne pas qu’il en soit amoureux, elle est encore fort agréable.
— Ah ! ce qu’elle a de mieux, c’est son ascendant sur Barras.
Et le marquis de conter l’inconstance et la jalousie du vicomte de Beauharnais, dont sa femme souffrit : ce qui ne l’empêcha pas de le pleurer abondamment lorsqu’il passa de vie à trépas.
— Voilà bien les femmes : elles n’aiment et ne regrettent que ceux qui les tyrannisent.
— Cela n’est pas rassurant pour son nouveau mari, car il semble lui être bien soumis.
— Avec ce front et ce profil, on n’est soumis à personne. J’ai étudié Lavater, et, s’il faut l’en croire, ce petit gaillard-là ne doit pas être facile à mener.
Pendant ce dialogue à mi-voix, la gaîté de Mme Hamelin anime le dîner. Bonaparte reste silencieux. Au sortir de table, on passe dans un salon abondamment fleuri de jonquilles, de jacinthes, d’héliotropes. Mme Bonaparte se trouve mal ; on en accuse les fleurs. Mme Tallien, « toujours empressée d’être agréable à ses amis et de présager ce qui peut le mieux leur plaire », se penche vers Sophie Liottier et lui donne à entendre que cette indisposition a une tout autre cause. Bonaparte entend la confidence et, de longues années après, celle qui la reçut se rappelait l’expression de joie qui anima son visage. Sitôt sa femme revenue à elle, il lui serre la main, n’a pas l’air d’entendre l’adieu de

Sophie Gay Crayon par Isabey (Musée du Louvre)
Mme Tallien, passe devant Sophie Liottier sans
même la regarder, et s’éclipse. Dans le boudoir de
Mme Fonfrède, on renoue la ceinture antique de
Joséphine qu’on lui avait ôtée, et Mme Tallien fait
remarquer à sa jeune amie l’unique présent de
noces de Bonaparte à sa femme : un simple collier
où des chaînes de cheveux s’attachaient à une
plaque d’or émaillée, sur laquelle on lisait : Au
Destin !
Sophie Liottier a écouté avec un intérêt visible la conversation de Mme Hamelin, et ri de ses bons mots : sensible à ce petit succès, la Merveilleuse la considère d’un air bienveillant, et la jeune femme rentre chez elle avec le désir de retrouver bientôt la spirituelle créole[27].
Lorsque Bonaparte est promu divisionnaire après avoir canonné les royalistes sur les marches de Saint Roch, elle la rencontre à nouveau chez les Tallien.
Mme Tallien, au début, a éprouvé quelque peine à former un salon. On était trop près de la Terreur. Elle réussit cependant à attirer les députés et les banquiers que connut son père, puis des fournisseurs d’armées, le tout panaché de gens de lettres et d’artistes. Chez elle on dîne, on soupe, on fait de la musique, on joue gros jeu. Elle habite une petite maison de campagne plutôt que de ville. cette fameuse Chaumière, simple d’apparence, ornée à l’intérieur avec infiniment d’élégance et de goût, et où une pièce reproduit le boudoir d’Aspasie. Sophie Liottier trace un bref et saisissant croquis des principaux convives. D’abord le maître de la maison, au visage remarquable par sa douceur. « Rien dans ses manières ne s’oppose au désir qu’on éprouve d’oublier la plupart de ses actions politiques en faveur de celle que l’amour lui inspira pour le salut de la France. » Assis à droite de Mme Tallien, Barras, « un homme d’une taille imposante, dont le regard audacieux rappelle autant l’insolence d’un petit gentilhomme que la fierté d’un grand démocrate ; plus galant que poli, il affecte le langage léger, et ne parle des affaires publiques qu’en témoignant sa répugnance pour ce genre de conversation ». Cependant il lui faut bien se déranger au milieu du dîner pour recevoir les dépêches de Hoche qu’un courrier lui apporte.
À la gauche de Mme Tallien, un petit bossu devenu grand prêtre, le directeur La Réveillère-Lépeaux, qui rêve l’établissement d’un culte nouveau reposant sur le déisme, celui des théophilanthropes. « Rien n’est plus plaisant que sa fureur de convertir, si ce n’est la gravité de ceux qui se croient obligés d’écouter ses longs discours sur la nécessité de reconnaître un Dieu ». Bonaparte l’écoute en donnant les signes du plus profond dédain. Il est assis auprès d’Eugène de Beauharnais. Personne ne prête attention à lui. On écoute un ex-marquis dont le babil rappelle les petits soupers de Versailles. Bonaparte surveille jalousement un brillant colonel d’artillerie et Marie-Joseph Chénier qui s’efforcent de plaire à Joséphine. Sophie Liottier a connu dans son enfance le père des deux Chénier. Elle a toujours été prévenue en faveur d’André. Elle a bien étudié le caractère de Marie-Joseph, et en donne un excellent portrait.
« L’esprit de Chénier joint l’emportement de la passion à l’impertinence de l’ironie. Dédaigneux pour tout ce qui n’exalte pas son imagination, sa préférence est une sorte de triomphe obtenu sur son amour-propre : on s’en trouve plus fier que flatté ; car quoiqu’elle soit rare, le mérite n’en est pas toujours l’objet. Sensible jusqu’à la faiblesse, généreux jusqu’à la prodigalité, vain jusqu’à la folie, impérieux jusqu’à l’insolence, l’amour du succès l’a seul porté à prendre cet état de républicain, auquel sa nature était complètement opposée. Mais il veut avant tout voir briller son génie, faire représenter ses ouvrages, jouir de la célébrité que lui promet tait un talent supérieur, réussir enfin ; et comme cela devient toujours moins difficile quand on se range du parti le plus fort, il s’est enrôlé dans les troupes de Robespierre, sans prévoir où ce chef sanguinaire le conduira. » Il lui est resté attaché par crainte plutôt que par opinion, et ce sera la source de la maladie qui mettra dix ans à le tuer. Dès l’époque où nous sommes, il a deviné, « grâce à son esprit d’auteur, le despote qui couve sous Bonaparte, dont la jalousie ne cessera de l’accabler sous les preuves d’une rancune vraiment italienne[28] ».
Sophie Liottier évoquera plus tard la quantité de sentences républicaines que l’on débite ce soir-là sur l’horreur du pouvoir absolu, devant celui qui va si prochainement s’en saisir.
Cette période du Directoire lui laisse dans l’esprit, et même dans l’allure, des traces ineffaçables. Sainte-Beuve le remarque justement : ses souvenirs les plus vifs datent des bulletins de l’armée d’Italie[29]. La danse, la musique, le théâtre, les réceptions mondaines où elle coudoie les personnes les plus en vue de ce temps, lui composent une existence unissant les plaisirs à un intérêt passionnant.
Malheureusement, cette médaille a son revers. La jeune femme laisse l’argent couler facilement entre ses doigts : son vieux mari, qui jadis avança des sommes assez rondelettes à sa belle-mère, tient serrés les cordons de la bourse. Il donne libre cours à ce caractère peu commode qui l’incitera par la suite à intenter procès sur procès aux gens avec lesquels il entrera en contact. La vie du ménage devient de plus en plus difficile. Un beau jour, en 1799, elle se rompt. Sophie de La Valette reprend son nom et sa liberté. Elle conserve l’éducation de ses enfants. Elle ne tardera pas à se remarier, mais cette fois avec un homme dont elle a dit : « Il n’en est pas de plus selon moi que lui ». Il lui donnera le nom sous lequel elle passera à la postérité.
De huit ans plus âgé qu’elle, Jean-Sigismond Gay était né à Lyon le 9 février 1768. Son grand-père, François Gay, était originaire de La Roche, dans la Haute-Savoie. Son père, Joseph Gay, né à Aix les-Bains en 1724, épousa en 1765 la fille d’un négociant de la place des Terreaux, à Lyon, Marie Claudine-Louise Galy. Il en eut six enfants[30] qu’il fit solidement instruire ; cette tradition se perpétua dans la famille. Il acquit une belle fortune, et acheta en 1774, d’un officier supérieur de l’armée sarde, M. de Chabod, la terre de Lupigny, située dans les environs de Chambéry, sur le territoire de la commune de Boussy, près Rumigny. La possession de cette terre lui valut la noblesse que lui conféra, le 10 avril 1782, le roi de Sardaigne, Victor Amédée II. Malheureusement, le château avait grand besoin de réparations, et dévora la fortune de Joseph Gay ; il dut abandonner ses biens à ses créanciers le 10 avril 1782 ; le chagrin le mina : sa femme et lui moururent l’année suivante. Leurs enfants réunirent ce qui leur restait des biens paternels, se retirèrent à Chambéry, puis, en pleine Révolution, vinrent chercher fortune à Paris. La sœur aînée de Sigismond, Marie-Françoise, présidente de la Société philanthropique des Dames de Chambéry, avait reçu en 1793 une lettre de félicitations de l’abbé Grégoire. À Paris, elle cherche à se créer des ressources en faisant des traductions ; anglicisant son nom, elle signe : Mary Gay, celle d’Eléonore de Rosalba d’Anne Radcliffe, et celle des Secrets de famille, de Miss Peat. Elle publiera même un roman de son cru, Albertine, sorte d’autobiographie. Elle épouse Nicolas-Gabriel Allart, qui menait de front les affaires et les plaisirs ; il dirigeait un cabinet d’affaires achalandé ; il gérait les intérêts de grandes villes de France, et de villes conquises, Lyon, Toulouse, Aix-la-Chapelle, etc. Regnauld de Saint-Jean-d’Angély l’avait mis fort en crédit auprès des ministres. Il recevait une société spirituelle et distinguée où figuraient Chénier, Talma, Arnault et Duroc. Ce dernier lui procura d’avantageuses missions financières en Italie. Allart emmena sa femme : ainsi leur fille aînée, la fameuse Hortense Allart, vint au monde à Milan en 1801 ; la seconde, Sophie Allart, née à Paris en 1804, sera peintre, voyagera beaucoup, et épousera, à Rome, un négociant français, Gabriac ; elle reste très liée avec ses cousines Gay[31].
Sophie de La Valette a rencontré Sigismond Gay dans le monde. Il revient d’un voyage de trois ans en Egypte[32]. Elle n’a pas hésité à abandonner, avec son premier mari, cinquante mille livres de rentes ; elle n’hésite pas davantage à épouser un homme sans autre fortune que ses capacités ; elle aime l’argent pour le dépenser, mais elle n’y tient pas autrement, et sait aussi bien s’accommoder de l’abondance que de la disette.
En janvier 1803, elle perd accidentellement fille Emma-Sophie[33] à peine âgée de cinq ans. Pour pleurer son enfant, elle s’est retirée « à un bout de Paris », dans un quartier « très désert », rue de La Rochefoucauld. Elle y fait une singulière rencontre.
Mlle Contat, de la Comédie-Française, offrait avec la mère de Sophie Gay une ressemblance si frappante, que la première fois que la jeune femme la vit jouer, une telle crise de larmes la saisit qu’il fallut l’emporter de la salle. Elle tenta vainement de vaincre cette émotion, et dut renoncer à aller au Théâtre-Français les soirs où jouait Mlle Contat. Or voici que l’actrice choisit, en guise de maison de campagne, celle précisément attenante à la maison de Sophie Gay, rue de La Rochefoucauld. Un jardin l’entoure :
« Un mur très bas séparait ce jardin du mien, conte Sophie Gay. Des fenêtres de mon appartement on voyait le parterre, les pelouses, l’allée où se pro menait habituellement Mlle Contat. Quand le temps le permettait, je me promenais le long du mur qui séparait nos allées de tilleuls, et j’écoutais avec délices les accents de cette voix qui faisait battre mon cœur ; car le temps opère d’une manière étrange sur la douleur, et le souvenir qui nous tue aujourd’hui devient plus tard une triste et douce volupté de l’âme. Je ne saurais peindre ce que j’éprouvais en retrouvant, dans un être complète ment étranger à moi, ces regards, ces gestes, ces inflexions auxquelles j’étais accoutumée à obéir, ce sourire gracieux qui me récompensait de tout. Mon imagination était quelquefois exaltée par cette ressemblance jusqu’à la folie. Je restais des heures entières à contempler ce beau visage, à suivre tous les mouvements de cette femme qui me faisait l’effet d’une résurrection. »
Mlle Contat n’est pas sans remarquer ce manège. Elle en parle au vicomte de Ségur, un intime de sa voisine. Ségur répète le propos. Sophie Gay promet que Mlle Contat n’aura plus à se plaindre de son importunité, mais le vicomte l’engage à se donner tout à son aise le plaisir de contempler la belle actrice :
— Vous êtes inconnue dans un village, et à la campagne on voisine toujours.
D’ailleurs, Mlle Contat reçoit ce qui reste de la meilleure compagnie de Paris On n’est pas exposé, dit le vicomte, à rencontrer chez elle les talents jacobins qu’accueille Sophie Gay : allusion à Talma, auquel Ségur en veut toujours pour avoir épousé Julie Carreau, qu’il aimait.
Quelques jours plus tard, Vigée, le frère de Mme Lebrun, l’illustre peintre, tout dévoué à Mlle Contat qui jouait sa pièce l’Entrevue à la Comédie Française, et qu’il inondait en vers de sa reconnaissance et de son admiration, propose à Sophie Gay d’assister chez sa voisine à la lecture du Mérite des femmes, de Legouvé. Le lendemain, un billet « ayant toute la grâce d’une conversation spirituelle » confirme la démarche de l’ambassadeur.
Sophie Gay, émue en entrant pour la première fois dans le salon d’une actrice, se rassure vite. Ni son état, ni l’embonpoint de la quarantaine n’enlèvent rien aux manières distinguées, à la politesse affectueuse de la maîtresse de la maison. Sur un canapé, voici la marquise de Jaucourt et Mme Desprez, sur un autre Mme de Soulès, femme du receveur général de Rouen, et la célèbre Mme Lebrun, que la postérité connaît sous le nom de Vigée-Lebrun. Près d’elles M" de Beaufort et Legouvé, et la jeune et ravissante beauté de Mlle Mars. Côté des hommes, le comte Louis de Narbonne, qui aima d’amour Mlle Contat et l’aime aujourd’hui d’amitié ; le marquis de Jaucourt, le vicomte de Ségur, le marquis de Girardin, le marquis de Gontaut-Saint-Blancar, MM. Vigée, Desprez, de Parny, maints auteurs joués par Mlle Contat. Ils discutent les innovations littéraires et dramatiques du jour ; Sophie Gay voit juste en y discernant le début du romantisme, le berceau de la poésie romantique et du drame historique. En 1837, elle écrit : « Nous n’avons que la caducité du romantisme ».
Le vicomte de Ségur vient s’asseoir auprès d’elle. Il lui nomme les personnes qu’elle ne connaît pas, non sans parsemer la nomenclature des pointes de sa verve caustique.
Voici Colin d’Harleville, un petit vieux aux yeux baissés, à l’attitude modeste, toujours blotti dans un coin du salon pour qu’on aille l’y chercher : « la violette de l’Institut », une violette prétend-on, en procès avec toute sa famille. Il conserve une haine farouche contre Fabre d’Églantine, ce septembriseur qui imagina de remplacer les noms des saints du calendrier par des noms de légumes :
— J’ai cherché, dit Ségur, celui qui avait pris la place de mon patron : il se trouva que je m’appelais Chou-frisé.
Ce nom s’accorde si bien aux frisures de la coiffure à l’ancienne mode arborée par le vicomte, que Sophie Gay rit de bon cœur.
Le gros monsieur poudré qui cause avec Colin d’Harleville est Desfaucherets, l’auteur du Mariage secret ; il possède à un degré éminent le genre d’esprit à la mode, parle avec aisance, et cultive le jeu de mots[34]. Près d’eux, la figure spirituelle de Népomucène Lemercier ; celui-là, Sophie Gay le reconnaît : en 1797, un de ses amis le lui amena dans sa loge le soir de la première représentation d’Agamemnon, où Lemercier triompha. Le public appelait l’auteur à grands cris ; chose difficile, il sut répondre aux compliments sans ridicule présomption ni hypocrite modestie. Sophie s’étonne d’apercevoir Alexandre Duval, un ami de son mari ; elle sait que récemment il refusa une modification réclamée par Mlle Contat à son rôle dans Édouard en Écosse, alors en répétitions ; Mlle Contat lui jeta le rôle à la tête ; il jura que si l’on y changeait un iota, il retirerait sa pièce. Mais une brouille entre gens aussi nécessaires l’un à l’autre ne pouvait durer longtemps.
Ségur désigne encore Emmanuel Dupaty, qui signa avec lui l’Opéra-comique, un petit acte auquel Sophie Gay accorda les honneurs de la scène dans sa maison de campagne de Fontenay-le-Bel, et enfin M. de Parny, le fils du poète érotique, récemment marié avec Mlle Contat — soit dit en confidence, — mariage tenu secret jusqu’au jour où elle quittera la Scène.
Justement, elle s’avance vers le vicomte. La table et le verre d’eau, classiques depuis le règne de Louis XIV où commença le goût des lectures[35], attendent toujours Legouvé. Or, Legouvé est en retard, à son habitude : il faut distraire les invités et calmer leur attente. L’antique bat son plein : on a donné à Mlle Contat une lyre d’invention nouvelle, qui remplace la guitare. Mlle Contat apporte cet instrument au vicomte de Ségur, et le prie de s’accompagner une chanson. D’autres ont refusé, parce que la lyre oblige à une position ridicule. Ségur se dévoue. Quel air, avec cette lyre, ses cheveux frisés et poudrés, ses mines de l’ancienne cour, sa voix frêle, sa prononciation périmée ! Sophie Gay n’avait pas alors « cette charitable hypocrisie qui sait jouir des ridicules en silence ». Elle éclate de rire, tout le salon en fait autant, y compris le chanteur, qui s’installe devant une glace pour jouir du comique de sa propre pose.
Legouvé arrive enfin. Il s’assied devant le verre d’eau, et sa voix grave et sonore annonce le Mérite des femmes.
— Ah ! Tant mieux ! ce ne sera pas long, murmure le vicomte de Ségur à l’oreille de sa voisine.
Il s’agit du dévoûment des femmes sous la Terreur. À certaines allusions, les regards se tournent vers Mme Lebrun, radieuse, les yeux brillants de joie, le teint jeune et frais, les cheveux blonds admirables, heureuse de se retrouver dans un pareil milieu après les tristesses de l’exil.
La lecture terminée, on félicite l’auteur. Sophie Gay fait remarquer le bon goût, la grâce, la coquetterie des compliments que tourne Louis de Narbonne, au vicomte de Ségur, qui en profite pour placer une anecdote. En 1792, après son ministère où il avait dépensé sans compter, il fallut à Narbonne trente mille livres pour éviter la prison. Un indiscret l’apprit à Mme de Staël, qui courut les demander à son mari.
— Ah ! Vous me comblez de joie ! s’écria M. de Staël, qui ajouta en donnant les trente billets de mille : « Jugez de mon bonheur : je le croyais votre amant ! »
M. de Parny offre la main à Sophie Gay pour passer dans la salle à manger, où l’on soupe. Et comme on est chez une comédienne, la soirée finit sur une scène de comédie. Florence, modeste confident sur les planches, excellent semainier par ailleurs, annonce qu’une indisposition de Talma oblige à changer le spectacle. Pour sauver la recette, la Comédie supplie Mlle Contat de jouer le Misanthrope et les Fausses Confidences. Vigée a parié que, quoi qu’il sollicite, Florence l’obtiendra. « Je ne veux pas jouer demain », répète l’artiste. Florence plaide en vain sa cause. Il va se retirer, quand soudain, avec l’accent du désespoir, il s’écrie :
— En vérité, madame, vous êtes sans pitié ! m’obliger, à l’heure qu’il est, d’aller faire réveiller Mme Petit pour la conjurer de vous doubler demain dans la Mère coupable ! C’est une barbarie, car elle est souffrante aussi, et pourtant, elle jouera, j’en suis sûr. Elle est si bonne camarade !
À mi-voix, Vigée dit à Sophie Gay :
— Faites attention : la scène commence.
En effet, Mlle Contat se radoucit. Pourquoi ne ferait-on pas relâche ? Non : on ne peut sacrifier une recette. Le vicomte de Ségur a bien vu l’effet produit par le nom de Mme Petit. Il blâme Mlle Contat de résister aux prières de ses camarades et aux vœux du public. On l’approuve, et Mlle Contat, charmée de se voir contrainte à faire ce qu’elle désirait, rappelle Florence :
— Puisqu’on le veut absolument, je jouerai demain le Misanthrope et les Fausses Confidences[36].
À partir de ce jour, les relations se nouent entre Sophie Gay et la comédienne. Mlle Georges nous en apporte l’écho, et ajoute quelques touches au tableau précédent : Mlle Contat, « toute grande dame qu’elle est », a accepté du Gouvernement un pavillon près de l’Odéon. Le pavillon est vilain, la salle à manger vilaine, le salon inexistant ; elle reçoit dans sa chambre à coucher… mais elle est logée pour rien. La plume un peu pointue de Mlle Georges continue : elle est très aimable chez elle ; « malgré tout, il y a toujours de cette charmante impertinence dont elle s’est fait une agréable habitude. M. de Parny est un gentilhomme qui s’est placé, par attachement sans doute, dans une singulière position. On le prendrait volontiers, malgré ses excellentes manières aristocratiques, plutôt pour l’intendant de la maison que pour le futur époux de cette grande artiste. Moi, fort ignorante de cette vie intime, j’étais mal à l’aise quand M" Contat lui disait : « Sonnez, je vous prie, mon cher, pour qu’on verse le café ». Et voici com ment M" Georges a vu, sans indulgence, Sophie Gay : « J’ai dîné chez M" Contat, il y a deux jours, avec M" Gay. C’est une aimable et spirituelle femme ; mais, bon Dieu ! qu’elle doit être fatiguée ! Elle parle bien, mais elle parle sans discontinuer »[37].
Toujours sous le Consulat, le souvenir d’un dîner chez la marquise de Condorcet se grave dans la mémoire de Sophie Gay. La marquise de Condorcet, demeurée belle, abhorre la Terreur qui lui a pris son mari, mais conserve son enthousiasme pour les idées nouvelles, mitigé par le regret de quelques préjugés anciens. Suivant cette double disposition de son esprit, elle réunit dans son salon les repré sentants des partis les plus opposés. Ils se détestent, et font des frais pour se plaire, preuve de la puis sance de l’esprit qui répudie les opinions et les antipathies pour jouir du charme de la conversation. La misère et la mort ont établi une certaine égalité. « Le gentilhomme le plus entiché de ses vieux pré jugés saisit avec empressement l’occasion d’y être infidèle en se rapprochant du plébéien éloquent ou de l’artiste spirituel auquel il devait de sortir de prison. »
Outre la jeune fille de la maison aux traits « angéliques », les convives sont Garat l’Idéologue, son neveu Maillat Garat, le chevalier de Panat, Benjamin Constant, Siéyès, Mme Talma. Détail typique de cette société aux éléments contradictoires : Sophie Gay est assise à table entre Chénier et le vicomte de Ségur. Étonnée, curieuse, elle regarde et elle écoute avide ment des hommes offrant de tels contrastes.
Le nom de Chénier lui fait un peu peur. Cependant le jacobin s’humanise, quitte son air dédaigneux, se fait gracieux, se vante d’un léger service rendu à Sigismond Gay : il ne s’agirait de rien moins que de lui avoir sauvé la vie, en le tirant de la Conciergerie la veille du jour où il devait comparaître devant le tribunal révolutionnaire.
D’un côté les manières aristocratiques de Chénier, de l’autre la gaîté républicaine du vicomte de Ségur : vieil ami à l’amitié coquette, car chez lui la coquetterie se mêle à tout, il n’oublie pas que sous la Terreur Sophie Gay l’a reçu en dépit de ses ailes de pigeon, de sa perruque poudrée, de sa mise aristocratique qu’il s’obstinait à ne pas quitter, et qui pouvait compromettre ses amis aussi bien que lui. Elle le voyait aussi beaucoup chez Mme de Courcelles, qui demeurait dans la même maison. Toutes deux lui prêchent inutilement la prudence : il ne peut retenir une épigramme. Quand on frappe les revenus d’un impôt du quart, il lance un distique :
Moi j’ai payé mon quart, et dis avec Voltaire :
À tous les cœurs bien nés que la patrie est chère !
À Elleviou qui le traite sans la moindre cérémonie, il fait ingénieusement sentir qu’il n’admet pas ce manque d’égards, en lui disant avec humilité :
— Monsieur, pourquoi ces airs de hauteur ? Depuis la Révolution, ne sommes-nous pas tous égaux ?
Aujourd’hui, cet élégant du dernier règne a gardé la raideur de sa taille droite, mais, sous son cha peau à cornes et sa perruque, il a perdu beaucoup de cheveux, et il affirme avoir donné un nom à chacun de ceux qui lui restent[38].
À gauche, Sophie Gay entend des sarcasmes amers contre l’esprit superficiel et la frivolité des gens de l’ancienne cour ; à droite, elle entend railler les ver tus civiques de ces fiers républicains qui mouraient de peur les uns des autres. En face, Benjamin Constant plaisante avec douceur, finesse et malice les ridicules prétentions des marquis de L’Œil-de-Bœuf et celles des jeunes Romains du Directoire ; Garat, « dont le républicanisme se disposait dès lors à tous les sacrifices qu’il a faits depuis au règne de l’empereur », n’émet que des aphorismes conciliants.
Sophie reproche au vicomte de Ségur de ne pas dissimuler sa malveillance pour Chénier, de le haïr si haut :
— Moi, le haïr ! dit Ségur en souriant, pas le moins du monde ! et pourvu qu’il veuille bien ne pas fraterniser avec moi… car vous savez ce qu’il en coûte pour…
Elle ne lui permet pas d’achever cette plaisante rie sanglante, et se retourne brusquement vers Chénier, craignant qu’il n’ait entendu. Chénier s’imagine que les fadeurs du vieux courtisan l’impatientent, et l’en complimente comme d’une preuve de bon goût. Et la voici obligée de défendre Ségur contre les épigrammes du républicain sur les ridicules courageux du gentilhomme.
Le dîner terminé, son mari la présente à une personne qui, dit-il, fit intervenir Benjamin Constant auprès de Chénier pour le sauver. Elle préfère avoir au jacobin cette obligation moins directe. Elle parle à plusieurs reprises des sept incarcérations dont son mari aurait été victime pendant la Terreur : la vérité oblige à reconnaître qu’elle a exagéré. Sigismond Gay fut peut-être considéré comme suspect, peut-être menacé : il n’alla pas une seule fois en prison ; les registres d’écrous des prisons de Paris en font foi. Nous avons connu des gens qui, pour s’être fait tué en 1848, réclamaient des bureaux de tabac à la troisième République : dès le Consulat, il était de bon ton, et pouvait devenir profitable, de se targuer de persécutions qu’on aurait subies sous la Terreur. Quoi qu’il en soit, Sophie assiste en observatrice avisée et curieuse aux transformations de la société française, dont elle note les phases avec justesse, et avec esprit[39].
Dès cette époque, elle est piquée de la tarentule littéraire. Elle n’est pas la seule. « Aucun siècle n’a commencé avec un aussi grand nombre de femmes de lettres », dit Fortunée Briquet au Premier Consul, en lui adressant son Dictionnaire historique des Françaises. C’est vrai. On comptait auparavant beau coup de femmes d’esprit et peu de femmes de lettres : la proportion est inversée. Mmes Desroches, Clément, Sarrazin, Lafontaine, Sommery, de Flamanville, Marie Courchamps, de Vannoz, Levesque, de Saint-Venant, Quesnard, Gacon-Dufour, Bonne, Mallarmé, Barthélemy Hadot, Chemin, de Montanclos, et cent cinquante autres également célèbres, encombrent les devantures des libraires avec des romans intitulés Méliosa, Koraïne, Ursule, Aurélie, Edmond et Henri, Isaure et Elvire, etc. Tandis que sous Louis XVI la jeune femme qui écrit est avant tout sentimentale, elle arbore sous le Directoire une belle impudeur et les principes les plus hardis. Sous le Consulat et l’Empire, elle se militarise, aime et admire la Gloire, et, ajoute malicieusement Sainte-Beuve, s’honore de la récompenser. La Restauration verra l’avènement de la femme pâle et frêle qui soupire aux Méditations et raffine sur les idées et les sentiments ; sous Louis Philippe, elle se teintera de socialisme, s’inspirera de George Sand, de Musset, d’Eugène Sue, rêvera son émancipation totale, et s’affirmera en fumant des cigarettes, voire des cigares.
Dès le Directoire, le poète Lebrun disait :
Rassurez les Grâces confuses ;
Ne trahissez point vos appas ;
Voulez-vous ressembler aux Muses ?
Inspirez, mais n’écrivez pas.
Mme P…… répond. Elle paraît, à une séance de l’Athénée, — extraordinaire réunion de beaux esprits, — la taille élancée, le regard audacieux, la voix pure et sonore ; elle monte à la tribune, et riposte par une Épître aux femmes, où elle dit :
De l’étude de l’Art la carrière est ouverte ;
Osons y pénétrer. Eh ! qui pourrait ravir
Le droit de les connaître à qui peut les sentir !
Elle aurait complètement gagné sa cause, dit Sophie Gay, « si, fière d’avoir rimé des vers charmants, elle avait renoncé au vain plaisir de les lire elle-même… Car si la manie des vers rend une femme ridicule, le goût des arts ajoute à son amabilité. C’est au mérite de ses ouvrages qu’est attaché le pardon d’un auteur féminin. » Tant de femmes écrivent que déjà l’on peut dire : « Quand une femme écrit, elle est une dixième Muse ; quand elle n’écrit pas, elle a encore la ressource de se croire la modeste violette », pensée notée sans signature dans les Causeries du monde, mais qui porte indubitablement la griffe de Sophie Gay[40].
Donc, comme tout le monde, elle écrit son roman, et, comme tout le monde, elle l’intitule Laure d’Estell. Elle ne signe pas. Il faudrait ne pas appartenir à la société parisienne pour en ignorer l’auteur. Lorsque Sainte-Beuve se documenta, avec le soin méticuleux que l’on sait, pour rédiger son étude sur Sophie Gay, Aglaé de Canclaux, désireuse de le voir « tirer parti de cette excuse pour une femme de se faire imprimer », lui fit savoir par l’intermédiaire d’un ami commun que sa mère avait écrit ce roman dans le but de venir en aide à ses oncle et tante à la mode de Bretagne, les Blottefière de La Viéville, rentrant d’émigration sans ressources, dans un moment où elle était aussi pauvre qu’eux. Le renseignement est inexact. D’une part, « dame Blottefière de La Viéville » figure comme marraine au baptême d’Euphémie Liottier, le 21 novembre 1798, de sorte qu’à l’apparition du roman, elle était en France depuis au moins quatre ans ; d’autre part, la notice consacrée à Sophie Gay en tête de sa comédie, le Marquis de Pomenars, et confirmée par une phrase du vicomte de Ségur, dit formellement : « Elle avait composé pour elle-même, sans aucune espèce de dessein de passer pour auteur, un roman intitulé Laure d’Estell. Le célèbre chevalier de Boufflers lui en ayant dérobé le manuscrit, le fit imprimer d’accord avec son mari même, en 1800 (1802), chez Pougens, leur ami commun, et à l’insu de Mme Gay ; Chénier a donné les plus vifs éloges à l’idée principale sur laquelle est fondée cette charmante production. » Il est possible que, le roman édité, Sophie Gay en ait abandonné le produit à ses parents de Blottefière ; on trouvera dans sa succession un éventail donné par Marguerite de Valois à sa grand’tante la marquise de Blottefière : peut-être le reçut-elle à titre de remerciement.
Marie-Charles-Joseph, chevalier de Pougens, qui l’éditait, ami de Gay et de Boufflers, n’était pas un libraire ordinaire : fils naturel du prince de Conti, il avait commencé une carrière diplomatique, qu’une cécité précoce interrompit. Sous la Révolution, il fonda une librairie, n’en continua pas moins à publier des ouvrages de son cru, et entra à l’Institut en 1799. Il en était donc membre lorsqu’il édita le premier roman de Sophie Gay : peu d’auteurs peuvent se vanter d’avoir un éditeur de pareille qualité[41].
Laure d’Estell, sans être un chef-d’œuvre, vaut sûrement mieux que la moyenne des productions du même genre qui paraissaient journellement. Sainte-Beuve vante le style net, courant et généralement pur, et les remarques fines, ce qui, sous sa plume, constitue un bel éloge. Les contemporains, les amis de l’auteur surtout, sonnent la fanfare de l’enthousiasme. Chénier envoie un billet de félicitations. Le vicomte de Ségur donne au Journal des Débats un article élogieux, inséré depuis dans ses Œuvres diverses. « Mme Geoffrin disait un jour : « Vous m’assurez que cet homme est simple ; mais est-il simple avec simplicité ? » Voilà le grand mérite du style de Mme Gay… On y remarque un naturel, une facilité si aimable, si rare, que chacun croit deviner le besoin qu’elle a eu d’écrire ce charmant ouvrage… Les personnages sont si bien établis, la gradation de l’intérêt marche avec une si profonde connaissance des ressources de l’art, que la louange même doit s’arrêter, pour laisser au public des jouissances si inattendues. » Le vicomte ne formule qu’une critique : il est fâcheux qu’un prêtre joue un rôle révoltant dans cet ouvrage. « Épaississons les voiles sur les vérités tristes », ajoute-t-il[42].
Le Journal de Paris du 23 floréal an X (19 mai 1802)[43] publie un article qui, aujourd’hui encore, a gardé toute sa saveur. Sous l’anonymat, on devine le chevalier de Boufflers. Le titre porte : Conversation entre un vieil homme de lettres et un jeune. Elle s’engage avec un joli cliquetis d’esprit : « — Mon parti est pris, mon cher maître ; au fait, quand tout le monde écrit, pourquoi n’écrirais-je pas ? Pourquoi ne chercherais-je pas aussi à me distinguer ? — Mon ami, prenez-y garde, peut-être que la manière la plus sûre de se distinguer quand tout le monde écrit, ce serait de ne pas écrire. — Ce serait aussi le moyen de n’être pas lu. — Vous auriez cela de commun avec beaucoup d’écrivains. — Je suis tourmenté de mes idées. — Heureux jeune homme ! et où sont-elles, ces idées, est-ce dans votre mémoire ou dans votre imagination ? — Il me semble que les écrivains n’y regardent pas de si près. — Bon pour les écrivains, mais les critiques ? Et à quel genre donnerez-vous la préférence ? — Au plus facile. » Ce qui écarte les genres dotés de règles par les anciens. « À quoi sert toute cette législation poétique ? Un talent supérieur y déroge impunément, et la médiocrité ne gagne rien à s’y soumettre. » En fin de compte, le jeune auteur choisit le roman, dont Aristote n’a pas parlé. Il développe si bien ses idées sur la manière d’écrire ce genre d’ouvrage, qu’il s’attire cette remarque : « Vous haïssez les règles, et vous en faites ». D’ailleurs, il demande au maître des conseils, qu’on lui donne, et qui sont toujours excellents, sur le style, sur la composition, sur la manière de nouer l’intrigue et de la dénouer, sur la progression à donner à l’intérêt, sur ce qu’il convient de demander aux livres ou de tirer de l’observation des passions humaines. « Dispensez-vous d’imaginer : il ne faut que regarder. » Le vieil homme de lettres précise ensuite quelques caractères, précisément ceux des héros du roman de Sophie Gay, et finit par énumérer tant de conditions indispensables à la bonté de l’ouvrage que le jeune auteur s’écrie : « Savez-vous bien, mon cher maître, que voilà trop de conditions que vous exigez pour un travail de haute fantaisie ; et où trouver un roman qui les rassemble ? » À quoi le maître répond froidement : « Chez Pougens, libraire, quai Voltaire : demandez Laure d’Estell, par Mme… »
Le trait final prouve que l’ingéniosité dans la publicité ne date pas d’aujourd’hui.
Ce bel article, le croirait-on, suscite une polémique. Dans son roman, Sophie Gay définit ainsi un personnage, qu’elle appelle Mme de Gercourt : « Tu la traites bien sévèrement. Quoi ! Tu prétends qu’elle met les vices en action et les vertus en préceptes ? Ah ! ma Juliette, tu n’as pas réfléchi sur toute l’étendue de cette méchanceté ! Sais-tu bien qu’une femme de ce caractère serait plus dangereuse par l’apparence même de cette vertu, que celle qui ne mettrait aucune pudeur dans sa conduite. On l’accuse, dis-tu, d’un peu de galanterie : tu n’ignores pas que sur ce point on amplifie toujours ; et quant à ce qui regarde la petite querelle de ménage qu’on veut absolument qu’elle ait excitée entre un grand seigneur et sa femme, sais-tu ce qui l’a amenée ? » Il est difficile de désigner plus clairement Mme de Genlis. « Elle qui, dans tous ses ouvrages interdit à une jeune femme la permission de parler d’aucune passion ! Qui les croit déshonorées quand elles ont fait imprimer une romance, et qui appelle athées toutes celles qui osent douter d’un seul miracle ! J’avoue qu’elle est moins scrupuleuse pour les femmes de son âge : elle leur permet d’écrire, mais seulement sur l’éducation ; l’amour maternel est l’unique amour dont elles doivent parler. Il est vrai qu’à cet âge il est possible d’avoir oublié tous les autres ; et, si je t’en crois, Mme de Gercourt s’est privée par cette loi du plaisir de se retracer un grand nombre de souvenirs. » Et encore : « L’affectation qu’elle met à parler vertu, prouve qu’elle la regarde comme une chose presque surnaturelle, et ce n’est pas ainsi que la vertu paraît aux gens habitués à la pratiquer[44]. » Sûrement, quelque propos de Mme de Genlis a piqué au vif Sophie Gay, qui riposte point par point.
Mme de Genlis n’a pas de peine à se reconnaître. L’article du vicomte de Ségur dans le Journal des Débats, et celui du Journal de Paris, l’émeuvent. Quelques jours après, cette dernière feuille publie, le 9 prairial an X (29 mai 1802), une lettre adressée « aux rédacteurs du journal », signée Verax Lebourru.
« Retiré dans une campagne isolée, je fais venir de Paris presque tous les ouvrages nouveaux qui sont annoncés avec éloges dans les journaux ; mais, je ne sais par quelle fatalité, presque tous ceux que j’ai lus depuis quelque temps m’ont paru souverainement médiocres, pour ne pas dire détestables. On m’assure que, le plus souvent, les journalistes n’ont pas même lu les ouvrages qu’ils louent avec une si intrépide assurance, et qu’ils n’insèrent ces articles mensongers que pour complaire à des amis officieux, ou même tout simplement au libraire. » Ces réflexions lui sont venues en lisant un roman intitulé Laure d’Estell sur l’indication du « citoyen Ségur jeune » dans le Journal des Débats, et du Journal de Paris lui-même. Tout ce qu’un auteur peut imaginer pour blesser un autre auteur au point sensible, une femme pour blesser une autre femme, vient naturellement sous la plume de Verax Lebourru. Malheureusement sa critique est lourde, et manque totalement d’esprit. Ce n’est pas la flèche brillante, le trait hardi et ingénieux, la trouvaille piquante : c’est le coup de poing du charretier. Verax Lebourru n’a jamais lu de roman aussi froid, aussi fade, aussi commun. Nulle sensibilité, nul abandon. Jamais un trait qui parte de l’âme. On dit que l’auteur est une femme ; mais où ces pensées fines et ingénieuses, ces aperçus délicats qui distinguent les productions des femmes ? On est tenté de se demander, comme le fermier de Mme Denys : « Messieurs, lequel de vous deux est madame ? » Une note de bas de page explique ce mot : « Mme Denys, qui était fort laide, étant au lit avec M. Duv… qu’elle avait épousé après la mort de son oncle, M. de Voltaire, on introduisit dans sa chambre un paysan qui lui apportait de l’argent ; à la vue de ces deux têtes, il ne sut à qui parler : « Messieurs, leur dit-il, lequel de vous deux est madame ? »
Avec une prudente réserve, les journalistes s’en sont tenus aux généralités : Verax Lebourru entre dans le détail pour justifier sa sévérité. La narration est fastidieuse, le début vide, l’intrigue pauvre et commune, le ton inconvenant. « Citoyen Ségur jeune, vous, arbiter elegantiarum, dites-nous si c’est ainsi qu’on écrit et qu’on parle dans la bonne compagnie où vous avez vécu ? » Le style est diffus, lâche, traînant, sans expression et sans couleur, il fourmille d’incorrections et de locutions bourgeoises. Et l’auteur de la lettre termine en affirmant qu’elle lui est dictée par la plus grande impartialité.
Deux jours plus tard, le Journal de Paris insère la lettre d’un anonyme qui se jette au travers de la querelle, dans le seul but de dénigrer un Voyage au Mont-d’or par l’auteur du Voyage à Constantinople, Salaberry. Mais le 15 prairial (4 juin), nouvelle lettre, adressée « à Mme X…, auteur du roman de Laure d’Estell. — Madame, vous n’exigerez sûrement pas que je remplisse à la rigueur les engagements que j’ai pris avec vous au sujet de la seconde édition de Laure d’Estell. Quand nous avons passé ce traité, nous ne nous attendions, ni vous, ni moi, à certaines observations de Mme de Gercourt, insérées dans le Journal de Paris, feuille 9, sous le nom de Verax le Bourru ; malgré tout le succès de votre ouvrage, j’ai peur que cet article, beaucoup plus Bourru que Verax, n’en arrête le débit. Au reste, madame, je tiendrais encore ma première parole, si vous pouviez corriger le caractère de Mme de G… ; mais comme l’entreprise serait trop difficile, je vous engagerai plutôt à le retrancher absolument. Souvenez-vous du Tartuffe de Molière, et pensez que s’il y a des présidents, il pourrait bien aussi y avoir des présidentes qui ne veulent pas qu’on les joue. J’ai l’honneur d’être avec respect votre très humble serviteur. Près regardant, libraire, quai des Lunettes. »
Cette fois, le coup est direct. Mme de G…, ouvertement démasquée, se sent touchée à fond. Le surlendemain, nouvelle lettre au Journal de Paris, adressée « au citoyen Près regardant, libraire, sur le quai des Lunettes. — En vérité, mon cher confrère, ce n’est pas la peine de demeurer sur le quai des Lunettes, et d’y regarder de si près, pour y voir aussi mal. Vous imprimez un roman médiocre ; on en fait un grand éloge, le livre se vend, le public murmure, les lecteurs grondent, les autres romanciers souvent molestés, tonnent, Verax le Bourru éclate. Le roman est jugé, délaissé ; c’est encore là un tout petit événement. Mais voici la faute, et en mon âme et conscience, je vous déclare coupable. Il se trouvait dans ce roman un assez méchant portrait dont on ne s’était pas avisé de chercher le modèle, et sur ce, mon maladroit confrère, vous croyez faire un coup de maître en mettant au bas le nom d’une dame connue par des succès, des ridicules, des talents, enfin par tout ce qui fait la célébrité des femmes qui sacrifient le repos à l’éclat, la paix au bruit, le bonheur à la renommée. Que s’ensuit-il ? Vous n’aviez imprimé qu’un roman dont on ne parle plus, et vous en faites un libelle dont vous croyez qu’on parlera. Il y a faute, dirait Figaro, mon cher confrère. Cela ne vous réussira pas ; on ne se fait pas pardonner l’ennui en offensant la morale. Bellevue, libraire, quai Voltaire. » On peut douter que ce style résolu soit de Mme de Genlis ; un ami a répondu pour elle. Sur cette dernière passe d’armes, la polémique s’arrête. Mais peu après, Mme de Genlis publie un volume de Contes, Souvenirs, Notices, et récolte dans le Journal de Paris un éreintement en quatre points.
Par ailleurs, Sophie Gay reçoit du jeune Alissan de Chazet une louange délicate, une poésie facile en vers gracieusement tournés, qui dut la charmer. Il l’admirait fort, et disait : « Près d’elle, on sent si bien tout le plaisir d’écouter ! »
À Madame S. G., auteur de Laure d’Estell[45].
J’ai lu cet ouvrage charmant,
Fruit délicat de votre aimable plume,
Où l’on rencontre à chaque instant
La critique sans amertume
Et la grâce sans ornement,
Les hochets et la politique,
La morale et le sentiment,
Et les armes de la logique
Sans l’ennui du raisonnement ;
Je l’ai lu, je veux le relire.
Près de votre pupitre amour s’était placé :
Vous pouviez sans effort le peindre et le décrire ;
On n’est jamais embarrassé
Pour exprimer ce qu’on inspire ;
Pourquoi prétendre vous cacher
Sous le voile de l’anonyme ?
La modestie en vain voudrait chercher
À l’épaissir : d’accord avec l’estime,
Le plaisir vient le détacher.
D’ailleurs, pour rester inconnue,
C’était trop peu de taire votre nom :
Il fallait déguiser la grâce méconnue
Qu’on prend pour la folie ou bien pour la raison,
Tantôt coquette et tantôt ingénue,
Qui joint le feu de l’abandon
À l’attrait de la retenue.
Il fallait ne pas nous charmer,
Forcer le naturel à ne jamais paraître ;
Qui vous connaît devait vous reconnaître.
Écrire, c’était vous nommer.
Vous vouliez, par un goût fantasque,
Cacher votre talent ? Votre talent vous perd :
Les traits s’éclipsent sous le masque,
Mais l’esprit reste à découvert.
De l’amour fidèle interprète,
De Caylus et de Lafayette
Suivez, suivez longtemps les pas.
Empruntez leurs traits délicats,
Leur plume qui séduit, leur langage qu’on aime,
Que dis-je ? Ne l’empruntez pas ;
Pour être toujours mieux, soyez toujours vous-même.
Vous avez su les égaler.
Vous ne devez qu’à vous votre couronne ;
Vous ne ressemblez à personne,
Heureux qui peut vous ressembler
Mais tais-toi, Muse trop sincère,
Finis cet éloge indiscret :
Vanter Sophie et dire qu’elle plaît,
C’est le moyen de lui déplaire.
Chacun le sait, le peintre de Ninon[46]
Et le chantre brillant d’Aline[47]
Ont su faire agréer une louange fine,
Qu’ils relevaient encor par l’éclat de leur nom.
C’était le droit des maîtres du Parnasse.
En son honneur, ils ont tous deux écrit,
Qui n’eût pas écrit à leur place !
Toujours le goût, le bon ton et l’esprit
Ont fait l’éloge de la grâce.
Entre temps, un livre autrement sensationnel vient de paraître. En décembre 1802, Mme de Staël publie Delphine. Elle touche à la religion, à la politique, au mariage, trois questions d’une actualité immédiate et qui soulevaient de vives animosités. « La thèse de Delphine, dit le grincheux Philarète Chasles, confusion des devoirs de l’homme et de ceux de la femme, insulte l’humanité et Dieu. C’est de ce roman que date la prétention des émancipées, prétention artificielle, fausse et ridicule, qui a taché, sinon souillé, quelquefois flétri, toujours rendu ridicules les femmes de mon temps. » Sophie Gay vit dans les salons où ce livre fait un bruit prodigieux. Elle lit les articles qu’il suscite au Journal de Paris, au Journal des Débats où on le combat avec force. La réplique parue dans la Décade ne lui suffit pas. Indignée des phrases acrimonieuses et personnelles du Mercure, elle rompt une lance en faveur de Mme de Staël. Dans le Journal de Paris du 23 janvier 1803, elle signe Sophie XXX une « Lettre d’une mère à sa fille » où elle prend vivement parti.
Cette mère exprime ses angoisses en apprenant que sa fille vient de publier un roman. Sait-elle à quoi elle s’expose ? « Dans le siècle où nous sommes, ce ne sont plus les livres que l’on critique, ce sont les personnes que l’on déchire ». Le journaliste prouve par ses impertinences « qu’un pédant courageux ne craint pas plus une femme d’esprit, absente, qu’un grand homme enterré ». La célébrité est funeste pour les femmes comme le soleil pour la blancheur de leur teint. Sous Louis XIV, sous Louis XV, le talent des femmes a pu passer sans encombre à l’ombre du génie des hommes. Aujourd’hui, ce génie fait défaut, et l’on s’en prend aux femmes. « Attendez donc, ma chère, la naissance d’un chef-d’œuvre pour mettre au jour votre petit ouvrage. Alors, je serai plus tranquille pour mon Eugénie, les sots et les méchants auront une pâture. Mais d’ici-là, persuadez-vous bien qu’une femme ne peut se faire imprimer avec sécurité, qu’autant qu’elle a l’avantage de réunir trois choses indispensables : un esprit médiocre, des amis journalistes, et un mari en place. »
La thèse est singulière ; mais n’y a-t-il pas un accent personnel dans cette riposte ?
Pour mieux affirmer son drapeau, Sophie Gay choisira pour la première fille qui lui viendra, une marraine dotée du prénom de Delphine[48].
Sa situation, celle de son mari, subissent un grand changement à cette époque. Sigismond Gay a étudié une affaire qui promet d’être brillante : des particuliers lui confient trois cent mille francs pour fonder à Anvers une maison de commerce et de banque à laquelle ils assurent l’appui du Gouvernement. On envisage un chiffre d’affaires de trois millions. Gay s’associe un nommé Groix ; au dernier moment, une difficulté surgit entre eux, et ils se séparent. Gay reprend l’idée avec un de ses amis, Sillan, mais transporte le champ de ses opérations à Aix-la-Chapelle. Là, il fournit si bien la preuve de sa capacité, que le 23 avril 1803, un arrêté du Premier Consul « nomme pour remplir les fonctions de receveur général du département de la Roër, le citoyen Gay, en remplacement du citoyen Harent, démissionnaire ». Gay reçoit l’ordre de se rendre sur-le-champ près du préfet, pour prêter serment, et être installé. Le voilà devenu un important personnage, avec les cent mille francs du revenu de sa place, et les bénéfices de sa maison de banque[49].
Telles sont les circonstances à la suite desquelles Sophie de La Valette, devenue Sophie Gay, mit au monde à Aix-la-Chapelle, le 25 janvier 1804, une fille, et les raisons de parrainage pour lesquelles cette fille s’appela Delphine.
II
Aix-la-Chapelle tend à devenir une station thermale de plus en plus fréquentée. Sophie Gay y retrouve des amis parisiens, et s’en crée de nouveaux. Après ses relevailles, elle est venue à Paris, où son état de santé la retient encore, lorsque le bruit court que l’impératrice doit faire à Aix une saison d’eau, et « essayer » sa cour naissante. La nouvelle répand la joie dans le pays. Les vrais malades cèdent leurs appartements aux malades ambitieux, en quête, sous prétexte d’eaux à prendre, d’une place encore vacante dans la Maison impériale. Pour des raisons de santé ou de fortune, M. et Mme de Semonville, M. et Mme de Montholon et leurs fils, Mme Mac Donald, M. et Mme de Turenne, M. de Villoutreix, le duc d’Arenberg, les principaux châtelains des rives du Rhin, arrivent ou vont arriver. De là l’obligation pour Sophie Gay de quitter Paris afin d’aider son mari à faire les honneurs de sa maison, enchantée, au fond, d’assister au spectacle qui va se dérouler.
À Liège, elle a soin d’abandonner sa voiture et de prendre un cheval. L’empereur ne vient jamais dans ce pays, et le corps des Ponts et Chaussées ne juge à propos d’entretenir que les routes par où il passe. Celle de Liège à Aix-la-Chapelle va de fondrières en précipices. Les voyageurs y laissent les débris de leurs voitures. Sophie Gay en a déjà cassé deux ; elle se résout à ne plus faire le trajet qu’à cheval. Comme on ne peut imposer à l’impératrice le même mode de locomotion, Crété, directeur des Ponts et Chaussées, donne l’ordre de boucher les trous avec du sable. Les Aixois estiment la réparation insuffisante, et déblaient ce sable de la route au moment précis où M. le Directeur va la suivre pour se rendre auprès de l’impératrice… et ce haut personnage, d’un embonpoint extrême, verse comme un simple particulier[50].
Mu par des motifs politiques, l’empereur achète pour l’impératrice et sa cour la maison de M. Jacobi, président du collège électoral. Petite et mal com mode, il la paie quatre fois sa valeur. Pfiffer, maître d’hôtel contrôleur de Sa Majesté, s’en rend vite compte, lors de son inspection préliminaire, le dimanche 22 juillet. Il la réserve aux dames du palais, et le préfet Méchin dispose son hôtel pour recevoir la souveraine. En dépit des inconvénients de cette maison, Joséphine, aveuglément soumise aux ordres de l’empereur, décide d’y descendre quand même.
Le 27 juillet, le préfet, les membres du Conseil de préfecture, le secrétaire général, les présidents et membres de la Cour de justice criminelle, M. l’évêque, son vicaire général et deux de ses chanoines, les présidents et membres des tribunaux de première instance de l’arrondissement, l’ingénieur en chef du département, l’inspecteur des forêts, les directeurs des domaines et des contributions, d’autres personnages de moindre envergure, endossent leur plus brillante tenue, et se groupent pour aller au-devant de l’impératrice. Le général de brigade Franceschi, commandant la subdivision militaire d’Aix, et le général Jacobi Trigny, commandant celle de Cologne, se sont portés en avant avec leurs escortes dès le matin.
À midi, solennellement, engoncé dans la raideur des uniformes neufs, le cortège se met en marche, préfet en tête. Il s’arrête au sommet d’une montagne, au bas de laquelle passe la limite du département. « L’avantage de pouvoir saluer notre impératrice chérie, écrit le préfet à son ministre, dans un lieu d’où se découvrait la plus riche et la plus magnifique perspective, m’avait fait choisir de préférence ce local pour l’attendre. Le ciel était assez beau, malgré les orages fréquents qui avaient régné depuis plusieurs jours, et au moment où nous aperçûmes les voitures de Sa Majesté, il sembla s’éclaircir encore. »
Vers quatre heures, le colonel Fuhler, écuyer cavalcadour, annonce l’approche de Joséphine. Des détachements de cavalerie le suivent de près. L’impératrice a parcouru assez rapidement le trajet de Liège à Aix-la-Chapelle : non que l’on ait réparé les routes, mais le préfet du département de l’Ourthe a habilement tourné la difficulté : il a donné l’ordre d’abattre les haies aux endroits les plus périlleux, pour permettre aux voitures impériales, — celle de l’impératrice est un monument, aménagée pour qu’elle puisse y coucher et y faire sa toilette[51], — de les éviter en passant à travers champs et prairies.
La suite de Joséphine se compose ainsi : la duchesse de La Rochefoucauld, dame d’honneur, et quatre dames du palais, la comtesse de Luçay, Mme Lannes, la comtesse de Colbert, la baronne de Vaudey ; le général d’Harville, grand écuyer, et deux chambellans, MM. de Beaumont et d’Aubusson de La Feuillade ; le colonel Fuhler, écuyer cavalcadour, et M. Deschamps, secrétaire des commandements.
Joséphine arrive au sommet de la montagne où l’attendent hommages et discours. M. l’évêque est très bref. M. le préfet adorne ses phrases de fleurs de rhétorique. « Ici, devant Votre Majesté Impériale, est l’antique cité qui fut il y a dix siècles la capitale de l’empire que recommence votre auguste époux. Sous le dôme de cette basilique reposent les cendres de Charlemagne ; ce temple a vu couronner sous ses voûtes trente-six empereurs des Romains, et ses lévites vont saluer dans l’adorée Joséphine la onzième impératrice qui se soit prosternée devant les autels qui les entourent. » En route pour la ville. Le général d’Harville a interdit au maire et aux fonctionnaires municipaux de se rendre aux portes suivant leur désir : il y a là des fossés profonds, sans parapets ; crainte d’accidents, ils restent sur la place d’armes, devant l’hôtel de ville. Là aussi attend le clergé de la cathédrale, avec le dais destiné à Sa Majesté. Le commandant de place est aux portes avec son état-major et un détachement d’artillerie.
À cinq heures, salves d’artillerie : la souveraine entre en ville. Sur le parcours qu’elle doit suivre, la foule stationne, les rues sont décorées d’arbres et d’arcs triomphaux. Un ordre mal compris engage le cortège dans le chemin le plus court qui va des portes à la maison Jacobi, et qui n’est pas du tout celui prévu. Sur la place, le dais, le clergé, le maire, attendent en vain. Désolée, l’impératrice, malgré la fatigue de la route, veut remonter en voiture pour parcourir le trajet fleuri de mâts et garni de foule ; le préfet l’en dissuade. Elle reçoit le maire, le commandant et les officiers des gardes d’honneur, et leur exprime ses regrets. Dans la journée, elle ne reçoit personne. Le soir, se rendant compte de l’impossibilité de se loger dans la maison Jacobi, elle s’installe à la préfecture, tandis que la ville s’illumine.
Le lendemain, 28 juillet, le général d’Harville lui présente les autorités locales. Le 1º août, on lui montre à la cathédrale les reliquaires et objets pré cieux, et un coffret, le Noli me tangere, fermé depuis l’an 1356, qui ne doit être ouvert qu’en une circonstance extraordinaire ; bien entendu, il s’ouvre tout seul sous ses doigts ; il contient quelques fragments de reliques. La présentation des dames est réservée pour le premier cercle tenu par l’impératrice, et les 5 et 6 août elle reçoit les dames de la ville qui sollicitent l’honneur de lui être pré sentées. À ce cercle, la beauté de Mme Méchin et l’esprit de Mme de Semonville brillent de tout leur éclat ; Mme de Turenne se contente de faire briller ses diamants ; on remarque pour leur élégance et leur beauté la femme du général Franceschi, celle d’un commissaire des guerres Mme M…, et, pour la singularité caricaturale de leurs modes arriérées, quelques Allemandes, la baronne de Fuhrt, la baronne de Lovenich, d’autres encore.
Depuis le dîner Fonfrède, Sophie Gay n’a revu Joséphine qu’aux fêtes données en l’honneur du vainqueur de Lodi et d’Arcole. Elle s’en croit complètement oubliée : elle se trompe. L’impératrice lui adresse gracieusement la parole, et admire la coupe de sa robe où elle reconnaît la main de Mme Germond ; son regard s’arrête aussi sur une coiffure qui, « sauf la différence d’une couronne de fleurs à une couronne de diamants », ressemble singulièrement à la sienne. « La pose de la guirlande, le fini des nattes » portent la signature de Duplan. Pour une ancienne pratique, que ne ferait-on pas ? Devenu premier valet de chambre de l’impératrice et libéré de son service avant l’heure du cercle, Duplan avait mis ses talents à la disposition de Sophie Gay… à la suite de quoi il reçoit l’ordre formel de ne plus travailler pour des têtes non couronnées. Il s’appliquera uniquement à coiffer l’impératrice en s’efforçant de cacher ses rides[52].
Peu avant son départ de Paris, Joséphine assista à la première distribution des croix de la Légion d’honneur. L’empereur a décidé qu’elle présidera à Aix-la-Chapelle la distribution des croix qu’il affecte au département de la Roër. La cérémonie a lieu le 10 août, jour où l’on célèbre la fète de Char lemagne. Le clergé, évêque en tête, reçoit la souve raine à la porte de la basilique ; elle traverse sous un dais la longueur de la nef et s’assied sur un trône préparé pour elle dans le chœur. Le front ceint d’un diadème en diamants, elle a revêtu pour la première fois le manteau de cour ; sa robe de moire blanche brodée d’or s’étale sur les degrés du trône ; ses dames l’entourent ; les grands officiers de sa maison se tiennent derrière elle. Uniformes, broderies et parures brillent près des ornements ecclésiastiques, des riches chasubles semées de perles fines données jadis à la cathédrale par l’empereur Othon. Sur l’autel, la couronne et le sceptre de Charlemagne. Le peuple prosterné chante les cantiques de Mozart. « Sous les voûtes de ce temple gothique où Charlemagne donnait l’accolade à ses vaillants chevaliers, à Roland, à Roger, à Renaud, les chevaliers de la Légion d’honneur s’inclinent devant Joséphine, en recevant de ses mains les décorations de l’ordre. »
Le chanoine Gauzargues prononce un sermon émouvant. « Un héros ordonne qu’on célèbre la mémoire d’un héros. Napoléon rétablit les honneurs de Charles, et c’est sous les voûtes antiques de ce temple érigé au Dieu vivant par ce puissant monarque, sur la tombe qui pendant trois siècles enferma ses cendres, en présence des restes de la dépouille mortelle de ce grand homme, devant Votre Majesté Impériale enfin que le restaurateur de l’empire d’Occident veut que l’on renouvelle les hom mages religieux que cette église rendait chaque année à son illustre fondateur. » Mais, pour la joie de Sophie Gay, voici la note comique : le général L… s’avise de prononcer « un discours adapté à la circonstance », où il se félicite de voir « la vertu sur le trône, et la beauté à côté ». Les vertus et les beautés présentes s’en offensent également, chacune faisant peu de cas de la beauté sans vertu, et encore moins de la vertu sans beauté.
L’entourage de l’impératrice apprécie les qualités de Sophie Gay. « Aussi belle que spirituelle, elle embellit notre cercle et l’anime par le charme de son esprit », dit l’une des dames du Palais, la baronne de Vaudey[53]. Ce soir-là, Joséphine lui demande ce qu’elle pense du discours du général L… Question embarrassante ! L’interpellée ne veut déplaire ni au général, ni à la souveraine. Elle s’en tire platement, en répondant que, distraite par le pompeux spectacle de la cérémonie, et très persuadée que le général orateur ne pouvait adresser à Sa Majesté « que des vérités agréables », elle n’a pas pensé à l’écouter.
— Ce qui ne vous empêchera pas d’en rire de bon cœur ce soir avec vos amis, lui dit tout bas Joséphine.
Sophie Gay, étonnée, ignore que Deschamps, le secrétaire des commandements, a parlé des charmants soupers que donne M. le Receveur général. Ami de Gay, Alexandre Duval passe la saison chez lui ; précurseur de Scribe et de Dumas père, Duval, après avoir tracé au crayon noir des portraits de conventionnels avec Isabey pour six francs pièce, après avoir été le rival de Trénitz, et demeurant toujours le camarade de Garat[54], n’est pas moins joyeux convive que Picard, directeur de la troupe du théâtre Louvois, lequel a reçu ordre de transporter sa scène à Aix pendant le séjour de José phine. Mi-comédiens, mi-auteurs, ces deux futurs académiciens ont la langue affilée. Ils font partie du groupe d’amis qui entoure habituellement le comte Daru, et se réunit régulièrement en un déjeûner dominical[55].
Le soir, on soupe, on s’en donne à cœur-joie de railler les ridicules de la nouvelle cour, la bassesse de ceux qui se prosternent là où on ne leur demande que de s’incliner, et de rire aux dépens des braves officiers dont la brusquerie se plie mal aux manières de l’ancienne cour. Jeune, beau et brave, le général qui commande le département ignore ces usages. L’impératrice est assise sur un canapé la première fois qu’il lui rend visite ; sans la moindre gêne, il s’assied à ses côtés. Le chambellan lui avance un siège, la dame d’honneur lui fait signe de s’y asseoir, il les salue, et ne bouge pas. Joséphine a la charité de ne pas s’en apercevoir ; mais l’officier de gendarmerie chargé de l’espionner envoie son rapport à l’empereur, et c’est elle qui reçoit la réprimande pour avoir supporté une pareille familiarité.
Un autre officier, « intrépide soldat des armées républicaines, adorant Bonaparte, grognant sur ses décrets, mais lui obéissant en esclave », apprenant chez Sophie Gay l’arrivée à Aix de M. et de Mme de Turenne, s’écrie :
— À la bonne heure : puisque le général a la rage de vouloir mêler des noms aristocratiques aux nôtres, qu’il nous en donne comme celui-là ; il n’y a pas un colonel qui ne soit flatté d’être le camarade du petit-fils de Turenne !
Impossible de lui faire admettre que Turenne n’eut pas de fils, et que les ancêtres des muscadins d’émigrés ne se battaient pas moins bravement. Celui-là, le capitaine d’H…, commanda le peloton de gendarmerie d’élite qui fusilla le duc d’Enghien. Il pâlit à ce souvenir qui surgit dans une conversation avec Sophie Gay. À peu de jours de là, il lui dit :
— Vous m’en voulez d’avoir fait mon devoir ?
— C’est vrai ; mais c’est une injustice qui passera, j’espère.
— Jamais ! Les femmes sont comme les généraux en chef : il ne faut jamais leur raconter que ce qui nous fait honneur.
À dater de ce jour, elle ne l’a plus revu. « Il a été tué à l’une de nos victoires », dit-elle[56].
L’impératrice a fait une allusion à Mme Tallien ; pour en parler plus à son aise, elle engage Sophie Gay à lui demander une audience. La jeune femme retrouve là Mme de Beauharnais dans sa simplicité et sa bienveillance. Joséphine parle de Thérésia : l’empereur ne lui pardonne pas d’avoir dédaigné le grand rôle qu’elle était appelée à jouer après avoir délivré la France de Robespierre. « Bonaparte en veut à tous ceux qui manquent leur destinée. » Pourtant, il n’oublie pas les services qu’elle leur rendit à tous deux autrefois. Il est plus sensible et reconnaissant qu’on ne croit.
La conversation saute aux souvenirs de la Malmaison. Méhul, Ducis et Népomucène Lemercier, des habitués que Joséphine aimait, l’ont abandonnée ; les deux derniers viennent de renvoyer à l’empereur la croix de la Légion d’honneur ; elle les blâme. Puis elle revient à M" Tallien en regardant, comme dans les comédies, si personne n’écoutait.
— Il faut que vous engagiez Thérésia à rompre ses rapports d’amitié avec Ouvrard. Bonaparte le croit un de ses plus grands ennemis ; c’est là, à vous dire vrai, l’unique cause de son animosité contre elle. Tâchez d’obtenir ce sacrifice, et je suis sûre qu’il lui rendra son ancienne affection et me permettra de la revoir comme autrefois.
Commission pénible, sans aucune chance de succès.
— N’importe ! promettez-moi de l’engager à suivre mon conseil. Mon Dieu ! on n’a pas toujours une aussi bonne raison pour…
Elle n’achève pas ; Sophie ne peut retenir un sou rire. De fait, sans s’arrêter à des pamphlets comme celui qui valut au marquis de Sade une prison définitive et qui compromit Joséphine elle-même, on conviendra que Thérésia ne donnait pas précisément l’exemple de l’ordre que Napoléon voulait rétablir dans la société et dans les mœurs. Après avoir eu un fils de M. de Fontenay, elle avait eu, probablement d’Ouvrard, un fils et une fille pendant que Tallien était en Égypte, et encore une fille pendant la procédure en divorce. Le divorce prononcé le 8 avril 1802, elle se remarie le 18 juillet 1805 avec le comte Joseph de Caraman, bientôt prince de Chimay. Elle en aura trois enfants. Elle ne sera, d’ailleurs, jamais reçue à la cour des Tuileries ni à celle de Bruxelles, et se consolera en s’en créant une à Chimay[57].
Ce sujet épuisé, Joséphine parle chiffons. Mme de Saint-Hilaire, première femme de chambre, apporte la dernière parure de Leroi.
— Qui vous a coiffée hier ? Vous aviez un turban drapé à merveille.
— Ah, mon Dieu ! Votre Majesté va encore sévir contre celui-là ?
Le turban est d’Herbault, second valet de chambre de l’impératrice, qui se promet d’employer son jeune talent.
Des chiffons, on passe au théâtre. Picard devrait bien varier son répertoire :
— Ne trouvez-vous pas que ses continuelles satires contre les parvenus sont passées de mode ?
Normande, Sophie Gay répond :
— Je crois qu’il donne demain une pièce nouvelle.
— En savez-vous le titre ?
« J’allais le dire… quand un instinct femelle m’arrêta tout à coup », a-t-elle écrit. La pièce s’appelait : la Femme de quarante-cinq ans. Or, Joséphine arrivait à cet âge où l’on a besoin du mystère de la toilette pour réparer des ans l’irréparable outrage[58]. Picard, en affichant ce titre, manque de tact. À la représentation, Sophie voit de sa loge la figure de l’impératrice se contracter à chaque plaisanterie lancée contre la femme de quarante-cinq ans. Elle préférerait ne pas avoir à donner son opinion, mais par son chambellan Joséphine l’invite à venir dans son salon après le spectacle. « À peine avais-je fait mes révérences, que l’impératrice me dit avec un sourire tant soit peu amer :
» — Eh bien, madame Gay, comment trouvez-vous la pièce nouvelle ? Moi, je ne saurais la juger. On devrait conseiller à Picard de ne la jouer que devant des femmes de vingt-cinq ans.
» — Il me semble, madame, qu’il y pourrait comprendre celles qui ne paraissent pas en avoir davantage.
» Cette flatterie assez mal tournée me valut un regard affectueux. »
Pour punir Picard, Joséphine ménage une faveur à Alexandre Duval. Elle sait par Deschamps que Duval doit lire une comédie chez Sophie Gay : la lecture aura lieu au palais impérial. Duval revient d’un tour en Russie où il a fui le mécontentement provoqué chez le Maître par son Édouard en Écosse. Il craint quelque mésaventure nouvelle, et n’a pas envie de retourner chez les Moscovites. Mais on l’assure de la bienveillance de Joséphine, et Sophie Gay l’introduit à la cour.
À leur entrée, le salon est bondé. Grosse affaire que de régler l’étiquette d’un cercle où pour la première fois tout le monde est assis ! Mme de La Rochefoucauld est au supplice ! Il y a eu des hésitations, de l’inexpérience, des vanités froissées ; Sophie remarque que ce spectacle captive Alexandre Duval au point de lui faire oublier qu’il y doit jouer son rôle. D’un geste, l’impératrice invite l’auteur à prendre place à la table préparée pour lui ; un signe du général d’Harville, et hommes et femmes s’asseoient. Un silence. « Et le premier acte s’écoule comme un ruisseau sur un terrain plat. »
Le titre de la pièce : le Tyran domestique, a mis quelques courtisans en défiance. Ils se rassurent vite. L’attention et les éloges de l’impératrice décident du succès de la lecture, qui s’achève sur une mésaventure de M. le Directeur des Ponts et Chaussées, Crété : il a bravé ses propres routes pour assister à la soirée, et en éprouve une telle fatigue que, dans l’excellent fauteuil où le hasard l’a installé, ses gros membres se détendent, son gros corps se délasse, et il s’assoupit. Le bruit des voix qui complimentent l’auteur le réveille. Voyant tout le monde debout, confus d’être le seul assis, il veut se relever précipitamment : « Mais les beaux cygnes blancs sculptés par Jacob et qui soutiennent les bras du fauteuil, se sont incrustés pendant son sommeil dans les cuisses du dormeur ; rien ne peut les en séparer, et c’est armé de ce bouclier tenace qu’il vient mêler ses éloges à tous ceux dont on accable l’auteur ». Il n’y a pas de sérieux qui tienne devant le comique d’une telle situation. L’impératrice s’efforce de n’en rien voir ; le rire qui gagne l’assistance s’égare sur l’un des personnages de la pièce, que l’auteur n’aurait jamais cru si drôle…, jusqu’à ce que le fauteuil lâche sa proie.
Entre temps, une expérience personnelle apprend à Sophie Gay la confiance que méritent les récits officiels. Elle reçoit une lettre très détaillée, très exacte, relatant le désastre arrivé à la Flottille de Boulogne par la faute de l’empereur, qui n’a pas voulu revenir sur un ordre inconsidérément donné à l’amiral Bruix. L’impératrice en reçoit une également ; elle en fait part à son entourage : simplement, une imprudence de Bruix a failli être funeste à la Flottille, et, pour finir, l’empereur s’accuse d’avoir beaucoup ri d’une mésaventure survenue au ministre de la Marine, Decrès : peu ingambe et fort replet, le ministre a voulu passer sur une planche, du quai à bord d’une canonnière ; il perdit l’équilibre, tomba à l’eau, et ne fut repêché qu’à grand’peine. À ce récit chacun de rire, comme avait ri l’empereur.
Soudain, l’arrivée de quelques grands personnages annonce celle de Napoléon. Parti de Saint-Cloud le 18 juillet, il a surveillé les opérations du camp de Boulogne jusqu’au 23 août, et de là s’est rendu à Coblentz[59]. Le mardi, 2 septembre, à midi, il fait son entrée dans Aix-la-Chapelle. Le maréchal Mortier, le général Mouton, deux grands et beaux hommes qu’admire fort le peuple allemand ouvrent la marche, avec un état-major éblouissant. Sans débrider, Napoléon donne ses audiences. Il visite les manufactures de draps, les fabriques d’épingles, et prend des décrets qui en favorisent l’essor. Il assiste aux fêtes que la ville donne en son honneur. Le 7 septembre, il se fait montrer à la cathédrale les reliques envoyées à Charlemagne par l’impératrice Irène. La grande dimension d’un os du bras de Charlemagne qu’on lui exhibe attire son attention. Il demande à Corvisart à quelle partie du bras cet os correspond. Corvisart sourit, et ne répond que sur une nouvelle interpellation. L’os est un tibia.
— Eh bien ! Gardez cette découverte pour vous. Il faut respecter tous les préjugés.
L’impératrice admire fort un camée tenant à l’une des châsses du Trésor ; le clergé le lui offre ; l’empereur lui défend d’accepter : « Action toute impériale qui fut médiocrement approuvée par Joséphine ». Mais Napoléon fera transporter au Louvre le pseudo-bras de Charlemagne, qui y restera jusqu’en 1815[60].
En sortant du Trésor, Napoléon s’assied sur le fauteuil de marbre où s’asseyaient pour leur couronnement les empereurs d’Allemagne, et sur lequel Othon III avait découvert le corps de Charlemagne. Que de rapprochements alors dans les esprits ! et que n’augure-t-on pas du règne qui commence !
Sophie Gay admire ces grandeurs. Le respect ne lui enlève pas sa présence d’esprit. Le jour où Napoléon l’aborde à sa manière brusque, elle lui répond du tac au tac.
— Madame, ma sœur vous a dit que je n’aimais pas les femmes d’esprit ?
— Oui, Sire, mais je n’en ai rien cru.
— Vous écrivez ? Qu’avez-vous fait depuis que vous êtes ici ?
— Trois enfants, Sire.
Il sourit, et passe, à ce rappel de sa réplique fameuse à Mme de Staël en 1797.
De fait, une des amies de Sophie Gay disait :
— Est-elle heureuse, cette Mme Gay, elle fait tout bien : les enfants, les livres, et les confitures[61].
— Peut-on un éloge plus complet ?
Elle et son mari ont connu Maret, et sollicité l’honneur de l’héberger. Maret travaille la nuit jusqu’à deux heures du matin. S’il entend encore parler dans le salon, il entr’ouvre la porte de son cabinet, et demande s’il n’est pas de trop. On l’accueille avec joie dans ce cercle de bons rieurs et de causeurs spirituels, artistes, aides-de-camp, maréchaux en herbe, qui jouent à la bouillotte tout en se racontant des histoires. Un soir, voilà Picard au désespoir : son jeune premier, Clozel, beau, pré somptueux et galant, admis dans une maison de la ville, fait la cour à la maîtresse du lieu ; il ne remarque pas la jalousie d’un ami de la dame. Ce dernier surprend un rendez-vous donné pour le lendemain dans un bois voisin. Pour l’empêcher sans scandale, il a recours à la pharmacie, et laisse tomber deux grains d’émétique dans la tasse de thé de Clozel. L’avantageux jeune premier absorbe la boisson, se sent mal, et se croit beaucoup plus grave ment atteint qu’il ne l’est en réalité. À cette nouvelle, Picard s’affole : le jeune premier doit jouer le soir même dans la seule représentation à laquelle assistera l’empereur. Que faire ?
Picard s’indigne des rires qui accueillent son désespoir. Sophie Gay lui conseille de confier l’histoire au secrétaire des commandements de l’impératrice ; Deschamps la contera à Joséphine, qui ne manquera pas d’en amuser l’empereur, et sûrement tout ira bien. En effet, on voit M. de Rémusat se rendre au domicile de Clozel ; il vient prendre de ses nouvelles… de la part de l’empereur, sans nul doute. Électrisé par ce témoignage d’intérêt, Clozel jouera, mort ou vif. Et jamais le rôle de Rifflard ne fut mieux tenu, et jamais il ne fit rire le public d’aussi bon cœur.
Sophie Gay adore veiller. Elle veillerait, dit-elle, même avec des ennuyeux, si les ennuyeux aimaient à veiller, ce qui ne s’est jamais vu. Maret la ravit chaque fois que son arrivée prolonge la soirée. Quel intérêt, aussi, à écouter la parole d’un personnage qui passe sa vie dans l’intimité du grand homme, et qui sait causer en homme du monde et en lettré ! Quelle saveur il donne à une simple anecdote datant de l’armée d’Italie : les soldats rient de voir leur chef les commander avec son petit chapeau râpé, déformé, imprégné de la poussière des batailles ; ils se cotisent pour lui en payer un neuf, et le général Bonaparte s’amuse de cet hommage, qui le flatte.
Maret a les poches pleines de lettres de soldats dans le goût de celle-ci : « Votre Majesté est trop juste et connaît trop bien mon oncle Eustache pour croire qu’il me donnera jamais un sou du bien de ma mère, à moins que je n’aille au pays lui parler de la bonne encre. C’est pourquoi il me faut un petit congé. » Quand par hasard une de ces lettres tombe sous les yeux de l’empereur, il est rare qu’il n’y fasse pas une réponse favorable.
Son séjour à Aix-la-Chapelle dure une semaine. Le 11 septembre, à cinq heures du matin, il se met en route pour visiter le nord du département de la Röer. Le lendemain 12, l’impératrice part à son tour pour Cologne où elle doit le rejoindre, et où les dames qui prétendent à la présentation s’exer cent à des révérences compliquées et comiques[62]. Cette visite a lancé Aix-la-Chapelle comme ville d’eaux. Les séjours qu’y feront les membres de la famille impériale augmenteront sa vogue.
La préfecture est presque chaque année palais impérial ou palais royal. En août et septembre 1806, séjour du roi et de la reine de Hollande[63]. En 1809 et 1810, saisons particulièrement brillantes : les étrangers affluent pour voir Madame Mère qui vient soigner ses névralgies, le roi et la reine de Hollande, la princesse Pauline à qui les médecins prescrivent les eaux. Pauline apporte tant d’agrément dans les réunions que, dit Beugnot, le roi Louis lui-même ne parvient pas à les attrister. Joséphine, depuis le divorce, y vient beaucoup plus souvent qu’à Plombières, qu’elle préférait auparavant. Chacune de ces puissances a sa cour, et chaque cour s’orne « de femmes aimables et de gens bien élevés ».
Sophie Gay assiste à toutes les fêtes. Elle savoure des couplets comme ceux que l’on chante à l’inauguration des portraits de l’empereur et de l’impératrice, le 1er juin 1809 :
Répétons donc, Messieurs, d’une voix unanime,
Vive Napoléon, ce héros magnanime.
Il versa ses bienfaits sur l’heureuse Cité,
Qui date son bonheur du jour qu’il a régné.
N’a-t-il pas de quoi déchaîner son enthousiasme, ce programme de la fête donné pour la naissance du roi de Rome ? Salves d’artillerie ; le portrait que Sa Majesté a daigné donner à la ville sera orné de guirlandes de fleurs ; les eaux jailliront devant la statue de Charlemagne ; la grande effigie de ce monarque sera promenée dans la ville, portée par plusieurs hommes cachés sous son manteau ; de dis tance en distance, elle jettera des bonbons, et d’une main elle portera son sceptre sur lequel sera écrit en gros caractères français et allemands : Je ne suis surpassé que par Napoléon. L’hôtel du préfet, l’hôtel de ville seront décorés de verdure et d’emblèmes analogues à la fête. Trois rosières seront mariées à des militaires blessés, etc.
Les relations de Sophie avec la reine Hortense datent probablement de son séjour à Aix. Ses grandes amies, Mme Regnault de Saint-Jean d’Angély et Mme Hainguerlot, s’y rencontrent avec la princesse Pauline. Le préfet, Alexandre de Lameth, est un vieil ami de la famille Gay. On continue à s’amuser beaucoup chez le receveur général. Des plus assidus à ces réunions, Barthélemy, jeune sous-préfet, se rappelle avec joie les heureux moments qu’il passa chez ce « fastueux ménage »[64].
Mme Gay vient de passer la trentaine. Sa physionomie vive, mobile, « pétille d’esprit » — l’expression revient sous la plume de tous ceux qui la décrivent, — mais d’un esprit plus malin que fin ; la taille belle, la figure régulière, l’air impérieux, le ton décidé, la parole prompte, la réponse vive, l’allure un peu masculine, la distinguent. Elle anime ses salons, où chacun se sent bien chez soi, mais amuse plus qu’elle n’attire. Elle ouvre sa mai son tous les soirs. On joue au whist, au quinze ou à la bouillotte. À onze heures, les personnes sérieuses se retirent : restent les intimes, Alexandre de Lameth et son état-major, M. de Pontécoulant et d’autres bons amis venus de Paris. Le maître de la maison va se coucher. Alors commence la seconde, la vraie soirée, qui se prolonge au moins jusqu’à deux heures ; l’entrain de la maîtresse de maison fait toujours paraître le temps trop court ; quel feu roulant d’anecdotes vivement contées ! Que de chansonnettes, de petits vers souvent passablement gaulois ! On met les tables de jeu bout à bout, et chacun s’installe à sa guise pour souper. On rit, on cause, on chante des couplets ; Sophie Gay en compose, et Montozon lui en inspire : originaire du Midi, son imagination l’incite à aventurer en son parler gascon des histoires peu vraisemblables, et voici la flèche qu’elle lui décoche :
En passant par l’Estramadure,
En franc amateur de gibier,
On avait mis sur la voiture
D’œufs de perdrix un plein panier.
Mais la chaleur était horrible :
De chacun sortait un petit.
— Eh ! Messieurs, ce n’est pas possible !
— C’est Montozon qui me l’a dit !
Barthélemy s’installe à un bout de table, Sophie se met à sa gauche, et un intime de la maison à sa droite. Bientôt il sent un petit pied effleurer son pied gauche ; pareille attaque se prononce sur sa droite. Il répond à ces tendres pressions. Soudain, au milieu d’un rire général provoqué par quelque saillie, il se relève brusquement en retirant sa chaise : les intéressés voient clairement qu’il était en tiers dans leur entretien. Ils se regardent, sur pris, mais ne lui témoignent aucune mauvaise humeur. Par contre, il se fait vertement tancer un jour qu’il revient de Paris avec un paquet et une lettre pour une dame de leurs relations. La lettre devait être remise personnellement. Il n’y voit pas malice, et la porte au logis du ménage, où elle provoque un violent orage. Sophie Gay le prêche de la belle façon, et conclut :
— J’aimerais mieux coucher avec quatre hommes que d’écrire une lettre !
Ce qui prouve que les belles dames du Directoire parlaient un langage aussi franc que les honnestes dames de Brantôme.
L’été à Aix-la-Chapelle, l’hiver à Paris, elle goûte fort cette existence. Depuis 1803, elle habite dans la capitale une grande maison avec jardin, 9, rue des Mathurins, au coin du passage Sandrié. Son salon dénote une artiste aimant l’éclat, la fanfare, l’élégance, les beaux-arts. Le meuble est couvert de casimir écarlate ; le piano demeure ouvert ; deci, delà, des miniatures d’Isabey et de Cicéri, des objets de bon goût. En bonne place, un buste de la princesse Borghèse sur un piédestal, et un grand portrait de la maîtresse de la maison alors qu’elle était dans sa fleur, par Bonnemaison. La peinture en est bonne, la pose gracieuse, l’expression fine, mutine, intelligente, les bras beaux et purs de ligne, les cheveux bouclés ; les seins roses transparaissent à travers la gaze légère de la robe blanche[65]. Elle a sa loge à l’Opéra et au Théâtre-Français. Le spectacle finit à onze heures ; elle n’attend pas le baisser du rideau pour rentrer chez elle, car elle reçoit tous les soirs. Les amis d’élite viennent causer des événements de la journée, usage de ce temps qui favorise les conversations intimes, les rapports d’esprit et d’amitié. On continue l’entretien de la veille, on échange des éloges et des épigrammes qui ne blessent pas, et l’on ne parle pas politique[66]. On discute littérature et beaux-arts ; si l’on chante des romances élégiaques, où les chevaliers gémissent sur leurs coursiers, où les troubadours plaintifs jurent d’aimer toujours, on se rattrape en riant à cœur-joie des saillies spirituelles qui fusent à tous propos.
Ces habitués, ce sont le comte de Pontécoulant, qui ne passe pas deux jours sans venir ; Népomucène Lemercier ; Étienne dit de Jouy, militaire sous la Révolution, aujourd’hui publiciste, bientôt académicien : Charles de Longchamps, chambellan de Caroline Murat, surintendant de ses théâtres, auteur d’ouvrages spirituels aujourd’hui bien éventés ; d’Aure ; Coupigny, le roi de la romance, à d’autres heures honnête employé au Ministère de la Marine, puis à celui des Cultes ; Musson le mystificateur et Lenoir son compère ; Alexandre Duval ; Dupaty ; Garat la mousique, comme disait Piccini, avec ses gilets prodigieux, son zézaiement d’incroyable, ses cravates Directoire ; le jeune J. de Norvins, à la fois amusant conteur et remarquable causeur, fils d’un ancien receveur général des finances, ancien émigré rentré en France pour accompagner le général Leclerc à Saint-Domingue d’où par chance il est revenu sain et sauf au printemps de 1803 ; d’Alvimare et sa harpe ; Frédéric Duvernois et son cor. Du côté des femmes, Sophie Gail, Mme Récamier, l’ex-Mme Tallien devenue princesse de Chimay, Mme Pelleport, la marquise de Custine, Mme Regnault de Saint-Jean-d’Angély, Mme de Barral, et une cousine de Sophie Gay, Mme de Grécourt. Elle reçoit aussi : Mlle Contat, Mlle Mars, Mlle Duchesnois ; des musiciens comme Spontini, Méhul, et Paër avec sa grosse tête, sa verrue sur le nez, et ses gros doigts que l’on s’étonne de voir caresser les touches avec autant de précision et de délicatesse ; des chanteurs comme Della Maria, Dalayrac, Elleviou aux cheveux blonds et bouclés, et le castrat romain Girolamo Crescentini, qui triomphait en ce temps dans Romeo e Giulietta, l’opéra de Zingarelli. Alexandre Soumet, dont tout Paris récite l’élégie de la Pauvre Fille, fait la connaissance de Talma dans ce salon où se réfugie l’aristocratie ralliée, et où l’on accueille d’illustres mécontents : le duc de Laval-Montmorency, Benjamin Constant, le duc de Broglie, Chateaubriand vers la fin de l’Empire, le duc de Choiseul, Lamoignon, le duc de Léry, l’élégant comte de Forbin, Perregaux, le comte Germain. L’aimable et charmant vicomte de Ségur n’est malheureusement plus là : la mort l’a emporté en 1805. Le chevalier de Boufflers est devenu un vieillard maigre et pâle, avec deux petites ouvertures en manière d’yeux, une petite tête poudrée « à l’oiseau royal » sur un corps de taille ordinaire, habillé tant bien que mal d’un habit râpé dont la broderie verte indique l’Institut ; tel quel, il fait le tour du salon ; quoique bien laid, il sourit avec grâce ; il dit à chaque femme un mot, un mot d’esprit d’une qualité fine et rare.
Quels agréables souvenirs se ménagent les jeunes gens ! On jouit là d’une complète liberté ; la vie se dépense et se paie argent comptant ; nulle prétention, rien ne gêne l’essor des esprits. Les talents de Sophie Gay qui joue du piano et de la harpe en virtuose, son culte pour les arts et pour les lettres, l’égalité de son affection, donnent un charme unique à ces réunions. « Jamais, dit J. de Norvins, l’hospitalité de la civilisation n’avait eu cet attrait, cette couleur, ce caractère. » Franche gaîté, causerie imprévue, musique délicieuse concourent au plaisir. Un prince prie Sophie Gay de le faire dîner avec Musson, Musson, le mystificateur professionnel, l’air bonhomme et un peu lourd, dont l’œil éteint s’allume lorsqu’il a lâché quelque balourdise bien conditionnée. Le prince se voit présenter, au lieu de celui qu’il espérait connaître, un mineur, Goffin, qui a sauvé plusieurs de ses camarades et mérité la croix : il en porte une énorme, pendant jusqu’au bas de son gilet. Il parle houilles sans arrêter.
— Vient-il des femmes dans les mines ?
— Beaucoup. Elles paraissent blanches dans le charbon.
En partant, le prince dit à son hôtesse :
— Ce brave homme m’a beaucoup amusé, mais je crois que Musson me fera encore plus rire.
— Eh bien ! répond-elle, je vous promets de vous le faire revoir.
Ainsi apprend-elle au prince qu’il a dîné avec Musson, et non avec Goffin.
Le jour de la fête d’Alexandre Duval, Sophie Gay joue chez elle un impromptu distribué entre Boïeldieu, le prince de Chimay, Mme Grassini, d’Alvimare, et Talma qui pour la première fois remplit un rôle bouffe.
On veillerait toute la nuit, si l’on n’était rappelé à l’heure et à la réalité par les invectives d’un perruquier, logé vis-à-vis, qui l’hiver, bien après minuit, vient arracher sa femme de la fenêtre ouverte où elle s’oublie aux mélodies de Garat, de d’Alvimare, de Duvernois, et des autres[67].
Sophie Gay retrouve plusieurs de ses amis chez le comte Regnault de Saint-Jean d’Angély. On raille la brune Mme Regnault de Saint-Jean d’Angély de ne se laisser jamais voir que de profil, un profil, au reste, beaucoup moins pur et grec que des flatteurs l’ont dit. Pauline Bonaparte va répétant : « Avez-vous remarqué comment elle entre dans un salon ? En marchant de côté, comme les crabes ! » Pourtant le portrait qu’en fit Gérard la montre de face ; on remarque l’écartement des yeux, qui n’enlève rien au charme extrême d’un ensemble séduisant. Le portrait peint à Milan par Appiani confirme cette impression[68]. Faisant allusion à ces images, plus tard, devenue vieille, Mme Regnault de Saint-Jean d’Angély dira à la plus jeune fille de Sophie Gay, en mettant de l’ampleur dans sa phrase, et des accents circonflexes :
— Va voir dans le salon comme j’étais belle ![69].
On la surnomme, en effet, belle et bonne. L’empereur se montre quelquefois dur pour elle : sous la Restauration, elle ne se rappellera que ses bienfaits, et ne demandera jamais aux Bourbons sa pension de veuve d’un conseiller et ministre d’État. Elle sculpte et chante ; toute jeune, elle assista au fameux souper grec de Mme Vigée-Lebrun ; elle a affronté la Conciergerie avec calme ; aujourd’hui, elle est fort « de la cour », et réunit dans son salon une société d’élite, bien que le duc de Broglie, qui en est, remarque que l’on y voit « plus d’hommes que de maris ». Les femmes, outre Sophie Gay, sont Mme Récamier, Mme de Staël, Mme Hamelin, et les hommes, Garat, Gérard, Millin, Arnault, Foureroy, Chaptal, le duc de Bassano, La Fayette, Benjamin Constant, Auguste de Colbert, le comte de Fuentès, Alphonse Pignatelli[70].
Sophie Gay fréquente le salon de Talma, où grands du jour, courtisans de l’ancien régime, artistes, hommes de lettres, savants, intrigants, agioteurs se donnent la main et jouent au boston. « Tourbillon d’esprit », elle enveloppe, enlève, étourdit l’helléniste Clavier, qui n’en peut plus et suffoque. Gérard cause finement, comme toujours, avec le bon vieux Ducis, patriarche à cheveux blancs, à l’air inspiré, au regard étincelant ; le mathématicien Legendre écoute Musson qui joue des proverbes ou mystifie un provincial frais débarqué. Mme de Bawr brille de tout son éclat, Mme de Bawr, auteur de huit pièces de théâtre et de trente volumes, pas un de moins, dont elle a consacré six à l’histoire, un par siècle du xive au xixe, et cela sans frémir. Arnault, Chénier et Lemercier vont de pair, les trois tragiques qui se sont partagé la succession de Voltaire « comme Antiochus, Cassandre et Lysimaque se sont distribué l’héritage d’Alexandre ». En dépit du ton réservé de la maîtresse du lieu, des écarts de langage pimentent parfois la conversation de ces hommes et de ces femmes d’esprit[71].
Souvent aussi, Sophie Gay se montre chez la princesse de Chimay. Elle y rencontre le duc de Gaëte, qui va bientôt jouer un rôle dans son existence, le cardinal Caprara, de Saint-Just, Arnault, Legouvé. Elle y entend pour la première fois chanter la comtesse Merlin. Lorsque les Chimay habitent leur château, où ils ont établi un théâtre, elle donne sur cette scène « un mauvais vaudeville de circonstance, le jour de saint Joseph, en l’honneur du patron du prince de Chimay ». Elle a pour interprètes Isabey, Ciceri, et Mme Grassini qui joue le rôle, conçu à son intention, d’une marchande de chansons[72].
Comédie encore chez Mlle Contat, devenue ouvertement Mme de Parny, et logée au château d’Ivry. Pour habituer sa fille à la scène, Mme de Parny fait jouer chez elle Tartufe ; Charles de Longchamps remplit le rôle de Tartufe ; Alissan de Chazet, réputé pour sa maniêre de lire la comédie, celui de Cléante ; Mme de Parny fait Mme Pernelle, Mlle Mars, Elmire, et Fleury, Orgon ; ainsi entourées, Amalric et Émilie Contat se tireront bien des rôles de Dorine et de Flipote. Un grand dîner précède la représentation, qui offre pour grosse attraction le début de Mlle Mars dans l’emploi où elle va triompher au Théâtre-Français : date notable dans les fastes de la scène ; Sophie Gay se trouve là, comme elle se trouvera jusqu’à son dernier jour à toutes les manifestations un peu marquantes de la vie parisienne[73].
Elle assiste aux fêtes du mariage de l’empereur. Le 1er juillet 1810, elle conduit sa fille Aglaé, qui a dix-sept ans maintenant, au bal de l’ambassade d’Autriche. Elle est près de l’empereur lorsque le feu prend. Elle juge aussitôt qu’une salle de bois risque de flamber subitement. Elle crie : « Ma fille ! ma fille ! » Le danseur de la jeune fille la sauve du feu et de la foule. Un colonel aide la mère à gagner une porte du jardin par un escalier qui s’écroule sous leurs pieds. « Les hommes de ma société, écrit-elle à Mme de Grécourt, se sont tous distingués dans cet incendie par des traits héroïques. Il n’est pas jusqu’à ce brave colonel Hulot qui n’ait employé le seul bras qui lui reste à sauver en se brûlant lui-même les femmes que le feu dévorait[74]. »
Cette constante activité mondaine ne l’empêche pas de surveiller de près l’éducation de ses filles. En pareille matière, elle ne prêche pas dogmatiquement la théorie : elle réalise la pratique. Ses idées sur l’éducation ont beau ne pas concorder avec celles de la docte Mme de Genlis : elle n’en a pas moins fait de ses filles des femmes remarquables, et de l’une d’elles une femme exceptionnelle. Comment s’y prend-elle ? Voici de quelle encre elle écrit, le 17 juin 1809, à sa fille Euphémie, « chez Mmes Mascarier, barrière Chaillot », à la veille de la première communion de l’enfant : « Reçois, ma chère enfant, toutes les bénédictions de mon cœur et les vœux qu’il forme pour ta félicité. Elle sera durable si tu conserves les bons sentiments qui remplissent en ce moment ton âme ; car le malheur n’atteint jamais complètement ceux que leurs vertus font chérir. Sois douce, mon Euphémie, et surtout indulgente ; apprends de bonne heure à sacrifier les intérêts de ton amour-propre aux petites faiblesses des gens qui voudront t’humilier. Venge-toi de l’injure par le bienfait, et, ce qui est peut-être plus difficile encore, de l’impolitesse par l’obligeance ; et tu verras que le ciel récompense généralement tous les sacrifices que le devoir impose par le plaisir d’avoir mérité sa protection, et le charme d’être aimé de tout ce qui nous entoure[75]. » Elle ne cherche pas à se mettre à la portée de son enfant : elle en élève l’esprit au niveau du sien. Ce qu’une observation intelligente du monde lui a appris, elle le condense en une phrase, en un conseil qui enferme non seulement une morale mondaine, mais encore une philosophie humaine.
D’ordinaire, elle ne semble guère occupée des choses de la politique. Pourtant, en 1811, elle se mêle à une intrigue que, par la suite, on ne débrouillera pas sans peine. Cette année-là, Cha teaubriand a vu s’élever des nuages entre l’empereur et lui : d’abord à propos de son discours à l’Académie que Napoléon corrige, puis à propos du temple de Jérusalem que Chateaubriand veut reconstruire, enfin à propos d’un ministère des Bibliothèques dont Chateaubriand demande la création à son bénéfice. La situation se tend au point qu’il se croit menacé. À ce sujet, il écrit dans ses Mémoires d’outre-tombe[76] : « Des personnes pleines de grâce, de générosité et de courage, que je ne connaissais pas, s’intéressaient à moi. Mme Lindsay, qui, lors de ma rentrée en France en 1800, m’avait ramené de Calais à Paris, parla à Mme Gay ; celle-ci s’adressa à Mme Regnault de Saint-Jean d’Angély, laquelle invita le duc de Rovigo à me laisser à l’écart. Les femmes de ce temps-là interposaient leur beauté entre la puissance et la fortune. »
Les Mémoires d’outre-tombe commencèrent à
Miniature par Isabey
pas plutôt publié que Fortunée Hamelin, dont l’âge n’a pas glacé les ardeurs, le déclare « ridicule et fait pour des bonbons », et parfaitement inexact. Le 1er août, elle écrit à la comtesse Kisseleff une lettre qui paraît en feuilleton dans le Constitutionnel ; elle y raconte comment, dans les serres de Boursault, elle ménagea une entrevue entre Chateaubriand et le duc de Rovigo ; la conclusion en fut que Chateaubriand put se retirer tranquillement dans sa retraite de la Vallée-aux-Loups. Parlant des personnes pleines de grâce auxquelles René fait allusion, Mme Hamelin ajoute : « J’étais liée avec ces aimables et belles personnes, et la comtesse Regnault est l’amie de toute ma vie. Or, elle ne parla pas à son mari, parce qu’elle savait que l’illustre écrivain n’était nullement menacé. Dire comment le nom de Mme Gay a remplacé le mien, je l’ignore, et ne relèverais pas cette substitution si elle ne prouvait jusqu’à l’évidence qu’une belle petite menotte, celle de Juliette, hélas ! a fait des corrections à l’usage de ses propres rancunes. » Il est certain que Mme Récamier n’aimait guère Mme Hamelin, à qui elle voulut enlever Montrond, sans toutefois compromettre l’éternelle blancheur de sa robe.
Dans la Presse du 14 août, Sophie Gay répond : puisque ce soupçon de substitution peut faire croire qu’elle a usurpé la reconnaissance de Chateaubriand et s’est rendue complice d’un acte d’ingratitude, elle détaille ses démarches en faveur du grand homme, sa visite au comte Daru au sujet du discours de l’Académie que l’auteur refusait de corriger comme l’empereur le voulait, et l’entretien qui décida Mme Regnault de Saint-Jean d’Angély à intervenir. Comme pièce justificative, elle publie ce billet que Chateaubriand lui envoya en avril 1811 : « Vous êtes, madame, si bonne et si douce pour moi que je ne sais comment vous remercier. J’irais à l’instant même mettre ma reconnaissance à vos pieds, si des affaires de toutes sortes ne s’opposaient à l’extrême plaisir que j’aurais à vous voir. Je ne pourrai même aller vous présenter tous mes hommages que jeudi prochain, entre midi et une heure, si vous êtes assez bonne pour me recevoir. Je suis obligé d’aller à la campagne. Pardonnez, madame, à cette écriture arabe. Songez que c’est une espèce de sauvage qui vous écrit, mais un sauvage qui n’oublie jamais les services qu’on lui a rendus et la bienveillance qu’on lui témoigne. » À ce billet, il est curieux de comparer celui par lequel, étant ministre, le vicomte répondit le 9 février 1823 à Mme Hamelin : « Je n’oublie jamais, madame, les services qu’on m’a rendus ! C’est à l’intérêt que vous avez bien voulu me témoigner que je dois de n’avoir pas été fusillé ou enfermé par Bonaparte. Aussi, madame, si je puis vous être utile, je suis prêt à payer la dette de la reconnaissance. Je voudrais pouvoir me rendre à vos ordres ; mais la multitude des affaires ne me laisse pas le temps de sortir pour d’autres affaires. Si je ne craignais d’abuser de vos bontés, je vous prierais de fixer le jour et l’heure où je pourrais avoir l’honneur de vous recevoir chez moi ; je serai bien heureux de pouvoir vous offrir à la fois mes remercîments et mes hommages. »
Voilà les données du problème. Comment les démêler ? « Sophie Gay, dit M. Gayot, bienveillante et d’esprit sagace, s’y est essayée, et, tout en blâmant Chateaubriand de son oubli, de son geste ingrat envers une bienfaitrice, a mis cette « correction » au compte d’un scrupule de conscience et d’un respect honorable envers Juliette vieillie qu’il ne voulait pas offusquer, même avec un nom pro noncé devant elle et qui, seul, faisait surgir les fantômes attristants du passé. L’excuse est délicieuse. Elle vient de Sophie Gay. » En réalité, l’intervention de l’une et de l’autre en 1811 en faveur de Chateaubriand est certaine, et l’attitude peu chevaleresque du vicomte envers Fortunée Hamelin ne l’est pas moins[77]. Il est juste d’ajouter qu’au moment de la guerre d’Espagne, Chateaubriand lui donnera ce que les gens de bourse appellent un « tuyau », grâce auquel elle pourra acheter pour 200.000 francs de terrains.
Vers le mois de mars de cette même année 1811, une fâcheuse mésaventure, qui change du tout au tout sa situation pécuniaire, advient à Sophie Gay. Le pis est qu’elle-même peut se la reprocher : son mari est suspendu de ses fonctions. Pourquoi ?
Leur ami Alexandre de Lameth a quitté la préfecture d’Aix-la-Chapelle au début de l’année 1809. Le 19 février, Merlet le remplace pour peu de temps, et, le 31 mai, Jean-Charles-François Ladoucette devient titulaire du poste. Aix-la-Chapelle est désormais la station thermale la plus fréquentée du continent. Il faut à la préfecture un homme du monde, capable de bien recevoir les baigneurs de marque. Lameth remplissait parfaitement ce rôle. Son successeur n’y semble pas moins apte : lettré, affable, bienveillant, Ladoucette se montre désireux de plaire à son tour. Réal note en lui une indulgence et un optimisme destinés à lui ménager les sympathies des habitants. Avec cela, désintéressé, aimant le travail, concevant facilement, et sachant représenter. Mais le plus doux des moutons peut devenir soudain le plus enragé des fauves, à moins que la bénignité de Ladoucette n’allât pas plus loin que ses administrés.
Un soir, dans son salon, Sophie Gay donne cours à sa verve caustique ; Ladoucette en est l’objet ; on rit beaucoup ; il l’apprend, et jure de se venger. Il provoque un examen de la comptabilité du receveur général. Il sait bien qu’il est fort difficile que la comptabilité d’un receveur général soit rigoureusement en règle. Il sait aussi que le comte Defermon des Chapelières, un ancien conventionnel devenu directeur au Ministère des finances de l’Empire, montre une excessive rigueur à l’égard des comptables, et agira fortement sur l’esprit du ministre. Sigismond Gay a beau être bien noté : « Il acquitte très exactement ses obligations en bons à vue. Il jouit d’un crédit très solide comme financier. Il est généralement considéré », disent les renseignements confidentiels fournis au ministre par le précédent préfet. On découvre qu’au 24 décembre 1810, il est comptable envers le Trésor d’une somme de 720 fr. 52 c., plus les intérêts pendant quinze mois, somme qu’il a payée sans être due et qu’il doit rembourser, sauf son recours.
Suspendu de ses fonctions, il continue à toucher son traitement. On espère autour de lui qu’il obtiendra un changement de recette ; malheureusement, son ministre est violemment prévenu contre lui. À la demande de Mme de Lacaux, car Sophie Gay n’a pas osé, dit-elle, solliciter elle-même cette nouvelle preuve de bienveillance, la princesse de Chimay intervient en sa faveur auprès du duc de Gaëte. Longtemps on hésite en haut lieu. On serait disposé à lui donner une autre recette générale ; par un fâcheux hasard, aucune ne devient vacante. Cette situation se prolonge pendant vingt-deux mois. Elle ne peut durer davantage. Un décret du 22 décembre 1812 nomme à Aix le baron Dalton, receveur général du département de Rhin-et-Moselle, à la place de Gay. Ce dernier continue à arborer son titre d’ancien receveur général tout en dirigeant sa banque d’Aix-la-Chapelle. À titre de consolation, peut-être, le prince de Wagram lui confie une fourniture de trois cent mille francs de tentes, mais il perd du coup plus de cent mille francs par an[78].
III
La maison de banque de Sigismond Gay à Aix la-Chapelle lui reste. Il garde toujours la maison d’habitation de la rue des Mathurins où sa femme passe l’hiver. C’est là que, le 20 septembre 1813, Joseph de Canclaux, consul de Sa Majesté l’Empereur à Nice (États sardes), vient chercher, pour la mener à l’autel, la fille aînée de Sophie Gay, Aglaé Liottier. Les cinq sœurs se marieront, suivant la règle d’autrefois, par ordre de primogéniture. Le père de Joseph de Canclaux est propriétaire à Estagel, dans les Pyrénées-Orientales ; son oncle est le général de division J.-B.-C. de Canclaux, membre du Sénat conservateur, grand officier de la Légion d’honneur, comte de l’Empire, alors âgé de soixante-treize ans. La cérémonie est brillante et les témoins retentissants : outre le général de Canclaux, ils s’appellent pour le marié André de Malzar, ancien officier de cavalerie, Antoine-Xavier Froidefont de Bellisle, auditeur au Conseil d’État, qui va devenir un familier de la maison Gay, et Rémond Rivals, receveur général du département de l’Aude ; pour la mariée, rien moins que Son Excellence Mgr le comte Regnault de Saint-Jean d’Angély, ministre d’État et conseiller d’État, président de la section de l’Intérieur, grand procureur général de Sa Majesté près de sa Haute Cour, secrétaire d’État de la famille impériale, grand officier de la Légion d’honneur, etc., et Louis-Gustave Doulcet de Pontécoulant, sénateur, comte de l’Empire, commandeur de la Légion d’honneur.
Dix jours plus tard, un premier convoi de prisonniers autrichiens défile à Aix-la-Chapelle, où Marie-Louise avait passé, au début d’août, sous les derniers arcs de triomphe qu’on y éleva pour l’Empire. La guerre se rapproche. Pendant l’hiver, Gay reste à son poste ; il ne communique plus que difficilement avec sa femme. Elle a envoyé sa seconde fille à Montreuil-sur-Mer, dans la famille Enlart, et lui écrit, le 14 mars 1814, une lettre où l’on saisit sur le vif plusieurs traits de la psychologie parisienne à la veille de l’occupation étrangère, l’atmosphère de fausses nouvelles mêlées aux vraies, les alternatives d’espoir et de découragement, et, quant aux plaisirs, la ferme volonté de n’en pas perdre une bouchée.
« Puisque l’on est tranquille à Montreuil, tu fais bien d’y rester, car notre sort est bien incertain dans la grande ville. Cependant nous avons de fortes raisons d’espérer que l’ennemi n’y viendra pas. L’empereur emporte chaque jour des avantages qui affaiblissent l’armée alliée, et remontent le courage des citadins. Paris est décidé à se bien défendre, et l’on assure que les ennemis sont très effrayés de cette détermination, qui les empêchera probablement de tenter le siège, à moins d’avoir remporté une victoire décisive sur nous. Un événement fort triste pour l’armée et pour mes amis, c’est la blessure du général Grouchy. Il a la cuisse cassée par un biscaïen ; on espère lui conserver la jambe, mais il est hors de service pour plus de trois mois, et comme il commande toute la cavalerie, c’est une perte irréparable. L’empereur la sent vivement. Gustave est aussi de retour avec une blessure au pied, mais peu dangereuse ; il s’est couvert de gloire dans les dernières affaires, et a acquis un grade sur le champ de bataille. Sa mère en est bien heureuse. C’est elle qui doit donner l’hospitalité à toute ma famille si Paris est menacé… J’ai des nouvelles indirectes de ton ami (ainsi désigne-t-elle son mari pour ses filles du premier lit). Je sais qu’il est tranquille et son pays gouverné assez paisiblement. Au milieu de tous nos désastres les Parisiens vont à la comédie comme [dans] les plus beaux jours de la monarchie. La Joconde a du succès, et toute la salle de la Comédie-Française est louée ce soir pour voir la pièce de M. Arnaud. Comme on m’a fait cadeau d’une loge, j’y mène ta sœur, c’est toujours autant de pris sur l’ennemi[79]. »
Lorsque les Cosaques campent à Paris, Sophie Gay n’en peut supporter la vue, et se calfeutre chez elle, où ses amis lui apportent les nouvelles et la tiennent au courant de ce qui se passe dans les salons les plus à la mode[80].
Elle a écrit son premier roman à une époque où son mari ne jouissait pas de la situation brillante qu’il eut depuis. Elle se contente de petits vers pendant la période dorée de la recette générale, vers légers à la manière du chevalier de Boufflers ; il en paraît dans l’élégant Chansonnier dédié aux dames pour l’année 1814, un coquet petit volume orné de fines gravures d’après des dessins de Sébastien Leroy, relié en moire violette dont les ornements dorés sont du plus pur style empire, le tout dans un boîtier de même. Ceux-ci sont tout à fait typiques : des Couplets sur l’absence, que l’on chante sur l’air : « J’ai vu partout dans mes voyages » :
Toujours on médit de l’absence,
Moi j’en veux dire un peu de bien ;
C’est elle qui de la constance
Est le véritable soutien.
Dans l’absence l’amant ignore
S’il est trahi par ses rivaux,
Et loin de l’objet qu’il adore,
Il n’aperçoit plus ses défauts.
À quinze ans Linval sut me plaire,
Je lui jurai constant amour ;
Linval, jaloux par caractère,
Ne me quittait pas un seul jour ;
Bientôt souffrant de sa présence
L’ennui vint rompre mon serment ;
Ah ! s’il eût fait la moindre absence,
Il serait encor mon amant.
Survint après le beau Ménandre,
Perfide, indiscret et léger ;
À tant d’attraits il faut se rendre,
Et sans peine il sut m’engager :
Iris lui promit sa tendresse,
Pour ses beaux yeux il me trahit :
J’allais en mourir de tristesse…
Un mois d’absence me guérit.
L’objet de ma flamme nouvelle
Depuis longtemps est loin de moi.
Je vais le retrouver fidèle
Et saurai lui garder ma foi ;
Mon cœur ému jouit d’avance
De tous les plaisirs de l’amour,
Puis-je médire de l’absence ?
C’est elle qui fait le retour.
Ce n’est encore signé que « Madame Sophie G… ». Mais elle a jugé l’heure venue de reprendre sa plume de romancière ; l’année précédente, au mois d’avril, elle a publié sous les initiales S. G. un nouveau roman, Léonie de Montbreuse. Sainte-Beuve s’est arrêté à ce « roman gracieux, où il n’entre rien que de choisi, et où elle a semé de fines observations de société et de cœur ». Elle l’écrivit à l’intention de sa fille aînée Aglaé, pour l’inciter à ne pas se marier sans son aveu, et inscrivit cette dédicace sur l’exemplaire qu’elle lui donna le 20 septembre 1813, le jour même où Aglaé épousait Joseph de Canclaux :
Comme un doux souvenir accepte cet ouvrage ;
Tu sais que pour toi seule il fut imaginé ;
Alors que du malheur nous ressentions l’outrage,
À te distraire il était destiné.
Parfois de ses chagrins tu plaignais Léonie
Et, sans les imiter, tu riais de ses torts ;
Plus sage en tes projets, sans ruses, sans efforts,
Tu m’as laissé le soin du bonheur de ta vie.
Le choix de cet époux qui devait te chérir
À ma tendresse fut confié par toi-même ;
Je le vois t’adorer presqu’autant que je t’aime.
Et ce que j’ai rêvé, tu viens de l’accomplir[81].
En 1815, elle publie Anatole, à coup sûr un des meilleurs romans parus à cette époque, d’ailleurs inféconde à ce point de vue. Il reçoit le meilleur accueil. Une amie de Gœthe informe Sigismond Gay que le dieu de Weimar place les romans de Sophie Gay sur les rayons de sa bibliothèque, et regarde celui-ci « comme l’ouvrage le mieux écrit et le plus rempli d’idées fines, spirituelles, d’appréciations profondes, de connaissance du cœur humain qui ait été imprimé depuis vingt-cinq ans ». Des visiteurs le verront à Coppet, dans la bibliothèque de Mme de Staël, où, par une singulière rencontre, il voisine avec les ouvrages de Mme de Genlis[82].
On composerait aisément un florilège d’observations mondaines et de pensées curieuses en cueillant, deci delà, une phrase dans les pages de ce livre : « L’amour-propre rend plus souvent injurieux qu’injuste. — Le plus grand malheur d’une femme n’est pas de succomber au sentiment qu’elle a éprouvé, mais au caprice qu’elle inspire. — Je vous demande pour ma franchise la même indulgence que l’on accorde ordinairement à la dissimulation. — Mme de Saverny ne savait pas combien le silence d’une seule personne peut gâter un succès. — Si parfois l’amour rend fous les gens d’esprit, l’amour-propre les rend souvent imbéciles ». Dans l’ordre littéraire : « Pour un grand nombre de gens, le jugement qu’on doit porter sur un ouvrage est tout entier dans le nom de l’auteur. » Au point de vue féministe : « Les succès littéraires des femmes ne peuvent être disputés que par des hommes médiocres », pensée ambiguë, qui suggère une habileté tactique aux femmes de lettres. Au point de vue social, l’auteur a la perspicacité de discerner que, chez ses contemporains, la préoccupation de sacrifier l’individu à la famille n’est déjà plus dans les idées courantes, observation dont l’importance se vérifie de nos jours, puisqu’elle est à la base du mouvement de dépopulation qui inquiète tant de bons esprits.
Preuve indubitable du succès d’Anatole : ce prénom devient à la mode. Et consécration historique de ce succès : au matin du jour où Napoléon quitte la Malmaison pour prendre le chemin de son dernier exil, il tend un volume au baron Fain en lui disant :
— Voilà un livre qui m’a distrait cette nuit.
L’exemplaire d’Anatole qui adoucit pour l’empereur les heures d’insomnie de la dernière nuit passée à la Malmaison, va recevoir une magnifique reliure, et rester dans la bibliothèque du baron Fain[83].
Peu après, une singulière aventure apprend à Sophie Gay une forme inattendue de la célébrité.
Dans la nuit du 27 août 1813, le bombardement de Dresde mit le feu à une maison où demeurait Mlle Amélie de X… ; le jeune et brave colonel du 6e régiment de lanciers, Victor de Galbois, la sauva de l’incendie ; une idylle s’ensuivit. Idylle brève, idylle interrompue comme la plupart de celles de ce temps-là.
Victor écrivit. Amélie, s’imaginant qu’un lien aussi rapidement noué ne résisterait sans doute pas aux hasards d’une longue séparation, ne répondit point tout d’abord. Il insista. Au moment où elle se décidait à répondre, un empêchement survint, et retarda le départ du billet destiné à Galbois.
Amélie était la fille d’un officier de l’ancien régime, qui, en garnison à Boulogne-sur-Mer, avait épousé la comtesse Mac Carthy. À la Révolution, l’officier noble alla servir dans l’armée de Condé ; on confisqua ses biens ; sa femme dut quitter la France. Ils confièrent leur enfant encore au berceau à sa marraine, la duchesse de Deux-Ponts, sœur du roi de Saxe et veuve du frère aîné du roi de Bavière. La duchesse fit élever Amélie dans un couvent de Franconie jusqu’à l’âge de quinze ans, puis la garda auprès d’elle une année en Bavière, d’où Amélie se rendit en Saxe.
Son premier billet à Victor de Galbois amena un malentendu, comme il s’en produit souvent entre amoureux, gens d’humeur susceptible. Tout s’arrangeait cependant, lorsque le retour de Napoléon de l’île d’Elbe retarda la solution de l’aventure, et compliqua la situation. La cour intervint pour donner à Amélie un époux de son choix. La Jeune fille ne voulut accepter qu’après avoir écrit une nouvelle lettre au colonel de Galbois. La première qu’elle expédia ne parvint pas à destination. Elle apprit que son héros avait reçu une blessure, et se trouvait à l’armée de la Loire. Dans une longue lettre du 26 décembre 1815, elle entrait dans le détail de son existence, lui apprenait qu’elle s’était confiée à sa marraine, et terminait ainsi : « Je connais son cœur, elle ne veut que mon bonheur, et je suis sûre que non seulement je n’ai pas d’obstacles à craindre d’elle, mais qu’elle fera son possible pour aplanir ceux qui pourraient s’élever du côté de la cour d’ici. Vous voyez avec quelle franchise je vous parle, Victor ; j’espère que vous en ferez autant. J’attendrai votre lettre avec la plus vive impatience ; elle me dira si je suis destinée à être heureuse en partageant le sort de mon ami, quel qu’il soit, ou bien si je suis condamnée à unir mon sort à un être qui est étranger à mon cœur. »
Pareille missive appelle une réponse décisive. Galbois, perplexe, se dit qu’une femme experte en psychologie féminine et mondaine peut lui donner un utile conseil ; le nom de l’auteur d’Anatole se présente aussitôt à son esprit ; justement, un de ses bons amis est des intimes de Sophie Gay : intermédiaire tout trouvé. Sophie Gay, promue docteur ès sciences amoureuses, examine les faits de la cause, et rend sa sentence : « Je suis si fière de l’honneur que vous me faites, mon ami, en me demandant un conseil pour votre intéressant colonel, que j’ai presque envie de vous répondre avec toute la gravité d’un arbitre : mais mon métier de romancière ne me permet pas de traiter ainsi le plus joyeux dénouement. Plaisanterie à part, je pense du fond de mon âme que votre héros doit accepter le noble dévouement de sa belle. L’état de l’amant, sa position politique, tout justifie la conduite de cette jeune personne dont le caractère peu commun ne doit pas être jugé moins favorablement par une démarche que la nécessité motive, et que le mariage légitimera. Heureux celui qui peut consacrer sa vie à payer de son amour un sentiment si désintéressé. Je lui fais bien mon compliment de posséder le cœur d’une femme si rare et d’un ami tel que vous. Avec de semblables biens, on peut braver tous les malheurs et se moquer du qu’en dira-t-on ? Je remercie votre aimable inconnue de l’occasion qu’elle m’offre de vous répéter les expressions de ma tendre amitié[84]. »
On ne pouvait répondre plus galamment.
Cet épisode ne la distrait pas de ses autres préoccupations. Elle commence à témoigner d’une activité « académique » que les années ne ralentiront pas. Toujours, elle a compté des académiciens parmi ses familiers. Elle travaille au recrutement des premiers parmi les seconds. Six jours après la mort du chevalier de Boufflers, elle intrigue avec vivacité auprès d’un comte académicien, qui ne peut guère être que Regnault de Saint-Jean d’Angély, pour asseoir Benjamin Constant, « bon prosateur, fort instruit en politique et littérature, courageux dans ses opinions, ingénieux dans ses ouvrages », dans le fauteuil qu’occupa son vieil ami, le chantre d’Aline. Baour-Lormian l’emporte, hélas ! sur le candidat de son choix[85].
Le grand événement de sa vie est alors le mariage de sa fille Euphémie, et d’Élisa. Le 15 février 1817, la première épouse François-Maurice Enlart, juge, puis président du tribunal à Montreuil-sur-Mer. Sa mère ne manque pas de composer des couplets de circonstance pour les lire au dessert. Deux mois après, jour pour jour, Élisa épouse Jean-Louis Barthélemy, comte O’Donnell, maître des requêtes au Conseil d’État du roi. Dix témoins, triés sur le volet, signent au contrat de mariage : le comte de Semonville, pair de France et grand référendaire à la Chambre des pairs ; le comte Alexandre de Lameth, lieutenant général ; le comte de Montguyon ; le comte de Sparre, lieutenant général ; le comte de Pontécoulant ; le comte de Choiseul, pair de France ; Froidefont de Bellisle, maître des requêtes, et Alexandre Duval, de l’Académie française. Le cœur de Sophie Gay, heureuse du bonheur de sa « petite comtesse », saute de joie ! « Tant de bonheur m’avait rajeunie, écrit-elle ; cette réunion de tous nos vieux amis, mêlés aux jeunes compagnes d’Éliza, avait quelque chose de si touchant qu’il était impossible de n’en être pas ému[86]. »
Bientôt après, des heures tristes : son beau-frère Allart meurt ruiné. Mme de Staël, sa constante admiration depuis le roman de Delphune, tombe dans un état de santé présageant sa fin. Les médecins ordonnent la campagne ; les forces de la malade ne lui permettent pas de supporter les fatigues du transport. Elle demande à Sophie Gay de lui louer le rez-de-chaussée de sa maison qui donne sur un jardin bien exposé, et procurera à la malade le calme et le bon air dont elle a besoin. Après un premier refus, Sophie Gay cède aux instances personnelles du baron de Staël, si bien que c’est dans sa chambre, dans son propre lit, que Mme de Staël rend le dernier soupir, le 14 juillet[87]. Quant à elle, retirée dans sa maison de campagne de Villiers-sur-Orge, elle écrit à sa fille Euphémie Enlart : « La mort de mon beau-frère et celle de Mme de Staël m’ont causé assez de tristesse pour en être un moment accablée ». Mais une vague de tristesse ne saurait engloutir sa débordante activité, son besoin de mouvement et d’action. Elle s’attelle à un roman, les Malheurs d’un amant heureux, qui paraît avec succès en 1818, et, la même année, elle aborde le théâtre[88].
Depuis le Directoire, elle connaît Edme-Sophie Garre, fille d’un médecin-major de l’École royale militaire, devenue Sophie Gail par son mariage en 1794 avec le célèbre helléniste de ce nom. Sophie Gail a un an de plus que Sophie Gay[89]. La nature ne la dota pas d’un beau physique. On les appelle la belle et la laide, ou encore « Sophie de la parole », et « Sophie de la musique », parce qu’elles ont collaboré. J’ai vu chez Mme Détroyat deux ravissantes petites tasses, du plus pur style empire : l’une représente un amour qui couronne un cahier de musique, avec une lyre derrière lui, et ces paroles en exergue : « Elle fait plus de deux jaloux ». Les Deux Jaloux sont un opéra-comique de Sophie Gail. L’autre représente une vue du château de Frankenberg, sous laquelle on lit un couplet de romance et des portées de musique ; en pendant à cette vue, le buste d’un personnage vêtu d’un uniforme militaire ; Sophie Gay pour les paroles, et Sophie Gail pour la musique, ont composé une romance, le Château de Frankenberg, qu’elles ont dédié à S. A. R. le prince Charles de Prusse.
L’helléniste Gail est un fort savant homme, qui mit sa science au service des Merveilleuses le jour où, supprimant la poche de leur vêtement, elles rétablirent l’usage de l’escarcelle, qu’elles ne veulent pas appeler par son nom. Comment disait-on en grec ? « Balantine », répond Gail sans hésiter. Et voilà « balantine » à la mode, en attendant le règne de « réticule ». Bien que parrain d’un accessoire de la toilette des femmes, il ne s’entend guère avec la sienne. Après quelques mois de mariage, le ménage se sépare. Sans fortune, très musicienne, Sophie Gail utilise son talent, accompagne Garat, voyage, donne des concerts en France et à l’étranger. Chanter la romance ne lui suffit pas ; en 1797, elle a composé deux airs pour un drame d’Alexandre Duval : en 1813, elle écrit une partition tout entière pour le théâtre Feydeau, puis cinq autres jusqu’en 1816, où elle part pour une tournée en Angleterre. Elle est l’âme des concerts qu’Isabey donne dans son hôtel, où l’on joue aussi la comédie. Il lui est arrivé une aventure dans son petit appartement de Paris : son ami le mathématicien de Prony, de l’Académie des sciences, passionné de musique, vient un soir lui rendre visite ; elle est au spectacle ; en l’attendant, il s’installe au piano, et compose une romance ; le piano est dans la chambre à coucher ; le temps passe vite ; lorsque Prony s’avise de regarder l’heure à sa montre, il constate qu’il est deux heures du matin. Distrait comme un mathématicien, il se déshabille et se couche. On entend d’ici les cris de frayeur que pousse Sophie Gail, rentrant chez elle à cette heure tardive, et apercevant un homme dans son lit[90].
À son retour d’Angleterre, elle s’associe avec la baronne Lydie Roger pour louer, rue Vivienne, un appartement mal commode, mais dont le salon, très vaste, permet de donner des concerts et des fêtes. La baronne Lydie Roger est une des cinq filles du fermier général Vassal. Lydie et sa sœur Albine ont épousé les deux frères Roger, millionnaires suisses récemment créés barons. Albine, la mère de Roger du Nord, a divorcé pour épouser Montholon qu’elle suit à Sainte-Hélène. Lydie, de son côté, s’est séparée de corps et de biens de son mari. Elle a des bras, des mains admirables, des pieds si parfaits que le statuaire Delaître les a moulés pour une Vénus de marbre, qui décore au Luxembourg le bas de l’escalier conduisant à la galerie. Amie de Benjamin Constant, elle distribue généreusement ses diamants et ses perles pour venir en aide à des républicains et à des bonapartistes dans le besoin.
L’association Sophie Gail — Lydie Roger dure une saison. On voit à leurs soirées la belle princesse de Chimay ; Mme de Pontécoulant, ancienne libraire du Palais-Royal sous le nom de Mme Lejay, que de mauvaises langues accusent d’avoir été quelque peu la maîtresse de Mirabeau : elle a donné asile à Pontécoulant traqué sous la Terreur, et cette aventure s’est terminée par un mariage, comme dans les comédies bien faites ; Mme de Lacan, qui a enlevé Talma à sa mère Mme Dubuc de Sainte-Olympe, et qu’accablent d’attentions le magistrat Cotta, le conseiller d’État de Formont, et d’autres ; Mme Blondel de La Rougerie à qui, sous l’Empire, le ministre Montalivet n’a pu refuser une place d’auditeur au Conseil d’État pour Alexandre Soumet ; Mme Hutchinson, femme de l’un des trois officiers anglais qui coopérèrent à l’évasion de Lavalette ; la comtesse de Furstenstein, nièce de Benjamin Constant ; l’historien Lemontey ; de Prony ; Vatout, le spirituel secrétaire du duc Decazes ; et des chanteurs, Henri Mouton, Berthon, Nicolo, Fétis. Dans ce salon, Sophie Gay accompagne ses deux filles, Mme O’Donnell et Delphine, et patronne le jeune Salvandy. Les invités assurent le succès des compositions de la maîtresse de la maison. Ils mettent à la mode O pescatore dell’onda ; le célèbre baryton Martin triomphe dans les savantes variations de cette « barcarolle vénitienne ». Après le concert, on danse, et Hippolyte Auger fait valser les treize printemps de la blonde et grasouillette Delphine Gay.
La jeune fille sort de la pension tenue, 59, rue des Martyrs, par Mme Clément, avec le concours de Mme Allix et Richer, et où le célèbre Blangini fut professeur de musique. À douze ans, Delphine y apprenait l’harmonie. Sans doute pour travailler le soir, elle réclamait à son père une chandelle qu’il lui expédie avec ce mot : « Je t’ai envoyé, chère Delphine, la chandelle si désirée et si attendue. Puisse-t-elle faire briller avec éclat ton talent, et employer utilement les moments qu’il te faut dérober à la tendresse de ta mère et de ton père ! Ainsi soit-il ! » Elle apprend par cœur Racine et Boileau, des poésies allemandes et italiennes. Son père est un admirateur passionné de Racine, et toujours elle se rappela sa voix aimée qui les lui disait avec flamme. Lorsqu’elle sera femme, elle verra en Racine un ami d’enfance : elle ne le juge pas, elle l’aime. Peut-être est-ce à la pension de Mlle Clément qu’elle reçut, avec Isaure, sa sœur cadette, les leçons de ce fameux maître d’écriture, dont pendant plus de deux ans la perruque « aux reflets ondoyants, mêlés de pourpre et d’or », servit de pâture à sa gaîté.
Cette perruque-là, c’était tout un poème ;
Ses malheurs surpassaient ceux d’Hécube elle-même !…
Le caractère primesautier de l’enfant, son rire exubérant et franc, éclate déjà ; elle le rappelait en ces vers :
Combien nous avons ri quand nous étions petites,
De ce rire bien fou, de ces gaîtés subites
Que rien n’a pu causer, que rien ne peut calmer,
Riant pour rire, ainsi qu’on aime pour aimer.
Après la saison d’hiver, sa mère l’emmène se reposer à Villiers-sur-Orge. Ce séjour à la campagne ne suffit pas à rétablir la santé de la jeune fille. À la fin du mois d’août, elle rejoint son père, pour « prendre les eaux dans sa ville natale, écrit Sophie Gay à Euphémie Enlart. Elle est tellement grandie qu’il faut la soigner un peu. Ton ami (c’est-à-dire Sigismond Gay) est enchanté d’avoir avec lui cette petite Antigone, mais je ne la prête qu’à condition qu’il me la rendra bientôt. Elle fait de grands progrès sur le dessin et parle fort bien l’anglais, ainsi qu’Isaure[91]. »
La maison de campagne de Sophie Gay à Villiers-sur-Orge s’appelle la Maison Rouge, construction datant du règne de Louis XIII, à laquelle son appareil de briques a valu ce nom. Dans la seconde moitié du xviie siècle, elle appartenait à la famille d’Aligre. En 1775, Mme Du Barry, qui habitait non loin de là le château de Saint-Vrain près d’Arpajon, l’acheta de son ami le financier Buffault, pour y installer sa mère et son beau-père, les Ranson de Montrob. Buffault, homme opulent, avait fort bien fait les choses, et la propriété avait fort bon air. Outre le pavillon principal, elle comportait divers bâtiments, cour et basse-cour, caves, écuries, remises, chapelle, colombier, parterre, jardin avec bassins, statues de pierre, orangerie, un vaste réservoir, des jets d’eau, un canal, des cascades, des potagers, le tout clos de murs. Des terres labourables, des prés, des vignes en dépendaient. Le tout fut confisqué à la Révolution, et vendu comme bien national. La propriété ne souffrit guère, sauf la chapelle, démolie, et les statues du parc, déménagées. Elle appartenait en 1813 à un ancien fabricant de plaques, Jean Robert, de qui Sophie l’acheta le 3 juin, pour le prix de 36.000 francs. Le pavillon comporte toujours la cuisine, la salle à manger, un grand salon à six fenêtres au rez-de-chaussée, trois pièces par étage, et les dépendances, y compris le réservoir des eaux. Les boiseries du salon sont les mêmes que du temps de M" Du Barry, avec leurs dessus de portes peints en camaïeu bleu, copiés d’après Lancret, et figurant des scènes champêtres ; une admirable console est restée fixée au mur[92].
Le site est ravissant. Le terrain dévale doucement en pente vers un ruisselet qui se jette dans l’Orge quelques mètres plus loin ; on le passe sur une porte qui s’abaisse en pont-levis. On se trouve alors devant une fraîche vallée ; une allée de peupliers offre une poétique promenade, le soir, au clair de lune, et « comme une galerie pour la conversa tion ». Souvent, des amis de Paris y font un court séjour. Ils découvrent une Sophie Gay bien différente de celle qu’ils ont connue l’hiver dans les salons. « Là, plus d’envie de briller, plus de rivalités inquiètes, plus de prise d’armes, moins de duels au premier sang. Du naturel, de la bonté, de la sérénité, les occupations domestiques et champêtres, une châtelaine à la fois et une fermière, une mère de famille surtout. Le calme des champs, le travail chacun chez soi, les lectures en commun avec les nouvelles qu’apportent les visiteurs ou la correspondance, cela se voit partout ; mais le mouvement d’une imagination qui ne tombait jamais dans les lieux communs, cette intelligence ouverte à tout, enrichissant tout, portant partout la vie, une âme à la fois sensible et éloquente, avec tous les enseignements d’une existence si pleine et si variée, il est rare de le trouver deux fois ». Là, on ménage, en 1816, un séjour à Fétis, convalescent. On voisine avec l’illustre auteur de l’Almanach du gourmand, Grimod de La Reynière, qui depuis l’année précédente s’est retiré dans son château de Villiers. Vers la fin de 1816, Grimod, près d’épouser une actrice du théâtre de Lyon, consulte Sophie Gay, qui ne cache pas ce qu’elle en pense. Il se froisse quelque peu de l’opinion exprimée, mais invite quand même sa voisine à la cérémonie. Il en reçoit ce billet, daté du 31 décembre 1816 : « Il est certain que j’ai eu tort de dire la vérité à mon voisin ; les rois, les femmes et les amoureux la reçoivent toujours mal ; mais qu’il soit tranquille, elle ne m’attirera plus désormais tant d’amertume de sa part, et il ne l’en tendra qu’à propos des sentiments d’amitié que je lui ai voués. Mon prochain départ pour Paris me privera du plaisir d’accepter son invitation nuptiale ; mais je n’en prendrai pas moins de part au succès de tout ce qui pourra contribuer à son bonheur[93]. »
En l’été de 1817, le comte Alexandre de Lameth s’y rencontre avec Emeric David, un archéologue ami de la famille Enlart. Sophie Gail y passe plusieurs jours. Elle retouche une romance dont Sophie Gay signe les paroles et la musique, Moeris, et dont la vogue va être considérable. Cette œuvrette correspondait exactement à la sensibilité à la mode.
Mais d’où me vient tant de langueur ?
Qui peut causer le chagrin que j’ignore ?
Près des objets de son bonheur,
Mon triste cœur, hélas, soupire encore.
Pourtant zéphir est de retour,
On dansera ce soir sous le feuillage,
Rien n’est changé dans ce séjour…
Moeris lui seul a quitté le village (bis).
Quoi ! Ces bouquets, ces prés fleuris
Dont j’aimais tant la fraîcheur, le silence,
Ces chants d’amour, de jeux suivis,
Tous ces plaisirs n’étaient que sa présence.
Hélas ! Combien je hais le jour
Qui l’éloigna de notre humble ermitage.
Tout renaîtrait dans ce séjour
Si Moeris seul revenait au village (bis).
Les deux femmes jettent en cette rencontre les bases d’une collaboration plus importante. Sophie Gay arrange le texte d’une comédie de Regnard, la Sérénade, de telle sorte que Sophie Gail puisse y adapter les morceaux de chant qu’elle a exécutés dans son salon avec le plus de succès, notamment le fameux Pescatore dell’onda [94].
La première représentation de la Sérénade a lieu au théâtre Feydeau, le 2 avril 1818. Le baryton Martin s’y taille un succès. Hippolyte Auger y assiste dans la loge des auteurs. Il rapporte que l’accueil douteux du public suscite un débat d’amour-propre entre les deux Sophie, « rejetant naturellement l’une sur l’autre cette froideur » dont il certifie l’injustice. La partition contient de fort jolies choses, de l’avis même de Garcia qui en fredonnait tous les morceaux ; sans compter qu’à l’esprit de Regnard, Sophie Gay a ajouté le sien, « ce qui n’est pas peu dire ». La Quotidienne affirme au contraire que la pièce « a été vivement applaudie ; un dialogue plein de naturel et de franchise, une musique variée et spirituelle en ont amené le succès ». La suite donne raison à ce pronostic. Le Dictionnaire des opéras, de Clément et Pierre Larousse, cède à des préoccupations antiféministes : « Il est singulier que les femmes qui écrivent pour le théâtre soient moins réservées dans le choix des situations et même dans celui des expressions que les hommes. La pièce de Mme Sophie Gay non seulement offense ce qu’on appelle les mœurs dramatiques, mais elle offre des images et des mots qui choquent la bienséance… Que des enfants désirent la mort de leurs parents pour en hériter, cela ne s’est vu que chez les Romains, au temps de Plaute et de Térence. » Et s’il concède que la musique est agréable, il y découvre la main de Boïeldieu[95].
Pour leur pièce, les deux auteurs rêvent maintenant sinon un parterre de rois, au moins un public de diplomates. Le Congrès d’Aix-la-Chapelle se prépare : belle occasion d’ajouter la Sérénade à toutes les comédies qui s’y joueront. En attendant, après les émotions d’une première, le calme des champs : Sophie Gay s’installe à Villiers-sur-Orge avec sa fille Isaure. Elle récolte des foins superbes et considère avec satisfaction sa vigne qui « promet des vendanges fort belles ». Toutes deux se préparent à transporter leurs « petites puissances » au Congrès. Elle sait déjà que l’on étouffe à Aix tant il y a de monde. On fait de grands préparatifs de fêtes, « et Dieu sait combien les petites et grandes filles vont danser !… Je me serais très bien passée de tout ce vacarme, ajoute-t-elle, mais puisque j’y suis condamnée, je tâcherai d’en tirer parti, en observant les fils de toutes les grandes marionnettes. » Un mois après, elle se met en route[96].
Son mari et Delphine l’attendent, et sa nièce Hortense Allart, qui a déjà fait un séjour à Aix-la-Chapelle en 1815 ; depuis, elle a perdu son père. À Aix elle dévore la bibliothèque de son oncle, « tout ce qui se trouve là, de l’histoire et de la philosophie[97] ».
Les grands personnages arrivent l’un après l’autre : le prince Auguste de Prusse le 2 août, et Mme Récamier le 3. Le prince s’est jadis fiancé avec elle, à Coppet, bien qu’elle fût mariée. Chaque soir, il lui rend visite, escorté par un peloton de cavaliers porteurs de torches, qui stationnent à la porte. Sophie Gay connaît de longue date Mme Récamier dont le mari était un ami du sien ; ici, leur liaison devient plus intime. Elles s’inquiètent ensemble de la santé de Benjamin Constant qui s’est cassé la jambe, et lisent ses articles de la Minerve française qu’elles prêtent aux diplomates étrangers. Le prince de Prusse rappelle à Sophie Gay le vœu exprimé autrefois par Mme de Staël : voir un grand peintre représenter Corinne « dans un des moments où elle se livre à son inspiration poétique ». Il désire réaliser le vœu, et charger David d’exécuter le tableau. Sophie Gay prêche en vain en faveur de son ami le baron Gérard. Pour complaire au prince, Sigismond Gay écrit à David alors exilé à Bruxelles. Mais l’ancien conventionnel commet la maladresse de marchander d’une façon si peu digne, que Mme Récamier à son tour prend le parti de Gérard, à qui va la commande. Il peindra cette Corinne au cap Misène, qui ornera le salon de l’Abbaye-aux-Bois[98].
Sophie Gay escomptait la venue d’une troupe de comédiens français ; hélas ! Aix-la-Chapelle est rentrée dans le domaine du roi de Prusse, et l’empereur d’Autriche estime que de telles représentations constitueraient une mesure antigermanique : il s’y oppose. On en sera réduit à se moquer des burlesques acteurs patronnés par ces deux monarques de peu de goût. Et notre auteur déploie toute sa verve à se donner le plaisir, assez piquant, « de jouer le rôle d’une bonne Française à la barbe de tous ces Cosaques ». Si seulement le comte Decazes venait ! Il amènerait Villemain et Vatout, deux familiers du salon de la rue des Mathurins. Sophie Gay le souhaite vivement : « Les grands seigneurs me ragoûtent d’autant plus des gens d’esprit, et je descendrais sans le moindre regret des beaux équipages où l’on me traîne avec six chevaux dans la ville, pour m’y promener, bras dessus, bras dessous, avec un homme de lettres aimable. Je n’ai pas plus de vanité que cela. »
Est-ce l’ostracisme prononcé contre les comédiens français par l’empereur d’Autriche ? La Sérénade ne sera pas jouée. Elle est « au croc », écrit Sophie Gay à Sophie Gail le 10 septembre, en la pressant de venir et lui offrant l’hospitalité. « Mon mari fait déjà provision du meilleur thé pour le prendre avec vous ; Isaure vous apprête un café délicieux ; Delphine veut être votre copiste de musique, Hortense, votre secrétaire. Moi, je me réserve l’emploi de confidente, et Dieu sait comme nous bavarderons. »
Hippolyte Auger accuse « Sophie de la parole » d’avoir fait de son amie un moyen de séduction. Quoiqu’elle parlât beaucoup, elle ne pouvait toujours parler ; alors « Sophie de la musique » occupait l’attention sans lui porter ombrage. « La diplomatie européenne se reposait de l’une par l’autre. » Sophie Gay garde encore un grand éclat de beauté, qui ne nuit en rien à ses autres prétentions, l’esprit les primant toutes. Sophie Gail la fait valoir par contraste : la beauté lui manque, et elle se fagote mal. Elle se sauve par sa distinction naturelle, sa simplicité de langage et de manières, par la douceur de son regard ; à l’extrémité de ses grands bras, sa jolie main devient « un trait d’union entre l’instrument et les sons qui révèlent son âme ».
Les ministres des quatre cours arrivent du 20 au 25 septembre, le roi de Prusse le 26, les empereurs d’Autriche et de Russie le 28. Wellington — « on ne fit jamais un grand homme à si peu de frais » disait une dame, — les accable de revues, et leur en inflige jusqu’à neuf heures de suite. Après leur arrivée, Mme Récamier regagne Paris. Fidèle à un engagement pris alors que toutes deux visitaient la cathédrale, elle adresse à Sophie Gay une lettre dont la destinataire « se pare » à un bal « étonnant » donné par d’Alopéus, ambassadeur de Russie à Berlin. Ce sera le dernier : elle ne s’attarde pas aux ultimes fêtes. Le duc de Richelieu a obtenu la libération du territoire français. Le traité est signé. Grandes et petites, les puissances réunies à Aix-la-Chapelle s’en vont l’une après l’autre. Sophie Gail entreprend en Allemagne une tournée de concerts avec Mme Catalani, et mourra prématurément peu après son retour en France. La jeune Hortense Allart a écrit au tsar pour le supplier d’adoucir la captivité de Napoléon ; lorsque le bruit court d’une maladie de l’empereur, elle demande au général Bertrand l’autorisation d’aller le soigner à Sainte-Hélène. Devant un tel zèle bonapartiste, Mme Bertrand la prend chez elle pour lui confier le soin d’élever ses filles. Hortense quitte les Gay avec lesquels toutes relations cesseront : Sampayo va fixer sa destinée, et bien d’autres après lui[99].
IV
Singulière époque que celle de la Restauration ! Après la chute de l’Empire, le décor change, mais sur la scène bon nombre des anciens personnages demeurent. La fusion voulue par Napoléon ne s’accomplira que beaucoup plus tard. Les contrastes, les oppositions abondent, dans tous les domaines : idées, langage, costumes, souvenirs, habitudes.
Le comte de Lameth s’écrie un jour :
— Ces aristocrates et ces prêtres en feront tant qu’il faudra encore leur tomber dessus.
— Nous nous défendrons, répond le général Sébastiani, fils d’un tailleur.
On dit devant M. de Balk que le peintre Gérard ne reçoit plus parce que son père est malade ; Gérard, un artiste…
— Est-ce que cela a un père ? demande M. de Balk.
Quoi de plus piquant que de voir, chez ce même Gérard, Pozzo di Borgo sortant de chez le roi en grand uniforme de général russe, s’asseoir sous le tableau représentant la bataille d’Austerlitz ? On ne peut s’empêcher de sourire autour de lui.
Sous l’Empire, on vivait « à gorge déployée » ; sous la Restauration, « on cache ses péchés ». Que de heurts dans ce monde où les changements de régime ont provoqué tant de lâchetés, de compromissions, où l’on s’allie sans hésiter à l’ennemi de la veille pour conserver un privilège !
Le mélange des rangs et des partis favorise l’adoption de la mode anglaise des raouts, réunions nombreuses hostiles à tout ce qui fait le charme et l’intérêt des cercles restreints où s’épanouissent la politesse raffinée, l’esprit aiguisé de la société française.
Elles sont socialement hors de cause, ces douairières du faubourg Saint-Germain, « paralysées de tout, hormis de la langue », qui ne quittent pas leur paravent, leurs chenets, leur bergère antique, leur chat familier, leur tabatière et leur bonbonnière ; elles exigent que quiconque est présenté à la cour se fasse ensuite présenter à elles. La marquise de Talaru s’obstine à porter les modes de l’ancienne cour, la coiffure que l’on admirait sur sa tête au temps du roi Louis XVI ; elle renouvelle pièce par pièce, rose par rose, pouf par pouf, les accessoires d’une toilette qui garde sa forme antique, tandis que le frais visage à qui tout cela jadis allait si bien s’est ridé, s’est flétri… contraste à la fois douloureux et comique. Une vieille dame se plaint que les jeunes hommes rendent leurs visites en pantalon et en bottes ; une jeune femme, — et non des moindres, la duchesse de Broglie, — se plaint des façons « inconcevables » des vieilles de l’ancien régime. « Il n’y a que la perfection du bon goût qui puisse enseigner de si mauvaises manières… cette familiarité insolente des grandes dames d’autrefois qui se croyaient tout permis ». D’autres, moins âgées, continuent, telle Sophie Gay, à arborer le turban de Mme de Staël, qui les date. Des étrangères, anglaises et surtout russes, s’infiltrent dans la société parisienne.
Rarement les esprits subirent de pareilles commotions, en religion, en politique, en littérature, en art, en histoire, en philosophie. Les idées fermentent, bouillonnent, s’entre-choquent. Elles se déversent dans les journaux et dans les livres ; elles éclosent dans les salons, qui jouent un rôle prépondérant[100]. Il en est de politiques, ceux de la princesse de La Trémoille, de la marquise de Montcalm, l’aînée des filles du duc de Richelieu, que les suites d’un accident obligent à vivre sur une chaise-longue, et qui n’en a pas moins d’amabilité, de culture et d’esprit. D’autres, ni politiques, ni littéraires, aristocratiques et frivoles, comme celui de la comtesse de Matignon où l’on se borne à débiter des potins et des gaillardises ; celui de la vieille princesse de Poix, qui n’a jamais émigré, où les mêmes personnes, à quelques absences près, se retrouvent quotidiennement depuis quarante ans ; il se rattache directement à la société du temps de Louis XV ; on y est enthousiaste et sensible pour les moindres choses ; le moindre mot un peu heureux provoque des applaudissements manuels, la moindre histoire attendrissante fait couler des torrents de larmes. On s’exclame au nez des gens : « Qu’elle est charmante !… Qu’il a d’esprit ! »
Il est des salons doctrinaires, studieux et raisonneurs, où sur un ton grave l’on discute longuement de politique ou de littérature. Il en est enfin d’aristocratiques, au sens étymologique du mot, « où règne d’une manière prédominante le goût de l’esprit et du savoir, où les hommes de toute opinion, distingués dans les lettres et les arts, sont accueillis avec un empressement marqué, où la politique proprement dite n’est admise que sous la condition du talent, où le gouvernement représentatif est fort bien venu, à cause de ses orateurs, mais où la littérature française et étrangère, la poésie, les sciences, l’érudition même, pourvu que la forme en soit piquante et curieuse, ont toute faveur[101]. Là, un poème de Byron, une méditation de Lamartine font événement, et Chateaubriand découvre et baptise l’Enfant sublime. Là, les lectures sévissent, alternant avec les concerts religieusement écoutés ; là, les journaux prennent le ton. Là se recrutent les abonnés du « petit coin » pour lequel seul jouent les acteurs en vedette. Et l’on s’y demande — question saugrenue, considération tellement périmée qu’aujourd’hui elle ne viendrait à l’esprit de personne, mais servant de témoin, comme disent les architectes, pour signaler les lézardes d’une civilisation, — s’il est plus flatteur d’avoir quinze représentations devant un même public, ou cent devant un public qui se renouvelle. La passion des lettres, la prédilection pour l’esprit distinguent ces salons[102].
Les conditions matérielles de l’existence facilitent les réunions qui s’y tiennent. Paris n’est encore ni bien grand ni bien peuplé, si on le compare à celui d’aujourd’hui. L’hôtel Biron est hors la ville, la Chaussée d’Antin finit de se construire. On voisine facilement. La maîtresse de maison s’astreint à rester toujours chez elle, et l’on est sûr de la rencontrer. Ainsi se forment et s’alimentent des foyers d’intelligence où la pensée règne en dominatrice, où le bon goût, les manières policées s’affirment et s’affinent, où l’esprit s’aiguise, où le langage s’épure. Ils rayonnent de là sur tout le pays ; leurs ondes s’étendent à toutes les classes de la société, qui en bénéficient. Ainsi se crée et s’entretient une élite intellectuelle, seule preuve chez un peuple d’une civilisation digne de ce nom. Voilà le milieu où Sophie Gay va vivre, dont elle fera le théâtre de ses ambitions à la fois littéraires et aristocratiques, où elle satisfera jusqu’à son dernier jour sa passion dominante pour les plaisirs de l’esprit.
Anne de Kersaint, son ancienne amie de pension, s’appelle aujourd’hui la duchesse de Duras. Sa tête de Bretonne conserve les traits qui la distinguaient dès l’enfance ; ils ont perdu le charme du jeune âge ; sans être laide, la duchesse n’inspirera pas de passion. Son mari l’a épousée pour sa fortune. Premier gentilhomme de la Maison du roi, sa position le met en rapport avec toutes les notabilités du temps. Sa femme n’a qu’à choisir pour se créer un salon où elle tente la conciliation, le compromis entre le goût, le ton d’autrefois, et les puissances nouvelles. « Ç’a été, dit Sainte-Beuve, une des productions naturelles de la Restauration, comme ces îles de fleurs formées un moment sur la surface d’un lac, aux endroits où aboutissent, sans trop se heurter, des courants contraires. » Sur la tête une coiffure qui semble elle aussi un compromis entre la toque et le turban, elle préside son salon du haut d’une chaise élevée, « jette à ses auditeurs les sujets de conférences comme des sujets de thèses », discute, tranche, émet des idées dont elle a à revendre. Ordonne-t-elle le silence ? On va entendre quelque récitation de vers ou de prose. Stendhal range parmi « les catins à la mode » cette femme rare et supérieure. Sans doute découvre-t-il en elle une affectation qui choque sa prétention au naturel. Elle cherche « quoique un peu honteusement, à recueillir la succession de Mme de Staël ». Mme de Staël se faisait apporter après le déjeuner et le dîner un léger rameau de verdure : on le voit à ses doigts sur le portrait qu’en a laissé Mlle Godefroy, l’élève du baron Gérard[103]. Ainsi Mme de Duras se fait apporter sur un plateau des bandes de papier, les roule en tourniquets toute la soirée, et les déchire l’un après l’autre.
Rien de divers comme les habitués de son salon : le chevalier Stuart, ambassadeur d’Angleterre et grand amateur de beaux livres ; Pozzo di Borgo, Corse et ambassadeur de Russie ; l’encyclopédique Humboldt ; le maréchal Marmont que ses amis affirment loyal et accablé par la fatalité ; le comte Molé ; Villèle ; le baron de Barante ; Villemain ; Talleyrand ; l’astronome Arago ; le sinologue Abel de Rémusat, qui décide la duchesse à intervenir en faveur de Daunou ; elle ne peut réinstaller l’ancien conventionnel aux Archives, mais obtient pour lui une chaire d’histoire au Collège de France ; l’abbé de Feletz, critique à la mode ; l’excellent Cuvier, dont la duchesse suit les cours au Collège de France ; de Frénilly, auteur de satires, et député ; Alexandre de Laborde qui conte ses souvenirs de voyage ; Eugène Brifaut, long et mince, sa tête aux cheveux noirs ondulés perchée sur une haute cravate blanche, académicien ; il zézaie ; il dit pa’ole d’honneu’, et c’te femme ; on sait vaguement qu’il fit jouer en des temps reculés une tragédie, Ninus ; personne n’en a lu une ligne, ni ne se rappelle sur quoi l’auteur assit sa réputation, mais la réputation subsiste ; « gros malin qui se tue à chercher l’esprit de Voltaire dans le ventre d’Épicure », dit le Rivarol de 1842. La délicatesse de son esprit, le brillant de sa conversation ne suffisent pas à expliquer ses succès au faubourg Saint-Germain, et l’on chuchote un mystère de naissance qui en fait « l’héritier indirect d’une grande dame de ce temps », ce qui est inexact. Enfin le dieu du temple, Chateaubriand. René est une des entreprises politiques de la duchesse de Duras, comme le mouvement en faveur de l’insurrection grecque : on sait ce qu’il advint de cette dernière ; quant à Chateaubriand, du jour où il tient son portefeuille de ministre, il répudie celle qui s’attendait à devenir son Égérie. Lorsqu’elle meurt, le dieu transporte son autel dans un autre temple, chez Mme Récamier[104].
La belle Juliette s’est retirée à l’Abbaye-aux-Bois. Le temps n’est plus où elle dépensait six cent mille francs par an dans son hôtel de la Chaussée d’Antin ; son mari a fait deux fois faillite. Mais jamais elle ne vit pareille élite se presser autour d’elle. Pendant de longues années, Chateaubriand installe chez elle cette opiniâtre personnalité, « cette vanité persistante et amère qui à la longue devient presque un tic ». Il arrive à trois heures, « guêtré, finement astiqué, serré de taille, la tête au vent, la main dans le gilet, la rose à la boutonnière ». Il pénètre dans le salon ; sur la cheminée, des vases et une glace où se mire le lit très séraphique de l’alcôve blanche ; au milieu, un guéridon, avec un énorme vase de Sèvres ; à gauche de la cheminée, une bibliothèque ; puis un clavecin, une harpe. Aux murs, la Corinne de Gérard offerte par le prince de Prusse, le portrait de Mme de Staël copié par Mlle Godefroy sur celui de Gérard, et un clair de lune à Coppet. Après la mort de Chateaubriand, un portrait du grand homme s’accrochera en pendant à celui de Mme de Staël.
Juliette l’accueille, toujours fine, délicate, toujours vêtue de blanc. Tête forte, osseuse, dont le crâne se dégarnit de plus en plus, il s’assied à gauche de la cheminée, elle à droite, et chaque jour, invariablement pendant de longues années, les mêmes répliques stéréotypées s’échangent :
— Voulez-vous du thé, monsieur de Chateaubriand ?
— Après vous, madame.
— Y ajouterai-je quelques gouttes de lait ?
— Quelques gouttes seulement.
— Vous en offrirai-je une seconde tasse ?
— Je ne permettrai pas que vous preniez cette peine.
À quatre heures, la porte s’ouvre, et les illustrations défilent, génération après génération. Sophie Gay les connaît pour la plupart. Le fidèle Ballanche, qui se casse de plus en plus, mais dont le bon sou rire trahit toujours la noble et belle intelligence, et le duc Mathieu de Montmorency, sont des plus intimes de la maison. Le jeune Sainte-Beuve vient deux ou trois fois par semaine. Une lecture doit elle avoir lieu ? On lance des invitations spéciales, car la cérémonie est toujours imposante. Combien de ces visiteurs ont noté le souvenir de leur visite ! Marceline Desbordes-Valmore envoie le sien à son mari ; il est exquis : « Tout ce que tu peux rêver d’affable, de tendre, de bon, de grâce, c’est Mme Récamier. Elle m’a embrassée dix fois, mais du cœur. Elle est simple… tiens, comme la bonté, car c’est tout dire. Elle a tout ensemble vingt ans et soixante ans, et ces deux âges lui vont bien. Elle touche le cœur.[105] »
Le peintre Gérard, un vieil ami que Sophie Gay connut peu après la Terreur, tient lui aussi un salon extrêmement fréquenté, et qui ne ressemble à aucun autre. Ancien juré au tribunal révolutionnaire, d’où lui restent quelques amis gênants, le voici maintenant professeur à l’école des Beaux Arts, membre de l’Institut, baron, officier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre de Saint-Michel, etc. Rue Bonaparte, presque en face l’église Saint-Germain-des-Prés, il a fait bâtir une maison, où il demeure. Il possède encore à Auteuil une magnifique habitation entourée d’un fort beau parc. L’hiver, il ouvre tous les mercredis son appartement de la rue Bonaparte. Il reçoit dans quatre pièces qui tournent autour d’un pilier central flanqué de quatre portes. On entre par une petite antichambre, on salue la maîtresse de la maison, puis, à sa guise, on s’attarde dans celui des quatre salons où des sympathies vous retiennent. Un ameublement simple, de bon goût, accompagne de beaux portraits peints par Gérard, celui de David par lui-même et donné à son élève, des œuvres de Gudin, Horace Vernet, Schnetz, Géricault. Mme Gérard joue au whist. Mlle Godefroy, personne d’âge, d’esprit et de talent, est presque de la famille ; elle sert le thé, aidée par un vieux valet de chambre. Gérard cause, et sa parole enchante ; il a prodigieusement lu ; il peut soutenir une conversation sérieuse, ou briller par d’amusantes saillies ; son regard profond et sagace illumine ses traits fins et délicats, bref, un vrai charmeur lorsqu’il veut plaire.
Chez lui, Andrieux ou Népomucène Lemercier lisent la pièce qu’ils vont faire représenter au Théâtre-Français, Rossini accompagne au piano Balbini, ou Mme Pasta, ou Tamburini. On entend Garat, Crescentini, la belle Grassini, Lablache, Rubini, Mme Malibran, Judith, Julia Grisi. La musique cesse : on cause. Parmi les causeurs, Sophie Gay retrouve le bon vieux Ducis, le savant Cuvier, l’élégant comte de Forbin, Guérin, Pozzo di Borgo, le comte de Saint-Aignan, Balzac qui cause avec tout le monde, et Mme de Bawr, Mme de Mirbel la miniaturiste, grande et forte, le teint délicat, dont la réputation d’artiste reçoit son essor de la sympathie que lui témoigne Louis XVIII au point d’inquiéter Mme du Cayla ; et Mme Ancelot qui raconte que Stendhal éprouvait une inimitié prononcée pour Sophie Gay, comme pour tout ce qui faisait trop d’effet ; Sophie s’assied-elle dans leur petit cercle avec Delphine ? Il lance une bordée de propos singuliers, saugrenus, jusqu’à ce qu’elles quittent la place ; mais quand la mère, qui aime beaucoup le jeu, leur laisse sa fille seule, la conversation devient charmante, et la jeune fille y prend spirituellement part.
Et ce sont encore le baron de Mareste, l’ami de Stendhal, le peintre Heim, Eugène Delacroix, Bertin l’Ancien et Bertin le Superbe, et Humboldt, qui parle bien et qui parle beaucoup, et l’abbé de Pradt, qui parle bien et qui parle toujours, si bien que lorsque Humboldt doit s’interrompre de parler pour se moucher, l’abbé de Pradt prend la parole et ne la rend plus. Et les choses iront ainsi chez Gérard pendant plus de trente ans, une nouvelle génération s’infiltrant peu à peu dans l’ancienne, et la remplaçant[106].
Chez Charles Nodier, le clan romantique au grand complet tient ses assises, poètes, peintres et musiciens. Balzac appelle irrévérencieusement Nodier « un sous-genre dans l’histoire naturelle de la littérature », et le Rivarol de 1842 le définit : « Notre dernier casuiste grammatical ». Il ne s’entoure que de jeunes ; il a su conquérir, et il garde, leur amitié. Jal, le père du célèbre Virgilius nauticus, en a tracé un excellent portrait. Nodier se tient le plus souvent dans la chambre de sa femme. « Chambre simple, frottée, luisante ; quelques portraits au mur. C’est là qu’après dîner il reçoit ses amis, avec le sourire lumineux qui éclaire ses joues creuses. Ils entrent comme chez eux, sans qu’il se lève de son fauteuil ; son corps fatigué et courbé se replie à moitié sur lui-même, ses grandes jambes croisées semblent ne pas oser se développer, son pantalon a peine à rattraper ses pieds ; ses bras, las comme son buste, abandonnent ses mains effilées, froides et décolorées, et de ce corps efflanqué, de cette négligence, il se dégage, sans qu’on puisse dire pourquoi, un charme inexplicable. Cette grande araignée tend une toile invisible où tout le monde se prend, depuis les plus petits enfants jusqu’aux grands poètes ; c’est la grâce. Assise en face de lui, Mme Nodier · avance ses jolis pieds, accueillante, accorte, souriante, et laissant voir ses belles dents ; sa figure vive et éclatante comme un bouquet égaie et rafraîchit la vue. » Bientôt s’y ajoute la grâce juvénile de Marie Nodier.
On dit des vers ; Lamartine se campe debout, une main passée en écharpe dans les boutons de l’habit, et module les stances du Lac. Nodier bat les cartes, et joue ; sa fille se met au piano. On chante la romance du jour. Puis les Werther, les René, les Obermann réunis là abandonnent comme une défroque leurs soupirs, leurs larmes, leurs angoisses, leurs terreurs ; ils allument des bougies partout, jusque sur le parquet ; et tous de rire et de danser. Une charmante eau-forte de Tony Johannot, où figure Delphine Gay, nous conserve le souvenir des joyeux ébats de la jeunesse romantique[107].
Pendant quarante ans, Mme Ancelot eut un salon qu’elle prit soin elle-même de décrire et de raconter ; elle l’a encore peint, à l’huile, aux cinq époques de son existence : en 1824, sous Louis-Philippe, en 1848, au début du règne de Napoléon III, et enfin en 1864. Véron a pu dire que ce fut une succursale de l’Académie française, et pour quelques-uns la porte d’entrée par où ils s’y introduisirent. Ancelot en personne fut du nombre ; Roger de Beauvoir griffonna à ce propos un quatrain :
Le ménage Ancelot, par ses vers et sa prose,
Devait à ce fauteuil arriver en tous cas,
Car la femme accouchait toujours de quelque chose,
Quand le mari n’engendrait pas.
Mérimée, la dent pointue, prétend que deux cale basses garnissaient la poitrine de la femme, qui ornait le front du poète Ancillus d’autre chose que des lauriers du génie. Sous la Restauration, elle reçoit un soir par semaine. Le personnel romantique de chez Nodier s’y retrouve en grande partie. Stendhal y cultive la mystification ; un soir, il s’y présente comme un marchand de bonnets de coton en gros, et rien ne l’en peut faire démordre. Par l’effet d’une courtoisie bien entendue, Mme Ancelot cède toujours la parole à Sophie Gay, ou à Delphine, ou à Mélanie Waldor. Elle a de l’observation et de la justesse, mais un esprit quintessencié qui s’accorde à sa beauté étudiée et à sa grâce féline. « Le tout prétentieux et naturellement ennuyeux », dit Hippolyte Auger, que la bienveillance n’étouffe pas, et à qui les vers, le piano, et « une eau chaude où le thé ne pouvait compromettre le sommeil de personne », semblent rester sur l’estomac.
Le tableau où Virginie Ancelot figure son salon en 1824, représente la lecture du poème de Philippe-Auguste par Parseval de Grandmaison. Le dos voûté, cinq pieds six pouces de taille, les cheveux grisonnant de poudre, une redingote de castorine, des pantoufles fourrées par-dessus les bottes, il prit jadis part à l’expédition d’Égypte. « On s’aperçoit que le soleil d’Osiris, dardant à pic sur la tête de notre poète errant, en a humé certaines par celles, dont le vide se fait sentir. »
Sophie et Delphine Gay assistent à la cérémonie[108].
Ce Philippe-Auguste est délayé en vingt-quatre mille alexandrins ; l’auteur ne les lit pas tous ce soir-là, mais il projette d’en consacrer vingt-quatre mille autres à Napoléon, et autant à Charlemagne. Per sonne ne s’étonnera que son auditoire se soit clair semé. Après 1830, il ne lui restera que Jules Lefèvre par amitié, Lacretelle comme parent, et le comte de Rochefort, qui représente à lui seul ce qui subsiste de public classique dans les salons de Paris. Un beau jour, Lefèvre va se battre pour les Polonais, et Lacretelle va à Mâcon tenter la députa tion ; enfin Rochefort tombe malade. Plus personne pour écouter les alexandrins de Parseval de Grand maison. L’infortuné n’a plus qu’à mourir, et n’y manque pas[109].
La marquise de Custine n’ouvre son salon qu’une ou deux fois par an ; elle y convie des artistes et des gens de lettres, le baron Gérard, les Bertin, Mme Vigée-Lebrun ; ce salon est un des premiers où chante la Malibran. La marquise a cinquante ans à cette époque. Elle a cruellement souffert de la Terreur ; elle souffre encore de Chateaubriand ; elle aura une fin douloureuse. On se rappelle qu’elle est
la marraine de Delphine Gay. Elle léguera à Sophie Gay, qui elle-même le laissera à sa fille Delphine, un bracelet en or émaillé orné d’un talisman rap porté de la Terre Sainte par Chateaubriand. Son fils Astolphe, marquis de Custine, rappelle à Sophie Gay leur amitié d’enfance dans les dédicaces des exemplaires de ses ouvrages qu’il lui offre. Sophie Gay ne l’oubliera pas dans son testament. Elle et sa fille ont toutes raisons d’être assidues aux soirées de Mme de Custine[110].
Elles vont avec Mme O’Donnell à celles de Casimir Delavigne, qui reçoit beaucoup de monde, et s’asseoient autour de la grande table réservée aux dames, couverte d’albums, de livres, de dessins ou d’ouvrages, et que préside Mme Casimir Delavigne. Après de modestes réceptions dans un simple logis du faubourg Poissonnière, ce sont de somptueuses soirées aux Menus Plaisirs dont Germain Delavigne est directeur[111].
Chez Benjamin Constant, les soirées alternent avec les dîners. Sa femme s’inquiète peu de ses convives ; elle en a soixante, et joue deux heures de suite aux échecs. Lui se multiplie. D’une exquise urbanité, il adresse les plus exquises paroles au duc de Wurtemberg, à Alexandre de Humboldt, au général Foy, à quelque rédacteur de la Minerve, au baron Méchin, à Manuel, à Emmanuel Dupaty, à Béranger, ou à la princesse de Chimay. Sophie Gay s’amuse bien le soir où un fâcheux félicite chaude ment Béranger de sa meilleure chanson : « Voilà vos

vœux, voilà votre mandat ». Malheureusement, la
chanson n’est pas fameuse, et Béranger n’en est pas
l’auteur : il a beau s’en défendre, le fâcheux persiste
à la lui attribuer.
Le 15 février 1820, on dîne : Lafayette, Béranger, Emmanuel Dupaty, le docteur Laberge, Coulmann, le maître de la maison, et Sophie Gay. Elle apporte l’écho du dernier interrogatoire de Louvel, que l’avocat général Colomb vient de lui raconter : Louvel montre un courage et un sang-froid inconcevables, il rectifie au procès-verbal les réponses dénaturées,… quand on apporte une convocation pour Lafayette et Benjamin Constant : ils doivent accompagner au château une délégation de la Chambre. Vite, Constant se met en tenue, avec ses culottes de conseiller d’État du temps de l’Empire, qu’il n’a jamais mises depuis. En hâte, on déguste une excellente poularde du Mans aux truffes, cadeau d’un électeur au général Lafayette, accablé à cette époque d’envois de ce genre. Ses amis en profitent. On mange et on parle politique. Sophie Gay s’en mêle, et la conversation tourne sur la vanité des poètes. Celle d’Étienne de Jouy, dit-elle, est bien bonne enfant. On lui dit : « Vous commencez à rimer mieux, vous vous y faites », sans le fâcher. Il est plus gai, plus fou dans la conversation que dans ses ouvrages.
— C’est, ajoute-t-elle, dans ses discussions littéraires avec son ami Charles Longchamps que sa déraison passionnée lui fournit le plus de mots comiques et d’exagérations fantasques ; et puis, quand sa colère si éloquente, si inoffensive, si divertissante en vient à provoquer les éclats de rire de tout le monde, il rit aussi de lui-même et déconcerte la moquerie par son esprit à y répondre. Pour moi, j’ai réussi a le mettre en colère, un jour qu’il me soutenait que l’italien n’est pas une langue. Après qu’il eut épuisé toutes les injures, je lui dis : « Il n’y a rien de plus désolant que de se disputer avec un homme médiocre ». Mon trait porta coup. « C’est la reine de l’injure », dit-il de moi ensuite. — C’est effectivement, remarque Béranger, une des plus cruelles : on ne sait jamais si elle est méritée ou non[112] !
Le même Jouy donne chez Girodet un échantillon de sa critique d’art. On examine la Galathée fraîchement peinte. Il y a là Humboldt, le comte de Forbin, le général Lejeune, le colonel Longuerue, Coulmann et Sophie Gay. Comme dit Humboldt, Jouy « fait beaucoup de moutarde » à propos de l’Amour : il est fort mal pendu, et le tableau manque de simplicité ; cette électricité ne vaut rien ; nos grands maîtres n’employaient pas de tels moyens ; si Galathée est bien dessinée, elle a l’air trop française ; le dessin de Pygmalion ne vaut rien ; il a un derrière qui ne suffit pas à l’usage ordinaire de la vie ; on voit que l’Amour a été effacé trois ou quatre fois ; il semble sortir d’un bocal d’esprit-de vin, etc. Le général Lejeune, auteur de cette curieuse série de tableaux des guerres de l’Empire que l’on peut voir au musée de Versailles, pallie ces critiques en affirmant que la peinture est si parfaite, si finie, qu’on peut la regarder à la loupe. Effectivement, il prise et cherche à réaliser ces qualités dans ses propres œuvres. Sophie Gay, charitable, déclare que chercher des défauts au tableau de Girodet, c’est en chercher dans les vers de Racine. Girodet écoute, la mine déplorable ; il fait peine à voir ; la fièvre le consume ; Larrey l’a condamné ; la condamnation ne portera effet que dans cinq ans.
Dans ses pérégrinations à travers le monde parisien, il arrive même à Sophie Gay de grimper au quatrième étage où perche l’appartement de garçon de Coulmann ; ce soir-là, elle laisse Delphine à la maison. De sa verve intarissable, elle anime la soirée. Auguste Odier a crayonné en guise d’invitation une lithographie fantaisiste. Sur la proposition de Jouy, on s’assied sur le tapis, parce qu’il n’y a pas de chaises pour tout le monde. On entend Dupaty lire avec énergie son poème des Délateurs, Liszt jouer du piano, Vatout donner la réplique à Mlle Duchesnois dans une scène de Phèdre, un couteau à papier servant de poignard sans troubler le pathétique de la situation ; Viennet, enfin, que sa voix magnifique fera choisir en 1830 pour lire au duc d’Orléans la charte à laquelle il doit prêter serment, déclame un fragment de son « Épître aux rois de la Chrétienté sur l’indépendance de la Grèce »[113].
Les salons que nous venons de traverser forment le cadre le plus habituel de la vie de Sophie Gay. Dans d’autres, elle passe, tout en courant les premières, voire les avant-premières, au théâtre, dans les ateliers d’artistes, partout où la vie parisienne se manifeste. Elle aime toujours le bruit, elle aime l’éclat, elle est « sonore ».
Elle aussi possède un salon. Le cadre variera du somptueux au médiocre ; la qualité des acteurs ne change pas. Elle y recueille les débris du Directoire, disent les langues envieuses. En réalité, elle conserve ses anciens amis. Népomucène Lemercier et Alexandre Duval, Benjamin Constant et Villemain qu’elle a su attirer, Emmanuel Dupaty, Isabey et sa fille, Cicéri, Horace Vernet, Pontécoulant qui garde son habitude de ne pas laisser passer deux jours sans venir, Gérard, Talma, Étienne de Jouy, Gros, Girodet, Hersent, Auber et Meyerbeer, Elleviou, tellement vieilli qu’on a peine à le reconnaître, Chateaubriand parfois ; Paul-Louis Courier y est conduit par Hersent. Des jeunes s’y agrègent, les fils de Pontécoulant et de Grouchy, et la plupart des romantiques : Alexandre Soumet, H. de Latouche, Guiraud, Pichat, Leduc Saint-Germain, Vatout bon enfant et rieur, Jules Lépine, Lemontey, le comte Jules de Rességuier, le marquis de Custine, Émile Deschamps, Frédéric Soulié, Lamartine, Vigny, Balzac, et ensuite Scribe, Méry, Eugène Sue, Alexandre Dumas, Janin. Soumet lui amène Victor Hugo qu’elle présente elle-même à Mme Récamier. Buchon, rédacteur au Constitutionnel, lui amène Thiers.
Les plus assidues parmi les femmes sont Mme de Custine, Mme de Courbonne, Mme Benjamin Constant, Mme Amaury Duval, Mme Hutchinson, Mme Dugazon, Mme Récamier attirée par quelque billet de ce goût : « J’étais venue pour supplier Mme Récamier de venir chez moi entre trois et six heures entendre chanter à Mme Damoreau des romances nouvelles de Rossini. Si M. de Chateaubriand était aussi aimable qu’il peut l’être ! vous comprenez ! Sophie Gay. » La princesse de Chimay arbore une mise quelque peu recherchée, mais paraît dix ans de moins que son âge ; son visage coloré et plein s’éclaire du regard séduisant de ses yeux de velours ; quelle douceur, quelle finesse dans sa physionomie, quel charme dans toute sa personne ! l’âge ne la touche pas. Seule, la peau de ses bras a rougi.
Sigismond Gay fait parfaitement les honneurs de chez lui. Après avoir reçu dans la journée de vieux académiciens et de jeunes littérateurs, sa femme préside le soir chez elle les réunions où Soumet lit sa tragédie de Saül, où Lamartine soupire le Lac, où Vigny récite Dolorida. La terreur littéraire est à la mode : H. de Latouche donne ici la primeur de sa Vallée-aux-Loups, dont les proses et les poèmes font frissonner l’auditoire. Il faut entendre, après le spectacle, ce cercle de causeurs instruits et spirituels ! La maîtresse de la maison « prend partout le combustible, et ne laisse jamais éteindre le feu sacré ». Thiers, jeune et ardent, récemment débarqué de son Midi la bourse vide, mais le portefeuille garni d’une lettre de recommandation pour Manuel sur laquelle il saura édifier sa fortune, s’amuse fort de cette parole vive, mordante, vantarde. Il l’excite à raconter ses succès aux différentes époques de sa vie. « Elle avait été au bal de M. de Chateaubriand, non sans quelque protestation de la part de Mme de Chateaubriand. Cette fête ne valait pas celles de l’Empire que distinguaient tant de femmes si belles encore. Quand son mari était receveur général à Aix-la-Chapelle, elle effaçait par son luxe l’impé ratrice Joséphine, qui s’y arrêta en revenant de Plombières, à un tel point que l’empereur s’en montra blessé.
— Mais sous le Consulat, disait M. Thiers, quand tout renaissait, que vous étiez la brillante femme d’un agent de change, qu’on fêtait les jeunes vain queurs de l’Italie, quel entrain, n’est-ce pas, avec tant d’enthousiasme et d’espérances !
« Et Mme Gay d’abonder dans ce sens et de peindre l’ivresse d’un temps « où l’on ne voulait pour ses dangers que du plaisir et de la gloire » (ce sont ses expressions).
— Ce que je regrette de n’avoir pas vu, continuait le malin interlocuteur, ce sont les réceptions sous le Directoire, le bonheur de se retrouver, ce besoin de sociabilité, ces toilettes grecques, racontez moi donc cela.
« Et Mme Gay de parler de ce tourbillon de grandes dames déchues, de fournisseurs enrichis, de jacobins · corrigés, et enfin des soirées de Mme Tallien et de Mme de Beauharnais. M. Thiers de remonter la Révolution, demandant toujours des renseignements sur les scènes curieuses du monde des salons, quand Mme Gay s’aperçoit du piège, et s’écrie tout d’un coup :
— Et n’allez-vous pas me demander comment on s’habillait et on s’amusait au mariage de Marie Antoinette ? »
D’ordinaire, son escrime originale, ses pointes acérées font sauter l’épée des mains de l’adversaire. Aux prises avec Villemain, ou Salvandy, ou Benja min Constant, elle est une éblouissante antagoniste. Elle ne résiste pas au plaisir de décocher un mot piquant. Talma s’étant fait exactement la tête de Napoléon pour jouer Sylla, et la pièce devant à ce détail la plus grande part de sa vogue, Sophie Gay, amie de l’auteur, s’écrie :
— C’est un succès de perruque !
Elle lance des mots à l’emporte-pièce contre ceux dont elle sent l’hostilité. On se répète celui-ci, à propos d’un académicien qu’elle aima et qui lui préféra une femme très riche : « Il est aimable, mais il est cher ». Et cet autre, sur un poète qui décrocha une pension avec une épître : « Je ne le vois plus depuis qu’il a des rapports avec le ministre de l’Intérieur ». Celui-là se vengea. En dépit de son admiration pour M" de Staël, elle ne peut se tenir de définir Coppet : « Cette prison des beaux esprits, où tout ce qui ne fait ni prose ni vers est obligé de réciter en plein théâtre, pour l’amuse ment d’un parterre suisse ». À Viennet qui déprécie le talent de Lamartine, elle réplique : « Allons, vous allez en faire le dernier des poètes, mais, grâce à Dieu, la place est prise ». Quels ennemis ne suscitent pas des traits pareils, de ceux qui ne pardonnent jamais !
Or cette femme mordante, parfois cruelle, se montre envers ses amis affectueuse, indulgente, ingénieuse à leur plaire. Elle comprend leurs douleurs, se montre pitoyable, obligeante, opiniâtrement dévouée. Mais sa faculté dominante, la caractéristique de son rôle social, celle qui nous la rend prodigieusement intéressante à cause des natures d’élite sur lesquelles elle l’exerce, Coulmann l’a exactement précisée en une brève formule. Coulmann « jeune, avec du cœur, de l’âme, de l’esprit, de l’instruction et ce qu’il faut de fortune pour vivre indépendant… un peu auteur, pas trop », de très bon air et fort aimable, Coulmann, futur député de Strasbourg, qui pour le moment se contente de plaire dans le monde, de fréquenter les salons libéraux, et de se lier avec les Muses du temps tout en se gardant à carreau. Il l’a observée de près ; il a longuement correspondu avec elle, qui se livre franchement dans ses lettres, plus franche ment que lui et sans arrière-pensée : « Je ne sais pas plus me cacher que m’apprendre, écrit-elle ; la personne qui me regarde sans me voir et m’écoute sans me connaître ne me comprendra jamais. » Or, Coulmann a formulé sur elle ce jugement : Personne ne savait mieux développer les qualités que vous pouviez posséder, faire porter le rayon où il pouvait vous être favorable, faire épanouir la fleur du cœur ou de l’esprit. Elle est dans la société de son temps un ferment, une animatrice singulièrement bienfaisante au talent, voire au génie. Le seul fait qu’elle exerce une action sur Balzac mesure l’importance de ce rôle qui est le sien.
À Paris, comme autrefois à Aix-la-Chapelle, les soirs où l’on ne lit pas de vers, où l’on ne joue pas de musique, on assaisonne de saillies, d’anecdotes, de la dernière histoire scandaleuse, on ponctue d’éclats de rire les parties de bouillotte et de whist ; ces femmes adorent jouer ; la princesse de Chimay tient tout ce qu’on lui propose. À deux heures du matin, on mange sur le pouce « quelque viande froide, quelque salade complexe, prêt à attendre l’aube plutôt que de se séparer d’une compagnie si charmante[114] ».
À côté de cette vie mondaine, Sophie Gay dirige soigneusement l’éducation de ses enfants, et, de plus en plus, pratique le métier d’auteur. Après la Sérénade au théâtre Feydeau, elle fait représenter à la Comédie-Française, le 18 décembre 1819, un acte en prose, le Marquis de Pomenars, marivau dage léger, imbu de l’esprit et de la forme du xviiie siècle. Elle conduit adroitement son intrigue, si elle ne trace pas de caractères. En somme, une mousse agréable, pétillante, sans trop de saveur, et sans prétentions. Le public et la presse l’accueillent bien. « Ce petit acte est rempli d’esprit, dit la Quotidienne, de délicatesse, et de bon goût ; qualités d’autant plus précieuses qu’elles deviennent de jour en jour plus rares. L’auteur a été demandé au milieu des plus vifs applaudissements. Michelot est venu annoncer qu’il désirait garder l’anonyme ; or c’était le secret de la comédie ; les journaux avaient annoncé que la pièce était d’une des femmes les plus spirituelles de Paris, et l’on avait à peu près deviné. »
Elle suit de près le mouvement des revues littéraires avant de s’y mêler directement. Elle encourage Edmond Géraud qui fonde la Revue d’Aquitaine. Des auteurs inconnus lui envoient leurs volumes nouvellement parus. Elle se prend d’un goût très vif pour Marceline Desbordes-Valmore, et lui consacre un article dans la Revue encyclopédique. Elle cite ses poésies pastorales comme un modèle du genre. « De tous temps l’Amour a été l’Apollon des femmes, et depuis Sapho jusqu’à Mme Dufrénoy, toutes ont dû leurs succès au chant plaintif de leur muse amoureuse. » Le talent de Mme Valmore est tout entier dans son cœur ; on ne peut mieux comprendre le charme de cette mélancolie que M. de Ségur appelait la « volupté du malheur ». Et après s’être indignée contre le sot préjugé « qui condamne au plus injuste mépris l’objet d’une admiration générale », c’est-à dire le comédien, elle finit ainsi : « Quelle que soit la carrière poétique que Mme Valmore veuille parcourir, elle peut se promettre d’arriver à ce temple où Voltaire l’eût placée à côté de M" Deshoulières ». Marceline n’y manquera pas.
En cette même année 1820, Sophie Gay a désormais si bien conquis sa réputation « d’homme de lettres », que des journaux lui attribuent une Biographie pittoresque des députés, œuvre de H. de Latouche, Émile Deschamps, P.-N. Bert, et F. L’Héritier. Elle se voit forcée de publier au Moniteur une rectification, affirmant qu’elle n’a pris « aucune part directe ou indirecte à la composition de cet ouvrage[115] ».
L’idée lui est venue d’arranger le Maître de chapelle, comédie de son ami Alexandre Duval, en opéra-comique, « pour donner à Paër et à Martin l’occasion de faire et de chanter une musique admirable ». Paër est directeur de la musique à l’Opéra-Comique, où la pièce est jouée et remporte un vif succès, devant une assemblée brillante et nombreuse ; à la seconde représentation, la recette monte à trois mille deux cents francs, ce qui est alors un beau chiffre. Ce succès se prolongera jusqu’à nous, en dépit des observations vinaigrées du critique C., au Journal des Débats. « Ce n’était pas la peine d’aller chercher dans une pièce heureusement oubliée de M. Duval le canevas du Maître de chapelle. L’anonyme qui a fait de cette ancienne comédie du théâtre de la République un opéra-bouffe, aurait dû sentir l’impossibilité d’appliquer à un musicien laïc les excellentes plaisanteries que M. Duval s’était permises sur un chanoine de Milan... On a demandé le nom des auteurs, Paul est venu annoncer que les paroles avaient été composées par une personne qui désirait rester inconnue, et que la musique était de M. Paër[116]. »
Mme Hugo, dans son livre Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, dit que ce soir-là, Soumet entraîna Victor Hugo diner chez Mlle Duchesnois. Le matin même, le poète, en quête d’un confesseur en prévision de son mariage, avait été présenté à l’abbé de Fraissinous par l’abbé de Rohan, mais l’abbé de Fraissinous ne lui convint pas. On le désirait sans doute beaucoup chez Mlle Duchesnois, car en l’introduisant Soumet s’écrie :
— Le voici !
Avec Mlle Duchesnois, il y a là Mlle Leverd, toutes deux décolletées « à mi-corps », et Sophie Gay. Après le dîner, on se rend à l’Opéra-Comique. Les deux actrices se placent sur le devant de la loge, Hugo entre elles, et Sophie Gay derrière. Il paraît que la jeune célébrité du poète, son air grave et pudibond, les piquèrent au jeu. En le reconduisant, Soumet lui dit :
— Eh bien ! J’espère que voilà une bonne soirée ! La plus grande tragédienne, la plus vive comédienne et la femme la plus lettrée du temps n’ont eu d’yeux que pour vous. Peste ! Avec quelle ardeur Duchesnois et Leverd vous demandèrent en vous quittant quel jour vous viendriez les voir ! Voyons, chez laquelle allez-vous demain ?
— Demain, dit Victor, j’irai chez l’abbé Lamennais.
Ce récit est certainement bien arrangé pour produire son effet. Biré n’en admet pas la véracité, à cause de l’écart des dates entre la première du Maître de chapelle et le mariage de Hugo. Cependant, Mme Ménessier-Nodier atteste la pudibonderie du poète à cette époque en décrivant le voyage de son père et de Victor Hugo, jeune marié, à Reims, pour les fêtes du sacre de Charles X : tous deux ne parviennent à souper et à se loger que chez le directeur du théâtre, avec la troupe ; Hugo s’y résigne avec une telle répugnance, que Nodier lui dit :
— Votre avenir m’inquiète, mon pauvre Victor. Vous êtes terriblement jeune, et j’ai peur que vous ne soyez terriblement vertueux !
D’autre part, ce trait n’est sûrement pas inventé : au cours du dîner chez Mme Duchesnois, loin de s’étonner de la figure de collégien de l’auteur des Odes et Ballades, Sophie Gay s’est écriée qu’elle a une fille à peine adolescente, Delphine, qui compose aussi des odes admirables, et elle projette une soirée où ces deux enfants de génie diront des vers tour à tour. Soumet entraîne Hugo chez Mme Gay, dont la jeune fille accueille fraternellement le poète[117].
Et en vérité, à ce moment même, Delphine se révélait.
V
La première inspiration poétique jaillit dans son âme à Villiers-sur-Orge. Le cadre est d’autant plus facile à imaginer qu’il n’a presque pas changé. Allez à Villiers-sur-Orge. Suivez la route qui mène à Longpont. À la sortie du village, vous trouverez la Maison Rouge. Le pavillon qu’habitèrent Sophie Gay et sa famille subit à peine quelques réfections, qui en sauvegardèrent la physionomie ; elle a belle allure ; on la débarrassa du badigeon jaune dont elle était enduite en 1816 ; l’appareil de briques soutenu par des chaînages en pierre de taille a reparu ; il s’éclaire délicieusement de rose lorsque les rayons du couchant frappent la façade qui regarde vers Montlhéry, dont la haute tour domine le paysage. À l’intérieur, les boiseries du salon sont intactes, avec leurs dessus de portes peints en camaïeu bleu d’après Lancret, et figurant des scènes champêtres. L’admirable console de style Louis XV est toujours fixée au mur. Au premier étage, on voit encore l’alcôve de la chambre où Sophie Gay couchait.
Tous les aspects que décrivent les correspondances du temps, vous les verrez aussi : voici le bois, où des arbres magnifiques ont grandi, et la prairie dont Sophie Gay récoltait les foins. La vigne fut arrachée au cours du xixe siècle ; il en subsiste quelques pieds en espalier sur des murs. Entre le bois et la prairie, les jeunes romantiques disaient leurs vers au clair de lune. Du côté qui dévale vers l’Orge, voici le petit ruisseau que l’on passait sur une porte abaissée en manière de pont-levis. Voici enfin la belle allée de peupliers : les vieux sont morts, d’autres ont repoussé à leur place. Le tout dans une vallée fraîche et verdoyante, dont les hauteurs qui l’enserrent sont bordées de bois d’un côté, de champs cultivés de l’autre.
À un kilomètre de là, voici Longpont avec sa vieille basilique où le style roman se mêle au début de l’architecture gothique ; la façade n’a pas changé depuis lors, comme en font foi des estampes de 1817 et de 1824. Elle évoque le souvenir des premiers rois capétiens. C’était l’église paroissiale où Delphine venait le dimanche assister à l’office. À gauche du chœur, une série d’inscriptions indique ceux des Maillé de La Tour Landry enterrés là ; trois noms s’accompagnent de dates récentes, les noms de trois Maillé tombés pour la France pendant la grande guerre. Mais voici Charles-François-Armand, duc de Maillé de La Tour Landry, qui fut premier gentilhomme de la chambre de Louis XVIII, et que connut Delphine ; voici Blanche-Joséphine Le Bascle d’Argenteuil, duchesse de Maillé, celle-là même qui demandait à Delphine de dire des vers dans son château de Lormois. Le château se dresse emmi le parc, non loin de l’église. Lui seul est défiguré, et l’on ne saurait sans doute retrouver dans ses dépendances la chaumière de Lormois où Delphine s’isolait parfois pour écrire, et d’où elle data plusieurs de ses poèmes.
Il faut aller là par une belle journée d’automne, lorsque le soleil dore les vignes et que les premières feuilles commencent à tomber des peupliers. L’atmosphère est douce, à peine embuée d’une brume impalpable qui enlève aux contours des choses ce que leurs lignes pourraient avoir de dur ou de tranchant. Le ciel est bleu, du bleu léger de l’Ile-de-France. On se sent au cœur du pays de l’équilibre et de l’harmonie. Les souvenirs d’un lointain passé jaillissent de la ligne onduleuse d’un coteau, de l’épaisseur d’une frondaison, d’une pierre grise où le maître tailleur d’images, le franc et sincère artiste médiéval, fixa sa pensée d’un coup de ciseau. Ils baignèrent les premières rêveries de celle qui s’intitula la Muse de la Patrie.
À la tombée du jour, l’or des feuillages s’avive. Les brumes montent de la rivière, étendant un voile de gaze blanche et diaphane sur la prairie, et peuplant de mystère les bois épais qui s’assombrissent. Au loin, la vieille tour haut perchée sur la motte seigneuriale grandit encore à l’horizon, avant de s’évanouir dans l’ombre. La première étoile s’allume. La pâleur du clair de lune va se glisser en flèches d’argent parmi les troncs des arbres qu’elle stylise en imposantes colonnades. Une émotion intense se dégage des choses.
Un jour pareil à celui-là, la belle jeune fille aux boucles blondes, aux yeux couleur de ciel, à la blanche robe de mousseline, erre à pas lents dans la grande allée de peupliers. Sa gaîté rieuse s’éteint au coin de ses lèvres. Une douce mélancolie voile son front rêveur. Elle a seize ans. Une élégie monte de son cœur à ses lèvres :
Jeune fille, où vas-tu si tard ?
D’où vient qu’à travers la vallée
Tu portes tes pas au hasard ?
Pourquoi les égarer dans cette sombre allée ?
Ainsi commence la Noce d’Elvire, timbrée d’une épigraphe de Mme Dufrénoy. La pièce est datée de septembre 1820.
Sa mère s’inquiète de cette vocation littéraire qui s’annonce. Elle en connaît trop les risques et les inconvénients. Elle en connaît aussi les joies, et n’en détourne pas sa fille. Mais elle lui donne deux conseils : « Si tu veux qu’on te prenne au sérieux, donnes-en l’exemple, étudie la langue à fond, pas d’à-peu-près, remontres-en à ceux qui ont appris le latin et le grec. » Et deuxièmement : « N’aie dans ta mise aucune des excentricités des bas-bleus ; ressemble aux autres par ta toilette, ne te distingue que par ton esprit ». Delphine, tendre orgueil de sa mère, lui voue un touchant amour. Elle suit ses conseils de point en point. Enthousiaste de Racine, elle étudie la poésie avec Alexandre Soumet, la prose avec Villemain. Elle apprend le latin. Pas une de ses œuvres qu’elle ne documente sérieusement : pour son poème de la Magdeleine, elle se plonge dans l’histoire des Hébreux, et s’informe des termes hébraïques désignant jusqu’aux accessoires de la toilette des femmes juives ; elle inscrit des citations à la suite du Dernier Jour de Pompéï : il existe encore des chemises bondées de notes historiques et archéologiques qu’elle a prises en vue de ses poèmes et de ses pièces de théâtre. D’autre part, elle conserve dans sa mise une extrême simplicité : jamais de fleurs dans les cheveux, une robe de mousseline blanche unie, une écharpe de gaze bleue comme ses yeux. Pas de coquetterie : la conscience de ses avantages matériels, dont elle n’use ni pour tourmenter les hommes, ni pour accabler les femmes. Qu’une femme à la mode la félicite après qu’elle a dit des vers, elle répond :
— Ce serait plutôt à moi, madame, à vous com plimenter. Pour nous autres, femmes, il vaut mieux inspirer des vers que d’en faire[118].
Lui demande-t-on d’en réciter, elle ne se fait pas prier. Quand on est à Villiers, elle va soupirer ses élégies à Longpont, au château de Lormois, chez la duchesse de Maillé, où l’on donne des séances littéraires, où la duchesse joue le Misanthrope avec l’acteur Lafon sur un théâtre improvisé, dit Coulmann : « on est bien heureux d’être invité et de voir du faubourg Saint-Germain » ; après quoi la jeune fille retourne jouer dans le jardin, ou se disputer avec le même Coulmann au point de s’arracher mutuellement les cheveux ; la couleur en est si bien la même que, dit Sophie Gay, on ne sait à qui appartiennent les uns ou les autres[119].
Elle est, comme il convient à son âge, très entière dans ses opinions, et se passionne dans la discussion. Un jour, en l’absence de Sophie Gay, Mme O’Donnell, Delphine, Vatout, Froidefont de Bellisle et Frédéric Soulié causent. Vatout, intime de Casimir Delavigne, conte que ce dernier retouche son poème sur lord Byron. Et voici, notée, la con versation. Il est bon de se souvenir qu’avant peu, dans certains milieux, l’enthousiasme pour Casimir Delavigne équivaudra à un impardonnable brevet de cuistrerie.
« Delphine. — Je préfère de beaucoup la pièce de Guiraud. Il a, lui, senti, compris, aimé Byron.
» Vatout. — Mais il n’y a chez lui ni élévation, ni force, ni couleur. C’est une éloquente médiocrité que votre Guiraud.
» Delphine. — Je suis sûre que Casimir Delavigne en parle différemment, mais c’est lui-même qu’il faudrait entendre, car on lui prête souvent des discours qui, quand nous l’avons vu, étaient fort peu conformes. Ainsi vous m’avez soutenu l’autre jour, et Horace Vernet l’a répété, que parce qu’on lui avait préféré Soumet à l’Académie, il ne s’y présenterait pas ; qu’on l’avait traîné dans la boue. Jamais Casimir Delavigne n’a pu se croire traîné dans la boue parce que Soumet était nommé à sa place ; il m’a parlé de Soumet, et il m’a parlé de lui avec admiration ; il a plus d’esprit que ses amis.
» Vatout. — Je n’ai jamais dit, mademoiselle, que Soumet a été traîné dans la boue.
» Delphine. — Vous me l’avez dit positivement, j’ai bonne mémoire.
» Vatout. — Et mauvaise langue.
» Bellisle. — Mais, Delphine, je vous en prie, modérez-vous ; que diriez-vous si on écorchait votre enfant ?
» Delphine. — C’est que je ne puis entendre des injustices. J’ai dernièrement pris le parti de Casimir Delavigne ; dois-je entendre de sang-froid attaquer mes amis chez moi ?
» Vatout. — Vous me faites tenir un langage sur Soumet qui m’empêcherait de lui serrer la main s’il venait ici.
» Delphine. — Vous l’avez tenu ce langage. Je suis lasse d’entendre déraisonner. Il faut ne pas savoir ce que c’est que la poésie, pour ne pas apprécier Soumet. Ses vers sont frappés au coin de Racine ; ils me touchent, ils parlent au cœur et ne sont pas un vain clinquant. C’est de la grâce, de la sensibilité vraie ; je m’y connais, moi.
» Vatout. — Comparez donc ses succès à ceux de Casimir Delavigne.
» Mme O’Donnell. — Delphine, mais est-ce qu’une demoiselle discute ainsi, s’emporte ainsi ?
» Bellisle. — Comment parlerez-vous quand vous aurez cinquante ans ? Vous prenez souvent un ton peu convenable, vous tranchez avec votre mère même ; vous ne vous doutez pas à quel point c’est choquant.
» Vatout. — C’est Mme de Genlis empereur, Mlle de Scudéry hors des gonds.
» Delphine. — Je ne suis pas une demoiselle ; mon rang est fixé ; je ne me marierai jamais. Je peux tout dire, surtout quand je suis chez moi. Dans le monde, je me tiens dans les bornes, je garde le silence.
» Vatout. — Casimir Delavigne ne vous ressemble pas, lui : c’est une demoiselle.
» Mme O’Donnell. — Delphine, tu es absurde. Voilà comme nous perdons tous nos amis ; et pour qui ? pour Soumet, qui ne vient pas seulement nous voir, et nous néglige.
» Delphine. — Il n’en est que plus beau de le défendre.
» Vatout sort en disant à Mme O’Donnell. — Au moins, écrivez cela à Rambouillet. »
Soumet y est bibliothécaire. Cette querelle n’empêche pas Delphine de rendre par ailleurs justice à Vatout ; elle déclare ne pas connaître d’homme plus spirituel ; et c’est alors son ami H. de Latouche qui corrige quelque peu ce jugement en comparant Vatout à un papillon en bottes à l’écuyère[120].
La scène, prise sur le vif, met à nu plusieurs des caractéristiques du tempérament de Delphine : son ardeur à défendre ses amis, sa passion pour les choses de l’esprit, et surtout son assurance, cette assurance imperturbable dont elle ne se départira jamais, qui l’empêchera de discerner ses propres ridicules — car il lui arrive d’en avoir — alors qu’elle découvre si aisément ceux des autres, mais qui sera pour elle en toutes circonstances un étai inébranlable, un puissant soutien, en somme, une grande force.
À peine un an après sa première élégie, elle se risque à un « chant ossianique sur la mort de Napoléon », qu’elle dédie à la comtesse Bertrand. Une épigraphe tirée de Mme de Sévigné voisine étrangement avec Ossian, Fingal, et la quincaillerie calédonienne présentée au public par Baour-Lormian ; double tendance subie par Delphine : l’une infligée par la mode, l’autre inhérente à sa nature. Elle se livre au courant du jour, mais, comme sa mère, elle se nourrit des lettres de Mme de Sévigné, et des grands classiques français.
En 1821, l’Académie française indique pour sujet du concours de poésie : « Le dévouement des médecins français et des sœurs de Sainte-Camille dans la peste de Barcelone ». Bercée dès l’enfance dans le luxe fin de l’esprit, excitée par sa mère à toutes les ambitions, élevée sur les genoux des académiciens, Delphine tente la partie. Elle a dix-sept ans. Elle ne traite pas complètement le sujet : ainsi en cas d’échec, elle se ménage une excuse ; et si son poème obtient un succès, elle en aura quand même le bénéfice moral.
Elle dit les vers, elle lit la prose avec art, intelligence et goût, d’une voix grave, bien timbrée, prenante. Aux soirées de sa marraine la marquise de Custine, elle lit des fragments d’Atala et des Martyrs. Chateaubriand daigne certains soirs se mêler à ses propres admirateurs, et Mme de Custine n’oubliera jamais l’émotion que Delphine provoque dans son salon en lisant la Lettre d’Amélie à René. Mme Récamier met à contribution ce talent de la jeune fille. Il y a grande réunion à l’Abbaye-aux-Bois. Entre autres célébrités, on remarque ce soir là le duc Mathieu de Montmorency, la maréchale Moreau, le prince Tufiakin, Mme Bernadotte dont le patronyme s’efface devant son titre de reine de Suède, Catellan, le comte de Forbin, Parseval de Grandmaison, Baour-Lormian, Ampère, Gérando, Ballanche, le baron Gérard. La conversation s’engage sur la poésie dont tout le monde parle, « un vrai chef-d’œuvre de sensibilité », la Pauvre Fille, de Soumet. Soumet, le maître, l’ami de Delphine. Sûrement, elle sait cette poésie par cœur. À la prière de Mme Récamier, elle la récite « avec une grâce, une justesse d’inflexions, un sentiment vrai et profond » qui tiennent l’auditoire sous le charme. Ravie de ce succès, Sophie Gay dit à mi-voix à Mme Récamier :
— Demandez à Delphine de vous dire quelque chose d’elle.
La jeune fille esquisse un geste de refus ; la mère insiste ; Mme Récamier craint d’exposer à la critique d’un aréopage difficile et pas toujours bienveillant, un talent dont elle n’a pas la moindre idée. Mais Sophie Gay n’en démord pas ; les personnes présentes joignent leurs instances aux siennes et à celles de Mme Récamier, que l’exemple a fini par entraîner. Delphine se lève, et dit « d’une façon enchanteresse » le poème qu’elle vient de composer et d’envoyer au concours de l’Académie. Dans ce salon où Lamartine a initié les amis de Mme Récamier, bien avant le grand public, à ses premières méditations, cette nouvelle primeur est hautement appréciée[121].
L’été suivant, le 24 août 1822, à deux heures et demie après-midi, l’Académie française entre en séance : en tête, le comte de Ségur, directeur, Laya, chancelier, et Raymond, secrétaire perpétuel. Une salle bondée, une assemblée brillante, surtout dans la première enceinte réservée aux dames. Sont-elles attirées par la nature du sujet du concours de poésie, « si bien approprié à la sensibilité naturelle à leur sexe » ? Ou bien le secret du concours a-t-il transpiré, et veulent-elles « par un mouvement d’amour-propre très légitime, prendre part au triomphe inaccoutumé d’une jeune personne de dix-sept ans » ? On chuchote : Villemain, élu l’année précédente, a rédigé un rapport, lu à la séance secrète qui précède la séance publique ; les juges ont pleuré en entendant une poésie dont ils ne connaissaient pas l’auteur…
La séance est ouverte. Le secrétaire perpétuel, après le rapport sur les prix de vertu, lit celui sur les prix d’éloquence, de prose et de poésie. Saintine avec une épître, Mennechet avec une ode sur la Restauration des lettres et des arts sous François Ier, emportent le prix ; Malitourne et Patin se partagent celui d’éloquence dont le sujet est un Éloge de Le Sage. Et ces différents partages inspirent au Journal des Débats cette observation : « Voilà matière à réflexion pour ceux qui connaissent les lois de l’équilibre ». Lemercier lit les vers de Saintine, Laya la première partie de l’œuvre de Malitourne, et Picard la deuxième partie de celle de Patin. Après quoi, l’on passe au concours auquel Delphine a pris part avec cent trente autres concurrents. Le secré taire perpétuel proclame : premier prix, M. Alletz, qui est couvert d’applaudissements ; premier accessit, M. Chauvet : deuxième accessit, M. Pichat. Il ajoute : « Si l’auteur du numéro 103, en ne traitant qu’une partie du sujet, n’avait donné pour excuse et son sexe et son jeune âge, l’Académie, à la perfection et au charme de plusieurs passages, aurait pu croire que la pièce était l’ouvrage d’un talent exercé dans les secrets du style et de la poésie ; mais la simplicité touchante de divers tableaux, la délicatesse, je dirai même la retenue des pensées et des expressions, auraient permis d’attribuer l’ouvrage à une personne de ce sexe qui sait si bien exprimer tout ce qui tient à la grâce et au sentiment. En se restreignant à l’éloge des sœurs de Sainte-Camille, l’auteur se plaçait, en quelque sorte, hors du concours, et dès lors l’Académie, qui a jugé l’ouvrage digne d’une mention honorable, a cru juste de lui assigner un rang distinct et séparé de celui des autres mentions ». La séance s’achève sur la lecture de plusieurs fragments du poème de Delphine par le vieil ami de son père et de sa mère, Alexandre Duval. Duval lit parfaitement bien. « Il ne s’est trouvé que des larmes pour la poésie de sa jeune amie ». À la sortie, la foule élégante se rue à la porte de l’Académie pour escorter le triomphe de la Muse nouvellement consacrée, qui s’avance au milieu d’un concert de murmures flatteurs.
Toute la presse retentit de son nom. Le Journal des Débats, la Quotidienne publient son éloge. Le Moniteur dit que la lecture de ses vers « a produit un effet difficile à décrire… Cette séance doit être comptée au nombre de celles où le mérite des productions couronnées s’est trouvé le mieux en proportion de l’intérêt des sujets donnés au concours ». Une note de bas de page ajoute : « La pièce de vers de Mlle Delphine Gay sur le dévouement des médecins français et des sœurs de Sainte-Camille dans la peste de Barcelone, paraîtra lundi, chez Ambroise Tardieu, rue du Battoir, n° 14, et chez les libraires du Palais-Royal. Prix : 75 centimes ». La nomenclature des poètes lauréats de l’Académie française, de Biré et Guiraud, prétend qu’elle a déployé à elle seule plus de talent que tous ses rivaux ensemble. Elle reçoit des lettres enthousiastes de Roger, le grand électeur de l’Académie, qui insiste sur ce qu’à la séance secrète son succès ne fut dû qu’à la séduction de son talent, et n’a rien emprunté aux charmes de sa personne ; de Guiraud, qui l’accuse de disposer de paroles magiques, « car il le fallait bien pour séduire des oreilles d’Académie » ; de Soumet, qui lui annonce avoir lu son poème à Jacques Deschamps de Saint-Amand, le père d’Émile et d’Antony Deschamps : vieillard de plus de quatre-vingts ans, il conserve une étonnante fraîcheur d’impressions ; il réunit dans son salon un groupe de jeunes littérateurs qui commencent à révolutionner les lettres ; il a pleuré d’attendrissement et de joie ; « de toute la jeune littérature, écrit Soumet, vous êtes le seul poète qui trouve grâce à ses yeux, et il pardonne presque à la barbarie du siècle présent en faveur de tant de jeunesse, de talent et de sensibilité ».
La reine Hortense, à qui Sophie Gay prête parfois l’appui de son inspiration musicale, fait demander à Delphine par Le Bas, précepteur du prince Louis, les paroles d’une romance pour les mettre en musique. De Londres, Chateaubriand envoie ses félicitations ; sa lettre ne parvient pas à son adresse ; il l’apprend par Mme Récamier, et griffonne aussitôt un nouveau billet : « Je sais pourquoi vous dites si bien les vers : vous parlez votre langue ». Un retard de cinq mois n’enlève au compliment rien de sa valeur.
Si ce concert d’éloges flatte l’amour-propre de celle qui en est l’objet, il n’y paraît pas. Elle a le succès « fort humble et fort gentil ; elle dit sur sa renommée académique des folies qui vous feraient mourir de rire en dépit de soi ». En quoi elle est bien elle-même. Mais de toutes les lettres reçues, celle-ci va droit à son cœur : « Aix-la-Chapelle, 31 août 1822. J’ai éprouvé, ma chère enfant, un chagrin bien amer en n’assistant pas au triomphe dont tu viens d’être l’objet, mais mon attendrissement au récit de ton beau-frère n’en a pas été moins vif. Le sentiment dont il était pénétré a passé dans mon âme, et j’ai pleuré comme si j’eusse été témoin ; ta tante et ta sœur ont partagé l’émotion, et nous avons été aussi bêtes les uns que les autres. Ma satisfaction dans cette circonstance est d’autant plus vive que je ne doute pas de l’heureuse influence qu’elle exercera sur l’esprit de ta mère en lui rendant le courage et l’espérance. Nous te devons d’autant plus, ma chère Delphine, de nous procurer de semblables jouissances, que, très maltraités par la fortune, tu nous en procures que tous les millions de la terre ne sauraient donner. Nous avons lu avec avidité le récit des journaux relatif à la mémorable séance. L’article de Mély-Janin nous a paru le mieux. Je t’envoie celui du Nouvelliste d’Aix-la-Chapelle publié ce matin ; voilà la ville de Charlemagne pour jamais intéressée à tes succès, et la postérité, pour connaître le lieu de ta naissance, n’éprouvera pas la cruelle incertitude qui a si fort tourmenté les commentateurs d’Homère ; « on ne s’attendait guère à voir Ulysse en cette affaire ». Je sais un gré infini à mon bon ami Duval de s’être chargé de lire tes vers, et en lui écrivant, comme ta mère le désire, je suivrai l’impulsion de mon cœur. Il est bien démontré aujourd’hui que si tu avais traité le sujet dans son entier, tu aurais obtenu sinon le premier prix, du moins la seconde place. Tu prouveras encore mieux cette vérité à la première occasion, en effaçant tous tes concurrents. Nous disions hier que tu vas servir d’exemple à toutes les demoiselles qui savent un peu écrire, qu’au premier concours il y aura un numéro douze ou quinze cents, tant l’émulation sera grande, et qu’alors au lieu de te savoir gré on te maudira. En attendant, moque-toi des envieux, continue ton vol, et reste persuadée que le premier succès est le plus difficile. Je te dirai que ta mère a un admirateur des plus flatteurs pour elle : c’est Gœthe, l’auteur de Werther. J’ai vu ici une dame qui est très liée avec lui, qui m’a assuré qu’il avait la collection de ses œuvres, et qu’il regardait Anatole comme l’ouvrage le mieux écrit et le plus rempli d’idées fines, spirituelles, d’aperçus profonds, de connaissance du cœur humain, qui ait été imprimé depuis vingt-cinq ans, époque, ajoute-t-il, d’autant plus honorable que plusieurs femmes distinguées ont exercé leur plume. Cette dame m’a supplié de lui donner un Chevalier, en m’assurant qu’avant douze jours il serait dans les mains de Gœthe, ce que je n’ai pas cru devoir refuser, persuadé que je serais approuvé. Je suis sûr que dans le monde tu as déjà un Gœthe qui te suit des yeux et t’attend au deuxième triomphe, qu’il arrive donc ! Isaure nous a lu une boutade de ta façon sur « le Bonheur d’être belle » aujourd’hui. Si je faisais des vers, la mienne aurait pour titre : « le Bonheur d’être père ». Crois, mon enfant, que j’apprécie cette jouissance, et que jamais rien de ce qui sera grand, beau, généreux, élevé, ne me surprendra de ta part, tant il est dans ta nature d’être distinguée et noble. Si l’affection est en raison des motifs qui l’inspirent, tu dois juger de l’étendue de celle que te porte le meilleur des pères[122]. »
Cette lettre charmante déborde de tendresse et de fierté paternelles. Elle finit par une si juste appréciation du caractère de Delphine qu’à vingt-trois ans de là, son mari, pleurant sa perte, n’en portera pas d’autre, en termes presque identiques. Elle montre, au surplus, le moral de Sophie Gay affecté à cette époque. Le Chevalier en question est une comédie en trois actes et en vers, Une Aventure du chevalier de Gramont, qu’elle fit jouer au Théâtre Français le 5 mars précédent, et qui sombra. Les affaires de la banque ne semblent pas non plus prospères comme jadis, et l’avenir l’inquiète.
Elle réalise cependant un projet depuis longtemps caressé. En 1821, elle comptait profiter d’un séjour de Coulmann en Suisse pour lui demander de la guider dans ce pays qu’elle rêve de visiter. Le voyage ne s’arrange pas ; sur le point de partir avec Pontécoulant qui s’y rendait, elle renonce, au dernier moment, à l’accompagner. À la fin du mois d’avril 1822, elle éprouve quelque velléité d’aller voir sa fille de Canclaux, mais le projet pour la Suisse revient sur l’eau. Elle arrête le plan de son voyage suivant les indications de Coulmann : elle s’arrêtera à Lyon, à Genève, et de là gagnera Berne, où elle le rejoindra. Il lui fera les honneurs de la Suisse.
La cérémonie de l’Institut retarde le départ. De Villiers, le 19 août, elle l’annonce à Coulmann : « Ce jeune auteur qui vient d’être si glorieusement mentionné, j’ai promis à mes vieux amis de l’Académie de le conduire à leur grande solennité du 24, pour entendre les vers cités par le père des Templiers. C’est quelque chose que d’être louée à dix-huit ans par un homme de ce mérite, et ma fierté maternelle n’a pu se refuser cette petite jouissance. » La cérémonie a lieu… et le départ est encore reculé. Au dernier moment, les passeports font défaut ; il faut surmonter « des difficultés imbéciles ».
Ces difficultés, la police de la Restauration les suscite. Elle a fort à faire, la police de la Restauration, et elle se donne beaucoup de mal pour remplir sa mission ! À peine est-il bruit que Sophie Gay doit se rendre dans le Midi, qu’une mouche le recueille, et le fixe sur le papier. « 27 juin 1822. On vient d’apprendre que M" Sophie Gay était il y a peu de jours à Bordeaux, d’où elle doit se rendre aux eaux de Bagnères après avoir parcouru néanmoins plusieurs villes du Midi, qui ne sont point sur la route de Bordeaux à Bagnères. C’est chez Mme Gay à Paris que se réunissent un grand nombre d’individus connus par leur haine du gouvernement. Mme Gay a été longtemps attachée à plusieurs polices, à celle du Directoire ainsi qu’à celle de Bonaparte ; elle est l’amie d’un certain Froidefont de Bellisle actuellement dans une grande intimité avec M. le duc de Choiseul, Doulcet de Pontécoulant, le général Maison et autres gens de cette espèce. Elle est aussi très liée avec le duc d’Alberg. D’après des données particulières, on a lieu de soupçonner que Mme Gay pourrait bien voyager dans ce moment pour le compte du Comité directeur [du parti libéral], comme elle a voyagé autrefois pour le Directoire et pour Fouché. On croit qu’il serait important de surveiller ses démarches de très près ».
Voilà qui est grave ! Le directeur de la Sûreté générale demande aussitôt : « Mme Gay a-t-elle un dossier ? Dans l’affirmative, me le remettre. » Une deuxième note, adressée à Duplay, sous-chef du bureau politique, pose encore une question : « De quels ouvrages Mme Gay est-elle auteur ? »
Le 2 juillet suivant, le préfet de Police apprend au ministre de l’Intérieur que Mme Gay, femme d’un ancien receveur général, femme d’esprit, fort intrigante, liée avec tout ce que le parti libéral compte de plus hostile, a quitté Paris pour aller à Bagnères en passant par plusieurs villes du Midi qui ne sont pas sur la route de Paris à Bordeaux, et qu’elle est l’auteur de :
« Léonie (c’est Léonie de Montbreuse) ;
» Rodolphe ou Astolphe, histoire d’un muet (c’est Anatole) ;
» On lui attribue une histoire dont il n’est paru qu’un volume intitulé, je crois, histoire d’un valet de chambre révolutionnaire (c’est le premier volume de : les Malheurs d’un amant heureux) ;
» Plusieurs pièces au Français dont la dernière est tombée, etc.
» Plusieurs petits théâtres, et beaucoup d’articles de journaux, etc. »
Bref, de quoi faire frémir un bibliographe ! Ces premiers renseignements ne tardent pas à se compléter. Le 5 juillet, le préfet de Police continue à éclairer, si l’on peut dire, le ministre de l’Intérieur : « Monseigneur, j’ai l’honneur d’ajouter aux renseignements que j’ai transmis à Votre Excellence, le 2 de ce mois, relativement à Mme Gay, que la fille de cette dame est mariée à Perpignan avec le général Canclaux, dont l’esprit d’opposition au gouvernement du roi et le zèle pour le parti d’Orléans est généralement reconnu. Ainsi par le moyen du voyage de Mme Gay à Bayonne et du séjour de Mme Canclaux à Perpignan, les Pyrénées orientales et occidentales sont en quelque sorte livrées aux intrigues de cette famille qui est entièrement dévouée aux ordres du Comité directeur. Je tiens les rapports que j’ai l’honneur de vous communiquer touchant cette affaire, d’une personne en qui je puis avoir confiance, et je crois qu’ils méritent que Votre Excellence les prenne en considération. » À coup sûr, le général Canclaux, qui a fait tirer sur les royalistes vendéens sous la Révolution et que l’Empire a fait comte, peut légitimement susciter les soupçons de la police. Mais si seulement Sophie Gay n’avait pas bougé de Paris, si le général Canclaux n’était pas mort depuis cinq ans, et si on ne le confondait pas avec son neveu, l’ancien consul de l’empereur à Nice, ces renseignements mériteraient sans doute de ne pas soulever aussi complètement la méfiance de l’historien. Quatre jours plus tard, le 9 juillet, pour éviter que Sophie Gay et le général Canclaux ne soulèvent tout le Midi de la France, les préfets des départements de la Gironde et des Hautes-Pyrénées sont armés de tous les renseignements précités, et reçoivent l’ordre de faire surveiller activement ces deux dangereux personnages.
À ce moment même, Sophie Gay se prépare à partir en Suisse avec Delphine. « J’arrache ma Delphine à tous les hommages d’un succès enivrant, dont pourtant sa simplicité n’est pas dérangée. Elle est aussi étonnée qu’amusée, et moi seule en suis fière… Delphine me charge de vous dire qu’après le char de triomphe rien ne lui paraît plus glorieux que votre char-à-bancs. Si vous nous renversez du haut de cette gloire, vous aurez affaire maintenant à la postérité ; ce sera votre affaire personnelle, et nous nous en lavons les mains. » Elle compte retirer son passeport le lendemain 2 septembre : elle ne montera en voiture que le 4, avec Delphine et sa femme de chambre, car elle aura « quelques toilettes à faire » à Lyon et à Genève.
La mère et la fille traversent une première fois cette dernière ville pour gravir le Montanvert et explorer la vallée de Chamonix. Elles ont la chance d’excursionner en compagnie de « l’homme le plus piquant et le plus intéressant par son esprit et l’étendue de ses connaissances… Jean Sbogar-Nodier » ; elles s’arrachent au plaisir de parcourir avec lui ces contrées miraculeuses pour ne pas manquer le rendez-vous de Berne, et voilà que de retour à Genève, une lettre de Coulmann annonce qu’il a quitté Berne, et ajoute que si elles veulent l’y attendre trois semaines, il viendra les prendre pour un voyage dans le nord de l’Italie. Désolée de ce contretemps, Sophie Gay ne veut pas mettre le pied en Italie sans pousser jusqu’à Rome, et les couches de Mme O’Donnell la rappellent à Paris. Elle se contentera de faire le tour du lac de Genève. En cette ville, elle applaudit au triomphe dans Mérope de Mlle Georges, qui le lendemain visite Ferney où on lui rend « de vrais hommages ». Elle rencontre Hippolyte Auger, qui voyage en Suisse en compagnie et aux frais d’un Allemand, Charles Delmar, dont le père s’enrichit en payant à Napoléon les frais de la guerre perdue par la Prusse ; Auger prétend avoir dès cette époque pres senti « la future M"° de Girardin, se faisant une auréole des vers qu’elle récitait ».
Le 20 septembre, nos deux voyageuses visitent Lausanne, puis Vevey et La Meillerie. Sophie Gay rêve aux impressions que lui procurera la vue de Coppet. « Là, dit-elle, m’attendent les souvenirs des plus vives émotions que jamais aucun livre m’ait produites, et je commence à ne plus compter que sur les souvenirs, eux seuls sont fidèles. » Hélas, « le duc de Broglie, en qualité d’ancien ami à moi, a voulu nous faire lui-même les honneurs de son château, et cela m’a privée du plaisir de rêver à mon aise dans ce triste lieu ; je n’ai pu avoir un pauvre petit tête-à-tête avec Mme de Staël. »
Contrairement à son précédent projet, elle va à Berne, y rend visite au baron de Krudener qu’elle a connu à Aix-la-Chapelle, et au ministre de France, comte Auguste de Talleyrand, qu’elle prie de viser son passeport pour retourner en France. Le 1er octobre, elle traverse une dernière fois Genève où une lettre de Coulmann lui apprend que la santé de sa sœur l’a rappelé à Strasbourg. Elle prend le chemin du retour par la Bourgogne, ne séjourne guère à Paris, et dans les premiers jours de novembre se réfugie à Villiers-sur-Orge avec Delphine, pour s’y reposer des fatigues du voyage.
Elle ne se doute certes pas que la police de la Restauration, ne la trouvant pas dans le midi de la France, l’a rattrapée sur la route de Suisse. M. Schmidt-Meyer, syndic de Genève, a adressé au comte Auguste de Talleyrand le rapport demandé sur elle et sur Odilon Barrot dont les allées et venues au même moment dans le même pays ne paraissent pas moins suspectes. Le comte de Talleyrand a transmis le tout à son ministre, s’excusant d’envoyer d’aussi maigres renseignements — ils sont en effet totalement insignifiants, — sur ce « qu’à l’exception de Berne, les cantons n’ayant point de police organisée, il est bien difficile de connaître la conduite politique des étrangers qui voyagent en Suisse, et dont le nombre est si grand que souvent à Berne même ils ne trouvent pas à se loger ».
Une première mauvaise nouvelle trouble la calme solitude de Villiers : le 30 novembre, le courrier annonce que Coulmann a perdu sa sœur. Trois semaines plus tard, un coup de foudre : Sigismond Gay meurt subitement à Aix-la-Chapelle, le 19 décembre, à onze heures et demie du matin ; il n’a pas encore cinquante-cinq ans[123].
VI
Sophie Gay fait bravement face à la situation. Elle sait que la liquidation de la succession de son mari sera longue ; elle compte bien que chacun de ses enfants en recevra une fortune modique, mais d’ici-là, il faudra vivre, et d’abord achever d’élever Delphine, Isaure et Edmond, puis les établir. Edmond, un garçon, sortira de pension pour entrer au régiment. Isaure garde à côté de sa sœur une attitude volontairement effacée ; elle vivra de traductions, de copies, de leçons, fera un séjour en Angleterre, et épousera Louis-Théodore Garre, fils de Sophie Gail, le 6 juin 1837. Lorsque ses moyens le lui permettent, sa mère lui alloue une petite pension ; elle lui cherche une situation d’institutrice ; pleine de bontés pour sa fille, elle ne la garde pas auprès d’elle, et l’installe chez une intime amie, Mme Bétout, 14, rue Basse-du-Rempart[124].
Pour Delphine, c’est autre chose.
Sophie Gay commença à pratiquer le métier d’auteur lorsque son mari perdit sa situation de receveur général. Maintenant qu’il n’est plus là, elle compte plus que jamais sur sa littérature pour alimenter son budget, et elle s’y livre entièrement. Mais bien vite elle comprend que le génie lui fait défaut. Elle n’est pas la seule. Ses romans et ses romances n’en connaissent pas moins la vogue ; par contre, à part l’opéra-comique, son théâtre ne lui ménage pas de triomphes éclatants, bien loin de là. Ce n’est pas par ses propres moyens qu’elle parvien dra à se maintenir au niveau de cette existence parisienne qu’elle mène depuis le temps du Direc toire, qui donne pâture à sa passion des choses de l’esprit, à son besoin de bruit et d’éclat, à son désir de voir et d’être vue, à son ardente curiosité de toute nouveauté intellectuelle ou artistique.
La célébrité conquise du jour au lendemain par Delphine lui montre la voie. Ce qui lui manque pour acquérir la gloire et la situation qu’elle convoite, elle le trouve dans sa fille. Elle va réaliser pour et par sa fille tout ce qu’elle a rêvé de réaliser pour et par elle-même. Avec quels soins, avec quelle ardeur va-t-elle cultiver le talent dont elle dirigera les manifestations ! Grâce à Delphine, elle garde le contact avec le faubourg Saint-Germain, où l’on aime entendre la jeune poétesse réciter ses vers. Elle attire chez elle les illustrations naissantes, c’est à-dire toutes les gloires du romantisme. Elle uti lise sa position antérieure, le nom qu’elle a déjà dans le monde des lettres, ses relations à l’Académie et dans les milieux les plus en vue de la capitale. Elle joue de la publicité avec tact, avec adresse, et sans répit : publicité parlée dans le monde, publicité imprimée dans les revues et les journaux. Elle se constitue le metteur en scène et le metteur en œuvre du talent de sa fille. Elle suscite des jalousies, des antipathies et des railleries, mais elle s’appuie sur de solides amitiés. Jamais elle ne perd de vue son but, que son long, patient et tenace effort atteindra.
À peine remise de la secousse que lui valurent la mort de son mari et la maladie de Delphine qui s’en suivit, elle prie Coulmann, qui voyage en Italie où il parle d’elle avec la reine Hortense, de s’enquérir de quelque livre intéressant et nouveau, et de le lui envoyer pour qu’elle le traduise. Elle négocie avec Ambroise Tardieu la réédition de Léonie de Montbreuse qui reparaît avec un frontispice d’Isabey, comme l’année précédente elle a réédité Anatole avec
un frontispice d’Horace Vernet, gravé par Moreau le Jeune. Le même éditeur réimprime les Malheurs d’un amant heureux, et comme la fabrication du volume traîne, elle lui écrit : « Pour la première fois de ma vie, je trouve que les malheurs vont bien lentement ». Il a publié le poème couronné de Delphine : elle surveille la vente, et le prie d’envoyer vingt-cinq exemplaires à un libraire d’Aix-la-Chapelle qui les réclame. Elle s’entremet en sa faveur auprès d’Alexandre Duval, dont Tardieu désirerait éditer un ouvrage[125].
À cette même époque, elle donne une preuve de ce libéralisme qui inquiète si fort la police. Magalon, jeune écrivain de vingt-huit ans, ancien volontaire sous les ordres du duc d’Angoulême qu’irritèrent les excès de la réaction blanche, a fondé l’année précédente l’Album, où il vient d’attaquer vivement les Jésuites : condamné à treize mois de prison et deux mille francs d’amende, il purge sa peine à Sainte-Pélagie, quand, le 13 avril au matin, on l’en extrait pour lui faire traverser Paris en compagnie de onze criminels de droit commun, les menottes aux mains et accouplé à l’un d’eux. On lui inflige à Poissy le même traitement qu’aux pires malfaiteurs. Il faudra l’intervention de Chateaubriand pour le ramener à Sainte-Pélagie. Il a reçu dans sa prison plus de visites qu’un ministre en crédit. Sophie ne manque pas cette occasion de se manifester : « J’ai vu, dit-elle à Coulmann, des scènes dignes de Walter Scott pour parvenir jusqu’à lui : je me suis trouvée avec une douzaine de femmes ou maîtresses de voleurs qui venaient aussi chercher leur permission. L’une d’elles m’a demandé si le mien partait aussi par la chaîne du 1er mai ? J’ai répondu que le mien n’avait pas le bonheur d’être pour les galères ; alors, me supposant l’amie d’un homme à pendre, je suis devenue l’objet de la considération et de l’intérêt général, ce qui m’a valu des confidences de tous les genres, et très nouvelles pour moi, je vous le jure. J’en ai bien fait rire notre ami[126] ».
Elle a dû abandonner le bel appartement et le jardin de la rue des Mathurins. Elle s’installe avec Delphine rue Louis-le-Grand. Lamartine les y a vues au numéro 28 ter. Il a décrit les lieux en enjolivant son style plus que l’objet même de sa description : deux pièces basses, un escalier de bois qui le frappe parce qu’il a l’habitude des escaliers de pierre, des livres au mur sur des tablettes, des épreuves cor rigées sur une table révélant assez « les travaux assidus des deux femmes », un petit cabinet où Delphine se retire pour composer, et qui donne sur une terrasse de douze pieds de circuit où souffrent deux ou trois pots de fleurs[127]. Là, cependant, les habitués du salon de la rue des Mathurins continuent à se réunir, les plus notoires célébrités de ce temps défilent.
Pourquoi Sophie Gay a-t-elle gardé la Maison Rouge de Villiers-sur-Orge ? Sa fille l’explique dans Napoline :
— Mais moi, je n’irai pas ce soir à cette fête,
Lui dis-je, nous partons pour Villiers aujourd’hui,
Et nous y resterons deux grands mois.
— Quel ennui !
Comment ! Sacrifier une fête superbe,
Un bal d’ambassadeur, à des dîners sur l’herbe !
— Oh ! Nous ne dînons pas sur l’herbe avec maman.
— Et vous me laissez seule au milieu d’un roman !
Et que ferez-vous là, mes champêtres amies ?
— Ce que l’on fait aux champs.
— Quoi ?
— Des économies.
On y fait des économies, et on y travaille. La mère s’y retire pour écrire ses romans, la fille y reçoit l’inspiration poétique.
Perspicace, Sophie Gay discerne l’avenir en matière de littérature, et surtout de littérateurs. Elle reste fidèle à ses vieux amis, mais elle ne se dévoue pas moins aux intérêts des jeunes. Ces jeunes, c’est tout le groupe romantique qui se réunit chez le père d’Émile Deschamps et chez Nodier. Auprès de Talma, elle bataille pour leurs pièces ; elle conduit tout, dit Soumet. Elle s’indigne de voir le grand tragédien céder indolemment aux intrigues de « certains petits auteurs », ce qui désigne plus particulièrement Ancelot. Elle est furieuse qu’il soit « enragé » contre le Saül de Soumet, contre sa Clytemnestre et sa Cléopâtre, contre le Léonidas de Pichald ; un moment, elle veut retirer son propre Chevalier de Gramont pour suivre le sort de ses amis. Mais le Comité, dit-elle, ne le permet pas. Cependant Talma triomphe dans plusieurs de ces rôles qu’on eut tant de peine à lui faire accepter. Elle exulte à ces succès comme à celui du Sylla de Jouy. Quant à Guiraud, il préfère passer à l’Odéon avec ses Macchabées, que le public accueille bien ; elle lui procure pour la brochure de sa pièce « un bon et solide libraire », Ambroise Tardieu[128].
Lorsque le cénacle se précise et fonde la Muse française, elle se charge encore de trouver un éditeur, et cet éditeur est encore Ambroise Tardieu. Le 11 juillet 1823, Émile Deschamps écrit à Guiraud : « Mme Gay est à Paris et s’occupe beaucoup de notre affaire ; elle travaille d’ailleurs beaucoup et très bien ». Delphine elle-même « travaille » pour eux : elle s’est associée à l’œuvre de bienfaisance de l’abbé Legris-Duval, disciple et continuateur de l’abbé de Fénelon, pour protéger les petits Savoyards (on se rappelle que les Gay sont originaires de Savoie) qui gagnent péniblement leur vie à Paris. Guiraud les a pris pour thème de plusieurs élégies. Delphine se charge de vendre ces poèmes, et elle y réussit pleinement. « Vous donnez à mes vers la vogue des vôtres, mademoiselle, et je vous en remercie », lui écrit Guiraud. À cette occasion, elle reçoit un joli billet de Chateaubriand : « Je vous dois une réponse depuis bien longtemps, mademoiselle, mais il n’y a rien qui soit plus indulgent que les talents, la beauté et la jeunesse. Vous m’avez donc, j’espère, pardonné mon silence bien involontaire. Je suis désolé de vous offrir si peu de chose pour les petits Savoyards. Quand je ferai des vers comme vous, je ferai fortune, et alors je mettrai toute cette fortune à vos pieds[129] ».
Les fondateurs de la célèbre petite revue se nomment Alexandre Soumet, Guiraud, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Saint-Valry — ne pas le confondre avec son fils, directeur politique de la Patrie, ni avec Valery, nommé bibliothécaire au Louvre afin d’économiser les échelles parce qu’il était très grand, et dont Émile Deschamps disait : « Il se baisse, et ramasse un oiseau dans les airs » [130] — Desjardins, Émile Deschamps, auxquels s’agrègent bientôt Nodier, Jules Lefèvre, Belmontet, Pichald, Chènedollé, Saint-Prosper, Brifaut, Baour-Lormian, Ancelot, Gaspard de Pons, le comte Théodore Walsh, H. de Latouche. Sophie Gay y introduit Marceline Desbordes-Valmore, qu’elle admire et encourage, comme elle encourage Valmore qui s’est fait remarquer dans un rôle de la Clytemnestre de Soumet. Peut-être est-ce elle qui introduit aussi à la Muse française Adélaïde-Gilette Dufrénoy. Hortense Céré-Barbé, Sabine-Casémire-Amable Tastu y publient également des vers. Car le nombre élevé des femmes de lettres de l’Empire ne diminue pas sous la Restauration. Languissantes et plaintives, elles s’enthousiasment pour Mme Verdier, la reine de l’idylle.
Célébrités oubliées, hélas ! Qui se doute aujourd’hui de l’influence de Mme Verdier ? Cependant Mme Dufrénoy a dit : « J’avais à peine essayé quelques vers lorsque Mme Verdier était déjà célèbre ; ses louanges, répétées de toutes parts, excitèrent mon émulation… Mme Bourdic-Viot me répétait souvent : nous sommes une foule de musettes, Mme Verdier seule est une muse[131]. »
Non : la muse, ce n’est ni Mme Bourdic-Viot, ni Mme Verdier, c’est Delphine Gay. Elle n’a pas vingt ans, elle est belle, simple, bon enfant. Elle dit ses vers comme elle les fait, avec élégance et grandeur. Sa conversation, pleine de substance, ne vise jamais au bel esprit. Elle se montre enjouée, sans grimace. Chateaubriand, Soumet, Guiraud l’entourent d’hommages respectueux. Les jeunes mêlent à ces hommages un sentiment plus tendre. À leurs yeux, elle apparaît comme la Muse française, avec un casque et une lyre, et c’est pourquoi ils accepteront si facilement ce titre de Muse de la Patrie qu’elle va se décerner elle-même. Ils constituent un groupe choisi, quelque peu quintessencié, d’où les génies vont se dégager, mais dont Sainte-Beuve a souligné le faible pour « la chevalerie dorée, le joli moyen âge de châtelaines, de pages et de marraines, le christianisme de chapelle et d’ermitage, les pauvres orphelins, les petits mendiants qui faisaient fureur et se partageaient le fonds général des sujets, sans parler des innombrables mélancolies personnelles ». Ces jeunes poètes prédisent à Delphine la couronne de l’élégie lyrique. Ils découvrent dans son talent « un mélange de vigueur masculine et de sensibilité de femme du monde, plus affectée des choses de la société que des charmes de la nature, plus nerveuse que tendre, plus douloureuse que mélancolique, le tout marchant de concert avec beaucoup d’esprit réel, sans prétention, et se manifestant sous une forme de versification pure, correcte, savante même et assez neuve alors… Il y avait dans son style un grand éclat tempéré par un goût déjà sûr »[132].
Tandis que sa mère communique à Guiraud son propre enthousiasme pour lord Byron, Delphine inspire les poètes amis. Antony Deschamps lui dédie, dans ses Italiennes, le poème intitulé le Vendredi saint, et Belmontet, dans les Tristes, une des plus belles pièces du recueil. Après avoir lu ses vers sur l’Ange de la Poésie, Émile Deschamps lui envoie ceux-ci[133] :
Quelle est cette beauté qu’un bel ange accompagne ?
L’azur de ses grands yeux brille, mouillé de pleurs.
Oh ! Quittez vos palais ou la verte campagne,
Donnez-lui des parfums, des sourires, des fleurs…
Courons !… Est-elle reine, ou déesse, ou bergère ?
Faut-il aimer, hélas ! admirer ou prier ?
Elle chante, et devant son écharpe légère,
Corinne courberait l’orgueil de son laurier.
Dès la deuxième livraison de la revue, Sophie Gay se voit payée des peines qu’elle a prises pour aider à la mettre au monde. Saint-Valry consacre un article à ses romans, « tous plus ou moins remarquables par la réunion si rare de l’art d’intéresser et d’émouvoir, et d’un grand talent d’observation. Tandis qu’aujourd’hui la plupart de nos auteurs comiques mettent des scènes romanesques de mauvais goût dans leurs comédies, Mme Gay, mieux inspirée, mêle d’excellentes scènes de comédie à ses romans ; c’est ce qu’on pourrait appeler de la munificence. Tour à tour et presque à chaque page, l’auteur d’Anatole excite un malin sourire par une réflexion piquante, ou bien, par un mot délicat, éveille un souvenir du cœur. Son style spirituel et facile rappelle souvent la manière gracieuse de Mme Riccoboni. Si l’idée première qui sert de base à chacun de ses charmants ouvrages manque quelquefois de force et de profondeur, on ne saurait du moins lui reprocher de manquer de justesse et de but moral. Ses personnages sont pleins de vie et d’originalité, et parfois l’on est tenté de leur rendre leurs véritables noms comme à d’anciennes connaissances qu’on a longtemps perdues de vue et qu’on est tout sur pris de retrouver ; enfin, dans toutes ses compositions, et principalement dans Anatole, Mme Gay a su jeter au milieu des scènes variées du grand monde, peintes avec une rare fidélité, des situations neuves d’où ressort l’intérêt le plus vif et le mieux soutenu ». Et pour finir il se borne à « conseiller à ceux de nos lecteurs qui sont arrivés jusqu’ici sans les connaître, d’être à l’avenir un peu plus soigneux de leurs plaisirs, et de réparer bien vite le péché d’omission. » Six mois plus tard, la Muse française publiait d’elle une élégie, l’Inconstant, reproduite en 1826 dans les Annales romantiques.
Delphine a entrepris la composition d’un grand poème biblique, Magdeleine, qu’elle remettra souvent sur le métier, et qu’elle ne terminera jamais : en décembre 1823, la Muse française en publie les chants I et VI, avec cette note : « Ce sujet a déjà fourni un chef-d’œuvre à la sculpture, et la poésie promet une rivale à la Madeleine de Canova ». Le compliment est déjà de taille. La Muse française entonne de bien autres chants de triomphe lorsque paraissent les Essais poétiques.
On imagine l’émotion de la jeune fille recevant de l’imprimeur Gaultier-Laguionie, en février 1824, les premiers exemplaires de son livre. À cette époque, les poétesses, et souvent aussi les poètes, se font représenter en tête de leurs ouvrages, l’air inspiré, une lyre à la main. Édouard d’Anglemont, en tête de ses Odes, se montre même en robe de chambre, en pantoufles, la cravate négligemment nouée, prenant son repas du matin, et tenant en main une lyre qu’il appuie sur la table où l’on voit la tasse et la chocolatière[134]. Delphine fait exception à la règle, et ne commet pas une pareille faute. Simplement, sur le titre en caractères gothiques, un fuseau s’appuie sur une harpe. À la fin du volume, un petit bois représente la Tour du prodige, sujet du dernier poème. En frontispice, une lithographie dessinée par Lucienne Collière figure naïvement la scène de la sœur de Sainte-Camille qui ne peut s’arracher à la vue du clocher natal.
Delphine, suivant l’usage, envoie les exemplaires de service. Les réponses arrivent : nous en possédons quelques-unes. Des premiers, le comte Daru, n’osant répondre directement à l’auteur, s’adresse à sa mère. Il vante la délicatesse des sentiments, le bonheur, la nouveauté et le naturel de l’expression, l’originalité du talent dans le goût et dans la grâce. Il remarque galamment que tous ces dons, Delphine les tient de sa mère. Puis Mme Adélaïde Dufrénoy, née Billet, se demande si elle doit féliciter l’auteur de parcourir une carrière qui offre tant d’écueils, mais devant tant de beauté, de grâce, comment ne pas la suivre
D’un regard à la fois complice et maternel ?
Chateaubriand griffonne quelques lignes de compliments : « J’ai retrouvé partout votre talent perfectionné ». Auger, le vieil académicien classique, l’accable d’éloges : « Vos sentiments sont vrais, vos idées justes et naturelles, rien dans vos vers ne sent l’apprêt ni l’effort ». La sachant très acoquinée au clan romantique, il lui recommande de rester elle-même, et la met en garde contre « je ne sais quelle fée à la mode qui fait prendre à ceux qu’elle touche de sa baguette la bizarrerie pour l’originalité, l’obscurité pour la profondeur, la niaiserie pour le sentiment, le prosaïsme pour la simplicité, et le barbarisme pour le génie du style ». Le réquisitoire est complet. Un autre académicien, le comte de Ségur, n’aurait jamais cru « qu’il fût possible de réunir à la fois tant de genres de talents, trop souvent opposés entre eux, la grâce et la simplicité, la richesse des images et l’élégante clarté d’un style noble et correct, enfin l’éloquente chaleur des sentiments passionnés et la sévère retenue du goût le plus délicat ». Il rappelle qu’il présidait l’Institut lorsque l’Académie proclama ses premiers succès ; il rappelle le modeste embarras de la jeune fille, et la douce jouissance que ses succès donnaient à sa mère.
La lettre d’H. de Latouche se distingue des autres. De dix-neuf ans plus âgé que Delphine, il connut Sophie Gay dès qu’il arriva à Paris. Éborgné par une balle dès le collège, ce gros homme réussit à faire oublier cette disgrâce par son esprit, sa distinction, sa voix au timbre flatteur, insinuant, carressant, voluptueux. Il a le cœur ardent et passionné, le tempérament vif et amoureux. De goût sûr, il manque de style. Son esprit lui suggère d’impitoyables épigrammes. C’est un rude jouteur pour Sophie Gay, qui ne l’appelle jamais que « mon ennemi intime ». Pourtant, il lui a voué une amitié qui ne se démentira jamais.
Le groupe de la Muse française vient de l’éliminer. Retiré à Aulnay, dans la Vallée-aux-Loups, il voisine parfois avec les habitantes de Villiers. « Puisque vous avez bravé le temps hier, lui écrit Sophie Gay, vous pourrez bien supporter celui d’aujourd’hui… J’ai l’âme fort triste, et pourtant j’ai promis de ne pas paraître malheureuse. Venez m’aider à tenir ma parole ». À Delphine, il envoie des billets de ce goût : « J’apprends que vous êtes dans votre village. Je maudis l’absence de toute santé qui m’empêche d’aller au-devant de vous : c’était le devoir du plus humble vassal de votre talent. Soyez la bienvenue ici ! Je ne désespérerai plus d’y retrouver Hygie (vieux style), puisque la Muse ne dédaigne pas d’y descendre. Le paysan d’Aulnay envoie l’hommage de son bon souvenir à la fée de Villiers. Je ferais un sonnet sur votre apparition si je me rappelais de (sic) mon métier de rimeur. Mais j’espère que vous reviendrez bientôt dans votre vallée. Je vais reprendre des forces exprès pour me trouver à votre rencontre. Dans le bouquet que vous emporterez ce soir, cueillez des œillets pour votre mère, et dites-lui qu’ils représentent mon amitié. »
N’y a-t-il pas, avec de la sensibilité et de l’émotion, une sorte de tendresse dans son remerciement à l’envoi des Essais poétiques ? « Je vous remercie du gracieux présent que vous m’avez fait. J’aurais pu dire, au moment même où l’on m’a remis vos vers, tout ce que j’en pense ; il y avait plusieurs jours que je les possédais, et je les relisais avec enchantement dans une retraite où le prestige du monde et la complaisance des admirations disparaît. Je n’ose mêler plus de louanges sincères aux flatteries qui sans doute vous environnent ; je ne veux pas donner à la voix d’une vieille amitié le tort de paraître froide, au milieu des compliments et des gazettes, mais j’ai regretté dans mes bois de ne pouvoir vous adresser à vous-même l’hommage du plaisir que m’a fait votre livre ; car si j’ai vu se refroidir quelques empressements littéraires pour n’avoir pu me faire l’adulateur du succès, ou plutôt d’ouvrages qui ne contentaient mon mauvais goût poétiquement ni philosophiquement, je sens que l’hypocrisie que je ne puis m’imposer n’eût point fait baisser mes yeux devant votre couronne. Votre envoi m’a fait naître dans l’esprit (peut-être mieux que dans l’esprit) deux sentiments qu’il faut que je vous dise. J’ai été charmé de supposer qu’on pouvait, autour de vous, oublier à demi les torts qu’on aurait eus soi-même ; et cette dédicace à Gustave [O’Donnell, récemment enlevé par le croup] a touché mon cœur. Imaginez que je n’ai rien su de lui que depuis peu de jours, et par un soupir de son père. J’aurais pu parler de ses yeux, demander si cet enfant qui m’aimait se souvenait encore de ma tendresse pour lui ; et l’herbe est déjà sur sa pauvre tombe. Si j’avais pu prévoir ce sort, je crois qu’avant de quitter votre village je l’aurais emporté dans mes bras, je l’aurais volé à sa mère, je l’aurais défendu contre un mal qui ne l’eût peut-être pas frappé dans un autre pays. Adieu, jeune fille et courageux poète ; vos succès ne me seront jamais étrangers ; vous êtes trop loin de l’âge où l’on peut prévoir le besoin des amis pour que je vous offre un dévouement sans réserve et sans faste ; mais je le pratiquerai sans l’offrir. Qu’est-il arrivé d’heureux ou de malheureux dans votre famille que je n’en aie partagé la peine ou la joie, malgré vous ? » On a beaucoup médit de Latouche : on l’a probable ment calomnié[135].
La presse n’accueille pas le premier ouvrage de Delphine Gay avec cette unanimité dans la louange que suppose Latouche. Le monde littéraire est trop divisé pour cela. Le Globe, sévère et doctrinaire, attend plus d’un an, jusqu’au 28 avril 1825, pour parler des Essais poétiques. Il leur consacre un long article. « Il y a dans notre capitale un petit cercle de jeunes poètes, dont les odes, les élégies, les chants d’amour faisaient fureur il y a deux ans, quand la critique haineuse des partis les poursuivait avec acharnement, et qui, depuis qu’on leur rend justice, descendent chaque jour de ce char de victoire où l’envie les avait élevés. Unis pour se consoler, ils ont formé une espèce d’académie des Arcades, où règne une jeune Muse, véritable prêtresse du temple. Là, dit-on, s’instruit maintenant le procès du siècle que naguère on élevait jusqu’au ciel : il est barbare, il ne sent pas la poésie ; et pour nous autres, humbles interprètes de ce bon sens vulgaire qui veut comprendre avant d’admirer, on nous y déclare profanes. Laure elle-même a, si nous croyons la renommée, prononcé notre arrêt. Elle aurait tort pourtant ; nous aussi de loin nous rendons hommage à son talent. Certes sa poésie n’abonde pas trop en idées ; mais si elle en a peu, elles sont naïves, naturelles, et l’on est certain qu’elles lui appartiennent. C’est un trésor qu’il lui sera possible d’accroître. Au reste, c’est de trois sources seules qu’elles découlent : beauté, amour, ma mère, voilà les mots que ramène sans cesse sa poésie ». Dans ce cadre, elle écrit des choses charmantes, mais « si elle chante Bonaparte, c’est d’une voix faible ; si elle essaie une histoire de revenants, son vers est obscur et sans verve ». L’auteur anonyme de l’article lui conseille de conserver son originalité, de ne pas aller dans le monde, de se garder du verbiage romantique. Et, peu féministe, il la blâme de publier trop vite : il n’aime pas que les sentiments d’une jeune fille soient, sitôt éclos, livrés en pâture au public, avec l’indication de la date et du lieu où ils ont pris naissance ; qu’elle attende d’avoir fait choix d’un époux, et de s’être acquis « une protection contre les attaques du monde et des consolations contre ses injustices ». L’auteur, évidemment piqué d’avoir été considéré comme un philistin par le cénacle, ne se doute certes pas du chemin que feront Hugo, Vigny et Delphine elle-même. Il reviendra sur cette comparaison du groupe romantique avec l’Académie des Arcades, fondée à Rome cent cinquante ans plus tôt pour épurer la langue, et qui ne réussit qu’à la surcharger de concetti.
La Muse française n’attend pas un an pour « donner ». Dès avril 1824, Alexandre Guiraud embouche la trompette. O matre pulchra filia pulchrior, inscrit-il en épigraphe. « Que la jeune Muse à laquelle je consacre cet article me pardonne une galanterie classique ; j’espère qu’elle n’entend pas son Horace, et elle me permettra de ne pas le lui expliquer, car je suis sûr que je la ferais rougir. » Mais Horace aura l’avantage de la cautionner auprès de ceux qu’il appelle ironiquement ses supérieurs. « La réputation de Mlle Delphine Gay a commencé d’une manière bien grave : elle s’est établie sur un suffrage académique ; et (ce qui est rare, même à l’Académie française) le jugement d’un petit nombre est devenu celui de tous. » Delphine Gay a tenu ses promesses. « Aussi toutes les admirations viennent-elles de tous les points les plus opposés se rassembler autour d’elle. » Si belle que soit « notre nouvelle Corinne », ces admirations ne vont pas à sa beauté : on s’en rend compte dès qu’on lit ses œuvres, mais « on applaudit cette heureuse harmonie entre la Muse et ses chants ». Guiraud parle ensuite de la culture des lettres chez les femmes, sujet de discussion ; Mme de Staël a résolu victorieusement la question en leur faveur. Pour prouver son impartialité autant que sa clairvoyance, il n’hésite pas à relever une faute de français :
Je bénis mes parents de m’avoir fait si belle.
Il faudrait faite. « Rien ne peut excuser une faute contre la langue, pas même la permission de Vaugelas, lorsque Racine, Corneille, Bossuet et Pascal ont refusé de la confirmer ». L’observation est juste. On s’étonne que la faute n’ait pas été supprimée dans les éditions suivantes. D’ailleurs, Guiraud termine sur une note dithyrambique : « Nos poèmes français ont peu de pages aussi belles et aussi touchantes. Que Mlle Delphine Gay achève ce monument qu’elle élève à la fois à sa gloire et à la nôtre. Elle est décidément, comme son héroïne, dans la bonne voie ; et nous lui garantissons que, plus heureuse qu’elle, il n’y a pas de remords littéraire qui l’attende au bout de son entreprise ».
Deux mois plus tard, Émile Deschamps revient à la charge. Il salue la mise en vente de la troisième édition des Essais poétiques, et s’empresse « de constater ce triomphe de la belle poésie dans un siècle aussi prosaïque ». Une nouvelle élégie dédiée, et pour cause, à la duchesse de Duras, enrichit le recueil, Ourika, qu’il cite en entier. « Je n’ajouterai pas une ligne de plus après de pareils vers, dont le charme sera senti par tout le monde, comme l’a été la délicieuse nouvelle qui les a inspirés. Je ferai seulement remarquer que si Ourika n’a eu qu’une existence amère et incomplète pendant sa vie, la voilà maintenant en possession d’une double immortalité ; c’est une compensation qui lui était bien due. »
Dans le même numéro, rendant compte des Tristes, il cite quelques vers de la poésie dédiée à Delphine par Belmontet :
Notre Corinne enfant, prêtresse de la lyre,
Oh ! Qu’elle est belle ainsi dans son naissant délire !
Elle a changé de nom, et sa gloire aujourd’hui
Comme l’astre de Thèbe en France a déjà lui.
Une grâce enivrante à sa beauté se mêle,
Et ses chants inspirés sont gracieux comme elle ;
Déjà, d’une couronne ornant ses blonds cheveux,
Son jeune et beau génie a fait plus que nos vœux ;
Déjà c’est un honneur de marcher sur ses traces :
Il sera trois Corinne, ainsi qu’il est trois Grâces.
Rivaux de la prêtresse et dans son temple admis,
Nous tous, l’environnant de nos lauriers amis,
Nous redirons ses chants sur nos lyres confuses,
Et nous l’invoquerons : on invoquait les Muses.
Un autre poète de l’Arsenal représente l’espiègle lutin d’Argail voltigeant autour des blonds cheveux de « l’illustre Delphine… et dérobant une fleur du bouquet de son sein ». Le concert d’adulations monte autour d’elle comme un encens. C’est la gloire pour cette jeune fille de vingt ans. Comment n’en est-elle pas grisée ? D’autres le furent à moins.
Sa mère juge l’heure venue de fixer ses traits pour la postérité. Elle fait appel au talent du peintre de portraits à la mode, depuis qu’il exécuta celui de Mme Didot : Louis Hersent, élu l’année précédente à l’Académie des Beaux-Arts, et avec cela très bien vu du monde royaliste. La postérité n’a pas ratifié le jugement des contemporains, et bien qu’Hersent soit mort en 1860, elle a commencé pour lui de bonne heure, par la plume de Gustave Planche, qui, rendant compte du Salon de 1831, conclut crûment : « En résumé, le portrait du roi par M. Hersent me paraît signaler d’une façon éclatante la nullité de l’artiste ». Formule plutôt sévère ! La peinture du portrait de Delphine semble, à la vérité, assez pauvre, mais tous ses amis la reconnaissent, et on en parle beaucoup.
Comment est-elle à cette époque ? Le portrait d’Hersent la montre dans sa robe blanche, un ruban de soie serrant la taille, et une écharpe bleue flottant légèrement sur ses épaules ; elle apparaît grande, bien en chair, la tête importante sous les coques de cheveux à la mode, les bras pas entièrement formés, des bras de jeune fille. Les femmes qui parlent d’elle (cette opinion sera sûrement la moins indulgente) sont unanimes : ce qui frappe à première vue, c’est l’éclat éblouissant de sa beauté, la fraîcheur de son teint. La première impression est inoubliable : plusieurs emploient le mot. L’accentuation des traits inspire à Jenny Bajac ce mot que rapporte avec plaisir Edmond Géraud, le type de l’homme de lettres de province jaloux de ses confrères parisiens : « Elle a l’air d’être la fille de Vénus et de Polichinelle ». Mme Lenormant, la nièce de Mme Récamier, insiste sur le charme infini qui se dégage de sa personne ; elle s’embellit en disant des vers. Mme d’Agoult, alors M. de Flavigny, a scruté les détails de sa physionomie pour une raison que l’on comprend tout de suite à lire cette phrase : « Après notre mariage à toutes deux, nous fûmes, elle et moi, avec la belle duchesse de Gramont, les trois blondes à la mode dans le faubourg Saint-Germain ». Voici comme elle l’a vue : « Delphine entra chez nous, grave et simple ; vêtue de blanc, le regard tranquille, le front sérieux ; ses longs cheveux blonds sans ornements retombaient des deux côtés de son beau visage en riches ondulations. Elle suivait en silence sa tapageuse mère… Elle récita un fragment de son poème de Magdeleine. Elle disait bien, sans emphase ; son organe était plein et vibrant, son attitude décente, son air noble et sévère. Grande et un peu forte, la tête fièrement attachée sur un cou d’une beauté antique, le profil aquilin, l’œil clair et lumineux, elle avait, dans toute sa personne, un air de sibylle accoutrée et quelque peu façonnée à la mode du temps. Il y avait en elle une puissance que l’on sentait bonne. On lisait à son front, dans son regard, une ouverture d’âme qui donnait confiance et enhardissait à l’aimer ». Cet air inspiré, les yeux au ciel, Hersent le lui a donné. Ni le peintre, ni Mme d’Agoult ne semblent l’avoir vue rire. Le témoignage le plus décisif est celui de Delécluze. Au vernissage du Salon de 1825, il a l’occasion de comparer côte à côte l’original et la copie, et il s’en acquitte avec son œil exercé de peintre. « Il y a de la ressemblance, mais, sur la peinture, les traits sont fort adoucis. J’ai rarement vu une jeune fille, de l’âge de Mme Gay, même en Italie où la nature est constamment plus forte, qui eût les os plus fortement caractérisés que cette jeune personne. Comme poète, sa figure est très remarquable, par la puissance de son regard et l’air de profonde intelligence que décèlent tous les mouvements de sa physionomie. Comme femme, elle manque d’une certaine faiblesse gracieuse qui plaît dans son sexe et qui flatte si doucement l’orgueil naturel de l’homme : il aime à jouer le rôle de protecteur. Au total, c’est une fort belle personne. Elle est grande, bien faite, ses cheveux blonds se marient bien avec l’éclat de son teint, et elle joint à beaucoup de grâce dans ses mouvements un air de simplicité et de bonhomie même, qui disparaît quand on observe avec grande attention sa figure, non que sa physionomie ait rien d’affecté, mais parce qu’on ne peut accorder facilement l’idée de l’ingénuité avec une expression si forte et un air d’intelligence aussi prononcé que celui qui éclate dans ses yeux. »
Nous la voyons bien maintenant : rien de la petite oie blanche, idéal de la jeune fille de ce temps. Au contraire, une individualité accentuée. En général, les appréciations des hommes ne comportent pas de restrictions. Celle de Villemain est à relever. À une soirée chez la duchesse de Duras, on dispute de la vraie noblesse.
— Il faut s’entendre, dit-il ; la noblesse est une sensitive ; il y a ici deux personnes d’une race à part, dont nous n’avons pas vu les parchemins : Capo d’Istria et Delphine Gay.
Elle se contentait de celle-là, et à l’occasion raillait l’autre. Elle porte un jour ce coup de boutoir à des gens infatués de leurs aïeux dont ils parlaient sans cesse :
— Moi aussi, qui ne déploie pas ma généalogie, j’ai un ancêtre.
— Et quel est cet ancêtre ?
— Un gardeur de cochons, Félix Péretti.
— Sixte-Quint ?
— Précisément.
« Et l’on ne parla plus d’aïeux ce soir-là », ajoute Gautier qui rapporte l’anecdote[136].
Si l’on compare son portrait à celui de sa mère, on est frappé de la ressemblance de leurs bouches : le dessin en est identique, fin, spirituel, nullement sensuel, quelque peu ironique.
Car Hersent exécute aussi le portrait de Sophie Gay. Elle pose pour lui en octobre 1824. Elle fait répéter au Théâtre-Français une pièce en trois actes et en prose, Marie ou la Pauvre Fille, dont elle est l’auteur. Elle espère un succès. Dans la même année, triomphe de la fille avec les Essais poétiques, succès de la mère sur la scène du Théâtre-Français, et les portraits de toutes deux par le peintre à la mode exposés au Salon de 1825 : comme on en parlera, et quelle excellente publicité !
Hélas ! Sophie Gay joue de malheur ! Marie ou la Pauvre Fille, représentée le 9 novembre, sombre lamentablement, bien que défendue par Mlle Mars et Mlle Leverd. Le Moniteur, indulgent, expose que l’auteur a encadré l’élégie de Soumet dans l’action de sa pièce ; bien que l’ouvrage ne manque point d’intérêt, ni le dialogue de vérité, cette histoire d’une fille abandonnée, reconnue grâce à la croix de sa mère, a été trop vue, est trop prévue. L’attendrissement n’a gagné qu’une partie du public, si bien que l’effet fut manqué sur l’ensemble. La pièce aurait toutes chances de succès sur une scène musicale. Dans le Journal des Débats, le critique dramatique avance qu’une femme peut composer de jolis romans, et échouer dans les pièces de théâtre. Mme de Staël et Mme Gay « ont fait des romans qui sont restés et qu’on relit toujours avec plaisir : l’une et l’autre ont fait des drames qui n’ont rien ajouté à leur réputation littéraire ». Il y a pour une femme un courage presque viril à braver les orages de la représentation : dès lors on est moins disposé à avoir à son égard les ménagements respectueux que l’on accorde aux dames. « Ici, il n’y a eu de complet que la chute, et, quelque pénible qu’il soit de le dire, cette chute a été méritée… Nous attendons Mme Gay à son prochain roman. »
Le Globe en parle après la seconde représentation : « Mardi, nous en étions aux espérances avec la Pauvre Fille, aujourd’hui, nous avons à enregistrer une double chute ; car l’expérience de mercredi n’a pas suffi à Mme Gay ni à Mlle Mars. Elles ont fait un nouvel appel à la galanterie du parterre : c’est un peu trop abuser des privilèges du sexe… Jamais plus malheureux essai d’un mauvais genre n’avait été fait à la scène… Faire trois actes pour encadrer vingt-cinq beaux vers, est une licence théâtrale dont le public a fait justice[137]. »
Sophie Gay n’a pas plus de chance avec son portrait qu’avec sa pièce. Le 28 octobre 1824, elle reçoit de son peintre cette peu réjouissante missive : « Madame, j’ai été fort incommodé cette nuit, et je me sens dans l’impossibilité de travailler ce matin. Veuillez donc m’excuser si je vous prie de ne pas vous déranger pour me donner séance aujourd’hui. Je suis en outre dans la nécessité de vous dire que la manière dont mademoiselle votre fille s’est expliquée hier relativement à votre portrait m’a tout à fait découragé. Je ne conteste pas la justesse de ses observations, quelque sévères qu’elles soient, mais comme j’ai fait tout ce que la portée de mon talent me rend possible, et qu’en recommençant aujourd’hui ce qui ne lui convient pas, il n’y a pas de raison pour que je parvienne à la satisfaire davantage, car je ne puis voir que par mes yeux, je pense que dans cette situation le mieux est de ne pas se consumer à redresser infructueusement un ouvrage mal pris. J’espère de vos bontés que vous voudrez bien me pardonner le dérangement et les pertes de temps que ce malheureux portrait vous a occasionnés, et que dans la nécessité où je suis de renoncer à le continuer, vous rendrez au moins justice au désir de vous satisfaire, dont le zèle avec lequel
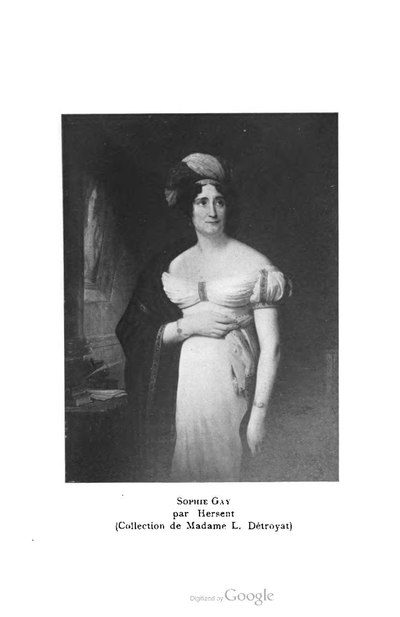
je m’en suis occupé ne doit pas vous laisser de
doute[138] ».
Delphine laissa sans doute échapper quelque parole vive comme dans sa discussion avec Vatout ; mais l’épiderme du peintre est susceptible. Le portrait de Sophie Gay paraît cependant supérieur à celui de Delphine : la peinture en est plus solide, plus vibrante. Le modèle, que coiffe toujours le turban de Mme de Staël, se montre dans toute la force de l’âge mûr, belle encore, l’œil vif, les lèvres prêtes à s’ouvrir pour quelque trait d’esprit. La toile n’est donc pas accrochée au Salon. Elle reste dans l’atelier d’Hersent. On l’y retrouvera à la mort du peintre. On ne sait plus alors comment il se fait qu’elle se trouve là : Émile de Girardin l’achète pour lui, et la donne ensuite à sa nièce, Mme Détroyat, lorsqu’elle se marie : Mme Détroyat la conserve pieusement.
Le 11 janvier 1825, Hersent est promu officier de la Légion d’honneur, en compagnie d’Horace Vernet ; Heim, Schnetz et David d’Angers sont nommés chevaliers, tous amis des Gay. Le 14, vernissage et visite du roi. Sophie Gay est assise à côté de Mme Horace Vernet, qu’accompagnent son mari et son beau-père Carle Vernet. Delphine attire l’attention plus que quiconque. Gérard, très entouré, en chapeau à trois cornes, et l’épée au côté, cherche à retenir le groupe qui l’environne. « Mais la planète Gay, dont l’attraction triple (poète, femme et jeune) a plus d’action, non seulement attire à elle toute l’atmosphère de gloire qui entourait Gérard, mais force Gérard lui-même à se confondre dans le nombre des bienheureux qui forment un nuage d’adorateurs autour de la jeune poétesse. »
Tout le monde se lève. Voici le roi. Des bruits ont couru naguère, au temps où il s’appelait le comte d’Artois. Il a vu la belle Delphine, il l’a entendue dire des vers chez une femme de la cour logée aux Tuileries. Elle produit sur lui une vive impression. Aussitôt, un complot s’ourdit : Sophie Gay en fut-elle avertie ? Peut-être. À coup sûr, sa fille ignora tout. Des courtisans qui se rappellent les errements de la cour sous l’ancien régime, ont imaginé de donner Delphine au prince, sinon pour favorite, au moins pour épouse morganatique. La combinaison échoue. Le comte d’Artois a fait vœu de continence au lit de mort de Mme de Polastron. D’ailleurs, Delphine avait trop de fierté pour jamais accepter pareil marché. Mais Charles X, le plus gracieux gentilhomme de son royaume, lui a conservé sa bienveillance. En ce jour, « tout le monde entoure ce prince chéri ; c’est une véritable fête de famille, et il faut y avoir assisté pour sentir tout ce que fait éprouver de délicieux cette familiarité noble et touchante. Mme et Mlle Gay se trouvent auprès du roi lorsque ce prince jette les yeux sur un très beau portrait de Mlle Gay, peint par Hersent.
» — Votre portrait est bien joli, mademoiselle, dit le roi à cette demoiselle, et la ressemblance est parfaite. Peignez-vous aussi ?
» — Non, sire, répond Mlle Gay d’une voix émue et tremblante, je n’ai pas ce talent.
» — Mais en revanche, reprend Sa Majesté avec bonté, vous écrivez si bien ! »
Paroles vraiment royales !
De par la volonté de Sophie Gay, le portrait de sa fille par Hersent figure aujourd’hui au Musée de Versailles, dans la galerie consacrée aux gloires du xixe siècle. Quelque jour, l’autre portrait ira ie rejoindre, celui qu’une appréciation trop vive de Delphine empêcha de figurer au Salon de 1825[139].
On ne peut dénier à Sophie Gay un sens aigu de l’actualité. Elle n’ignore pas la manière de s’en ser vir. Elle donne à sa fille toutes directions utiles à ce point de vue.
La duchesse de Duras écrit une nouvelle, Ourika. Une duchesse auteur ! Cela pique la curiosité. Chateaubriand, naturellement, vante l’ouvrage. Le succès se déclare. Louis XVIll fait un mot : « C’est une Atala de salon ! » Alexandre Duval en tire une pièce que Mlle Mars refuse de jouer sous prétexte qu’elle ne veut pas se noircir le visage, et que Mlle Bourgoing accepte par courtisanerie. Les vaude villistes font des couplets. Les bonnets, les schalls, les chapeaux, les robes s’intitulent « à la Ourika ». La malignité s’en mêle ; les amies de l’auteur appellent ses filles : Ourika, Bourika et Bourgeonika. On ne parle que de cela. Et incontinent une élégie sous le même titre et dédiée à la duchesse s’ajoute à la troisième édition des Essais poétiques.
Horace Vernet expose-t-il un tableau qui produit une sensation dans le public ? Cette Druidesse qu’il a représentée, vite Delphine Gay la met en vers, et lui dédie le poème[140]. Autre dédicace à Ducis, le peintre, de la poésie intitulée Madame de La Vallière, écrite pour son tableau représentant Mme de La Vallière causant avec Mme de Thémines dans le cimetière du couvent des Carmélites.
Le 28 octobre 1824, le peintre Gros lance une invitation : « Monsieur, venant de terminer les peintures de la coupole de l’église Sainte-Geneviève, et devant les livrer aux regards du public le jour de la Saint-Charles, je prends la liberté de vous adresser la notice et d’espérer que vous voudrez bien me faire l’honneur de venir les visiter à partir du dimanche 31 octobre jusqu’au 3 novembre inclusivement[141] ». Le 9 août 1811, Gros a passé un traité avec Montalivet, ministre de l’Intérieur, pour, sur l’ordre du Maître, décorer de peintures la coupole du Panthéon. Aujourd’hui, Napoléon n’est plus là. Dans sa composition, le peintre doit remplacer la famille impériale par celle de Louis XVIII ; Marie Louise se transforme en duchesse d’Angoulême, le roi de Rome en duc de Bordeaux. Il refait le quart de son travail.
Après les privilégiés, le public est admis à visiter la coupole le 4 novembre ; une foule immense défile devant cette œuvre gigantesque. Les élèves de Gros lui ménagent une ovation. L’enthousiasme est grand, la peinture considérée comme un chef-d’œuvre, en dépit des critiques qui estiment Louis XVI trop bourgeois dans sa robe de chambre, assis sur un nuage, et rappelant le triomphe des maris montant au ciel en bonnets de coton dans les Petites Danaïdes. Le 24 novembre c’est le tour du roi. Il affecte en entrant d’appeler le peintre M. Gros, et, en sortant : M. le baron.
Voilà, certes, un beau motif de poésie. Le 21 avril 1825, Delphine improvise un poème, pour lequel on improvise une fête. Au-dessus du maître autel, entre ciel et terre, on installe deux fauteuils d’honneur, l’un pour le baron Gros, l’autre pour la poétesse. Quarante amis, dit le Globe, quatre cents, dit la duchesse d’Abrantès (faute d’impression d’un côté ou de l’autre), écoutent. Les uns fixent leurs regards sur la peinture, les autres sur la jeune Muse, d’autres enfin se recueillent et prient. Delphine parle. Rarement elle parut aussi belle ; on peut en croire la duchesse d’Abrantès, peu suspecte de partialité en faveur de la famille Gay. « La voix tombant des cieux comme celle de la simple bergère, et allant faire tressaillir, dans un coin obscur des catacombes, les cendres oubliées d’un poète et d’un philosophe : n’est-ce donc pas un tableau merveil leux, digne presque des jours de la Grèce ? Apelle, prends ton pinceau, et rends-nous cette scène magique : nous la placerons dans l’église souterraine : tu seras l’alpha et l’oméga de notre vieux panthéon. »
Le lendemain, la duchesse d’Abrantès demande à Gros s’il est content des vers de Delphine :
— Je n’en sais rien ! Je verrai cela plus tard. Hier, je n’ai aperçu qu’une femme ravissante de jeunesse et de beauté qui me parlait ; mais ce qu’elle m’a dit, je n’en sais plus rien.
« Et je vis que Gros avait la tête complètement tournée », ajoute la duchesse.
Le poème de Delphine bénéficie d’une seconde lecture à l’Académie, où il recueille des applaudisments unanimes. Puis, il paraît en brochure. Jouy félicite l’auteur : vers charmants, pureté soutenue, simplicité classique, toute la grâce, toute l’élégance qui caractérise ce jeune et beau talent. Deux réserves toutefois. Il cite : « Et sa voix — les bénissait du haut de son supplice ». — « Je trouve, dit-il, plus d’ambition que de justesse dans cette expression ; ce n’est pas le supplice qui est élevé, c’est l’âme de celui qui l’endure, et c’est en ce sens que Molière a pu dire en parlant d’un homme insolent : il vous regarde du haut de son esprit. » Non moins justement, il signale l’abus de la conjonction car. Mais ce sont fautes légères. Jules de Rességuier, que Sophie Gay appelle volontiers : « cher troubadour », envoie une poésie :
Le Seigneur m’inspirait : sa divine lumière
Embrasait de ses feux mon âme tout entière.
De magiques pinceaux évoquent à nos yeux,
Les âges de la France et dévoilent les cieux,
Et sous la coupole immortelle,
Le génie inspiré se révélait deux fois,
Lorsque tu chantais, pâle et belle,
Et brillais au milieu des anges et des rois.
Lutèce a cru revoir sa céleste Patronne ;
Ta voix de notre Gloire a marqué tous les pas ;
Tu chantes les lauriers dont elle se couronne :
Il en est un pourtant que tu ne chantes pas.
La foule t’accompagne à l’enceinte divine ;
Elle brûle à tes pieds un encens qui t’est dû,
Et tout bas se demande, en écoutant Delphine,
Si la femme est montée, ou l’ange descendu[142].
Un joli billet de Sophie Gay remercie le troubadour de ce compliment bien tourné. « Delphine, qui aime encore mieux la poésie que la gloire, regrette presque d’être l’occasion de ces vers charmants ; car elle les dirait sans cesse. Jamais la flatterie n’a employé de plus doux accents pour séduire. C’est bien l’harmonie la plus céleste et la plus dangereuse. Oh ! Ce plaisir d’être ainsi chantée doit consoler de bien des peines ! » Delphine en a, nous saurons bientôt lesquelles.
Cinq semaines plus tard, alors que le bruit de celui-ci s’éteint à peine, nouvel événement : le sacre de Charles X à Reims ; nouvelle occasion pour la Muse d’accorder sa lyre au diapason de l’actualité. Les préparatifs de la cérémonie enfièvrent la haute société. On s’enthousiasme à lire dans les gazettes la description des magnificences imaginées par Hittorff pour la cathédrale. Les étrangers affluent. Le duc de Northumberland apporte dans ses bagages pour trois millions de vaisselle d’or et d’argent. À Paris, on admire les voitures du sacre, les toilettes exposées chez les couturiers. À l’Intendance des Menus, on défile devant les ornements et les costumes qui serviront à Reims. Et l’on se répète que Sophie Gay, trompée sans doute par un jeu de lumière, et à coup sûr sans intention maligne, a déclaré que l’habit du grand chambellan était de couleur changeante ; or le grand chambellan n’est autre que le prince de Talleyrand.
Victor Hugo et Lamartine reçoivent la Légion d’honneur le 19 avril. Les poètes se préparent à chanter. La cérémonie a lieu le 29 mai. Delphine date de Villiers-sur-Orge, le lendemain 30, son poème de la Vision.
Jeanne d’Arc lui apparaît, évoque le souvenir du sacre d’un autre Charles, et se rassure sur l’avenir de la France lorsque Charles X prête serment de maintenir les lois, l’égalité de la justice pour tous, la liberté des cultes ; avant de remonter dans les cieux, Jeanne d’Arc espère bien qu’en dépit du danger, Delphine signalera courageusement à la France les manquements que le roi pourrait faire à son serment. Delphine jure à son tour d’accomplir cette sainte mission. Dieu l’a vouée à la gloire en la créant poète. Elle chantera, elle rallumera le flambeau de la Vérité.
Le héros, me cherchant au jour de sa victoire,
Si je ne l’ai chanté doutera de sa gloire.
Après sa mort, les Français la pleureront, et l’appelleront : Muse de la Patrie.
Il est visible que son entourage a fini par lui inculquer une très haute opinion d’elle-même. Ses amis consacrent le titre qu’elle vient de se décerner. Mais le Globe veille, le Globe prompt à ironiser, et qui, parmi les poètes du Cénacle, semble prendre Delphine pour cible préférée. Par une étrange rencontre, à cette époque, Hortense Allart y publie, sous les initiales E. D., ses Lettres sur les ouvrages de Mme de Staël (19 mai 1825). Ce journal attend jusqu’au 7 juillet pour porter son coup.
« C’en est fait, nos poètes des Arcades triomphent ; Corinne monte au Capitole : ce n’est plus la timide et modeste vierge rougissant sous les regards des hommes et se cachant dans le sein d’une mère en murmurant le nom d’amour ; c’est la prêtresse en délire, en proie au dieu dont elle est possédée, altière, impérieuse, et commandant les respects de la terre. Pauvre jeune fille ! Qu’as-tu fait de ta couronne de bluets et de roses ? Se trouvera-t-il un Oswald pour la recueillir ? C’est ainsi que j’entendais hier s’exprimer un véritable ami de Mlle Gay, après la lecture de la Vision ; et tout le monde fut de son avis, et chacun accusait les flatteurs qui ont égaré sa raison et gâté son talent. Une voix si tendre et si touchante, une grâce si naïve et si pure, une si jeune et si fraîche imagination, étaient-elles donc destinées à vieillir sitôt, et devions-nous nous attendre à voir succéder à ces confidences charmantes, expression de sentiments véritables, ces chants d’un faux orgueil et d’un enthousiasme vulgaire, ces apothéoses vieillies, qui n’ont d’audace que parce qu’elles sont ridicules ? » Le rédacteur oppose à ce poème celui de Mme Tastu, à laquelle il donnerait plus volontiers ce nom de Muse de la Patrie. Après quoi il analyse la Vision, et finit ainsi : « Ne semble-t-il pas entendre Jeanne d’Arc mourante ? Heureusement il ne s’agit pour Mlle Gay ni de persécutions, ni de bûcher : son courage peut se déployer sans péril dans les salons et à l’ombre de la cour. La patrie n’a pas besoin non plus de sacrifices : il en est un surtout qu’elle défend à ses filles bien aimées, celui de la modestie : ce fut toujours en France la première leçon des mères. » La leçon est assez rudement donnée. Il faut bien avouer qu’au point de vue littéraire le conseil donné par le Globe est bon ; on s’en apercevra par la suite[143].
Le 20 septembre, le critique s’adoucit : « Des flatteurs ont failli perdre M" Gay ; ils l’avaient enivrée d’orgueil, elle oubliait les grâces et la modestie de ses premiers essais : un ami spirituel et sensé la sauve ; il la prie de chanter pour la Grèce malheureuse, d’implorer la pitié pour ses enfants, ses vierges, ses vieillards, et le charme revient avec une si douce et si sainte mission. Ce n’est plus une Muse altière, commandant avec autorité les respects de la France ; c’est l’humble et tendre charité, empruntant au talent un langage plus aimable et plus persuasif : qui n’applaudirait à un si heureux changement ? » Et dans le nouveau poème le journaliste découvre cette fois de l’esprit, de la finesse, de la grâce, et, lorsque le poète parle aux prêtres de leur devoir, de la force et de l’onction : « On sent qu’elle est chrétienne, et chrétienne comme saint Paul ».
L’ami spirituel et sensé, c’est Villemain, intime des dames Gay chez lesquelles il vient presque chaque soir passer un bon moment. Familier du salon de la duchesse de Duras, ardente à vouloir l’indépendance de la Grèce, Villemain charge Delphine de quêter pour les Grecs. Elle répond :
La Fortune en fuyant m’a ravi ses trésors,
Et ma richesse est dans ma lyre ;
Je n’ai, pour seconder vos généreux efforts,
Que les bienfaits de ceux qui daigneront me lire.
Elle joint à ces vers la Quête pour les Grecs, poème écrit le 24 août 1825. La brochure est distribuée aux bons endroits. Le comte Daru vante les grâces naturelles, sans affectation, sans ornements fastueux, de ces vers, et risque cette image d’aspect saugrenu : « On dirait que c’est à votre toilette que vous avez appris votre poétique ». Sans doute parce que la toilette est simple.
Le général Sébastiani émaille sa réponse de con sidérations politiques. « Vos vers en faveur des Grecs sont dignes de la noble cause qui les a ins pirés ; ils offrent l’heureuse union d’un beau talent et des sentiments les plus élevés. Les Grecs méritent votre intérêt même après avoir demandé à passer sous la domination anglaise. Abandonnés par l’Europe, ils se sont vus forcés d’implorer l’appui du seul gouvernement qui ne s’est pas montré leur ennemi. Ibrahim n’a pas entendu dans le Péloponèse une voix suppliante ; vieillards, femmes, enfants, tous périssent plutôt que de se soumettre. Des chrétiens, des Français, ont organisé et discipliné les armées qui les exterminent. »
L’ami de Mme Récamier, le prince Auguste de Prusse, que Sophie Gay connut à Aix-la-Chapelle lors du fameux Congrès, reçoit un exemplaire, et remercie en français, ou quelque chose d’ap prochant : « Mademoiselle, Daignez agréer bien ma reconnaissance de la bonté que vous avez eue de m’envoyer vos poésies. L’admiration pour vos talents dont vous faites un si noble usage, pouvait seule être augmentée qu’en vous voyant déclamer vos poésies inspirées par les plus beaux sentiments. Je suis avec la plus parfaite estime, mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur. Auguste, prince de Prusse. » L’histoire ne dit pas quelle obole accompagnait ce billet.
Sophie Gay se remue beaucoup, comme toujours, pour que la quête soit fructueuse. Elle envoie dix brochures à Coulmann par le canal de la recette générale de Strasbourg. « Nous les vendons au pro fit de ces malheureux, depuis trente sous jusqu’à cent mille francs. Ainsi, placez-les le mieux que vous pourrez. » La duchesse d’Orléans, la duchesse de Duras se mettent de la partie, et « placent » des exemplaires. Tant et si bien que le 27 octobre suivant, le Moniteur annonce que Mlle Gay a remis à M. Ternaux aîné, président du Comité des Grecs, une somme de trois mille francs, premier produit de sa quête, et publie la lettre de remerciements où Ternaux aîné dit entre autres belles choses : « Continuez, mademoiselle, à consacrer vos talents à de si nobles sujets, et comptez sur la reconnaissance des gens de bien, comme sur les applaudissements des hommes éclairés. » Le 26 janvier 1826, nouvelle insertion au Moniteur ; Sophie Gay a trouvé le moyen de vendre dans la seule ville de Munich pour quatre cent francs de brochures, et la somme est versée au comité.
La Quête pour les Grecs a gagné la partie. La jeune Muse a justifié ses vers à Villemain : riche seulement de sa lyre, elle a réussi à récolter une large obole[144]. Le poème n’a pas encore produit tout son effet, quand survient la mort du général Foy. Delphine avait eu l’occasion de faire au Mont-Dore la connaissance du général. Ils étaient descendus dans le même hôtel. Sur le registre où les voyageurs inscrivent leurs noms, elle voit la signature du grand homme de l’opposition. Juste au-dessous, elle écrit :
À la tribune, ainsi qu’au champ d’honneur,
Digne à la fois et de Rome et d’Athènes,
C’est un César pour la valeur,
Pour l’éloquence un Démosthène.
Elle apprend sa mort le 20 décembre 1825, et jette aussitôt sur le papier des stances d’un beau souffle, qui seront insérées à la suite du volume de Pensées du général Foy, avec le dithyrambe de Viennet et l’élégie d’Alexandre Dumas. Elle finissait sur cette belle image :
Hier, quand de ses jours la source fut tarie,
La France, en le voyant sur sa couche étendu,
Implorait un accent de cette voix chérie…
Hélas ! au cri plaintif jeté par la patrie,
C’est la première fois qu’il n’a pas répondu !
Ces vers sont gravés dans le tombeau du général.
On sait quelle foule accompagna le convoi, foule d’inconnus et de célébrités : Dupin aîné, Kératry, Benjamin Constant, Alexandre de Lameth qui représentent les députés de l’opposition, et Mérimée, Viennet, Victor Hugo dans l’éclat de ses vingt-trois ans, Delphine Gay dans la splendeur de ses vingt et un ans. Elle s’écrie : « Ah ! Voilà comment je voudrais mourir, au milieu de tant d’hommes illustres qui pleurent et de tant de femmes en deuil ![145] »
Les vers qu’elle compose au fur et à mesure des événements, ceux qui procèdent de la fantaisie de son imagination, elle les récite dans les salons amis. Chez la duchesse de Duras, le cercle diplomatique, politique et scientifique se tait pour écouter la Veuve de Naïm, ou Velléda, ou le Parthénon. Delphine y dit plusieurs fois la Quête pour les Grecs ; le duc de Doudeauville est convoqué pour l’entendre. La duchesse accable la jeune fille de billets complimenteurs : « C’est à vous qu’on voudrait ressembler, aimable Delphine, mais cela n’est pas facile ; il faut vous aimer pour se consoler de vos perfections ». Un autre jour : « Ces pauvres Grecs ont grand besoin que vous leur prêtiez l’appui de votre beau talent ; on aime à voir s’allier les grandes puissances des nobles sentiments et des nobles pensées, et des belles actions ; tout cela, quoi qu’on en dise, finit par remporter la victoire ». La duchesse possède une vieille tante aveugle qui ne sort pas ; elle obtient que Delphine vienne lui dire dans l’intimité sa Quéte, puis son Hymne à sainte Geneviève. La duchesse de Rauzan, fille de la duchesse de Duras, surenchérit : « Maman est à Saint-Cloud depuis quelques jours, Mademoiselle, elle revient samedi avec grand désir d’entendre avant votre départ des vers charmants qui ont déjà ravi plusieurs personnes. Venez donc samedi soir de bonne heure, nous dire cette Folle [des Champs-Élysées dont il paraît qu’on devient fou ; vous m’avez aussi promis le Malheur d’être laide (que Delphine écrit en pendant au Bonheur d’être belle), et malgré votre talent pour deviner toutes les impressions, tous les sentiments, permettez-moi de croire que vous n’entendez rien à celui-là. Donnezmoi, je vous prie une bonne réponse, et laissez une ignorante vous parler de son admiration. » Villemain a narré une soirée dont le souvenir le frappa. À Saint-Germain, pour clore une discussion assez chaude, la duchesse de Duras prie Delphine de réciter la Druidesse. « C’était sur la terrasse, entre l’horizon de Paris et les ombres projetées des vieux créneaux du château de Saint-Germain. Soirée belle et calme. La jeune fille, dont la grâce naïve et fière égalait le talent, ne répondit qu’en commençant de sa voix harmonieuse le chant de la Druidesse. Animés par un accent doux et sonore, les vers se succédaient faciles et coulaient avec charme. Debout, quelques mèches de ses cheveux blonds éparses à la brise légère de cette nuit d’été, la jeune Muse, comme elle se nommait si bien elle-même, doublait par sa personne l’illusion de son chant, et semblait se confondre avec le souvenir qu’elle célébrait. Le prestige nous avait tous éblouis[146]. »
On voit depuis quelque temps dans la société parisienne « une sorte de sapajou subtil et insinuant », petit, lippu, ridé, clignant de l’œil, coiffé d’une perruque à l’enfant, moitié chiendent, moitié filasse, une perruque comme on n’en porte plus, « vêtu à la diable, racontant lentement, d’un accent germanique, des drôleries où la saillie ne manque pas, viveur effronté, sceptique et bas sur jambes ». Le docteur Jean-Ferdinand Koreff, médecin du prince de Hardenberg, a quitté les États badois en novembre 1822 pour s’installer à Paris. Charlatan, faiseur d’anges, espion que la police surveille, il s’est glissé dans tous les mondes. Doué d’un esprit caustique, il lance des épigrammes faciles et mordantes. La duchesse de Rauzan le protège ainsi que la baronne Decazes, et, naturellement, le baron d’Arnim. Familier du prince de Talleyrand, habitué chez Letronne et chez Humboldt, il rencontre chez Cuvier, Delacroix, Victor Jacquemont, Mérimée, Stendhal qu’il réussit à démonter par son sang froid ; il fréquente chez Gérard, chez Mme Ancelot ; il se mêle au groupe des viveurs de la Maison Dorée. Il ne succombera même pas sous l’abominable scandale de l’affaire de la comtesse Lincoln, fille du duc et de la duchesse de Hamilton, que Wolowski et lui sont accusés d’avoir violée et volée dans un état de faiblesse et de somnolence où elle se trouvait, et qui s’en tirent en réclamant quatre cent mille francs d’honoraires ! Le tribunal leur en accorde vingt quatre mille[147].
On parle beaucoup dans le monde du talent de pianiste de la jeune M" de Flavigny, la future comtesse d’Agoult, qui signera en littérature Daniel Stern. Koreff apprend que Delphine serait tentée de la connaître. Toujours prêt à se mêler de tout, il se pose en intermédiaire, et demande pour les dames Gay une invitation au premier concert que donnera Mme de Flavigny dans son appartement de la place Vendôme. Mme d’Agoult a laissé dans ses Souvenirs le récit de la rencontre des deux jeunes filles : Mlle de Flavigny, passionnée pour le génie, exaltée à la pensée de jouer devant « cette glorieuse Delphine », de parler à un poète, à ses yeux un être au-dessus de tous les autres, et quel poète, avec toutes les séductions de sa beauté féminine ! « Je jouai avec émotion, dit-elle, avec une puissance que je ne me connaissais pas ; je fus extrêmement applaudie ; le morceau terminé, Mme Gay, se levant avec fracas, s’avança vers moi, et de sa voix de théâtre : « Delphine vous a comprise », s’écria-t-elle. Je restai toute interdite. Delphine, qui s’était approchée doucement, me tendit la main. Elle retint longtemps la mienne dans une affectueuse et forte étreinte ». À son tour, elle dit pour la jeune artiste un fragment de son poème de Magdeleine. De là date une sympathie que l’absence, et des circonstances que Mme d’Agoult a des raisons de ne pas préciser, modifieront[148].
Pour faire entendre à ses amis la Vision dite par l’auteur, Mme Récamier organise une réunion solennelle à l’Abbaye-aux-Bois, dans son petit salon du troisième étage. À la fin du mois de juin, il fait très chaud. Les chaises, occupées par les dames, sont disposées en plusieurs cercles concentriques ; le dernier laisse une place réservée au lecteur. Les hommes se tiennent debout le long des boiseries. Le portrait de M" de Staël et la Corinne de Gérard, dominent la scène. Dans sa robe de mousseline blanche nouée par un ruban bleu, Mme Récamier va de l’un à l’autre, distribuant à chacun un sourire, un mot amical, une parole bienveillante. Ce jour-là, la compagnie est de choix : les ducs Mathieu de Montmorency, de Laval, de Doudeau ville, les vicomtes de La Rochefoucauld, de Chateau briand, d’Arlincourt, MM. Villemain, de Catelan, de Sainte-Aulaire, Bertin de Vaux, P. Lebrun, Charles Lenormant, Charles Magnin, Saint-Marc Girardin, Dubois du Globe, Humboldt, Pasquier et son frère, Tourguenieff, Tufiakin, de Montlosier, de Rémusat, de Forbin, Parseval de Grandmaison, de Latouche, A. Roger, de Guizard, Seguin, Mohl, Ampère et son fils, Paul David, parent de Mme Récamier ; côté des dames, Mme Tastu, de Boigne, Catelan, de Gramont, Elisa Mercœur, la duchesse d’Abrantès, d’Hautpoul, Lenormant, et miss Clarke. Un dessus du panier du Tout-Paris de cette époque ; il n’y manque même pas les quatre ou cinq métèques de rigueur.
Delphine doit la première réciter son poème, puis Talma quelques tirades tragiques. Mais les dames Gay sont en retard. Talma les devance. L’assistance l’accueille par un murmure flatteur qui le ravit plus que des applaudissements bruyants. Delphine n’arrive toujours pas. L’auditoire commence à s’agiter ; pour calmer son impatience et lui procurer un peu de fraîcheur, car la chaleur augmente et les messieurs fondent dans le triple tour de leurs hautes cravates, Mme Récamier fait passer des rafraîchissements, des sorbets. À ce moment, Delphine et sa mère font leur entrée. Difficilement, Mme Lenormant et Mme Récamier les conduisent jusqu’au petit cercle resté vide au centre du salon. L’ordre se rétablit lentement. Enfin, chacun regagne sa place. Delphine prend un siège, s’y pose en se tournant vers le tableau de Corinne, et dit en souriant :
— Je suis bien.
Silence complet. Elle commence. Quand elle en vient au passage où elle parle du serment de main tenir la Charte, de la liberté de la presse et des avances du parti libéral, des indiscrets coulent un coup d’œil vers la partie de l’auditoire que ces allusions doivent peu flatter. Mais les ducs demeurent impassibles dans leur sérénité. La curiosité de la plupart des auditeurs reste concentrée sur Delphine. Elle a fini : on la couvre d’éloges qui ne cessent que lorsque Talma prend la parole[149].
À quelque temps de là, Mathieu de Montmorency tombe malade, assez gravement pour inquiéter son entourage. On vient aux nouvelles chez Mme Récamier ; elle en donne au fidèle Ballanche, à Dugas Montbel, à Féret, un jeune magistrat, et à Delécluze, réunis chez elle. Soudain, Sophie Gay entre, l’air effaré, et demande :
— Eh bien ? Comment va M. le duc de Montmorency ?
— Beaucoup mieux, répond Mme Récamier ; je l’ai vu il y a deux heures, la saignée lui a été très salutaire.
— Ah ! que vous me faites de bien ! Et Sophie Gay de partir comme un trait. Cette entrée brusque, ce prompt départ, jettent un froid. Pour rompre le silence, Mme Récamier demande à Dugas-Montbel ce que Ballanche vient de lui dire à l’oreille.
— Ballanche ? Madame, ne vous fiez pas à lui ; avec son air si bon et si doux, c’est une très mauvaise langue. Il prétend que Mme Gay est venue ici prendre des informations pour savoir si sa fille doit se mettre à faire des vers sur une convalescence ou sur une mort.
Cette mort arrive tragiquement le vendredi saint de l’an 1826 : le duc s’écroule au pied de l’autel de Saint-Thomas-d’Aquin où il priait. Quelques jours plus tard, à une soirée chez Gérard, Ingres, Pradier, Thévenin et Delécluze écoutent le maître parler de son art avec la solide fermeté de son jugement et la délicatesse de son goût, lorsqu’il est interrompu par l’entrée de Sophie Gay, qui lui coupe net la parole :
— Mon cher, nous avons fait des vers sur la mort de M. Mathieu de Montmorency ; ils seront demain dans les journaux ; et nous voulons que vous les connaissiez avant tout le monde.
On passe dans le salon voisin où Delphine s’est arrêtée pour causer, et où se tiennent M. et Mme Ancelot, Mme de Périgord, et le pianiste florentin Sgricci qui improvise facilement de sept à huit cents vers en trois quarts d’heure. Elle s’assied près de sa mère, prend, les yeux au ciel, sa pose favorite que fixa le pinceau de Hersent, et récite son poème. Dès qu’elle a fini, elle se lève ; sa mère lui donne le signal de la retraite, et dit à Gérard :
— Mon cher, mous sommes désolées de vous quitter si brusquement, mais nous devons passer encore chez deux amis ce soir… Ces vers sont beaux, n’est il pas vrai ?… M. de Chateaubriand a été bien frappé de celui-ci : « Donner à la vertu tout l’éclat de la gloire ». Mais Delphine avait un si beau sujet ! M. de Montmorency mourant le même jour que notre Sauveur ! C’est admirable, c’est sublime ! N’est-ce pas, Gérard ?… Mais nous vous quittons… Adieu ! Adieu ! La poésie, datée du 28, paraît en effet au Moniteur le 31 mars 1826[150].
Au début de cette année-là, Delphine publie un second recueil de poésies : Nouveaux Essais poétiques. L’éditeur est Urbain Canel, l’imprimeur J. Tastu. , Sur le titre, une lyre d’un dessin compliqué ; au cours du volume, d’autres lyres, des couronnes de laurier, des fleurons, et, en culs-de-lampe, des bois d’un gothique extrêmement romantique. Auger, le vieux classique, suit son idée, et félicite toujours l’auteur de ne pas tomber dans les déviations du bon sens et du bon goût qu’on veut faire passer pour d’admirables découvertes du génie. Le comte Daru dit dans le même esprit : « Vous êtes le soutien de l’ancienne école… Vous ne pouvez pas être d’un autre parti que celui de la vérité. » Il ajoute cette fadeur : « Il faudrait avoir votre talent pour vous exprimer tout le plaisir que m’a fait cette lec ture ». Comme toujours, le bon cœur de Marceline Desbordes-Valmore se dévoile dans la réponse qu’elle envoie de Bordeaux, le 22 mars. « Mademoiselle, j’arrive bien tard, bien reconnaissante et honteuse. Si ma chère interprète [Sophie Gay], qui me con naît si bien dans mes sentiments pour vous, n’avait été priée dès longtemps de vous remercier d’un sou venir qui m’a rendue heureuse, je serais toute empêchée pour m’excuser de ne l’avoir pas fait moi même comme j’en éprouvais le besoin. Mais, mademoiselle, le motif en est assez mélancolique pour toucher votre âme : depuis la naissance de mon dernier enfant, j’ai subi trois maladies, et je sais à peine si j’existe. Je ne prolongerai pas mes plaintes sur moi. Je suis trop pressée de vous exprimer mon plaisir en recevant votre charmant ouvrage. Si vous connaissez la teinte de mon caractère, vous ne serez pas étonnée que j’aie lu et que je relise avec une tendre préférence Madame de La Vallière, Elgise, la Veuve de Naïm, et le pur fragment de la Magdeleine. Tout cela m’enchante, parce que, en y trouvant comme partout le talent le plus élevé, mon cœur s’y attache à des vers de votre cœur, et j’en éprouve un bonheur reconnaissant comme si vous les aviez faits pour moi ; il est certain que votre gloire ne me sera jamais étrangère. Je n’en jouirai pas de bien près, mais tous mes vœux vous suivront dans cette carrière brillante où vous ne devez rencontrer que des cœurs bienveillants et bons comme le vôtre.
» Votre charmante mère m’oublie, et non pas moi. Il est vrai que la reconnaissance est de mon côté, et qu’elle donne de la mémoire. Mais j’ai ouï dire que l’on se lie par le bien que l’on a fait : jamais à ce compte Mme Gay ne se détachera entièrement de celle qui sera toujours d’elle et de vous, mademoiselle, la plus sincère amie. »
Un an plus tard, en janvier 1827, Goethe vient de lire le livre. Eckermann note, à la date du 21, que le grand homme l’a beaucoup vanté, et a ajouté : « Les Français se développent aujourd’hui, et ils méritent d’être étudiés. Je mets tous mes soins à me faire une idée nette de l’état de la littérature française contemporaine ».
Sophie Gay compte sur les Nouveaux Essais poétiques pour obtenir du roi une pension en faveur de sa fille. Un peu avant la publication du volume, la duchesse de Duras commence les démarches. Le 2 décembre 1825, elle adresse cette lettre à Honoré de Lourdoueix, chef de division des Beaux-Arts, Sciences et Lettres au Ministère de l’intérieur « Vous voulez, Monsieur, que je croie à votre bienveillance pour moi, et je vais faire appel à votre bienveillance cachée sur laquelle j’aime à compter. Vous avez à l’Intérieur un fond de pension pour les gens de lettres. Remarquez que je ne dis point les hommes de lettres, car la personne à laquelle je m’intéresse n’est point un homme, c’est une jeune fille remplie de grâces, d’esprit et de talent, [mais dont la fortune est loin d’être au niveau de toutes les qualités qui la distinguent] ; c’est Mlle Gay, auteur de cet épisode des sœurs de Sainte-Camille couronné par l’Académie, et qui s’occupe en ce moment d’un autre poème, espèce de Messiade française, où les sentiments religieux les plus touchants sont rendus avec une force et une grâce d’expression et un talent de poésie bien au dessus, à ce qu’il me semble, de celui qui s’est jamais montré dans une femme. Ne serait-il pas digne du but qu’on s’est proposé en créant ce fond pour l’encouragement des lettres, d’accorder à cette charmante jeune personne une petite pension que sa position lui rend absolument nécessaire ? [Un logement serait aussi fort acceptable, car après avoir été très à leur aise, des circonstances malheureuses ont réduit presque à rien les ressources de la mère et de la fille]. Dites-moi si j’ai tort de recommander à votre intérêt une affaire, de laquelle je souhaite si vivement le succès ? Il est un peu entre vos mains, et je l’y laisse. »
Cette lettre a été reproduite dans la brochure qu’Émile de Girardin consacra au souvenir de sa femme un an après qu’elle fut morte, sous le titre 29 juin 1855-29 juin 1856. Mais les phrases entre crochets ne s’y trouvent plus. On en devine le motif. Par contre, on y lit ce passage : « Il me semble que des paroles de bonté de la bouche du roi devraient être suivies de cette marque de munificence pour une jeune personne d’un talent unique. On ne peut craindre que cette grâce fasse planche, comme on dit : il n’y a pas deux mademoiselle Gay ». Phrase ajoutée, et provenant à coup sûr d’une autre lettre de la duchesse.
Car la négociation ne va pas toute seule. Mme de Duras doit faire intervenir le duc de Doudeauville. Enfin l’audience souhaitée est obtenue. Elle a lieu le 3 avril. Delphine eut déjà l’occasion de présenter au roi l’année précédente son poème de la Vision. Nous avons la lettre de Sophie Gay qui presse l’imprimeur, J. Tastu, de livrer au plus tôt, tout cartonné, l’exemplaire du roi, car on doit être au Château à l’heure dite. Le Moniteur ne signale pas cette audience. Par contre, dans le numéro du 4 avril 1826, on lit : « Aujourd’hui, le roi et Leurs Altesses Royales ont entendu la messe à midi à la chapelle. Avant la messe, Mlle Delphine Gay a été admise à la faveur de présenter au roi, en audience particulière, son Nouveau Recueil de poésies ».
Le Moniteur ne dit pas que le roi ait remis à Delphine un brevet de pension. Rien ne vient à l’appui de ce que Mme de Solms, d’Heilly et Léon Séché ont dit de cette audience, et des paroles que Charles X y aurait prononcées. La pension fut obtenue, on ne sait au juste à quel moment, non de mille cinq cents, mais de huit cents francs, et sur les fonds de la Liste civile.
Quant au conseil que le roi aurait donné à la jeune fille de voyager, je ne sache pas qu’il l’ait été ; à coup sûr, il n’aurait pas eu pour but de faire cesser des racontars sur le mariage morganatique projeté plus de deux ans auparavant, puisque alors Charles X était comte d’Artois. L’affaire était enterrée depuis longtemps. Non ; s’il existe un motif caché au voyage en Italie que Sophie va préparer et accomplir avec sa fille à l’automne suivant, il faut le chercher ailleurs[151].
VII
Delphine connaît toutes les satisfactions de l’amour-propre. Chacun de ses pas dans la vie marque un succès. Les rayons de la Gloire cares sent son front et l’illuminent. La nature l’a comblée de ses dons. Partout elle est adulée, choyée, fêtée. Elle semble l’image vivante du bonheur. Et pourtant elle n’est pas heureuse. Elle vient de subir cette première expérience de la vie qui blesse à tout jamais un jeune cœur, et laisse une cicatrice qui ne s’effacera plus.
En recherchant la société des jeunes gens du groupe de la Muse française, en favorisant leurs efforts, Sophie Gay ne poursuit pas uniquement un but littéraire. Il est humain qu’elle songe à y ren contrer un mari pour Delphine. Elle lui a répété que la carrière de Muse ne multiplierait pas les possibilités de mariage : la Muse n’en a rien cru. Elle prétend au contraire que « le flambeau de la Gloire n’est qu’un phare allumé pour attirer l’amour ». Sa mère ne peut que se résigner devant une vocation aussi décidée, dont par ailleurs elle a toutes raisons d’être satisfaite.
Seul reste de son ancienne splendeur, la Maison Rouge de Villiers-sur-Orge constitue un petit domaine qui ne manque pas d’allure. Le bâtiment a belle apparence, le parc enclôt un bois dans ses murs. La distance de Paris n’est pas bien grande. L’impression sur les amis qui les visitent corrige celle qu’ils éprouvent dans les deux petites pièces de l’appartement de la rue Louis-le-Grand. À Villiers, Sophie Gay fait figure de châtelaine ; elle voisine avec les Maillé, avec Grimod de La Reynière, qui habite toujours son château de Villiers. Pichald vient passer chez elle plusieurs jours de suite, et Guiraud, et Coulmann, et bien d’autres. À Guiraud, elle écrit le 30 avril 1822 : « J’espérais que ce beau temps vous donnerait un peu l’envie de campagner et que vous viendriez nous dire de ces vers que nous aimons tant à écouter entre le bois et la prairie… Donnez-nous quelques moments, ce sera la plus douce récompense de notre amitié pour vous ». Et elle ajoute : « Que faites-vous de l’ange Victor et de ce charmant poète de l’adultère ? Tous deux m’a vaient promis une visite champêtre, mais, je le vois, l’un est trop occupé dans le ciel et l’autre sur la terre pour se déranger en notre faveur ». L’ange Victor, c’est Hugo ; le charmant poète de l’adultère, c’est Vigny[152].
Vigny a sept ans de plus que Delphine. Séduisant au physique dans son uniforme de lieutenant de la garde royale, il affirme au moral sa maîtrise poé tique, autre genre de séduction. Il est « le plus aimable de tous ». Il coquette avec la jeune Muse. Elle se laisse prendre au jeu. Le Bonheur d’être belle, que son père traitait de boutade, traduit en réalité un ardent cri de joie poussé à l’idée qu’elle est aimée : « Quel bonheur d’être belle alors qu’on est aimée ! » Et plus loin :
Bientôt il va venir ! Bientôt il va me voir !
Comme, en me regardant, il sera beau ce soir !
Le voilà ! Je l’entends, c’est sa voix amoureuse !
Quel bonheur d’être belle ! Oh ! Que je suis heureuse !
Un peu plus tard, l’aveu éclate dans une autre poésie :
Volez, ange de poésie,
Déployez vos ailes de feu ;
Au guerrier qui m’avait choisie
Allez porter un doux aveu.
Allez, et secondez vous-même
L’ardeur dont il est enflammé :
Ne lui dites pas que je l’aime,
Mais faites qu’il se sente aimé !
Elle émaille ses poésies de maintes allusions semblables. Sa mère ne s’y trompe pas, non plus qu’à certaines rougeurs subites. Dans une lettre à Marce line Desbordes-Valmore, elle explique que le refus de plusieurs partis avantageux achève de l’éclairer. Elle obtient l’aveu de Delphine. Dans le tableau que fit Mme Ancelot de son salon en 1824, elle prit soin de placer Vigny exactement derrière Delphine qui se retourne légèrement de son côté, tandis que Parseval de Grandmaison débite à son habitude quelques milliers de vers. Mais Sophie Gay sait les extravagantes prétentions nobiliaires de M" de Vigny mère. Le poète lui-même n’a-t-il pas inscrit ce titre sur un manuscrit de sa plume : Notice sur Messieurs de Vigny mes aïeux depuis l’an 1096 ? Elle sait aussi le peu de fortune des deux héros de l’aventure. Le refus de M" de Vigny ne fait pas de doute. Et en effet, le jour où Vigny, épris de son côté, s’ouvre à sa mère de cette alliance qu’il souhaite, il se voit opposer un veto formel devant lequel il s’incline.
Sophie Gay a rempli son devoir de mère avec son tact et sa sûreté habituels. « Après m’être assurée que ce rêve ne pouvait se réaliser, écrit-elle à Marceline, j’ai hâté le réveil ». Mais si elle enlève l’espoir du cœur de sa fille, elle-même ne veut pas se persuader que tout soit irrémédiablement fini. Elle prie Marceline, alors à Bordeaux où se trouve aussi le poète, de prononcer « certain nom » en le regardant droit dans les yeux... Elle vient de lire Dolorida dans le fascicule d’octobre de la Muse française. « Le moyen de se distraire d’un démon qui se rappelle à vous par de tels souvenirs ! » Les jeunes gens possèdent des goûts, des talents qui s’accordent si bien : « Plus j’y songe, et plus je dis : c’est dommage ! »
Delphine garde une attitude parfaitement digne. La noblesse de son caractère ne se dément pas à l’épreuve. Elle supporte le coupavec courage. Ses vers seuls portent la trace de sa désillusion et de sa peine :
Une fois, à l’amour mon cœur osa prétendre :
D’un bien commun à tous je rêvai la douceur ;
Mais celui que j’aimais ne voulut pas m’entendre…
« Tu ne saurais m’oublier », porte le titre d’une romance dont elle écrit les paroles, et que Pau line Duchambge met en musique. On pourrait citer d’autres exemples.
Qu’advient-il de Vigny ? Le 8 août 1824, dans une lettre adressée de Paris à Édouard Delprat, il y glisse cette allusion : « J’ai trouvé ici [à Paris] beaucoup d’affaires et de devoirs, peu de plaisirs, et enfin une peine profonde dernièrement ». Le 27 août 1824, il écrit de Pau à sa cousine, la comtesse de Clérambault : « Je ne suis pas heureux, mais je n’éprouve pas de chagrin. Il est vrai que ce serait trop aussi, j’en ai un qui me suflit ». Un an plus tard, il épouse une Anglaise que sa mère sup posait fort riche et qui possédait des îles en Polynésie. Malheureusement, les îles en Polynésie n’offrent guère plus de consistance que les châteaux en Espagne. Mme de Vigny et son fils s’en aperçoivent une fois le mariage célébré.
En 1826, Vigny quitte ses garnisons provinciales, et revient à Paris avec sa femme. Le cercle des amis de Nodier ne s’explique pas son choix. Là aussi, songeant à son union manquée avec Delphine, on dit : « C’est dommage ». Lorsqu’on apprend que l’Anglaise ne lui apporta qu’un simulacre de fortune dont, à la mort de son père, il ne reste presque rien, on ne s’interdit pas quelques piquantes rail leries.
Voilà, à coup sûr, la raison déterminante du voyage en Italie. Sophie Gay veut éviter à sa fille la rencontre dans les milieux amis de Vigny marié. Le Cinq-Mars du poète vient de le porter au premier rang dans le monde des lettres. Pourquoi le chapitre intitulé « la Toilette » porte-t-il en épigraphe le vers de Delphine :
Qu’il est doux d’être belle alors qu’on est aimée ?
Avant de quitter Paris, et répondant sans doute à l’envoi du volume, Sophie Gay lui adresse ce bil let : « La mère et la Muse espèrent que M. le comte de Vigny ne les laissera point partir sans venir recevoir leurs adieux et tous les compliments qu’elles lui doivent pour le succès de Cinq-Mars qui augmente chaque jour. C’est tout comme les bons sentiments qu’inspire l’auteur[153]. »
Ce voyage en Italie a, pour la jeune Muse, l’allure d’une marche triomphale.
Les voyageuses se mettent en route à la fin du mois d’août. Elles s’arrêtent à Lyon. Delphine s’ac coude au balcon de son hôtel, « belle, imposante comme la Rachel de la Bible, couverte de cheveux blonds retombant sur toutes ses roses ». La foule émerveillée passe et repasse devant elle. Valmore assiste à la scène. Il court chercher sa femme, vite, vite, pour lui faire voir ce que, dit-il, elle ne verra jamais. L’empressement de la foule oblige Delphine à fermer ses fenêtres par une chaleur torride ; encore, les curieux la regardent-ils à travers les vitres.
Ce jour-là, elle fait la connaissance personnelle de Marceline Desbordes-Valmore, qui la juge : « Je sus bientôt par moi-même qu’elle était bonne, vraie comme sa beauté. En l’examinant avec attention, on ne tombait que sur des perfections, dont l’une suffit à rendre aimable l’être qui la possède. » Au mois d’octobre suivant se constitue à Lyon l’Académie provinciale, avec cette fière devise : « Lyon contre Paris ». Mais pour recruter les cinquante académiciens titulaires, on doit faire appel à une trentaine d’écrivains de Paris ; eux seuls donnent un lustre à l’Académie. Delphine y voisine avec Adolphe Thiers.
De Lyon, elle passe les Alpes, avec arrêt à l’hospice du Mont-Saint-Bernard. Là, l’inspiration lui dicte une ode, l’Écho des Alpes, qu’elle dédie aux religieux, et où sous l’épigraphe : « Dieu seul est grand ! » elle évoque les souvenirs d’Annibal, de Jules César et de Napoléon :
Quel fut le fruit de leur conquête ?
Le poison, le fer, et l’exil !
La gloire des bienfaits est la seule éternelle !
Sophie Gay tient du général marquis de Lagrange une lettre de recommandation pour Lamartine, secrétaire d’ambassade à Florence. Par malchance, elle ne peut la lui présenter : il est à Rome. Elle compte l’y retrouver, et continue son voyage sur Terni. Auprès de cette petite ville, on visite une cascade célèbre, celle du Velino, formée par l’ouverture d’un lac et le détournement d’une rivière ; les anciens Romains accomplirent ce travail. Le spectacle est fort beau, le site est éminemment romantique. Une amie de Sophie Gay, M" Vigée-Lebrun, fuyant la Terreur, l’admira et en parla dans ses souvenirs. Boucher de Perthes, alors simple officier de douanes, l’a décrite pour y être venu maintes fois sous l’Em pire. L’année précédente, en novembre 1825, Sten dhal s’y arrêta, et repartit « fatigué d’admiration », dit-il dans une lettre à Romain Colomb.
Les voyageuses ne se doutent pas qu’à l’auberge de Terni où elles descendent, elles dorment sous le même toit que l’illustre secrétaire d’ambassade. Arrivées le soir après lui qui rentre à Florence, elles sont le lendemain matin déjà en route pour la cascade lorsqu’il se lève. L’aubergiste lui apprend que deux dames françaises viennent de monter en voiture, et que la plus jeune est la plus célèbre improvisatrice de France. Il devine Delphine Gay. Le courrier, qu’il connait, lui confirme que tel est bien le nom de la jeune fille, et, à sa prière, saute sur son cheval pour prévenir les Françaises que Lamartine va les rejoindre.
Le poète a somptueusement décrit la scène. À l’amour près, sa rencontre avec Delphine devant la chute du Velino est aussi romantique que celle de Chateaubriand avec l’Occitanienne au bord d’un gave pyrénéen.
Il s’avance sans être aperçu. Il se donne tout le loisir de la contempler pendant qu’elle-même, appuyée à un parapet de rochers, s’enivre du merveilleux spectacle. « Elle était à demi assise sur un tronc d’arbre que les enfants des chaumières voisines avaient roulé là pour les étrangers ; son bras, admirable de forme et de blancheur, était accoudé sur le parapet. Il soutenait sa tête pensive ; sa main gauche, comme alanguie par l’excès des sensations, tenait un petit bouquet de pervenches et de fleurs des eaux nouées par un fil, et qui traînait, au bout de ses doigts distraits, dans l’herbe humide. Sa taille élevée et souple se devinait dans la nonchalance de sa pose ; ses cheveux abondants, soyeux, d’un blond sévère, ondoyaient au souffle tempétueux des eaux, comme ceux des sibylles que l’extase dénoue ; son sein gonflé d’impression soulevait fortement sa robe : ses yeux, de la même teinte que ses cheveux, se noyaient dans l’espace. Son profil légèrement aquilin était semblable à celui des femmes des Abbruzzes ; elle les rappelait aussi par l’énergie de sa structure et par la gracieuse cambrure du cou. Ce profil se dessinait en lumière sur le bleu du ciel et sur le vert des eaux ; la fierté y luttait dans un admirable équilibre avec la sensibilité ; le front était mâle, la bouche féminine ; cette bouche portait, sur des lèvres très mobiles, l’impression de la mélancolie. Les joues pâlies par l’émotion du spectacle, et un peu déprimées par la précocité de la pensée, avaient la jeunesse, mais non la plénitude du printemps c’est le caractère de cette figure qui attachait le plus le regard en attendrissant l’intérêt pour elle. Plus fraîche, elle aurait été trop éblouissante. Sa tête, et le port de sa tête, rappelaient trait pour trait en femme celle de l’Apollon du Belvédère en homme ; on voyait que sa mère, en la portant dans ses flancs, avait trop regardé les dieux de marbre. »
Elle se lève en l’entendant venir ; il salue la mère, qui le présente à sa fille. De la communion de leurs âmes devant la splendeur de la nature naît une amitié profonde. Lamartine s’est toujours défendu de tout sentiment plus tendre. « C’était de la poésie, mais point d’amour. Je l’ai aimée jus qu’au tombeau sans jamais songer qu’elle était femme ; je l’avais vue déesse à Terni. »
Elle lui fait promettre de lui envoyer des vers à Rome. Il lui fait promettre de répondre, et de venir avec sa mère passer une quinzaine à Florence, où l’inspiration la visitera sûrement. On retourne ensemble à Terni. Le soir même, on se sépare, les unes continuant leur voyage vers la ville éternelle, l’autre regagnant Florence[154].
À Rome, les dames Gay se présentent d’abord à l’ambassadeur de France. Elles le connaissent de longue date : c’est le duc de Laval-Montmorency. Sa maison est, sans contredit, la plus brillante de Rome ; lui seul donne des bals et des fêtes. Le plus grand monde y paraît. Bon gentilhomme, grand aristocrate, il en a les manières nobles et distinguées, mais avec un air distrait qui surprend. Il erre dans son salon une lorgnette à la main, et ne cache pas sa surprise en saluant des personnes qu’il invita la veille. Il aime conter, et il bégaie. Il est constamment amoureux malgré ses soixante ans. « Il questionne beaucoup, persuadé que dans sa position la nécessité de tout savoir donne le droit de tout demander ; mais il est paresseux et peu soucieux des affaires sérieuses. » Stendhal, moins mordant que la comtesse Potocka qui a tracé ce portrait peu flatté, se contente de trouver qu’il fait les honneurs de chez lui « avec une grâce vraiment parfaite, car elle n’embarrasse jamais ».
Le duc invite ses visiteuses à dîner. Il a quelque chose à leur remettre : une lettre de Lamartine ! Mais il ne s’en dessaisit qu’à une condition : Delphine lira les vers qu’elle pourrait contenir. Sophie Gay fait sauter le cachet. Delphine s’écrie :
— Il y a des vers !
Sans façon, elle s’empare du pli, et va le dévorer dans un coin. Elle entrecoupe sa lecture d’exclamations :
— C’est ravissant, divin ! Lui seul a le secret de cette poésie si brillante et si triste !
Émue, elle lit les vers à haute voix. Sa mère avait appris au poète la disparition des cascades de Tivoli sous un éboulement, à la suite d’une inondation terrible, et lui de composer aussitôt la Perte de l’Anio ; il n’en a encore écrit que la première partie, qu’il vient d’envoyer en ce début de septembre ; il n’enverra la seconde qu’au mois de janvier suivant. Mais dès le 16 septembre, Sophie Gay en accuse réception, et joint à sa réponse des vers de Delphine, fraîchement composés.
Au début d’octobre, les deux femmes défèrent à son invitation, et reviennent à Florence. Très bien vu du grand-duc de Toscane, qui lui offre un buste de Machiavel probablement sans ironie, Lamartine est, le 19 octobre, nommé chargé d’affaires après le départ de M. de La Maisonfort. La belle et blonde duchesse de Guiche remportait des succès dans la société" italienne : « Encore une victoire ! » s’écrie joyeusement Delphine, bonne Française. Pendant ce temps, le courrier pour France est chargé d’une lettre à l’adresse du marquis de La Grange ; Lamartine y a tracé ces lignes, qui sont la prose dont les pages du Cours familier sont la poésie : « Nous jouissons dans cet instant de votre amie Mlle Delphine Gay. Elle paraît une bonne personne, et ses vers sont ce que j’aime le moins d’elle. Cependant, c’est un joli talent féminin, mais le féminin est terrible en poésie. » Plus tard, il changera de gamme. Mais rapprochons cette réflexion de cette autre : « Elle riait trop » ; n’y découvre-t-on pas une corrélation avec le fâcheux jugement que le poète porta sur La Fontaine[155] ?
Le 24 octobre, la Muse et sa mère repartent pour Rome. Elles pensaient travailler : comment le pour raient-elles ? Au premier rayon de soleil, on court visiter les ruines « où on est étourdi par le babil d’une colonie d’Anglais », ou bien on assiste à d’imposantes cérémonies religieuses, ou bien on rend des visites. Le soir, dîners, raouts, concerts, bals. « La pauvre Muse ne s’est jamais trouvée moins inspirée. » Un événement ranime l’inspiration : le 23 novembre, la goélette du roi la Torche entre au port de Civita-Vecchia avec treize marins des États pontificaux que la frégate la Galathée, appuyant l’action de notre consul général à Alger, a délivrés des mains des pirates d’Alger. La qua rantaine que subit la Torche dure jusqu’au 1er décembre ; Fauré, son commandant, est à Rome le 2. Le 5, le duc de Laval présente au pape dans la basilique de Saint-Pierre le commandant Fauré, quatre officiers de son état-major, et les prisonniers romains délivrés. Le cardinal secrétaire d’État a fixé le rendez-vous dans la chapelle de Saint-Léon. Le duc de Laval s’y rend avec le secrétaire de l’ambassade, les officiers de marine et plusieurs Français et Françaises de marque : le comte Olivier de la Rochefoucauld, sous-préfet, M. Raoul-Rochette, membre de l’lnstitut, M. de Chabrol, auditeur au Conseil d’État, Mme la comtesse de Valence, la vicomtesse de Marcellus, la comtesse de Menou, Sophie Gay et Delphine Gay « qui avait pour titre un beau talent poétique qu’elle a heureusement exercé sur des sujets religieux, et qui même venait de composer des vers sur la délivrance des prisonniers ». Elle écrira encore à Rome le neuvième chant de son poème chrétien, Magdeleine. Les Français se réunissent aux prières de quarante heures auxquelles assiste le Pape, et suivent Sa Sainteté dans un appartement attenant à la chapelle Saint-Léon, où les présentations ont lieu. Delphine, à demi cachée sous un long voile, se prosterne, et reçoit, en même temps que les plus saints encouragements, la bénédiction du Saint-Père, « comme la récompense de sa pureté et comme les promesses des bontés du Ciel ; tout cela dans le plus beau temple du monde ». Au commandant Fauré et à ses officiers, le Pape remet une médaille d’or en témoignage de sa reconnaissance ; il les remercie du zèle et du succès avec lesquels ils ont rempli les ordres du roi très chrétien. Le pape ordonne alors qu’on fasse entrer les prisonniers délivrés ; il leur dit en italien :
— Mes amis, n’oubliez jamais la reconnaissance que vous devez au roi de France ; faites remercier l’amiral qui vous a renvoyés habillés comme les marins français, et les braves officiers qui vous ont conduits dans votre patrie.
Il leur remet à chacun une médaille d’argent.
Le duc de Laval envoie à son ministre la copie des vers de Delphine, Sur le retour des Romains cap tifs à Alger délivrés par le roi de France. Elle les récite le 11 décembre, au grand dîner que donne l’ambassadeur en l’honneur de l’équipage de la Torche.
Le monde lui fournit d’autres motifs de poèmes. Spectacle nouveau pour elle qu’un ricevimento : les femmes portent des robes extrêmement décolletées, « et il faudrait être bien difficile pour n’être pas reconnaissant envers leur couturier », dit Stendhal. « Peignez-vous le mélange de quarante femmes vêtues de cette manière, et de quatorze cardinaux, plus une nuée de prélats, d’abbés, etc. La mine des abbés français est vraiment à mourir de rire ; ils ne savent que faire de leurs yeux, au milieu de tant de charmes ; j’en ai vu se détourner pour ne pas les voir ; les abbés romains les regardent fixement avec une intrépidité tout à fait louable. Parmi les petits plaisirs que peut donner la haute société, un des plus grands est de voir un cardinal, en grand costume rouge, donner la main, pour la présenter dans un salon, à une jeune femme aux yeux vifs, brillants, étourdis, voluptueuse et vêtue comme je l’ai dit. On passe trois heures ensemble à se regarder, à circuler, à prendre d’excellentes glaces, et l’on se sépare pour se retrouver le lendemain. »
À une réunion de ce genre, le 21 novembre 1826, chez le fameux prince-banquier Torlonia, qui reçoit une fois par semaine tous les étrangers de distinction dans son superbe palais, Delphine voit la fille de la comtesse Anna Potocka faire son entrée dans le monde ; la beauté de la future princesse San guszko produit sur elle une si vive sensation qu’elle lui inspire sa charmante poésie de Nathalie : « Elle m’est apparue au milieu d’une fête… » D’ailleurs, la beauté de Delphine elle-même n’est pas moins appréciée. « Hier, dit la comtesse Potocka, Mlle Gay apparut jeune et belle comme Corinne. Rarement une femme reçut en partage un si beau talent et sut, comme elle, voiler son génie avec tant de simplicité, de candeur et de modestie. Je voudrais l’entendre au Capitole et l’y voir couronnée. » Et Catherine de Wurtemberg : « Elle réunit la jeunesse et la beauté au talent, et lorsqu’elle récite ses vers, elle prend vraiment la forme d’une Muse ».
Elle fréquente chez la duchesse de Saint-Leu, qui passe une partie de l’hiver à Rome dans la villa Paolina, avec le prince Louis et son précepteur Philippe Le Bas. Le prince a dix-huit ans. Delphine l’entend répéter souvent que toute son ambition serait de porter l’uniforme français. Le soir où l’on apprend la mort de Talma, chacun déplore cette perte et rappelle le rôle où il a vu Talma pour la dernière fois. Le prince frappe du pied avec impatience, et s’écrie, les larmes aux yeux :
— Quand je pense que je suis Français, et que je n’ai jamais vu jouer Talma !
En février, le prince Louis était à Florence, et, par l’intermédiaire d’une dame que Lamartine connaissait, cherchait à rencontrer chez elle notre chargé d’affaires. Lamartine se retrancha sur son caractère diplomatique pour ne pas se rendre à l’invitation. Il définit le prince Louis à son ministre comme « un jeune homme de belle tournure, d’esprit distingué, d’une éducation parfaite ». le prince n’a plus aucune prétention à la grandeur. « D’ailleurs cette famille est pour la France un objet de curiosité plutôt que d’inquiétude », dit le poète.
Grand ricevimento chez l’ambassadeur du roi des Pays-Bas auprès du Saint-Siège : Delphine se rappellera toujours l’apparition de la princesse Doria, « grande et brune romaine aux traits réguliers, aux regards imposants, digne de Rome antique par la noblesse de sa démarche et la fierté de son caractère, digne de Rome sainte par sa bonté charitable et l’ardeur de sa piété ». La princesse est couverte de diamants, dont le plus beau, le Doria, est un diamant historique « gros comme un petit pavé de juillet ». À Paris, Delphine le reconnaîtra un soir, sur la fille de la princesse.
Vers la fin de janvier, nos voyageuses poussent jusqu’à Naples, où Delphine écrit son poème : le Dernier Jour de Pompéi, dont onze pages de notes attestent la sérieuse documentation.
On l’a trop souvent comparée à Corinne, et sa mère tient M" de Staël en trop haute admiration, pour que l’on s’étonne de leur voir accomplir le pèlerinage au cap Misène. Elles sont de retour à Rome pour les fêtes du carnaval. Cette année-là, le grand carnaval masqué commence le 17 février, « par un mauvais temps, au grand déplaisir du peuple romain dont la grande affaire n’est pas la politique ». Le 2 mars, Antony Deschamps écrit à Alfred de Vigny : « Nous sortons des fêtes du car naval, des confetti, des moccoletti. Mme Gay et Delphine sont toujours ici : elles vont partout, comme à Paris, passent les nuits au bal, et ne connaissent pas Rome. J’ai entendu des vers de Delphine sur la Mer Morte qui sont très beaux. » Et c’est pour l’avoir rencontrée à Rome à cette époque qu’Antony Deschamps lui dédie son poème du Vendredi saint.
Elle assiste aux cérémonies de la semaine sainte. Le jeudi, dans une des salles du Vatican, elle revoit la princesse Doria, non plus en robe de velours et en diamants, mais en robe de laine et en tablier de toile, lavant, dans un baquet véritable, les pieds des pèlerines : acte d’humilité fort recherché, car il faut être grande dame pour avoir le droit de l’accomplir, et Delphine, non sans malice, remarque les deux filles du comte de Celles, ambassadeur des Pays-Bas, toutes joyeuses et toutes fières d’avoir obtenu cet honneur.
Entre temps, Sophie Gay ne perd pas le contact avec Paris. Par le canal de Rességuier, elle apprend à Alfred de Vigny que son Cinq-Mars a autant de succès à Rome qu’à Paris. Elle espère bien que dans le petit groupe formé par Jules de Rességuier, Alfred de Vigny, Alexandre Soumet, Alexandre Guiraud, Émile Deschamps, Pauline Duchambge dont les romances font fureur chez la duchesse de Saint-Leu, on ne les oublie pas, et que l’on parle d’elles de temps en temps. Elle demande à Rességuier un service précis : elle lui expédie deux des récentes poésies de Delphine, et le prie de les examiner et de les envoyer au concours des Jeux floraux, s’il les en croit dignes. Elle a soin de lui faire observer qu’après avoir trouvé tant d’encouragements à l’Académie française, Delphine ne voudrait pas d’un échec à l’Académie de Toulouse, et elle charge le « cher troubadour » de la petite intrigue, « car où n’en faut-il pas » ?
En attendant, l’Académie du Tibre lui ouvre ses rangs ; le 16 avril 1827, comme le désirait la comtesse Potocka, Delphine monte au Capitole. Elle est reçue membre de cette compagnie romaine[156].
Elle quitte la Ville éternelle sur ce triomphe. De là, elle visite Ferrare et la prison du Tasse, où sur le mur elle lit gravés le nom de lord Byron, Byron qui lui avait écrit : « J’ai lu vos vers », et, plus fraîchement, celui de Casimir Delavigne. Le 2 mai, sa mère et elle s’établissent à la campagne auprès de Florence ; elles y restent un mois entier, près de Lamartine. Il a souvent l’occasion de les rencontrer, et écrit à un ami : « La jeune Muse est très simple et très bonne ». La duchesse de Saint-Leu, que son entourage appelle toujours la reine Hortense, passe ce même mois de mai à Florence avec son fils Louis et sa suite ; en juin, elle retourne à Arenenberg, où les dames Gay sont invitées à la suivre, tandis que Lamartine va rejoindre à Livourne la cour du grand duc, qui y passe l’été.
Dans un beau site, accidenté, pittoresque, planté de sapins, le château d’Arenenberg domine le lac. La duchesse de Saint-Leu l’habite huit mois de l’année. Elle tient toujours un riche état de maison, avec deux dames d’honneur, un écuyer, le précepteur du prince Louis, et un nombreux domestique. Dans un salon, le portrait en pied de l’impératrice José- phine ; dans un autre, sa statue ; et des tableaux, des bustes, dont celui de Byron.
La duchesse reçoit « avec cette grâce héréditaire qui avait acquis à sa mère tant de cœurs ennemis, avec cette politesse affectueuse qui fait pardonner la toute-puissance ». Elle s’exprime sur les événements et les personnes qui ont décidé ou profité de sa chute, avec tant de modération, de justice et d’impartialité, qu’on oublie comme elle la part qu’elle eut dans ces révolutions. Un seul signe trahit sa peine : les larmes qui embuent son regard lorsqu’on parle de la France. « Visitée par les talents les plus distingués de l’Europe, elle offre l’exemple d’une disgrâce honorée, et d’un malheur sans rancune. »
À Arenenberg, la vie s’écoule doucement. L’après midi, on se promène autour du lac de Constance, On va visiter le tombeau de Charles le Gros, ou bien on se livre au charme de la conversation ; la reine, élève d’Isabey, montre des portraits, des miniatures qu’elle a peints. Lorsqu’il survient pour le dîner des hôtes inattendus, la reine s’écrie :
— Tous mes plans sont dérangés. Je comptais parler philosophie, voilà maintenant qu’il va falloir parler littérature et voyage…
Et comme Delphine ne comprend pas, la reine a la bonté de lui expliquer en riant cette énigme : Mme Campan, dont Hortense de Beauharnais fut l’élève, prétendait qu’il fallait régler la conversation d’un diner sur le nombre des convives. Si l’on est douze à table, il faut parler voyages, littérature ; si l’on est huit, il faut parler beaux-arts, sciences, inventions nouvelles ; si l’on est six, on peut parler politique et philosophie ; si l’on est quatre, on ose parler de choses sentimentales, de rêves de cœur, d’aventures romanesques.
— Et si l’on est deux ?
— Chacun parle de soi ; le tête à tête appartient à l’égoïsme.
Ainsi la phrase mystérieuse voulait dire tout simplement : nous serons dix à table. Le soir, à huit heures, on prend le thé. Des environs, même de Munich, des visiteurs viennent se joindre aux invités qui séjournent au château. Bocher avec son père et sa mère, son frère et sa sœur, y demeure quelque temps en cet été de 1827, en même temps que Sophie et Delphine Gay. Les autres convives sont Mme Récamier, le prince Czartorisky, le prince de la Moskowa, le comte de Boubers, le colonel Bracke. Le soir, on se livre aux jeux innocents, on joue des charades. Delphine récite des vers. La reine prend sa harpe, dont elle joue à ravir, et s’accompagne. Elle chante d’une voix faible et brisée, mais d’une douceur tellement pénétrante qu’elle produit une profonde impression,… elle chante : « Partant pour la Syrie, — Ni jamais, Ni toujours », et autres romances élégiaques et naïves. On achève la soirée en dansant des valses et des mazurkas.
Quelle que soit l’innocence de ces jeux et de ces passe-temps, la police de la Restauration ne les perd pas de l’œil. Et cet œil terrible s’arrête encore une fois sur Sophie Gay. Dans son rapport du 9 septembre 1827, le préfet du Haut-Rhin glisse cette phrase : « Parmi les noms des personnes qui me sont signalées comme ayant fait quelque séjour à Constance, figure Mme Gay, qui est depuis longtemps chez Mme de Saint-Leu ». Il est probable que Mme Gay n’en serait pas autrement troublée, même si elle le savait. Delphine en tout cas, n’a pas caché son libéralisme, et ne dissimule pas davantage ses sentiments à l’égard de la reine IIortense. L’année suivante, elle compose pour la reine une romance, la Pèlerine, qu’Amédée de Beauplan met en musique. En voici le texte, qui ne figure pas aux Œuvres complètes. Il est daté de Wolfsberg, 1828, seule trace d’un voyage que la Muse et sa mère auraient accompli cette année-là dans ces parages si cette date est exacte :
Soldats gardiens du sol français,
Vous qui veillez sur la colline,
De vos remparts livrez l’accès,
Laissez passer la pèlerine.
Les accents de sa douce voix,
Que nos échos ont retenue,
Et ce luth qui chanta Dunois
Vous annonceront sa venue.
Soldats gardiens…
Sans peine on la reconnaîtra
À sa pieuse rêverie,
Aux larmes qu’elle répandra
Aux noms de France et de patrie.
Soldats gardiens…
Son front couvert d’un voile blanc
N’a rien gardé de la couronne ;
On ne devine son haut rang
Qu’aux nobles présents qu’elle donne.
Soldats gardiens…

Elle ne vient pas sur ces bords
Réclamer un riche partage :
Des souvenirs sont ses trésors,
Et la gloire est son héritage.
Soldats gardiens…
Elle voudrait de quelques fleurs
Parer la tombe maternelle,
Car elle est jalouse des pleurs
Que d’autres y versent pour elle.
Soldats gardiens…
Par une curieuse coïncidence, cette romance sera d’une parfaite actualité en 1831, quand la reine Hortense traversera la France.
Après un long séjour à Arenenberg, vers la fin de l’automne 1827, Delphine et sa mère reviennent en France. Les voici à Villiers-sur-Orge. La jeune fille s’y remémore les impressions de son beau voyage. Elle les fixe en un poème, le Retour, qu’elle dédie à sa sœur la comtesse O’Donnell. En ces vers la Muse de la patrie s’exalte. Elle montre les souvenirs de France ne cessant de la hanter pendant son absence ; tout est motif à les lui rappeler ; elle a vu passer en Italie l’ombre de Bayard, de Gaston de Foix, du connétable de Montmorency (sans doute pour être agréable au duc de Laval), et enfin de Bonaparte. Elle relève le fait que des archéologues français font jaillir du sol romain l’évocation du grandiose passé de la Rome antique. Elle cite Casimir Delavigne venu en Italie l’année qui précéda son propre voyage, et Lamartine et ses chants, et le baron Gérard et ses tableaux, et elle triomphe de la victoire remportée à Florence par la beauté de la duchesse de Guiche. Enfin elle nous apprend qu’on voulut la marier à un grand seigneur italien : elle refusa de payer de l’exil un sort brillant, d’autant plus que :
Un cœur qu’a fait battre la gloire
Reste sourd à la vanité.
Et elle trouve cette amusante image : si tendrement que soit dit : « Je vous aime », un accent étranger gâterait tout. Non : son bonheur est en France ; il lui faut pour chanter le ciel de la patrie. Si par infortune elle mourait à l’étranger, elle désire être ramenée dans l’humble vallon de l’Orge, et avoir un tombeau sous les peupliers de la sombre allée, près de la Maison Rouge. On saisit ici une fois de plus la profonde empreinte laissée sur son esprit par ce paysage de l’Ile-de-France où l’inspiration la visita pour la première fois. Et sous une forme plus grandiloquente, elle rencontre l’idée que Joachim Du Bellay traduisit en vers immortels, à son retour d’Italie[157].
VIII
Delphine et sa mère reprennent le cours de leur existence mondaine et littéraire. La première publie en 1828 un nouveau recueil de vers : le Dernier Jour de Pompéi, suivi de poésies diverses, son poème du Retour, et la romance de la Pèlerine ; la seconde, un roman en quatre volumes, Théobald, épisode de la guerre de Russie. Elles fréquentent toujours leurs amis artistes, Gérard, Horace Vernet, Victor Schnetz. David d’Angers commence la série de ses médaillons ; il y réserve une large place aux gens de lettres et aux artistes ; il exécute en 1828 celui de Delphine, dont il a déjà sculpté la figure sur la tombe du général Foy, et le lui envoie : « J’ai l’honneur de vous offrir le croquis en bronze que j’ai fait d’après vous ; c’est un bien faible à peu près de vos traits, mais j’espère que celui que je ferai pour le bas relief de Sainte-Geneviève réussira mieux ». Elle reçoit le médaillon à Villiers : « Je reçois avec bien l’orgueil, Monsieur, ce bronze flatteur qui se charge de m’envoyer tout droit à la postérité ; je voudrais que mes vers eussent la même puissance, j’essayerais de vous répondre, mais votre beau talent n’a besoin que de lui, pour éterniser sa gloire ».
À la vérité, quelque dureté marque les traits : Jouin, le biographe de David d’Angers, remarque que pour coiffer une tête de femme, le sculpteur n’a point de rival. « Comparez les cheveux de Delphine Gay, ceux de Mme Desbordes-Valmore et ceux de Mme Voïart, vous serez étonné que l’artiste ait pu faire leur arrangement assez dissemblable pour éveiller en vous des pensées d’un ordre opposé. À l’heureuse fierté de la première, la mélancolie de la seconde sert de contraste, tandis que la Muse retirée, mais sans grande passion, de Mme Voïart, se laisse deviner à la grâce correcte de sa coiffure. » Jugement confirmé par Goethe ; le dieu de Weimar reçoit de David le 7 mars 1830 une caisse de cinquante-sept médaillons ; tout joyeux de contempler tant de personnages intéressants, il répète à plu sieurs reprises qu’il ne saurait assez remercier l’auteur de ce trésor. « Une chose qui me paraît digne de remarque, écrit-il le lendemain à David, c’est votre rare talent à saisir l’individualité de chaque figure. Combien le type vrai et simple de Mlle Delphine Gay diffère du portrait de Mme Lescot, aux ajustements d’un goût si recherché ! Croirait-on que ces deux œuvres sont sorties d’une même main ? » Lorsque David termine le buste de Chateaubriand, les dames Gay, parmi les premières, lui demandent la faveur de contempler cette œuvre dans son atelier[158].
La duchesse de Duras est morte, et son salon fermé. Parmi ceux où Delphine dit ses vers à cette époque, le comte d’Haussonville signale celui de la comtesse de Chastenay, « une sorte de bureau d’esprit en plein faubourg Saint-Germain ». On y joue des pièces de Brifaut. On y rencontre le comte Alexis de Saint-Priest. Le 29 mars 1829, grande soirée : la Muse doit réciter le septième chant de son poème de Magdeleine, intitulé « la Tentation ».
Cette attraction n’est pas la seule. On a beaucoup parlé depuis quelque temps dans la société pari sienne d’un mariage projeté entre Delphine Gay et Armand-Charles-Louis de Lagrange, général de division et comte de l’Empire, qu’il ne faut pas confondre avec son frère aîné, le marquis de Lagrange. Elle a vingt-cinq ans, il en a quarante-six. Les cheveux du général, déjà blancs, n’altèrent pas la jeunesse de sa physionomie. Il est riche et de bonne compagnie, de taille grande et de figure martiale, « façon des militaires du premier Empire ».
Or, on croit savoir que le mariage ne tient plus. Jacquot, dit Mirecourt, poursuivi plus tard par Émile de Girardin devant les tribunaux et condamné pour diffamation, explique que les allures trop « directoriales » de Sophie Gay en sont la cause. À une soirée chez Gérard où se trouvait le comte, elle serait entrée « avec toutes sortes de chassés-croisés et de pas de gavotte », en chantant :
J’entre en train
Quand il entre en train,
J’entre en train quand il entre !
Le témoignage de Mirecourt est peu probant. Mais à une de ses amies qui l’interrogeait sur ce mariage, Sophie Gay répondit avec un accent extrêmement sentimental :
— Ah ! Pourquoi réveillez-vous les cruelles douleurs d’une mère ! Oui, il n’est que trop vrai, M. de Lagrange a trouvé le moyen d’arriver au cœur de ma fille par son imagination.
Puis, reprenant son ton habituel :
— Et il s’est conduit avec elle comme un cochon !
Le comte de Lagrange épousa, « au lieu de Del phine, dit Mme de Boigne, une personne rencontrée
chez Mme de Montcalm ». Vingt ans plus tard, Delphine dédicace au comte un exemplaire de sa Cléopâtre : elle a inscrit le nom, et elle a signé. On la voit solliciter pour lui une invitation au théâtre Castellane. Il lui survivra, et mourra en 1864, à quatre-vingt-un ans.
Voilà donc pourquoi, à la soirée de Mme de Chastenay, les initiés, et c’est à peu près tout le monde, se montrent aussi curieux de deviner comment Delphine supporte ce récent déboire matrimonial, que d’entendre ses vers. Elle déçoit la malignité par sa simplicité, son naturel. « Il ne parut pas qu’elle en fût autrement affectée, dit le comte d’Haussonville. Elle était simplement mise comme à son ordinaire, vêtue d’une robe blanche un peu arrangée à l’antique et dépourvue de tout ornement, non moins que sa coiffure dont l’agrément consistait surtout dans la teinte blonde des cheveux qui tombaient sur ses épaules en boucles abondantes et soyeuses. Il y avait dans tout cela une apparence de mise en scène, comme d’une statue qui s’offrirait d’elle même à l’admiration des amateurs. En guise de piédestal, la statue s’assit sur une chaise isolée au milieu de la pièce, de façon à pouvoir être contemplée sous toutes ses faces. La pose était conforme aux préceptes de l’acteur Lafon, qui disait : « Regardez comme je m’y prends, car cela est essentiel au théâtre. Quand mon corps est par ici, ma tête est par là ; il n’y a que cela pour faire valoir les formes. » Fidèle à cette esthétique, obliquement posée sur son siège, ses beaux bras blancs ramenés de droite à gauche et les doigts de ses mains négligemment croisés sur ses genoux, la tête rejetée en arrière, les yeux au ciel, c’est-à-dire vers les corniches, Delphine Gay entama sa récitation. Sa voix était intentionnellement grave, langoureuse et comme sortant des profondeurs de son être. Elle faisait un peu contraste avec le sujet du chant qu’elle avait choisi, et qu’elle prit la peine de nous expliquer. Il était singulier, et fit d’abord dresser les oreilles. C’était le Diable prenant, pour tenter la Magdeleine, la figure de saint Joseph. Au bout de quelques vers, nous étions tous à nous regarder les uns les autres. À mesure qu’elle avançait dans sa déclamation, les mères présentes donnaient des signes visibles d’inquiétude ; quelques-unes avaient l’air de se demander si elles n’allaient pas emmener leurs filles. Mme Gay s’aperçut de l’effet, et, de cette voix retentissante dont j’ai parlé tout à l’heure, on l’entendit s’écrier au milieu du silence général :
« Ma fille est vraiment étonnante ; elle a tout deviné ». J’entendis presque aussitôt la comtesse de Noailles murmurer tout bas près de moi à sa voisine la comtesse de Laborde : « Ah ! vraiment ! pas si étonnante ! elle n’eut qu’à regarder autour d’elle ».
Récit piquant, qui ne pèche pas par la bienveillance. Le comte Apponyi assiste à cette même soirée. Il la voit sous un angle différent. Il constate d’abord, ce qu’une lettre précédemment citée de la duchesse de Duras dément, que les Français ignorent la Messiade de Klopstock, imitée, dit-il, par la poétesse dans sa description de l’enfer, puis admire dans le poème « des vers délicieux et de bien beaux tableaux ». À relire aujourd’hui ce chant de Magdeleine, on se convainc, en effet, que les vers sont solidement frappés, harmonieux, et souvent animés d’un beau souffle. Et l’on se demande avec angoisse quels passages ont si fort effarouché les mères et menacé la pudeur des vierges[159] !
Quelques mois plus tard, le 27 juin, Delphine Gay va jouer un rôle inattendu dans une solennité littéraire autrement imposante.
Chateaubriand, tenté par la Muse tragique, a écrit une tragédie en vers, Moïse, sans réussir à la faire jouer. Mme Récamier sait quel regret il en éprouve. Elle lui ménage une revanche. Elle convoque une soixantaine de personnes, une élite, devant qui l’acteur Lafon lira la pièce.
Huit heures du soir. Les rameaux de la Fête-Dieu jonchent encore les cours et les escaliers du couvent de l’Abbaye-aux-Bois. Le dais d’un reposoir, velours rouge et étoiles d’or, demeure debout. Arrivent d’amples et élégantes robes d’organdi, de nobles pairs en habit bourgeois, de jeunes doctrinaires empesés, des muscadins de l’an III restés étourdis. Ce sont Mmes Apponyi et de Fontanes, Sophie et Delphine Gay, les ducs de Doudeauville et de Broglie, MM. de Sainte-Aulaire et de Barante, Ballanche, Cousin, Villemain, Lebrun, Gérard, Lamartine, H. de Latouche, Saint-Marc-Girardin, Valery, Mérimée, David d’Angers, Gudin, le baron Pasquier, de Rémusat, Dubois directeur du Globe, de Girardin, Ampère, Jussieu, Dugas-Montbel, Taylor, Méchin, Mmes de Boigne, de Gramont, Mme et Mlle de Barante, Mlle de Sainte-Aulaire, etc. « Les intérêts de la cour, les arts, la liberté, la littérature sont représentés par ambassadeurs. »
Nous connaissons déjà le cadre : ce soir, Madame de Staël et la Corinne de Gérard semblent « plus belles au magique éclat des flambeaux » ; deux lauriers à fleurs roses ornent la cheminée de marbre blanc, et un buste qui veut être la Béatrice du Dante, mais que Canova a copié « ici sur nature, dans l’impuissance d’inventer des traits plus par faits ». Le guéridon est prêt, avec la lampe voilée, et le manuscrit fermé qui attend.
Voici le dieu : Chateaubriand se glisse modeste ment parmi les rangs serrés de ses admirateurs. L’acteur Lafon, de la Comédie-Française, prend place au guéridon, et commence la lecture du pre mier acte, entrecoupée d’exclamations admiratives du public, et parfois d’hésitations singulières du lecteur, que l’on s’explique mal. Lorsque Lafon attaque le deuxième acte, il devient évident qu’il n’a pas pris la peine d’étudier son manuscrit. Il hésite, balbutie, s’interrompt… Au chœur des filles Amalécites, l’auditoire supplie l’auteur de lui prendre le manuscrit des mains, et de le lire lui même. Chateaubriand se résigne. Mais voici qu’à son tour il hésite, balbutie, et dénonce une lacune dans son manuscrit. « Alors la voix émue d’une personne qui eût été digne de faire les vers oubliés, et dont la mémoire les avait à moitié retenus sur une première lecture, Mme Gay, pourquoi hésiter à la nommer ? les a soufflés avec un zèle mêlé de quelque trouble et de quelque incertitude. Il faudrait avoir vu tout ce que cette émotion d’un autre poète avait de touchant, et deviner tout ce que le sourire de l’auteur de Moïse exprimait de reconnais sance, pour se faire une idée de cette scène. »
Chateaubriand lit maintenant le troisième acte. Il scande les strophes d’un chœur : mouvements de gaieté dans l’auditoire, sourires des dames dissimulés derrière les éventails… Par amour de la couleur, l’auteur n’a pas suffisamment gazé certains passages trop bibliques. Comme l’écrit Ballanche à Mme Lenormant : « Madame votre tante était sur les épines ». Il y avait de quoi ! Heureusement, le quatrième acte s’achève sans autre incident, et dans un élan unanime d’admiration. Toutefois, des restrictions se font jour. On conseille à l’auteur de ne pas risquer l’aventure de la scène. « Le poète n’a pas touché le but, car il l’a dépassé », dit H. de Latouche. Mais l’à-propos et la mémoire de Delphine ont sauvé une situation difficile, et donné une preuve tangible et flatteuse de son culte pour René[160].
Sophie Gay, à partir de cette époque et pendant les vingt ans qui vont venir, publie dix-sept ouvrages formant trente-six volumes, fait jouer deux pièces de théâtre, dirige un théâtre d’amateurs, fonde une revue, les Causeries du monde, et collabore à maints journaux et revues ; une vraie carrière d’homme de lettres. Delphine marche délibérément, et plus glorieusement, sur ses traces.
Une évolution se dessine dans leurs relations parmi les gens de lettres et les artistes. Peu à peu, les anciens amis de sa mère vieillissent, quelques-uns disparaissent. Ils vieillissent surtout au point de vue littéraire. Delphine se rapproche de la jeune génération, et déjà manifeste sa tendance à n’admettre dans son intimité que les plus grands, ceux dont les noms domineront le siècle. Son talent même évolue. On ne s’en aperçoit pas encore dans les œuvres qu’elle publie, mais son originalité propre, la vraie forme de son tempérament d’écrivain, percent dans sa correspondance.
Le comte Alexis de Saint-Priest, rencontré chez Mme de Chastenay, a écrit une comédie qu’il ne parvient pas à faire jouer ; la censure se jette à la traverse. Il communique son manuscrit à Delphine, qui le lui rend avec cette lettre (1" septembre 1829) : « À force de changer de ministre, peut-être en trouverez-vous un qui permette de jouer votre pièce. En attendant, je vous engage à en composer une autre, à la mode, avec beaucoup de rime et fort peu de raison ; cherchez quelque imagination dans le genre du nouveau drame de M. Dumas : c’est une femme qui, pour l’empêcher d’être jaloux du roi, avec lequel elle se promène en bateau, enferme son mari dans un cachot dont elle seule garde toujours la clef ; le roi, plein de finesse, lui fait entendre que si elle cessait tout à coup de porter à manger à son mari, elle pourrait devenir veuve, et que lui, roi, pourrait l’épouser. Alors, tirant de son sac la clef du cachot conjugal, elle la laisse tomber tendrement dans le lac, en s’écriant : « Je suis reine ! » Ce mot touchant est le dernier de la pièce, que l’on a refusée, sans doute parce qu’elle a paru trop fade ; mais l’auteur d’Henri III, qui ne se décourage pas facilement, a porté ce chef-d’œuvre à l’Odéon, où il compte bien nous le voir applaudir cet hiver. » Il s’agit d’Edith aux longs cheveux. Tout le vicomte de Launay est déjà dans cette page de critique fine, pénétrante, spirituelle et ironique. Delphine connaît Alexandre Dumas depuis l’enterrement du général Foy, où, à côté d’elle, il a dit une élégie de sa façon. L’élégie n’eut pas le succès des stances de la Muse, mais ce n’est pas dans cette direction que le grand jeune homme mince et crépu du portrait de Devéria doit trouver sa voie. En attendant, il se prend pour Delphine d’une amitié sentimentale qui lui inspirera un jour une bien jolie lettre.
Elle a fait aussi la connaissance de Balzac, à peu près sûrement par Latouche. Auparavant, elle l’a sans doute rencontré chez Gérard. Balzac, en mars 1828, s’est réfugié chez Latouche rue de Tournon, Latouche auquel il doit de l’argent et qui l’engage à venir, même s’il ne peut le rembourser, pour cette raison : « J’aime encore mieux vos rires que tout ». Et encore : « Venez, avec ou sans chef d’œuvre ; je n’ai pas ri depuis votre départ ». Et ce découvreur de talents fait les frais du Dernier Chouan que Balzac vient d’écrire. Sophie Gay, habile à discerner les talents naissants, ouvre au débutant son salon ; il s’y lie avec la duchesse d’Abrantès et le grincheux Philarète Chasles. Ce gros garçon exubérant et gai, brillant causeur tôt mis en verve par le bruit et les lumières, assez mal tenu de sa personne, toujours prêt à faire éclater des vêtements trop étroits pour son corps trop puissant, et dont les gros souliers laissent à chaque pas qu’il fait une empreinte dans les tapis, devait s’entendre à merveille avec Sophie Gay, comme lui exubérante et gaie, avec Delphine, avec Mme O’Donnell, un trio de femmes spirituelles, rieuses, et ne craignant pas les histoires salées qu’il conte volontiers. Bien vite, il se plaît à venir le soir, au coin du feu, leur lire dans l’intimité quelque conte nouvellement éclos. À peine invite-t-on un ou deux amis, tels le comte et la comtesse Jules de Rességuier, avec qui Sophie Gay s’est étroitement liée. Au coin du feu, sans faste, avec de vieux amis, les succès de l’esprit étaient les seuls permis, a dit Delphine dans son poème de Napoline. Et puis, Balzac a découvert un avantage à fréquenter l’ancienne merveilleuse : par elle, il se documente. Elle le fournit d’anecdotes. Il la vide de tous les renseignements qu’il en peut tirer sur le Directoire, comme il fera de la duchesse d’Abrantès pour la période de l’Empire, et de la duchesse de Castries pour la première Restauration. Et ce milieu-là n’est pas étranger à l’élaboration de la Physiologie du mariage.
Ce coin du feu où Sophie convie Balzac à lire ses contes et Rességuier ses poésies, Belmontet y lit l’Enfant du château, et Frédéric Soulié des vers ; ce dernier est assez difficile à atteindre : « Je l’ai fait chercher de porte en porte dans ma rue où il prétend demeurer, on n’a pu le trouver ». Il est vrai que Sophie Gay persiste à l’orthographier : Soulier.
Delphine envisage la possibilité d’aborder le théâtre, comme fit sa mère, avec le concours d’un musicien. Elle adresse à Auber cette discrète invite : « Ô Déjanire ! La tienne était de glace en comparaison de celle que je reçois ! Que ne puis-je couvrir tous ces papiers de vers dignes des chants du bienfaiteur ! Mais ce bienfaiteur adorable ne viendra-t-il pas bientôt chercher la prose de mes remerciements ? » En post-scriptum : « Je vous écris toutes ces bêtises pour vous prouver que je suis en état de faire un opéra ». Elle n’en fit pas, et fit mieux. Et les hommages des poètes continuent à monter jusqu’à elle. Tandis que sa mère a renoué avec Rességuier la conversation commencée d’Italie au sujet des Jeux floraux et qui n’aboutit pas, l’aimable poète insère dans le recueil de ses Tableaux poétiques, paru en 1828, cet hymne d’actions de grâce et d’adoration d’une frappe sonore et pure. L’épigraphe est tirée des vers de Belmontet que nous connaissons déjà, et l’éloge rebondit d’un poète à l’autre.
Homère en la voyant, Homère aurait chanté ;
Raphaël à la toile eût appris sa beauté.
Maintenant nos pinceaux, nos vers sont inhabiles.
Ils ne sauraient fixer des traits aussi mobiles,
Et l’on peindrait plutôt les doux rayons des cieux
Que les rayons plus doux qui tombent de ses yeux.
Le vague enchantement du bruit lointain des lyres,
L’ivresse des parfums, le charme des sourires,
Le premier sentiment qu’un mot nous révéla,
C’est Delphine… Chactas l’eût nommée Atala.
Son âme est un secret d’amour et d’harmonie ;
Son esprit vif et prompt a l’élan du génie ;
Elle comprend la gloire, elle aime son danger ;
La gloire est un péril qu’elle peut partager.
Avec ravissement elle a vu la tempête,
Les vents impétueux ont sifflé sur sa tête,
Et, de braver l’orage éprouvant le besoin,
Elle a dit au pilote : il faut aller plus loin !
Et dès que le Zéphir la ramène au village,
On la voit se courber sur la roche sauvage,
Et jeter, en riant, dans les flots azurés,
Des coquilles de nacre et des cailloux dorés.
De la terre et du ciel c’est un divin mélange ;
Tantôt comme la femme et tantôt comme l’ange,
Elle peut soutenir le vif éclat des cieux,
Et nos faibles regards lui font baisser les yeux.
Voyageuse ici-bas, céleste passagère,
Elle n’a de nos maux qu’une atteinte légère ;
Comme une douce pluie aux beaux jours du printemps,
Les pleurs dans ses beaux yeux ne restent pas longtemps !
Elle chante ! et l’écho des pieuses enceintes
Ajoute un nom de plus au nom des Muses saintes ;
Et rêvant de triomphe et d’immortalité,
On nomme avec orgueil cette jeune beauté,
Qui, sur sa lyre d’or ou sa harpe d’ébène,
Fait sourire l’amour ou pleurer Madeleine.
À son tour, Édouard d’Anglemont, que nous avons vu au frontispice d’un de ses livres tenant d’une main sa lyre et de l’autre sa tasse de chocolat, dédie à Delphine le Mont Saint-Michel, une des légendes de son recueil paru en 1829, et qu’il fait d’abord insérer dans le Voleur. Peu s’en faut qu’elle n’obtienne alors une dédicace de l’un des hommes les plus populaires, de l’homme du jour à la fin de la Restauration : Béranger. Lorsque, condamné à neuf mois de prison et dix mille francs d’amende le 10 décembre 1828 pour ses chansons l’Ange gardien, la Gérontocratie et le Sacre de Charles le Simple, il subit sa peine à la Force, c’est à qui s’inscrira chez le préfet de Police pour aller le voir dans sa prison. Delphine charge Froidefont de Bellisle de porter un de ses recueils de vers à l’illustre chansonnier ; il fait savoir qu’ils ont distrait un moment les ennuis de sa captivité : « Si je pouvais le croire, écrit Delphine, cette pensée me rendrait bien fière, et je sens qu’elle deviendrait ma plus douce inspiration. Mais n’emploierez-vous pas à notre profit ce temps de retraite forcée ? La poésie est généreuse : faites qu’on pardonne à vos ennemis en prouvant combien le malheur peut servir au talent, et consolez-nous de votre long exil, en faisant parvenir jusqu’à nous ces chants à la fois si joyeux et si noblement tristes dont l’homme heureux répète les refrains, que le vieux soldat écoute en pleurant, et que le poète admire avec envie. » La flatterie porte sur cet immense orgueilleux. Il a composé jadis une chanson sur Mme Dufrénoy, considérée comme « la première de nos Muses » ; il la place même « bien au-dessus de celles qui ont pré cédé ». En principe, il déteste « ces femmes qui écrivent quand elles ne sont ni bonnes, ni belles », mais il a reconnu que Delphine possède les épaules d’une Vénus, et se décide à écrire pour elle une chanson, l’Ange exilé. Malheureusement, un jour que l’on parle devant Sophie Gay des éloges décernés par le chansonnier aux vers de sa fille, la mère de la Muse réplique :
— Delphine rend bien aussi justice à Béranger.
Le propos est répété ; il froisse une susceptibilité excessive, et, sous le titre de l’Ange exilé une destination idéale, Corinne de L…, remplace le nom de Delphine Gay. La chanson n’est d’ailleurs pas fameuse :
Qui peut me dire où luit son auréole ?
De son exil Dieu l’a-t-il rappelé ?
Mais vous chantez, mais votre voix console :
Corinne, en vous l’ange s’est dévoilé (bis).
Votre printemps veut des fleurs éternelles,
Votre beauté de célestes atours (bis),
Pour un long vol vous déployez vos ailes ;
Ange aux yeux bleus, protégez-moi toujours. (bis)
En dépit des nombreux bis, ces vers ne sortent pas d’une platitude désespérante. Delphine eût sans doute été flattée d’un hommage public rendu par un homme aussi célèbre ; son bon goût aurait sûrement rendu la justice qui convient aux couplets du chansonnier[161].
Un autre grand homme, plus près de son esprit et de son cœur, la dédommage. Au coin du feu où on lit de si beaux vers et de si belle prose, s’assied et chante le poète qui pour elle efface tous les autres. Sainte-Beuve a insisté sur l’effet intense produit par les Premières méditations poétiques sur les jeunes générations de cette époque. Cette auréole illuminait Lamartine lorsque Delphine Gay le vit pour la première fois devant la cascade du Velino. Elle ne cesse, comme alors, de le supplier : des vers, toujours des vers. Elle lui dit, au coin du feu, ceux qu’elle vient de composer ; parfois, il riposte par des vers de sa façon. Un soir, elle le questionne :
— Avez-vous quelques vers nouveaux à me lire ?
— Non ; je ne travaille pas depuis quelque temps.
— Cela est impardonnable.
— Eh bien, donnez-moi un sujet ; je le commencerai, si vous me promettez de le finir.
— Soit : le Rêve d’une jeune fille[162].
Il tient parole. Elle attend jusque fin décembre 1830 pour terminer le poème. On admire qu’elle ait été de force à donner la réplique à Lamartine, sans que ses vers pâlissent à côté de ceux du grand poète. La soudure ne se voit pas.
De menus faits cimentent leur amitié ; elle lui donne une levrette, baptisée Nisida ; il donne à Sophie Gay un jeune chien, Roméo, en nourrice à Saint-Point où il les invite. Il y reçoit, en décembre 1828, le nouveau recueil de poésies de Delphine : le Dernier Jour de Pompéi, poème suivi de poésies diverses. Il retrouve, à les lire, le sentiment déjà éprouvé lorsqu’il les lui entendit réciter en petit comité. Il y surprend un ton de mélancolie qui ne régnait pas dans les précédents recueils. « Seriez-vous moins heureuse ? » demande-t-il.
Il passe à Paris le mois de juin 1829. Il la voit souvent, à l’aise, dans l’intimité, avec une admiration et une sympathie croissantes non seulement pour son beau génie poétique, ce sont ses propres expressions, mais pour les mille qualités d’esprit et d’âme qui la feraient aimer même par ceux qui ne savent ni lire, ni entendre. À peine de retour à Mâcon, il reçoit un portrait de Nisida qu’elle a tracé de mémoire, et une poésie, le Départ, où elle livre le secret de son sentiment pour lui :
Elle s’interroge : quel est ce sentiment « qui dépasse en ardeur l’amitié la plus tendre, et qui n’est pas l’amour » ? C’est l’attrait de deux cœurs exilés de leur sphère et qui se sont reconnus. Le champ de la pensée est leur commun asile ; entre eux, la gloire est un lien :
On parle à son ami des chagrins de la terre ;
On confie à l’amour le Secret d’un instant ;
Mais, au poète aimé, l’on redit sans mystère
Ce que Dieu seul entend !
Lamartine n’a jamais répondu à ce sentiment, cependant très pur, que par une amitié toute simple. Leurs âmes ne vibrent pas exactement à l’unisson. De là une légère désharmonie, assez douloureuse au cœur de Delphine pour que, dans son testament, elle n’ait pu en retenir l’expression. Il a promis une réponse en vers. À la fin du mois d’août, elle témoigne ses regrets de n’avoir pas à lire, à répéter, ces vers qu’elle attend avec impatience pour se consoler et s’encourager : elle n’a jamais été moins inspirée qu’en ce moment. Lamartine ne viendra-t-il pas bientôt à Paris ? Il lui tarde, dit-elle, de s’entendre annoncer « le monsieur qui a un chien ». Il répond de Montculot : son poème n’est pas au point, ne le satisfait pas. Quelques jours plus tard, il confesse l’avoir écrit depuis six semaines ; il l’a recopié sur papier anglais à grandes marges pour l’envoyer officiellement… mais il l’a lu à des amis : ils lui ont conseillé de le garder secret ; le sachant adressé « à une jeune et belle personne » comme elle, le public pourrait mettre sur le compte de sentiments personnels ce qui n’est que de l’admiration poétique. Les stances en question sont cependant bien pures de toute méchante interprétation : il l’en fera juge lorsque tous deux se reverront.
Delphine a toutes raisons d’attendre à bref délai la visite de Lamartine à Paris. Il s’est présenté à l’Académie française le 2 décembre 1824 ; il a été battu par Droz. Le comte Daru étant mort le 5 septembre 1829, il pose à nouveau sa candidature, mais ne bouge pas de son château de Montculot, près de Dijon. Il ne veut pas faire deux cents lieues pour risquer un second soufflet, écrit-il. Il sollicite par lettre ses amis, et aussi ses amies : Brifaut, Villemain, Mme Amable Tastu en donnant comme prétexte que son père, qui a soixante-dix-sept ans et qui est de l’ancien régime, considère un fauteuil académique comme l’apogée de la gloire humaine. Que Sophie Gay ait intrigué en sa faveur, on n’en doute pas, bien qu’aucune lettre ne se soit encore rencontrée pour le prouver. Les autres candidats sont le duc de Bassano, et Philippe de Ségur. Bas sano se retire, et Lamartine est élu par dix-neuf voix contre quatorze à son concurrent. Il vient à Paris en novembre : la mort de sa mère le rappelle aussitôt en Bourgogne.
Ce qu’il a dit de ses vers à Delphine augmente d’autant plus la curiosité de la jeune fille. Elle les réclame encore le 6 janvier 1830 : « Je n’ose vous demander les vers que je désire tant. Je voudrais que ce fût une consolation pour vous que de causer un si grand plaisir. Après de vifs chagrins, on n’est guère sensible qu’au bonheur qu’on donne. Cela ne vous donnera-t-il pas le courage de me les envoyer ? J’en serais si heureuse. Ils m’aideraient à supporter tant de regrets et tant de plaisirs qui m’ennuient. Envoyez-moi de grâce un mot qui nous apprenne que vous pensez encore à nous. »
Il est malade, accablé d’affaires : « Je suis si triste que je ne vous inspirerais que tristesse ; et vous-même, je ne vous crois pas heureuse. Je serai bien heureux le jour où vous m’écrirez : « Je suis heureuse ». Il vient d’écrire l’éloge de son prédécesseur le comte Daru : « C’est détestable, comme ce qu’on écrit de commande, quand on a envie de pleurer plus que d’écrire ».
L’Académie française le reçoit le 1er avril 1830. Sans doute à ce moment Delphine lit-elle enfin les beaux vers qu’il a écrits pour elle, et qui ne portent d’autre titre que la dédicace : « À mademoiselle Delphine Gay ». Ils sont insérés dans le volume des Poésies diverses, à la suite des Recueillements poétiques.
Les séances de réception à l’Académie française sont fort courues. Pour y assister, on doit faire la queue et prendre son rang en personne. Il arrive que des dames adorablement habillées et jolies doivent quitter la place, faute de dénicher un coin où se loger. En pareil cas, on a vu un académicien se déranger pour chercher une chaise à Delphine Gay. La réception de Lamartine fait événement. Par chance, nous en possédons un compte rendu rédigé par Adolphe Thiers dans le National qu’il vient de fonder avec un groupe d’amis. Les articles ne sont pas signés, mais, sur son exemplaire personnel, Thiers a pris soin de noter de sa main les noms des auteurs. Ainsi savons-nous que celui-ci sort de sa plume.
« On était curieux de savoir quelles révolutions s’étaient opérées dans l’esprit de M. de Lamartine à la vue de toutes ces choses… Une foule immense s’était pressée de bonne heure aux portes de l’Institut, et manifestait la curiosité la plus honorable pour le récipiendaire. Depuis la réception de MM. de Montmorency et Royer-Collard, on n’avait pas vu une foule aussi considérable au Collège des Quatre-Nations. Déjà la salle était pleine, qu’on avait deux ou trois fois entendu des cris aigus aux deux portes qui sont placées à côté du bureau, et que par ces portes avaient eu lieu deux ou trois irruptions de femmes élégamment parées, qui, pénétrant à travers les baïonnettes, étaient venues s’asseoir au milieu des bancs des académiciens, ou se placer debout autour des fauteuils du président et du secrétaire. L’empressement de nos dames pour les scènes académiques est extrême, et on ne saurait leur en vouloir. Malheureusement, elles n’apportent pas toujours un goût bien littéraire au milieu de ces scènes. Après avoir regardé leurs parures, et s’être levées sur les pieds pour apercevoir les personnages qui attirent l’attention, elles se meurent d’aise à toute pensée fausse et brillante, à toute antithèse bien conditionnée… On a attendu deux heures au moins l’ouverture de la séance. On vivait, en attendant, de curiosité ; on montrait du doigt les académiciens qui passaient. Un mouvement a accueilli M. Royer-Collard ; tout le monde était debout, quand on a annoncé le récipiendaire. Il avait la réputation de joindre les avantages extérieurs aux talents dont la nature l’a doté. Sa figure, en effet, est noble et douce. Une voix claire, pure, et d’une expression touchante, quoique un peu monotone, semble convenir parfaitement à ses vers. Elle a été faite pour les dire. » On sent ici la pointe. Thiers analyse ensuite l’éloge de Daru, la courte réplique de Cuvier, des strophes de Lebrun sur le ciel d’Athènes et le mont Parnasse. Il constate que Lamartine est fréquemment applaudi, et finit ainsi : « Au reste, faut-il le dire, nous ne croyons jamais voir dans les rangs des ennemis de la liberté, un talent si généreux et si élevé ». Thiers pronostique juste ; mais se doute-t-il à quel point Lamartine le distancera dans ses opinions politiques ?
En tous cas, il ne prévoit pas qu’en mai 1848, Lamartine emploiera tous les moyens imaginables pour faire échouer son élection, partout où il sait que Thiers se porte candidat.
La séance levée, la foule entoure et félicite le récipiendaire. Il offre le bras à Delphine Gay, et, avec elle, sort de la salle, puis traverse la cour. Elle le lui rappellera par la suite : « J’étais bien fière ce jour-là, et toutes les femmes étaient bien envieuses de moi[163]. »
Des bouleversements politiques, littéraires et artistiques, caractérisent l’année 1830. Une extraordinaire effervescence règne dans les esprits. Une sève de vie nouvelle circule impétueusement dans le corps social. « Tout germe, bourgeonne, éclate à la fois. » Voici d’une part « des jeunes gens intelligents, hardis, décidés, habiles chiens de chasse, ardents oiseaux de proie » ; ils traitent de chimère ou d’exaltation romanesque « cette intime conscience qui rend incapable de tromper, d’être ingrat, de se montrer servile envers le pouvoir et dur pour le malheur ». Voici d’autre part des êtres fous de lyrisme et d’art, qui croient à un mouvement pareil à celui de la Renaissance, qui se flattent d’avoir d’avoir retrouvé « le grand secret perdu », c’est-à-dire la poésie. Ceux-ci méprisent l’argent. Le sort d’Icare ne les effraie pas, et ils crient « Des ailes ! Dussions-nous tomber dans la mer ! ».
L’exaltation des cerveaux, des dissidences ardentes, provoquent des brisures dans les relations, et rompent de vieilles amitiés. Dans sa lettre du 25 janvier 1830 à Delphine Gay, Lamartine écrit : « Je ne comprends pas comment M. Villemain a voulu se brouiller avec vous à propos de son mariage. C’est mal débuter. L’amitié va très bien à un homme marié, et la vôtre et celle de votre aimable mère m’auraient semblé, à sa place, un présent de quelque prix. » Quel est le motif réel de Villemain ? Coulmann a sténographié avec sa précision ordinaire une scène qu’il ne reste qu’à répéter après lui : « Mme Gay avait obtenu de présenter sa fille à Charles X, il l’avait accueillie avec sa courtoisie chevaleresque, et ce triomphe aux Tuileries avait fait pencher les sympathies de l’une et de l’autre en faveur d’un souverain qui n’était pas tout à fait à leurs yeux un grand roi, mais un prince excellent et plein de goût. L’impression un peu affaiblie du prestige exercé par Louis XIV sur Mme de Sévigné va se faire sentir par les paroles suivantes :
« Delphine. — Je voudrais qu’il vînt un bon despote pour fermer la bouche à tous ces bavards de la Chambre.
» Mme Gay. — On hésite à accorder au gouverne ment les quatre-vingts millions qu’il demande. On ne fera rien, et un beau jour la France sera envahie de nouveau.
» Villemain. — La France ne sera plus jamais envahie. L’ennemi ne remettra jamais les pieds à Paris.
» Mme Gay. — Qui l’empêchera ? Autour de qui se rangera-t-on ? Dans l’intérieur on ne tend qu’à renverser la dynastie.
» Villemain. — Toutes les capitales ont été conquises. La nôtre ne l’a été que parce qu’on détestait Bonaparte, et on avait alors raison de le détester ; mais aujourd’hui on ne veut à aucun prix d’une invasion, et il n’y en aura pas. Il n’y a rien qui soit plus puissant que la France après quatorze années de paix. On ne hait pas la dynastie ; autant celle-là qu’une autre, plutôt celle-là, même. Après tout, qu’on la détruise, cela m’est égal. Vous croyez que c’est une dispute de places, vous vous trompez. Ce sont là des opinions que vous rapportez du faubourg Saint-Germain : c’est ainsi qu’on parle dans ses salons. Non, la liberté y est pour quelque chose.
» Mme Gay. — J’aime mieux la liberté que ceux qui font des phrases en sa faveur ; mes actions l’ont prouvé. Je ne suis pas du faubourg Saint-Germain et ne veux pas en être. Vous y allez plus que moi.
» Villemain. — Permettez-moi de vous dire que vous n’entendez rien à la politique, et brisons sur ce sujet ; car nous avons des opinions diamétralement opposées.
» Mme Gay. — Elles sont opposées, parce que je suis patriote, moi, et que j’en puis mieux raisonner que quelqu’un qui a beau avoir plus d’esprit que je n’en ai. Tous mes amis sont des libéraux, et dans la Révolution j’ai caché et sauvé plus d’un proscrit. Pontécoulant, qui sort de chez moi, qu’est-ce autre chose qu’un des plus anciens amis de la liberté ?
» Villemain. — La citation n’est pas heureuse, et souffrez que je vous le dise. Si M. de Pontécoulant avait gardé toujours son caractère noble et ferme, il n’aurait pas accepté une place de M. de Villèle.
» Mme Gay. — Quand on a été le confident et l’instrument de M. Decazes, on a bonne grâce à traiter ainsi un de mes amis. Il semble que vous n’ayez pas accepté de places. Vous y avez agi noblement, mais enfin vous les acceptiez.
» Villemain. — Gardez votre errata, madame, je n’en ai pas besoin. Je ne blâme pas ceux qui prennent des places. J’en ai occupé sous M. Decazes ; j’avais vingt-cinq ans, j’ai eu tort. Aujourd’hui, je ne serais ni le confident, ni l’instrument de M. Decazes, ni de personne ; mais je suis sorti pauvre de cette place, ce qui prouve que je n’en ai pas fait un mauvais usage. Vous qui veniez quelquefois au ministère, pourriez-vous vous souvenir que j’y ai rendu des services ? Il me semble que quand je refusais dernière ment les fonctions que vous me pressiez tant d’accepter, je faisais au moins preuve de désintéressement. »
« Je me lève, un peu embarrassé d’être témoin d’un pareil débat. M. Villemain me suit et me dit en descendant l’escalier :
« — Vous savez, vous qui avez fait la proposition de m’acheter une maison pour ma conduite à l’Académie, si j’ai de l’indépendance ; je n’aspire qu’à cela. J’étais las aussi de faire toujours des compliments à Mme Gay et bien aise de décharger une fois mon cœur. Son besoin de servitude me révolte. Je vais aussi au faubourg Saint-Germain, parce qu’on m’y recherche et qu’on m’y gâte ; mais y faire réciter des vers à sa fille, quand on ne daigne la recevoir que pour cela, c’est trop honteux. Il n’y a que sa situation ou le besoin qui puisse l’excuser. »
Coulmann, qui a gardé son sang-froid, met les choses au point en trois lignes : « Un des caractères des femmes-auteurs de ce temps n’était pas d’avoir la pudeur de la science, comme dit Fénelon, pudeur qu’il leur voulait égale à toutes les autres. Elles produisaient non seulement leurs œuvres devant le public, mais elles s’y produisaient elles-mêmes (telles la princesse de Salm, Mme de Genlis). Il n’est pas étonnant que Mme Gay se soit crue autorisée à se conformer à ces illustres exemples. » La duchesse de Broglie avait déjà dit de Villemain émancipé de Decazes : « Après tout, ce n’est qu’un affranchi ». Et la Biographie pittoresque des quarante de l’Académie lui consacre dès 1826 ce paragraphe : « Quel est ce loup-garou, à l’œil hagard, à la chevelure en désordre, à la démarche incertaine, au vêtement négligé ?… Il y a deux hommes dans notre professeur, l’écrivain et le pensionnaire du gouvernement. Quand le premier dit : marchons, le second crie : arrêtons-nous ; quand le premier enfante une pensée généreuse, le second se laisse affilier à la confrérie des bonnes lettres. Où cette funeste condescendance s’arrêtera-t-elle ?… Il est si difficile de se passer de place, lorsque depuis longtemps on en remplit une… et puis, M. l’Abbé, Mme la Marquise, Son Excellence, les truffes, le champagne, les décorations, les réceptions, les dévotions, les affiliations… »
Quoi qu’il en soit, entre Sophie Gay et Villemain, la cassure se produit[164].
Les critiques qu’il a formulées trouvent un écho dans la Biographie des dames de la cour et du faubourg Saint-Germain, par un Valet de chambre congédié, qui dissimule Fr.-Eug. Garay de Monglave et E.-Constant Piton. Le succès, même d’une jeune fille qui n’a jamais attaqué personne, offusque les médiocrités des bas-fonds du monde des lettres, dont l’envie invente avec une rare fertilité d’imagination les calomnies les plus ingénieuses, et parfois non sans esprit. « La fille de l’auteur d’Anatole et de l’arrangement de la Sérénade n’est pas encore à la cour ; mais comme elle a l’espoir d’y être admise avant notre seconde édition, nous avons cru devoir par anticipation la comprendre dans cette biographie. Tout vient à point à qui sait attendre : M" Delphine Gay attend avec un courage admirable ; mais elle ne perd pas son temps pour cela : le roi va-t-il à Notre-Dame, à Saint-Cloud, à l’Institut, vous pourrez être sûr que la première personne qui s’offrira à sa vue sera M" Gay, avec ses belles touffes de cheveux blonds, son teint de lis et de roses, sa taille svelte et sa robe bleu-haïti. « Quelle est cette jeune femme ? demande le monarque ? — Mlle Delphine Gay, répond le premier gentilhomme. — Toujours Mlle Delphine Gay ! » et il poursuit sa route de mauvaise humeur. Y a-t-il un bal à la Chaussée d’Antin ? Tout le monde debout sur les sièges a les yeux fixés sur une contredanse. Quelle est cette jeune dame, qui chasse et rechasse si bien ? Mlle Delphine Gay. Toujours Mlle Delphine Gay ! C’est le marquis de Carabas de la société parisienne. Le baron Gros finit-il sa coupole de Sainte-Geneviève ? Qui chantera ce bel ouvrage ? Mlle Delphine Gay. Le général Foy est-il ravi à la France consternée ? Qui se fera l’interprète du deuil national ? Mlle Delphine Gay. La Congrégation perd-elle M. le duc de Montmorency ? Qui consolera l’autel et le trône ? Mlle Delphine Gay. Sa fabrique de vers est en aussi grande activité que celle des griffonneurs publics qui écrivent sur leurs carreaux : « Ici on fait des vers et couplets pour les fêtes et les noces. » Il n’y a qu’un malheur, c’est que
Églé, belle et poète, a deux petits travers,
Elle fait son visage et ne fait pas ses vers.
» Qui les fait donc ? Allez quai Voltaire, entrez sous cette grande maison, montez, montez toujours, six étages, deux cent quatre-vingt-dix marches, et dans une petite bonbonnière, d’où la vue embrasse tout le département de la Seine, vous trouverez l’Apollon du Belvédère. » L’Apollon du Belvédère désigne H. de Latouche.
Le fiel est distillé goutte à goutte. Chaque trait est savamment aiguisé, depuis « l’auteur de l’arrangement de la Sérénade » jusqu’à celui de la fin, que les brouillons des manuscrits de Delphine suffiraient à infirmer s’il en était besoin. Cet ouvrage, tissu de méchancetés et de calomnies de même sorte, est saisi, condamné, et soigneusement détruit par autorité de justice.
Delphine continue sa route droite.
En février, elle assiste à un bal donné à l’Opéra ; « aux sons du bal, à la clarté du bal », elle improvise le Bal des pauvres, qui paraît aussitôt au Journal des Débats et au Moniteur. Le 25, jour mémorable entre tous, jour de la première représentation d’Hernani ! Tous les jeunes romantiques sont à leur poste : ils ont le mot de passe, « hierro », griffonné sur les billets rouges qu’ils présentent à l’entrée. Ils s’emparent de la place, et débordent les claqueurs « qui, quoique stipendiés, ont des tendances classiques ». Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Victor Pavie commandent des groupes, et se signalent par leur fanatisme.
La salle est houleuse. Soudain, le tumulte s’apaise : Delphine Gay vient d’entrer dans sa loge : une loge donnée par Hugo. Elle se penche pour regarder la salle : une triple salve d’applaudissements crépite. Les poètes de la nouvelle école ont reconnu leur Muse, avec sa beauté royale, ses bras admirables, ses boucles blondes, la robe et l’écharpe bleue du portrait d’Hersent dont elle prend inconsciemment la pose. Elle triomphe aussi ce soir-là[165].
Le 9 juillet, une dépêche télégraphique, le canon des Invalides, et les journaux, annoncent la prise d’Alger. Le 11, à Villiers-sur-Orge, Delphine écrit son poème : la Prise d’Alger, Te Deum, que publie la presse libérale. Trois strophes visent Bourmont ; l’une rappelle qu’on l’appela transfuge, l’autre qu’il donna son honneur pour favoriser le retour du roi, la troisième que la victoire lui vaut son pardon, et que le sang pur de son fils lave la tache imprimée à son nom. Et les journaux libéraux annoncent qu’en manière de représailles le ministre de l’Intérieur a supprimé la pension de quinze cents francs dont jouit la Muse. Le National du 20 juillet reproduit l’information. Le 21, le Globe reproduit à son tour un écho de l’Universel, dont un rédacteur a interviewé le ministre de l’Intérieur, qui a répondu ne connaître « ni Mlle Gay, ni sa pension, ni ses vers ». Le 22, la Quotidienne se charge d’éclaircir la question. La feuille royaliste souligne d’abord qu’un événement public de quelque importance ne saurait être considéré comme accompli que si la lyre de Mlle Gay intervient : « C’est là une chose générale ment reconnue, et par Mlle Gay elle-même. » Une note cite les vers de la Vision : « Le héros me cherchant, etc. » Immanquablement, la Muse devait chanter la prise d’Alger. Or, des bruits circulent : ses vers sont peu poétiques ; elle a décoché une grossière injure au général en chef ; enfin sa pension « d’homme de lettres » lui est retirée. « Qu’on juge de l’anxiété de la France pendant ce débat ! » Aujourd’hui, tout se découvre : ce n’est pas sur les fonds de l’Intérieur, mais sur ceux de la Liste civile, que Mlle Gay « reçoit tous les ans pour huit cents francs de lauriers ». Le ministre se verrait dans l’obligation de supprimer l’allocation si elle dépendait de lui ; au lieu que la Liste civile, avec le droit de récompenser les poètes, a de plus celui de leur faire grâce. Le cas se présente d’en user… Il y aurait à la fin quelque immoralité à encourager sans fin ce besoin qu’éprouvent quelques femmes de ne point être de leur sexe. « Mieux vaut ne pas tenir compte de la manifestation de Mlle Gay, et n’en pas faire une femme politique. » Le Figaro revient sur la question. « La Quotidienne traite M" Gay avec un ton de dédain et de persiflage bien étrange dans la bouche de ceux qui se disent les représentants de l’ancienne galanterie française. Mais Mlle Gay a dit que M. de Bourmont avait été transfuge, dès lors la colère de la Quotidienne n’a plus de bornes ; elle se voit affranchie de toutes les lois de la décence et du goût. Elle a pensé qu’il s’agissait peut-être encore de sauver le trône et l’autel, qu’elle sauve régulièrement deux fois par semaine. »
Cet écho paraît le 26 juillet : la révolution est en marche ; le gouvernement de Charles X n’a pas le loisir de trancher la question, toujours en suspens le 9 novembre suivant ; à cette date, dans la famille, on doute que la pension soit conservée.
La situation des deux femmes est difficile. Le 19 juin précédent, Sophie Gay a vendu la Maison Rouge. Le 15 avril 1823, elle avait souscrit à Froidefont de Bellisle une obligation de vingt-sept mille francs : c’est à Froidefont de Bellisle qu’elle vend sa propriété de Villiers au prix de cent mille francs, dans lequel le mobilier entre pour vingt mille francs. Comme elle avait précédemment acheté une pièce de terre et un pré concurremment avec son gendre, le comte O’Donnell, — l’usufruit lui revenant, la nue propriété restant à son gendre, — ce dernier participe à la vente. Il deviendra maire de Villiers, et la ville de Montlhéry lui devra son école d’enseignement mutuel, où il fera instruire plusieurs enfants à ses frais.
D’autre part, les barricades ne favorisent guère la vente du Moqueur amoureux, le nouveau roman de Sophie Gay. Du fond de sa province, Edmond Géraud le qualifie de bavardage de salon ; la douce Marceline en parle dans un billet à des amis communs, M. et Mme Paul de Nérac. « Mme Gay m’a envoyé avec beaucoup de grâce et de politesse son roman du Moqueur. Pour spirituel, oui ! mais pour amoureux… c’est toujours elle, brillante, fine, émue, et charmante à lire. »
Bien que la révolution de Juillet ne soit pas faite pour améliorer leur sort, les deux femmes l’accueillent bien. Au fond, elles n’ont jamais cessé d’être libérales, en dépit de leurs relations aristocratiques. Les jeunes enthousiastes qui applaudissaient Delphine à la première représentation d’Hermani, ce sont les Jeune France, républicains et bonapartistes ; ils arborent le gilet rouge, par contraste avec les carlistes qui arborent le gilet vert, tandis que les saint-simoniens le préfèrent bleu. Delphine, à l’unisson des libéraux, écrit le Serment, hommage aux trois Écoles, poème qui paraît dans un petit in-douze au titre encadré d’un triple filet, bleu, blanc et rouge, le Momus de la Liberté, recueil national des meilleures pièces de vers et chansons composées depuis le 27 juillet 1830. Elle y rappelle ses objurgations au roi lorsqu’à son sacre il prêta le serment qu’il n’a pas tenu, et exalte les jeunes gens qui viennent de faire la révolution : ceux-là ont l’avenir devant eux, ils sont purs, ils n’ont pas servi les régimes les plus divers. Elle ne peut encore pré voir que cela viendra[166].
Quant à elle, son prestige ne cesse de grandir. La Malibran écrit ces mots à Lamartine : « Croiriez-vous que je n’ose pas lui écrire ? Une femme savante me fait plus peur qu’un homme savant. Si vous vouliez, étant assis auprès d’elle, lui donner un petit coup de coude en la regardant de côté, et marmotter entre vos dents : écrivez-lui un petit mot !… cela m’encouragerait, et je donnerais en quantité un bœuf pour un œuf, mais en substance un grain de sable pour une montagne. » D’Espagne, le marquis de Custine lui envoie, ainsi qu’à sa mère, de longues lettres où il consigne ses impressions de voyage, qu’il publiera par la suite. Elle assiste, chez la vicomtesse de Saint-Priest, au bal où le duc d’Orléans, que les carlistes cherchent à ridiculiser en l’affublant du surnom de Grand Poulot, se montre, au point qu’on le remarque, empressé auprès de Mme d’Audenarde, de Vatry, de Vaudreuil et Victor de Caraman. Mme Récamier, à qui Sophie Gay vient de présenter Victor Hugo, met fréquemment sa jeune amie à son programme, et l’annonce comme une attraction sur les invitations qu’elle lance. George Sand, installée à Paris le 4 janvier 1831, informe le mois suivant son mari qu’elle a vu H. de Latouche. « Il a été fort aimable. Il me mène dimanche à l’Abbaye-aux-Bois, chez Mme Récamier ; Delphine Gay doit y dire des vers, et j’y verrai toutes les célébrités de l’époque[167]. »
Malgré cette situation unique pour une jeune fille, Delphine n’écrit pas à Lamartine la phrase qu’il lui demande, pour lui apprendre qu’elle est heureuse. Lors de la mise en accusation des ministres de Charles X, amis de Jules de Rességuier qui s’en montre vivement affligé, Lamartine les défend dans son Ode contre la peine de mort. De Milly, il envoie à Delphine un exemplaire autographié. « Quels beaux vers et quelle belle action ! répond-elle. Nous vous relisons tous les jours avec plus d’admiration… L’amiral de Rigny en a été si ravi qu’il nous les a volés. » Pourquoi le poète ne revient-il pas à Paris ? « La retraite est impossible à supporter dans l’inquiétude ; comme la nuit, elle rembrunit tous les objets. Une heure de danger réel vaudrait mieux qu’un jour d’inquiétude inutile. La vie à Paris vous serait plus agréable, on ne voit que les gens qu’on aime et qui pensent comme soi ; plus de raouts, de bals, de vanité. Chaque soir quatre à cinq de nos amis qui vous plairaient viennent causer avec nous des événements du jour. Chacun vient se consoler de ses craintes par les preuves de dévouement qu’il se promet. Vous aimeriez cette manière de vivre qui est douce et mélancolique… Votre sollicitude pour nos pauvres intérêts nous touche sensiblement. Nous sommes entourées de gens qui perdent de si gros revenus que nous n’osons plus nous plaindre de la diminution des nôtres. Tant que j’aurai de quoi nourrir Nisida et Roméo, je supporterai courageusement la misère, et, d’ailleurs, l’exemple d’Homère est là pour nous sauver de toute humiliation. C’est bien le moins si nous ne sommes pas toujours aussi riches que lui… Je suis paresseuse ; je vais, en souvenir de vous, tâcher de continuer votre Rêve ; les miens ne viendront pas m’en distraire, je n’en fais plus. La réalité de nos jours humilie la plus brillante imagination. Mais elle ne glace pas le cœur, et vous connaissez le mien. Venez, je crois qu’il y a quelque chose de grand à faire pour les nobles caractères[168]. »
Cette lettre soulève un coin du voile. La Muse, désenchantée, se voit belle d’une beauté rare, illustre comme aucune femme de son temps, et pauvre, de cette pauvreté qui l’oblige à porter des chapeaux calèches de chez Herbault, des robes à manches pendantes dites « à la folle ». Elle a manqué le mariage avec Vigny, elle a refusé un grand seigneur italien, elle a manqué le mariage avec le comte de Lagrange. Elle a plus de vingt-six ans. Bien qu’elle n’ait aucun rapport avec Hortense Allart, le cousinage avec cette personne excessive lui fait du tort. « La belle Delphine fait des vers qui ne lui font pas trou ver un mari », s’écrivent ses amies derrière son dos.
Qui, d’ailleurs, épouserait-elle ? Lisez ce passage cinglant sur les jeunes hommes de l’aristocratie nobiliaire : « Et c’est parmi ces jeunes fats, dans cette pépinière de fainéants, que je dois chercher un mari !… Certes, j’aimerais mieux devenir la femme de quelque pauvre étudiant bien obscur, mais noble ment honteux de son obscurité, dévoré du désir de la gloire, jaloux de rendre illustre son nom bourgeois, et cherchant nuit et jour dans la poussière des livres le secret des grandes renommées… que d’épouser jamais un de ces jolis cœurs de bonne famille qui se traînent, courbés, écrasés sous le poids de leur nom formidable, ces petits seigneurs de comédie qui n’ont de leur haute position que le masque de la vanité, qui ne savent rien faire, ni agir, ni travailler, ni souffrir ; ces paladins déchus qui n’ont jamais guerroyé qu’avec des sergents de ville, et qui n’ont encore pu rendre leurs noms célèbres que dans les bastringues de la barrière et dans les tabagies du boulevard ». Lisez encore cette poésie, Ma Réponse, qui commence par ce vers :
On accuse mon cœur de ne pouvoir aimer.
À qui lui reproche de ne pouvoir chanter l’amour sans rêver la gloire, elle réplique :
Toi qui sais mon secret, ma harpe, défends-moi.
Et à qui la blâme de sa froideur et de sa légèreté : ne faut-il pas être gaie quand même dans ce monde frivole, où elle cherche en vain qui pourrait lui plaire ?
Livrerai-je mon cœur à ce bel indolent ?
Suivre ou donner la mode est son premier talent.
D’opales, de rubis, sa parure étincelle.
Et c’est en s’admirant qu’il me dit : « Qu’elle est belle ! »
Celui-là, un lion, se considérerait comme déshonoré s’il ne portait des habits de chez Staub, des pantalons de Blin, des gilets de Blanc, un chapeau de Gibus, des bottes de Sakosky et une canne de Marcadé. Ses préoccupations intellectuelles ne vont pas au-delà. Quel compagnon pour une femme de la trempe de Delphine ! Elle continue la revue :
Dois-je lui préférer ce jeune ambassadeur,
Qui prend la gravité pour de la profondeur,
Qui met toute sa gloire à contraindre son âme,
Et sa diplomatie à tromper une femme ?
Puis, que dites-vous de ce portrait piquant et les tement troussé, pour lequel Thiers a posé en pied ?
Séduite par l’espoir de succès éclatants,
Faut-il choisir enfin ce tribun de vingt ans,
Rhéteur ambitieux, sévère par système,
Qui maudit sa jeunesse auprès de ce qu’il aime ;
Qui déjà, s’apprêtant à défendre nos lois,
Sur les moindres sujets veut exercer sa voix,
Et, rêvant au conseil sa future importance,
Fait en parlant d’amour des essais d’éloquence ?
Pendant cette période, elle compose des poésies qui s’intitulent : « Je n’aime plus », et « Découragement », et d’autres où elle glisse mille et une allusions à sa lancinante déception. Alors, il semble qu’elle se réfugie dans ce sentiment complexe et fort qu’elle a voué à Lamartine, qui peut-être n’est pas ce qu’elle aurait souhaité qu’il fût, et au-dessous duquel celui qui en est l’objet demeurera toujours d’un degré.
Cependant, à ce moment même, et sans peut-être qu’elle s’en doute, l’homme qu’elle doit épouser n’est pas loin[169].
IX
Adélaïde-Marie Fagnan, fille d’un haut fonctionnaire des finances sous Louis XVI, avait, épousé à seize ans un magistrat, Dupuy, qui fut conseiller à la Guadeloupe, et mourut en 1842, conseiller à la Cour royale de Paris. Elle était fraîche et charmante. Greuze en a fait sa Jeune Fille à la colombe. Elle était de ces jeunes femmes du début de l’Empire qui admiraient la gloire, et s’honoraient de la récompenser. La gloire lui apparut, entre deux campagnes, sous l’uniforme de l’un des beaux de l’armée, le général comte Alexandre-Louis-Robert de Girardin, second fils du marquis de Girardin, le protecteur de Jean-Jacques Rousseau. Il en résulta un fils, venu au monde à Paris, le 22 juin 1806, et déclaré à l’état civil sous le nom d’Émile Delamothe.
Ses parents le confièrent à un brave homme, Choisel, qui demeurait boulevard des Invalides, et prenait en sevrage les enfants des grandes familles. Il gardait à la même époque des enfants de la princesse de Chimay ; il faut placer là le début des relations de l’enfant avec le docteur Cabarrus, fils d’Ouvrard et de Mme Tallien. Jusqu’à l’âge de huit ans, le garçonnet est l’objet des soins affectueux de ses parents. Arrivent les événements de 1814 : son père se rallie à Louis XVIII, et épouse Mlle de Vintimille ; sa mère ne le considère plus que comme un remords. Et cet enfant de huit ans, en pleine connaissance, voire d’une intelligence précoce, apprend qu’Émile Delamothe n’est pas son nom ; il subit cette dureté du sort : passer de la tendresse à l’indifférence et à l’aversion. Au point de vue affectif, au point de vue social, cette suprême injustice n’est-elle pas la plus douloureuse des écoles ? Quelle expérience de la vie celui qui l’éprouve ne doit-il pas acquérir du coup !
Remis à un ancien officier, Darel, blessé en Égypte et nanti d’un petit emploi dans la vénerie (Louis XVIII a nommé le général de Girardin grand veneur), il est transféré au haras du Pin, en Normandie, chez le père de Darel. Sa marraine, Mlle Du Bourg, qui va devenir Mme de Varaignes, habite non loin de là le château de son père : Émile y a ses entrées ; il en profite pour dévorer la bibliothèque.
Il a dix-sept ans. Mme de Senonnes, femme du secrétaire général de la Maison du roi, le remarque, et l’emmène à Paris. Peu après, Émile suit dans sa disgrâce Senonnes révoqué. Il entre en qualité de commis chez un agent de change. Lesté d’un petit pécule de douze cents francs de rente sur les fonds espagnols, il les joue, et en perd les deux tiers. Il veut alors s’engager dans un régiment de hussards : on le refuse pour faiblesse de constitution.
Le jour de sa majorité, il va trouver son père, et lui demande l’autorisation de prendre son nom. Le père refuse.
— Soit, dit-il, faites-moi un procès !
Et il signe Émile Girardin, puis Émile de Girardin. Et comme il ne tarde pas à acquérir de la réputation par son esprit, Montrond dit au général de Girardin :
— Dépêche-toi de le reconnaître, ou il ne te reconnaîtra pas !
Le marquis de La Bourdonnaye s’entremet pour lui proposer une fortune s’il veut renoncer au nom qu’il a pris ; Émile répond : « Ou le nom, ou rien » ; et le marquis ne peut s’empêcher de lui donner son estime.
Ce père qui se refuse, Lamartine le définit l’excentricité transcendante, et ajoute : « Celui qui n’a pas connu le père ne peut comprendre le fils ». Émile, décidé à sortir de l’ornière, travaille jour et nuit. Il vit en anachorète dans une petite chambre, au rez-de-chaussée, 28 avenue des Champs-Élysées. Il fréquente assidûment le cabinet de lecture de Mme Désauges, au Palais-Royal. Il y rencontre Lautour-Mézeray, qu’il connut en Normandie, et s’y lie avec H. de Latouche, Alexis Dumesnil, Alphonse Rabbe, Eugène de Monglave, Maurice Alhoy. Ses nouveaux amis l’encouragent à écrire. Il jette ses rancœurs sur le papier. Au début de l’année 1828, il publie chez le libraire Désauges un petit volume : Émile, fragmens. Dès la couverture, l’épigraphe, tirée de Delille, indique la tendance du livre :
Malheureux le mortel, en naissant isolé,
Que le doux nom de fils n’a jamais consolé !
La préface porte une signature auguste : le vicomte de Chateaubriand ; bien que courte et un peu froide, c’est déjà un coup de maître que d’entrer dans la littérature avec un tel parrain. L’auteur s’adresse à une Mathilde idéale : elle a les yeux bleus : il ne nous en dit pas davantage. Il lui conte sa vie. Imprégné de Rousseau, influencé par Xavier de Maistre, Sterne, La Fontaine, il laisse percer sa prédilection pour Lamartine. On relève dans ce premier écrit des pensées directrices : « J’ai fait du malheur de ma naissance l’étude de toute ma vie ». Il met dans le mariage toutes ses espérances de bonheur : « Cette proscription qui désole mon existence ne cessera entièrement que lorsque j’aurai des enfants ; je le sens, j’ai besoin de recevoir le nom de père pour oublier que le nom de fils ne me fut jamais donné ». Une étrange fatalité s’acharnera à détruire cet espoir : Émile de Girardin aura un fils illégitime que sa première femme, qui ne lui a pas donné d’enfant, adoptera ; et après avoir eu de la seconde une fille, Marie-Clotilde, qui meurt du croup, à peine âgée de six ans, dans les bras de l’impératrice Eugénie à Biarritz (7 octobre 1865), il lui intentera et gagnera une action en désaveu de paternité pour le fils qu’elle mettra au monde par la suite.
Dans Émile, il envisage aussi quelques-unes des difficultés qu’il rencontrera pour se marier, avec, pour dot, le malheur de sa naissance ; il n’ose dire le premier : « J’aime… » Quelques pensées dénoncent pour son âge une étonnante maturité d’esprit. « Je ne hais pas les hommes. Je ne sais pas si je les méprise. — Il semble qu’écrire soit pour l’imagination une existence physique. — Le plaisir qui coûte une illusion ne la remplace jamais »[170].
Quatre éditions s’enlèvent coup sur coup. Ce succès décide l’auteur à publier, la même année, un nouveau volume : Au hasard, pages sans suite d’une histoire sans fin, manuscrit trouvé dans le coin d’une cheminée, et mis au jour par Ad. Bréant. La dédicace occupe une page blanche : un A suivi de points, des guillemets à la ligne qui reste blanche, et, tout en bas et à droite, en petits caractères : « Hommage d’un auteur modeste ». L’introduction explique ce rébus : « Pour laisser à tous ceux qui achèteraient ce livre, la satisfaction d’inscrire eux-mêmes leurs noms sur la page blanche de l’immortalité ». Comme dans Émile, il a jeté là les réflexions que l’injustice de sa situation lui inspire, les pensées que lui suggère une expérience rapidement et douloureusement acquise, et servie par une intelligence aiguë. « Le secret pour avoir une idée, c’est de la piller quelque part. » Idée savoureuse chez le fondateur du Voleur et le protagoniste d’une idée par jour ! « Pourquoi, au lieu de me nommer Montmorency, ne suis-je qu’un bâtard ? — En domptant le caractère, on l’avilit toujours. — Foule abjecte qu’on nomme le peuple, masse passive, décorée de l’appareil d’un nom, qui meurt successivement sans avoir vécu, dont la force matérielle cède à la volonté d’un seul individu, et qui ne se meut que par l’impulsion qu’elle reçoit. — France, noble patrie de la routine. — Je vais au-devant de toutes les jouissances que je puis satisfaire. — L’avarice est un vice digne de pitié. — Espèce humaine, que tu es vile, sois que tu commandes à l’intérêt ou que tu obéisses à la vanité ! — Indépendance !… C’est en toi seule que réside la félicité humaine. — C’est un fâcheux inconvénient de n’être pas riche. »
À la même époque, il publie une romance, musique de A. Brocard, sous ce titre : N’aimez jamais !
Ses succès littéraires aguichent son ami Lautour-Mézeray. Par malheur, la copie de Lautour ne passe nulle part.
— Il n’y a qu’un moyen, c’est de fonder nous mêmes un journal, dit Émile.
Lequel ? Si l’on en faisait un en prélevant les meilleurs articles de tous les autres ? Lautour propose de l’appeler la Lanterne magique.
— Non, nous n’aurions pour abonnés que des enfants.
Et il adopte : le Voleur. Henry Monnier dessine la vignette ; pour le remercier, les deux associés l’invitent à déjeuner huit jours plus tard. Mais pour imprimer le journal, il faut de l’argent. Émile emprunte cinq cents francs. Au lieu de payer l’imprimeur, il place le tout en annonces. Quand Henry Monnier se rend au déjeuner convenu, la poste a déjà apporté une dizaine de mille francs aux fondateurs du Voleur. Le premier numéro paraît le 5 avril 1828. Six mois plus tard, il tire à deux mille cinq cents exemplaires, et rapporte net cinquante mille francs[171].
Pareil succès engendre des imitateurs : Émile de Girardin les absorbe, ou les écrase. Une annonce du 5 janvier 1829 avise les abonnés du Grec que ce journal cesse de paraître, et qu’ils recevront en son lieu et place le Voleur, sans aucune augmentation de prix, pendant toute la durée de leur abonnement. Le 10 avril suivant, même opération avec le journal l’Atlas. Quant au Forban, au Pirate, au Compilateur, ils végètent sans gloire.
Nous avons rencontré dans l’entourage de Sophie Gay la plupart des noms qui signent les articles du Voleur : Béranger, Vigny, Soumet, Émile Deschamps, Rességuier, Belmontet, Hugo, le comte Daru, Elisa Mercœur, Mme Tastu. Mais le journal ne publie pas uniquement de la reproduction ; il donne parfois de l’inédit, par exemple des vers de Marceline Desbordes-Valmore, les Deux Ramiers, ou d’Alexandre Dumas. Arsène Houssaye affirme que les rédacteurs

n’étaient pas payés : peut-être pas en argent, mais
ils recevaient des dédommagements, témoin ce billet
d’Émile de Girardin adressé à Alexandre Dumas,
au café Desmares, rue du Bac-Saint-Germain :
« Monsieur, le portrait pour lequel vous avez bien
voulu accorder quelques séances est terminé, et les
abonnés du Voleur le recevront le 30. Je serais
charmé de pouvoir en compléter l’envoi par un
article dont vous seriez l’objet, et auquel je serais
heureux d’ajouter tout le bien que je pense de l’auteur
d’Henri III, si l’ami que vous pourriez charger
de ce soin se bornait à un précis biographique.
Veuillez agréer, monsieur, l’expression de ma sincère
et haute admiration ». Tel est le début des
relations du grand publiciste et du grand romancier[172].
Le 31 mai 1828, le Voleur publie un article d’une colonne, signé d’un E., et consacré au dernier roman de Sophie Gay. « Il se manufacture à Paris tant de romans médiocres et détestables, qu’à moins de les lire tous, et quel supplice plus grand ! il est très difficile de distinguer dans la foule ceux de ces ouvrages dignes de l’intérêt des lecteurs éclairés qui savent apprécier le mérite et la difficulté de ce genre. C’est là notre excuse d’avoir attendu la deuxième édition de la nouvelle production de Mme Gay pour en parler : sans doute c’est déjà une recommandation qu’un nom connu par un grand nombre de succès ; mais depuis que le talent ne fonde plus de réputations que pour en faire des raisons de commerce écrites sur des couvertures, la célébrité de l’auteur est peut-être un motif de plus de se défier de la célébrité de l’ouvrage… Mme Gay a réussi, et si nous nous abstenons d’entrer dans plus de détails de son livre, c’est que nous ne voulons pas qu’elle puisse prendre un éloge pour une louange ! » Il semble que quelqu’un ait signalé à Émile de Girardin l’ouvrage en question, en le priant d’en parler. Le 28 juin, le Voleur publie une élégie de Sophie Gay, l’Inconstant ; le 10 juillet, un extrait inédit des Harmonies de Lamartine, précisément la Perte de l’Anio, que l’auteur envoya de Florence à Delphine Gay ; le 25 juillet, une poésie inédite d’Émile Deschamps. Ce ne sont sûrement pas là de simples coïncidences.
Le 20 décembre, le Voleur revient à la charge pour annoncer que Scribe termine un volume où il a reproduit « les situations neuves et dramatiques de l’intéressant roman de Théobald ». Le 15 et le 25, il annonce le recueil de vers de Delphine, le Dernier Jour de Pompéi, et cite un fragment. Le 30 janvier 1829, troisième citation extraite de ce même volume, avec un article de deux colonnes et demie où on lit : « La critique pourrait peut-être indiquer dans ces derniers vers plus d’imagination que de sensibilité ; mais heureusement nous n’avons pas à décider si Mlle Delphine Gay possède, selon l’expression de M. Victor Hugo, une âme complète de poète. Notre tâche s’arrête à signaler dans ses chants, en même temps qu’une pureté et une science très remarquable de la phrase poétique, une puissante faculté d’enthousiasme, et c’est par l’accord de ces deux qualités si distinctes que Mlle Delphine Gay conserve le surnom que lui a mérité la nationalité de son génie. » Le 5 mai, nous apprenons que MM. de Jouy et Antoine Béraud ont tiré de ce volume un livret de tragédie lyrique, que l’Opéra l’a reçu, et que Rossini doit en faire la musique.
Le 20 octobre, en annonçant que la duchesse de Berry accorde son patronage à la Mode, le Voleur se flatte d’avoir vu dans la livraison qui va paraître une romance inédite de Mlle Delphine Gay, le Pêcheur de Sorrente, musique de Mme Pauline Duchambge, et, dans son numéro suivant, le Voleur en publie le texte. Le 25 novembre, un curieux écho attire notre attention : « À l’une des dernières représentations du More de Venise, quelques sifflets ayant fait justice de ce que M. de Vigny appelle des vers, l’un des coryphées des nouvelles doctrines se leva, et avec un geste où se peignait toute son indignation : « Depuis quand les oies sifflent-elles ? — Depuis qu’elles écrivent ! » répondit une voix du parterre. » Pourquoi cette animosité contre Vigny ?
Voici l’année 1830 : le 10 janvier et le 25 février, deux articles paraissent au Voleur sur le nouveau roman de Sophie Gay, le Moqueur amoureux ; le 20, article et citation du poème de Delphine, le Bal des pauvres. Au mois de mai, des flèches contre Bourmont : « Ce qu’il y a de remarquable dans la proclamation de M. de Bourmont, c’est un superbe point d’exclamation après le mot : Soldats ! » Et celle-ci : « Parmi les conseils sanitaires donnés à nos soldats, l’article 7 leur enjoint « de ne pas boire d’eau de mare, sans la passer dans un mouchoir, pour éviter d’avaler les sangsues ». « S’il prenait envie aux requins d’avaler M. de Bourmont, ils sont priés de le passer dans un mouchoir. » On ne s’étonne pas que le Voleur publie le premier le poème de Delphine sur l’Expédition d’Alger. Après la révolution, il donne les Serments, et un peu après le Pêcheur d’Islande.
Il est dûment établi que le Voleur accorde aux dames Gay un traitement de faveur. La Mode va faire chorus. Et Émile de Girardin publie une romance, J’ai rêvé, que Massini met en musique et que les deux auteurs dédient à Mlle Delphine Gay. Émile de Girardin, nommé inspecteur des Beaux Arts par le ministère Martignac en 1828, avait eu, dès le printemps de 1829, l’idée d’une publication féminine, Corinne, pour laquelle il sollicite la collaboration de Marceline Desbordes-Valmore en lui envoyant un prospectus. Il n’est pas autrement question de la Corinne, mais l’idée se transforme : Girardin et son ami Lautour-Mézeray réussiront à mettre sur pied un nouveau périodique, la Mode, appelé à réussir. La marraine d’Émile, Mme de Varaignes, les aide dans leur entreprise. Elle leur présente Auger. Le libraire Levavasseur présente Balzac. Jules Janin, Eugène Sue doivent les soutenir. Sophie Gay s’y emploie activement. Le premier numéro paraît en octobre. Le 10 décembre, Émile de Girardin, reçu en audience particulière par la duchesse de Berry, lui soumet les livraisons de la Mode déjà parues, et publiées sous son auguste patronage : les armes de Madame, encadrées de gracieuses arabesques de Tonny Johannot, décorent la couverture.
Les principaux collaborateurs se nomment Jules Janin, Eugène Sue, Auger, Rességuier, Soumet, Charles Nodier, Elzéar de Sabran, Millevoye, Casimir Delavigne, Gavarni, Hugo, Balzac, Lamartine. On s’étonne que la Mode témoigne tant d’admiration au dernier, et attaque vigoureusement Hernani. Auger se plaît aux supercheries littéraires : il publie un article signé Alexandre III. Un soir, dans son salon, Sophie Gay en fait le plus vif éloge, mais l’attribue au comte Alexandre de Laborde.
— Mais, madame, je n’y suis pour rien, je vous assure, proteste M. de Laborde.
— Modestie, cher comte, c’est votre esprit, c’est votre manière !
Rien ne peut l’en faire démordre, cependant qu’Auger, témoin de la scène, s’amuse prodigieuse ment.
Pour elle et Delphine, la Mode, ouverte à leurs productions littéraires, ne le cède en rien au Voleur dans les éloges qu’elle leur décerne et le soin qu’elle prend de leur renommée[173]. Du fait de la Mode, Delphine devient l’héroïne d’une aventure, assez remarquable à la veille de la révolution de Juillet.
Le numéro du 11 décembre 1829 contient un article : « l’Assemblée législative de la mode », non signé. On s’amuse volontiers à des jeux de ce genre depuis que le féminisme s’avise de se montrer agressif ; le Miroir du 14 mars 1821, par exemple, contient une amusante fantaisie sur l’Académie des bonnes femmes de lettres. Ici, l’auteur suppose qu’une Chambre des représentants vient d’être nommée pour décréter les lois de la mode ; il profite de l’occasion pour railler quelque peu la vraie Chambre. La reine, c’est-à-dire la mode, assiste à la séance d’ouverture de la session ; le discours de la Couronne contient des allusions à celui qui vient d’être prononcé à la Chambre des députés. On nomme une commission de l’adresse et une autre des pétitions. On élit un bureau et une présidente. Pour la présidence, « toutes les espérances se seraient dirigées sur Mme la princesse de Ch[imay], quelques membres de la gauche assurant d’une manière positive qu’elle devait avoir vingt-cinq ans en thermidor an XI : on ajoute qu’à ce calcul une explosion subite de murmures se serait fait entendre et que le tumulte était à son comble, quand une lettre de Mme la princesse de Ch[imay], annonçant qu’une grossesse avancée l’empêchait de se rendre à ses devoirs, serait venue calmer les craintes ; on repousse Mme H[amelin] à gauche, la comtesse Du C[ayla] à droite ; quelques voix conciliatrices rap pellent les droits de Mme R[écamier], mais son âge est inférieur à celui de plusieurs des honorables membres, et elle a donné sa démission de la Mode pour se livrer dans une retraite absolue au culte des arts et de l’amitié ». Discussion. On décide alors qu’au lieu de choisir la plus âgée, on prendra la plus jeune : la question reste indécise entre M" de Béarn, de Beauvilliers, de La Panouse, et Cécile de Noailles ; cette dernière offre le fauteuil à Mlle Delphine Gay, motion accueillie avec les plus vifs transports. Après le départ de la reine, on décide le maintien du bureau provisoire. « Cette sage motion est adoptée : Mlle Delphine Gay, nommée présidente, prend possession du fauteuil et remercie l’Assemblée par une allocution où se trouvent réunis la puissance de son talent et le charme de son caractère. » Après quoi l’on décrète les manches courtes.
Que se passe-t-il ensuite ? Une lettre de Louise Smith, future baronne Georges de Vaufreland[174], à Louise Vernet nous l’apprend (20 décembre 1829) : « Que je voudrais donc savoir si vous êtes abonnés à la Mode ! En attendant, je vais te dire ce qui vient d’arriver aux rédacteurs du journal, parce que, de toutes manières, je crois que cela t’amusera. Dans le numéro qui a paru il y a eu hier huit jours, il y avait un article qui n’était pas du tout ce qu’il y a de plus clair, à ce que m’a dit maman, et dans lequel on fait M" Delphine Gay présidente de la mode ; elle avait pour secrétaire Mlle Cécile de Noailles, Mlle de Béarn, Mlle de Beauvillers et Mme de La Panouse. Beaucoup d’autres femmes de la société étaient nommées ; on se moquait beaucoup de Mme de Vernon, dame de la cour, âgée de plus quatre vingts ans ; il n’y avait personne qui ne fût scandalisé en voyant les noms de ces jeunes personnes imprimés dans un mauvais journal comme la Mode ; le prince de Mouchy en fut indigné ; il en parla à la duchesse de Berry, qui chercha à excuser les rédacteurs de la Mode ; il porta ses plaintes au roi qui a obligé la duchesse de Berry de retirer sa protection. Le numéro d’hier n’a pas encore paru ; nous en savons la raison ; il devait y avoir la continuation de l’article de samedi, mais ils n’ont pas eu la liberté de le faire paraître. »
Et en effet, dans le numéro suivant, le duc de Lévis retire à la Mode le patronage de la duchesse de Berry à cause de cet article, dont Auger se déclare l’auteur, article, dit le noble duc, « qui blesse toutes les convenances, non seulement en parodiant la plus auguste de nos institutions (!), mais en faisant jouer un rôle ridicule à des personnes de la haute société dont le nom ne devrait jamais être prononcé sans leur aveu ». À la suite de quoi, Delphine Gay refuse la présidence en une spirituelle poésie « À Mademoiselle ***», et Émile de Girardin et Lautour-Mézeray déclarent la Chambre dissoute.
Le Voleur du 31 juillet 1831 annoncera en trois lignes que le duc de Mouchy, ancien capitaine des gardes du corps, arrêté en Vendée, vient de passer à Versailles et à Sèvres entre deux gendarmes pistolet au poing[175].
La révolution de Juillet a triomphé. Aussitôt « la soif des places dévore toute la meute des anciens mécontents ». Émile de Girardin laisse passer le flot. Il attend jusqu’au 12 août pour écrire au géné ral Gérard, ministre de la Guerre. Il n’a encore que vingt-quatre ans ; il se contente de demander une décoration. Il détaille son rôle au cours des trois Glorieuses.
« Général, Votre réponse qui m’accorde une audience est arrivée trop tard, à mon extrême regret, pour que je puisse en profiter. Je n’ose pas vous importuner par une seconde demande.
» À présent que les solliciteurs les plus pressants doivent être satisfaits, je me décide à vous rappeler qu’après avoir assuré la défense de ma rue et de mon quartier, je fus l’un des premiers à cheval le mercredi 27 ; qu’après avoir exécuté déjà un ordre du général La Fayette, de retour j’accompagnai votre première sortie jusqu’à la place Vendôme, et je vous restai toujours activement attaché jusqu’au jeudi soir. Peut-être n’avez-vous pas oublié la proposition de Charles X que je fus chargé de vous transmettre vendredi 29 ?
» Ce dernier jour, après vous avoir quitté, j’exécutai une partie des ordres du général Pajol. L’un de mes chevaux a servi encore pendant ces trois jours à M. Larrant, directeur du Courrier électoral, que vous avez eu quelque temps près de vous.
» J’ai dû me retirer samedi, mon activité n’étant plus utile, et un service d’ordonnance plus régulier se trouvant établi.
» Je n’ai sollicité rien de mes amis dont quelques uns ont été appelés à des fonctions importantes, mais je suis informé qu’un certain nombre de croix seront distribuées, et j’ose en solliciter une ; j’ai mis tous mes efforts à la mériter, et ma vie à risquer ne me coûterait pas encore pour l’obtenir. » Arrêté deux fois, comme suspect, place de la Bourse et caserne de la Pépinière, mercredi 27, avant qu’on se fût décidé à signer aucun ordre ni dépêche, il m’a fallu défendre ma vie, et je l’aurais infailliblement perdue sans mon titre de neveu de Stanislas Girardin.
» Un homme du peuple nommé Dastuque, qui m’a sauvé à cette occasion, a été placé par M. le comte Alexandre de Laborde à ma recommandation pour ce fait.
» Je ne sollicite pas de place, général ; ma fortune actuelle est engagée dans plusieurs journaux qui ont toujours autant qu’il a été dans leur nature concouru aux derniers événements. Le Courrier des électeurs et l’Aigle dont je possède une partie ont signé tous les deux la protestation. La plus grande partie de la Mode et du Voleur m’appartient, ainsi qu’une partie de l’agence qui expédie aux cent journaux des départements tous les jours leurs nouvelles.
» Je n’insisterai pas une seconde fois, général ; je ne puis invoquer un meilleur témoignage que le vôtre ; je vous ai constamment servi le 27 et le 28 : un instant, général, vous m’avez témoigné une si grande bonté qu’elle me rassure sur le succès de cette démarche. Oh ! général, que vous pouvez inspirer de reconnaissance et de dévouement, et les temps sont encore assez gros d’événements pour que le dévouement d’un homme de mon activité et de mon âge ne soit pas à dédaigner ! »
Le dernier paragraphe porte coup. Il dénote l’assurance d’un homme qui sait ce qu’il vaut. Six semaines après, il vaut d’ailleurs un peu plus : il ajoute un nouveau journal à la liste de ceux qu’il possède déjà, et, toujours avec son ami Lautour-Mézeray, il demande à la reine son patronage, qu’elle accorde, pour le Garde national, « entreprise éminemment nationale »[176].
Il ne demeure plus dans une modeste chambre aux Champs-Elysées : il habite un appartement 20, rue du Helder, au coin de la rue Taitbout. Il possède au moins deux chevaux, sa lettre au général Gérard en fait foi. Il avait dit : « Pour surgir de l’obscurité il n’est qu’un moyen ; c’est de gratter la terre avec ses ongles si on n’a pas d’outil ; mais de la gratter jusqu’à ce qu’on ait arraché une mine de ses entrailles ». De cette mine, il a désormais découvert le filon.
Sa mise est élégante, irréprochable, sa taille petite, mais élancée et svelte, ses manières sont distinguées. Il a la main et le pied d’un homme racé. La figure est pâle, d’une pâleur nullement maladive, avec des traits fins, un regard spirituel, perçant, parfois dédaigneux, partant d’un œil auquel un petit trait donnait un caractère qui le faisait reconnaître à ne point s’y méprendre. La parole nette et l’accent ferme dénotent une intention bien arrêtée. D’une bravoure peu commune, d’un sang froid imperturbable, il dirige une volonté de fer vers le but qu’il s’est fixé. Le 20 février 1831, il va pour la quatrième fois sur le terrain. S’il montre de la fierté dans l’habitude de la vie, il charme dans l’intimité. Dès cette époque, il est journaliste dans l’âme. « Il est journal, il a toujours été journal, il mourra journal », a dit de lui Auger. Et Arsène Houssaye conte que, surpris une nuit par le coup de sonnette inhabituel du mari de la comtesse L… K…, dont il était l’amant, il s’écria désespéré :
— Ô mon Dieu ! Je suis sûr qu’on vient me chercher parce que les machines ont sauté !
Il est prudent de se méfier des anecdotes racontées par Arsène Houssaye ; si celle-ci n’est pas vraie, elle fait image, et l’image n’est sûrement pas fausse[177].
Émile de Girardin est affilié à la jeunesse dorée. Il fréquente chez Alfred Tattet, où il rencontre des financiers et des industriels qui se nomment Ternaux, les frères Mosselmann, Feray, Sallandrouze Lamornaix, Edouard Manuel, les frères Bocher, et dans un autre ordre d’idées des hommes comme Arvers, Musset, Guttinguer, Roger de Beauvoir, Achille Bouchet, Nestor Roqueplan, Alfred Arago, Florimond Levol, Romieu, Sainte-Beuve, d’Alton-Shée, le comte Germain.
Il devient l’hôte assidu du salon de Sophie Gay. Il se tient discrètement debout derrière le fauteuil de Delphine. Il la regarde sans cesse, lui parle bas ; elle détourne son beau visage pour lui répondre, ou lui sourire. Lamartine remarque ce manège : il demande à Sophie Gay quel est cet inconnu ; elle lui conte son histoire, et consulte le poète ami sur de vagues projets de mariage. Lamartine répond que ce jeune homme a « une de ces physionomies qui percent les ténèbres et qui domptent les hasards ».
Une nature aussi noble que celle de Delphine devait donner son estime à l’homme qui, né sans nom et sans fortune, avait su à vingt-cinq ans illustrer l’un et conquérir l’autre, plutôt qu’à l’un de ceux qui, nés avec un nom et une fortune, ne savent ni faire briller le nom, ni même conserver la fortune. Elle compose à Villiers, en 1831, une élégie intitulée Mathilde, dont le sujet lui est fourni, dit une note de bas de page, « par une nouvelle intitulée Émile, publiée il y a plusieurs années ». Mathilde, on se le rappelle, est le nom de l’héroïne à laquelle Émile confie le résultat de ses méditations. Dans son élégie, Delphine résume l’histoire d’Émile de Girardin ; il paraît difficile de le faire avec plus de précision. Puis elle avoue :
Je le vis. — Des plus fiers l’estime l’honorait…
Que j’aimai ce front calme, et ce cœur agité…
Au monde avec courage il dérobait ses pleurs ;
Moi, je les devinai sous sa fierté frivole ;
Je dis : « l’amour coupable a causé ces malheurs :
« Oh ! qu’un amour pur le console ! »…
Et mon cœur fut à lui !… Par mes soins assidus,
D’un père il retrouva la tendresse ravie :
Maintenant je les vois l’un à l’autre rendus…
Dès lors, ce billet de Sophie Allart, — qui s’amuse à signer : Mademoselle (sauf i !!) — daté de Paris le 22 mai 1831, et envoyé à Rome à Louise Vernet, n’a plus rien qui nous surprenne :
« Delphine décidément se marie le 1er juin, avec Émile de Girardin, reconnu[178], doté, aimé, poétisé. Je vous écrirai s’il y a noce et vous ferai un beau récit sur la Muse qui ne veut pas rester vieille fille comme les neuf sœurs. Faon est un peu petit et maigre pour sa belle moitié ; il y avait sympathie plutôt avec (ici, la main prudente de la destinataire a discrètement pratiqué un trou dans le papier). Je souhaite cependant que Sapho soit heureuse, et je pense que vous faites avec moi des vœux pour cette bonne personne. »
On célèbre le mariage à l’église Saint-Roch, le 1er juin 1831. Les témoins du marié sont le lieutenant général Charles-Joseph, comte de Pully, grand officier de la Légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis, chevalier de la Couronne de fer, âgé de quatre-vingt-un ans, et Marie-François-Joseph Maxime Cromot, baron du Bourg, maréchal de camp, chevalier de la Légion d’honneur, âgé de soixante quinze ans. Ce dernier est le père de M" de Varaignes, la marraine d’Émile. Les témoins de la mariée sont Paul-Laurent de Nérac, propriétaire, soixante sept ans, et Antoine-Xavier-Catherine Froidefont de Bellisle, cinquante-cinq ans, membre de la Chambre des députés, et conseiller d’État. Le marié signe Émile Girardin, d’une petite écriture ronde, ferme et droite ; la mariée signe d’une écriture menue et penchée, et ajoute un paraphe assez compliqué, que simplifiera bien vite la correspondance active de Mme de Girardin. La cérémonie terminée, en dépit de la pluie qui tombe, le jeune couple monte en voiture et file vers la Maison Rouge[179].
Huit jours après la cérémonie, le 9 juin, Chateaubriand écrit à Mme Récamier ces quatre mots « Delphine mariée : ô Muses ! »[180].
Le mariage n’empêchera pas la Muse de chanter.TABLE DES NOMS DE PERSONNES
Abrantès (Laure de Saint Martin Permont, duchesse d’), 28, 211, 212, 225, 267, 268.
Agoult (Marie de Flavigny, comtesse d’), pseud. Daniel Stern, 201, 223, 224.
Alberg (Duc d’), voir Dalberg.
Alhoy (Maurice), 298.
Aligre (Famille d’), 118.
Allart de Méritens (Hortense), 28, 38, 124, 126, 127, 215, 293.
Allart (Marie-Françoise Gay, Mme), 37, 38.
Allart (Nicolas-Gabriel}, 38, 112.
Allart(Sophie), voir Gabriac.
Alletz, 169.
Allix (Mlle), 117.
Alopéus (Comte David d’), 126.
Alton-Shée (Edmond, comte d’), 315.
Alvimare (Martin-Pierre d’), 29, 89, 91.
Ampère, 167, 225, 263.
Ancelot (J.-A.-F. Polycarpe), 141, 186, 188, 227.
Ancelot (Marguerite-Virginie Chardon, Mme), 139, 141, 142, 223, 227, 235.
Andrieux, 138.
Anglemont (Édouard d’), 192, 270.
Angoulême (Marie-Thérèse-Charlotte, duchesse d’), 210.
Annibal, 239.
Antiochus, 91.
Apelle, 211.
Appiani (Andréa), 92.
Apponyi (Comte Rodolphe), 6, 262.
Apponyi (Comtesse), 260.
Arago (Alfred), 134, 314.
Arc (Jeanne D’), 214, 216.
Arenberg (Duc D’), 65.
Aristote, 55.
Arlincourt (Charles-Victor Prévôt, Vicomte d’), 225.
Arnal (Etienne), 11. Arnaud (F.-T.-M. De Baculard D’), 104.
Arnault (Antoine-Vincent), 38, 92, 93.
Arnim (Baron D’), 223.
Artois (Comte D’), V. Charles X.
Arvers (Félix), 314.
Auber, 148, 268.
Aubusson de La Feuillade, 68.
Audenarde (Mme d’), 290.
Audibert, 142.
Auger (Hippolyte), 117, 122 126, 142, 178, 179,306,307, 310, 314.
Auger (Louis-Simon), 142 193.
Auguste, Prince de Prusse, 124, 136, 218.
Aure (d’), 88.
Bachsa, Voir Bochsa.
Bajac (Jenny), 200.
Balbini, 138.
Balk, 128.
Ballanche (Pierre-Simon ). 137, 167,226, 227, 263, 264.
Balzac (Honoré de), 1, 6, 139, 140, 148, 152, 267, 268, 306, 307.
Baour-Lormian, 112, 142, 188.
Barante (Baron de), 134, 263.
Barante (Baronne de), 263.
Barante (Mlle de), 263.
Barral (Mme de), 89.
Barras (P.-F.-J.-N., comte de), 34.
Barrot (Odilon), 180.
Barthélemy, 85, 86.
Bassano (H.-B. Maret, duc de), 81, 82, 83, 92, 275.
Bawr (Sophie Coury de Champ Grand, baronne de), 93, 139, 142.
Bayard, 255.
Béarn (Mlle de), 319.
Beaufort (Mme de), 41.
Beauharnais (Alexandre, Vicomte de), 32.
Beauharnais (Eugène de), 34.
Beauharnais (Joséphine Tascher de La Pagerie, Vicomtesse de), Voir Joséphine.
Beaumont (M.-A. La Bonninière, comte de), 68.
Beauplan (Amédée Rousseau de), 254.
Beauvilliers (Mlle de), 309.
Beauvoir (Roger de), 141, 314, Beer (Michel), 142. Belmontet (Louis), 188, 190. 200, 268, 269, 302.
Béranger (J.-P. de), 144, 145, 146, 270, 302.
Béraud (Antoine), 305.
Berlioz (Hector), 11.
Bernadotte (Mme), reine de Suède, 167.
Berry (Caroline, duchesse de), 305, 306, 307, 310.
Bert (P.-N.), 155.
Berthier, Voir Wagram.
Berthon, 116.
Bertin L’aîné, 139, 143.
Bertin de Vaux, 139, 143, 225.
Bétourné (A.), 8.
Bertrand (H.-G., Général, comte), 127.
Bertrand (comtesse), 127, 166.
Bétont (Mme), 181.
Beugnot (Jean-Claude, Comte), 84.
Biré (Edmond), 157, 170.
Blanc, 294.
Blangini (J.-M.-F.), 29, 117.
Blin, 294.
Blondel de La Rougerie (Mme), 116.
Blottepière de Viéville, 18, 22, 52.
Bocher, 253, 314.
Bociisa (R.-N.-C.), 8.
Boïeldieu. 91, 123.
Boigne (Charlotte d’osmond, Comtesse de), 225, 260, 265.
Boileau, 127.
Bonaparte (Mme), voir Joséphine.
Bonaparte (Lœtitia), 84.
Bonaparte (Louis), 84.
Bonaparte (Prince Louis), Voir Napoléon III.
Bonaparte (Napoléon), Voir Napoléon Ier.
Bonaparte (Pauline), 29, 84, 87, 91.
Bonjour (Casimir), 142.
Bonne (Mme), 50.
Bonnemaison, 87.
Bordeaux (Duc De), 210.
Borghèse (Princesse), Voir Bonaparte (Pauline).
Bossuet, 199.
Boubers (comte de), 283.
Boucher de Perthes (Jacques), 240.
Bouchet (Achille), 314.
Boufflers (Stanislas, Chevalier de), 19, 52, 54, 62, 89, 105, 111.
Bourdic-Viot (Mme), 188.
Bourgoing (Marie-Thérèse-Étiennette), 209.
Bourmont (Victor, comte de Ghaisne de), 286, 288, 305, 306.
Boursault (J.-F.), 97.
Bracke (Colonel), 253.
Brantome, 87.
Brifaut (Charles), 134, 188, 259, 275.
Briquet (Marguerite-Ursule Fortunée Bernier, Mme), 50.
Brisay (Mme De), 20.
Brocard (A.), 301.
Broglie (Duc De), 89, 92, 179, 263.
Broglie (A.-J.-G. de Staël, duchesse De), 129, 283.
Bruix (Eustache, Amiral), 79.
Buchon, 148.
Buffault, 118, 119.
Byron (Lord), 131, 163, 189, 251, 252.
Cabarrus (Docteur), 297.
Cabarrus (Thérésia), Voir Chimay.
Campan (Mme), 252. Campenon, 142. Canclaux (J.-B.-C., Général, Comte), 102, 177. Canclaux (Joseph De), 102, 105, 177.
Canclaux (Aglaé Liottier, Mm° De), 21, 51, 94, 102, 105. 174, 177.
Candeille (P.-J.), 19. Canel (Urbain), 228. Canova (Antoine), 191, 263. Capo D’istria, 203.
Caprara (Cardinal), 93. Caraman (Mme Victor De), 290.
Castellane (Jules, Comte De), 7.
Castries (Duchesse De), 268. Catalani (Mme), 127. Catelan, 225. Catelan (Mmº), 225. Catellan, 167. Caylus (M.-M. De Vilette, Mal’ Quis De), 61. Celles (Antoine-Charles-Fia Cre. Comte De Wisher De . 250.
Céré-Barbé (Hortense), 188. César, 239. Chabod, 37. 21
Chabrol de Crousol (Comte) 245.
Chaptal (J.-A.), Comte de Chanteloup, 92.
Charlemagne, 15, 68, 71, 72, 80, 84, 144, 172.
Charles VII, 214.
Charles X, 208, 214, 232, 280, et Sa Mère
Choiseul (Duc de), 89, 175.
Chopin (Frédéric), 6.
Chopin (Isabelle), 6.
Cicéri (P.-L.-C.), 87, 93, 148.
Clarke (Miss), 225.
Clavier (Etienne), 93.
Clément (Mme), 50.
Clérambault (comtesse de), 237.
288, 291, 311.
Charles Le Gros, 252.
Charles, Prince de Prusse,
Chauvet, 169.
Clozel, 82.
Colbert (Auguste, Général, comte de), 92.
Colbert (Comtesse de), 68.
Colin d’harleville, 41, 42.
Collière (Lucienne), 192.
Colomb (Avocat Général), 145.
Colomb (Romain), 240.
Condé (Prince de), 109.
Condorcet (M.-L.-S. de Grou
Chy, Marquise de), 46.
Constant de Rebecque (Benjamin), 47,48, 49, 89, 92, 94, 111, 116, 124, 144, 145, 14S, 151, 220.
Contat (Amalric), fille de Chazet (Alissan de), 60.
Chemin (MºE), 50.
Chênedollé (C.-J. Lioult de),
Contat (Emilie), Louise, 94.
114.
Chasles (Philarète), 62, 267.
Chastenay (Louise-Marie-Victorine, comtesse de), 259, 260, 266.
Chateaubriand (Vicomte de), 89, 96, 97, 98, 99, 131, 135, 136, 143, 148, 149, 166, 171, 184, 187, 189, 193, 209, 225, 228, 240, 258, 262, 264, 299, 317.
Chateaubriand (Vicomtesse de), 150.
Chénier (André), 35.
Chénier (Marie-Joseph), 34, 35, 38, 47, 48, 49, 52, 53, 93.
Chimay (Joseph, Comte de Caraman, Prince de), 76, 91, 93.
Chimay (Thérésia Cabarrus, Princesse de), 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 75, 76, 89, 93, 101, 116, 144, 149, 150, 153, 297, 308.
Choisel, 296.
Louise, 94. sœur de
Contat (Louise), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 89.
Conti (Prince de), 53.
Corneille (Pierre), 199.
Corvisart (J.-N., Baron), 80.
Coulmann, 145, 146, 147, 152, 162, 174, 178, 179, 180, 183, 184, 218, 234, 280, 282.
Coupigny (A.-F. de), 88.
Courbonne (Mme de), 148.
Courcelles (Mme de), 47.
Courchamps (Marie), 50.
Courier (Paul-Louis), 148. Cousin (Victor), 263.
Cousineau (P.-J.), 8.
Delécluze (Étienne-Jean), 201,
Crescentini (Girolamo), 89,
226, 227. Delille (Abbé Jacques), 299. Della Maria (Dominique), 89.
138.
Crété, 66, 78.
Custine (Delphine de Sabran, Marquise de), 15, 89, 143, 144, 148, 166.
Custine (Astolphe, Marquis de), 144, 148, 290.
Cuvier (Georges), 134, 138, 223, 278.
Czartorisky (Prince), 253.
Delmar (Charles), 179. Delprat (Edouard), 237. Denys (Mme), 58. Désauges (Mmes), 298. Désauges, 298. Desbordes-Valmore (Marce Line), 137, 154, 188, 228, 235, 236, 239, 258, 289, 302, 306.
Dalayrac (Nicolas d’aleyrac, Dit), 89. Dalberg (Duc de), 175. Dalton (Baron), 101. Dalvimare, Voir d’alvimare.
Damoreau (Mme), 149. Dante, 263. Darel, 297.
-
Deschamps (Antony), 170, 190, 249.
Deschamps 148, 155, 190, 199, Deschamps
-
(Emile), 6, 142, 170, 186, 187, 188, 250, 302, 304. (Jean-Marie), 68,
73. -
Deschamps
de
Saint-Amand
Daru (P.-A.-N. Bruno, Comte), 73, 97, 192, 217, 228, 275,
(Jacques), 170. Desfaucherets (J.-B. Brousse),
276, 278, 302. Dastuque, 312.
Deshoulières (Mme), 154.
42.
Daunou, 134. David (Emeric), 121. David (Louis), 124, 138. David (Paul), 225. David d’angers, 207, 257,
258, 263. Decazes (Elie, Duc), 116, 125, 281, 282, 283. Decazes (Baronne), 223. Decrès (Denis, Amiral), 79. Dejermont
Des
Chapelières
(Comte), 100. Delacroix (Eugène), 139, 223. Delaitre, 116.
Delavigne (Casimir), 144, 163, 164, 165, 251, 255, 307. Delavigne (Germain), 144.
Desjardins, 187. Desprez, 141.
Desroches (Mme), 50. Détroyat (Mme Léonce), 114, 207.
Deux-Ponts (Duchesse De), 109. Devéria, 267. Didot (Mme), 200. Doria (Princesse), 248, 249. Doudeauville (Ambroise, Duc De), 220, 225, 231, 263. Droz (F.-X.-J), 275. Dubarry (Comtesse), 118, 119. Du Bellay (Joachim), 256. Dubois, 252, 263. Du Bourg (M.-F.-J.-M. Cro Mot, Baron), 317.
-
324
Une Muse
Dubuc de Saint-Olympe (Mº), 116.
Du Cayla (Mme), 139, 308. Duchambge(Pauline), 237, 250, 305.
Duchesnois (Catherine-José Phine Raffin, Dite Mº), 89, 147, 156, 157. Ducis (Jean-François), 75, 93,
Et Sa Mère
Enlart (Euphémie Liottier, Mme F.-M.), 22, 52, 112, 113, 118.
Enlart
(François-Maurice),
· 103, 112, 121. Epicure, 135. Erambert, 25. Etienne, Voir Jouy. Eugénie (Impératrice), 299.
138.
Ducis (Louis), 210. Dufrénoy (Adélaïde-Gilette), 154, 161, 188, 192, 271. Dugas-Montbel (Jean - Bap Tiste), 226, 227, 263. Dugazon (Mme), 148. Dumas, 25. Dumas (Alexandre), 6, 73, 148, 220, 266, 302, 303. Dumesnil (Alexis), 298. Dupaty (Emmanuel), 43, 88,
Fétis, 116, 120. Flamanville (Mme de), 50. Flavigny (Mme de), 223.
144, 145, 147, 148. Dupin Aîné, 220.
Fleury, 94. Florence, 44, 45.
Duplan, 25, 70.
Foix (Gaston de), 255. Fonfrède (J.-B. Boyer), 30, 70. Fonfrède (Mme), 28, 30, 33. Fontanes (Mme de), 263. Fontenay (Marquis de), 76. Fontenay (Marquise de), Voir Chimay (Princesse de).
Duplay, 176.
Dupuy, 296. Dupuy(Adélaïde-Marie Fagnan, Mme), 296. Duras (Duchesse de), 18, 133, 134, 199, 203,209, 217, 219, 221, 222,230, 231, 259, 262. Duroc (Michel), Duc de Frioul, Duval (Alexandre). 42, 73, 78, · 88, 91, 112, 115, 148, 155,
Fabre d’églantine, 42. Fain (Baron), 108. Fauré, 245, 246. Feletz (Abbé de), 187, 283. Fénelon, 187, 283.
Féray, 314. Féret, 226.
Forbin (L.-N.-P.-A., comte de), 89, 139, 146, 167, 225.
Formont, 116.
Fouché, 175.
Duval (Amaury), 148.
Duvernois (Frédéric), 89, 91.
Fourcroy (A.-F. de), 92. Fournier-Sarlovèze(François, Baron), 28. Foy (Maximilien - Sébastien, Général), 144, 219, 257, 266.
Eckermann (J.-P.), 230. Elleviou (Jean), 48, 89, 148.
Fraissinous (Abbé de), 156. Franceschi (Général), 67, 70,
169, 172, 183, 209.
285.
Franceschi (Mme), 70. Frantin, 142. Frédéric Ier (Empereur), 15. Frénilly, 134.
Froidefont de Bellisle (A.-X. C.), 102, 112, 163, 164, 175, 270, 288, 317.
Fuentès (Comte de), 92. Fuhler (Colonel), 67, 68. Fuhrt (Baronne de), 70. Furstenstein (Comtesse de), 116.
Gabriac, 38.
Gabriac (Sophie Allart, Mme), 38, 316. Ga Con-D U Four (Marie-Ar Mande-Jeanne), 50. Gaete (Gaudin, Duc de), 93, 101.
Et Sa Mère
325
Gauzargues (Chanoine), 71. Gavarni (Sulpice - Guillaume Chevalier, Dit), 307. Gay (Anne-Sophie), 37. Gay (Edmond), 181. Gay (François), 37. Gay (Jean-Sigismond), 14, 15, 36, 37, 38, 49, 64, 100, 103, 107, 118, 124, 180. Gay (Joseph), 37. Gay (Louise-Marie), 37. Gay (Marie-Adélaïde), 37. Gay (Marie-Françoise), Voir Allart.
-
Gay (Marie - Claudine - Louise Galy, Mme Joseph), 37.
Gay (Marie-Françoise-Sophie Nichault de Lavalette, Mme). Gay (Victoire), 37. Gayot, 99. Gayrard, 142. Genlis (Stéphanie-Félicité Comtesse de), 55, 56, 59, 60, 95, 107, 164, 283. Geoffrin (Mme), 53. Georges (Marguerite-Georges Weymer, Dite Mlle), 45, 46, -
Gail, 113. Gail (Sophie Garre, Mme), 89, 113, 114, 116, 121, 125, 126, 127, 181. Galbois (Colonel Victor de), 109, 110.
Gallemand (Mme de), 142. Garat (Dominique-Joseph),25, 29, 48, 73, 88, 92, 114, 138. Garay de Monglave (F.-E.), 284.
Garcia, 122. Garnier, 25. Garre(Bernardine-Isaure Gay, Mme), 113, 117, 123,126, 173, 181.
Garre (Edme-Sophie), Voir Sophie Gail. Garre (Louis-Théodore), 181. Gaultier-Laguionie, 192. Gautier (Théophile), 18, 204, 286.
178.
Gérando (Baron de), 167. Gérard (François, Baron), 91, 92, 93, 124, 128, 134, 136, 137, 139, 143, 148, 167, 207, 208, 223, 224, 227, 228, 255, 257, 259, 263, 267.
Gérard (Mme), 138. Gérard (Etienne-Maurice, Ma Réchal, Comte), 311, 313. Géraud (Edmond), 154, 200, 289.
Gercourt (Mme de), Voir Mme de Genlis.
Géricault, 138.
Grisi (Giulia), 138.
Germain (Auguste-Jean-Ger Main, Comte de Montfort, Dit Le Comte), 89, 315. Germond (Mme), 70.
Groix, 64.
Gibus, 294.
Ginestous (Mme de), 16. Girardin (de), 263. Girardin (Alexandre - Louis Robert, Comte de) 296, 298, 316.
Girardin (Comtesse de), 297.
Girardin (delphine-Gabrielle Gay, Mº Emile de). Girardin (Emile de). Girardin ( Ernest - Stanislas, , Comte de), 312. Girardin (Fernand-Jacques, Marquis de), 316. Girardin (René-Louis, Mar Quis de), 296. Girardin (Stanislas-Charles, Marquis de), 41, 316. Girodet, 146, 147, 148. Gluck, 19.
Godefroy (Mlle), 134, 136, 138. Goethe, 107, 172,173,230, 258. Goffin, 90.
Goltz (A.-F.-G., Comte Von der), 20. Gontaut Saint-Blancard (Mar Quis de), 41. Gramont (Duchesse de), 201, 225, 263. Grassini (Joséphine), 91, 93, 138.
Grécourt (Mme de), 89, 94. Grégoire (Abbé), 37. Greuze (J.-B.), 296. Grévedon (P.-L.-H.), 8. Grimod de La Reynière, 120, 234.
Gros (Antoine-Jean, Baron), 148, 210, 211, 212, 285. Grouchy (Emmanuel, Maré Chal Marquis de), 104, 148. Gudin (Théodore), 138, 263. Guérin, 139.
Guiche (Duchesse de), 244, 255. Guiraud, 170.
Guiraud (Alexandre), 142, 148, 163, 170, 186, 187, 189, 198, 199, 234, 250.
Guizard, 225. Guttinguer (Ulric), 314.
Hadot(Marie-Adélaïde Richard,
Mme Barthélemy), 50. Hainguerlot, 25, 26.
Hainguerlot (Mme), 85. Hamelin (Antoine-Marie-Ro Main), 25. Hamelin (J.-G.-F. Lormier Lagrave, Mme), 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 92, 97, 98, 99, 308. Hamilton (Duchesse), 223. Hardenberg (Prince de), 223. Harent, 64.
Harent (Claude), 15. Harville (Général d’), 68, 69, 78.
Haussonville (Comte d’), 259, 260.
-
Hautpoul (Mme d’), 225. Heilly (d’), 232. Heim, 139. Herbault, 76, 292. Hersent (Louis), 148, 200, 201, 204, 207, 208, 209, 227, 286. Hittorff (J. I.), 214.
Hoche (Lazare, Général), 34. Homère, 172, 269.
Horace, 198. Hortense (Reine), 84, 85, 171, 183, 248, 250, 251, 252,254. Houssaye (Arsène), 302, 314. Hugo (Victor), 1, 2, 6, 8, 9,
327
Dit de), 88, 145, 146, 147, 148, 186, 212, 305. Judith, 138. Junot (Mme) Voir Duchesse d’abrantès.
Jussieu, 263.
10, 142, 148, 156, 157, 187,
Kératry (Auguste-Hilarion de), 198, 214, 220, 234,286, 290, 302, 304, 307. Hugo (Mme Victor), 142, 156.
Hullin, 24. Hulot (Letienne, Général Ba Ron), 95.
220.
-
Kisselef (Comtesse), 97. Klopstock, 262.
Koreff (Docteur Jean-Ferdi Nand), 222, 223. Krudener (Baron de), 179.
Humboldt, 134, 139, 144, 146, 223, 225.
Hutchinson (Mme), 116, 148.
Ibrahim, 218.
Labarre (Antoinette, Dite An Tonia Lambert, Mmº), 1 À 13. Labarre (Théodore), 6, 8. Laberge (Docteur).
Impérani, 19.
Lablache, 138.
Ingres (J.-A.-D.), 237. Irène (Impératrice), 80. Isabey (J.-B.), 73, 87, 93, 115, 148, 183, 252.
Laborde(Comte Alexandre de), 134, 307, 312. Laborde (Comtesse de), 262. La Bourdonnais-Blossac (Ar Thur, Marquis de), 298. Lacan (Mme de), 116. Lacaux (Mme de), 101.
Jacob, 79. Jacobi, 66.
Jacobi-Trigny (Général), 67. Jacquemont (Victor), 223.
Lacretelle, 142, 143. Ladoucette (Jean-Charles François), 100.
Jal, 140.
Lafayette (Marquis de), 145,
Janin (Jules), 6, 148, 306, 307. Jaucourt (Marquis de), 41. Jaucourt (Marquise de), 41. Johannot (Tony), 141. Joséphine (Impératrice), 30, 32, 35, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 150, 251. Jouin, 258.
Jouy (Victor-Joseph-Étienne,
311.
Lafon (Pierre), 162, 261, 263, 264.
La Fontaine (Jean de), 244, 299.
Lafontaine (Mme), 50. Lage (Marquise de), 16. Lagrange (Armand-Charles Louis Lelièvre, G . Comte de), 259, 260, 293. Lagrange (Adélaïde-Blaise François Lelièvre, Général, Marquis de Fourille Et de), 239, 259. Lais (François Lays, Dit), 119.
La Touche (Hyacinthe Thabaud de), 148, 149, 155, 165, 188, 193, 194, 195, 196, 225, 263, 265, 267, 285, 291, 298.
Lautour-Mézeray, 298, 301, 306, 310, 313.
La Maisonfort, 244.
Lamartine (Alphonse de), 1, 6, 10, 11, 131, 140, 148, 149, 151, 167, 185,214, 239, 242, 243, 244, 248, 251, 255, 263, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 290,291, 295, 298, 299, 304, 307, 315. Lamballe (Princesse de), 16.
La Trémoille (Princesse de), 130.
Lavalette (Antoinette-Fran Çoise Péretti, Mme Nichault de), 17. Lavalette (Augustin-François Nichault de), 17. La Valette (A.-N. Chamans, Comte de), 116.
Lamennais, 156.
Lameth (Alexandre de), 19, 85, 86, 99, 100, 112, 121, 128, 220. Lameth (Théodore de), 28. Lamoignon, 89.
Lamothe-Langon, 142.
La Vallière (Louise de), 210. Laval-Montmorencv (Duc de). 89, 225, 240, 245, 246, 255. La Ville, 142. Laya, 168, 169.
Le Bas (Philippe), 171, 248. Lebrun (Pierre), 50, 225, 263.
Lancret, 119, 158.
Lamy (Franck), 10. Lange (Anne-Françoise-Elisa Beth), 25. Lannes (Mme), 68. La Panouse (Mlle de), 309. La Réveillère-Lépeaux (Louis
278.
-
Marie de), 34. La
Rochefoucauld (Duchesse
de), 68, 78. La
Rochefoucauld-Doudeau
Ville, Voir Doudeauville. La Rochefoucauld (François, Duc de), 24. La Rochefoucauld (Olivier de), 245.
La
Le Brun (Mme), Voir
Vigée
Lebrun.
Leclerc (Général V.-E.), 89. Leduc Saint-Germain, 148. Lefèvre-Deumier (Jules), 143, 188.
Legend’re, 93.
Legouvé (G.-M.-J.-B.), 41, 43, 93.
Legouvé (M"E), 41. Legris-Duval (Abbé), 187. Lejay (Mme), 116. Lejeune (Général), 146. Lemaire, 142.
Rociiefoucauld (Vicomte de), 225. Larrant, 311.
Lemontey, 16, 142, 148.
Larrey, 147.
Lenoir, 88.
Las Cases (Marquise de), 16.
Lenormant (Charles), 225.
Lemercier (Népomucène), 42, 75, 88, 138, 148. Lenormant (Amélie Cyvoct, Mme), 200, 225, 264. Lépine (Jules), 148. Leprince de Beaumont (Mme), 18.
Leroi, 76. Leroy (Sébastien), 105. Léry (Duc de), 89. Lescot (Mme), 258. Letronne (J.-A.), 223.
Levavasseur, 306. Leverd (Jeanne-Emilie), 156, 205.
Lévesque (Mmº), 50. Levis (Duc de), 310. Lhéritier (F.), 155. Ligny (Jean de), 21. Lincoln (Comtesse), 223. Lindsay (Mme), 96. Liottier (Emma-Sophie), 22, 39.
Liottier (Gaspard), 21. Liottier (Jean), 21. Liottier (Marie-Marguerite de Ligny, Mme G.), 21. Liszt (Frantz), 147. Littré, 3. Livry (Marquis de), 31. Longchamps (Charles de), 88, 145.
Longuerue (Colonel), 146. Louis Xiii, 118. Louis Xiv, 43, 63, 280.
329
Luçay (Comtesse de), 68. Lysimaque, 93.
Mac Carthy (Comtesse), 109. Mac Donald (Mºº), 65. Machiavel, 244. Magalon, 184.
Magnin (Charles), 225. Maillat-Garat, 47. Maillé de La Tour-Landry
(Charles-François-Armand, Duc de), 159.
Maillé (Blanche-Joséphine Le Bascle d’argenteuil, duchesse de), 159, 162. Maillé
de
La
Tour-Landry
(Maison de), 159, 234. Maison (Général), 175. Maistre (Xavier de), 299. Malibran (Mme), 138, 143, 290. Malitourne, 168.
Mallarmé (Mme), 50. Malzar (André de), 102.
Manuel (Édouard), 144, 149, 314.
Marcadé, 294. Marcellus (Vicomtesse de), 245.
Mareste (Baron de), 139. Maret, Voir Bassano.
Louis Xvi, 50, 129, 211.
Marie-Amélie (Reine), 219. Marie-Antoinette (Reine), 150. Marie-Louise (Impératrice), 103, 210.
Louis Xviii, 155, 209, 210,
Marmont,
Louis Xv, 63, 131.
297.
Louis-Philippe, 50, 141, 147, 316.
Lourdoueix (Honoré de), 230. Louvel, 145. Lovenich (Baronne de), 70.
Duc
de
Raguse
(Maréchal), 134, 142. Mars (Mlle), 41, 89, 94, 205, 209.
Martignac (Vicomte de), 306. Martin (Baryton), 117, 122, 155. Mascarier (Mme), 95. Massini, 306.
Matignon (Comtesse de). 131. Méchin (Alexandre-Edme, Ba Ron), 66, 144, 263. Méchin (Mme), 70. Méhul, 19, 75, 89. Mély-Janin, 142, 172. Ménessier (Mme), 140, 157. Mennechet, 142, 168. Menou (Comtesse de), 245.
Mercoeur (Elisa), 225, 302. Mérimée (Prosper), 141, 220, 223, 263.
Merlet (Gustave), 100. Merlin (Comtesse), 17, 93. Méry, 148. Meyerbeer, 142, 1 48. Michelot, 154. Millevoye, 307.
Millin (Aubin-Louis), 92.
de), 137, 167, 225,226,227, 228, 277, 285. Montozon, 86.
Montrond (Comte Casimir de), 28, 97, 298. Moreau Le Jeune, 183. Moreau (La Maréchale), 167. Mortier (Maréchal), Duc de Trévise, 80.
Moskowa
(Napoléon-Joseph,
Prince de), 253. Mosselmann, 314. Mouchy (Duc de), 310. Mouton, Comte Lobau (Géné Ral), 80. Mouton (Henri), 116. Mozart, 71. Murat (Caroline), 88. Musset (Alfred de), 1, 6, 10. 50, 314.
Musson, 26, 88, 90.
Mirabeau, 116.
Mirbel (Mme Lisinska de), 139. Mirecourt (Eugène Jacquot, Dit de), 259, 260.
Mohl (Jules), 225. Molé (Comte), 134. Molière, 59, 212.
Monglave (Eugène de), 298. Monnier (Henry), 301, 302. Montalivet (Comte de), 116, 210.
Napoléon Ier, 16, 30, 31, 33, 34, 64, 71, 74, 79, 80, 81, 83, 96, 98, 108, 109, 127, 128, 143, 151, 166, 175, 197, 210, 239, 255. Napoléon Ii, 210.
Napoléon Iii, 8, 141, 171,248, 251.
Montanclos (Mme de), 50. " Montcalm (Marquise de), 130, 260.
Narbonne (Comte Louis de), 41, 44.
Nérac (Paul-Laurent de), 289,
Montguyon (Comte de), 112. Motholon (Comte de), 65, 115. Montholon (Mme de), 65. Mont Losier (Comte de), 225. Montmorency (Connétable de), 255.
Montmorency
Nadermann, 8.
(Mathieu, Duc
317.
Nérac (Mme de), 289. Nerval (Gérard-Labrunie, Dit de), 286. Nicolo, 116.
Noailles (Cécile de), 309. Noailles (Comtesse de), 262. Nodier (Charles), 139, 140, 142, 157, 178, 186, 188, 237, 307. Nodier (Mme), 140. Nodier (Marie), Voir Mme Mé Nessier.
Northumberland (Duc de), 214. Norvins (J. Marquet de Mont Breton, Baron de), 20,88, 90,
Odier (Auguste), 147. O’donnel (Elisa-Louise Gay, Comtesse), 112, 116, 144, 163, 164, 165, 178, 255, 267. O’donnel (Gustave), 195. O’donnel (Jean-Louis-Barthé Lemy, Comte), 112, 288. Orléans (Duc d’), 290. Orléans (Duchesse d’) Voir Marie-Amélie.
Othon Iii (Empereur), 15, 71, 81.
331
Péretti (Félix), Voir Sixte Quint. Périgord (Mme de), 227. Perregaux (Comte), 24, 89. Petit (Mme), 45. Pfiffer, 66.
Picard (Louis-Benoît), 73, 77, 78, 82, 169. Piccini, 19, 88.
Pichald (Michel Pichat, Dit), 142, 148, 169, 186, 188, 234. Pignatelli (Alphonse), 92. Piton (E.-Constant), 284. Planche (Gustave), 200. Poix (Princesse de), 131. Polastron (Mme de), 208. Pons (Gaspard de), 142, 188. Pontécoulant (Louis-Gustave Doulcet, Comte de), 86, 103, 112, 148, 174, 175, 281. Pontécoulant (Comtesse de),
-
116.
Ouvrard (Jules), 25, 30, 75, 76, 297.
Potocka (Comtesse 243, 247, 250.
Paér (Ferdinand), 86, 155, 156.
Pougens (C.-M.-J., Chevalier de), 52, 55. Pradier, 227. Pradt (Abbé de), 139. Prony (G.-C.-F.-M. Riche, Ba Ron de), 115, 116. Pully, (Lieutenant-Général Charles-Joseph, Comte de),
Anna),
Pozzo Di Borgo, 128, 134, 139.
Pajol (Général Comte), 311. Panat (Chevalier de), 47. Parny, 41, 43, 44, 46.
Parny (Mme de), Voir Louise Contat.
Parseval de Grandmaison, 142, 143, 167, 225, 235.
Pascal (Blaise), 199.
316.
Pasquier (Etienne, Duc), 225, 263.
Pasta (Judith), 11, 138. Patin, 168, 169. Paul, 135.
Pavie (Victor), 286. Peat (Miss), 38. Pelleport (Mme), 89.
Quesnard (Mme), 50. Rabbe (Alphonse), 298. Raciiel, 10, 11. Racine (Jean), 17, 147, 161, 199. Radcliffe (Anne), 37. Raffaneau (M.-A.-C.), 15. Ranson de Montrob, 118.
Raphael, 269. Rauzan (Duchesse de), 221, 223.
Raymond, 168.
Rohan (Abbé de), 156. Roland, 171.
Rome (Roi de), Voir Napoléon Ii. Romieu (Auguste), 315. Roqueplan (Louis-Victor-Nes Tor), 314. Rossini, 138, 149.
Réal (Guillaume-André), 100. Récamier (Juliette Bernard, Mme), 8, 25, 28, 80, 92, 124, 126, 135, 137, 148, 167, 171, 218, 224, 225, 226, 227, 253, 263, 290, 291, 308, 317.
Rousseau (J.-J.), 296, 299. Rovigo (Savary, Duc de), 96,97. Royer-Collard, 277, 278. Rubini, 138.
Regnard, 122.
Sabran (Elzéar de), 307.
Regnault de Saint-Jean d’an
Sade (Marquis de), 76.
Gély, 38, 91, 103, 111. Regnault de Saint-Jean d’an
Gély (Mme), 28, 85, 89, 91, 92, 95, 97, 98. Rémusat, 82, 134, 225, 263. Renaud, 71.
Rességuier (Comte Jules de), 6, 142, 148, 212, 250, 268, 269, 291, 302, 307. Rey, 25.
Riccoboni (Mme), 191 . Richelieu (Duc de), 127, 130. Richer (Mlle), 117. Richer, 19.
Rigny (Amiral de), 291. Rivals (Rémond), 102. | Robert (Jean). 119. Robespierre, 35, 75.
| Rochefort, 143. Rochette (Désiré-Raoul, Dit Raoul-), 142, 145. Roger, 71, 170. · Roger (A.), 225. Roger (Albine), 115. Roger (Baronne Lydie), 115, 116.
Roger Du Nord, 115.
Saint-Aignan (Comte de), 139. Saint-Hilaire (Mme de), 76. Saintine, 142, 168, 169. Saint-Just (Sans Doute Godard d’aucourt, Dit de), 43. Saint-Leu (Duchesse de), Voir Reine Hortense.
Saint-Marc-Girardin (Marc Girardin, Dit), 225, 263. Saint-Priest (Alexis de), 259, 266.
Saint-Priest (Vicomtesse de), 290.
Saint-Prosper, 18S. Saint-Valry, 142, 187, 190. Saint-Venant (Mme de), 50. Sainte-Aulaire (Comte de), 225, 263.
Sainte-Aulaire (Comtesse de), 225.
Sainte-Aulaire (Mlle de), 225. Sainte-Beuve, 15, 36, 50, 51, 53, 106, 133, 137, 189, 272, 315.
Sakosky, 294. Salaberry (Ch.-M. d’irum Berry, Comte de), 58.
Sallandrouze-Lamornaix, 314.
Salm (Comtesse de Princesse de), 283. Salvandy, 117, 151.
Théis,
Sampayo, 127.
Sand (George), 50, 291. Sanguszko (Princesse), 247. Sapho, 154.
Sarrazin (Mme), 50. Savary, Voir Rovigo. Schmidt-Mayer, 180.
Schnetz (Victor), 138,207, 257. Scott (Walter), 184. Scribe (Eugène), 8, 73, 148, 304.
Scudéry (Mlle de), 164. Sébastiani (Général, Comte Horace), 218. Séché (Léon), 232. Seguin, 225. Ségur (Joseph-Alexandre, Vi Comte de), 19, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 58, 62, 89, 154. Ségur (Général, Comte Philippe de), 168, 193, 275.
Semonville (Marquis de), 65, 112.
Semonville (Marquise de), 65, 70.
Senonnes, 297 Senonnes (Mme de), 297. Sévigné (Marquise de), 166, 280.
Sgricci, 227. Siéyès (Abbé), 47. Sixte-Quint, 204. Smith (George), 309. Solms (Mme de), 232. Sommery (Mme de), 50. Soulès (Mme de), 41. Soumet (Alexandre), 89, 116,
333
148, 149, 156, 157, 161, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 186, 187, 188, 189, 250, 302, 307.
Sparre (Lieutenant-Général, Comte de), 112. Spontini, 89. Stael (Baronne de), 28, 44, 62, 63, 81,92, 107, 112, 113,
124, 130, 133, 136, 151, 179, 199, 205, 207, 224, 249. Stael (Baron de), 44, 113. Staub, 294.
Steibelt (Daniel), 19, 20. Stendhal, 133, 139, 223, 240, 243, 246.
Stern (Daniel), Voir Comtesse d’agoult. Sterne (Laurence), 299. Stuart (Chevalier), 134. Sue (Eugène), 50, 148, 306, 307.
Talaru (Marquise de), 129. Talleyrand, Prince de Béné
Vent (Charles-Maurice de), 28, 134, 214, 223. Tallien, 33.
Tallien (Mme), Voir Princesse de Chimay. Talma, 38, 40, 44, 89, 91, 92,
116, 148, 151, 186, 225, 226,de 248.
Talma (Mme), 40, 47. Tamburini, 138.
Tardieu (Ambroise), 183, 186. Tasse (Le), 251. Tastu (J.), 228, 231. Tastu (Sabine-Casémire-Ama Ble), 188, 216, 225, 275, 302.
Tattet (Alfred), 314. TAYLoR (Baron), 263.
TERNAUx aîné, 219, 314.
THÉMINEs (Mme de), 210.
THÉVENIN, 227.
THIERs (Adolphe), 148, 149, 150, 239, 277, 278, 294.
ToRLoNIA (Prince), 247.
ToURGUENIEFF, 225.
TRÉNITz, 24, 30, 73.
TUFIAKIN, 167, 225.
TURENNE (Maréchal, vicomte de), 74.
TURENNE, 65, 74.
TURENNE (Mme de), 65, 70, 74.
VERNET (Mme Horace), 207.
VERNET (Louise), 309, 316.
VERNON (Mme de), 309.
VÉRON (Docteur), 141.
VICToR-AMÉDÉE II, roi de Sardaigne, 37.
VIGÉE (L.-J.-B.-S.), 40, 41, 44, 45
VIGÉE-LEBRUN (Mme), 40, 41, 44, 92, 143, 240.
VIGNY (Alfred de), 1, 142, 148, 149, 187, 198, 234, 235, 236, 237, 238, 249, 250, 293, 302, 305.
VIGNY (Mme de), mère, 236, 237.
VALENCE (Comtesse de), 245.
VALERY (Antoine-Claude-Pasquin), 263.
VALMALÉTA, 31.
VALMoRE, 188, 238.
VANNoz (Mme de), 50.
VARAIGNES (Mlle du Bourg, Mme de), 297, 306, 317.
VASSAL, 115.
VAToUT (Jean), 116, 125, 147, 148, 163, 164, 165, 207.
VATRY (Mme de), 290.
VAUDEY (Baronne de), 68, 72.
VAUDREUIL (Mme de), 290.
VAUFRELAND (Baron Georges de), 309
VAUFRELAND (Louise Smith, baronne de), 309.
VAUFRELAND (Ludovic de), 309.
VERDIER (Suzanne Allut, Mme), 188
VERGENNES, 19.
VERNET (Carle), 207.
VERNET (Horace), 138, 148, 163, 183, 207, 210, 257.
VILLÈLE (Joseph, comte de), 134, 281.
VILLEMAIN, 125, 134, 148, 151, 161, 168, 203, 217, 219, 222, 225, 263, 275, 279, 280, 281, 282, 283.
VILLoUTREIX, 65.
VIoTTI, 29.
VoIART (Mme), 258.
VoIART (Mlle), voir Mme Tastu.
VoLTAIRE, 17, 58, 93, 135, 154.
WAGNER (Richard), 11.
WAGRAM (Alexandre Berthier, maréchal, prince de), 141.
WALDoR (Mélanie), 142.
WALSH (Comte Théodore), 188.
WELLINGTON (Duc de), 136.
WoLowSKI, 223.
WURTEMBERG (Catherine de). 247.
WURTEMBERG (Duc de), 144.
ZINGARELLI (Nicolo), 89.
TABLE DES PLANCHES
TABLE DES MATIÈRES
privée où l’on évoque le passé. — Picard, auteur et directeur, manque d’à-propos. — Alexandre Duval est introduit dans le cercle de l’impératrice par Sophie Gay. — Il lit le Tyran domestique. — Arrivée de Napoléon. — Une verte réplique de Sophie Gay, que l’empereur n’intimide pas. — Maret et les petits soupers de son hôtesse. — Le salon de Sophie Gay à Paris. — Ceux de Mme Regnault de Saint-Jean d’Angély, de Talma, de la princesse de Chimay. — Comédie chez Mlle Contat. —
L’incendie de l’ambassade d’Autriche (1810). — Sophie Gay, mondaine toujours en ébullition, auteur et mère de famille. — Les protectrices de Chateaubriand ; la reconnaissance de René. — Le préfet Ladoucette se venge d’un mot de la femme en faisant priver le mari de sa recette générale (1812)
- ↑ Miniature appartenant à Mme L. Détroyat.
- ↑ Acte de naissance dans Manecy : Une Famille de Savoie, Aix-les-Bains, 1904, in-8° p. 60. — Testament de Sophie Gay du 20 janvier 1847. Arch. Franchet d’Esperey.
- ↑ D. Stern : Mes Souvenirs, Paris, 1880, in-12, p. 308. — Sainte-Beuve : Causeries du lundi, Paris, 1852, III, p. 298. — Aix-la-Chapelle, Borcette et Spa, Manuel à l’usage des baigneurs, Aix-la-Chapelle et Leipzig, 1834, in-12.
- ↑ Turquan : les Femmes de l’émigration, Paris, 1912, deux volumes in-8°, I, p. 109-173.
- ↑ On trouve aussi l’orthographe Michault, mais sur l’acte de baptême de Sophie, Michault a été corrigé en Nichault.
- ↑ Sainte-Beuve : Lundis, III, p. 297.
- ↑ Sophie Gay : Laure d’Estell, Paris, 1802, in-8o, p. 82.
- ↑ Notes manuscrites de Sainte-Beuve : collection Spoelberch de Lovenjoul, à Chantilly, qui sera désormais désignée : Lov., D, 1992, fol. 49. — Sainte-Beuve : Lundis, VI, p. 53 et s.
- ↑ A. Bardoux : la Duchesse de Duras, Paris, 1898, in-8o, p. 45.
- ↑ Th. Gautier : Portraits contemporains, Paris, 1874, in-12, p. 20.
- ↑ Ibid., p. 31.
- ↑ Sophie Gay : Salons célèbres, Paris, 1837, in-8°, p. 241.
- ↑ J. de Norvins : Souvenirs d’un historien de Napoléon, mémorial, Paris, 1896. trois volumes in-8°, l, p. 171.— Fétis : Biographie universelle des musiciens. — Sainte-Beuve : Lundis, VI, p. 54.
- ↑ Sainte-Beuve : Lundis, VI, p. 53.
- ↑ Turquan : Napoléon amoureux, Paris, sans date, in-12, p. 153.
- ↑ Les renseignements d’état civil sont tirés des actes de l’état civil, des registres de catholicité, et des archives de la famille Enlart.
- ↑ Sophie Gay : Madame Hamelin, art. nécrol. du Constitutionnel, 8 mai 1851.
- ↑ Sophie Gay : les Malheurs d’un amant heureux, Paris, 1823, trois volumes, I. p. 159.
- ↑ Sophie Gay : Madame Hamelin, dans le Constitutionnel, 8 mai 1851.
- ↑ Arsène Houssaye : les Femmes du temps passé, Paris, 1863, in-4o, p. 428. — Edm. et J. de Goncourt : Histoire de la société française sous le Directoire, Paris, 1864, in-12, passim.
- ↑ Arch. Préf. de Pol. : Rapports du commissaire détaché à la Bourse.
- ↑ H. Bouchot : le Luxe français sous l’Empire, Paris, 1882, in-18, p. 5. — H. Fleischmann : Dessous de princesses et maréchales d’Empire, Paris, 1909, in-16, p. 59.
- ↑ Sophie Gay : Constitutionnel, 8 mai 1851, et les Malheurs d’un amant heureux, I, p. 34, 159. — Turquan : Madame Récamier, Paris, sans date, in-16, p. 53. — Niel : Notice sur Garat, le célèbre chanteur, dans Mém. de la Société d’émulation de Cambrai, t. XVII, p. 90. — Henri Monnier : Mémoires de M. Joseph Prudhomme, Paris, 1857, p.263.
- ↑ Sophie Gay : les Malheurs d’un amant heureux, passim, et Salons célèbres, p. 110. — Edm. et J. de Goncourt : Histoire de la société française sous le Directoire, passim.
- ↑ Sophie Gay : les Malheurs d’un amant heureux, III, p. 115.
- ↑ Escudier : la France musicale, Paris, 1855-1856, p. 110. — H. Fleischmann : Dessous de princesses et de maréchales d’Empire, p. 132. — F. Blangini : Souvenirs, Paris, 1834, in-8°, p. 349.
- ↑ Sophie Gay : Constitutionnel, 8 mai 1851 ; Salons célèbres, p. 266 ; les Malheurs d’un amant heureux, I, p. 166. — Marquiset : Une merveilleuse, Madame Hamelin, Paris, 1909, in-8°, p. 99. — Turquan. la Citoyenne Tallien, Paris, sans date, in-8°. — Journal de Paris, an X, iv, p. 1949.
- ↑ Sophie Gay : les Malheurs d’un amant heureux, I, p. 166-171, et Ellénore, Paris, 1844-1846, quatre volumes in-8° (Introduction).
- ↑ Notes manuscrites de Sainte-Beuve. Lov., D, 1992, f° 137.
- ↑ Marie-Françoise, née en 1765 ; Anne-Sophie, en 1766 ; Jean-Sigismond, en 1768 ; Victoire, en 1770 ; Marie-Adélaïde, en 1771 ; Louise-Marie, en 1774. — Manecy : Une famille de Savoie, Aix-les-Bains, 1904 in-8°.
- ↑ A. Beaunier : Trois amies de Chateaubriand, Paris, 1910, in-12, p. 229, 317. — P. de Saman : les Enchantements de Prudence, Paris, 1877, in-18, p. 7.
- ↑ Bibl. nat., ms., n. a. fr., 21.536, f. 71.
- ↑ Voici la liste des enfants de Sophie Gay : Aglaé, née le 6 décembre 1793, mariée le 20 septembre 1813 à Joseph de Canclaux, consul de France à Nice ; Euphémie, née le 21 septembre 1795, mariée le 15 février 1817 à François-Maurice Enlart, président du tribunal de Montreuil-sur-Mer ; Emma-Sophie, née le 2 avril 1798, morte en janvier 1803 ; Delphine-Gabrielle, née le 26 janvier 1804, mariée le 1er juin 1831 à Émile de Girardin ; Bernardine-Isaure, née le 4 avril 1805, mariée le 5 juin 1837 à Louis-Théodore Garre ; Edmond, né le 18 décembre 1807, tué près de Constantine le 11 mai 1842. De plus, Sophie Gay a adopté une fille de son mari, Elisa-Louise, née le 16 mars 1800, mariée le 15 avril 1817 au comte Jean-Louis-Barthélemy O’Donnell, maître des requêtes au Conseil du roi.
- ↑ Arnault : Souvenirs d’un sexagénaire, Paris, 1833, quatre volumes in-8°, I, 309.
- ↑ Jouy : l’Hermite de la Chaussée d’Antin, Paris, 1814, cinq volumes, in-12, III, 43.
- ↑ Sophie Gay : Salons célèbres, p. 69.
- ↑ Mlle Georges : Mémoires inédits, publiés par P.-A. Chéramy, Paris, 1908, in-18, p 168.
- ↑ Comte J. d’Estourmel : Derniers souvenirs, Paris, 1860, p.285. — Arnault : Souvenirs d’un sexagénaire, II, 166.
- ↑ Sophie Gay : Salons célèbres, p. 78, et Ellénore (Introduction). — L. Labat : Liste des arrestations, transfèrements, élargissements de 1790 à 1795, ms., Arch. Préf. de Pol.
- ↑ Marquiset : les Bas-Bleus du premier Empire, Paris, 1913, in-8o, p. 3. — Sainte-Beuve : Lundis, VI, 68. — Sophie Gay : les Malheurs d’un amant heureux, I, 256, et Causeries du monde, II 69.
- ↑ Lepeintre : Suite du répertoire du Théâtre-Français, Paris, 1823, L, 177. — Lov., 2038, f° 46. — Sainte-Beuve : Lundis, VI, 52. — Testament de Sophie Gay, arch. Franchet d’Esperey.
- ↑ Vicomte de Ségur : Œuvres diverses, Paris, 1819, in-18, p. 22.
- ↑ Journal de Paris, an X, III, 1432.
- ↑ Sophie Gay : Laure d’Estell, p. 68, 83, 89, 112.
- ↑ Alissan de Chazet : Mémoires, Souvenirs, Œuvres et Portraits, Paris, 1837, trois volumes in-8o, II1, 77, 433.
- ↑
Le vicomte de Ségur.
- ↑
Le chevalier de Boufflers.
- ↑ Journal de Paris, an XI, p.574, 683, 777. — Biographie universelle et portative des contemporains, Paris, 1834, cinq volumes in-8°, II, p. 1833. — Sainte-Beuve : Portraits de femmes, Paris, sans date, in-8°, p. 133 ; et Lundis, VI, 54.
- ↑ Manery : Une famille de Savoie, p. 25. — Moniteur, 20 floréal an XI 10 mai 1803).
- ↑ Arch. nat., Fic, III, Roër, 4. — Moniteur, an XII, p. 1413, 1429, 1438, 1460, 1482, 1491, 1522, 1548, 1556 ; an XIII, p. 70. — Sophie Gay : Salons célèbres, p. 255 et suiv.
- ↑ Fleischmann : Dessous de princesses et maréchales d’Empire, p. 36.
- ↑ Fleischmann : Dessous de princesses et maréchales d’Empire, p.58.
- ↑ Baronne de V[audey] : Souvenirs du Directoire et de l’Empire, Paris, 1848, in-8°, p. 47.
- ↑ Edm. Taigny : Isabey, sa vie et ses œuvres, extr. Revue européenne, Paris, 1859, in-8°, p. 22.
- ↑ Sainte-Beuve : Lundis, IX, 442.
- ↑ L’adjudant qui commanda le feu s’appelait Pelé ; le lieutenant, Noirot. — Nougarède de Fayet : le Duc d’Enghien, Paris, sans date, in-18, p. 201.
- ↑ Lairtullier : les Femmes célèbres de 1789 à 1795 et leur influence pendant la Révolution, Paris, 1840, deux volumes in-8°. — Marquis de Sade : Zoloé et ses deux acolytes, Paris, 1800, in-12.
- ↑ Baronne de V[audey] : Souvenirs du Directoire et de l’Empire, p. 64.
- ↑ Baron Fain : Mémoires, Paris, 1908, in-8o, annexe 2.
- ↑ Docteur Max Billard : le Squelette du bras droit de Charlemagne, extr. de l’Asepsie, avril 1909.
- ↑ Th. Gautier : Portraits contemporains, p. 22.25.
- ↑ Baronne de V[audey] Souvenirs du Directoire et de l’Empire, p. 47. — Moniteur, an XIII, p. 70. — Alissan de Chazet : Memoires, III, 41.
- ↑ Arch. nat., Fte, III, Roër, 4. — Sophie Gay : Un mariage sous l’Empire, Paris, 1832, deux volumes in-8°, I, 130. — Turquan : les Sœurs de Napoléon, Paris, 1896, in-18, p. 288. — Fleischmann : Dessous de princesses et de maréchales d’Empire, p. 35.
- ↑ Barthélemy : Souvenirs d’un ancien préfet, 1787 à 1848, Paris, 1886, in-18, p. 38.
- ↑ J.-J. Coulmann : Réminiscences, Paris, 1862-1869, trois volumes in-8°, I, 327. — Portrait appartenant à la famille de Canclaux.
- ↑ Sophie Gay : Un Mariage sous l’Empire, II, 160.
- ↑ J. de Norvins : Mémorial, III, 298. — Th. Gautier : Portraits contemporains, p. 20 et suiv. — Jacques Boulenger : Marceline Desbordes-Valmore, Paris, sans date, in-18, p. 62. — Arnault : Souvenirs d’un sexagénaire, IV, 302. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française (1823-1827), Paris, 1909, in-18, p. 22. — Duchesse d’Abrantès : Histoire des salons de Paris, Paris, 1837-1838, six volumes in-8o, V, 363. — Edm. Biré : l’Année 1817, Paris, 1895, in-8o, p. 338. — Baron Honoré Duveyrier : Anecdotes historiques, Paris, 1907, in-8o, p. 231. — Alissan de Chazet : Mémoires, III, 92. — Philarète Chasles : Mémoires, Paris, 1876-1877, deux volumes in-18, I, 297.
- ↑ Le portrait de Gérard est au Louvre ; celui d’Appiani à Versailles.
- ↑ Rapporté par Mme Détroyat.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 179. — Mme Vigée Lebrun : Souvenirs, Paris, 1835, deux volumes in-8o, I, 100. — P. de Saman : les Enchantements de Prudence, p. 10. — Duchesse d’Abrantès : Histoire des salons de Paris, VI, 363. — Turquan : les Sœurs de Napoléon, p.268.
- ↑ Brifaut : Souvenirs d’un académicien, introduction par le Dr Cabanès, Paris, sans date, deux volumes in 8°, I, 93.
- ↑ Gazette de France, 1er avril 1843.
- ↑ S. Gay : Salons célèbres, p. 49.
- ↑ Lettre de Sophie Gay à Mme de Grécourt, 8 juillet 1810, arch. Du Manoir de Juaye. — L. Grasilier : l’Incendie de l’hôtel de l’ambassade d’Autriche, extr. le Vieux Montmartre, fasc. 79, 1913-1918, p. 263-295.
- ↑ Lettre de Sophie Gay à Euphémie Liottier, 11 juillet 1909, arch. Enlart.
- ↑ Chateaubriand : Mémoires d’outre-tombe, édition Biré, III, 50.
- ↑ Constitutionnel, 1er août 1811. — Presse, 14 août 1811. — Gayot : Fortunée Hamelin (une ancienne muscadine), Lettres inédites (1839-1851), Paris, sans date, in-8°, p.16, 22, 301-305. — Marquiset : Une merveilleuse, p. 148. — Chateaubriand : Mémoires d’outre-tombe, III, 50, note de Biré.
- ↑ Arch. nat., F1b, Roër, 3 ; A Fiv, Décrets, plaquette 4375 ; A Fr, 5573 no 12. — Moniteur, 27 décembre 1812, p. 1423. — De Lanzac de Laborie : la Rive gauche du Rhin, dans Revue hebdomadaire, 11 janvier 1919, p. 164. — Mme de Solms : Madame de Girardin, Bruxelles, 1837, in-12, p. 7. — Lettre de Mme Allart, dans Manecy, Une famille de Savoie, p. 30. — Lettre de Sophie Gay à la princesse de Chimay, arch. Détroyat.
- ↑ Lettre de Sophie Gay à Euphémie Liottier, 14 novembre 1814, arch. Enlart. — Arch. nat., Ftc, lll, Roër, 3 et 4.
- ↑ S. Gay : Salons célèbres, p. 23.
- ↑
Sainte-Beuve : Lundis, VI, 52. — Lov., D, 2058, f. 46.
- ↑ Lettre de Sigismond Gay à Delphine Gay, 31 août 1821, Arch. Détroyat. — Coulmann : Réminiscences, II, 114.
- ↑ Manecy : Une famille de Savoie, p. 29. — Th. Gautier : Portraits contemporains, p. 28.
- ↑ Lettres d’Amélie de X… à Victor de Galbois, et lettre de Sophie Gay à X…, communiquées par M. Léonce Grasilier.
- ↑ Lettre de Sophie Gay au comte [Regnault de Saint-Jean d’Angély], 15 janvier 1815, arch. Détroyat.
- ↑ Arch. Enlart. — Poésie autogr. à la fin du Chansonnier dédié aux dames pour l’année 1815, exemplaire appartenant à Mlle Enlart.
- ↑ Edm. Biré : l’Année 1817, p. 243, citant un article de S. Gay sur Mme de Staël dans le Plutarque français, édit. par Mennechet, Paris, 1847, in-8o, ill., VI, 255. — Comte Molé : Mémoires, dans Revue de Paris, 15 décembre 1923, p. 732.
- ↑ Lettre de S. Gay à Euphémie Enlart, 18 août 1817, arch. Enlart.
- ↑ Sophie Gail, née le 28 août 1775, morte le 24 juillet 1819.
- ↑ Ed. et J. de Goncourt : Histoire de la société française sous le Directoire, p. 414. — Mme de Bawr : Souvenirs, Paris, 1853, in-8°, p. 304. — Fétis : Biographie universelle des musiciens, art. Gail. — Edm. Taigny : Isabey, sa vie et son œuvre, p. 43.
- ↑ Hipp. Auger ; Mémoires, dans Revue rétrospective, p. 149 (1891). — Lettre de S. Gay à Euphémie Enlart, 18 août 1827, arch. Enlart. — Lettre de S. Gay à Delphine, 5 mars 1816, arch. Détroyat. — Mme de Girardin : Œuvres (r.d. Plon), I, 139-147. Lettres parisiennes (Éd. Michel-Lévy), II, 28. — Blangini : Souvenirs, p. viii.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 327. — Lettres de Sigismond Gay à Delphine, sans date, et 5 mars 1816, arch. Détroyat. L’adresse porte : La Maison Rouge, par Linas, Seine-et-Oise. — Titres de propriété de la Maison Rouge, arch. Ernault. — Ch. Vatel : Histoire de Madame Du Barry, Versailles, 1883, trois volumes in-18, II, 295.
- ↑ Lettre de Sigismond Gay à Sophie Gay, 1816, arch. Détroyat. — Pinard : Histoire, Archéologie, Biographie de Longjumeau, Paris, 1864, in-8°, p. 333.
- ↑ Lettre de S. Gay à Euphémie Eulart, 18 août 1817, arch. Eulart. — Hipp. Auger : Mémoires, p. 149 et s.
- ↑ Hipp. Auger : Mémoires, p. 149. — La Quotidienne, 3 avril 1818. — Clément et Pierre Larousse : Dictionnaire des opéras, mis à jour par Pougin, Paris, sans date, in-8o, art. « Sérénade ».
- ↑ Lettre de Sophie Gay à Euphémie Enlart, 27 juin 1818, arch. Enlart.
- ↑ P. de Saman, les Enchantements de Prudence, p. 234. — L. Séché : Hortense Allart dans ses rapports avec Chateaubriand, Paris, 1908, in-8o, p. 45. — Manecy, Une Famille de Savoie, p. 17.
- ↑ Ed. Herriot : Madame Récamier, Paris, 1904, deux volumes in-8o. II, p. 55. — Turquan ; Madame Récamier, p. 113. — Lettres de Sophie Gay, dans L. Séché : Muses romantiques, Delphine Gay (Mme de Girardin) dans ses rapports avec Lamartine, etc., Paris, 1910, in-8o, p. 16, 33.
- ↑ Lettre de Sophie Gay à Mme Récamier, 15 octobre 1818, arch. Détroyat. — Baron de Barante : Souvenirs, Paris, 1890-1899, sept volumes in-8o, II, 339. — A. de Vaulabelle : Histoire des deux Restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe, Paris, 1860, huit volumes in-8o, IV, 491. — L. Séché, Hortense Allart, p. 45. — Fétis : Biographie universelle des musiciens.
- ↑ Sainte-Beuve : Lundis, III, 299. — A. Bardoux : la Duchesse de Duras, p. 2. — Coulmann : Réminiscences, l, 189. — Mme de Staël : Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, Paris, 1814, trois volumes in-8o, III, 101. — Mme Ancelot : les Salons de Paris. Foyers éteints, Paris, 1858, in-18, p. 147. — La Mode, I, 154. — Journal de la duchesse de Broglie, dans : duc de Broglie : Souvenirs (1785-1870), Paris, 1886, quatre volumes in-8o, II, 121. — Bouchot : le Luxe français sous la Restauration (1815-1818), p. 6. — Delécluze : Souvenirs de soixante années, Paris, 1862, in-18, p. 294, 307. — Ch.-M. Desgranges : la Comédie et les Mœurs sous la Restauration et la monarchie de juillet (1815-1848), Paris, 1904, in-8o, p. 6. — A. Houssaye : les Confessions, Paris, 1885-1891, six volumes in-8o, I, 377. — Amélie Cyvoct : Journal, dans Revue des Deux-Mondes, 1er décembre 1922, p. 5, 13.
- ↑ Villemain : Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature, Paris, 1854, in-8o, p. 455. — Daniel Stern : Mes Souvenirs, p. 289. — Sainte-Beuve : Portraits de femmes, p. 62. — Mme de Boigne, née d’Osmond : Récits d’une tante. Mémoires, Paris, 1907, quatre volumes in-8o, III, 3, 13.
- ↑ Ch.-M. Desgranges : la Comédie et les Mœurs, p. 26. — Villemain : Souvenirs contemporains, p. 155.
- ↑ Ce portrait orna le salon de l’Abbaye-aux-Bois ; à sa vue, Thémistocle Canaris, enfant, apercevant le turban légendaire, s’écria en lui montrant le poing : « Oh ! le vilain méchant Turc ! » Il est aujourd’hui au musée de Versailles. Il est la copie d’un original, peint par le baron Gérard lui-même.
- ↑ A. Bardoux : la Duchesse de Duras, p. 45. — Bouchot : le Luxe français sous la Restauration, p. 119. — Mme de Boigne : Mémoires, III, 199. — Stendhal : Correspondance (1800-1842), publ. par Paupe et Chéramy, Paris, 1908, trois volumes in-8o, Lettre au baron de Mareste, II, 192. — Maréchal Marmont, duc de Raguse : Mémoires de 1792 à 1841, Paris, 1857, neuf volumes in-8o, VII, 206. — Sainte-Beuve : Portraits de femmes, p. 62. — Jal : Souvenirs d’un homme de lettres (1795-1873), Paris, 1877, in-12, p. 254. — Villemain : Souvenirs contemporains, p. 460. — Legouvé : Soixante ans de souvenirs, Paris, 1886-1887, deux volumes in-8o, II, 332. — Vicomte de Beaumont-Vassy : les Salons de Paris sous Louis-Philippe, Paris, in-18, p. 93. — Le Rivarol de 1842, Paris, 1842, in-12, p. 38.
- ↑ Marceline Desbordes-Valmore : Correspondance intime, publiée par Benjamin Rivière, Paris, 1896, deux volumes in-8°, I, 44. — Beaumont-Vassy : Salons de Paris, p. 85, 93. — Comtesse de Bassanville : les Salons d’autrefois, Paris, 1863, quatre volumes in-18, II, 240. — Bouchot : le Luxe français sous la Restauration, p. 116. — Mme Cavaignac : Mémoires d’une inconnue (1780-1816, Paris, 1894, in-8°, p. 113. — Sainte-Beuve : Correspondance, I, 130 et Lundis, I, 434. — Turquan : Madame Récamier, p. 274. — A. Houssaye : les Confessions, II, 304. —- Magasin pittoresque, 1860, t. XVIII, p. 268.
- ↑ Mme de Bawr : Souvenirs, p. 102. — Mme Ancelot : les Salons de Paris, p. 45, 63. — Delécluze : Souvenirs de soixante ans, p. 294. — Amélie Cyvoct (Mme Lenormant) : Journal, dans Revue des Deux-Mondes, 1er décembre 1922, p. 513. — Charles Blanc : Histoire des peintres de toutes les écoles, école française, Paris, 1865, in-4o, p. 50.
- ↑ Tony Johannot : Une soirée d’artistes, eau-forte. — M. Salomon : le Salon de l’Arsenal, dans Revue de Paris, 1906, V, p. 313. — Mme Ancelot : les Salons de Paris, p. 303. — Jal : Souvenirs d’un homme de lettres, p.546. — André Pavie : Médaillons romantiques, Paris, 1909, in-8°, p.3.— Le Rivarol de 1842, p. 138. — Balzac : Correspondance (1819-1850), Paris, 1877, deux volumes in-18, I, 91.
- ↑ Les autres personnages sont : Baour-Lormian, La Mothe-Langon, Lemaire, Gayrard et sa femme, Mély-Janin, Lemontey, Auger et sa femme, Mme de Gallemand, Casimir Bonjour, Lacretelle et sa femme, Frantin, Campenon, Marmont, Victor Hugo et sa femme, Saint-Valry, Audibert, Raoul Rochette, Saintine, Soumet, Guiraud, Emile Des champs, Mme de Bawr, Mennechet et sa femme, Alfred de Vigny Gaspard de Pons, de La Ville, Pichat, Michel Beer frère de Meyerbeer, Jules de Rességuier, le lecteur, et les maîtres de maison.
- ↑ Jacques Boulenger : Sous Louis-Philippe, les Dandys, Paris, 1907, in-8°, p. 156. — Auger : Mémoires, p. 421. — Docteur Véron : Mémoires d’un bourgeois de Paris, Paris, 1856, cinq volumes in-12, I, 247. — Mme Ancelot : Un Salon de Paris, Paris, 1866, in-8°, p. 1-11. — Biographie pittoresque des quarante de l’Académie, par le portier de la maison, Paris, 1826, in-12, p. 59.
- ↑ A. Bardoux : Madame de Custine, Paris, 1888, in-8°, p. 341. — H. Fleischmann : Rachel intime, Paris, 1910, in-12, p. 58. — Marquis de Custine : Voyage en Russie, ex. dédicacé appartenant à M. C. Enlart. — Testament de Sophie Gay, arch. Franchet d’Esperey : « Je lègue au marquis de Custine, en souvenir de mon amitié pour lui et sa famille, ma petite chapelle et le baguier à colonnes noires et gothiques avec leurs dépendances. »
- ↑ Bassanville : Salons d’autrefois III, 10.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 283-287. — Jal : Souvenirs d’un homme de lettres, p. 472.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 282, III, 15-22.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 277-327 ; III, 21. — Sainte-Beuve : Lundis, IX, 144. — L. Séché : Delphine Gay, p. 149. — Lettre de Sophie Gay à Mme Récamier, arch. Détroyat. — E. Dupuy : Alfred de Vigny, Paris, 1910, deux volumes in-18, l, 170. — Mme de Solms : Madame de Girardin, p. 7. — D’Heilly : Madame Émile de Girardin, sa vie et ses œuvres, Paris, 1868, in-12, p. 16. — D. Stern : Souvenirs, p.307. — Mme Ancelot : Salons de Paris, p. 20. — Mémoires d’une femme de qualité depuis la mort de Louis XVIII jusqu’à la fin de 1870, Paris, 1829-1830, six volumes in-8°, IV, 199. — Michel Salomon : le Salon de l’Arsenal, p.855. — S. Gay : Un Mariage sous l’Empire, I, 80. — P.-L. Courier : Œuvres, précédées d’un essai par Armand Carrel, Paris, 1876, in-12.
- ↑ La Quotidienne, 19 décembre 1819. — Sainte-Beuve : Lundis, III, 480, VI, 66, XII, 149. — [Edmond Géraud] : Un Homme de lettres sous l’Empire et la Restauration, fragments de journal intime, publié par Maurice Albert, Paris | 1893], in-18, p. xv. — Revue encyclopédique, novembre 1820, t. VII, p. 157. — Moniteur universel, 4 août 1820. — Ch. Beslay : 1830-1848-1870, Mes Souvenirs, Paris-Neufchâtel-Bruxelles, 1873, in-16.
- ↑ Lettre de Sophie Gay à Euphémie Enlart, 3 avril 1821, arch. Enlart. — Clément et Pierre Larousse : Dictionnaire des Opéras. — Fétis : Biographie universelle des musiciens. — Journal des Débats, 31 mars 1821. — Miroir, 31 mars 1821.
- ↑ Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, Bruxelles-Paris, 1863, deux volumes, in-8o, II, 46, 55. — E. Biré : Victor Hugo avant 1830, Paris-Nantes, 1883, in-12, p. 267. — Mme Ménessier-Nodier : Charles Nodier, Paris, 1867, in-18, p. 265.
- ↑ Henri Girard : Un Bourgeois dilettante à l’époque romantique, Émile Deschamps (1791-1871) Paris, 1921, deux volumes in-8°, I, 92. — Victor Hugo raconté, II, 55. — 29 juin 1855, Mme Émile de Girardin, née Delphine Gay, 29 juin 1856, Paris, 1856, in-12. Discours de Jules Janin, p. 3. — Arch. Détroyat.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 327 et s. — Solms : Madame de Girardin, p. 11.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 327 et suiv. — Sainte-Beuve : Lundis, XI, 155.
- ↑ A. Bardoux : Madame de Custine, p. 341. — Mme Récamier : Souvenirs et Correspondances, publiés par Mme Lenormant, Paris, 1859, deux volumes in-8e, I, 329.
- ↑ Journal des Débats, 31 juillet et 26 août 1822. — Quotidienne, 25 août 1822. — Moniteur, 1822, p. 1251. — Biré et Guiraud : les Poètes lauréats de l’Académie française, Paris, 1864, deux volumes in-18, l,311. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 182-188. — Henri Girard : Émile Deschamps, p. 27. — Stéphane-Pol : la Jeunesse de Napoléon III, correspondance inédite de son précepteur Philippe Le Bas, Paris, sans date, in-8°, p. 119. — Coulmann : Réminiscences, II, 125. — Delphine Gay : Essais poétiques, p. 29. — Lettre de Sigismond Gay à Delphine, 31 août 1822, arch. Détroyat.
- ↑ Arch. nat., Ft 6905, doss. 7404. — Lettres de S. Gay à Coulmann, dans Réminiscences, II, 125-128, 177. — Hipp. Auger : Mémoires, p. 334. — Extrait de l’acte de décès de Sigismond Gay, dans Manecy, Une Famille de Savoie, p. 57.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, II, 178. — Lettre d’Isaure Gay à Euphémie Enlart, 12 mars 1827, arch. Enlart.
- ↑ Lettre de S. Gay à Ambroise Tardieu, 22 février 1823, arch. Détroyat. — Coulmann : Réminiscences, II, 178-203.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, II, 296.
- ↑ Lamartine : Cours familier de littérature, deuxième entretien. — Lettre de Sophie Gay à X…, arch. Detroyat.
- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 322. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 43-44 329.
- ↑ Manecy : Une Famille de Savoie, p. 41. — L. Séché : Delphine Gay, p. 44.
- ↑ Paul Foucher : les Coulisses du passé, Paris, 1873, in-18, p. 44.
- ↑ L. Séché : Le Cénacle de la Muse française, p. 31, 59, 143. — Jacques Boulenger : Marceline Desbordes-Valmore, p. 210. — Jules Marsan : la Muse française (1823-1824), Paris, 1907, deux volumes in-12, I, xli. — Émile Deschamps : Œuvres complètes, I, 302. — Henri Girard : Émile Deschamps, I, 107. — Biré : Victor Hugo avant 1830, p. 325.
- ↑ Lettre d’Émile Deschamps à Sainte-Beuve : dans Henri Girard, Émile Deschamps, l, 94. — Sainte-Beuve : Portraits contemporains, I, 410.
- ↑ Émile et Antony Deschamps : Poésies, Paris, 1841, in-18, p. 13. — Henri Girard : Émile Deschamps, I, 94, citant collect. Paignard, Inédits de Deschamps. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 206.
- ↑ Champfleury : les Vignettes romantiques, Paris, 1883, in-4o, p.32.
- ↑ Lettres de Daru et H. de Latouche à Sophie Gay, de Mme Dufrénoy, Auger, comte de Ségur, et H. de Latouche à Delphine Gay, arch. Détroyat, et Bib. nat., ms., n. a. fr., 2765 f° 150. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 177-183. — Sainte-Beuve : Lundis, III, 492. — Jacques Boulenger : Marceline Desbordes-Valmore, p. 130. — Lettre de O’Donnell à Enlart, arch. Enlart. — Lettre d’Émile Deschamps à Saint-Valry, dans Biré, Victor Hugo avant 1830, p. 304. — Imbert de Saint-Amand : Madame de Girardin, avec des lettres. Paris, 1874, in-12, p. 154.
- ↑ Michel Salomon : le Salon de l’Arsenal, p.854. — Edm. Géraud : Un Homme de lettres sous la Restauration, p. 244. — Mme Récamier : Souvenirs et Correspondance, publ. par Mme Lenormant, I, 329. — Solms : Madame de Girardin, p. 58. — Th. Gautier : Portraits contemporains, p. 20. — Mme d’Agoult (D. Stern) : Mes Souvenirs, Paris, 1877, in-8°, p. 308. — Delécluze : Souvenirs inédits, dans Rev. rétrospective, juillet 1888 et s., p. 271. - Magasin pittoresque, XIII, 159.
- ↑ Moniteur, 11 novembre 1824, p. 1474. — Journal des Débats, 11 novembre 1824. — Le Globe, 13 novembre 1824.
- ↑ Arch. Détroyat.
- ↑ Arch. nat., O3*, 548, f. 19. — Delécluze : Souvenirs inédits, dans Revue rétrospective, p. 271, 276. — Moniteur, 16 janvier 1825, p. 67. — L. Séché : Delphine Gay, p. 45. — Lamartine : Cours familier de littérature, l, 127. — Falloux : Mémoires d’un royaliste, Paris, 1888, deux volumes in-8°, I, 56
- ↑ A. Bardoux : Madame de Custine, p. 329. — C. Leroux-Cesbron : Une Négresse héroine de roman au siècle dernier, dans Bullet. de la Soc. hist. et arch. des VIIIe et XVIIe arr. de Paris, 1922, nouvelle série, n° 3, p 179. — Mme de Boigne, Mémoires, III, 399. — Bouchot : le Luxe français sous la Restauration, p. 119.
- ↑ Bibliothèque d’art et d’archéologie, Documents originaux, Gros.
- ↑
Delestre : Gros, sa vie et ses œuvres, Paris, 1845, in-8°, p. 189,
341, 363. — G. Dargenty : le Baron Gros, Paris, 1887, in-8°, p. 60. —
A.-M. et J.-J. Ampère : Correspondances et Souvenirs de 1805 à 1864,
rec. par Mme H. C[hevreux], Paris, 1875, deux volumes in-18, I, 314. —
Ch. Blanc : Histoire des peintres, p. 22. — Le Globe, 7 mai 1825. —
Duchesse d’Abrantès : Mémoires sur la Restauration, Paris, 1836, six
volume in-8°, VI, 109, passage repris dans les Mémoires d’une femme de
qualité, V, 160. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 181.—
Jules de Rességuier : Tableaux poétiques, Paris, 1828, in-8°, p. 67. —
Laissez-passer de Gros pour Delphine Gay, arch. Détroyat. — P. Lafond
l’Aube romantique, Jules de Rességuier et ses amis, Paris, 1910, in-12,
p. 120.
- ↑ Bouchot : le Luxe français sous la Restauration, p.33. — Mémoires d’une femme de qualité, V, 172. — Arch. nat., O°, 548, f° 230. — Le Globe, 7 juillet 1825.
- ↑ Le Globe, 20 septembre 1825. — Lettres de Daru, 27 décembre 1825 ; de Sébastiani, 9 septembre 1825 ; du prince Auguste de Prusse, 17 octobre 1825, arch. Détrovat. — Coulmann : Réminiscences, I, 324. — Moniteur, 27 octobre 1825 et 8 janvier 1826..
- ↑ Bassanville : Salons d’autrefois, III, 10. — H. Jouin : David d’Angers, sa vie, son œuvre, ses écrits et ses contemporains, Paris, 1878, deux volumes in-8°, I, 164. — 29 juin 1855-29 juin 1856, Jules Janin, art. nécrologique, p. 17.
- ↑ Lettres des duchesses de Duras et de Rauzan, arch. Détroyat. — Villemain : Souvenirs contemporains, p. 460. — Jean Balde : Madame de Girardin, Paris, sans date, in-18, p. 22. — Véron : Mémoires d’un bourgeois de Paris, III, 46.
- ↑ Arch. Nat., F7, 6923 (9850). — Intermédiaire des chercheurs, XIV, 449, 506, 538 ; LXXVII, 58. — Bibl. nat., ms, n. a. fr., 12758, p. 562.
- ↑ Mme d’Agoult : Souvenirs, p. 305-308.
- ↑ Delécluze : Souvenirs de soixante années, p. 288. — Herriot : Madame Récamier, p. 196.
- ↑ Delécluze : Souvenirs de soixante années, p. 291. — Moniteur, 31 mars 1826, p. 407.
- ↑ Lettres de Daru, Marceline Desbordes-Valmore à Delphine Gay, de Sophie Gay à J. Tastu, arch. Détroyat. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 178, et Delphine Gay, p. 49. — Eckermann : Conversations de Gœthe pendant les dernières années de sa vie (1822-1832), trad. Delérot, Paris, 1865, deux volumes in-16, I, 286. — Intermédiaire des chercheurs et des curieux, LX, no 1227, col. 159. — 29 juin 1855-29 juin 1856, p. 56. — Moniteur, 4 avril 1826, p. 427. — Solms : Madame de Girardin, p. 15. — D’Heilly : Madame de Girardin, p. 26.
- ↑ Delphine Gay : Essais poétiques, pièce liminaire. — Coulmann : Réminiscences, I, 336. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 62 — Arch. Détroyat.
- ↑ Paul Lafond : Alfred de Vigny en Béarn, dans Bull. Soc. des sciences, lettres et arts de Pau, deuxième série, t. XXIII, p. 1. — Delphine Gay : Œuvres, I, 188, 211, 234, 237, et Tu ne saurais m’oublier, romance, musique de Pauline Duchambge, Paris, Pleyel, 1826. — E. Dupuy : la Jeunesse des romantiques, Paris, 1905, in-18, p. 163, et Alfred de Vigny, I, 33, 190, 335. - L. Séché : Alfred de Vigny, Paris, 1913, deux volumes in-18, II, 26, 218. — Sainte-Beuve : Nouveaux lundis, VI, 416.— Maurice Allem : Alfred de Vigny, Paris, sans date, in-8°, p. 36 et suiv. — Alfred de Vigny : Lettres inédites à Édouard Delprat et au capitaine de La Coudrée (1824-1853), Bordeaux, 1913, in-8°, p. 25.
- ↑ Mme Vigée-Lebrun : Souvenirs, V, 149. — Boucher de Perthes : Sous dix rois, Souvenirs de 1791 à 1860, Paris, 1863, huit volumes in-12, l I, 155. — Stendhal : Correspondance, III, 408. — Lamartine : Cours familier de littérature, I, 101 et suiv. — Faguet : Amours d’hommes de lettres, Paris, sans date, in-12, p. 196.
- ↑ Comtesse Potocka : Voyage d’Italie (1826-1827), publié par Casimir Stryenski, Paris, 1899, in-18, p. 59. — Maritain : Lamartine et madame de Girardin, dans Annales de l’Académie de Mâcon, 1903, p. 245. — Mme de Girardin : Œuvres, I, 271. — Lettre de Sophie Gay à Lamartine, 16 septembre 1826, dans Lettres à Lamartine, p. 50. — Lettre de Lamartine au marquis de La Grange, dans Maritain, Lamartine et madame de Girardin. — Stendhal : Correspondance, III, 438. — Arch. Affaires étrangères, Rome, 961, f. 279 ; Florence, 166, f. 164, 166.
- ↑ Dépêches du duc de Laval au baron de Damas, 8 décembre 1826, arch. Affaires étrangères, Rome, 961, f. 280, 300, et 962, f. 92 v° ; Florence, 166, f. 132, 167 v°, 181, 229. — D’Heilly : Madame de Girar din, p. 27. — Solms : Madame de Girardin, p. 18. — Lettre de Sten dhal à Mº° C…, hiver 1826, Correspondance, Il I, 428. — Lettre de Sophie Gay à Lamartine, 4 janvier 1826, dans Maritain, Lamartine et madame de Girardin, p. 245. — Comtesse Potoeka : Voyage d’Italie, p. 50, 57 ; Mémoires (1794-1820), introd. par Casimir Stryenski, Paris, 1897, in-8°, page v. — Lettre de Catherine de Wurtemberg, 13 février 1827, dans Charavay, Catalogue d’autographes, mai 1908, pièce 23. — M"° de Girardin:Lettres parisiennes, I, 26; II, 149. — Baron de Meneval Lettres de la reine Hortense à Louis-Napoléon (1824-1836), dans Revue d’histoire diplomatique, 1923, n°° 1-3. — Sainte-Beuve : Lundis, Ill, 301. — E. Dupuy : Alfred de Vigny, I, 161. — Lettres de Sophie Gay à Jules de Rességuier, 20 décembre 1826, 2 février 1827, dans Lafond : l’Aube romantique, p. 114, 119. — Gailly de Taurines : la Reine Hor tense en exil, Paris, 1914, in-12, p. 229. — M"° de Girardin : Œuvres, I, 55, 129, 271, 281. — Lettre de Desmousseaux de Givré à M"° Lenormant, 2 janvier 1827, dans L. Séché, Delphine Gay, p. 54.
- ↑ 29 juin 1855-29 juin 1856, p. 14. — Baron de Meneval : Lettres de la reine Hortense et du prince Louis-Napoléon, dans Revue d’histoire diplomatique, 1923, nos 1-3. — Maritain : Lamartine et madame de Girardin, p. 243. — Stéphane Pol : la Jeunesse de Napoléon III, passim. — Mémoires de madame la duchesse de Saint-Leu, suivis des romances, album, p. 76. — Sophie Gay : le Moqueur amoureux, Paris, 1830, deux volumes in-8o, p. 249. — Bocher : Mémoires (1816-1907) précédés des souvenirs de famille, Paris, sans date, deux volumes in-8o, I, 149. — Coulmann : Réminiscences, II, 22. — La Reine Hortense en Italie et en Angleterre pendant l’année 1831, p. 267. — Gailly de Tanrines : la Reine Hortense en exil, p. 289. — Mme de Girardin : Œuvres, I, 271, et Lettres parisiennes, IV, 90.
- ↑ G. Le Breton : Schnetz et son époque, lettres inédites sur l’art, par Louis David, etc., Paris, 1855, in-8°, p. 16. — Lettre de David d’Angers à Delphine Gay, 2 septembre 1828, arch. Détroyat. — Henry Jouin : David d’Angers et ses relations littéraires, Paris, 1890, in-8°, p.35-47, et David d’Angers, sa vie, son œuvre, I, 179, 203, 267, 576.— Eckermann : Conversations de Gœthe, II, 189.
- ↑ Mirecourt : Madame de Girardin, p. 40. — Du Bled : le Salon de madame de Girardin, dans le Monde moderne, 1898, I, 533. — Mme de Boigne : Mémoires, III, 13. — Comte d’Haussonville, Ma Jeunesse (1814-1830), Paris, 1885, in-8°, p. 280. — Comte Apponyi : Mémoires, I, 156. — Marquiset : les Bas bleus du premier Empire, p. 135. - Lettre de Mme de Girardin au comte de Castellane, arch. du marquis de Girardin.
- ↑ Marin : Histoire de la vie et des ouvrages de monsieur de Chateaubriand, Paris, 1832, deux volumes in-8°, II, 133. — Turquan : Madame Récamier, p. 349. — Lettre de Ballanche à Mme Lenormant, dans Mme Récamier, Souvenirs et Correspondances, p. 278. — Revue de Paris, 1829, I, 248.
- ↑ Lettre de Delphine Gay à Saint-Priest, dans le Français, 29 novembre 1878. — Lafond : l’Aube romantique, p. 114, 176. — Bib. nat., ms., n. a. fr., 12758, f. 188. — Jules de Rességuier : Tableaux poétiques, p. 61. — Le Voleur, 31 mai 1829. — Lettre de Sophie Gay à Belmontet, arch. Détroyat. — Bardoux : la Bourgeoisie française, (1789-1848), Paris, 1886, in-8°, p. 232. — Lettres de Delphine Gay à Béranger, 22 janvier 1829, et de Béranger à Coulmann, dans Béranger, Correspondance, publiée par Boiteau, Paris, 1860, quatre volumes in-8°, I, 220, 226, 354. — Maritain : Lamartine et madame de Girardin. — Béranger : Chansons (1815-1836), p.288. — Coulmann : Réminiscences, I, 327 et suiv. — Lettre de H. de Latouche à Balzac, Lov., A 30910-12. — Philarète Chasles : Mémoires, I, 303. — G. Ferry : Balzac et ses amies, Paris, 1888, in-12, p. 29. — Th. Gautier : Portraits contemporains, p.29.
- ↑ Épigraphe du Rêve d’une jeune fille, dans Mme de Girardin, Œuvres, I, 303.
- ↑ Mme de Girardin : Œuvres, I, p. 303-309. — Maritain : Lamartine et Madame de Girardin, p. 260-264.— Louis Barthou . : l’Élection de Lamartine à l’Académie française, dans Revue des Deux-Mondes, 15 septembre 1916, p. 303. — Lamartine : Poésies diverses dans les Harmonies poétiques et religieuses, Paris, 1856, in-12, p. 222, et Lettres échangées entre Delphine Gay et lui, dans Correspondance, II, 149-159. — Lettre de Lamartine au vicomte de X…, dans l’Intermédiaire des chercheurs, LXXXI, 326. — Lettre de Goschler à Thiers, 23 mai 1848, Bibl. Thiers, 4°, mss. 32. — Imbert de Saint-Amand : Madame de Girardin, p. 15-26. — Bouchot : le Luxe français sous la Restauration, p. 281. — Le National 3 avril 1830.
- ↑ Albert Sorel : Madame de Staël, Paris, 1890, in-12, p. 162. — Th. Gautier : Histoire du romantisme, Paris, 1874, in-18, p. 2. — Lettre de Lamartine à Delphine Gay, dans Imbert de Saint-Amand, Madame de Girardin, p. 21. — Coulmann : Réminiscences, I, 341. — Sainte-Beuve : Lundis, XI, 475. — Biographie pittoresque des quarante de l’Académie française, par le portier de la maison [J. Méry, A. Barthé lemy et Léon Vidal], Paris, 1825, in-8°, p. 75.
- ↑ H. d’Alméras : la Vie parisienne sous la Restauration, Paris, in-8°, p. 301. — Journal des Débats, 18 février 1830. — Moniteur, 19 février 1830. — Th. Gautier : Histoire du romantisme, p. 100-118 et préface des Œuvres de Mlle de Girardin, p. III. — Victor Pavie : Médaillons romantiques, p. 113. — Raoul Deberdt : Un Excitateur d’âmes, dans Revue des revues, 1899, p. 274.
- ↑ Certificats de vie de Delphine Gay, arch. Détroyat. — Le National, 20 juillet 1830. — Le Globe, 21 juillet 1830. — La Quotidienne, 22 juillet 1830. — Le Figaro, 26 juillet 1830. — Lettre d’Isaure Gay à Euphémie Enlart, 9 novembre 1830, arch. Enlart. — Lettre de Chopin à Woyciechowski, dans Ganche, Frédéric Chopin, Paris, 1913, in-8°, p. 84. — Le Momus de la liberté, Paris, 1830, in-32, p. 185. — Titres de propriété de la Maison Rouge, arch. Ernault. — Edmond Géraud : Un Homme de lettres sous l’Empire et la Restauration, p. 258. — Catalogue de la vente de la bibliothèque du comte Robert de Montesquiou, Paris, 1923, in-8°, p. 59.
- ↑ Lettre de Malibran à Lamartine, 11 août 1830, dans L. Séché, Alfred de Musset, Paris, 1907, deux volumes in-8°, II, 139. — Marquis de Custine : l’Espagne sous Ferdinand VII, Paris, 1838, quatre volumes in-8°, lettres du 23 avril 1831 à Delphine Gay, et du 11 mai 1831, à Sophie Gay. — Maréchal de Castellane : Journal (1804-1862), Paris, 1895, cinq volumes in-8°, II, 410. — Lettre de Mme Récamier à David d’Angers, 21 janvier 1831, dans Jouin, David d’Angers et ses relations littéraires, p. 53. — Lettre de George Sand à Dudevant, 14 février 1831, dans Louise Vincent, George Sand et le Berry, Paris, 1919, deux volumes in-8°, I, 156. — Lettre de Victor Hugo à Sophie Gay, dans L. Séché, Delphine Gay, p. 149.
- ↑ Lettre de Sophie Gay à Rességuier, 12 janvier 1831, dans Lafond, l’Aube romantique, p. 77. — Lettre de Delphine Gay à Lamartine, 10 décembre 1830, dans Maritain, Lamartine et madame de Girardin, p. 269.
- ↑ Lettre d’Aimée Burton, sœur de Mme Horace Vernet, à Louise Vernet, 5 juillet 1829, arch. Delaroche-Vernet. — La Croix de Berny, par le vicomte Charles de Launay, Théophile Gautier, Jules Sandeau, Méry, Paris, 1846, deux volumes in-8° ; dans l’éd. Michel Lévy, p. 133.— Mme de Girardin : Œuvres, I, 287, 317, 324. — Champfleury : les Vignettes romantiques, p. 116.
- ↑ Intermédiaire des chercheurs, LXXXV, 792. — D’Estournel : Derniers souvenirs, p. 321. — Bonnes feuilles d’une notice jointe aux notes de Sainte-Beuve, Lov., D, 1991<mall>279. — Monsieur Émile de Girardin, par un journaliste, Paris, 1887, in-12, p. 26. — Lamartine : Cours familier de littérature, XVIII, 277. — D’Alton-Shée : Mémoires, Paris, 1869, I, 155. — Jules Rouquette : les Défenseurs de la République, Emile de Girardin, Paris, 1877, in-8°, 8 pages. — Falloux : Mémoires d’un roya liste, I, 54. — Marquis de Bonneval : Mémoires anecdotiques, Paris, 1900, in-16, p. 256.
- ↑ D’Alton-Shée : Mémoires, I, 155-179. — L. Séché : la Jeunesse dorée sous Louis-Philippe, Paris, 1910, in-12, p. 231. — Jacques Boulenger, les Dandys, p. 141. — Werdet : Souvenirs de la vie littéraire, Paris, 1879, in-18, p. 198, attribue inexactement la fondation du Voleur à Maurice Alhoy.
- ↑ 1830, Lov., D, 718°. — A. Houssaye : les Confessions, I, 291.
- ↑ Lettre d’Émile de Girardin à Marceline Desbordes-Valmore, 10 avril 1829, Lov., D, 71886. — Auger, Mémoires, p. 176, 365, 369. — Th. Muret : À travers champs. Souvenirs et propos divers, Paris, 1838, deux volumes in-12, I, 3.
- ↑ Elle a un frère, Georges, à Saint-Cyr en 1840. Il était question pour eux de s’appeler Smith d’Érigny. Ils habitaient Saint-Leu-Taverny. Elle épouse en 1834 le baron Georges de Vaufreland, frère cadet du baron Ludovic de Vaufreland, et neveu de Piscatori.
- ↑ Le Miroir, 14 mars 1821. — La Mode, 1829, p. 308, 326. — Lettre de Louise Smith à Louise Vernet, 20 décembre 1829, arch. Delaroche-Vernet. — Mme de Girardin : Œuvres, I, 321. — Le Voleur, 31 juillet 1831.
- ↑ Général de Rumigny (1789-1860), publié par Gouraud d’Ablancourt, Paris, 1921, in-8°, p. 255. - Lettre d’Émile de Girardin au général Gérard, Lov., D, 718°. — Le Voleur, 30 septembre 1830.
- ↑ Duc de La Rochefoucauld-Doudeauville : Esquisses et portraits, Paris, 1844, trois volumes in-8°, II, 95. — Le Figaro, 2 avril 1854, rappelant celui de 1828. — Auger : Mémoires, p. 366. — Bassanville : Salons d’autrefois, III, 136. — Le Voleur, 20 février 1831. — A. Houssaye : les Confessions, VI, 352.
- ↑ Feu le marquis de Girardin m’a confirmé que le comte Alexandre de Girardin se refusa toujours à reconnaître son fils, bien qu’il profitât de l’influence que ce fils avait su conquérir. À la fin du règne de Louis-Philippe, en présence de ce refus persistant, Émile de Girardin alla trouver le marquis de Girardin, chef de la famille, et le pria d’user de son autorité pour obliger son cadet à le reconnaître. Le comte Alexandre refusa encore. Alors le marquis de Girardin obtint la constitution à la Chambre des Pairs d’une commission qui décida qu’Émile de Girardin était bien le fils du comte Alexandre. Feu le marquis de Girardin m’a déclaré n’avoir pas trouvé la preuve écrite de ce fait, mais il m’en a certifié l’authenticité sur la foi de son père, qui le lui avait raconté.
- ↑ Les Gay jouiront pendant encore au moins trois ans de cette propriété, après la vente. Froidefont de Bellisle n’exécutant pas les conditions du contrat, Sophie Gay se verra contrainte de lui faire un procès, à lui et à l’union de ses créanciers. Le procès se terminera seulement le 7 avril 1840, par un jugement qui condamne Bellisle et l’union de ses créanciers à payer à Sophie Gay une somme de 33.500 franes, plus les intérêts, et les dépens. — Titres de propriété de la Maison Rouge, arch. Ernault. — Lettre d’Isaure Gay à Euphémie Enlart, 16 septembre 1833, arch. Enlart.
- ↑ L. Séché : la Jeunesse dorée sous Louis-Philippe, p. 11. — Mme de Girardin : Œuvres, I, 329. — Lettre de Sophie Gabriac [Allart] à Louise Vernet, 22 mai 1851, arch. Delaroche-Vernet. — Acte de mariage, reconstitué sur une expédition délivrée le 24 mars 1877 par Doulcet, archiviste de la Chambre des députés. — Registre des mariages, paroisse Saint-Roch, 1831, p. 60. — Lettre de Sophie Gay à Jules de Rességuier, 31 mai 1832, dans Lafond, l’Aube romantique, p. 131. — Chateaubriand : Mémoires d’outre-tombe, V, 435

