Valérie/Texte entier
VALÉRIE
par
MADAME DE KRUDENER
PARIS
LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES Rue Saint-Honoré, 338
M DCCC LXXXIV
Il a été tiré en outre vingt exemplaires sur papier de Chine (n° 1 à 20) et vingt sur papier Whatman (nos 21 à 40), accompagnés d’une triple épreuve du frontispice.
VALÉRIE
PUBLIÉE PAR D. JOUAUST
D'APRÈS L'ÉDITION ORIGINALE
Frontispice gravé par Lalauze
PARIS
LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES
Rue Saint-Honoré, 338
M DCCC LXXXIV
AVANT-PROPOS
En donnant accès aujourd’hui au roman de Valérie dans notre Bibliothèque des Dames, nous n’avons pas la prétention de consacrer une nouvelle notice à Mme de Krüdener et à son œuvre, sur lesquelles tout a été dit, et qui ne nous paraissent pas mériter d’autres études et d’autres recherches. Nous renverrons donc simplement le lecteur à la remarquable notice faite par M. X. Marmier dans la Revue germanique de juillet 1833, et à celle de Sainte-Beuve, imprimée en tête de l’édition Charpentier, après avoir paru dans la Revue des Deux-Mondes, puis à la récente préface de M. Parisot, ainsi qu’à l’intéressant volume que M. Paul Lacroix a publié, il y a quatre ans, sur Mme de Krüdener.
Il y a deux personnages dans Mme de Krüdener : d’abord l’écrivain, qui a pris la plume pour traduire les impressions de ses débuts dans la vie ; puis la femme mystique et exaltée se posant en prophétesse et poursuivant le rêve de fonder une religion nouvelle. C’est naturellement du premier que nous avons à nous occuper ici, sans toutefois négliger absolument les détails qui concernent le second, les excentricités de la visionnaire devant servir à expliquer certains côtés étranges de l’œuvre de l’écrivain.
Julie Victinghoff, née à Riga en 1766, fut mariée, à l’âge de quatorze ans, au baron de Krüdener, qui n’en avait pas quarante. Bien qu’à cet âge un homme ne puisse paraître un vieillard à une femme, si jeune qu’elle soit, elle le trouva trop âgé pour elle ; et l’on pourra s’en étonner quelque peu, puisque cinq ans après,à l’âge de dix-neuf ans, elle devenait la maîtresse de l’académicien Suard, qui avait atteint la cinquantaine. Quoi qu’il en soit, le désaccord ne tarda pas à se mettre entre les deux époux.
Le baron de Krüdener était ambassadeur, et son secrétaire intime conçut pour la baronne un violent amour, qu’il n’osa, paraît-il, jamais lui avouer, et qui, avec l’aide d’une phtisie, le conduisit rapidement au tombeau, si même il ne le porta au suicide. C’est du moins ce que laissa dire Mme de Krüdener, qui n’était nullement insensible à la gloire de faire des victimes. En tout cas, cette aventure flatta singulièrement son penchant à la sentimentalité et au mysticisme ; elle se plut à en faire le sujet d’un roman dans lequel elle prit le nom de Valérie, donnant celui de Gustave au malheureux jeune homme qui était mort de l’avoir aimée. On lui pardonnera facilement de s’y faire un rôle tout idéal et de se présenter au lecteur avec une auréole de pureté qu’elle ne porta pas toujours dans la vie réelle : en effet, après s’être éprise des cinquante ans de Suard, elle conçut, en 1801, une violente passion pour le talent du chanteur Garat ;passion malheureuse, qui finit par trouver un outrageant dédain chez l’objet aimé, et à la suite de laquelle la sentimentale baronne renonça pour toujours aux faiblesses du cœur et des sens.
Plus que toute autre la baronne de Krûdener a subi ce charme irrésistible qui n’a jamais cessé d’attirer les étrangers vers la France. Aussi est-ce en français qu’elle écrivit son roman de Valérie, et l’on est vraiment émerveillé de la facilité avec laquelle elle sut manier une langue qui n’était pas la sienne. Elle fit plusieurs séjours à Paris. C’est pendant le second, qui commença en 1801, que parut Valérie (1803). Le roman ne plut pas à Napoléon, dont Mme de Krüdener ambitionnait l’approbation. Elle en conçut un grand ressentiment, et se trouva ainsi toute préparée à entrer dans le mouvement de réaction germanique qui se dessinait contre le maître des destinées de la France, et qui s’accentua davantage après l’assassinat du duc d’Enghien. Mme de Krüdener retourna alors en Allemagne. Elle s’y lia avec la reine de Prusse, qu’elle eut la douleur de voir mourir bientôt. Le chagrin qu’elle ressentit de cette perte la jeta dans le mysticisme, et elle commença a faire à Heidelberg, à Bade, à Carlsruhe, du prosélytisme en faveur de la religion nouvelle dont elle voulait jeter les bases.
Elle revint ensuite à Paris avec les alliés. C’est alors surtout qu’elle eut un salon très suivi, et qu’elle acquit cette grande influence que désormais elle devait mettre exclusivement au service de son mysticisme religieux. Elle fut dans une très grande intimité avec l’empereur de Russie, qui se laissa prendre à son rêve d’une union intime entre la France et la Russie. Aussi Alexandre présenta-t-il solennellement son amie à toute l’armée russe, lors de la grande revue qu’il passa dans les plaines des Vertus, en Champagne[1]. Ce fut l’apogée de l’influence de Mme de Krüdener, et la trop confiante baronne ne tarda pas à éprouver que l’amitié d’un souverain est de celles sur lesquelles on peut compter le moins. Alexandre l’abandonna bientôt, et de cet abandon date pour Mme de Krüdener une existence errante et accidentée dans les péripéties de laquelle nous n’avons pas l’intention de la suivre.
Complètement vouée, dès lors, à une vie d’extase et de prédication, elle arrive d’abord à Bâle, où elle fait tant de prosélytes qu’on est obligé de l’expulser. Puis on la retrouve alternativement et successivement dans les principales villes de Suisse, dans le grand-duché de Bade, en Allemagne, moralisant et catéchisant sans cesse, attirant toujours sur ses pas une foule de mendiants et de sectaires, chassée de partout, et n’entrant parfois dans une ville que pour y rester quelques heures, si bien que finalement les puissances s’émeuvent du bruit qu’elle soulève autour d’elle, et qu’elle est reconduite militairement à la frontière russe. Là elle a le déboire de voir son souverain, son ancien prosélyte et ami, lui interdire le séjour de Saint-Pétersbourg et de Moscou, et la confiner dans une terre aux environs de Riga. Elle obtient pourtant ensuite la permission d’aller à Saint-Pétersbourg : elle y est recueillie par la princesse Galitzin, qu’elle endoctrine, et dont la maison devient le temple où elle réunit ses fidèles. Enfin elle veut aller fonder une colonie religieuse aux environs de la mer d’Azof, et c’est là qu’elle va mourir d’un cancer, le 13 décembre 1824, en ayant la douleur de voir avorter son entreprise.
Revenons maintenant à Valérie, qui eut un très grand succès, surtout auprès des femmes, dont ce roman flattait singulièrement l’amour-propre. La perfection avec laquelle il était écrit donna à penser que Mme de Krüdener n’en était pas l’auteur. On voulut qu’il fût de Bernardin de Saint-Pierre, qui peut-être fut appelé à donner quelques conseils. On attribua aussi la paternité de l’œuvre à Bérenger, l’auteur aujourd’hui oublié de la Morale en action, avec qui la baronne s’était liée pendant un séjour qu’elle fit à Lyon. Mais M. Paul Lacroix a justement publié dans son curieux travail[2] une lettre qu’elle écrivait à Bérenger en 1805, et qui prouve bien qu’il était étranger à la composition et à la rédaction du roman. En voici le passage qui nous intéresse :
« C’est à Lyon que j’achevai Valérie. J’avais entrepris cet ouvrage à Genève, inspirée par les beautés mélancoliques du Léman et de la Grande-Chartreuse. Je vous en lus la moitié. Je fis la même confidence à V… et à Camille Jordan. On me pressa d’achever, et j’achevai ce romanesque et très fidèle tableau d’une passion sans exemple comme sans tache.
« Ce n’est pas le désir d’étaler de l’esprit qui m’a inspiré ces pages, que je crois touchantes, et auxquelles vos journaux daignent accorder quelques éloges. Non, certes : ce qu’il y a de bon dans Valérie appartient à des sentiments religieux que le Ciel m’a donnés, et qu’il a voulu protéger en faisant aimer ces sentiments… Je vois, au reste, par ce succès de ma chérissime Valérie, que la piété, l’amour pur et combattu, les touchantes affections, et tout ce qui tient à la délicatesse et à la vertu, émeuvent et touchent plus en France qu’ailleurs. »
Après cette appréciation de Mme de Krüdener par elle-même, voyons le jugement que Sainte-Beuve a porté sur elle. En vertu d’une fiction par laquelle il se plaît à placer chaque auteur dans l’époque à laquelle il aurait dû vivre, l’éminent critique fait de Mme de Krüdener une figure du moyen âge.
« C’est (dit-il) comme une sainte qui nous apparaît, une sainte du Nord, du XIIIe siècle, une sainte Élisabeth de Hongrie, ou encore quelque sœur du grand maître des chevaliers porte-glaive,qui, du fond de la Livonie, attirée sur le Rhin et longtemps mêlée aux délices des cours, ayant aimé et inspiré les illustres minnesinger du temps, ayant fait elle-même quelque roman en vers comme un poète de la Wartbourg, ou plutôt ayant voulu imiter notre Chrestien de Troyes, ou quelque autre fameux trouvère en rime française, en cette langue le plus délitable d’alors, serait enfin revenue à Dieu, à la pénitence, aurait désavoué toutes les missions et les flatteries qui l’entouraient, aurait prêché Thibaut, aurait consolé des calomnies et sanctifié Blanche, serait entrée dans un ordre qu’elle aurait subi, qu’elle aurait réformé, et, autre sainte Claire, à la suite d’un saint François d’Assise, aurait remué comme lui des foules et parlé dans le désert aux petits oiseaux. »
Voilà un portrait complet et tracé de main de maître : aussi n’avons-nous voulu rien retrancher de cette longue période, dans laquelle l’illustre critique se laisse emporter, par son lyrique enthousiasme, un peu au delà de sa mesure ordinaire, et fait de Mme de Krüdener un être un peu trop idéal. Passant ensuite de l’auteur à son œuvre, Sainte-Beuve s’exprime ainsi au sujet de Valérie :
« Quand Mme de Staël, en pleine célébrité et hautement accueillie par l’école française du XVIIIe siècle, commençait à tourner à l’Allemagne, Mme de Krüdener, Allemande, et malgré la littérature alors si glorieuse de son pays, n’avait d’yeux que vers le nôtre. Dans cette langue préférée, elle nous envoyait un petit chef-d’œuvre où les teintes du Nord venaient, sans confusion, enrichir, étendre le genre des Lafayette et des Souza. Après Saint-Preux,après Werther, après René, elle sut être elle-même, à la fois de son pays et du nôtre, et introduire son mélancolique Scandinave dans le vrai style de la France… Dans Valérie, plus que chez Mme de Staël, l’inspiration germanique, si sentimentale qu’elle soit, se corrige en s’exprimant, et, pour ainsi dire, se termine avec un certain goût toujours, et par une certaine forme discrète et française.
« Valérie, par l’ordre des pensées et des sentiments, n’est inférieure à aucun roman de plus grande composition, mais surtout elle a gardé, sans y songer, la proportion naturelle, l’unité véritable ; elle a, comme avait la personne de son auteur, le charme infini de l’ensemble.
« Valérie a des côtés durables en même temps que des endroits de mode et déjà passés. Il y a eu dans le roman des talents très remarquables, qui n’ont que des succès viagers, et dont les productions, exaltées d’abord, se sont évanouies à quelques années de là. Mlle de Scudéry et Mme Cottin, malgré le grand esprit de l’une et le pathétique d’action de l’autre, sont tout à fait passées. Pas une œuvre d’elles qu’on puisse relire autrement que par curiosité, pour savoir les modes de la sensibilité de nos mères. Mme de Montolieu est encore ainsi : Caroline de Lichtfield, qui a tant charmé une première fois à quinze ans, ne peut se relire, pas plus que Claire d’Albe. Valérie, au contraire, a un coin durable et à jamais touchant ; c’est une de ces lectures qu’on peut se donner jusqu’à trois fois dans sa vie, aux différents âges.
« Le style de Valérie a, comme les scènes mêmes qu’il retrace, quelques fausses couleurs de la mode sentimentale du temps. Je ne saurais aimer que le comte envoie, pour le tombeau de son fils, une belle table de marbre de Carrare, rose, dit-il, comme la jeunesse, et veinée de noir comme la vie. Mais ces défauts de goût y sont rares, aussi bien que quelques locutions vicieuses (en imposer pour imposer), qu’un trait de plume corrigerait. Le style de ce charmant livre est, au total, excellent, eu égard au genre peu sévère : il a le nombre, le rythme, la vivacité du tour, un perpétuel et parfait sentiment de la phrase française. »
M. Paul Lacroix, dans son livre déjà cité, appuie le jugement de Sainte-Beuve et ajoute :
« Mme de Krüdener aurait égalé, surpassé peut-être Bernardin de Saint-Pierre, si elle avait appliqué uniquement aux lettres son génie, sans l’égarer dans les brouillards du mysticisme religieux. Elle possédait au plus haut degré le talent d’exprimer ses idées dans un langage facile, élégant, harmonieux. Étrangère, elle avait deviné notre langue plutôt qu’elle ne l’avait apprise, et elle s’en servait avec un merveilleux instinct, qui suppléait à cette science, à cet art, qu’on acquiert à force de travail et de temps. Elle était devenue écrivain, comme elle devint plus tard orateur, pour les nécessités de son apostolat ; comme elle eût été poète, si elle avait eu besoin de faire entrer sa pensée dans le moule du vers pour lui donner plus de portée et plus d’écho[3].
Mme de Krüdener n’a guère fait que Valérie. Ses autres écrits, qui ne sont que de la controverse ou des extases religieuses, tiendraient en un petit nombre de pages. Elle avait pourtant commencé, sous le titre d’Othilde, un autre roman, consacré à l’amour divin, et qui, dans sa pensée, était comme une expiation de Valérie, le roman de l’amour terrestre. C’était, disait-elle, dans une lettre adressée, en 1809, à son amie, Mlle Cochelet, lectrice de la reine de Hollande, un ouvrage « fait avec le Ciel ». Le sujet d’Othilde, dont l’action se passait au moyen âge, ne nous est pas connu, et il est fort probable que l’ouvrage n’a jamais été achevé. Il en est resté un fragment que M. Paul Lacroix a donné dans le livre auquel nous venons de faire un emprunt.
Quoi qu’il en soit, Valérie a suffi à établir le renom littéraire de la baronne de Krüdener, puisque ce roman a déjà été réimprimé plusieurs fois, et que c’est à la demande d’un grand nombre de personnes que nous lui donnons aujourd’hui une place dans notre Bibliothèque des Dames.
PRÉFACE
Je me trouvois, il y a quelques années, dans une des plus belles provinces du Danemark : la nature, tour à tour sauvage et riante, souvent sublime, avoit jeté dans le magnifique paysage que j’aimois à contempler, là de hautes forêts, ici des lacs tranquilles, tandis que dans l’éloignement la mer du Nord et la mer Baltique rouloient leurs vastes ondes au pied des montagnes de la Suède, et que la rêveuse mélancolie invitoit à s’asseoir sur les tombeaux des anciens Scandinaves, placés, d’après l’antique usage de ce peuple, sur des collines et des tertres répandus dans la plaine.
« Rien n’est plus poétique, a dit un éloquent écrivain, qu’un cœur de seize années. » Sans être aussi jeune, je l’étois cependant ; j’aimois à sentir et à méditer, et souvent je créois autour de moi des tableaux aussi variés que les sites qui m’environnoient. Tantôt je voyois les scènes terribles qui avoient offert au génie de Shakespeare les effrayantes beautés de Hamlet ; tantôt les images plus douces de la vertu et de l’amour se présentoient à moi, et je voyois les ombres touchantes de Virginie et de Paul : j’aimois à faire revivre ces êtres aimables et infortunés ; j’aimois à leur offrir des ombrages aussi doux que ceux des cocotiers, une nature aussi grande que celle des tropiques, des rivages solitaires et magnifiques comme ceux de la mer des Indes.
Ce fut au milieu de ces rêves, de ces fictions et de ces souvenirs que je fus surprise un jour par le récit touchant d’une de ces infortunes qui vont chercher au fond du cœur des larmes et des regrets. L’histoire d’un jeune Suédois d’une naissance illustre me fut racontée par la personne même qui avoit été la cause innocente de son malheur. J’obtins quelques fragmens écrits par lui-même : je ne pus les parcourir qu’à la hâte ; mais je résolus de noter sur-le-champ les traits principaux qui étoient restés gravés dans ma mémoire. J’obtins après quelques années la permission de les publier : je changeai les noms, les lieux, les temps ; je remplis les lacunes, j’ajoutai les détails qui me parurent nécessaires ; mais, je puis le dire avec vérité, loin d’embellir le caractère de Gustave, je n’ai peut-être pas montré toutes ses vertus ; je craignois de faire trouver invraisemblable ce qui pourtant n’étoit que vrai. J’ai tâché d’imiter la langue simple et passionnée de Gustave. Si j’avois réussi, je ne douterois pas de l’impression que je pourrois produire : car, au milieu des plaisirs et de la dissipation qui absorbent la vie, les accens qui nous rendent quelque chose de notre jeunesse ou de nos souvenirs ne nous sont pas indifférens, et nous aimons à être ramenés dans des émotions qui valent mieux que ce que le monde peut nous offrir.
J’ai senti d’avance tous les reproches qu’on pourroit faire à cet ouvrage. Une passion qui n’est point partagée intéresse rarement : il n’y a pas d’événemens qui fassent ressortir les situations ; les caractères n’offrent point de contrastes frappans ; tout est renfermé dans un seul développement, un amour ardent et combattu dans le cœur d’un jeune homme. De là ces répétitions continuelles : car les fortes passions, on le sait bien, ne peuvent être distraites et reviennent toujours sur elles-mêmes ; de là ces tableaux peut-être trop souvent tirés de la nature. Le solitaire Gustave, étranger au monde, a besoin de converser avec cette amie ; il est d’ailleurs Suédois ; et les peuples du Nord, ainsi qu’on peut le remarquer dans leur littérature, vivent plus avec la nature ; ils l’observent davantage, et peut-être l’aiment-ils mieux. J’ai voulu rester fidèle à toutes ces convenances ; persuadée d’ailleurs que, si les passions sont les mêmes dans tous les pays, leur langage n’est pas le même ; qu’il se ressent toujours des mœurs et des habitudes d’un peuple ; et qu’en France il est plus modifié par la crainte du ridicule ou par d’autres considérations qui n’existent pas ailleurs. Qu’on ne s’étonne pas aussi de voir Gustave revenir si souvent aux idées religieuses : son amour est combattu par la vertu, qui a besoin des secours de la religion ; et, d’ailleurs, n’est-il pas naturel d’attacher au Ciel des jours qui ont été troublés sur la terre ?
Mon sincère désir a été celui de présenter un ouvrage moral, de peindre cette pureté de mœurs dont on n’offre pas assez de tableaux et qui est si étroitement liée au bonheur véritable. J’ai pensé qu’il pouvoit être utile de montrer que les âmes les plus sujettes à être entraînées par de fortes passions sont aussi celles qui ont reçu le plus de moyens pour leur résister, et que le secret de la sagesse est de les employer à temps. Tout cela avoit été bien mieux dit, bien mieux démontré avant moi ; mais on ne résiste guère à l’envie de communiquer aux autres ce qui nous a profondément émus nous-mêmes. Il est un enthousiasme qui est à l’âme ce que le printemps est à la nature : il fait éclore mille sentimens, il fait verser des larmes auxquelles on croit le pouvoir d’en faire répandre d’autres.
C’était là ma situation en lisant les fragmens de
Gustave ; et si quelques regards attendris s’attachent sur cet ouvrage, comme sur un ami qui nous a révélé notre propre cœur, ils sauront tout à la fois et m’excuser et me défendre.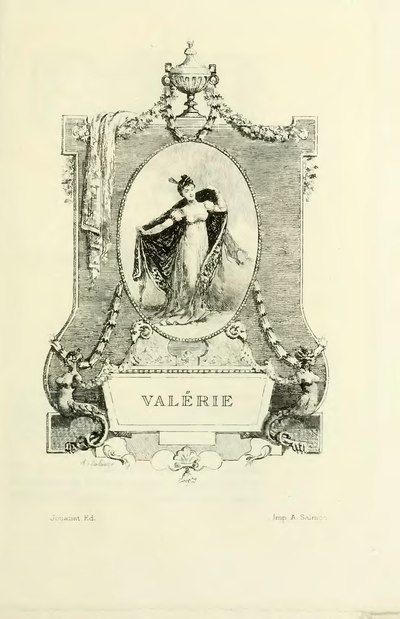
VALÉRIE
ou
LETTRES
DE GUSTAVE DE LINAR
LETTRE PREMIÈRE
Tu dois avoir reçu toutes mes lettres, Ernest : depuis que j’ai quitté Stockholm, je t’ai écrit plusieurs fois. Tu peux me suivre dans ce voyage, qui seroit enchanteur s’il ne me séparoit pas de toi. Oh ! pourquoi n’avons-nous pu réaliser ces rêves délectables de notre jeune âge, quand notre imagination s’élançoit dans ce grand univers, voyoit rouler d’autres cieux, entendoit gronder de plus terribles orages ! quand, assis ensemble sur ce rocher qui se séparoit des autres et qui nous donnoit l’idée de l’indépendance et de la fierté, nos cœurs battoient tantôt de mille pressentimens confus, tantôt se rejetoient dans la sombre antiquité, et voyoient sortir de ces ténèbres nos héros favoris ! Où sont-ils, ces jours radieux de fortes et de douces émotions ? Je t’ai quitté, aimable compagnon de ma jeunesse, sage ami qui réglois les mouvemens trop désordonnés de mon cœur, et endormois mes tumultueux désirs aux accens de ton âme ingénieuse et inspirée ! Cependant, Ernest, je suis quelquefois presque heureux ; il y a un charme enivrant dans ce voyage, qui souvent me ravit ; tout s’accorde bien avec mon cœur, et même avec mon imagination. Tu sais comme j’ai besoin de cette belle faculté, qui prend dans l’avenir de quoi augmenter encore la félicité présente ; de cette enchanteresse qui s’occupe de tous les âges et de toutes les conditions de la vie, qui a des hochets pour les enfans, et donne aux génies supérieurs les clefs du ciel, pour que leurs regards s’enivrent de hautes félicités… Mais où vais-je m’égarer ? Je ne t’ai rien dit encore du comte. Il a reçu toutes ses instructions ; il va décidément à Venise, et cette place est celle qu’il désiroit. Il se plaît dans l’idée que nous ne nous séparerons pas, qu’il pourra me guider lui-même dans cette nouvelle carrière où il a voulu que j’entrasse, et qu’il pourra, en achevant lui-même mon éducation, remplir le saint devoir dont il se chargea en m’adoptant. Quel ami, Ernest, que ce second père ! Quel homme excellent ! La mort seule a pu interrompre cette amitié qui le lioit à celui que j’ai perdu, et le comte se plaît à la continuer religieusement en moi. Il me regarde souvent ; je vois quelquefois des larmes dans ses yeux : il trouve que je ressemble beaucoup à mon père, que j’ai dans mon regard la même mélancolie ; il me reproche d’être, comme lui, presque sauvage et de craindre trop le monde. Je t’ai déjà dit comment j’ai fait la connoissance de la comtesse, de quelle manière touchante il me présenta à Valérie (c’est ainsi qu’elle se nomme et que je l’appellerai désormais) ; d’ailleurs, elle veut que je la regarde comme une sœur, et c’est bien là l’impression qu’elle m’a faite. Elle m’en impose moins que le comte : elle a l’air si enfant ! Elle est très vive, mais sa bonté est extrême. Valérie paroît aimer beaucoup son mari : je ne m’en étonne pas ; quoiqu’il y ait entre eux une grande différence d’âge, on n’y pense jamais. On pourroit trouver quelquefois Valérie trop jeune ; on a peine à se persuader qu’elle ait formé un engagement aussi sérieux ; mais jamais le comte ne paroît trop vieux. Il a trente-sept ans ; mais il n’a pas l’air de les avoir. On ne sait d’abord ce qu’on aime le plus en lui, ou de sa figure noble et élevée, ou de son esprit, qui est toujours agréable, qui s’aide encore d’une imagination vaste et d’une extrême culture ; mais, en le connoissant davantage, on n’hésite pas : c’est ce qu’il tire de son cœur qu’on préfère ; c’est quand il s’abandonne et qu’il se découvre entièrement qu’on le trouve si supérieur. Il nous dit quelquefois qu’il ne peut être aussi jeune dans le monde qu’il l’est avec nous, et que l’exaltation iroit mal avec une ambassade.
Si tu savois, Ernest, comme notre voyage est agréable ! Le comte sait tout, connoît tout, et le savoir en lui n’a pas émoussé la sensibilité. Jouir de son cœur, aimer et faire du bonheur des autres le sien propre, voilà sa vie ; aussi ne gêne-t-il personne. Nous avons plusieurs voitures, dont une est découverte ; c’est ordinairement le soir que nous allons dans celle-là. La saison est très belle. Nous avons traversé de grandes forêts en entrant en Allemagne ; il y avoit là quelque chose du pays natal qui nous plaisoit beaucoup. Le coucher du soleil surtout nous rappeloit à tous des souvenirs différens que nous nous communiquions quelquefois ; mais le plus souvent nous gardions alors le silence. Les beaux jours sont comme autant de fêtes données au monde ; mais la fin d’un beau jour, comme la fin de la vie, a quelque chose d’attendrissant et de solennel : c’est un cadre où vont se placer tout naturellement les souvenirs, et où tout ce qui tient aux affections paroît plus vif, comme au coucher du soleil les teintes paroissent plus chaudes. Que de fois mon imagination se reporte alors vers nos montagnes ! Je vois à leurs pieds notre antique demeure ; ces créneaux, ces fossés, si longtemps couverts de glaces, sur lesquels nous nous exercions, la lance à la main, à des jeux guerriers, glissant sur cette glace comme sur nos jours, que nous n’apercevions pas. Le printemps revenoit ; nous escaladions le rocher ; nous comptions alors ces vaisseaux qui venoient de nouveau tenter nos mers ; nous tâchions de deviner leur pavillon ; nous suivions leur vol rapide ; nous aurions voulu être sur leurs mâts, comme les oiseaux marins, les suivre dans des régions lointaines. Te rappelles-tu ce beau coucher du soleil, où nous célébrâmes ensemble un grand souvenir ? C’étoit peu après l’équinoxe. Nous avions vu la veille une armée de nuages s’avancer en présageant la tempête : elle fut horrible ; tous deux nous tremblions pour un vaisseau que nous avions découvert ; la mer étoit soulevée et menaçoit d’engloutir tous ces rivages. À minuit, nous entendîmes les signaux de détresse. Ne doutant pas que le vaisseau n’eût échoué sur un des bancs, mon père fit au plus vite mettre des chaloupes en mer ; au moment où il animoit les pilotes côtiers, il ne résista pas à nos instances, et, malgré le danger, il nous permit de l’accompagner. Oh ! comme nos cœurs battoient ! comme nous désirions être partout à la fois ! comme nous aurions voulu secourir chacun des passagers ! Ce fut alors que tu exposas si généreusement ta vie pour moi. Mais il faut rester fidèle à ma promesse ; il faut ne point te parler de ce qui te paroît si simple, si naturel ; mais au moins laisse-moi ma reconnoissance comme un de mes premiers plaisirs, si ce n’est comme un de mes premiers devoirs, et n’oublions jamais le rocher où nous retournâmes après cette nuit, et d’où nous regardions la mer en remerciant le Ciel de notre amitié.
Adieu, Ernest ; il est tard, et nous partons de grand matin.
LETTRE II
Ernest, plus que jamais elle est dans mon cœur, cette secrète agitation qui tantôt portoit mes pas sur les sommets escarpés des Koullen, tantôt sur nos désertes grèves. Ah ! tu le sais, je n’y étois pas seul : la solitude des mers, leur vaste silence ou leur orageuse activité, le vol incertain de l’alcyon, le cri mélancolique de l’oiseau qui aime nos régions glacées, la triste et douce clarté de nos aurores boréales, tout nourrissoit les vagues et ravissantes inquiétudes de ma jeunesse. Que de fois, dévoré par la fièvre de mon cœur, j’eusse voulu, comme l’aigle des montagnes, me baigner dans un nuage et renouveler ma vie ! Que de fois j’eusse voulu me plonger dans l’abîme de ces mers dévorantes, et tirer de tous les élémens, de toutes les secousses, une nouvelle énergie, quand je sentois la mienne s’éteindre au milieu des feux qui me consumoient !
Ernest, j’ai quitté tous ces témoins de mon inquiète existence ; mais partout j’en retrouve d’autres : j’ai changé de ciel ; mais j’ai emporté avec moi mes fantastiques songes et mes vœux immodérés. Quand tout dort autour de moi, je veille avec eux ; et, dans ces nuits d’amour et de mélancolie, que le printemps exhale et remplit de tant de délices, je sens partout cette volupté cachée de la nature, si dangereuse pour l’imagination, par le voile même qui la couvre : elle m’enivre et m’abat tour à tour ; elle me fait vivre et me tue ; elle arrive à moi par tous les objets et me fait languir après un seul. J’entends le vent de la nuit, il s’endort sur les feuilles, et je crois ouïr encore des pas incertains et timides ; mon imagination me peint cet être idéal après lequel je soupire, et je me jette tout entier dans ce pressentiment d’amour et d’extase qui doit remplir le vague de mon cœur. Hélas ! serai-je jamais aimé ? Verrai-je jamais s’exaucer ces brûlans et ambitieux désirs ? Donnerai-je un moment, un seul instant, tout le bonheur que je pourrai sentir ? Vivrai-je de ce don splendide qui fait toucher au ciel ? Ah ! ce n’est pas tout, Ernest, que de donner, il faut faire recevoir ; ce n’est pas tout de valoir beaucoup, il faut être senti de même. Pour faire mûrir la datte, il faut le sol d’Afrique ; pour faire naître ces grandes et profondes émotions qui nous viennent du ciel, il faut trouver sur la terre ces âmes ardentes et rares qui ont reçu la douce et peut-être la funeste puissance d’aimer comme moi.
LETTRE III
Mon ami, j’ai relu ce matin ma lettre d’hier ; j’ai presque hésité à te l’envoyer : non pas que je voulusse jamais te cacher quelque chose, mais parce que je sens que tu me reprocheras avec raison de ne pas chercher, comme je te l’avois promis, à réprimer un peu ce qu’il y a de trop passionné dans mon âme. Ne dois-je pas, d’ailleurs, cacher cette âme, comme un secret, à la plupart de ceux avec qui je serai appelé à vivre dans le monde ? Ne sais-je pas qu’il n’y a plus rien de naturel aux yeux de ces gens-là que ce qui nous éloigne de la nature, et que je ne leur paroîtrai qu’un insensé en ne leur ressemblant pas ? Laisse-moi donc errer avec mes chers souvenirs au milieu des forêts, au bord des eaux, où je me crée des êtres comme moi, où je rassemble autour de moi les ombres poétiques de ceux qui chantèrent tout ce qui élève l’homme, et qui surent aimer fortement. Là, je crois voir encore le Tasse soupirant ses vers immortels et son ardent amour ; là, m’apparoit Pétrarque au milieu des voûtes sacrées qui virent naître sa longue tendresse pour Laure ; là, je crois entendre les sublimes accords du tendre et solitaire Pergolèse ; partout je crois voir le génie et l’amour, ces enfans du ciel, fuyant la multitude et cachant leurs bienfaits comme leurs innocentes joies. Ah ! si je n’ai pas été doté comme les fils du génie, si je ne puis charmer comme eux la postérité, au moins j’ai respiré comme eux quelque chose de cet enthousiasme, de ce sublime amour du beau, qui vaut peut-être mieux que la gloire elle-même.
Cependant, mon Ernest, ne crois pas que je m’abandonne sans réserve à mes rêveries. Quoique le comte soit un des hommes dont l’âme ait gardé le plus de jeunesse, si je puis m’exprimer ainsi, il m’en impose trop pour que je ne voile pas une partie de mon âme. Je cherche surtout à ne pas paroître extraordinaire à Valérie, qui, si jeune, si calme, me paroît comme un rayon matinal qui ne tombe que sur des fleurs et ne connoît que leur tranquille et douce végétation.
Je ne saurois mieux te peindre Valérie qu’en te nommant la jeune Ida, ta cousine. Elle lui ressemble beaucoup ; cependant elle a quelque chose de particulier que je n’ai encore vu à aucune femme. On peut avoir autant de grâce, beaucoup plus de beauté, et être loin d’elle. On ne l’admire peut-être pas, mais elle a quelque chose d’idéal et de charmant qui force à s’en occuper. On diroit, à la voir si délicate, si svelte, que c’est une pensée. Cependant, la première fois que je la vis, je ne la trouvai pas jolie. Elle est très pâle ; et le contraste de sa gaieté, de son étourderie même, et de sa figure, qui est faite pour n’être que sensible et sérieuse, me fit une impression singulière.
J’ai vu depuis que ces momens où elle ne me paroissoit qu’une aimable enfant étoient rares. Son caractère habituel a plutôt quelque chose de mélancolique ; et elle se livre quelquefois à une excessive gaieté, comme les personnes extrêmement sensibles, et qui ont les nerfs très mobiles, passent à des situations tout à fait étrangères à leurs habitudes.
Le temps est beau ; nous nous promenons beaucoup ; le soir, nous faisons quelquefois de la musique : j’ai mon violon avec moi ; Valérie joue de la guitare ; nous lisons aussi : c’est une véritable fête que ce voyage.
LETTRE IV
Mon ami, ce n’est que d’aujourd’hui que je connois bien Valérie. Jusqu’à présent elle avoit passé devant mes yeux comme une de ces figures gracieuses et pures dont les Grecs nous dessinèrent les formes, et dont nous aimons à revêtir nos songes ; mais je croyois son âme trop jeune, trop peu formée, pour deviner les passions ou pour les sentir ; mes timides regards aussi n’osoient étudier ses traits. Ce n’étoit pas pour moi une femme avec l’empire que pouvoient lui donner son sexe et mon imagination ; c’étoit un être hors des limites de ma pensée : Valérie étoit couverte de ce voile de respect et de vénération que j’ai pour le comte, et je n’osois le soulever pour ne voir qu’une femme ordinaire. Mais aujourd’hui, oui, aujourd’hui même, une circonstance singulière m’a fait connoître cette femme, qui a aussi reçu une âme ardente et profonde. Oui, Ernest, la nature acheva son ouvrage, et, comme ces vases sacrés de l’antiquité, dont la blancheur et la délicatesse étonnent les regards, elle garde dans son sein une flamme subtile et toujours vivante.
Écoute, Ernest, et juge toi-même si j’avois connu jusqu’à présent Valérie. Elle avoit eu envie aujourd’hui d’arriver de meilleure heure pour dîner : le comte avoit envie d’avancer, mais il a cédé ; au lieu d’envoyer le courrier, il est monté lui-même à cheval pour faire tout préparer. Quand nous sommes arrivés, Valérie l’a remercié avec une grâce charmante ; ils se sont promenés un instant ensemble, et tout à coup le comte est revenu seul et d’un air assez embarrassé. Il m’a dit : « Nous dînerons seuls ; Valérie préfère ne pas manger encore. » J’ai été fort étonné de ce caprice, et déjà j’avois cru m’apercevoir qu’elle avoit de l’inégalité dans le caractère. Nous nous sommes hâtés de finir le repas. Le comte m’a prié de faire prendre du fruit dans la voiture, croyant que cela feroit plaisir à sa femme. Je sortis du bourg, et je trouvai la comtesse avec Marie, jeune femme de chambre qui a été élevée avec elle, et qu’elle aime beaucoup ; elles étoient toutes deux auprès d’un bouquet d’arbres. Je m’avançai vers Valérie, et je lui offris du fruit, ne sachant trop que lui dire ; elle rougit, elle paroissoit avoir pleuré, et je sentois que je ne lui en voulois plus. Elle avoit quelque chose de si intéressant dans la figure, sa voix étoit si douce quand elle me remercia, que j’en fus très ému. « Vous aurez été étonné, me dit-elle avec une espèce de timidité, de ne pas m’avoir vue au dîner ? — Pas du tout », lui répondis-je, extrêmement embarrassé. Elle sourit. « Puisque nous devons être souvent ensemble, continua-t-elle, il est bon que vous vous accoutumiez à mes enfantillages. » Je ne savois que répondre : je lui offris mon bras pour s’en retourner, car elle s’étoit levée. « Êtes-vous incommodée, Madame ? lui dis-je enfin ; le comte le craignoit. — S’est-il informé où j’étois ? me demanda-t-elle précipitamment. — Je crois qu’il vous cherche, lui répondis-je. — Votre dîner a été cependant assez long. » Je l’assurai que nous avions été peu de temps à table. « Cela m’a paru fort long », m’a-t-elle répondu. Elle regardoit autour d’elle très souvent pour voir si elle n’apercevoit pas le comte, quand un des gens est venu avertir que les chevaux étoient mis. « Et mon mari, a-t-elle demande, où est-il ? — Monsieur a pris les devans, à pied, a répondu cet homme, après avoir ordonné qu’on mît les chevaux pour que madame n’arrivât pas de nuit, à cause des mauvais chemins. — C’est bon », a dit Valérie d’une voix qu’elle cherchoit à maîtriser… Mais je m’apercevois de toute son agitation. Nous sommes entrés dans la voiture ; je me suis assis vis-à-vis d’elle. D’abord elle a été pensive ; puis elle a cherché à cacher ce qui la tourmentoit ; elle a ensuite essayé de paroître avoir oublié ce qui s’étoit passé ; elle m’a parlé de choses indifférentes ; elle a tâché d’être gaie, me racontant plusieurs anecdotes fort plaisantes sur V…, où nous devions arriver bientôt.
Je remarquois qu’elle mettoit souvent la tête à la portière pour voir si elle n’apercevroit pas le comte ; elle faisoit dire au postillon d’avancer, parce qu’elle craignoit qu’il ne se fatiguât à force de marcher. À mesure que nous avancions, elle parloit moins et redevenoit pensive : elle s’étonna de ce que nous ne rejoignions point son mari. « Il marche très vite », lui répondis-je ; mais je m’en étonnois aussi. Nous traversâmes une grande forêt : l’inquiétude de Valérie augmentoit toujours ; elle devint extrême. À la fin, elle étoit descendue ; elle devançoit les voitures, croyant se distraire par une marche précipitée ; elle s’appuyoit sur moi, s’arrêtoit, vouloit retourner sur ses pas ; enfin, elle souffroit horriblement. Je souffrois presque autant qu’elle ; je lui disois que sûrement nous trouverions le comte arrivé à la poste, qu’il auroit pris un chemin de traverse, et je le pensois. Malheureusement, on lui avoit parlé d’une bande de voleurs qui, quinze jours auparavant, avoient attaqué une voiture publique. Je sentois croître mon intérêt pour elle à mesure que son inquiétude augmentoit : j’osois la regarder, interroger ses traits ; notre position me le permettoit. Je voyois combien elle savoit aimer, et je sentois l’empire que doivent prendre sur d’autres âmes les âmes susceptibles de se passionner. J’éprouvois une espèce d’angoisse, que son angoisse me donnoit ; mon cœur battoit ; et en même temps, Ernest, j’éprouvois quelque chose de délicieux quand elle me regardoit avec une expression touchante, comme pour me remercier du soin que je prenois.
Nous arrivâmes à la poste ; le comte n’y étoit pas. Valérie se trouva mal ; elle eut une attaque de nerfs qui me fit frémir. Ses femmes couroient pour chercher du thé, de la fleur d’orange ; j’étois hors de moi. L’état de Valérie, l’absence du comte, un trouble inexprimable que je n’avois jamais senti, tout me faisoit perdre la tête. Je tenois les mains glacées de Valérie ; je la conjurois de se calmer : je lui dis, pour la tranquilliser, que tous les voyageurs alloient voir un château, très près du grand chemin, dont la position étoit singulière. Dès que je la vis un peu moins souffrante, je pris avec moi deux hommes du pays, et nous nous dispersâmes pour aller à sa recherche. Après une demi-heure de marche, je le trouvai qui se hâtoit d’arriver : il s’étoit égaré. Je lui dis combien Valérie avoit souffert ; il en fut extrêmement fâché. Quand nous fûmes près d’arriver à la maison de poste, je me mis à courir de toutes mes forces pour annoncer le comte et pour être le premier à donner cette bonne nouvelle. J’eus un moment bien heureux en voyant tout le bonheur de Valérie. Je retournai alors vers le comte, et nous entrâmes ensemble ; Valérie se jeta à son cou. Elle pleuroit de joie ; mais, l’instant d’après, paroissant se rappeler tout ce qu’elle avoit souffert, elle gronda le comte, lui dit qu’il étoit impardonnable de l’avoir exposée à toutes ces inquiétudes, de l’avoir quittée sans lui rien dire ; elle repoussoit son mari, qui vouloit l’embrasser. « Oui, il est impardonnable, dit-elle, d’écouter son ressentiment. — Mais je n’étois pas fâché, lui dit-il. — Comment ! vous n’étiez pas fâché ? — Non, ma chère Valérie, soyez-en sûre ; je voulois éviter une explication. Je sais que vous êtes vive, que cela vous fait mal ; je sais aussi combien vous vous apaisez facilement : vous êtes si bonne, Valérie ! » Elle avoit les larmes aux yeux ; elle prit sa main d’une manière touchante. « C’est moi qui ai tort, dit-elle ; je vous en demande bien pardon. Comment ai-je pu me fâcher d’un mot qui n’étoit sûrement pas dit pour me faire de la peine ? Oh ! combien vous êtes meilleur que moi ! « J’aurois voulu me jeter à ses pieds, lui dire qu’elle étoit un ange. Le comte, qui est si sensible, ne m’a pas paru assez reconnoissant.
LETTRE V
Je t’ai dit que nous devions passer quelques jours ici pour que Valérie se reposât : ces jours ont été les plus agréables de ma vie. Il me semble qu’elle a plus de confiance en moi depuis que je la connois mieux ; elle pense, je crois, que je ne m’étonne plus de quelques petites inégalités d’humeur, dont je dois maintenant connoître la source. Une très grande sensibilité empêche d’avoir une attention continuelle sur soi-même. Les âmes froides n’ont que les jouissances de l’amour-propre ; elles croient que le calme et la méthode qu’elles portent dans toutes leurs actions et dans toutes leurs paroles leur attireront la considération de ceux qui les observent ; elles savent pourtant bien aussi se fâcher et se réjouir ; mais c’est pour des riens, et c’est toujours au dedans d’elles-mêmes ; elles craignent jusqu’aux traits de leur visage, comme des dénonciateurs qui vont raconter ce qui se passe au logis. Absurde prétention, de prendre pour sagesse ce qui vient de l’aridité du cœur !
Jamais Valérie ne me paroît plus aimable, plus touchante, que quand sa vivacité l’a emportée un instant et qu’elle cherche à racheter un tort. Et quel tort ! celui d’aimer comme on ne sait pas aimer dans le monde. Je l’observois l’autre jour, lorsqu’elle reçut une lettre de sa mère ; je la lisois avec elle en suivant sa physionomie. Et, quand après cela elle sera ou triste ou préoccupée, qu’elle ne saura pas, avec une étude parfaite de dissimulation, approuver tout ce qu’on lui propose, sourire à ce qui l’ennuie, appellera-t-on cela des caprices ? Et pourtant elle veut racheter comme des torts ces momens où elle ne peut appartenir qu’à l’idée qui domine son âme ! La meilleure des filles, la plus aimante des femmes voudroit être à la fois et profondément sensible, et toujours attentive à ne jamais contrarier les autres ! Et quand on me diroit : « Il y a des femmes plus parfaites », je répondrai : « Valérie n’a que seize ans. » Ah ! qu’elle ne change jamais ! qu’elle soit toujours cet être charmant que je n’avois vu jusqu’à présent que dans ma pensée !
LETTRE VI
Je me promenois ce matin avec Valérie dans un jardin au bord d’une rivière. Elle a demandé le déjeuner ; on nous a apporté des fraises, qu’elle a voulu me faire manger à la manière de notre pays, car elle m’avoit entendu dire que cela me rappeloit les repas que je faisois avec ma sœur, et nous envoyâmes chercher de la crème. Nous avions avec nous quelques fragmens du poème de l’Imagination, que nous lisions en déjeunant. Tu sais combien j’aime les beaux vers ; mais les beaux vers, lus avec Valérie, prononcés avec son organe charmant, assis auprès d’elle, environné de toutes les magiques voix du printemps qui sembloient me parler, et dans cette eau qui couroit, et dans ces feuilles doucement agitées comme mes pensées ! Mon ami, j’étois bien heureux, trop heureux peut-être ! Ernest, cette idée seroit terrible ; elle porteroit la mort dans mon âme, qu’habite la félicité ; je n’ose l’approfondir.
Valérie fut émue en lisant l’épisode enchanteur d’Amélie et de Volnis ; et, quand elle arriva à ces vers :
En longs et noirs anneaux s’assembloient ses cheveux ;
Ses yeux noirs, pleins d’un feu que son mal dompte à peine,
Étinceloient encor sous deux sourcils d’ébène…
« Savez-vous que cela vous ressemble beaucoup ? » J’ai rougi d’embarras, et puis j’ai pensé : « Ah ! si vous étiez mon Amélie ! » Mais soudain je me suis reproché ma pensée comme un crime, et c’en étoit bien un. Je me suis levé, je me suis enfui ; j’ai été m’enfoncer dans la forêt voisine, comme si j’avois pu m’éloigner de cette coupable pensée.
Après une course assez rapide, réfléchissant à ce que penseroit de moi Valérie, que j’avois quittée si ridiculement, je résolus de revenir à la maison et de lui demander pardon. Cherchant dans ma tête une excuse et n’en trouvant point, je cueillois en chemin des marguerites pour les lui apporter, et je me mis, sans y penser, à les interroger en les effeuillant, comme nous avions fait tant de fois dans notre enfance. Je me disois : « Comment suis-je aimé de Valérie ? « J’arrachois les feuilles l’une après l’autre jusqu’à la dernière ; elle dit : Pas du tout. Le croirois-tu ? cela m’affligea.
J’ai voulu aussi savoir comment j’aimois Valérie. Ah ! je le savois bien ; mais je fus effrayé de trouver, au lieu de beaucoup : passionnément ; cela m’épouvanta. Ernest, je crois que j’ai pâli. J’ai voulu recommencer, et encore une fois la feuille a dit : Passionnément. Mon ami, étoit-ce ma conscience qui donnoit une voix à cette feuille ? Ma conscience sauroit-elle déjà ce que j’ignore moi-même, ce que je veux ignorer toute ma vie ? Ce que tu ne croirois jamais si on te le disoit, toi qui me connois si bien, toi qui sais que jamais je ne fus léger, que la femme d’un autre fut toujours un objet sacré pour moi ? Et j’aimerois Valérie ! Non, non,
Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes.
Sois tranquille, Ernest, tu n’auras pas besoin de me rejeter loin de toi.
LETTRE VII
Je suis bien sûr, mon ami, que la crainte seule d’aimer celle que je n’ose nommer (car je dois la respecter trop pour associer son nom à une idée qui m’est défendue) m’a fait croire… Je ne sais t’exprimer ce que je sens, cela doit être obscur pour toi ; voici quelque chose de plus clair. Ce soir, arrivant dans un village d’Autriche et trouvant qu’il étoit plus tard qu’on ne pensoit, le comte s’est décidé à passer la nuit dans cet endroit. On a dressé le lit de Valérie, et, pendant qu’on arrangeoit son appartement, nous sommes tous passés dans une jolie salle qu’on venoit de peindre et d’approprier avec assez d’élégance. Il y avoit là quelques mineurs qui jouoient des valses. Tu sais combien on cultive la musique en Allemagne. Quelques jeunes filles qui étoient venues voir l’hôtesse valsoient ; elles étoient presque toutes jolies, et nous nous amusions à voir leur gaieté et leur petite coquetterie villageoise. Valérie, avec sa vivacité ordinaire, a appelé ses deux femmes de chambre ; elle vouloit aussi leur donner le plaisir de la danse. Bientôt le bal a cessé, les musiciens seuls sont restés. Le comte est venu prendre Valérie et l’a fait valser, quoiqu’elle s’en défendît, ayant une espèce d’éloignement pour cette danse que sa mère n’aimoit pas. Quand il eut fait deux ou trois fois le tour de la salle, il s’arrêta devant moi. « Je serai spectateur à mon tour, a-t-il dit, Gustave, Valérie vous permet de finir la danse avec elle. » Mon cœur a battu avec violence ; j’ai tremblé comme un criminel ; j’ai hésité longtemps si j’oserois passer mon bras autour de sa taille. Elle a souri de ma gaucherie. J’ai frémi de bonheur et de crainte ; ce dernier sentiment est resté dans mon cœur, il m’a persécuté jusqu’à ce que j’aie été complètement rassuré. Voici comment je suis devenu plus tranquille.
La soirée étoit si belle que le comte nous a proposé une promenade. Il avoit donné le bras à Valérie, je marchois à côté de lui ; il faisoit assez sombre, les étoiles seules nous éclairoient. La conversation se ressent toujours des impressions que reçoit l’imagination ; la nôtre est devenue sérieuse et même mélancolique comme la nuit qui nous environnoit. Nous avons parlé de mon père ; nous nous sommes rappelé, le comte et moi, plusieurs traits de sa vie qui mériteroient d’être publiés pour faire l’admiration de tous ceux qui savent sentir et aimer le beau. Nous avons mêlé nos tristes et profonds regrets, et parlé de cette belle espérance que l’Être suprême laissa surtout à la douleur : car ceux-là seuls qui ont beaucoup perdu savent combien l’homme a besoin d’espérer. À mesure que le comte parloit, je sentois mon affection pour lui s’augmenter de toute sa tendresse pour mon père. « Quelle douce immortalité, pensois-je, que celle qui commence déjà ici-bas dans le cœur de ceux qui nous regrettent ! »
Que j’aimois cet homme si bon qui sait connoître ainsi l’amitié ! l’amitié que tant d’hommes croient chérir, et que si peu savent honorer dans tous ses devoirs ! Comme mon cœur éprouvoit alors ce sentiment pour le comte ! J’y mêlois ce qui le rend à jamais sacré, la reconnoissance. Il me sembloit que mon cœur épuré ne contenoit plus que ces heureuses affections qui se réfléchissoient doucement sur Valérie. Nous nous étions assis, la lune s’étoit levée, les lumières s’éteignoient peu à peu dans le village, quelques chevaux paissoient autour de nous, et les eaux argentées et rapides d’un ruisseau nous séparoient de la prairie. « J’ai de tout temps aimé passionnément une belle nuit, dit le comte, il me semble qu’elle a toujours mille secrets à dire aux âmes sérieuses et tendres ; je crois aussi que j’ai conservé cette prédilection pour la nuit, parce qu’on me tourmentoit le jour. — Vous n’étiez pas heureux dans votre enfance ? — Ni dans ma jeunesse, ma chère Valérie. » Il soupira. « Mais j’ai sauvé ce qu’il y a de si précieux à conserver, une âme qui n’a jamais désespéré du bonheur. Le passé est pour moi comme une toile rembrunie qui attend un beau tableau qui n’en ressortira que davantage. C’est maintenant votre ouvrage à tous deux, mes amis, dit-il en tendant ses bras vers nous ; c’est à vous à conduire doucement mes jours. » Valérie l’embrassa avec tendresse ; je me jetai aussi à son cou ; je ne pus proférer une seule parole. Quel serment pouvoit valoir les larmes que je versois ? Jamais je n’oublierai ce moment, il m’a rendu le calme et le courage.
LETTRE VIII
J’ai voulu renoncer à une partie de ces douces habitudes qui étoient devenues un besoin pour moi, et qui pouvoient devenir dangereuses. J’ai demandé au comte la permission d’aller dans une autre voiture, au moins quelquefois, et j’ai prétexté l’envie que j’avois d’apprendre l’italien, afin de savoir quelque chose de cette langue quand nous arriverions à Venise. J’ai bien vu que Valérie ainsi que son mari me trouvoient bizarre ; mais enfin ils ne m’ont point empêché de suivre mon nouveau plan. J’évite aussi de me promener seul avec elle. Il y a un charme si ravissant dans cette belle saison auprès d’un objet aussi aimable ! respirer cet air, marcher sur ces gazons, s’y asseoir, s’environner du silence des forêts, voir Valérie, sentir aussi vivement ce qui me donneroit déjà sans elle tant de bonheur ; dis, mon ami, ne seroit-ce pas défier l’amour ?
Le soir, quand nous arrivions, et que, fatiguée de la route, elle se couchoit sur un lit de repos, je venois toujours m’établir avec le comte auprès d’elle ; mais il se mettoit dans un coin à écrire, et moi, j’aidois Marie à faire le thé : c’étoit moi qui en apportois à Valérie, et qu’elle grondoit quand il n’étoit pas bon. Ensuite c’étoit sa guitare que je lui accordois. J’en joue mieux qu’elle ; il m’est arrivé de placer ses doigts sur les cordes dans un passage difficile ; ou bien je dessinois avec elle ; je l’amusois en lui faisant toutes sortes de ressemblances. Ne m’est-il pas arrivé de la dessiner elle-même ! Conçois-tu une pareille imprudence ? Oui, j’ai esquissé ses formes charmantes, elle portoit sur moi ses yeux pleins de douceur, et j’avois la démence de les fixer, de me livrer, comme un insensé, à leur dangereux pouvoir. Eh bien ! Ernest, je suis devenu plus sage ; il est vrai que cela me coûte bien cher : je perds non seulement tout le bonheur que j’éprouvois dans cette douce familiarité (je ne devrois pas le regretter, puisqu’il pouvoit me conduire à des remords), mais je perdrai peut-être la confiance de Valérie, elle commençoit à me témoigner de l’amitié. Hier, en arrivant dans la ville où nous devions coucher, j’ai vite demandé ma chambre. « Allez-vous donc encore vous enfermer ? m’a-t-elle dit ; vous devenez bien sauvage. » Elle avoit l’air mécontent en disant cela ; je l’ai suivie, j’ai arrangé le feu, porté des paquets, taillé des plumes pour le comte, afin de cacher l’embarras que me donne une situation toute nouvelle. Je croyois, à force d’attentions qui rappeloient la politesse, suppléer à toutes ces inspirations du cœur qui ne sont nullement calculées. Aussi Valérie s’en est-elle aperçue. « On croiroit, dit-elle, que nous vous avons reproché de ne pas assez vous occuper de nous, et que vous voulez nous cacher que vous vous ennuyez. » Je me suis tu ; il m’étoit également impossible et de la tirer de son erreur, et de ne lui dire que quelques phrases qui n’eussent été qu’agréables. J’avois l’air sûrement bien triste, car elle m’a tendu la main avec bonté, et m’a demandé si j’avois du chagrin. J’ai fait un signe de tête comme pour dire oui, et les larmes me sont venues aux yeux.
Ernest, je suis triste, et ne veux pas m’occuper de ma tristesse. Je te quitte, pardonne-moi ces éternelles répétitions.
LETTRE IX
Je suis extrêmement troublé, mon ami, je ne sais ce que tout cela deviendra ; sans que je l’eusse voulu, Valérie s’est aperçue qu’il y avoit quelque chose d’extraordinaire et d’affligeant dans mon cœur. Elle m’a fait appeler ce soir pour tirer des papiers d’une cassette que Marie ne pouvoit pas ouvrir. Le comte étoit sorti pour se promener. Ne voulant pas sortir brusquement, j’ai pris un livre et lui ai demandé si elle désiroit que je lui lusse quelque chose. Elle m’a remercié, en disant qu’elle alloit se coucher. « Je ne suis pas bien », a-t-elle ajouté ; puis, me tendant la main : « Je crois que j’ai de la fièvre. » Il a bien fallu toucher sa main : j’ai frissonné ; je tremblois tellement qu’elle s’en est aperçue. « C’est singulier, a-t-elle dit, vous avez si froid, et moi, si chaud ! » Je me suis levé avec précipitation, voyant qu’elle étoit debout devant moi ; je lui ai dit qu’en effet j’avois très froid et très mal à la tête. « Et vous vouliez vous gêner et rester ici pour me faire la lecture ? — Je suis si heureux d’être avec vous, ai-je dit timidement. — Vous êtes changé depuis quelque temps, et je crains bien que vous ne vous ennuyiez quelquefois. Vous regrettez peut-être votre patrie, vos anciens amis ? Cela seroit bien naturel. Mais pourquoi nous craindre ? pourquoi vous gêner ? » Pour toute réponse, je levois les yeux au ciel et je soupirois. « Mais qu’avez-vous donc ? » me dit-elle d’un air effrayé. Je m’appuyai contre la cheminée sans répondre ; elle a soulevé ma tête, et, d’un air qui m’a rappelé à moi, elle m’a dit : « Ne me tourmentez pas, parlez, je vous en prie. » Son inquiétude m’a soulagé ; elle m’interrogeoit toujours. J’ai mis ma main sur mon cœur oppressé, et je lui ai dit à voix basse : « Ne me demandez rien, abandonnez un malheureux. » Mes yeux étoient sans doute si égarés qu’elle m’a dit : « Vous me faites frémir. » Elle a fait un mouvement comme pour mettre sa main sur mes yeux. « Il faut absolument que vous parliez à mon mari, a-t-elle dit, il vous consolera. » Ces mots m’ont rendu à moi-même ; j’ai joint les mains avec une expression de terreur. « Non, non, ne lui dites rien. Madame, par pitié, ne lui dites rien. » Elle m’a interrompu : « Vous le connoissez bien mal, si vous le redoutez ; d’ailleurs, il s’est aperçu que vous aviez du chagrin, nous en avons parlé ensemble, il croit que vous aimez… » Je l’interrompis avec vivacité : il me sembloit qu’un trait de lumière étoit envoyé à mon secours pour me tirer de cette terrible situation. « Oui, j’aime, lui dis-je en baissant les yeux et en cachant mon visage dans mes mains pour qu’elle n’y vît pas la vérité, j’aime à Stockholm une jeune personne. — Est-ce Ida ? » me dit-elle. Je secouai la tête machinalement, voulant dire non. « Mais, si c’est une jeune personne, ne pouvez-vous pas l’épouser ? — C’est une femme mariée, dis-je en fixant mes yeux à terre et soupirant profondément. — C’est mal, me dit-elle vivement. — Je le sais bien », dis-je avec tristesse. Elle se repentit apparemment de m’avoir affligé, et ajouta : « C’est encore plus malheureux : on dit que les passions donnent des tourmens si terribles ; je ne vous gronderai plus quand vous serez sauvage ; je vous plaindrai ; mais promettez-moi de faire vos efforts pour vous vaincre. — Je le jure », dis-je, enhardi par le motif qui me guidoit ; et, prenant sa main : « Je le jure à Valérie, que je respecte comme la vertu, que j’aime comme le bonheur qui a fui loin de moi. » Il me sembloit que je voyois un ange qui me réconcilioit avec moi-même, et je la quittai.
LETTRE X
Aujourd’hui, en montant en voiture, je suis resté seul un instant avec Valérie ; elle m’a demandé avec tant d’intérêt comment je me trouvois que j’en ai été profondément ému. » Je n’ai rien dit à mon mari de notre conversation ; j’ignorois si cela ne vous embarrasseroit pas : il est des choses qui échappent, et qu’on ne confieroit pas ; votre secret restera dans mon cœur jusqu’à ce que vous me disiez vous-même de parler. Cependant, je ne puis m’empêcher de vous dire qu’à votre place je voudrois être guidé par un ami comme le comte : si vous saviez comme il est bon et sensible ! — Ah ! je le sais, lui dis-je, je le sais » ; mais je sentois en moi-même que je pouvois tromper Valérie, et m’enorgueillir même de mon subterfuge, et qu’il m’étoit impossible de tromper le comte volontairement. « Je me suis rappelé encore, a dit Valérie, que j’ai pu vous induire en erreur hier pendant notre conversation : je vous ai dit que votre ami s’étoit aperçu que vous aviez du chagrin ; c’est vrai, j’ai ajouté : « Il croit que vous « aimez » ; j’allois achever, et vous m’avez interrompue avec vivacité, croyant que je vous parlois de votre amour, tant le cœur se persuade facilement qu’on s’occupe de ce qui l’occupe ! J’avois tout autre chose à vous dire… Mais je vois le comte qui s’avance, tranquillisez-vous, il ne sait rien. »
Ernest, vit-on jamais une plus angélique bonté ? Et ne pas oser lui dire tout ce qu’elle inspire ! Lui faire croire, lui persuader qu’on en peut aimer une autre quand une fois on l’a connue. Ô mon ami, cet effort est bien grand !
LETTRE XI
Nous sommes arrivés à Vienne. Le comte m’a prié d’aller avec lui dans le monde : j’y étois décidé. Il faut bien m’éloigner, autant que je le pourrai, de Valérie ; elle est résolue à ne point faire de connoissance ici, à rester chez elle et à ne voir qu’une jeune femme avec qui elle a passé quelque temps à Stockholm.
Le comte m’a regardé hier de manière à m’embarrasser beaucoup ; il m’a reproché doucement d’avoir de l’inégalité dans le caractère, d’être singulier : j’ai rougi. « Votre père, mon cher Gustave, avoit le même besoin d’être seul ; sa santé délicate lui faisoit redouter le grand monde ; mais, à votre âge, mon ami, il faut apprendre à vivre avec les hommes. Et que deviendrez-vous un jour, si, à vingt ans, vous fuyez vos meilleurs amis ? » Depuis huit jours je n’ai pas été un instant sans chercher à m’éviter moi-même ; j’ai senti toute la fatigue attachée à l’envie de s’amuser. J’ai vu des bals, des dîners, des spectacles, des promenades, et j’ai dit cent fois que j’admirois la magnificence de cette ville tant vantée par les étrangers. Cependant je n’ai pas obtenu un seul moment de plaisir. La solitude des fêtes est si aride ! celle de la nature nous aide toujours à tirer quelque chose de satisfaisant de notre âme ; celle du monde nous fait voir une foule d’objets qui nous empêchent d’être à nous et ne nous donnent rien.
Si je pouvois observer, former mon jugement, m’amuser des ridicules ; mais je sens trop vivement pour que cela me soit possible. Si j’osois m’occuper de l’objet que je fuis, je ne me trouverois plus seul au milieu de ces rassemblemens : je parlerois à Valérie absente, et n’écouterois personne ; mais je ne puis me permettre ce dangereux plaisir, et je travaille sans cesse à en éloigner la pensée.
LETTRE XII
Cette lettre, cher Gustave, t’apportera au milieu des beaux pays que tu habites maintenant les parfums de notre printemps et les souvenirs de la patrie. Oui, mon ami, les cieux se sont ouverts, des milliers de fleurs sont revenues sur les prairies de Hollyn, que nos pieds foulèrent si souvent ensemble. Que ne sommes-nous encore réunis ! nous traverserions ces vastes forêts, nous poursuivrions l’élan jusque dans ses retraites les plus cachées, mais, sans le blesser, nous le laisserions à sa sauvage liberté, et, charmés de silence et de solitude, nous nous reposerions, comme nous le fîmes si souvent, de nos courses vagabondes. Ce besoin d’errer sans projet, sans dessein, t’ôtoit quelque chose de ces forces trop actives, trop dévorantes. Oh ! que n’es-tu encore ici, que ne calmes-tu ainsi cette agitation de ton âme, qui te jette maintenant dans des dangers que je crains tant pour toi ! Tu le sais, Gustave, je n’ai jamais redouté l’amour, il est désarmé, pour moi, par la tranquillité de mon imagination, par une foule d’habitudes douces, de sensations peut-être monotones, mais qui par là même ont un empire continuel. Ma vie se compose d’un doux bien-être, et je ressemble à ces végétaux de l’Inde que la nature destina à garantir de l’orage, puisque l’orage ne les frappe jamais. C’est ainsi que je me crois plus fait que bien d’autres pour calmer, pour diriger un peu les mouvemens trop exaltés de ton âme. Ce n’est pas ton absence seule qui me chagrine, c’est cette passion que chaque jour verra augmenter avec les charmes, et surtout avec les vertus de Valérie. Oui, Gustave, elle croîtra avec ces dangereuses compagnes, elle consumera ces forces avec lesquelles tu luttes encore. Oh ! crois-moi, reviens, arrache-toi à ces funestes habitudes ! Ouvre ton âme à cet ami que tu m’as appris à respecter, reviens ; n’a-t-il pas pour but ton bonheur, et pour règle ses devoirs ? Ton âme vaste et grande le frappa, il te crut propre aux plus brillans développemens ; et, mûri lui-même par l’expérience, appelé à cette auguste adoption par l’amitié, il voulut être ton père, et achever, dans la patrie des arts, cette éducation déjà si heureusement commencée. Mais, s’il voyoit cette même âme dévastée, ces grandes facultés anéanties ; s’il voyoit ton bonheur s’engloutir dans un terrible naufrage ; dis-moi, lui-même ne seroit-il pas inconsolable ? Encore une fois, reviens, change ta dévorante et délicieuse fièvre contre plus de tranquillité. Que dis-je ? ta délicieuse fièvre ! non, non, Gustave n’a point d’ivresse ; pour lui l’amour n’a que des tourmens, et ses félicités n’arrivent dans son sein que comme des poignards qui le déchirent.
Adieu, mon ami, je compte t’écrire bientôt et te parler d’Ida, qui, malgré la coquetterie que tu lui reproches et ses petites imperfections, ne laisse pas que d’être bien bonne et bien aimable.
(La réponse à cette lettre d’Ernest ne s’est point retrouvée.)
LETTRE XIII
Oh ! Ernest, je suis le plus malheureux des hommes : Valérie est malade ; elle est peut-être en danger ; je ne puis t’écrire, j’ai la fièvre, je sens tous les battemens de mon cœur contre la table où je suis appuyé ; je ne pourrois compter les tourmens que j’ai endurés depuis ce matin.
Elle va mieux, elle est tranquille. Ô Valérie ! Valérie ! avois-je besoin de ces craintes pour savoir qu’il n’est plus de ressource pour moi, que je t’aime comme un insensé ! C’en est fait : il est inutile de lutter contre cette funeste passion. Ô Ernest ! tu ne sais pas combien je suis malheureux. Mais puis-je me plaindre ? elle est mieux, elle est hors de danger. Tu ne sais pas comment elle est devenue malade ; c’est une chute, mais cette chute n’eût été rien, si… Quelle agitation il m’est resté, quel supplice ! Ma tête est bouleversée ! Mais je veux absolument t’écrire ; je veux que tu saches combien je suis foible et malheureux.
Le comte m’annonça, il y a quelques jours, que nous partirions dans peu, afin d’arriver à Venise, de nous y établir ; il ajouta que Valérie avoit besoin de repos, que son état l’exigeoit. Son état ! Ernest, cela me frappa. Et quand le comte me dit qu’elle deviendroit mère, qu’il me le dit avec joie, crois-tu qu’au lieu de l’en féliciter je restois dans une espèce de stupeur ? mes bras, au lieu de chercher le comte pour l’embrasser, pour lui témoigner ma joie, se sont croisés machinalement sur moi-même ; je trouvois qu’il y avoit de la cruauté à exposer cette jeune et charmante Valérie ; j’ai beaucoup souffert, et le comte s’en est aperçu. Il m’a dit avec bonté : « Vous ne m’écoutez pas » ; et, voyant que je portois la main à ma tête, il m’a demandé si j’étois malade. « Je vous trouve changé. — Oui, je suis malade », lui ai-je répondu ; et, rejetant sur les poêles d’Allemagne, qui sont de fonte, un mal de tête que j’éprouvois réellement, j’ai remercié le comte de sa bonté toujours attentive pour moi ; je lui ai dit que son bonheur m’étoit mille fois plus cher que le mien, et c’étoit vrai. Au dîner, je n’ai osé rester dans ma chambre de peur de voir arriver le comte chez moi, de me voir interroger ; et cependant j’éprouvois un embarras extrême, j’étois tourmenté par l’idée de revoir Valérie. Il me sembloit que tout étoit changé autour de moi, singulier effet de l’altération de ma raison. Depuis quelque temps je deviens réellement fou ; les tendres attentions du comte pour Valérie m’avoient toujours rappelé celles d’un frère, d’un ami : il est si calme ! il a tant de dignité dans sa manière de l’aimer ! Valérie est si jeune !
En entrant dans l’antichambre de la comtesse, j’ai vu un homme qui sortoit de chez elle : il avoit l’air fort grave ; il me sembloit qu’il secouoit la tête en mettant une espèce de surtout qui étoit jeté sur une chaise : mon cœur a battu violemment ; j’ai cru que c’étoit un médecin, et que Valérie n’étoit pas bien ; j’ai voulu lui parler, je n’ai osé élever la voix, tant je pensois qu’elle devoit être troublée ; je suis entré dans la chambre de Valérie ; elle étoit devant une glace ; mais, étant encore trop agité, je ne voyois pas ce qu’elle faisoit. Cependant je me réjouissois de la voir levée, j’approchois, je la trouvois fort rouge. « Êtes-vous malade, Madame la comtesse ? dis-je avec une espèce d’inquiétude et de gravité. — Non, Monsieur de Linar », me dit-elle du même ton. Et elle se mit à rire. Elle ajouta : « Vous me trouvez très rouge, c’est que j’ai pris une leçon de danse. — Une leçon de danse ! m’écriai-je. — Oui, me dit-elle encore en riant ; me trouvez-vous trop vieille pour danser ? Au moins vous ne me défendez pas l’exercice. » Et elle rioit toujours ; elle a levé les bras un moment après pour descendre un rideau, et tout à coup elle a jeté un cri, en mettant sa main sur le côté. « Valérie, me suis-je écrié, vous me ferez mourir ; vous nous ferez tous mourir, ai-je ajouté, avec votre légèreté. Pouvez-vous vous exposer ainsi ! vous vous ferez mal. » Elle m’a regardé avec étonnement, elle a rougi. « Pardon, Madame, ai-je ajouté, pardonnez à l’intérêt le plus vif… » Je me suis arrêté. « N’oserai-je donc plus sauter, lever les bras ? — Oui, ai-je dit timidement, mais actuellement… » Elle m’a compris ; elle a rougi encore, et est sortie. Quand le comte est venu, elle l’a tiré à l’écart et l’a grondé.
Deux jours après, Valérie sortit pour voir une femme de sa connoissance ; en descendant de voiture, elle a sauté étourdiment ; elle est tombée de manière à se faire beaucoup de mal ; on a été obligé de la reconduire chez elle sur-le-champ ; toute la nuit la fièvre a été forte : on l’a saignée, car on craignoit une fausse couche. Heureusement que la voilà hors de tout danger !
Nous partons dans peu de jours ; je compte t’écrire de la route.
LETTRE XIV
Nous avons quitté le Tyrol, nous sommes entrés en Italie ; nous nous sommes mis en route ce matin avant le lever du soleil. Pendant qu’on faisoit rafraîchir les chevaux fatigués d’une marche de trois heures, le comte a proposé à sa femme de prendre les devans, et nous avons fait une des promenades les plus agréables : nous étions ravis de fouler aux pieds le sol de l’Italie ; nous attachions nos regards sur ce ciel poétique, sur cette terre d’antiques merveilles, que le printemps venoit saluer avec toutes ses couleurs et tous ses parfums. Quand nous eûmes marché quelque temps, nous aperçûmes des maisons groupées çà et là sur un coteau, et l’impétueux Adige se lançant avec fureur au milieu de ces tranquilles campagnes. Un groupe de cyprès et des colonnes à moitié ruinées fixèrent notre attention. Le comte nous dit que c’étoit sûrement quelque temple ancien. Cette terre couverte de grands débris s’embellit de ses ruines, et les siècles viennent expirer tour à tour dans ces monumens, au milieu de la nature toujours vivante. Nous nous écartâmes du grand chemin pour aller visiter ce temple dont l’architecture corinthienne nous parut encore belle. Apparemment que les habitans du village aimoient ce lieu solitaire, que les cyprès et le silence sembloient vouer à la mort. Nous vîmes son enceinte remplie de croix qui indiquoient un cimetière ; quelques arbres fruitiers et des figuiers sauvages se mêloient au vert noirâtre des cyprès. Une antique cigogne paroissoit au sommet d’une des plus hautes colonnes, et le cri solitaire et aigu de cet oiseau se confondoit avec la bruyante voix de l’Adige. Ce tableau à la fois religieux et sauvage nous frappa singulièrement. Valérie, fatiguée ou entraînée par son imagination, nous proposa de nous reposer. Jamais je ne la vis si charmante : l’air du matin avoit animé son teint ; son vêtement pur et léger lui donnoit quelque chose d’aérien, et l’on eût dit voir un second printemps, plus beau, plus jeune encore que le premier, descendu du ciel sur cet asile du trépas : elle s’étoit assise sur un des tombeaux ; il souffloit un vent assez frais, et, dans un instant, elle fut couverte d’une pluie de fleurs des pruniers voisins, qui, de leur duvet et de leurs douces couleurs, sembloient la caresser. Elle sourioit en les assemblant autour d’elle ; et moi, la voyant si belle, si pure, je sentis que j’eusse voulu mourir comme ces fleurs, pourvu qu’un instant son souffle me touchât. Mais, au milieu du trouble délicieux d’un premier amour, au milieu de cette volupté d’un matin et d’un printemps d’Italie, un pressentiment funeste vint me saisir ; Valérie s’en aperçut, et me dit que j’avois l’air préoccupé. « Je pense aux feuilles de l’automne qui, flétries et desséchées, tomberont et couvriront ces fleurs. — Et nous aussi », dit-elle. Le comte nous appela alors pour nous montrer une inscription ; mais Valérie vint bientôt reprendre sa place. Un grand et beau papillon, qu’on nomme, je crois, le sphinx, enchanta Valérie par ses couleurs : il étoit sur un des figuiers, le comte voulut le prendre pour l’apporter à sa femme ; mais, comme le Sphinx de la Fable, il alla s’asseoir sur le seuil du temple ; je courus pour m’en saisir, mon pied glissa, et je tombai ; bientôt relevé, j’eus le temps de saisir encore le papillon, que j’apportai à la comtesse. Tout effrayée de ma chute, elle étoit pâle, et le comte s’en aperçut. « Je parie, dit-il, que Valérie a la superstition de sa mère et de beaucoup de personnes de sa patrie. — Oui, dit-elle, je suis honteuse de l’avouer. — Et quelle est cette superstition ? » demandai-je d’une voix émue. Le comte me répondit en riant : « C’est quelque grand malheur qui vous arrivera ; vous êtes tombé dans un cimetière, et vous verrez que Valérie s’attribuera vos désastres. » Je ne puis te dire, Ernest, ce que j’éprouvai ; je tressaillis. « Peut-être, pensai-je, vient-il m’avertir de mon destin, et d’une main amie m’empêcher de tomber dans le précipice que me creuse une passion insensée. — Asseyez-vous tous deux ici, nous dit Valérie, et ne vous moquez plus de moi. Vous rappelez-vous, mon ami, dit-elle au comte, la belle collection de papillons que possédoit mon père ? Oh ! comme on aime ces souvenirs de l’enfance ! comme elle étoit jolie, cette maison de campagne ! — Ne me parlez pas, répondit le comte, de ces tristes sapins ; j’ai la passion des beaux pays. — Et moi, dit Valérie, je voudrois avoir écrit tant de choses, si simples qu’elles ne sont rien par elles-mêmes, et qui me lient pourtant si fortement à ces sapins, à ces lacs, à ces mœurs, au milieu desquels j’ai appris à sentir et à aimer. Je voudrois qu’on pût se communiquer tout ce qu’on a éprouvé ; qu’on n’oubliât rien de ce bonheur de l’enfance, et qu’on pût ramener ses amis, comme par la main, dans les scènes naïves de cet âge. Il y avoit une grange auprès de la maison, où revenoit toujours une hirondelle avec laquelle je m’étois liée d’amitié ; il me sembloit qu’elle me connoissoit ; quand le départ pour la campagne étoit retardé, je tremblois de ne plus retrouver mon hirondelle ; je défendois son nid, quand mes jeunes compagnes vouloient s’en saisir. — Voilà comment, dit le comte, Valérie promettoit déjà de devenir une bonne petite maman. — Je n’étois pas toujours si raisonnable, poursuivit Valérie ; quelquefois je me plaisois à tourmenter mes sœurs : j’étois la seule qui sût bien conduire une petite barque que nous avions, et qui étoit très légère ; je l’éloignois du rivage, fière de ma hardiesse et n’écoutant pas leurs menaces ; seulement, quand elles me prioient et m’appeloient leur chère Valérie, je savois bien vite revenir adroitement au port. Qu’il étoit charmant, ce petit lac, où le vent jetoit quelquefois les pommes de pin de la forêt, ce lac au bord duquel croissoient des sorbiers avec leurs grappes rouges, que je venois cueillir pour mes oiseaux, tandis que sur les branches des sapins se balançoient de jeunes écureuils en se mirant dans les ondes ! »
Nous fûmes interrompus par le bruit des voitures qui vinrent nous enlever à ces doux souvenirs de l’enfance de Valérie, où je la voyois, plus jeune, plus délicate encore, courir sous les sapins, attacher ses yeux d’un bleu sombre, avec leurs regards si tendres, sur la petite famille qu’elle protégeoit : il me sembloit que je ne l’aimois plus que comme une sœur. Ainsi les scènes de l’innocence ramenèrent un moment dans mon cœur le sentiment qu’il m’est permis d’avoir pour elle. Nous remontâmes dans la berline, qui s’avançoit lentement le long de l’Adige ; les femmes de la comtesse nous suivoient dans l’autre voiture. C’est ainsi que j’ai fait ce voyage, m’habituant peu à peu à la douce présence de Valérie et vivant toujours sous son regard. Il est bien tard ; je reprendrai ma lettre au premier endroit où nous nous arrêterons.
LETTRE XV
C’est de Padoue que je t’écris (tu vois que nous avançons à grands pas vers Venise). Cette antique ville, qui est habitée par plusieurs savans, nous parut d’une tristesse affreuse ; mais Valérie avoit besoin de se reposer. Ce soir, apprenant que David et la Banti devoient chanter, la comtesse eut envie d’aller à l’Opéra. Le comte, ayant des lettres à écrire, ne put nous y accompagner. Valérie ne voulut point faire de toilette, et nous prîmes une loge grillée. Ô Ernest ! de tous les dangers, aucun ne pouvoit être aussi terrible pour ton ami ! Figure-toi ce que je devois éprouver : il me sembloit que toutes les voluptés habitoient cette funeste salle ; le contraste des lumières, des parures de ces femmes éblouissantes, avec cette loge foiblement éclairée, où il me sembloit que Valérie ne vivoit que pour moi ; la voix enchanteresse de David qui nous envoyoit des accens passionnés ; cet amour chanté par des voix qu’on ne peut imaginer, qu’il faut avoir entendues, et qui, mille fois plus ardent encore, brûloit dans mon cœur ; Valérie transportée de cette musique, et moi si près d’elle, si près que je touchois presque ses cheveux de mes lèvres ; alors, la rose même qui parfumoit ses cheveux achevoit de me troubler. Ô Ernest ! quels tumultes ! quels combats pour ne pas me trahir ! Et, actuellement encore que j’ai quitté depuis trois heures ce spectacle, je ne puis dormir ; je t’écris d’une terrasse où Valérie est venue avec le comte, et d’où elle est sortie depuis une heure. L’air est si doux que ma lumière ne s’éteint pas, et je passerai la nuit sur la terrasse. Comme le ciel est pur ! Un rossignol soupire dans le lointain ses plaintives amours ! Tout est-il donc amour dans la nature ? Et les accens de David, et la complainte de l’oiseau du printemps, et l’air que je respire, empreint encore du souffle de Valérie, et mon âme défaillante de volupté ? Je suis perdu, Ernest ! je n’avois pas besoin de cette Italie si dangereuse pour moi. Ici, les hommes énervés nomment amour tout ce qui émeut leurs sens et languissent dans des plaisirs toujours renouvelés, mais que l’habitude émousse ; ils ne reçoivent pas de l’âme cette impulsion qui fait du plaisir un délire et de chaque pensée une émotion ; mais moi, moi, destiné aux fortes passions et ne pouvant pas plus leur échapper que je ne puis échapper à la mort, que deviendrai-je dans ce pays ? Ah ! puisque ceux qui n’ont besoin que de plaisirs par cela seul ne sentent rien fortement, moi qui apporte une âme neuve et ardente, sortant d’un climat âpre, moi, je suis d’autant plus sensible aux beautés de ce ciel enchanteur, aux délices des parfums et de la musique, que j’avois créé ces délices avec mon imagination, sans qu’elles fussent affoiblies par l’habitude. Ernest, que faisois-tu quand tu me laissas partir ? Il falloit me précipiter dans les flots de la Baltique comme Mentor précipita Télémaque.
LETTRE XVI
Gustave, j’ai dans ma tête une suite de tableaux et de souvenirs qu’il faut que je te communique ; ton image y a été mêlée sans cesse, et le plaisir que j’ai à t’en parler doit me faire pardonner si j’entre dans trop de détails. J’ai voulu passer la fête de saint Jean chez les parens d’Ida, où l’on est toujours plus gai qu’ailleurs. Tu sais combien de fois nous avions fait ce voyage ensemble, je voulus aussi le faire à pied. Je partis la nuit, avec mon fusil, car j’avois le projet de chasser dans ma course. Il avoit fait si chaud pendant la journée que la fraîcheur me parut délicieuse. Je passai d’abord par le Bocage des Nymphes, que nous avions nommé ainsi parce que nous aimions à y lire Théocrite. Un vent frais agitoit les souples et légers bouleaux ; ces arbres exhaloient une forte odeur de rose : ce parfum me rappela vivement le souvenir de notre première course ; c’étoit dans la même saison, à la même heure et avec le même projet que nous partîmes ensemble. Je m’assis à l’entrée du bocage, sur une des larges pierres qui sont au bord de la fontaine, et où l’on vient encore abreuver les vaches du village. Tout étoit calme, je n’entendois dans le lointain que les aboiemens des chiens de la ferme qui est à l’ouest. J’entendis sonner onze heures à la cloche du château ; et cependant il faisoit encore assez clair pour me permettre de lire sans difficulté ta dernière lettre ; les expressions de ta tendresse m’émurent vivement, et le trouble de ton malheureux amour me fit éprouver quelque chose d’inexprimable. Au milieu de cette tranquille nuit et de ces tranquilles campagnes, un vent chaud souffloit dans les feuilles ; il me sembloit qu’il venoit d’Italie pour m’apporter quelque chose de toi. Je fus tiré de ma rêverie par un jeune garçon qui faisoit marcher devant lui des bœufs qu’il conduisoit à la ville la plus voisine ; il chantoit monotonement quelques paroles sur l’air des montagnes ; il s’arrêta auprès de la fontaine pour se reposer ; je continuai ma marche ; de jeunes coqs de bruyères s’agitoient dans leurs nids et sembloient appeler le jour par leurs chants ou plutôt par leur murmure matinal ; enfin je passai près du lac d’Ullen. La fraîcheur qui précède l’aurore commençoit à se faire sentir ; je vis sur ces bords quelques canards sauvages qui, à mon approche, secouèrent leurs ailes et leur tête appesantie de sommeil. D’abord je voulus tirer sur eux, puis je leur laissai gagner tranquillement la largeur du lac. Je doublai le petit cap, et m’enfonçai dans la forêt. Je marchois sous les hauts sapins, n’entendant que le bruit de mes pas, qui quelquefois glissoient sur les aiguilles des rameaux dont la terre étoit jonchée. En attendant, le court intervalle entre la nuit et l’aurore s’étoit passé. J’arrivai à la chaumière du bon André ; j’entrai dans l’enceinte de ce petit enclos, où tant de fois nous étions venus ensemble : tout dormoit encore ; les animaux seuls venoient de se réveiller, ils paroissoient me recevoir avec plaisir. Je m’assis un instant, et je respirai l’air pur du matin. Je considérai autour de moi ces ustensiles si simples, si propres, et je pensai à la paix qui habitoit cette demeure. Je passai une partie de la journée dans cette ferme, et je m’assis pendant le gros de la chaleur sous ce vieux chêne si épais, où le soleil, dans toute sa force, ne parvenoit à jeter, à travers les branches, que quelques feuilles dorées qui tomboient çà et là ; des colombes des champs filoient au-dessus de ma tête ; les souvenirs de notre jeunesse m’environnoient ; et, quand je m’en allai et que je ne vis que mon ombre solitaire, je sentis mon cœur se serrer, je sentis combien tu étois loin de moi, cher compagnon de mon heureuse enfance.
J’arrivai le soir à la jolie maison qu’habitent les parens d’Ida. C’étoit la veille de la fête de saint Jean ; tout le monde me demanda de tes nouvelles, et fut peiné de ton absence. Le lendemain matin, quand je descendis pour déjeuner, je trouvai Ida avec une couronne d’épis que de jeunes paysannes avoient posée sur ses cheveux. Elle étoit sous ce grand sapin près de la fontaine qui est dans la cour ; une multitude de jeunes filles et de jeunes garçons l’environnoient, chacun lui avoit apporté son présent : les premiers avoient posé sur la fontaine des fraises dans des paniers d’écorce de bouleau ; d’autres, comme les filles d’Israël, y avoient placé de grandes cruches de lait, tandis que d’autres encore lui offroient des rayons de miel. Ida remercioit chacune d’elles avec une grâce charmante, et passoit quelquefois ses doigts délicats sur les joues vermeilles des jeunes paysannes. Plusieurs enfans lui apportèrent des oiseaux qu’ils avoient élevés ; l’un d’eux tenoit dans ses petites mains une nichée entière de rossignols ; mais Ida exigea qu’on les reportât où on les avoit pris, ne voulant pas priver la mère de ses petits, ni les forêts de leurs plus aimables chantres. Je remarquai un jeune garçon de seize à dix-huit ans, il tenoit entre ses bras une petite hermine toute blanche, qu’il avoit apprivoisée, et qu’il offrit en rougissant à Ida.
Le soir toute la cour fut remplie de paysans. Tu te rappelles l’antique usage de la Saint-Jean : toutes les femmes avoient une couronne de feuilles sur la tête, et leurs tabliers étoient remplis de feuilles odorantes, dont elles couvroient tous ceux qui s’approchoient d’elles, en chantant des paroles amicales et bienveillantes ; on avoit dressé de grandes tables dans la forêt qui touche à la cour, et on avoit allumé les feux de la Saint-Jean ; on soupa, et ensuite on dansa toute la nuit. Voilà, cher Gustave, le récit de cette petite fête, dont j’ai voulu te mander tous les détails afin que ton imagination les suive tous et se rapproche des scènes où la mienne t’appeloit sans cesse et s’occupoit toujours de toi. Adieu, mon cher Gustave ; adieu, quand te verrai-je, ami cher ?…
LETTRE XVII
Nous voilà depuis un mois à Venise, cher Ernest. J’ai été très occupé avec le comte, et c’est ainsi qu’il m’a fallu passer tant de temps sans t’écrire ; et puis, je suis si mécontent de moi-même que cela me décourage souvent. Je sens qu’il m’est aussi impossible de te tromper que de guérir de cette cruelle maladie qui trouble et ma conscience et ma raison… J’étois honteux de te parler de moi ; vingt fois j’ai voulu me jeter aux pieds du comte, lui tout avouer, le quitter après : c’est bien là mon devoir, je le sens clairement, tout m’avertit que je devrois suivre cette voix intérieure qui ne nous trompe pas, et qui me crie sans cesse : « Pars, retourne sur tes pas, il te reste encore une autre amitié, et deux patries à retrouver, dont l’une est dans le cœur d’Ernest, où tu comptas tes premiers jours de bonheur. Tu déposeras dans ce cœur noble et grand l’image de Valérie, que tu n’oses garder dans le tien ; tu l’y retrouveras, non telle que ta coupable imagination te la peint, mais comme l’amie qui doit travailler au bonheur du comte. » Et, malgré tout cela, je ne pars pas, et lâchement je cherche à m’abuser, et je crois encore que je pourrois guérir. Il y a quelques jours que j’étois décidé à prier le comte de me faire aller à l’ambassade de Florence pour y passer un an. J’avois trouvé une raison plausible pour cela, je me disois : « Du moins, je serai sous le même ciel que Valérie. » Mais je la revis, elle me parla d’un voyage que le comte lui feroit faire dans huit mois, et je résolus de ne partir que deux mois avant elle, pour me déshabituer ainsi peu à peu de sa présence, espérant la revoir à son passage à Florence.
Ernest, plus que jamais j’ai besoin de ton indulgence. Je relis tes lettres, j’entends ta voix me rappeler à la vertu, et je suis le plus foible des hommes.
LETTRE XVIII
T’écrire, te dire tout, c’est revivre dans chaque instant de la nouvelle existence qu’elle m’a créée. Garde bien mes lettres, Ernest, je t’en conjure ; un jour peut-être, au bord de nos solitaires étangs, ou sur nos froids rochers, nous les relirons, si toutefois ton ami se sauve du naufrage qui le menace, si l’amour ne le consume, comme le soleil dévore ici la plante qui brilla un matin. Hier encore, une chose assez simple en elle-même me montra sa confiance. Tout fortifie sa naissante amitié, tout alimente ma dévorante passion : elle met entre nous deux son innocence, et l’univers reste pour elle comme il est, tandis que tout est changé pour moi.
Depuis longtemps l’ambassadeur d’Espagne lui avoit promis un bal ; cette réunion devoit être des plus brillantes par la quantité d’étrangers qui sont à Venise, car les nobles vénitiens ne peuvent fréquenter les maisons des ambassadeurs. Valérie s’en faisoit une fête. À huit heures du soir j’entrai chez elle pour lui remettre une lettre ; je la trouvai occupée de sa toilette. Sa coiffure étoit charmante ; sa robe, simple, élégante, lui alloit à ravir. « Dites-moi sans compliment comment vous me trouvez, me demanda Valérie : je sais que je ne suis pas jolie, je voudrois seulement ne pas être trop mal, il y aura tant de femmes agréables ! — Ah ! ne craignez rien, lui dis-je, vous serez toujours la seule dont on n’osera compter les charmes, et qui ferez toujours sentir en vous une puissance supérieure au charme même. — Je ne sais pas, dit-elle en riant, pourquoi vous voulez faire de moi une personne redoutable, tandis que je me borne à ne pas vouloir faire peur. Oui, continua-t-elle, je suis d’une pâleur qui m’effraye moi-même, moi qui me vois tous les jours, et je veux absolument mettre du rouge. Il faut que vous me rendiez un service, Linar. Mon mari, par une idée singulière, ne veut pas que je mette du rouge ; je n’en ai point. Mais, ce soir au bal, paroître avec un air de souffrance au milieu d’une fête, je ne le puis pas ; je suis décidée à en mettre une teinte légère. Je partirai la première, je danserai, il ne verra rien. Faites-moi le plaisir d’aller chez la marquise de Rici ! sa campagne est à deux pas d’ici, vous lui demanderez du rouge ; mon cher Linar, dépêchez-vous, vous me ferez un grand plaisir. Passez par le jardin afin qu’on ne vous voie pas sortir. » En disant ces mots, elle me poussa légèrement par la porte. Je courus chez la marquise ; je revins au bout de quelques minutes : Valérie m’attendoit avec l’impatience d’un enfant, une légère émotion coloroit son teint ; elle s’approcha du miroir, mit un peu de rouge, puis elle s’arrêta pour réfléchir : il me sembloit que j’entendois ce qu’elle se disoit. Ensuite elle me regarda. « C’est ridicule, dit-elle, je tremble comme si je faisois une mauvaise action… C’est que j’ai promis… Cependant le mal n’est pas bien grand. Oh ! combien il doit être affreux de faire quelque chose de vraiment répréhensible ! » En disant cela, elle s’approcha de moi. « Vous pâlissez », me dit-elle ; elle prit ma main : « Qu’avez-vous, Linar ? vous êtes très pâle. « Effectivement, je me sentois défaillir ; ces mots : « Combien il est affreux de faire quelque chose de vraiment répréhensible ! » étoient entrés dans ma conscience comme un coup de poignard. Cette crainte de Valérie pour une faute aussi légère me fit faire un retour affreux sur ma passion criminelle et mon ingratitude envers le comte. Valérie avoit pris de l’eau de Cologne, elle vouloit m’en faire respirer. Je remarquai que d’une main elle tenoit le flacon, tandis que de l’autre elle ôtoit son rouge en passant ses jolis doigts sur ses joues. Nous sortîmes un instant après, et elle monta en voiture. J’allai rêver au bord de la Brenta ; la nuit me surprit, elle étoit calme et sombre ; je suivois le rivage, désert à cette heure-là, et je n’entendois que dans l’éloignement le chant de quelques mariniers qui s’en alloient vers Fusine pour regagner les lagunes. Quelques vers luisans étinceloient sur les haies de buis comme des diamans. Je me trouvai insensiblement auprès de la superbe villa Pisani, louée par l’ambassadeur d’Espagne, et j’entendis la musique du bal. Je m’approchai ; on dansoit dans un pavillon dont les grandes portes vitrées donnoient sur le jardin. Plusieurs personnes regardoient, placées en dehors près de ces portes. Je gagnai une fenêtre, et je montai sur un grand vase de fleurs. Je me trouvai au niveau de la salle. L’obscurité de la nuit et l’éclat des bougies me permettoient de chercher Valérie sans être remarqué. Je la reconnus bientôt ; elle parloit à un Anglois qui venoit souvent chez le comte. Elle avoit l’air abattu, elle tourna ses yeux du côté de la fenêtre, et mon cœur battit : je me retirai, comme si elle avoit pu me voir. Un instant après, je la vis environnée de plusieurs personnes qui lui demandoient quelque chose ; elle paroissoit refuser, et mêloit à son refus son charmant sourire, comme pour se le faire pardonner. Elle montroit avec la main autour d’elle, et je me disois : « Elle se défend de danser la danse du châle ; elle dit qu’il y a trop de monde. Bien, Valérie, bien ! Ah ! ne leur montrez pas cette charmante danse ; qu’elle ne soit que pour ceux qui n’y verront que votre âme, ou plutôt qu’elle ne soit jamais vue que par moi, qu’elle entraîne à vos pieds avec cette volupté qui exalte l’amour et intimide les sens.
On continuoit à presser Valérie, qui se défendoit toujours et montroit sa tête, apparemment pour dire qu’elle y avoit mal. Enfin, la foule s’écoula ; on alla souper : Valérie resta ; il n’y eut plus qu’une vingtaine de personnes dans la salle. Alors je vis le comte, avec une femme couverte de diamans et de rouge, s’avancer vers Valérie ; je le vis la presser, la supplier de danser ; les hommes se mirent à ses genoux, les femmes l’entouroient ; je la vis céder ; moi-même, enfin, entraîné par le mouvement général, je m’étois mêlé aux autres pour la prier, comme si elle avoit pu m’entendre ; et, quand elle céda aux instances, je sentis un mouvement de colère. On ferma les portes pour que personne n’entrât plus dans la salle : lord Méry prit un violon ; Valérie demanda son châle d’une mousseline bleu foncé ; elle écarta ses cheveux de dessus son front ; elle mit son châle sur sa tête ; il descendit le long de ses tempes, de ses épaules ; son front se dessina à la manière antique, ses cheveux disparurent, ses paupières se baissèrent, son sourire habituel s’effaça peu à peu, sa tête s’inclina, son châle tomba mollement sur ses bras croisés sur sa poitrine ; et ce vêtement bleu, cette figure douce et pure, sembloient avoir été dessinés par le Corrège pour exprimer la tranquille résignation ; et, quand ses yeux se relevèrent, que ses lèvres essayèrent un sourire, on eût dit voir, comme Shakespeare la peignit, la Patience souriant à la Douleur auprès d’un monument.
Ces attitudes différentes, qui peignent tantôt des situations terribles, et tantôt des situations attendrissantes, sont un langage éloquent puisé dans les mouvemens de l’âme et des passions. Quand elles sont représentées par des formes pures et antiques, que des physionomies expressives en relèvent le pouvoir, leur effet est inexprimable. Milady Hamilton, douée de ces avantages précieux, donna la première une idée de ce genre de danse vraiment dramatique, si l’on peut dire ainsi. Le châle, qui est en même temps si antique, si propre à être dessiné de tant de manières différentes, drape, voile, cache tour à tour la figure, et se prête aux plus séduisantes expressions. Mais c’est Valérie qu’il faut voir : c’est elle qui, à la fois décente, timide, noble, profondément sensible, trouble, entraîne, émeut, arrache des larmes, et fait palpiter le cœur comme il palpite quand il est dominé par un grand ascendant ; c’est elle qui possède cette grâce charmante qui ne peut s’apprendre, mais que la nature a révélée en secret à quelques êtres supérieurs. Elle n’est pas le résultat des leçons de l’art ; elle a été apportée du ciel avec les vertus : c’est elle qui étoit dans la pensée de l’artiste qui nous donna la Vénus pudique et dans le pinceau de Raphaël… Elle vit surtout avec Valérie ; la décence et la pudeur sont ses compagnes ; elle trahit l’âme en cherchant à voiler les beautés du corps.
Ceux qui n’ont vu que ce mécanisme difficile et étonnant à la vérité, cette grâce de convenance, qui appartient plus ou moins à un peuple ou à une nation, ceux-là, dis-je, n’ont pas l’idée de la danse de Valérie.
Tantôt, comme Niobé, elle arrachoit un cri étouffé à mon âme déchirée par sa douleur ; tantôt elle fuyoit comme Galatée, et tout mon être sembloit entraîné sur ses pas légers. Non, je ne puis te rendre tout mon égarement, lorsque, dans cette magique danse, un moment avant qu’elle finît, elle fit le tour de la salle en fuyant, ou en volant plutôt sur le parquet, regardant en arrière, moitié effrayée, moitié timide, comme si elle étoit poursuivie par l’Amour. J’ouvris les bras, je l’appelai ; je criois d’une voix étouffée : « Valérie ! ah ! viens, viens, par pitié ! C’est ici que tu dois te réfugier ; c’est sur le sein de celui qui meurt pour toi que tu dois te reposer. » Et je fermois les bras avec un mouvement passionné, et la douleur que je me faisois à moi-même m’éveilla, et pourtant je n’avois embrassé que le vide ! Que dis-je ? le vide ! non, non : tandis que mes yeux dévoroient l’image de Valérie, il y avoit dans cette illusion, il y avoit de la félicité.
La danse finit : Valérie, épuisée de fatigue, poursuivie d’acclamations, vint se jeter sur la croisée où j’étois. Elle voulut l’ouvrir en la poussant en dehors ; je l’arrêtai de toutes mes forces, tremblant qu’elle ne prît l’air. Elle s’assit, appuya sa tête contre les carreaux : jamais je n’avois été si près d’elle ; une simple glace nous séparoit. J’appuyois mes lèvres sur son bras ; il me sembloit que je respirois des torrens de feu : et toi, Valérie, tu ne sentois rien, rien ! tu ne sentiras jamais rien pour moi !
LETTRE XIX
Il n’y a que huit jours que je ne t’ai écrit, et combien de choses j’ai à te dire ! Combien le cœur fait vivre, quand on rapporte tout à un sentiment dominateur ! Il faut que je te parle d’un petit bal que j’ai donné à Valérie. Sa fête approchoit ; j’ai demandé au comte la permission de la célébrer avec lui. Nous sommes convenus qu’il s’empareroit de la matinée pour donner à la comtesse un déjeuner à Sala (campagne à quatre lieues de Venise), où il réuniroit plusieurs personnes de sa connoissance. On devoit danser après le déjeuner et se promener ensuite dans les beaux jardins du parc, que Valérie aime passionnément.
Je ne pouvois trouver un lieu plus enchanteur pour seconder mes projets. Ainsi je demandai la permission d’arranger une des salles pour le soir ; ce qu’on m’a accordé. J’avois eu un plaisir extrême à m’occuper de ce qui devoit l’amuser ; je me disois que ce bonheur-là étoit innocent, et je m’y livrois ; j’étois plus tranquille depuis que je ne songeois qu’à courir, à acheter des fleurs, à orner et arranger la salle comme je voulois qu’elle le fût.
Hier donc, nous partîmes d’assez bon matin pour arriver à Sala avant la chaleur. Valérie comptoit seulement y déjeuner et revenir le soir à Venise. Il y eut une course de chevaux, donnée par mylord E…, qui vient souvent chez le comte, et que Valérie intéresse beaucoup, sans qu’elle-même s’en aperçoive. On déjeuna dans des bosquets impénétrables aux rayons du soleil, La matinée se prolongea : on voulut danser ; mais les femmes, prévenues qu’il y auroit un bal le soir, préférèrent la promenade, et Valérie bouda un peu. Cela nous mena assez tard. La marquise de Rici, instruite de nos projets, proposa à la comtesse de ne pas coucher à Venise, mais de passer chez elle le reste de la journée et la nuit : on partit fort gaiement.
Nous arrivâmes les derniers chez la marquise. Les femmes avoient eu soin d’apporter d’autres robes, et elles parurent toutes très élégamment vêtues. Valérie éprouvoit un moment d’embarras ; sa robe étoit chiffonnée ; elle avoit couru dans les bosquets ; et, quoiqu’elle me parût mille fois plus jolie, je la voyois promener des regards inquiets sur sa personne. Une de ses manches s’étoit un peu déchirée, elle y mit une épingle ; son chapeau parut lui peser, elle l’ôta, le remit : je voyois tout cela du coin de l’œil. La marquise la laissa un instant s’agiter ; puis elle l’appela, et Valérie trouva une robe des plus élégantes ; elle arrivoit de Paris : c’étoit une galanterie du comte. Son coiffeur se trouva là aussi : on posa sur ses cheveux une guirlande de mauves bleues, dont la couleur alloit à merveille avec le blond de ses cheveux. Elle mit un bracelet enrichi de diamans, avec le portrait de sa mère, que le comte lui avoit donné. On m’appela pour me montrer tout cela, et je me disois, en voyant la comtesse passer d’une glace à l’autre et monter sur une chaise pour voir le bas de sa robe : « Elle a bien un peu plus de vanité que je ne croyois » ; mais je faisois grâce à cette légère imperfection en faveur du plaisir qu’elle lui donnoit. Elle étoit surtout enchantée de l’étonnement qu’elle alloit causer, puisqu’elle s’étoit récriée sur le désordre de sa toilette… Au moment où elle alloit jouir de son triomphe, Marie, qui l’habilloit, toussa ; le sang se porta à sa tête ; elle faisoit des efforts pour se débarrasser de quelque chose qui la tourmentoit à la gorge… Valérie, tout effrayée, lui demanda ce qu’elle avoit ; Marie lui dit qu’elle sentoit une épingle qu’elle avoit eu l’imprudence de mettre dans sa bouche, mais qu’elle espéroit que ce ne seroit rien. La comtesse pâlit, et l’embrassa pour lui cacher sa frayeur. Je courus chercher un chirurgien ; mais Valérie, tremblant qu’il ne tardât trop à venir et n’ayant point de voiture, avoit jeté sa guirlande, remis son chapeau, pris un fichu ; elle entraînoit Marie tout en courant, et se trouva sur mes pas quand je frappai à la porte du chirurgien, qui demeuroit près de Dole, petit bourg voisin.
Qu’elle me parut irrésistible, Ernest ! Ses traits exprimoient une inquiétude si touchante ! Son âme entière étoit sur son charmant visage. Ce n’étoit plus cette Valérie enchantée de sa parure et attendant avec impatience un petit triomphe ; c’étoit la sensible Valérie, avec toute sa bonté, toute son imagination, portant le plus tendre intérêt et toutes les craintes d’une âme susceptible de vives émotions, sur l’objet qu’elle aimoit et qu’elle auroit aimé sans le connoître dans ce moment-là, puisqu’il étoit en danger. Heureusement Marie ne souffroit pas beaucoup, et l’on parvint à retirer l’épingle. La comtesse leva vers le ciel ses beaux yeux remplis de larmes et le remercia avec la plus vive reconnoissance. Après avoir bien fait promettre à Marie qu’elle ne feroit plus la même imprudence, nous regagnâmes la campagne de la marquise ; elle-même venoit à notre rencontre.
Quand nous arrivâmes, tous les yeux se portèrent sur nous ; les femmes chuchotoient : les unes plaignoient Valérie d’avoir si chaud ; les autres s’attendrissoient sur cette charmante robe que les ronces avoient abîmée, et qui méritoit plus d’égards. Valérie commençoit à s’embarrasser ; sa jeunesse et sa timidité l’empêchoient de prendre le ton qui lui convenoit ; elle paroissoit attendre que le comte parlât pour la tirer de cette situation gênante ; mais (ô étrange empire de la multitude sur les âmes les plus nobles et les plus belles !) le comte lui-même garda le silence. J’allois parler ; il me regarda froidement : un instinct secret m’avertit que je nuirois à la comtesse, et je me tus.
La marquise entra. Alors le comte se leva et s’approcha d’une fenêtre ; Valérie s’avança vers lui. J’entendis qu’il lui disoit : « Ma chère amie, vous auriez dû m’appeler ; vous êtes si vive ! tout le monde vous a attendue pour le dîner. « Je la vis chercher à se justifier. Je tremblois que son mari ne lui dît quelque chose de désagréable, car il ne pouvoit savoir que ce que les autres lui avoient peut-être mal rendu. Je vis à côté de moi un jeune enfant de la maison. « Mon ami, lui dis-je, allez vite souhaiter la bonne fête à Mme la comtesse de M…, cette jolie dame qui est là, et vous aurez du bonbon. — Est-ce sa fête aujourd’hui ? — Oui, oui, allez. » Il partit, et, avec sa grâce enfantine, il fit son petit compliment à Valérie, qui, déjà émue, le souleva, l’embrassa. Ce moyen me réussit. Comment le comte, rappelé à l’idée de la fête de Valérie, auroit-il voulu lui faire de la peine ce jour-là ? Je le vis prenant la main de sa femme ; je n’entendis pas ce qu’il lui disoit, mais elle sourit d’un air attendri.
Elle passa dans une pièce attenante pour arranger ses cheveux qui tomboient ; je restai à la porte sans oser la suivre. L’enfant alla auprès d’elle et lui dit : « Me donnerez-vous aussi du bonbon, comme ce monsieur, pour vous avoir souhaité la bonne fête ? — Quel monsieur, mon petit ami ? — Mais celui qui est là ; regardez. » Elle m’entrevit, parut me deviner, et ses yeux s’arrêtèrent sur moi avec reconnoissance ; elle embrassa encore une fois l’enfant et lui dit : « Oui, je vous donnerai aussi du bonbon ; mais allez embrasser ce bon monsieur. » Avec quel ravissement je reçus dans mes bras cet enfant chéri ! Comme je posai mes lèvres à la place où Valérie avoit posé les siennes ! Mais comment te rendre, Ernest, ce que j’éprouvai en trouvant une larme sur la joue de l’enfant, en la sentant se mêler à tout mon être ! Il me sembla aussi repasser toute ma destinée ; cette larme me paroissoit la contenir tout entière. Oui, Valérie, tu ne peux m’envoyer, me donner que des larmes ; mais c’est dans ces témoignages de ta pitié que se retrancheront désormais mes plus douces jouissances.
Je laisse là ma lettre ; je suis trop affecté pour continuer.
LETTRE XX
J’ai à te raconter encore, mon cher Ernest, tous les détails de la petite fête que je donnai à la comtesse ; il m’en est resté un souvenir qui ne s’effacera jamais. Je t’ai laissé avec toutes les émotions que m’avoit données le petit messager de Valérie. Vers les neuf heures du soir, après qu’on eut quitté la table et qu’elle eut pris un peu de repos, on proposa une promenade, on prit des flambeaux, et toutes les voitures partirent. Rien n’étoit joli comme cette suite d’équipages et ces flambeaux qui jetoient une vive clarté sur la verdure des haies et sur les arbres furtivement éclairés. Valérie ne savoit pas où elle alloit, et sa surprise fut extrême quand on la fit descendre à Sala : elle trouva les jardins éclairés, une musique délicieuse la reçut. Je me trouvai à l’entrée du jardin, car je l’avois devancée, et je lui présentai la main pour la conduire à la salle du bal. « Qu’est-ce donc que tout cela ? me dit-elle. — C’est Valérie qu’on voudroit fêter ; mais qui peut réussir à exprimer tout ce qu’elle inspire, et quelle langue lui diroit tout ce qu’on sent pour elle ?… » La comtesse regardoit autour d’elle avec ravissement.
Nous arrivâmes à la salle ; elle étoit spacieuse, et tout le monde fut charmé de voir remplacer ces jardins éblouissans de lampions par un clair de lune, d’après Voléro. La musique se tut, les portes se fermèrent ; il s’étoit fait un silence involontaire de toutes parts, et Valérie l’interrompit. « Ah ! s’écria-t-elle d’une voix attendrie, c’est Dronnigor. » Je vis avec délices que mon idée avoit réussi. Un décorateur habile m’avoit parfaitement compris ; des vues gravées de la campagne où Valérie avoit passé son enfance, et les conseils du comte, nous avoient aidés à exécuter mon plan ; on avoit peint ce lac, cette barque où elle conduisoit ses sœurs ; ces pins avec leurs formes pyramidales où se balançoient de jeunes écureuils ; ces sorbiers, amis de la jeune Valérie, et cette heureuse maison, à moitié cachée par les arbres, où elle avoit passé ses premiers jours de bonheur : tout cela étoit éclairé par la lune qui versoit sa tranquille clarté et de longs jets de lumière sur de jeunes bouleaux, sur les joncs du lac qui paroissoient frémir et murmurer et sur d’aromatiques calamus. Tu ne conçois pas avec quelle perfection Voléro a imité les clairs de lune : on la voyoit lutter avec les mystères de la nuit ; on entendoit aussi dans le lointain les airs de nos pâtres ; j’avois fait imiter leurs chalumeaux, et ces sons errans, qui tantôt s’affoiblissoient et tantôt devenoient plus forts, avoient quelque chose de vague, de tendre et de mélancolique.
Il y avoit le long de la salle des bancs de gazon et de larges bandes de fleurs : toutes ces fleurs étoient blanches ; il m’avoit semblé que cette couleur virginale peignoit celle à qui elles étoient venues se donner ; le jasmin d’Espagne, les roses blanches, des œillets, des lis purs comme Valérie, s’élevoient partout dans des caisses cachées sous le parquet gazonné, et son chiffre et celui du comte, simplement enlacés, étoient suspendus à un pin naturel, planté près de l’endroit du lac où Valérie avoit dit pour la première fois au comte qu’elle consentoit à devenir sa femme. Dis, Ernest, dis, après cela, si je ne sais pas l’aimer avec cette résignation qui seule excuse peut-être un peu ce funeste amour !
Mais il me reste à te détailler ce qui suivit cette première partie de la fête. À peine fûmes-nous dix minutes dans cette salle, les uns assis au milieu des fleurs, les autres parlant à voix basse, tous paroissant aimer cette scène tranquille qui sembloit offrir à chacun quelques souvenirs agréables, que la toile du fond se leva ; une gaze d’argent occupoit toute la place du haut en bas, elle imitoit parfaitement une glace. La lune disparut, et on vit à travers la gaze une chambre très simplement meublée, assez éclairée pour qu’on ne perdît rien, et une douzaine de jeunes filles assises auprès de leurs rouets, ou le fuseau à la main, travaillant toutes. Leur costume étoit celui des paysannes de notre pays ; des corsets d’un drap bleu foncé, un fichu d’une toile fine et blanche qui, se roulant comme un bandeau,enveloppoit pittoresquement leur tête, et descendoit sur leurs épaules avec des nattes de cheveux qui tomboient presque à terre. Ce tableau étoit charmant. Une des jeunes filles paroissoit se détacher de ses compagnes ; elle étoit plus jeune, plus svelte, ses bras étoient plus délicats ; les autres sembloient être faites pour l’entourer. Elle filoit aussi ; mais elle étoit placée de manière à ce qu’on ne vît pas ses traits. À moitié cachée par son attitude et par sa coiffure, elle étoit vêtue comme les autres, et paroissoit pourtant plus distinguée. Valérie se reconnut dans cette scène naïve de sa jeunesse, où elle s’étoit plu, comme elle le faisoit souvent, à travailler au milieu de plusieurs jeunes filles qu’on élevoit chez ses parens, qui, riches et bienfaisans, recueilloient des enfans pauvres, les élevoient et les dotoient ensuite. Elle comprit que j’avois voulu lui retracer le jour où le comte la vit pour la première fois et la surprit au milieu de cette scène aimable et naïve. Dès lors, charmé de sa candeur et de ses grâces, il l’aima tendrement.
Mais revenons à ce miroir magique qui ramenoit Valérie au passé. De jeunes filles élevées dans le conservatoire des Mendicanti formoient un groupe, costumées comme nos paysannes suédoises : elles chantoient mieux qu’elles, et, au lieu de leurs romances, nous entendîmes des couplets composés pour la comtesse, accompagnés par Frédéric et Ponto, placés de manière à ne pas être aperçus. Les voix ravissantes des filles des Mendicanti, le talent de ces artistes fameux, la sensibilité de Valérie, contagieuse pour les autres, tout fit de ce moment un moment délicieux ; et les Italiens, habitués à exprimer fortement ce qu’ils sentent, mêlèrent leurs acclamations à la joie douce que me faisoit ressentir le bonheur de Valérie.
Le bal commença dans une des salles attenantes ; tout le monde s’y précipita. La toile étant tombée, on vit reparoître le clair de lune. Valérie resta avec son mari ; tous deux parlèrent avec tendresse du souvenir que cette fête leur retraçoit. Le comte me dit les choses du monde les plus aimables ; sa femme, en me tendant la main, s’écria : « Bon Gustave ! jamais je n’oublierai cette charmante soirée et la salle des souvenirs. » Elle rentra ensuite avec le comte dans le bal. Je sortis pour respirer le grand air et m’abandonner pendant quelques instans à mes rêveries. En rentrant, je cherchois des yeux la comtesse au milieu de la foule, et, ne la trouvant pas, je me doutois qu’elle avoit cherché la solitude dans la salle des souvenirs. Je la trouvai effectivement dans l’embrasure d’une fenêtre : je m’approchai avec timidité ; elle me dit de m’asseoir à côté d’elle. Je vis qu’elle avoit pleuré ; elle avoit encore les larmes aux yeux, et je crus qu’elle s’étoit rappelé la petite discussion du matin. Je savois combien les impressions qu’elle recevoit étoient profondes, et je lui dis : « Quoi ! Madame, vous avez de la tristesse, aujourd’hui que nous désirons surtout vous voir contente ? — Non, me dit-elle ; les larmes que j’ai versées ne sont point amères : je me suis retracé cet âge que vous avez su me rappeler si délicieusement ; j’ai pensé à ma mère, à mes sœurs, à ce jour heureux qui commença l’attachement du comte pour moi ; je me suis attendrie sur cette époque si chère ; mais j’aime aussi l’Italie, je l’aime beaucoup », dit-elle. Je tenois toujours sa main, et mes yeux étoient fixement attachés sur cette main qui, deux ans auparavant, étoit libre ; je touchois cet anneau qui me séparoit d’elle à jamais, et qui faisoit battre mon cœur de terreur et d’effroi ; mes yeux s’y fixoient avec stupeur. « Quoi ! me disois-je, j’aurois pu prétendre aussi à elle ! Je vivois dans le même pays, dans la même province ; mon nom, mon âge, ma fortune, tout me rapprochoit d’elle ; qu’est-ce qui m’a empêché de deviner cet immense bonheur ? » Mon cœur se serroit, et quelques larmes, douloureuses comme mes pensées, tomboient sur sa main. « Qu’avez-vous, Gustave ? Dites-moi ce qui vous tourmente. » Elle vouloit retirer sa main ; mais sa voix étoit si touchante, j’osai la retenir. Je voulois lui dire… que sais-je ? Mais je sentis cet anneau, mon supplice et mon juge ; je sentis ma langue se glacer. Je quittai la main de Valérie, et je soupirois profondément. « Pourquoi, me dit-elle, pourquoi toujours cette tristesse ? Je suis sûre que vous pensez à cette femme. Je sens bien que son image est venue vous troubler aujourd’hui plus que jamais ; toute cette soirée vous a ramené en Suède. — Oui, dis-je en respirant péniblement. — Elle a donc bien des charmes, me dit-elle, puisque rien ne peut vous distraire d’elle ? — Ah ! elle a tout, tout ce qui fait les fortes passions : la grâce, la timidité, la décence, avec une de ces âmes passionnées pour le bien, qui aiment parce qu’elles vivent, et qui ne vivent que pour la vertu ; enfin, par le plus charmant des contrastes, elle a tout ce qui annonce la foiblesse et la dépendance, tout ce qui réclame l’appui ; son corps délicat est une fleur que le plus léger souffle fait incliner, et son âme forte et courageuse braveroit la mort pour la vertu et pour l’amour. » Je prononçai ce dernier mot en tremblant, épuisé par la chaleur avec laquelle j’avois parlé, ne sachant moi-même jusqu’où m’avoit conduit mon enthousiasme. Je tremblois qu’elle ne m’eût deviné, et j’appuyois ma tête contre un des carreaux de la fenêtre, attendant avec anxiété le premier son de sa voix. « Sait-elle que vous l’aimez ? me dit Valérie, avec une ingénuité qu’elle n’auroit pu feindre. — Oh ! non, non, m’écriai-je, j’espère bien que non ; elle ne me le pardonneroit pas. — Ne le lui dites jamais, dit-elle ; il doit être affreux de faire naître une passion qui rend si malheureux. Si jamais je pouvois en inspirer une semblable, je serois inconsolable ; mais je ne le crains pas, et cela me console de ne pas être belle. » Je m’étois remis de mon trouble. « Croyez-vous, Madame, que ce soit la beauté seule qui soit si dangereuse ? Regardez milady Erwin, la marquise de Ponti : je ne crois pas qu’un statuaire puisse imaginer de plus beaux modèles ; cependant on vous disoit encore hier que jamais elles n’avoient excité un sentiment vif ou durable. Non, poursuivis-je, la beauté n’est vraiment irrésistible qu’en nous expliquant quelque chose de moins passager qu’elle, qu’en nous faisant rêver à ce qui fait le charme de la vie au delà du moment fugitif où nous sommes séduits par elle ; il faut que l’âme la retrouve quand les sens l’ont assez aperçue. L’âme ne se lasse jamais : plus elle admire, et plus elle s’exalte ; et c’est quand on sait l’émouvoir fortement qu’il ne faut que de la grâce pour créer la plus forte passion. Un regard, quelques sons d’une voix susceptible d’inflexions séduisantes, contiennent alors tout ce qui fait délirer. La grâce surtout, cette magie par excellence, renouvelle tous les enchantemens. Qui plus que vous, dis-je entraîné par le charme de son regard, de son maintien, a cette grâce ? Ô Valérie ! (je pris sa main) Valérie ! « dis-je avec un accent passionné. Son extrême innocence pouvoit seule lui cacher ce que j’éprouvois. Cependant je tremblois de lui avoir déplu, et, comme on jouoit dans cet instant une valse très animée, je la priai, avec la vivacité qu’inspiroit la musique, de danser avec moi, et, sans lui laisser le temps de réfléchir, je l’entraînai. Je dansois avec une espèce de délire, oubliant le monde entier, sentant avec ivresse Valérie presque dans mes bras, et détestant pourtant ma frénésie. J’avois absolument perdu la tête, et la voix seule de ce que j’aimois pouvoit me rappeler à moi. Elle souffroit de la rapidité de la valse, et me le reprochoit. Je la posai sur un fauteuil ; je la conjurai de me pardonner. Elle étoit pâle ; je tremblois d’effroi : j’avois l’air si égaré que Valérie en fut frappée. Elle me dit avec bonté : « Cela va mieux ; mais, une autre fois, vous serez plus prudent : vous m’avez bien effrayée ; vous ne m’écoutiez pas du tout. Ô Gustave ! me dit-elle avec un accent très significatif, que vous êtes changé ! « Je ne répondis rien. « Promettez-moi, dit-elle encore, de chercher à recouvrer votre raison ; promettez-le-moi, dit-elle d’une voix attendrie, aujourd’hui, dans ce jour où vous m’avez montré tant d’intérêt. « Elle se leva, voyant qu’on se rapprochoit de nous : je lui tendis la main comme pour l’aider à marcher, et, en serrant avec respect et attendrissement cette main, je lui dis : « Je serai digne de votre intérêt, ou je mourrai. » Je m’enfonçai dans les jardins, où je marchai longtemps en proie à mille tourmens que me créoient les remords dont j’étois déchiré.
LETTRE XXI
Je ne t’ai point encore parlé de cette singulière ville, qui s’élève au sein de la mer et commande aux vagues de venir se briser contre ses digues, d’obéir à ses lois, de lui apporter les richesses de l’Europe et de l’Asie, de la servir en lui amenant chaque jour les productions dont elle a besoin, et sans lesquelles elle périroit au milieu de son faste et de son superbe orgueil. La place qu’occupe cette cité, d’abord couverte de pauvres pêcheurs, voyoit leurs nacelles raser timidement ces eaux, où voguent maintenant les galères du sénat. Peu à peu le commerce s’empara de ce passage, qui lioit si facilement l’Orient à l’Europe, et Venise devint la chaîne qui unit les mœurs d’une autre partie du monde à celles de l’Italie. De là ces couleurs si variées, ce mélange de cultes, de costumes, de langages, qui donnent une physionomie si particulière à cette ville et fondent les teintes locales avec le singulier assemblage de vingt peuples différens. Peu à peu aussi s’éleva ce gouvernement sage et doux pour la classe obscure et paisible de la république, implacable et cruel pour le noble qui auroit voulu le braver ou le compromettre ; semblable à ce Tarquin dont le fer frappoit chacune de ces fleurs qui osoit s’élever au-dessus de leurs compagnes. Il falloit, à Venise, que chaque tête altière pliât ou tombât, si elle ne se courboit pas sous le fer d’un gouvernement appuyé sur dix siècles de puissance, et enveloppé du lugubre appareil de l’inquisition et des supplices.
Aussi rien n’effraye l’imagination comme ce tribunal ; tout vous épouvante : ces gouffres sans cesse ouverts aux dénonciations ; ces prisons affreuses où, courbé sous des voûtes de plomb que le soleil embrase, le coupable expire lentement ; le silence habitant ces vastes corridors où l’on craint jusqu’à l’écho, qui rediroit un accent imprudent. Et cependant, autour de cette enceinte, qu’habite l’épouvante et que frappe si souvent le deuil, le peuple, comme un essaim d’abeilles, bourdonne le jour et s’endort sur les marches de ces palais où vivent ses souverains, et, à l’ombre du despotisme, jouit d’une grande liberté, et même d’une coupable indulgence pour ses crimes. Heureux de paresse et d’insouciance, le Vénitien vit de son soleil et de ses coquillages, se baigne dans ses canaux, suit ses processions, chante ses amours sous un ciel calme et propice, et regarde son carnaval comme une des merveilles du monde.
Les arts ont embelli la magnificence des monumens ; le génie du Titien, de Paul Véronèse et du Tintoret, ont illustré Venise ; le Palladio a donné une immortelle splendeur aux palais des Cornaro, des Pisani ; et le goût et l’imagination ont revêtu de beautés ce qui seroit mort sans eux.
Venise est le séjour de la mollesse et de l’oisiveté. On est couché dans des gondoles qui glissent sur les vagues enchaînées ; on est couché dans ces loges où arrivent les sons enchanteurs des plus belles voix de l’Italie. On dort une partie de la journée ; on est, la nuit, ou à l’Opéra, ou dans ce qu’on appelle ici des casins. La place de Saint-Marc est la capitale de Venise, le salon de la bonne compagnie la nuit, et le lieu de rassemblement du peuple le jour. Là, des spectacles se succèdent ; les cafés s’ouvrent et se referment sans cesse ; les boutiques étalent leur luxe ; l’Arménien fume silencieusement son cigare ; tandis que, voilée et d’un pas léger, la femme du noble Vénitien, cachant à moitié sa beauté et la montrant cependant avec art, traverse cette place qui lui sert de promenade le matin, et le soir la voit, resplendissante de diamans, parcourir les cafés, visiter les théâtres, et se réfugier ensuite dans son casin, pour y attendre le soleil. Ajoute à tout cela, Ernest, le tumulte du quai qui avoisine Saint-Marc, ces groupes de Dalmates et d’Esclavons, ces barques qui jettent sur la rive tous les fruits des îles, ces édifices où domine la majesté, ces colonnes où vivent ces chevaux, fiers de leur audace et de leur antique beauté ; vois le ciel de l’Italie fondre ses teintes douces avec le noir antique des monumens ; entends le son des cloches se mêler aux chants des barcarolles ; regarde tout ce monde ; en un clin d’œil, tous les genoux sont ployés, toutes les têtes se baissent religieusement : c’est une procession qui passe. Observe ce lointain magique, ce sont les Alpes du Tyrol qui forment ce rideau que dore le soleil. Quelle superbe ceinture embrasse mollement Venise ! C’est l’Adriatique ; mais ses vagues resserrées n’en sont pas moins filles de la mer ; et, si elles se jouent autour de ces belles îles, d’où se détachent de sombres cyprès, elles grondent aussi, elles se courroucent et menacent de submerger ces délicieuses retraites.
Je me promène souvent, Ernest, sur ces quais je me perds dans la foule de ce peuple ; je m’élance au delà de cette mer ; mais je ne me fuis pas moi-même. Je voulois cependant ne pas te parler de moi aujourd’hui. Je cherche à m’étourdir, et je te peins tout ce qui m’environne pour ne pas te parler d’une passion que je ne puis dompter.
Adieu, Ernest ; je sens que je te parlerois de Valérie.
LETTRE XXII
Non, Ernest, non, jamais je ne m’habituerai au monde ; le peu que j’en ai vu ici m’inspire déjà le même éloignement, le même dégoût qui me poursuit toujours dès que je suis obligé de vivre dans la grande société. Tu as beau vouloir que je cherche par ce moyen à oublier Valérie ou à m’en occuper plus foiblement, y parviendrai-je jamais ? et faut-il encore altérer mon caractère, l’aigrir ? dois-je tâcher de recouvrer la tranquillité aux dépens des principes les plus consolans ? Tu le sais, mon ami, j’ai besoin d’aimer les hommes ; je les crois en général estimables, et, si cela n’étoit pas, la société depuis longtemps ne seroit-elle pas détruite ? L’ordre subsiste dans l’univers, la vertu est donc la plus forte. Mais le grand monde, cette classe que l’ambition, les grandeurs et la richesse séparent tant du reste de l’humanité, le grand monde me paroît une arène hérissée de lances, où, à chaque pas, on craint d’être blessé ; la défiance, l’égoïsme et l’amour-propre, ces ennemis nés de tout ce qui est grand et beau, veillent sans cesse à l’entrée de cette arène et y donnent des lois qui étouffent ces mouvemens généreux et aimables par lesquels l’âme s’élève, devient meilleure, et par conséquent plus heureuse. J’ai souvent réfléchi aux causes qui font que tous ceux qui vivent dans le grand monde finissent par se détester les uns les autres et meurent presque toujours en calomniant la vie. Il existe peu de méchans, ceux qui ne sont pas retenus par la conscience le sont par la société ; l’honneur, cette fière et délicate production de la vertu, l’honneur garde les avenues du cœur et repousse les actions viles et basses, comme l’instinct naturel repousse les actions atroces. Chacun de ces hommes séparément n’a-t-il pas presque toujours quelques qualités, quelques vertus ? Qu’est-ce qui produit donc cette foule de vices qui nous blessent sans cesse ? C’est que l’indifférence pour le bien est la plus dangereuse des immoralités ; les grandes fautes seules épouvantent, parce qu’elles effrayent la conscience. Mais on ne daigne pas seulement s’occuper des torts qui reviennent sans cesse, qui attaquent sans cesse le repos, la considération, le bonheur de ceux avec qui l’on vit, et qui troublent par là journellement la société.
Nous parlions de cela hier encore, Valérie et moi, et je lui faisois remarquer dans ces réunions brillantes, au milieu de cette foule de gens de tous les pays qui viennent ici pour s’amuser, je lui faisois remarquer cette teinte monotone de froideur et d’ennui répandue sur tous les visages. « Les petites passions, lui disois-je, commencent par effacer ces traits primitifs de candeur et de bonté que nous aimons à voir dans les enfans ; la vanité soumet tout à une convenance générale ; il faut que tout prenne ses couleurs ; la crainte du ridicule ôte à la voix ses plus aimables inflexions, inspecte jusqu’au regard, préside au langage et soumet toutes les impressions de l’âme à son despotisme. Ô Valérie ! lui disois-je, si vous êtes si aimable, c’est que vous avez été élevée loin de ce monde qui dénature tout ; si vous êtes heureuse, c’est que vous avez cherché le bonheur là où le Ciel a permis qu’il puisse être trouvé. C’est en vain qu’on le cherche ailleurs que dans la piété, dans la touchante bonté, dans les affections vives et pures, enfin dans tout ce que le grand monde appelle exaltation ou folie, et qui vous offre sans cesse les plus heureuses émotions. »
Ernest, je sentois que si je l’aimois ainsi, c’étoit parce qu’elle étoit restée près de la nature ; j’entendois sa voix qui ne déguise jamais rien ; je voyois ses yeux qui s’attendrissent sur le malheur et qui ne connoissent que les plus célestes expressions ; je l’ai quittée brusquement, Ernest, je l’ai quittée, j’ai craint de me trahir.
LETTRE XXIII
J’apprends que toutes mes lettres écrites depuis deux mois sont à Hambourg, chez M. Martin, banquier. Le courrier expédié par le comte avoit eu l’ordre de remettre ses dépêches à notre consul, à Hambourg, et de se rendre lui-même à Berlin. Malheureusement il a oublié de remettre le paquet de lettres à ton adresse.
Mais qu’aurois-tu appris ? Je suis toujours le même ; quelquefois repentant, et toujours le plus foible des hommes. Mon fatal secret est toujours caché à Valérie ; mais ma situation envers le comte est vraiment bien douloureuse. Je l’ai vu quelquefois au moment de m’interroger ; il me disoit qu’il me trouvoit triste, que jamais je n’aurois de meilleur ami : n’étoit-ce pas me dire qu’il comptoit sur ma confiance ? Et moi, je le fuyois, j’évitois ses regards ; je lui paroissois défiant, ingrat peut-être ! Ernest, combien cette idée me tourmente ! Je ne puis t’en dire davantage, le comte m’attend.
LETTRE XXIV
Je ne sais comment je vis, comment je puis vivre avec les violentes émotions que j’éprouve sans cesse. Étoit-ce à moi d’aimer ? Quelle âme ai-je donc reçue ! Celles qui sont le plus sensibles, celle du comte même, qu’elle est loin de souffrir comme la mienne ! et cependant il l’aime bien cette même femme qui consume ma raison, mon bonheur et ma vie, et qui, sans se douter de son empire, me verra peut-être mourir sans deviner la cause de mon funeste sort. Cruelle pensée ! Ah ! pardonne, Valérie, ce n’est pas de toi que je me plains, c’est moi que je déteste. La foiblesse seule peut être aussi malheureuse : toujours dépendante, elle a des tourmens qui n’osent aborder qu’elle ; je traîne à ma suite mille inquiétudes inconnues aux autres.
Mais j’oublie que tu ne sais encore rien ; non, tu ne conçois pas ce que j’ai souffert, Ernest ; j’ai si peu de raison, si peu d’empire sur moi-même ! Écoute donc, mon ami, s’il m’est possible toutefois de mettre un peu d’ordre dans mon récit. Quoique Valérie ne soit qu’au septième mois de sa grossesse, on a craint qu’elle n’accouchât avant-hier. Son extrême jeunesse la rend si délicate qu’on a toujours présumé qu’elle n’atteindroit pas le terme prescrit par la nature. Nous avions dîné plus tard qu’à l’ordinaire, parce que Valérie ne s’étoit pas trouvée bien ; vers la fin du repas, je l’ai vue pâlir et rougir successivement ; elle m’a regardé et m’a fait signe de me taire ; mais, après quelques minutes, elle a été obligée de se lever : nous l’avons suivie dans le salon, où elle s’est couchée sur une ottomane ; le comte inquiet a voulu sur-le-champ faire chercher un médecin. Valérie ayant passé dans sa chambre, je n’ai point osé l’y accompagner ; mais je suis entré dans une petite bibliothèque attenante, où je pouvois rester sans être vu. Là, j’entendois Valérie se plaindre, en cherchant à étouffer ses plaintes ; je ne sais plus ce que j’ai senti, car heureusement les douleurs ont un trouble qui empêche de les retrouver dans tous leurs détails, tandis que le bonheur a des repos où l’âme jouit d’elle-même, note, pour ainsi dire, ses sensations, et les met en réserve pour l’avenir.
Il ne m’est resté que des idées confuses et douloureuses de ces cruels momens. Quand Valérie paroissoit souffrir beaucoup, tout mon sang se portoit à ma tête, et j’en sentois battre les artères avec violence. J’étois debout, appuyé contre une porte de communication qui donnoit dans la chambre de la comtesse ; je l’entendois quelquefois parler tranquillement, et alors le calme revenoit dans mon âme. Mais que devins-je quand je l’entendis dire qu’elle avoit perdu une sœur en couches de son premier enfant ! Je frissonnai de terreur, le sang paroissoit s’arrêter dans mes veines, et je fus obligé de me traîner le long des panneaux pour m’asseoir sur une chaise.
La comtesse appela Marie, et lui dit de me chercher ; je sortis de la bibliothèque, j’allai à sa rencontre, et je la suivis chez Valérie. « Je vous envoie chercher, Gustave, me dit-elle en prenant un air presque gai ; mais les traces de la souffrance qui étoient encore sur son visage ne m’échappèrent pas ; j’ai voulu vous voir un moment, et vous dire que cela ne sera rien ; mes douleurs passent. J’ai pensé que vous seriez bien aise d’être rassuré ; je sais l’intérêt que vous prenez à vos amis. » Avec quelle bonté elle me dit cela ! Mes yeux lui exprimèrent combien j’étois touché qu’elle m’eût deviné. « Vous devriez faire de la musique, Gustave, me dit-elle, mais pas au salon, je ne vous entendrois pas ; ici à côté vous trouverez le petit piano, cela me distraira. » Savoit-elle, Ernest, qu’il falloit me distraire moi-même et me tranquilliser ? Je trouvai le piano ouvert ; il y avoit une romance qu’elle avoit copiée elle-même ; ce fut celle-là que je pris, elle m’étoit inconnue, je me mis à la chanter ; je te noterai le dernier couplet pour que lu voies comment, par une inconcevable combinaison, cette romance me replongea dans mes tourmens et dans la plus horrible anxiété ; elle commence ainsi :
J’aimois une jeune bergère.
L’air et les paroles sont, je crois, de Rousseau ; il n’y avoit peut-être que moi qui ne connusse pas cette romance. Il me sembloit que Valérie recommençoit à se plaindre ; je continuai pourtant. J’arrivai au dernier couplet :
Après neuf mois de mariage,
Instans trop courts !
Elle alloit me donner un gage
De nos amours,
Quand la Parque, qui tout ravage,
Trancha ses jours.
Ma voix altérée ne put achever ; une sueur froide me rendit immobile : Valérie jeta un cri ; je voulus me lever, voler à elle, je retombai sur ma chaise, et je crus que j’allois perdre entièrement connoissance. Je me remis cependant assez pour courir à la porte de l’appartement de la comtesse. L’accoucheur sortit dans ce moment. « Au nom du Ciel ! dis-je en lui prenant la main et en tremblant de toutes mes forces, dites-moi s’il y a du danger. » Il leva les épaules, et me dit : « J’espère bien que non ; mais elle est si délicate qu’on ne peut en répondre, et elle souffrira beaucoup. » Il me sembloit que l’enfer et tous ses tourmens étoient dans ce mot j’espère. Pourquoi ne me disoit-il pas : « Non, il n’y a pas de danger. — Mais, vous-même, me dit-il, vous ne me paroissez pas bien. » Dans tout autre moment j’eusse pu être inquiet de son observation ; mais j’étois si malheureux que toute autre considération disparoissoit dans cet instant. Je me mis à courir par toute la maison, mon agitation ne me laissant aucun repos ; je ne sais tout ce qui se passa, mais je me trouvai à la chute du jour dans les rues de Venise, courant sans m’arrêter ; je voulus demander un verre d’eau dans un café ; je vis un homme de ma connoissance qui s’avançoit vers moi ; la crainte qu’il ne m’abordât fit que je me mis à marcher très vite du côté opposé ; mes forces s’épuisoient entièrement. Je passois devant une église ; elle étoit ouverte, j’y entrai pour me reposer. Il n’y avoit personne qu’une femme âgée qui prioit ; elle étoit devant un autel où étoit un christ ; à la foible clarté de quelques cierges, je voyois son visage où étoit répandue une douce sérénité. Ses mains étoient jointes, ses yeux envoyoient au ciel des regards où se peignoit une résignation mêlée d’une joie céleste. Je m’étois appuyé contre un des piliers de l’église, quand mes yeux s’arrêtèrent sur cette femme ; cette vue me calma beaucoup ; il me sembloit que la piété et le silence qui régnoient autour de moi abattoient la tempête de mon âme agitée. La femme se leva doucement, passa devant moi, me fixa un moment avec bienveillance ; puis elle regarda la place où elle avoit prié et reporta ses yeux sur moi ; ensuite elle baissa son voile et sortit. Je m’avançai vers cette place, je tombai à genoux, je voulus prier ; mais l’extrême agitation que je venois d’éprouver ne me permit pas d’assembler mes idées. Cependant je souffrois moins ; il me sembloit qu’en présence de l’Éternel, sans pouvoir même l’invoquer, mes peines étoient adoucies par cela seul que je les déposois dans son sein au milieu de cet asile où tant de mes semblables venoient l’invoquer. Je ne faisois que répéter ces mots : « Dieu de miséricorde !… pitié !… Valérie !… » puis je me taisois, et je sentois des larmes qui me soulageoient. Je ne sais combien de temps je restai ainsi ; quand je me levai, il me sembla que ma vie étoit renouvelée, je respirois librement, je me trouvois auprès d’un des plus beaux tableaux de Venise, une vierge de Solimène ; plusieurs cierges l’éclairoient, des fleurs fraîches encore et nouvellement offertes à la Madone mêloient leurs douces couleurs et leurs parfums à l’encens qu’on avoit brûlé dans l’église. « C’est peut-être l’amour, me disois-je, qui est venu implorer la Vierge ; ce sont deux cœurs timides et purs qui brûlent de s’unir l’un à l’autre par des nœuds légitimes. » Je soupirois profondément, je regardois la Madone ; il me sembloit qu’un regard céleste, pur comme le ciel, sublime et tendre à la fois, descendoit dans mon cœur ; il me sembloit qu’il y avoit dans ce regard quelque chose de Valérie. Je me sentois calmé. « Elle ne souffre plus, me disois-je, bientôt elle sera remise, ses traits auront repris leur douce expression. Elle me plaindra d’avoir tant souffert pour elle ; elle me plaindra, elle m’aimera peut-être. » Insensiblement ma tête s’exalta ; je tombai à genoux. Ô honte ! ô turpitude de mon cœur abject ! le croirois-tu, Ernest ? j’osois invoquer le Dieu du ciel et de la vertu, qui ne peut protéger que la vertu, qui la donna à la terre pour qu’elle nous fît penser à lui ; j’osois le prier dans ce lieu saint de me donner le cœur de Valérie. Je ne voyois qu’elle : les fleurs, leur parfum, la mélancolie du silence qui régnoit autour de moi, tout achevoit de jeter mon cœur dans ces coupables pensées. J’en fus tiré par un enfant de chœur ; il m’avoit apparemment appelé plusieurs fois, car il me secoua par le bras. « Signor, me dit-il, on va fermer l’église. » Il tenoit un cierge à la main ; je le regardois d’un air étonné ; absorbé dans mon délire, j’avois oublié le lieu sacré où je me trouvois. Le cierge incliné de l’enfant de chœur me montra la place où j’étois à genoux, c’étoit un tombeau : j’y lus le nom d’Euphrosine, et ce nom paroissoit être là pour citer ma conscience devant le tribunal du juge suprême. Tu le sais, Ernest, c’étoit le nom de ma mère, de ma mère descendue aussi au tombeau, et qui reçut mes sermens pour la vertu. Il me sembloit sentir ses mains glacées, lorsqu’elle les posa pour la dernière fois sur mon front pour me bénir ; il me sembloit les sentir encore, mais pour me repousser. Je me levai d’un air égaré ; je n’osois prier, je n’osois plus invoquer l’Éternel, et je revoyois Valérie mourante ; mon imagination me la montroit pâle et luttant contre la mort. Je tordis mes mains ; je cachai ma tête en embrassant un des piliers avec une angoisse inexprimable. « Oh ! Signor, dit l’enfant effrayé, qu’avez-vous ? » Je le regardois ; il voulut s’éloigner de moi. « Ne crains rien, lui dis-je, et ma voix altérée le rappela. Je suis malheureux, mon ami, ne me fuis pas. » Il se rapprocha de moi. « Êtes-vous pauvre ? dit-il ; mais vous avez un bel habit. — Non, je ne suis pas pauvre ; mais je suis bien malheureux. » Il me tendit sa petite main et serra la mienne. « Eh bien, dit-il, vous achèterez des cierges pour la Madone, et je prierai pour vous. — Non, pas pour moi, dis-je vivement, mais pour une dame bien bonne, bonne comme toi. Oh ! viens, lui dis-je en le serrant sur mon cœur, et laissant couler mes larmes sur son visage ; viens, être pur et innocent ! toi qui plais à Dieu et ne l’offenses pas, prie pour Valérie. — Elle s’appelle Valérie ? — Oui. — Et qu’est-ce qu’il faut demander à Dieu ? — Qu’il la conserve ; elle est dans les douleurs ; elle est malade. — Ma mère est malade aussi, et elle est pauvre. Valérie l’est-elle aussi ? — Non, mon ami ; voilà ce qu’elle envoie à ta mère. » Je tirai ma bourse, où il y avoit heureusement de l’or ; il me regarda avec étonnement : « Oh ! comme vous êtes bon ! comme je prierai Dieu et la sainte Vierge tous les jours pour vous ! et avant pour… Comment s’appelle-t-elle ? — Valérie. — Ah ! oui, pour Valérie ! » Ses mains se joignirent ; il tomba à genoux. Pour moi, sans oser proférer une parole, j’élevois aussi mes mains, je baissois mes regards vers la tombe ; mon cœur étoit contrit, déchiré ; et il me sembla que je déposois mon repentir et ses supplices au pied de la croix sur laquelle le Carrache avoit essayé d’exprimer la grandeur du Christ mourant ; je voyois devant moi ce superbe tableau, foiblement éclairé par le cierge de l’enfant.
LETTRE XXV
Toutes mes inquiétudes sont finies ; je ne tremble plus pour celle qui n’a été qu’un moment, il est vrai, la plus heureuse des mères, mais qui existe, qui se porte bien. Oui, Ernest, j’ai vu la sensible Valérie, mille fois plus belle, plus touchante que jamais, répandre sur son fils les plus douces larmes, me le montrer éveillé, endormi, me demander si j’avois remarqué tous ses traits, pressentir qu’il auroit le sourire de son père, et ne jamais se lasser de l’admirer et de le caresser.
Hélas ! quelque temps après, ces mêmes yeux ont répandu les larmes du deuil et de la douleur la plus amère : le jeune Adolphe n’a vécu que quelques instans, et sa mère le pleure tous les jours. Cependant elle est résignée ; mais elle a perdu cette douce gaieté qui suivit ses premiers transports de bonheur ; la plus profonde mélancolie est empreinte dans ses traits ; ils ont toujours quelque chose qui peint la douleur. En vain le comte cherche à la distraire ; ce qui la calme est justement ce qui la ramène à Adolphe. Elle a acheté un petit terrain qui appartient à des religieuses ; ce terrain est à Lido, île charmante, près de Venise ; c’est là que l’on a enterré le fils de Valérie. Le comte a été profondément affecté de la perte qu’il a faite ; je ne l’ai pas quitté pendant son chagrin. Ma douleur, si véritable, la manière dont je l’exprimois, mes soins assidus, ont touché cet homme excellent. Il m’a témoigné une tendresse si vive ! Je voyois qu’il me savoit gré d’avoir quitté mon genre de vie solitaire. Hélas ! il ne saura jamais combien il m’a fallu de courage pour la fuir, pour lutter contre ces longues habitudes de mon cœur, si douces, si chères ! Je ne serai jamais compris. Toi seul, Ernest, tu pourras me plaindre, concevoir mes douleurs et pleurer sur moi.
LETTRE XXVI
Explique-moi, Ernest, comment on peut n’aimer Valérie que comme on aimeroit toute autre femme. Hier je me promenois avec le comte, nous avons rencontré une femme qui étoit arrêtée devant une boutique du pont de Rialto. « Voilà une bien jolie personne », me dit le comte. Je l’ai regardée, et sa taille et ses cheveux m’ont rappelé Valérie ; j’ai eu envie de dire qu’elle ressembloit à la comtesse, mais je craignois que ma voix ne me trahît. Cependant, comme il y avoit beaucoup de bruit sur le pont et qu’il ne m’observoit pas, je le lui ai dit. « Nullement, m’a-t-il répondu, cette femme est extrêmement jolie ; Valérie a de la jeunesse, de la physionomie, mais jamais on ne la remarquera. » J’éprouvois quelque chose de douloureux, non pas que j’eusse besoin que d’autres que moi la trouvassent charmante, mais de penser que je l’aime avec une passion si violente, qu’elle est pour moi le modèle de tous les charmes, de toutes les séductions, et que jamais je ne pourrai lui exprimer un seul instant de ma vie ce que j’éprouve ; je n’osois dire au comte combien je le trouvois injuste. « Au moins, lui dis-je, on ne peut refuser à la comtesse le prix des vertus et de la beauté de l’âme. — Ah ! sans doute, c’est une excellente femme ; ce sera une femme bien essentielle, et, quand elle aura été plus dans le monde, elle sera même extrêmement aimable. »
Quoi ! Valérie, tu as besoin de plus de développement pour être extrêmement aimable ! Ton esprit, ta sensibilité, tes grâces enchanteresses, ne t’assignent-elles pas déjà la première de ces places qu’osent te disputer des femmes légères qui, avec quelques mines, quelques grâces factices et de froides imitations de ce charme suprême que la vraie bonté seule donne, se croient aimables ! Comment peux-tu devenir meilleure, toi qui ne respires que pour le bonheur des autres ; qui, renfermée dans le cercle de tes devoirs, ne comptes tes plaisirs que par tes vertus ; emploies chaque moment de la vie au lieu de la dissiper ; diriges ta maison et la remplis des félicités les plus pures ! Moi seul serois-je donc destiné à te comprendre, à t’apprécier, et n’aurois-je eu cette faculté que pour devenir si malheureux ! Ces tristes réflexions avoient absorbé mon attention ; je marchois silencieusement à côté du comte et je me disois : « L’homme ne saura-t-il donc jamais jouir du bonheur que le Ciel lui donne ? Et cet homme si distingué, si bien fait pour être heureux par Valérie, ne se trouveroit-il pas en effet plus à envier et plus heureux qu’un autre ? Mais pourquoi, me disois-je, faut-il que le bonheur soit un délire ? Cette ivresse même avec laquelle l’amour le juge ne le dégrade-t-elle pas ? et ne vois-je pas le comte rendre chaque jour le plus beau des hommages à Valérie, lui confier son avenir, lui dire qu’elle embellit sa vie, et avoir besoin d’elle comme d’un air pur pour respirer ? » Mais j’avois beau me dire tout cela, je fînissois toujours par penser : « Ah ! comme je l’aimerois mieux ! »
LETTRE XXVII
Le comte, tu le sais déjà, redoute pour Valérie les courses qu’elle fait à Lido ; mais il finit toujours par céder : ses affaires l’occupent, et c’est moi qui l’ai accompagnée, avec Marie, ces jours-ci. Nous y allâmes la semaine passée. Sa douce confiance m’enchante. Elle est si sûre que ce qu’elle désire ne trouvera jamais d’opposition de ma part qu’elle ne demande pas : « Pouvez-vous venir avec moi ? » mais elle me dit : « N’est-ce pas, Gustave, vous viendrez avec moi ? »
J’ai été à Lido en son absence, j’y ai apporté des arbustes enlevés avec soin d’un jardin, et qui ont continué à fleurir ; j’ai planté des saules d’Amérique et des roses blanches auprès du tombeau d’Adolphe. Valérie étoit fort triste le jour que nous devions y aller ensemble. En débarquant à Lido, je la voyois oppressée ; elle paroissoit souffrir beaucoup ; ses yeux étoient mélancoliquement baissés vers la terre. Nous arrivâmes à l’enceinte du couvent ; nous passâmes par une grande cour abandonnée, où l’herbe haute et flétrie par la sécheresse embarrassoit nos pas. La journée étoit encore fort chaude, quoique nous fussions déjà à la fin d’octobre. Une des sœurs du couvent vint nous ouvrir la porte qui donnoit sur le petit terrain que Valérie a acheté ; Valérie l’a remerciée ; elle lui a pris la main affectueusement, et lui a dit : « Ma sœur, vous devriez remettre une clef à un de mes gondoliers ; je vous donnerai trop souvent la peine d’ouvrir cette porte. Y a-t-il longtemps que vous êtes dans ce couvent ? a-t-elle ajouté. — Depuis mon enfance. — Vous ne vous y ennuyez pas ? — Oh ! jamais ; la journée ne me paroît pas assez longue. Notre ordre n’est pas sévère. Nous avons de très belles voix dans notre couvent ; cela nous fait rechercher par beaucoup de monde. — — Mais vous ne voyez pas ce monde ? — Je vous demande pardon : nous avons beaucoup plus de liberté qu’ailleurs, et, avec la permission de l’abbesse, nous pouvons voir les personnes qu’elle admet. Les jours de fête, nous ornons l’église de fleurs, nous en cultivons de bien belles ; nous sommes aussi chargées de l’instruction des enfans. — Aimez-vous les enfans ? demanda vivement Valérie. — Beaucoup », répondit la sœur. Dans ce moment la cloche appela la religieuse. Valérie étoit restée à la place où elle nous avoit quittés ; ses yeux la suivirent. « Jamais, dit-elle, elle ne connoîtra la douleur de perdre un fils bien-aimé ! — Ni les peines de l’amour malheureux ! ajoutai-je en soupirant. — Elle paroît si calme ! Mais aussi elle ne connoît pas toutes les félicités attachées au bonheur d’aimer ; et il y en a de si grandes ! Et puis, Gustave, nous reverrons les êtres que nous avons aimés et perdus ici-bas. L’amour innocent, l’amitié fidèle, la tendresse maternelle, ne continueront-ils pas dans cette autre vie ? Ne le pensez-vous pas, Gustave ? me demanda-t-elle avec émotion. — Je le crois », lui répondis-je, profondément ému ; et, prenant sa main, je la mis sur ma poitrine. « Peut-être alors, lui dis-je, des sentimens réprouvés ici-bas oseront-ils se montrer dans toute leur pureté, peut-être des cœurs séparés sur cette terre se confondront-ils là-bas. Oui, je crois à ces réunions comme je crois à l’immortalité. Les récompenses ou les punitions ne peuvent exister sans souvenirs ; rien ne continueroit de nous-mêmes sans cette faculté. Vous vous rappellerez le bien que vous fîtes, Valérie, et vous retrouverez dans votre souvenir ceux que votre bienfaisance chercha sur cette terre ; vous aimerez toujours ceux que vous aimâtes. Pourquoi seriez-vous punie par leur absence ? Ô Valérie, la céleste bonté est si magnifique ! » Le soleil, en cet instant, jeta sur nous ses rayons ; la mer en étoit rougie, ainsi que les Alpes du Tyrol, et la terre sembloit rajeunie à nos yeux, et belle comme l’espérance qui nous avoit occupés. Nous arrivâmes à l’enceinte du tombeau ; les arbustes le cachoient. Valérie, étonnée de ce changement, se douta que je les avois fait planter ; elle me remercia d’une voix attendrie, en me disant que j’avois réalisé son idée. Nous écartâmes des branches touffues d’ébéniers qui avoient fleuri encore une fois dans cette automne et quelques branches de saule et d’acacia. Valérie fixa ses regards sur la tombe d’Adolphe ; ses larmes coulèrent ; elle leva ses yeux au ciel ; je vis ses lèvres se remuer doucement, son visage s’embellir de piété : elle prioit pour son fils. Des voix célestes se mêlèrent à ce moment d’attendrissement ; les religieuses chantoient de saintes strophes qui arrivoient jusqu’à nous à travers le silence, au moment où le soleil se retiroit lentement, abandonnant la terre et s’éteignant au milieu des vagues, comme la vie de l’homme qui s’éteint, qui paroît tomber dans l’abîme des ténèbres pour en ressortir plus belle et plus brillante.
LETTRE XXVIII
Le comte veut distraire Valérie de sa douleur : il craint pour sa santé, il trouve qu’elle est maigrie ; il veut, dit-on, hâter son voyage de Rome et de Naples. Il paroît qu’il n’en a point encore parlé à sa femme. C’est mon vieux Erich qui a appris du valet de chambre du comte qu’on faisoit en secret les préparatifs du voyage, afin de surprendre Valérie plus agréablement. Ernest, j’ai parlé souvent avec enthousiasme au comte de cette belle partie de l’Italie, du désir que j’avois de la voir ; eh bien, s’il me proposoit d’être de ce voyage, je refuserois ; je refuseiois, j’y suis décidé. Est-ce à moi à abuser de son inépuisable bonté ? Si, par un miracle, je n’ai pas encore été le plus méprisable des hommes ; si mon secret est encore dans mon sein ; si l’extrême innocence de Valérie m’a mieux servi que ma fragile vertu, l’exposerai-je, ce funeste secret, au danger d’un nouveau voyage, à cette présence continuelle, à cette dangereuse familiarité ? Non, non, Ernest, je refuserai ; et, si je pouvois ne pas le faire après avoir si clairement senti mon devoir, il faudroit ne plus m’aimer. Ô ma mère ! du haut de votre céleste séjour, jetez un regard sur votre fils ! il est bien foible, il s’est jeté dans bien des douleurs ; mais il aime encore cette vertu, cette austère et grande beauté du monde moral que vos leçons et votre exemple gravèrent dans son cœur.
LETTRE XXIX
Toi seul tu es assez bon, assez indulgent, pour lire ce que je t’écris et ne pas sourire de pitié, comme ceux qui se croient sages, et que je déteste.
Hier, dans la sombre rêverie qui enveloppe tous mes jours, et dans laquelle je ne pense qu’à Valérie et à l’impossibilité d’être jamais heureux, je suivois le tumulte de la place Saint-Marc ; le jour baissoit. Le vaste canal de la Judeïca étoit encore rougi des derniers rayons du soir, et les vagues murmuroient doucement ; je les regardois fixement, arrêté sur le quai, quand tout à coup le bruit d’une robe de soie vint me tirer de ma rêverie. Elle avoit passé si près de moi que mon attention avoit été éveillée. Je levai les yeux, et mon cœur battit avec violence ; la femme qui avoit passé près de moi, dont je ne pouvois voir les traits, mais dont je voyois encore la taille, les cheveux, je crus… je crus que c’étoit elle ; le trouble qu’elle m’inspire toujours me retint à ma place, je n’osois la suivre, éclaircir mes doutes. Elle avoit encore l’habillement du matin : le zendale, le mystérieux zendale, qui tantôt voile et tantôt cache toute la figure, la grande jupe de satin noir, le corset de satin lilas, le même que Valérie porte toujours, et que je lui avois encore vu la veille ; un voile noir enveloppoit sa tête, et laissoit échapper une boucle de cheveux cendrés, de ces cheveux qui ne peuvent être qu’à Valérie. « Est-ce la comtesse ? me disois-je. Mais seule, sans aucun de ses gens, traversant ce quai, à cette heure, c’est impossible ; et si, comme elle le fait souvent, elle alloit chercher l’indigence, Marie, sa chère Marie, seroit avec elle. » Tout en observant cette femme, je la suivois machinalement. Enfin elle s’est arrêtée devant une maison de bien peu d’apparence. Elle a frappé un grand coup de marteau ; le jour étoit entièrement tombé. « Qui est là ? cria une voix cassée. Ah ! c’est toi, Bianca ? » En même temps la porte s’ouvrit, et je vis disparoître cette femme. Je restai anéanti de surprise à cette place, où me retenoient encore l’étonnement, la curiosité et un charme secret. « Il faut que je revoie cette femme, me disois-je… Quelle étonnante ressemblance ! Il existe donc encore un être qui a le pouvoir de faire battre mon cœur ! » Mille idées confuses s’associoient à celle-là : si je voyois partir Valérie de Venise, si je m’éloignois d’elle, comme une loi sévère me l’ordonne, alors il me resteroit quelque chose qui rendroit mes souvenirs plus vivans, un être qui auroit le pouvoir de me retracer l’image de Valérie. Ah ! sans doute jamais je ne pourrois un seul instant lui être infidèle. Mais, comme on voudroit arrêter l’ombre d’un objet aimé, quand on ne peut l’arrêter lui-même, ainsi cette femme me la rappellera. La nuit étoit venue, elle étoit sombre ; je m’étois assis sous les fenêtres du rez-de-chaussée ; je pensois à Valérie, quand j’entendis ouvrir une des jalousies ; je levai la tête, et je vis de la lumière ; une femme s’avança, s’assit sur la fenêtre ; je me doutois que c’étoit Bianca, et toute ma curiosité étoit revenue. Je sentis, après quelques minutes, quelque chose tomber à mes pieds : c’étoit des écorces d’orange que Bianca venoit de jeter. Le croirois-tu, Ernest ? l’écorce d’une orange, le parfum d’un fruit dont l’Italie entière est couverte, que je vois, que je sens tous les jours, me fit tressaillir, remplit d’une volupté inexprimable tous mes sens. Il y avoit quinze jours qu’assis auprès de Valérie, sur le balcon qui donne sur le Grand Canal, elle me parla de son voyage de Naples et du projet du comte de m’emmener avec lui ; je sentis mes joues brûlantes et mon cœur battre et défaillir tour à tour : tantôt de ravissantes espérances me transportoient aux bords de ce rivage enchanté ; Valérie étoit à mes côtés, et les félicités du ciel m’environnoient ; mais bientôt je soupirois, n’osant me livrer à ces images de bonheur ; forcé à plier sous la terrible loi que me prescrivoit le devoir, décidé à refuser ce voyage et n’ayant pas la force de prononcer mon propre arrêt. Valérie avoit engagé les autres à aller souper, se plaignant d’un léger mal de tête, et ne voulant manger que quelques oranges qu’elle me pria de lui apporter : nous étions restés seuls ; j’étois assis à ses pieds, sur un des carreaux de son ottomane ; je me livrois à la volupté d’entendre sa voix me dépeindre tous les plaisirs qu’elle se promettoit de ce voyage ; mon imagination suivoit vaguement ses pas ; et l’instant où je la voyois s’éloigner de moi jetoit un voile mélancolique sur toutes ces images. « Bientôt, dit-elle, nous verrons Pausilippe, et ce beau ciel que vous aimez tant. » Impatientée de ce que je ne partageois pas assez vivement ce qui l’enchantoit, elle me jeta quelques écorces d’orange. J’en vis une que ses lèvres avoient touchée, je l’approchai des miennes : un frisson délicieux me fit tressaillir ; je recueillis ces écorces ; je respirai leur parfum ; il me sembloit que l’avenir venoit se mêler à mes présentes délices : la douce familiarité de Valérie, sa bonté, l’idée de ne la quitter que pour peu de temps, tout fit de ce moment un moment ravissant. Je me disois qu’au sein des privations, condamné à un éternel silence, j’étois encore heureux, puisque je pouvois sentir cet amour, dont les moindres faveurs surpassoient toutes les voluptés des autres sentimens.
Voilà, mon ami, voilà le souvenir qui ce soir revint avec tant de charme ; et quand, assis sous le même ciel qui nous avoit couverts, Valérie et moi, environné d’obscurité et de l’air tiède et suave de l’Italie, le cœur toujours plein d’elle, je sentis ce même parfum, dis-moi, mon Ernest, quand tout se réunissoit pour favoriser mon illusion et me rappeler ce moment magique, mon délire étoit-il donc si étonnant ?
LETTRE XXX
Elle est partie, je te l’ai déjà dit ; je te le répète, parce que cette pensée est toujours là pour appesantir mon existence. Il me semble que je traîne après moi des siècles dans ces espaces qu’on nomme des jours. Je ne souffre que de cet ennui qui est un mal affreux, de cet ennui insurmontable qui place dans une vaste uniformité tous les instans comme tous les objets. Rien ne m’émeut, pas même son idée. Je me dis : « Elle n’est plus là ! » mais à peine ai-je la force de la regretter ; je me sens mort au dedans de moi, quoique je marche et que je respire encore. Quelle est donc cette terrible maladie, cette langueur qui me fait croire que je ne suis plus susceptible de passion, ni même d’un intérêt vif ; qui me feroit envier les hommes les plus médiocres seulement parce qu’ils ont l’air d’attacher du prix aux choses qui n’en ont point ? Quand la nature, et sa grandeur, et son silence, me parloient, étoit-elle autre qu’elle n’est aujourd’hui ? Où sont-elles, les voix de la montagne, des torrens, des forêts ? Sont-elles éteintes ? ou bien l’homme porte-t-il en lui, avec la faculté de mesurer la grandeur, le pouvoir de rêver aussi d’ineffables harmonies ? Ah ! sans doute, il est un langage vivant au dedans de nous-mêmes qui nous fait entendre tous ces secrets langages. Les ondes deviennent pittoresques en réfléchissant de beaux paysages ; mais, pour les réfléchir, il faut qu’elles soient pures.
Il semble qu’un ouragan ait passé au dedans de moi et y ait tout dévasté ; et cet amour, qui crée des enchantemens, n’a laissé après lui, pour moi, qu’un désert.
Je sens que je m’abandonne moi-même. Quand je la voyois, j’étois souvent malheureux. Forcé de lui cacher mon amour comme on cache un délit, je voyois un autre en être aimé, suffire à son bonheur ; et cet autre étoit un bienfaiteur, un père, que je craignois d’outrager ; et je sentois en moi un autre empire, une force de passion qui me rejetoit dans un coupable vertige. Ainsi, forcé de les aimer tous deux, ne pouvant échapper à aucun de ces deux ascendans, ma vie étoit une lutte continuelle ; mais, au milieu des vagues, je m’efforçois encore d’atteindre l’un ou l’autre rivage. L’un, escarpé et sévère, m’effrayoit ; mais je voyois la vertu me tendre la main, et il y avoit quelque chose en moi qui, dès mes plus jeunes années, m’animoit pour elle. L’autre rivage étoit comme une de ces belles îles jetées sur des mers lointaines, dont les parfums viennent enivrer le voyageur avant même qu’il l’aperçoive. Je fermois les yeux, je perdois la respiration, et la volupté m’entraînoit comme un foible enfant ; mais dans ces courts instans, au moins, j’avois le bonheur de l’ivresse, qui ne compte pas avec la raison. Sans doute, je me réveillois, et c’étoit pour souffrir ; mais, dans ces jours de danger, et souvent de douleurs, j’étois soutenu par une activité, par une fièvre de passion, par des momens d’orgueil, par des momens plus beaux de défiance, et que la vertu réclamoit : mon existence se composoit de grandes émotions ; et le souffle de Valérie, quelque chose qui arrivât, m’environnoit et m’empêchoit de m’éteindre comme à présent.
LETTRE XXXI
Il y a bien longtemps, mon ami, que je ne t’ai écrit ; mais qu’avois-je à te dire ? Parle-t-on d’un rivage abandonné, où tout attriste, d’où les eaux vives se sont retirées, et sur lequel a passé le vent de la destruction, qui a tout desséché ? Mais, actuellement que l’espérance d’être moins malheureux est venue derechef visiter mon âme, je pense à toi ; toi, dont l’amitié jeta de si beaux rayons dans ma vie ; toi, que j’aimois dans cet âge qui prépare aux longues affections, dans l’enfance, où le cœur n’a été rétréci par rien.
Ernest, je suis moins malheureux : que dis-je ? je ne le suis plus. Je vis, je respire librement ; je pense, je sens, j’agis pour elle : et si tu savois ce qui a produit cet énorme changement ! Une pensée d’elle est venue me toucher, à cent lieues de distance. Il m’a semblé qu’elle reprenoit des rênes abandonnées, qu’elle se chargeoit de ma conduite, et j’ai soulevé ma tête, un sang plus chaud a circulé dans mes veines, une douce fierté a relevé mon regard abaissé vers la terre.
Il y a eu hier deux mois qu’elle est partie. On est venu me demander à l’hôtel pour me dire qu’il y avoit à la douane des caisses de Florence, avec une lettre de la comtesse, qu’on me prioit de réclamer moi-même. À ces mots, je sentis le reste de mon sang se porter à mon cœur en battemens précipités et inégaux ; j’éprouvois une impatience qui contrastoit bien avec mon état ; j’étois si foible qu’à peine pouvois-je m’habiller, et mes yeux voyoient tous les objets doubles. Enfin, j’ai suivi mon conducteur. J’ai trouvé la lettre ; mais je n’ai osé la lire, de peur de me trouver mal, et je la serrois convulsivement dans mes doigts ; et, quand je pus me dérober à la vue des commis, je la portai à mes lèvres. Je pris une gondole ; j’embarquai les caisses ; j’allai tout près de là dans un jardin solitaire, et je m’étendis sous un laurier : déjà sensible aux douces émotions, je laissois venir sur ma tête les rayons du soleil qui alloit se coucher dans la mer, je comptois déjà avec les plaisirs, et, puisque je vivois depuis deux instans, je voulois déjà vivre heureux. Voilà bien l’homme ! Et qu’est-ce qui m’avoit tiré de cet état de stupeur ? Une feuille de papier. Je ne savois encore ce qu’elle contenoit, n’importe : avec elle étoient revenus mes souvenirs, mon imagination ; c’étoit Valérie qui l’avoit touchée, c’étoit elle qui avoit pensé à moi. Longtemps je ne pus lire ; des nuages épais couvroient mes yeux ; quelquefois je frissonnois, et je me disois : « Peut-être le comte a-t-il été rappelé et ne reviendra-t-il pas à Venise. » Quand je pus lire, je cherchai les dernières lignes, pour voir s’il n’y avoit rien d’extraordinaire, si elles ne disoient pas un plus long adieu… Je vis : « Faites suspendre mon portrait dans le petit salon jaune où nous prenons le thé. »
Oh ! quels momens d’enivrante extase ! Valérie, je reverrai tes traits chéris, je pourrai les voir à toute heure ! Le matin, quand l’aube encore douteuse n’aura paru que pour moi, je volerai à ce salon chéri ; ou plutôt, ignoré du reste de la maison, j’y passerai les nuits ; je croirai voir ton regard sur moi, et tu viendras encore, comme un esprit bienfaisant, dans mes songes. Mon ami, malgré moi, il faut que je finisse : je suis trop foible pour écrire de longues lettres.
LETTRE XXXII
Voilà la copie de la lettre de Valérie ; ne pouvant dormir, je l’ai transcrite pour toi, mon ami. Quelle nuit délicieuse je viens de passer ! Je me suis établi dans le petit salon jaune : j’y avois fait placer le portrait de Valérie ; mais tu ignores encore ce qu’il y a d’enchanteur pour moi dans ce tableau peint par Angelica ; je veux que toi-même tu l’apprennes dans les paroles ingénues et presque tendres de Valérie. Reviens avec moi au salon, Ernest. Au-dessous du tableau, qui occupe une grande place, est une ottomane de toile des Indes : je m’y suis assis, j’ai fait du feu, j’ai mis auprès de l’ottomane un grand oranger que Valérie aime beaucoup ; j’ai arrangé la table à thé ; j’en ai pris comme j’en prenois avec elle, car elle l’aime passionnément. Le parfum du thé et de l’oranger, la place où elle étoit assise, et où je n’ai eu garde de m’asseoir, croyant la voir occupée par elle, tout m’a rappelé ce temps de ravissans souvenirs… Je suis resté comme cela jusqu’à deux heures du matin, et puis j’ai lentement copié sa lettre, m’arrêtant à chaque ligne, comme on s’arrête en revoyant, après une longue absence, son lieu natal, à chaque place qui vous parle du passé.
Vous n’avez pas cru, bon et aimable Gustave, que vos amis aient pu vous oublier au milieu de leur bonheur. Si j’ai tardé si longtemps à vous écrire, c’est que j’ai voulu vous faire plus d’un plaisir à la fois ; et je savais que mon portrait vous en ferait, surtout parce qu’il vous rappellerait des momens que vous aimiez. J’ai donc retardé ma lettre, et vous avez aujourd’hui les traits de Valérie ; vous avez les souvenirs de Lido, et ces paroles, que je voudrais rendre touchantes, par l’amitié si vraie que j’ai pour vous.
Que n’ai-je, comme vous ou comme mon mari, étudié l’histoire et les arts, pour vous parler plus dignement de tout ce que je vois ! Mais je ne suis qu’une ignorante ; et si j’ai senti, ce n’est pas parce que je sais penser, c’est parce qu’il y a des choses si belles qu’elles vous transportent et qu’elles semblent éveiller en vous une faculté qui vous avertit que c’est là la beauté. Je vous écris de Florence, qui est, dit-on, la ville des arts. Ah ! la nature l’a bien adoptée ! Aussi, que de fois j’ai rêvé aux bords de l’Arno et sous les épais ombrages des Caccines ! Cela m’a rappelé nos promenades de Sala et près de Vérone. Il n’y a pas de cirque ici ; mais que de monumens appellent l’attention ! que d’écoles différentes ont envoyé leurs chefs-d’œuvre ! c’est ici aussi que vivent la Vénus et le jeune Apollon : on peut réellement dire qu’ils vivent ; ils sont si purs, si jeunes, si aimables ! Ne sachant rien dire moi-même, il faut que je vous rende ce que disoit mon mari : que la Vénus est belle ; et l’on sent pourtant que, s’il y avoit une femme comme celle-là, les autres n’en pourroient être jalouses. Elle a si bien l’air de s’ignorer, d’être étonnée d’elle-même ! Sa pudeur la voile ; quelque chose de céleste couvre ses formes ; et elle intimide en paroissant demander de l’indulgence. J’ai été à la fameuse galerie du grand-duc ; j’y ai vu la Madonna della Seggiola, de Raphaël ; mes regards se sont pénétrés de sa haute beauté. Quel céleste amour remplit ses traits si purs ! Un saint respect, un doux ravissement, sont entrés dans mon cœur.
J’ai vu, non loin d’elle, un tableau d’un maître peu connu : c’était un berceau et une jeune femme assise à côté. Soudain je me suis prise à pleurer, et j’ai pensé à mon fils et aux douces félicités que j’avois rêvées si souvent : je me suis retracé ce berceau où je ne l’ai couché que deux fois, ce berceau que je m’étois si délicieusement peint, tantôt éclairé par le premier rayon du soleil, et mon enfant dormant, tantôt moi-même m’arrachant au sommeil, murmurant sur lui de douces paroles pour l’endormir ; et je me disois : « Ô mon jeune Adolphe ! tu es tombé de mon sein comme une fleur de deux matins, et tu es tombé dans le cercueil ! et mes yeux ne te verront plus sourire ! » Et je me suis retirée dans l’embrasure d’une fenêtre, où j’ai abondamment pleuré, cherchant à cacher mes larmes. Mon mari, qui est survenu, a voulu me consoler. Vous savez combien cet être si aimable, si excellent, a de pouvoir sur moi ; mais ma douleur ne m’en a pas moins aussi ramenée à votre souvenir, à votre infatigable patience. Oh ! comme vous cherchiez toujours à calmer mes peines ! comme vous me parliez toujours de mon Adolphe ! Je n’ai rien oublié, Gustave. Je vous vois encore, à Lido, changer mon aride douleur en larmes mélancoliques, et cueillir auprès du tombeau de mon fils les roses que vous y aviez fait croître : ces fleurs, si souvent destinées au bonheur, me paroissoient mille fois plus belles par le triste contraste même de leur beauté et de la mort ; tant la pensée qui touche l’âme embellit tout !
Ces chers et tristes souvenirs m’ont donné le désir de les arrêter encore, de les fixer, et, si je quitte une fois Venise et la place où dort mon Adolphe, de les emporter dans une terre où ils me rappelleront vivement Lido.
Mon mari désiroit depuis longtemps avoir mon portrait fait par la fameuse Angelica, et j’ai pensé qu’un tableau tel que j’en avois l’idée pouvoit réunir nos deux projets. Ma pensée a merveilleusement réussi ; jugez-en vous-même. N’est-ce pas Valérie, telle qu’elle étoit assise si souvent à Lido ; la mer se brisant dans le lointain, comme sur la côte où je jouois dans mon enfance ; le ciel vaporeux ; les nuages roses du soir, dans lesquels je croyois voir la jeune âme de mon fils ; cette pierre qui couvre ses formes charmantes, maintenant, hélas ! décomposées ; et ce saule si triste, inclinant sa tête comme s’il sentait ma douleur ; et ces grappes de cytise, qui caressent en tombant la pierre de la mort ; et, dans le fond, cette antique abbaye où vivent de saintes filles, qui ne seront jamais mères, dont la voix nous paroissoit la musique des anges ? N’est-ce pas le tableau fidèle de cette scène d’attendrissante douleur ? Quelque chose y manque encore : c’est l’ami qui consoloit Valérie et ne l’abandonnoit pas à sa morne douleur ; c’est Gustave. Peut-il la croire assez ingrate pour l’avoir oublié ? Valérie ne pouvoit le placer lui-même dans le tableau ; mais il y est pourtant, il s’y reconnoîtra. Qu’il se rappelle le 15 novembre, où j’étois allée seule à Lido, où, dans une sombre tristesse, mes yeux restoient attachés sur la tombe d’Adolphe : Gustave accourut ; il apportoit un jeune arbuste, qu’il vouloit planter près de cette place ; il avoit aussi des lilas noués dans un mouchoir : il savait combien j’aimois cette fleur hâtive et douce, et ses soins en avoient obtenu quelques-unes de la saison même qui les refuse presque toujours. Leur parfum me réveilla de ma sombre rêverie ! je vis Gustave si heureux de m’en apporter que je ne pus m’empêcher de lui sourire pour l’en remercier ; et Gustave retrouvera dans le tableau, près de la place où je suis assise, un mouchoir noué d’où s’échappent des lilas, et son nom tracé sur le mouchoir.
Je vous envoie aussi une très belle table de marbre de Carrare, rose comme la jeunesse, et veinée de noir comme la vie ; faites-la placer sur le tombeau de mon fils. Elle n’a que cette simple inscription : Ici dort Adolphe de M…, du double sommeil de l’innocence et de la mort.
Je vous envoie aussi de jeunes arbustes que j’ai trouvés dans la Villa-Médicis, qui viennent des îles du sud et fleurissent plus tard que ceux que nous avons déjà : en les couvrant avec précaution l’hiver, ils ne périront pas, et nous aurons encore des fleurs quand les autres seront tombées.
Mon mari vous écrira de Rome ; il vous envoie deux vues de Volpato. Faites placer mon portrait dans le petit salon jaune où nous prenons le thé ordinairement.
Eh bien ! Ernest, que dis-tu de cette charmante lettre, si enivrante pour moi, et pourtant si pure ? Que je serois le plus abject des hommes, si je pensois à Valérie autrement qu’avec la plus profonde vénération ! Qu’elle est touchante cette lettre ! qu’elle est belle l’âme de Valérie, de celle qui daigne être ma sœur, mon amie ! et qu’il seroit lâche celui dont la passion ne s’arrêteroit respectueusement devant cet ange qui ne semble vivre que pour la vertu et la tendresse maternelle !
LETTRE XXXIII
J’ai repris ma santé ; au moins, je suis mieux. Je m’occupe de mes devoirs, et mes jours ne se passent pas sans que je ne compte même de grands plaisirs. Chaque matin je visite le tableau ; je me remplis de cette douce contemplation ; je retrouve Valérie : il me semble, dans ces heures d’amour et de superstition, qu’elle me voit, qu’elle m’ordonne de ne pas me livrer à une honteuse oisiveté, à un lâche découragement, et je travaille. Cette maison, qui me paroissoit si triste depuis qu’elle est partie, est redevenue une habitation délicieuse depuis que je suis souvent dans le salon jaune ; la ressemblance du portrait est frappante : ce sont absolument ses traits, c’est l’expression de son âme, ce sont ses formes. Il m’arrive quelquefois de lui parler, de lui rendre compte de ce que j’ai fait. Je retourne souvent à Lido. J’ai planté les arbustes qu’elle m’a envoyés ; j’ai fait mettre aussi la pierre sur le tombeau d’Adolphe. Hier, je suis resté fort tard à Lido ; j’ai vu la lune se lever. Je me suis assis au bord de la mer ; j’ai repassé lentement toute cette époque qui contient ma vie, depuis que je connois Valérie ; je me suis retracé ces soirées où, assis ensemble, nous entendions murmurer le jonc flétri autour de nous ; où la lune jetoit une douteuse et pâle clarté sur les ondes, sur les nacelles des pécheurs ; où sa timide lueur arrivoit en tremblant entre les feuilles de quelques vieux mûriers, comme mes paroles arrivoient en tremblant sur mes lèvres, et parloient à Valérie d’un autre amour. Alors aussi les filles de sainte Thérèse entonnèrent de saints cantiques ; et ces voix réservées pour le Ciel seul, arrivant tranquillement à nous, conjurèrent l’orage de mon sein, comme autrefois le divin législateur des chrétiens conjuroit la tempête de la mer et ordonnoit aux vagues de se calmer. Tout cela m’est revenu dans cette mémoire que nous portons dans notre cœur, et qui n’est jamais sans larmes et sans doux attendrissement.
Peut-être ne devrois-je pas penser ainsi à Valérie, revenir à elle par tous les objets qui me la retracent ; je le sens bien : il n’est pas prudent de chercher le calme par ces chemins dangereux.
Mais enfin l’essentiel n’est-il pas de me retrouver moi-même, et, avant de jeter le passé dans l’abîme de l’oubli, ne faut-il pas chercher à acquérir des forces ? Si je faisois chaque jour seulement un pas, si je pouvois m’habituer à la chérir tranquillement !… Oui, je te le promets, Ernest, je le ferai ce pas, qui, en m’éloignant d’elle, m’en rapprochera et me rendra digne de son estime et de la tienne.
LETTRE XXXIV
Je suis en Scanie, cher Gustave ; j’ai quitté Stockholm, et, pour retourner chez moi, j’ai passé par tes domaines. J’ai fait le voyage avec l’extrême vitesse que permet la saison ; mon traîneau a volé sur les neiges. Hélas ! pourquoi ce mouvement si rapide ne me rapprochoit-il pas de toi ? Depuis près de deux mois j’ignore ce que tu fais, et cela ajoute encore aux chagrins de l’absence. Je sais d’ailleurs combien le départ de Valérie t’a affligé. Pauvre ami ! que fais-tu ? Hélas ! je le demande en vain à la nature engourdie autour de moi ; mon cœur même, mon cœur si brûlant d’amitié, ne me répond pas quand je l’interroge sur ton sort : il me présage je ne sais quoi de triste, et même de sombre. Gustave, Gustave, tu m’effrayes souvent… Je voudrois partir, te voir, me rassurer sur ta destinée. Cher ami, je le sens, je ne puis plus vivre sans toi… J’irai t’arracher à ces funestes lieux. Tu le sais, sous cette apparence de calme, ton ami porte un cœur sensible, et c’est peut-être cette même sensibilité qui a trouvé dans l’amitié de quoi suffire doucement à mon cœur.
Je continuerai ma lettre demain ; je t’écrirai du château de tes pères, et, ne pouvant être avec toi, je visiterai ces lieux témoins de nos premiers plaisirs.
Je t’écris de ta chambre même, que j’ai fait ouvrir et dans laquelle j’ai encore trouvé mille choses à toi ; j’ai tout regardé, ton fusil, tes livres : il me sembloit que j’étois seul au monde avec tous ces objets. J’ai feuilleté un de tes philosophes favoris : il parloit du courage, il enseignoit à supporter les peines, mais il ne me consoloit pas, je l’ai laissé là ; puis j’ai ouvert la porte qui donne sur la terrasse, je suis sorti. La nuit étoit claire et très froide ; des milliers d’étoiles brilloient au firmament. J’ai pensé combien de fois nous nous étions promenés ensemble, regardant le ciel, oubliant le froid, cherchant parmi les astres la Couronne d’Ariane, dont l’amour et les malheurs te touchoient tant, et l’étoile polaire, et Castor et Pollux, qui s’aimoient comme nous : leur amitié fut éternisée par la Fable ; la nôtre, disions-nous, le sera aussi, parce que rien de ce qui est grand et beau ne périt. Je me rappelois nos conversations, et je sentis mon cœur apaisé. La nature seule unit à sa grandeur ce calme qui se communique toujours, tandis que les plus beaux ouvrages de l’art nous fatiguent quand ils ne nous montrent que l’histoire des hommes.
Je rentrai dans ta chambre ; combien je fus touché, Gustave, en trouvant dans ton bureau ouvert un monument de ta bienfaisance, un fragment de billet : je le copie, afin que ton cœur flétri par le chagrin se repose doucement pendant quelques instants[4].
Gustave, ces lignes achevèrent de m’attendrir ; un besoin inexprimable de te serrer contre mon cœur, qui sait si bien t’aimer, me donnoit une agitation que je ne pouvois calmer, que tout augmentoit dans ce lieu si rempli de ton souvenir. Je descendis dans la grande cour du château ; je traversai ces vastes corridors, jadis si animés par nos jeux et ceux de nos compagnons, maintenant déserts et silencieux ; je passai devant la loge aux renards, et je me rappelai, en voyant ces animaux, le jour où par mon imprudence l’un d’eux te blessa dangereusement. Je saisis les barreaux de la grille, et je les regardai s’agiter et courir çà et là. Hector, ce beau chien danois si fidèle, arriva, me vit et tourna autour de moi en signe de reconnoissance ; je pris ses larges oreilles, je le caressai, en pensant qu’il t’aimoit, qu’il ne t’avoit sûrement pas oublié ; et soudain une idée, dont tu riras, me passa par la tête : je courus à ta chambre, où j’avois encore vu un de tes habits de chasse ; je l’apportai à Hector en le lui faisant flairer, et je crus voir que ce bon chien le reconnoissoit. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il mit ses pattes sur l’habit, remua la queue, et donna toutes les démonstrations de la joie auxquelles il mêla quelques sons plaintifs. Ce spectacle m’attendrit tellement que je pressai la tête de cet animal contre mon sein, et sentis couler mes larmes.
Adieu, Ernest, je pars pour le presbytère de ***, d’où je t’écrirai dans quelques jours.
J’ai été au presbytère ; j’ai revu notre respectable ami, le vieux pasteur, et ses charmantes filles. Le croirois-tu ? Hélène se marie demain, et j’ai promis d’assister à ses noces. J’arrivai à six heures du soir à cette paisible maison ; un vaste horizon de neige m’éclairoit assez pour me conduire, car il faisoit déjà nuit quand je partis. Mon traîneau fendoit l’air ; les lumières du presbytère me guidoient, et je dirigeai ma course par le lac où de jeunes mélèzes m’indiquoient le chemin que je devois suivre : car tu sais combien ce lac est dangereux par les sources qui s’y trouvent et qui l’empêchent de geler également partout. Le silence de la nuit et de ces eaux enchaînées me faisoit entendre chaque pas des chevaux et laissoit arriver jusqu’à moi le bruit des sonnettes d’autres chevaux de paysans qui regagnoient les hameaux et auquel se mêloit de temps en temps la voix rauque et solitaire de quelques loups de la forêt voisine ; j’en vis un passer devant mon traîneau, il s’arrêta à quelque distance, mais il n’osa m’attaquer.
Quand j’arrivai au presbytère, je vis une quantité de traîneaux dessous le hangar, près de la maison, avec de larges peaux d’ours qui les couvroient et qui me firent juger qu’ils n’appartenoient pas à des paysans ; je trouvai le corridor très éclairé, couvert d’un sable fin et blanc, et jonché de feuilles de mélèze et d’herbes odorantes ; j’eus à peine le temps d’ôter mon énorme vitchoura que la porte s’ouvrit et me laissa voir une nombreuse compagnie. Le vieux pasteur me reçut avec une touchante cordialité ; il se réjouit beaucoup de me revoir. La jeune sœur d’Hélène vint me présenter des liqueurs faites par elle-même et des fruits séchés ; et le vieillard ensuite me fit faire la connoissance d’un jeune homme de bonne mine, en me disant : « Voilà mon gendre futur ; demain il épouse Hélène. » À ces mots, je sentis quelques battemens de cœur. Tu sais combien la jeune Hélène me plut. J’avois été bien près de l’aimer ; et l’idée que ma mère n’approuveroit jamais une union entre elle et moi me donna la force de combattre tout de suite un sentiment qui ne demandoit qu’à se développer. La raison m’avoit ordonné de la quitter ; mais, dans cet instant, tous ces aimables souvenirs revinrent à ma mémoire, et je me rappelai vivement cet été tout entier passé avec elle. Hélène s’approcha de moi, sur l’ordre de son père ; elle me salua une seconde fois, et avec plus de timidité que la première. Le vieillard fit apporter du vin de Malaga, qu’on versa dans une coupe d’argent, pour me faire boire, selon l’usage, à la santé des futurs époux. Hélène, pour suivre encore la coutume, porta cette coupe à ses lèvres, puis elle me la présenta en baissant les yeux. Je rougis, Gustave, je rougis prodigieusement. Je me rappelai qu’autrefois, quand j’étois à table auprès d’Hélène et que cette même coupe faisoit la ronde, mes lèvres cherchoient la trace des siennes ; maintenant tout m’ordonnoit une conduite opposée. Ma jeune amie s’en aperçut, et je vis ce front si pur se couvrir aussi de rougeur. Je sortis précipitamment et fis quelques tours de promenade dans le petit jardin, où je vis encore des arbres que nous avions plantés ensemble. La lune s’étoit levée ; j’étois redevenu calme comme elle : je m’applaudis de n’avoir pas troublé le cœur d’Hélène par une passion qui auroit pu être douloureusement traversée, de n’avoir pas aussi affligé ma mère ; et je me composai, du bonheur d’Hélène que je voyois déjà heureuse épouse et mère, une suite d’images qui me consoloient de ce que j’avois perdu.
Adieu, Gustave. Que n’es-tu ici, au milieu de ces scènes naïves et tranquilles, ou que ne suis-je près de toi pour adoucir tes maux !
LETTRE XXXV
Ce jour est un jour de bonheur pour ton ami. J’ai reçu ta lettre, cher Ernest, en même temps que j’en recevois une du comte. Il sembloit que l’amitié eût choisi cette journée pour l’embellir de tous ses bienfaits. Et quand ton cœur me ramenoit en Suède, au milieu de tant de tableaux où s’enlaçoient et les souvenirs de la patrie et ceux des affections plus chères encore, le comte me transportoit à son tour au milieu de ces merveilleuses créations du génie, de ces antiques souvenirs d’où l’histoire semble sortir toute vivante, pour nous raconter encore ce que d’autres siècles ont vu. Il faut, Ernest, que tu partages ce que j’ai éprouvé, et je t’envoie des fragmens des endroits qui m’ont le plus intéressé. Je ne veux point toucher au passage qui peint la constante affection du comte ; tu verras comme il me juge et comme j’en suis aimé. Page:Krudener - Valerie.djvu/161 Page:Krudener - Valerie.djvu/162 Page:Krudener - Valerie.djvu/163 Page:Krudener - Valerie.djvu/164 Page:Krudener - Valerie.djvu/165 Page:Krudener - Valerie.djvu/166 Page:Krudener - Valerie.djvu/167 Page:Krudener - Valerie.djvu/168 Page:Krudener - Valerie.djvu/169 Page:Krudener - Valerie.djvu/170 Page:Krudener - Valerie.djvu/171 Page:Krudener - Valerie.djvu/172 Page:Krudener - Valerie.djvu/173 Page:Krudener - Valerie.djvu/174 Page:Krudener - Valerie.djvu/175 Page:Krudener - Valerie.djvu/176 Page:Krudener - Valerie.djvu/177 Page:Krudener - Valerie.djvu/178 Page:Krudener - Valerie.djvu/179 Page:Krudener - Valerie.djvu/180 Page:Krudener - Valerie.djvu/181 Page:Krudener - Valerie.djvu/182 Page:Krudener - Valerie.djvu/183 Page:Krudener - Valerie.djvu/184 Page:Krudener - Valerie.djvu/185 Page:Krudener - Valerie.djvu/186 Page:Krudener - Valerie.djvu/187 Page:Krudener - Valerie.djvu/188 Page:Krudener - Valerie.djvu/189 Page:Krudener - Valerie.djvu/190 Page:Krudener - Valerie.djvu/191 Page:Krudener - Valerie.djvu/192 Page:Krudener - Valerie.djvu/193 Page:Krudener - Valerie.djvu/194 Page:Krudener - Valerie.djvu/195 Page:Krudener - Valerie.djvu/196 Page:Krudener - Valerie.djvu/197 Page:Krudener - Valerie.djvu/198 Page:Krudener - Valerie.djvu/199 Page:Krudener - Valerie.djvu/200 Page:Krudener - Valerie.djvu/201 Page:Krudener - Valerie.djvu/202 Page:Krudener - Valerie.djvu/203 Page:Krudener - Valerie.djvu/204 Page:Krudener - Valerie.djvu/205 Page:Krudener - Valerie.djvu/206 Page:Krudener - Valerie.djvu/207 Page:Krudener - Valerie.djvu/208 Page:Krudener - Valerie.djvu/209 Page:Krudener - Valerie.djvu/210 Page:Krudener - Valerie.djvu/211 Page:Krudener - Valerie.djvu/212 Page:Krudener - Valerie.djvu/213 Page:Krudener - Valerie.djvu/214 Page:Krudener - Valerie.djvu/215 Page:Krudener - Valerie.djvu/216 Page:Krudener - Valerie.djvu/217 Page:Krudener - Valerie.djvu/218 Page:Krudener - Valerie.djvu/219 Page:Krudener - Valerie.djvu/220 Page:Krudener - Valerie.djvu/221 Page:Krudener - Valerie.djvu/222 Page:Krudener - Valerie.djvu/223 Page:Krudener - Valerie.djvu/224 Page:Krudener - Valerie.djvu/225 Page:Krudener - Valerie.djvu/226 Page:Krudener - Valerie.djvu/227 Page:Krudener - Valerie.djvu/228 Page:Krudener - Valerie.djvu/229 Page:Krudener - Valerie.djvu/230 Page:Krudener - Valerie.djvu/231 Page:Krudener - Valerie.djvu/232 Page:Krudener - Valerie.djvu/233 Page:Krudener - Valerie.djvu/234 Page:Krudener - Valerie.djvu/235 Page:Krudener - Valerie.djvu/236 Page:Krudener - Valerie.djvu/237 Page:Krudener - Valerie.djvu/238 Page:Krudener - Valerie.djvu/239 Page:Krudener - Valerie.djvu/240 Page:Krudener - Valerie.djvu/241 Page:Krudener - Valerie.djvu/242 Page:Krudener - Valerie.djvu/243 Page:Krudener - Valerie.djvu/244 Page:Krudener - Valerie.djvu/245 Page:Krudener - Valerie.djvu/246 Page:Krudener - Valerie.djvu/247 Page:Krudener - Valerie.djvu/248 Page:Krudener - Valerie.djvu/249 Page:Krudener - Valerie.djvu/250 Page:Krudener - Valerie.djvu/251 Page:Krudener - Valerie.djvu/252 Page:Krudener - Valerie.djvu/253 Page:Krudener - Valerie.djvu/254 Page:Krudener - Valerie.djvu/255 Page:Krudener - Valerie.djvu/256 Page:Krudener - Valerie.djvu/257 Page:Krudener - Valerie.djvu/258 Page:Krudener - Valerie.djvu/259 Page:Krudener - Valerie.djvu/260 Page:Krudener - Valerie.djvu/261 Page:Krudener - Valerie.djvu/262 Page:Krudener - Valerie.djvu/263 Page:Krudener - Valerie.djvu/264 Page:Krudener - Valerie.djvu/265 Page:Krudener - Valerie.djvu/266 Page:Krudener - Valerie.djvu/267 Page:Krudener - Valerie.djvu/268 Page:Krudener - Valerie.djvu/269 Page:Krudener - Valerie.djvu/270 Page:Krudener - Valerie.djvu/271 « Avec qui es-tu donc, mon fils, dans les courses solitaires ? » Il a tiré Ossian, et, d’un air passionné, il a dit : « Avec les héros, la nature et… — Et qui, mon fils ? » Il a hésité ; je l’ai embrassé. « Ai-je perdu ta confiance ? » II m’a embrassée avec transport. « Non, non ! » Puis il a ajouté en baissant la voix : « J’ai été avec un être idéal, charmant ; je ne l’ai jamais vu, et je le vois pourtant ; mon cœur bat, mes joues brûlent ; je l’appelle ; elle est timide et jeune comme moi, mais elle est bien meilleure. — Mon fils, ai-je dit avec une inflexion tendre et grave, il ne faut pas l’abandonner ainsi à ces rêves qui préparent à l’amour et ôtent la force de le combattre. Pense combien il se passera de temps avant que tu puisses te permettre d’aimer, de choisir une compagne ; et qui sait si jamais tu vivras pour l’amour heureux ! — Eh bien ! ma mère, ne m’avez-vous pas appris à aimer la vertu ? » J’ai souri et j’ai secoué la tête comme pour lui dire : Cela n’est pas aussi facile que tu penses ! « Oui, ma belle maman, la vertu ne m’effraye plus depuis qu’elle a pris vos traits. Vous réalisez pour moi l’idée de Platon, qui pensoit que, si la vertu se rendoit visible, on ne pourroit plus lui résister. Il faudra que la femme qui sera ma compagne vous ressemble, pour qu’elle ait toute mon âme. » J’ai encore souri. « Oh ! comme je saurois aimer ! bien, bien au delà de la vie ! et je la forcerois à m’aimer de même ; on ne résiste pas à ce que j’ai là dans le cœur ; quelque chose de si passionné ! » a-t-il dit en soupirant et frémissant ; puis, après un moment de silence, il a ajouté : « Un de nos hommes les plus étonnans, les plus excellens, Swedenborg, croyoit que des êtres qui s’étoient bien, bien aimés ici-bas, se confondoient après leur mort et ne formoient ensemble qu’un ange : c’est une belle idée, n’est-ce pas, maman ? »
LETTRE XLVIII
SUITE
Ici finissoit le journal, et vous seul pouvez imaginer ce qu’il me fit souffrir par les terribles rapprochemens que je faisois. Ces brillantes espérances qui venoient se briser contre un cercueil ; cette mère si aimable, qui sembloit pressentir le malheur que nous avons sous les yeux, et ce caractère si pur, si noble, si sensible, qui a tenu toutes les promesses de l’enfance : il n’est pas d’expression pour tout ce que j’éprouvois. Pour lui, il m’écoutoit avec un calme que j’aurois cru impossible. Vingt fois je voulus m’arrêter, me repentant de n’avoir pas assez prévu ce qu’il y avoit de trop douloureux dans cet écrit ; il me conjuroit, mais avec calme, de continuer.
Quelquefois il sembloit qu’il cherchoit à se rappeler ces scènes de son jeune âge ; il écartoit, en rêvant, de dessus son front ses cheveux, qui paroissoient l’embarrasser, et la pâleur de son front alors me faisoit si mal ! Quand je lui lus ce passage où Page:Krudener - Valerie.djvu/275 Page:Krudener - Valerie.djvu/276 Page:Krudener - Valerie.djvu/277 Page:Krudener - Valerie.djvu/278 Page:Krudener - Valerie.djvu/279 Page:Krudener - Valerie.djvu/280 Page:Krudener - Valerie.djvu/281 Page:Krudener - Valerie.djvu/282 Page:Krudener - Valerie.djvu/283 Page:Krudener - Valerie.djvu/284 de la relire, il était trop affoibli ; mais il a voulu la toucher, la regarder, parce qu’elle étoit pour vous.
Il n’est plus pour nous ni crainte ni espoir ; la douleur seule reste et ronge mon cœur. Le vertueux Gustave, mon fils, mon espérance, n’est plus… il a été rejoindre ses pères, et ses jours orageux sont ensevelis dans la froide demeure de la destruction. Je vais accomplir le triste et dernier devoir que j’ai à lui rendre, je vais tâcher de faire vivre encore les derniers instans de celui qui n’est plus, pour les retracer à celui qu’il aima tant… Je m’arrête : laissez couler mes larmes ; laissez couler les vôtres, pour que votre sein ne se brise pas.
J’ai eu un violent accès de fièvre ; j’ai été dans mon lit, privé pendant quelque temps de sentiment, puis tout entier à la douleur dont je me ressens encore. Je tâcherai de vous peindre, non ce que j’ai éprouvé, mais ce qui me reste de souvenir de ce terrible moment et de ce qui le concerne.
Le lendemain du jour où il vous écrivit, sa poitrine et sa tête s’embarrassèrent tellement que le médecin craignit qu’il ne passât pas la nuit. Nous ne le quittâmes pas d’un instant. Cependant, ’a cinq heures du matin, il y eut un grand mieux : il se sentit tout à coup plus calme ; l’oppression diminua ; ses mains seulement étoient extraordirement froides et s’engourdissoient. On les lui fit mettre dans de l’eau tiède ; ce sentiment parut lui faire plaisir. A six heures, à peu près, il demanda quel quantième du mois nous avions ; je lui dis que c’étoit le huit décembre, « Le huit ! » répéta-t-il sans rien ajouter. Puis il me demanda si je cro)’ois que nous aurions du soleil : le médecin lui répondit qu’il le croyoit, parce que le ciel avoit été très pur pendant la nuit, a Cela me feroit plaisir », dit-il. Il demanda du lait d’amande. A huit heures, il dit à Erich : « Mon ami, regardez le temps ; voyez s’il fera beau. ï> Erich revint et lui dit : « Les brouillards montent, et les montagnes se dégagent ; il fera beau. — Je voudrois bien, dit Gustave, voir encore un beau jour sur la terre.» Puis, se retournant vers moi, il me dit : « L’aumônier ne vient pas, je mourrai sans avoir accompli les devoirs de la religion. — Mon ami, dis-je, votre volonté vous est comptée par Celui devant qui rien ne se perd. — Je le sais », dit-il en joignant ses mains. Puis il se retourna encore vers moi, et me dit : « Je voudrois me lever», et, prévoyant que je m’y opposerois, il continua : «Je me sens fort bien ; je voudrois en profiter pour prier. » En vain je lui objectai qu’il prieroit dans son lit, qu’il étoit trop foible, je ne pus le détourner de cette idée. Il passa une robe de chambre ; mais à peine eut-il essayé de se tenir sur ses jambes qu’un vertige l’obligea à se rasseoir en s’appuyant sur moi. Il se leva derechef, s’agenouilla lentement ; et, mettant sa tête dans ses mains et s’appuyant contre le dossier d’un fauteuil, il pria avec ferveur. J’entendois quelques mots que la piété, le repentir, lui faisoient prononcer avec onction ; j’entendois mon nom et celui de Valérie se confondre ; il demandoit notre bonheur. Moimême, à genoux h ses côtés, je voulois prier pour lui ; mais, trop distrait, des paroles sans suite arrivoient sur mes lèvres ; je ne pensois qu’à lui. Quand il eut fini et qu’on l’eut aidé à se relever, il nous dit : « Je suis tranquille ; la paix est dans mon cœur. » Il sourit doucement, ne voulut point être déshabillé, et se recoucha ainsi. Il nous pria d’avancer son lit vers la fenêtre, de mettre sa tête de manière à voir l’ouest. « C’est là la Lombardie, me dit-il ; c’est là où le soleil se couche : je l’ai vu bien beau auprès de vous et auprès d’elle ! » Il fît approcher son lit encore plus près de la fenêtre. Le médecin craignit qu’il ne vînt de l’air. « Cela ne me fera plus de mal », dit Gustave, et il sourit tristement. Il nous pria de lui mettre des coussins pour qu’il fût assis. On avoit une vue très étendue de cette fenêtre, d’où l’on embrassoit une grande partie de la chaîne de l’Apennin ; l’aurore éclatait dans l’orient ; et le soleil, déjà levé en Toscane, s’avançoit vers nos montagnes. Gustave écarta les rideaux, se retourna et contempla ce magnifique spectacle. Pour moi, qui avois suivi toutes ses idées, de noirs pressentimens, d’affreuses images, me glaçoient ; j’étois assis sur son lit, et ma tête étoit dans mes mains. Il leva les siennes au ciel avec un regard inspiré, et me dit : « Laissons la douleur à celui pour qui la vie est tout, et qui n’est pas initié dans les mystères de la mort. — Hélas ! lui dis-je, l’avenir m’épouvante malgré moi, Gustave. — Oh ! que je bénis le Ciel, dit-il, de l’espérance et de la tranquillité qui se confondent dans mon cœur et le rendent aussi serein que le sera ce jour ! Oui, dit-il, et sa figure s’anima de la plus céleste expression en regardant l’horizon ; oui, ô mon Dieu ! l’aurore répond du soleil ; ainsi le pressentiment répond de l’immortalité ! » Il répandit doucement alors les deux dernières larmes qu’il a versées sur cette terre ; il ne parla plus. Il pria qu’on lui jouât le superbe cantique de Gellert sur la résurrection ; Berthi le joua. Il respiroit péniblement ; il avoit presque toujours les yeux fermés : un instant il les ouvrit quand le cantique fut fini ; il me tendit la main, fixa ses yeux du côté du couchant. Deux ramiers privés vinrent s’asseoir sur la corniche de la fenêtre ; il me les fit remarquer de la main. « Ils ne savent pas que la mort est si près d’eux », dit-il.
Le soleil s’étoit entièrement levé ; je voyois que Gustave cherchoit ses rayons. Sa respiration s’embarrassoit de plus en plus ; sa tête s’appesantit ; il me cherchoit de la main, et je vis qu’il ne me reconnoissoit plus. Il soupira, une légère convulsion altéra ses traits : il expira sur mon sein, une de ses mains dans celles d’Erich…
Je reprends mon récit interrompu ; j’avois besoin de force et de courage pour le continuer, j’ai encore devant mes yeux la plus triste des images, telle qu’elle me frappa en rentrant dans cette chambre d’où avoit disparu l’âme la plus tendre et la plus sublime. Je reculai d’horreur en voyant ce jeune et superbe Gustave couché dans le cercueil ; je m’appuyai contre la porte : il me sembloit que je faisois un rêve dont je ne pouvois sortir. Je m’avançai pour le considérer encore, et soulevai le mouchoir qui couvroit ses traits ; la mort y avoit déjà gravé son uniforme repos. Je le contemplai longtemps, mais sans attendrissement : il me sembloit que ma douleur s’arrêtoit devant une pensée auguste plus grande que la douleur ; et, sur ce cercueil même, je me sentois vivant d’avenir. Mon âme s’adressoit à la sienne. « Tu as eu soif de la félicité suprême, lui disois-je ; tu as détourné tes lèvres de la coupe de la vie, qui n’a pu te désaltérer ; mais tu respires maintenant la pure félicité de ceux qui vécurent comme toi, » Sa bouche avoit conservé les dernières traces de cette douce résignation qui étoit dans son âme ; la mort l’avoit enlevé sans le toucher de ses mains hideuses. À côté de lui étoit la table où étoient rangés tous ses papiers. À cette vue, mon cœur s’émut, comme s’il étoit encore vivant. Je voyois toutes ses dispositions écrites de sa main ; sa montre y étoit aussi. Je me rappelai qu’il m’avoit prié de la porter ; je la pris silencieusement ; je la regardai, elle étoit arrêtée. Je sentis un frisson désagréable ; et, en me retournant pour m’asseoir et prendre quelques forces, je renversai un des cierges ; il tomba sur la poitrine de Gustave : je me précipitai pour le relever ; et, en voyant l’inaltérable repos de celui qui ne pouvoit plus rien sentir ici-bas, je fis un cri. « Ô Gustave ! me disois-je, Gustave ! tu ne peux donc plus rien éprouver, rien entendre ! La voix gémissante de l’amitié passe à côté de toi et ne t’émeut plus ! » Je posai mes lèvres sur son front glacé : « Ô mon fils ! mon fils !… » C’est tout ce que je pus dire. Je restai immobile ; mon âme disoit un long adieu à cet objet si cher de mes affections ; et, lorsque je voulus fermer le cercueil, mes yeux tombèrent sur la main de Gustave qui étoit restée suspendue. Il avoit à un de ses doigts la bague décorée de ses armes, selon l’usage de notre pays ; je voulus la lui ôter ; puis, me rappelant que c’étoit là le dernier rejeton de cette illustre
maison des Linar : « Reste, lui dis-je, reste, et descends avec lui dans la tombe. » Alors mes larmes coulèrent ; je replaçai cette main sur la poitrine du mort, et je fermai son cercueil !
pour la
BIBLIOTHÈQUE DES DAMES
juillet 1884
Cette collection a pour but de réunir les ouvrages qui doivent le plus spécialement plaire aux Dames, et formera pour elles, à coté des grands classiques, dont elles ne doivent pas se désintéresser, une bibliothèque intime où elles pourront trouver un délassement à des lectures plus sérieuses. Comme la Bibliothèque des Dames ne comprendra que des ouvrages empruntés aux bons écrivains français, elle s’adresse également aux hommes, parmi lesquels elle ne pourra manquer de trouver un grand nombre d’amateurs.
Cette collection est imprimée avec le luxe et l’élégance que commandent les personnes à qui elle est destinée. Chaque volume, enfermé dans une gracieuse couverture imprimée en deux couleurs, est orné d’un frontispice gravé à l’eau-forte. — Le tirage est fait à petit nombre, sur papier de Hollande ; il y a aussi des exemplaires sur papier de Chine et sur papier Whatman.
Le Mérite des Femmes, par G. Legouvé, avec préface et appendice d’E. Legouvé 6 fr.
La Princesse de Clèves, de MMe de La Fayette, avec préface par M. de Lescure, i vol 8 fr.
Les Contes des Fées, de MMe d’Aulnoy, avec préface par M. de Lescure, 2 vol 15 fr.
Poésies de Madame Des Houllières, avec préface par M. de Lescure. i vol. 7 fr.
La Vie de Marianne, de Marivaux, avec préface par M. de Lescure, 3 vol 25 fr.
Œuvres morales de la Marquise de Lambert, avec préface par M. de Lescure, i vol. 7,50
Souvenirs de Madame de Caylus, avec notice par Jules Soury, i vol 7 fr.
Lettres à Émilie sur la mythologie, de Demoustier, avec préface par le Bibliophile Jacob, 3 vol 22 fr.
Sous presse : Mémoires de Madame Roland. — De l’Éducation des Filles, de Fénelon.
En préparation : Divers Ouvrages d’éducation, Contes, Romans, Mémoires, Correspondances, etc.
Juillet 1884.
Cette collection a pour but de réunir les ouvrages qui doivent le plus spécialement plaire aux Dames, et formera pour elles, à coté des grands classiques, dont elles ne doivent pas se désintéresser, une bibliothèque intime où elles pourront trouver un délassement à des lectures plus sérieuses. Comme la Bibliothèque des Dames ne comprendra que des ouvrages empruntés aux bons écrivains français, elle s’adresse également aux hommes, parmi lesquels elle ne pourra manquer de trouver un grand nombre d’amateurs.
Cette collection est imprimée avec le luxe et l’élégance que commandent les personnes à qui elle est destinée. Chaque volume, enfermé dans une gracieuse couverture imprimée en deux couleurs, est orné d’un frontispice gravé à l’eau-forte. — Le tirage est fait à petit nombre, sur papier de Hollande ; il y a aussi des exemplaires sur papier de Chine et sur papier Whatman.
Le Mérite des Femmes, par G. Legouvé, avec préface et appendice d’E. Legouvé 6 fr.
La Princesse de Clèves, de MMe de La Fayette, avec préface par M. de Lescure, i vol 8 fr.
Les Contes des Fées, de MMe d’Aulnoy, avec préface par M. de Lescure, 2 vol 15 fr.
Poésies de Madame Des Houllières, avec préface par M. de Lescure. i vol. 7 fr.
La Vie de Marianne, de Marivaux, avec préface par M. de Lescure, 3 vol 25 fr.
Œuvres morales de la Marquise de Lambert, avec préface par M. de Lescure, i vol. 7,50
Souvenirs de Madame de Caylus, avec notice par Jules Soury, i vol 7 fr.
Lettres à Émilie sur la mythologie, de Demoustier, avec préface par le Bibliophile Jacob, 3 vol 22 fr.
Sous presse : Mémoires de Madame Roland. — De l’Éducation des Filles, de Fénelon.
En préparation : Divers Ouvrages d’éducation, Contes, Romans, Mémoires, Correspondances, etc.
Juillet 1884.
TABLE DES MATIÈRES
- ↑ Elle a publié, sous le titre le Camp des Vertus, les pensées que lui inspira cette solennité.
- ↑ Madame de Krüdener, ses lettres et ses ouvrages inédits. Paris, Ollendorff, 1880.
- ↑ Il existe d’elle, en effet, une pièce de vers que cite M. Paul Lacroix, et qui fait penser aux Méditations de Lamartine.
- ↑ Ce fragment ne s’est pas retrouvé.
