Utilisateur:FreeCorp/Brouillon/EncyclopedieTome01-Accusatif
Mis en ordre & publié par M. DIDEROT, de l’Académie Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse ; & quant à la Partie Mathématique, par M. D’ALEMBERT,
de l’Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale
de Londres.
Tantùm de medio sumptis accedit honoris ! Horat.

| Chez | BRIASSON, rue Saint Jacques, à la Science. | |
| DAVID l’aîné, rue Saint Jacques, à la Plume d’or. | ||
| LE BRETON, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la Harpe. | ||
| DURAND, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon. |
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.
A MONSEIGNEUR
LE COMTE D’ARGENSON,
MINISTRE
ET SECRETAIRE D’ETAT DE LA GUERRE.
Monseigneur,
L’autorité suffit à un Ministre pour lui attirer l’hommage aveugle & suspect des Courtisans ; mais elle ne peut rien sur le suffrage du Public, des Etrangers, & de la Postérité. C’est à la nation éclairée des Gens de Lettres, & sur-tout à la nation libre & desintéressée des Philosophes, que vous devez, MONSEIGNEUR, l’estime générale, si flateuse pour qui sait penser, parce qu’on ne l’obtient que de ceux qui pensent. C’est à eux qu’il appartient de célébrer, sans s’avilir par des motifs méprisables, la considération distinguée que Vous marquez pour les talens ; considération qui leur rend précieux un homme d’Etat, quand il sait, comme Vous, leur faire sentir que ce n’est point par vanité, mais pour eux-mêmes qu’il les honore. Puisse, MONSEIGNEUR, cet Ouvrage, auquel plusieurs Savans & Artistes célebres ont bien voulu concourir avec nous, & que nous Vous présentons en leur nom, être un monument durable de la reconnoissance que les Lettres Vous doivent, & qu’elles cherchent à Vous témoigner. Les siecles futurs, si notre Encyclopédie a le bonheur d’y parvenir, parleront avec éloge de la protection que Vous lui avez accordée dès sa naissance, moins sans doute pour ce qu’elle est aujourd’hui, qu’en faveur de ce qu’elle peut devenir un jour. Nous sommes avec un profond respect,
MONSEIGNEUR,
Vos très-humbles & très-obéissans Serviteurs,
DIDEROT & D’ALEMBERT.
Sous un Temple d’Architecture Ionique, Sanctuaire de la Vérité, on voit la Vérité enveloppée d’un voile & rayonnante d’une lumiere qui écarte les nuages & les disperse.
À droite de la Vérité, la Raison & la Philosophie s’occupent l’une à lever, l’autre à arracher le voile de la Vérité.
À ses piés, la Théologie agenouillée reçoit sa lumiere d’en-haut.
En suivant la chaîne des figures, on trouve du même côté la Mémoire, l’Histoire Ancienne & Moderne, l’Histoire écrit les fastes, & le Tems lui sert d’appui.
Au-dessous sont grouppées la Géométrie, l’Astronomie & la Physique.
Les figures au-dessous de ce grouppe, montrent l’Optique, la Botanique, la Chymie & l’Agriculture.
En bas sont plusieurs Arts & Professions qui émanent des Sciences.
À gauche de la Vérité, on voit l’Imagination, qui se dispose à embellir & couronner la Vérité.
Au-dessous de l’Imagination, le Dessinateur a placé les différens genres de Poësie, Epique, Dramatique, Satyrique, Pastorale.
Ensuite viennent les autres Arts d’Imitation, la Musique, la Peinture, la Sculpture & l’Architecture.
’Encyclopédie que nous présentons au Public, est, comme son titre l’annonce,
l’Ouvrage d’une société de Gens de Lettres. Nous croirions pouvoir
assûrer, si nous n’étions pas du nombre, qu’ils sont tous avantageusement
connus, ou dignes de l’être. Mais sans vouloir prévenir un jugement qu’il
n’appartient qu’aux Savans de porter, il est au moins de notre devoir d’écarter
avant toutes choses l’objection la plus capable de nuire au succès
d’une si grande entreprise. Nous déclarons donc que nous n’avons point eu la témérité de
nous charger seuls d’un poids si supérieur à nos forces, & que notre fonction d’Editeurs consiste
principalement à mettre en ordre des matériaux dont la partie la plus considérable
nous a été entierement fournie. Nous avions fait expressément la même déclaration dans le
corps du Prospectus[1] ; mais elle auroit peut-être dû se trouver à la tête. Par cette précaution,
nous eussions apparemment répondu d’avance à une foule de gens du monde, & même
à quelques gens de Lettres, qui nous ont demandé comment deux personnes pouvoient traiter
de toutes les Sciences & de tous les Arts, & qui néanmoins avoient jetté sans doute les
yeux sur le Prospectus, puisqu’ils ont bien voulu l’honorer de leurs éloges. Ainsi, le seul moyen
d’empêcher sans retour leur objection de reparoître, c’est d’employer, comme nous faisons
ici, les premieres lignes de notre Ouvrage à la détruire. Ce début est donc uniquement destiné
à ceux de nos Lecteurs qui ne jugeront pas à propos d’aller plus loin : nous devons aux
autres un détail beaucoup plus étendu sur l’exécution de l’Encyclopedie : ils le trouveront
dans la suite de ce Discours, avec les noms de chacun de nos collegues ; mais ce
détail si important par sa nature & par sa matiere, demande à être précédé de quelques réflexions
philosophiques.
L’Ouvrage dont nous donnons aujourd’hui le premier volume, a deux objets : comme Encyclopédie, il doit exposer autant qu’il est possible, l’ordre & l’enchaînement des connoissances humaines : comme Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts & des Métiers, il doit contenir sur chaque Science & sur chaque Art, soit libéral, soit méchanique, les principes généraux qui en sont la base, & les détails les plus essentiels, qui en font le corps & la substance. Ces deux points de vûe, d’Encyclopédie & de Dictionnaire raisonné, formeront donc le plan & la division de notre Discours préliminaire. Nous allons les envisager, les suivre l’un après l’autre, & rendre compte des moyens par lesquels on a tâché de satisfaire à ce double objet.
Pour peu qu’on ait réfléchi sur la liaison que les découvertes ont entr’elles, il est facile de s’appercevoir que les Sciences & les Arts se prêtent mutuellement des secours, & qu’il y a par conséquent une chaîne qui les unit. Mais s’il est souvent difficile de réduire à un petit nombre de regles ou de notions générales, chaque Science ou chaque Art en particulier, il ne l’est pas moins de renfermer en un système qui soit un, les branches infiniment variées de la science humaine.
Le premier pas que nous ayons à faire dans cette recherche, est d’examiner, qu’on nous permette ce terme, la généalogie & la filiation de nos connoissances, les causes qui ont dû les faire naître, & les caracteres qui les distinguent ; en un mot, de remonter jusqu’à l’origine & à la génération de nos idées. Indépendamment des secours que nous tirerons de cet examen pour l’énumération encyclopédique des Sciences & des Arts, il ne sauroit être déplacé à la tête d’un ouvrage tel que celui-ci.
On peut diviser toutes nos connoissances en directes & en réfléchies. Les directes sont celles que nous recevons immédiatement sans aucune opération de notre volonté ; qui trouvant ouvertes, si on peut parler ainsi, toutes les portes de notre ame, y entrent sans résistance & sans effort. Les connoissances réfléchies sont celles que l’esprit acquiert en opérant sur les directes, en les unissant & en les combinant.
Toutes nos connoissances directes se réduisent à celles que nous recevons par les sens ; d’où il s’ensuit que c’est à nos sensations que nous devons toutes nos idées. Ce principe des premiers Philosophes a été long-tems regardé comme un axiome par les Scholastiques ; pour qu’ils lui fissent cet honneur il suffisoit qu’il fût ancien, & ils auroient défendu avec la même chaleur les formes substantielles ou les qualités occultes. Aussi cette vérité fut-elle traitée à la renaissance de la Philosophie, comme les opinions absurdes dont on auroit dû la distinguer ; on la proscrivit avec elles, parce que rien n’est si dangereux pour le vrai, & ne l’expose tant à être méconnu, que l’alliage ou le voisinage de l’erreur. Le système des idées innées, séduisant à plusieurs égards, & plus frappant peut-être parce qu’il étoit moins connu, a succédé à l’axiome des Scholastiques ; & après avoir long-tems regné, il conserve encore quelques partisans ; tant la vérité a de peine à reprendre sa place, quand les préjugés ou le sophisme l’en ont chassée. Enfin depuis assez peu de tems on convient presque généralement que les Anciens avoient raison ; & ce n’est pas la seule question sur laquelle nous commençons à nous rapprocher d’eux.
Rien n’est plus incontestable que l’existence de nos sensations ; ainsi, pour prouver qu’elles sont le principe de toutes nos connoissances, il suffit de démontrer qu’elles peuvent l’être : car en bonne Philosophie, toute déduction qui a pour base des faits ou des vérités reconnues, est préférable à ce qui n’est appuyé que sur des hypothèses, même ingénieuses. Pourquoi supposer que nous ayons d’avance des notions purement intellectuelles, si nous n’avons besoin pour les former, que de réfléchir sur nos sensations ? Le détail où nous allons entrer fera voir que ces notions n’ont point en effet d’autre origine.
La premiere chose que nos sensations nous apprennent, & qui même n’en est pas distinguée, c’est notre existence ; d’où il s’ensuit que nos premieres idées réfléchies doivent tomber sur nous, c’est-à-dire, sur ce principe pensant qui constitue notre nature, & qui n’est point différent de nous-mêmes. La seconde connoissance que nous devons à nos sensations, est l’existence des objets extérieurs, parmi lesquels notre propre corps doit être compris, puisqu’il nous est, pour ainsi dire, extérieur, même avant que nous ayons démêlé la nature du principe qui pense en nous. Ces objets innombrables produisent sur nous un effet si puissant, si continu, & qui nous unit tellement à eux, qu’après un premier instant où nos idées réfléchies nous rappellent en nous-mêmes, nous sommes forcés d’en sortir par les sensations qui nous assiégent de toutes parts, & qui nous arrachent à la solitude où nous resterions sans elles. La multiplicité de ces sensations, l’accord que nous remarquons dans leur témoignage, les nuances que nous y observons, les affections involontaires qu’elles nous font éprouver, comparées avec la détermination volontaire qui préside à nos idées réfléchies, & qui n’opere que sur nos sensations même ; tout cela forme en nous un penchant insurmontable à assûrer l’existence des objets auxquels nous rapportons ces sensations, & qui nous paroissent en être la cause ; penchant que bien des Philosophes ont regardé comme l’ouvrage d’un Etre supérieur, & comme l’argument le plus convaincant de l’existence de ces objets. En effet, n’y ayant aucun rapport entre chaque sensation & l’objet qui l’occasionne, ou du moins auquel nous la rapportons, il ne paroît pas qu’on puisse trouver par le raisonnement de passage possible de l’un à l’autre : il n’y a qu’une espece d’instinct, plus sûr que la raison même, qui puisse nous forcer à franchir un si grand intervalle ; & cet instinct est si vif en nous, que quand on supposeroit pour un moment qu’il subsistât, pendant que les objets extérieurs seroient anéantis, ces mêmes objets reproduits tout-à-coup ne pourroient augmenter sa force. Jugeons donc sans balancer, que nos sensations ont en effet hors de nous la cause que nous leur supposons, puisque l’effet qui peut résulter de l’existence réelle de cette cause ne sauroit différer en aucune maniere de celui que nous éprouvons ; & n’imitons point ces Philosophes dont parle Montagne, qui interrogés sur le principe des actions humaines, cherchent encore s’il y a des hommes. Loin de vouloir répandre des nuages sur une vérité reconnue des Sceptiques même lorsqu’ils ne disputent pas, laissons aux Métaphysiciens éclairés le soin d’en développer le principe : c’est à eux à déterminer, s’il est possible, quelle gradation observe notre ame dans ce premier pas qu’elle fait hors d’elle-même, poussée pour ainsi dire, & retenue tout à la fois par une foule de perceptions, qui d’un côté l’entraînent vers les objets extérieurs, & qui de l’autre n’appartenant proprement qu’à elle, semblent lui circonscrire un espace étroit dont elles ne lui permettent pas de sortir.
De tous les objets qui nous affectent par leur présence, notre propre corps est celui dont l’existence nous frappe le plus, parce qu’elle nous appartient plus intimement : mais à peine sentons-nous l’existence de notre corps, que nous nous appercevons de l’attention qu’il exige de nous, pour écarter les dangers qui l’environnent. Sujet à mille besoins, & sensible au dernier point à l’action des corps extérieurs, il seroit bien-tôt détruit, si le soin de sa conservation ne nous occupoit. Ce n’est pas que tous les corps extérieurs nous fassent éprouver des sensations desagréables, quelques-uns semblent nous dédommager par le plaisir que leur action nous procure. Mais tel est le malheur de la condition humaine, que la douleur est en nous le sentiment le plus vif ; le plaisir nous touche moins qu’elle, & ne suffit presque jamais pour nous en consoler. En vain quelques Philosophes soutenoient, en retenant leurs cris au milieu des souffrances, que la douleur n’étoit point un mal : en vain quelques autres plaçoient le bonheur suprème dans la volupté, à laquelle ils ne laissoient pas de se refuser par la crainte de ses suites : tous auroient mieux connu notre nature, s’ils s’étoient contentés de borner à l’exemption de la douleur le souverain bien de la vie présente ; & de convenir que sans pouvoir atteindre à ce souverain bien, il nous étoit seulement permis d’en approcher plus ou moins, à proportion de nos soins & de notre vigilance. Des réflexions si naturelles frapperont infailliblement tout homme abandonné à lui-même, & libre de préjugés, soit d’éducation, soit d’étude : elles seront la suite de la premiere impression qu’il recevra des objets ; & l’on peut les mettre au nombre de ces premiers mouvemens de l’ame, précieux pour les vrais sages, & dignes d’être observés par eux, mais négligés ou rejettés par la Philosophie ordinaire, dont ils démentent presque toujours les principes.
La nécessité de garantir notre propre corps de la douleur & de la destruction, nous fait examiner parmi les objets extérieurs, ceux qui peuvent nous être utiles ou nuisibles, pour rechercher les uns & fuir les autres. Mais à peine commençons-nous à parcourir ces objets, que nous découvrons parmi eux un grand nombre d’êtres qui nous paroissent entierement semblables à nous, c’est-à-dire, dont la forme est toute pareille à la nôtre, & qui, autant que nous en pouvons juger au premier coup d’œil, semblent avoir les mêmes perceptions que nous : tout nous porte donc à penser qu’ils ont aussi les mêmes besoins que nous éprouvons, & par conséquent le même intérêt de les satisfaire ; d’où il résulte que nous devons trouver beaucoup d’avantage à nous unir avec eux pour démêler dans la nature ce qui peut nous conserver ou nous nuire. La communication des idées est le principe & le soutien de cette union, & demande nécessairement l’invention des signes ; telle est l’origine de la formation des sociétés avec laquelle les langues ont dû naître.
Ce commerce que tant de motifs puissans nous engagent à former avec les autres hommes, augmente bien-tôt l’étendue de nos idées, & nous en fait naître de très-nouvelles pour nous, & de très éloignées, selon toute apparence, de celles que nous aurions eues par nous-mêmes sans un tel secours. C’est aux Philosophes à juger si cette communication réciproque, jointe à la ressemblance que nous appercevons entre nos sensations & celles de nos semblables, ne contribue pas beaucoup à fortifier ce penchant invincible que nous avons à supposer l’existence de tous les objets qui nous frappent. Pour me renfermer dans mon sujet, je remarquerai seulement que l’agrément & l’avantage que nous trouvons dans un pareil commerce, soit à faire part de nos idées aux autres hommes, soit à joindre les leurs aux nôtres, doit nous porter à resserrer de plus en plus les liens de la société commencée, & à la rendre la plus utile pour nous qu’il est possible. Mais chaque membre de la société cherchant ainsi à augmenter pour lui-même l’utilité qu’il en retire, & ayant à combattre dans chacun des autres un empressement égal au sien, tous ne peuvent avoir la même part aux avantages, quoique tous y ayent le même droit. Un droit si légitime est donc bien-tôt enfreint par ce droit barbare d’inégalité, appellé loi du plus fort, dont l’usage semble nous confondre avec les animaux, & dont il est pourtant si difficile de ne pas abuser. Ainsi la force, donnée par la nature à certains hommes, & qu’ils ne devroient sans doute employer qu’au soutien & à la protection des foibles, est au contraire l’origine de l’oppression de ces derniers. Mais plus l’oppression est violente, plus ils la souffrent impatiemment, parce qu’ils sentent que rien de raisonnable n’a dû les y assujettir. De-là la notion de l’injuste, & par conséquent du bien & du mal moral, dont tant de Philosophes ont cherché le principe, & que le cri de la nature, qui retentit dans tout homme, fait entendre chez les Peuples même les plus sauvages. De-là aussi cette loi naturelle que nous trouvons au-dedans de nous, source des premieres lois que les hommes ont dû former : sans le secours même de ces lois elle est quelquefois assez forte, sinon pour anéantir l’oppression, au moins pour la contenir dans certaines bornes. C’est ainsi que le mal que nous éprouvons par les vices de nos semblables, produit en nous la connoissance réfléchie des vertus opposées à ces vices ; connoissance précieuse, dont une union & une égalité parfaites nous auroient peut-être privés.
Par l’idée acquise du juste & de l’injuste, & conséquemment de la nature morale des actions, nous sommes naturellement amenés à examiner quel est en nous le principe qui agit, ou ce qui est la même chose, la substance qui veut & qui conçoit. Il ne faut pas approfondir beaucoup la nature de notre corps & l’idée que nous en avons, pour reconnoître qu’il ne sauroit être cette substance, puisque les propriétés que nous observons dans la matiere, n’ont rien de commun avec la faculté de vouloir & de penser : d’où il résulte que cet être appellé Nous est formé de deux principes de différente nature, tellement unis, qu’il regne entre les mouvemens de l’un & les affections de l’autre, une correspondance que nous ne saurions ni suspendre ni altérer, & qui les tient dans un assujettissement réciproque. Cet esclavage si indépendant de nous, joint aux réflexions que nous sommes forcés de faire sur la nature des deux principes & sur leur imperfection, nous éleve à la contemplation d’une Intelligence toute puissante à qui nous devons ce que nous sommes, & qui exige par conséquent notre culte : son existence, pour être reconnue, n’auroit besoin que de notre sentiment intérieur, quand même le témoignage universel des autres hommes, & celui de la Nature entiere ne s’y joindroient pas.
Il est donc évident que les notions purement intellectuelles du vice & de la vertu, le principe & la nécessité des lois, la spiritualité de l’ame, l’existence de Dieu & nos devoirs envers lui, en un mot les vérités dont nous avons le besoin le plus prompt & le plus indispensable, sont le fruit des premieres idées réfléchies que nos sensations occasionnent.
Quelque intéressantes que soient ces premieres vérités pour la plus noble portion de nous-mêmes, le corps auquel elle est unie nous ramene bientôt à lui par la nécessité de pourvoir à des besoins qui se multiplient sans cesse. Sa conservation doit avoir pour objet, ou de prévenir les maux qui le menacent, ou de remédier à ceux dont il est atteint. C’est à quoi nous cherchons à satisfaire par deux moyens ; savoir, par nos découvertes particulieres, & par les recherches des autres hommes ; recherches dont notre commerce avec eux nous met à portée de profiter. De-là ont dû naître d’abord l’Agriculture, la Medecine, enfin tous les Arts les plus absolument nécessaires. Ils ont été en même tems & nos connoissances primitives, & la source de toutes les autres, même de celles qui en paroissent très-éloignées par leur nature : c’est ce qu’il faut développer plus en détail.
Les premiers hommes, en s’aidant mutuellement de leurs lumieres, c’est-à-dire, de leurs efforts séparés ou réunis, sont parvenus, peut-être en assez peu de tems, à découvrir une partie des usages auxquels ils pouvoient employer les corps. Avides de connoissances utiles, ils ont dû écarter d’abord toute spéculation oisive, considérer rapidement les uns après les autres les différens êtres que la nature leur présentoit, & les combiner, pour ainsi dire, matériellement, par leurs propriétés les plus frappantes & les plus palpables. A cette premiere combinaison, il a dû en succéder une autre plus recherchée, mais toûjours relative à leurs besoins, & qui a principalement consisté dans une étude plus approfondie de quelques propriétés moins sensibles, dans l’altération & la décomposition des corps, & dans l’usage qu’on en pouvoit tirer.
Cependant, quelque chemin que les hommes dont nous parlons, & leurs successeurs, ayent été capables de faire, excités par un objet aussi intéressant que celui de leur propre conservation ; l’expérience & l’observation de ce vaste Univers leur ont fait rencontrer bientôt des obstacles que leurs plus grands efforts n’ont pû franchir. L’esprit, accoûtumé à la méditation, & avide d’en tirer quelque fruit, a dû trouver alors une espece de ressource dans la découverte des propriétés des corps uniquement curieuses, découverte qui ne connoît point de bornes. En effet, si un grand nombre de connoissances agréables suffisoit pour consoler de la privation d’une vérité utile, on pourroit dire que l’étude de la Nature, quand elle nous refuse le nécessaire, fournit du moins avec profusion à nos plaisirs : c’est une espece de superflu qui supplée, quoique très-imparfaitement, à ce qui nous manque. De plus, dans l’ordre de nos besoins & des objets de nos passions, le plaisir tient une des premieres places, & la curiosité est un besoin pour qui sait penser, sur-tout lorsque ce desir inquiet est animé par une sorte de dépit de ne pouvoir entierement se satisfaire. Nous devons donc un grand nombre de connoissances simplement agréables à l’impuissance malheureuse où nous sommes d’acquérir celles qui nous seroient d’une plus grande nécessité. Un autre motif sert à nous soûtenir dans un pareil travail ; si l’utilité n’en est pas l’objet, elle peut en être au moins le prétexte. Il nous suffit d’avoir trouvé quelquefois un avantage réel dans certaines connoissances, où d’abord nous ne l’avions pas soupçonné, pour nous autoriser à regarder toutes les recherches de pure curiosité, comme pouvant un jour nous être utiles. Voilà l’origine & la cause des progrès de cette vaste Science, appellée en général Physique ou Etude de la Nature, qui comprend tant de parties différentes : l’Agriculture & la Medecine, qui l’ont principalement fait naître, n’en sont plus aujourd’hui que des branches. Aussi, quoique les plus essentielles & les premieres de toutes, elles ont été plus ou moins en honneur à proportion qu’elles ont été plus ou moins étouffées & obscurcies par les autres.
Dans cette étude que nous faisons de la nature, en partie par nécessité, en partie par amusement, nous remarquons que les corps ont un grand nombre de propriétés, mais tellement unies pour la plûpart dans un même sujet, qu’afin de les étudier chacune plus à fond, nous sommes obligés de les considérer séparément. Par cette opération de notre esprit, nous découvrons bien-tôt des propriétés qui paroissent appartenir à tous les corps, comme la faculté de se mouvoir ou de rester en repos, & celle de se communiquer du mouvement, sources des principaux changemens que nous observons dans la Nature. L’examen de ces propriétés, & sur-tout de la derniere, aidé par nos propres sens, nous fait bientôt découvrir une autre propriété dont elles dépendent ; c’est l’impénétrabilité, ou cette espece de force par laquelle chaque corps en exclut tout autre du lieu qu’il occupe, de maniere que deux corps rapprochés le plus qu’il est possible, ne peuvent jamais occuper un espace moindre que celui qu’ils remplissoient étant désunis. L’impénétrabilité est la propriété principale par laquelle nous distinguons les corps des parties de l’espace indéfini où nous imaginons qu’ils sont placés ; du moins c’est ainsi que nos sens nous font juger ; & s’ils nous trompent sur ce point, c’est une erreur si métaphysique, que notre existence & notre conservation n’en ont rien à craindre, & que nous y revenons continuellement comme malgré nous par notre maniere ordinaire de concevoir. Tout nous porte à regarder l’espace comme le lieu des corps, sinon réel, au moins supposé ; c’est en effet par le secours des parties de cet espace considérées comme pénétrables & immobiles, que nous parvenons à nous former l’idée la plus nette que nous puissions avoir du mouvement. Nous sommes donc comme naturellement contraints à distinguer, au moins par l’esprit, deux sortes d’étendue, dont l’une est impénétrable, & l’autre constitue le lieu des corps. Ainsi quoique l’impénétrabilité entre nécessairement dans l’idée que nous nous formons des portions de la matiere, cependant comme c’est une propriété relative, c’est-à-dire dont nous n’avons l’idée qu’en examinant deux corps ensemble, nous nous accoûtumons bientôt à la regarder comme distinguée de l’étendue, & à considérer celle-ci séparément de l’autre.
Par cette nouvelle considération nous ne voyons plus les corps que comme des parties figurées & étendues de l’espace ; point de vue le plus général & le plus abstrait sous lequel nous puissions les envisager. Car l’étendue où nous ne distinguerions point de parties figurées, ne seroit qu’un tableau lointain & obscur, où tout nous échapperoit, parce qu’il nous seroit impossible d’y rien discerner. La couleur & la figure, propriétés toujours attachées aux corps, quoique variables pour chacun d’eux, nous servent en quelque sorte à les détacher du fond de l’espace ; l’une de ces deux propriétés est même suffisante à cet égard : aussi pour considérer les corps sous la forme la plus intellectuelle, nous préférons la figure à la couleur, soit parce que la figure nous est plus familiere étant à la fois connue par la vue & par le toucher, soit parce qu’il est plus facile de considérer dans un corps la figure sans la couleur, que la couleur sans la figure ; soit enfin parce que la figure sert à fixer plus aisément & d’une maniere moins vague, les parties de l’espace.
Nous voilà donc conduits à déterminer les propriétés de l’étendue simplement en tant que figurée. C’est l’objet de la Géométrie, qui pour y parvenir plus facilement, considere d’abord l’étendue limitée par une seule dimension, ensuite par deux, & enfin sous les trois dimensions qui constituent l’essence du corps intelligible, c’est-à-dire, d’une portion de l’espace terminée en tout sens par des bornes intellectuelles.
Ainsi, par des opérations & des abstractions successives de notre esprit, nous dépouillons la matiere de presque toutes ses propriétés sensibles, pour n’envisager en quelque maniere que son phantôme ; & l’on doit sentir d’abord que les découvertes auxquelles cette recherche nous conduit, ne pourront manquer d’être fort utiles toutes les fois qu’il ne sera point nécessaire d’avoir égard à l’impénétrabilité des corps ; par exemple, lorsqu’il sera question d’étudier leur mouvement, en les considérant comme des parties de l’espace, figurées, mobiles, & distantes les unes des autres.
L’examen que nous faisons de l’étendue figurée nous présentant un grand nombre de combinaisons à faire, il est nécessaire d’inventer quelque moyen qui nous rende ces combinaisons plus faciles ; & comme elles consistent principalement dans le calcul & le rapport des différentes parties dont nous imaginons que les corps géométriques sont formés, cette recherche nous conduit bientôt à l’Arithmétique ou Science des nombres. Elle n’est autre chose que l’art de trouver d’une maniere abrégée l’expression d’un rapport unique qui résulte de la comparaison de plusieurs autres. Les différentes manieres de comparer ces rapports donnent les différentes regles de l’Arithmétique.
De plus, il est bien difficile qu’en réfléchissant sur ces regles, nous n’appercevions certains principes ou propriétés générales des rapports, par le moyen desquelles nous pouvons, en exprimant ces rapports d’une maniere universelle, découvrir les différentes combinaisons qu’on en peut faire. Les résultats de ces combinaisons, réduits sous une forme générale, ne seront en effet que des calculs arithmétiques indiqués, & représentés par l’expression la plus simple & la plus courte que puisse souffrir leur état de généralité. La science ou l’art de désigner ainsi les rapports est ce qu’on nomme Algebre. Ainsi quoiqu’il n’y ait proprement de calcul possible que par les nombres, ni de grandeur mesurable que l’étendue (car sans l’espace nous ne pourrions mesurer exactement le tems) nous parvenons, en généralisant toujours nos idées, à cette partie principale des Mathématiques, & de toutes les Sciences naturelles, qu’on appelle Science des grandeurs en général ; elle est le fondement de toutes les découvertes qu’on peut faire sur la quantité, c’est-à-dire, sur tout ce qui est susceptible d’augmentation ou de diminution.
Cette Science est le terme le plus éloigné où la contemplation des propriétés de la matière puisse nous conduire, & nous ne pourrions aller plus loin sans sortir tout-à-fait de l’univers matériel. Mais telle est la marche de l’esprit dans ses recherches, qu’après avoir généralisé ses perceptions jusqu’au point de ne pouvoir plus les décomposer davantage, il revient ensuite sur ses pas, recompose de nouveau ces perceptions mêmes, & en forme peu à peu & par gradation, les êtres réels qui sont l’objet immédiat & direct de nos sensations. Ces êtres, immédiatement relatifs à nos besoins, sont aussi ceux qu’il nous importe le plus d’étudier ; les abstractions mathématiques nous en facilitent la connoissance ; mais elles ne sont utiles qu’autant qu’on ne s’y borne pas.
C’est pourquoi, ayant en quelque sorte épuisé par les spéculations géométriques les propriétés de l’étendue figurée, nous commençons par lui rendre l’impénétrabilité, qui constitue le corps physique, & qui étoit la dernière qualité sensible dont nous l’avions dépouillée. Cette nouvelle considération entraîne celle de l’action des corps les uns sur les autres, car les corps n’agissent qu’en tant qu’ils sont impénétrables ; & c’est delà que se déduisent les lois de l’équilibre & du mouvement, objet de la Méchanique. Nous étendons même nos recherches jusqu’au mouvement des corps animés par des forces ou causes motrices inconnues, pourvu que la loi suivant laquelle ces causes agissent, soit connue ou supposée l’être.
Rentrés enfin tout-à-fait dans le monde corporel, nous appercevons bientôt l’usage que nous pouvons faire de la Géométrie & de la Méchanique, pour acquérir sur les propriétés des corps les connoissances les plus variées & les plus profondes. C’est à-peu-près de cette manière que sont nées toutes les Sciences appellées Physico-Mathématiques. On peut mettre à leur tête l’Astronomie, dont l’étude, après celle de nous-mêmes, est la plus digne de notre application par le spectacle magnifique qu’elle nous présente. Joignant l’observation au calcul, & les éclairant l’un par l’autre, cette science détermine avec une exactitude digne d’admiration les distances & les mouvemens les plus compliqués des corps célestes ; elle assigne jusqu’aux forces mêmes par lesquelles ces mouvemens sont produits ou altérés. Aussi peut-on la regarder à juste titre comme l’application la plus sublime & la plus sûre de la Géométrie & de la Méchanique réunies, & ses progrès comme le monument le plus incontestable du succès auxquels l’esprit humain peut s’élever par ses efforts.
L’usage des connoissances mathématiques n’est pas moins grand dans l’examen des corps terrestres qui nous environnent. Toutes les propriétés que nous observons dans ces corps ont entr’elles des rapports plus ou moins sensibles pour nous : la connoissance ou la découverte de ces rapports est presque toujours le seul objet auquel il nous soit permis d’atteindre, & le seul par conséquent que nous devions nous proposer. Ce n’est donc point par des hypothèses vagues & arbitraires que nous pouvons espérer de connoître la Nature ; c’est par l’étude réfléchie des phénomènes, par la comparaison que nous ferons des uns avec les autres, par l’art de réduire, autant qu’il sera possible, un grand nombre de phénomènes à un seul qui puisse en être regardé comme le principe. En effet, plus on diminue le nombre des principes d’une science, plus on leur donne d’étendue ; puisque l’objet d’une science étant nécessairement déterminé, les principes appliqués à cet objet seront d’autant plus féconds qu’ils seront en plus petit nombre. Cette réduction, qui les rend d’ailleurs plus faciles à saisir, constitue le véritable esprit systématique qu’il faut bien se garder de prendre pour l’esprit de système, avec lequel il ne se rencontre pas toujours. Nous en parlerons plus au long dans la suite.
Mais à proportion que l’objet qu’on embrasse est plus ou moins difficile & plus ou moins vaste, la réduction dont nous parlons est plus ou moins pénible : on est donc aussi plus ou moins en droit de l’exiger de ceux qui se livrent à l’étude de la Nature. L’Aimant, par exemple, un des corps qui ont été le plus étudiés, & sur lequel on a fait des découvertes si surprenantes, a la propriété d’attirer le fer, celle de lui communiquer sa vertu, celle de se tourner vers les pôles du Monde, avec une variation qui est elle-même sujette à des règles, & qui n’est pas moins étonnante que ne le seroit une direction plus exacte ; enfin la propriété de s’incliner en formant avec la ligne horisontale un angle plus ou moins grand, selon le lieu de la terre où il est placé. Toutes ces propriétés singulières, dépendantes de la nature de l’Aimant, tiennent vraissemblablement à quelque propriété générale, qui en est l’origine, qui jusqu’ici nous est inconnue, & peut-être le restera long-tems. Au défaut d’une telle connoissance, & des lumières nécessaires sur la cause physique des propriétés de l’Aimant, ce seroit sans doute une recherche bien digne d’un Philosophe, que de réduire, s’il étoit possible, toutes ces propriétés à une seule, en montrant la liaison qu’elles ont entre elles. Mais plus une telle découverte seroit utile aux progrès de la Physique, plus nous avons lieu de craindre qu’elle ne soit refusée à nos efforts. J’en dis autant d’un grand nombre d’autres phénomènes dont l’enchaînement tient peut-être au système général du Monde.
La seule ressource qui nous reste donc dans une recherche si pénible, quoique si nécessaire, & même si agréable, c’est d’amasser le plus de faits qu’il nous est possible, de les disposer dans l’ordre le plus naturel, de les rappeller à un certain nombre de faits principaux dont les autres ne soient que des conséquences. Si nous osons quelquefois nous élever plus haut, que ce soit avec cette sage circonspection qui sied si bien à une vue aussi foible que la nôtre.
Tel est le plan que nous devons suivre dans cette vaste partie de la Physique, appellée Physique générale & expérimentale. Elle diffère des Sciences Physico-Mathématiques, en ce qu’elle n’est proprement qu’un recueil raisonné d’expériences & d’observations ; au lieu que celles-ci par l’application des calculs mathématiques à l’expérience, déduisent quelquefois d’une seule & unique observation un grand nombre de conséquences qui tiennent de bien près par leur certitude aux vérités géométriques. Ainsi une seule expérience sur la réflexion de la lumière donne toute la Catoptrique, ou science des propriétés des Miroirs ; une seule sur la réfraction de la lumière produit l’explication mathématique de l’Arc-en-ciel, la théorie des couleurs, & toute la Dioptrique, ou science des Verres concaves & convexes ; d’une seule observation sur la pression des fluides, on tire toutes les lois de l’équilibre & du mouvement de ces corps ; enfin une expérience unique sur l’accélération des corps qui tombent, fait découvrir les lois de leur chûte sur des plans inclinés, & celles du mouvement des pendules.
Il faut avouer pourtant que les Géomètres abusent quelquefois de cette application de l’Algebre à la Physique. Au défaut d’expériences propres à servir de base à leur calcul, ils se permettent des hypothèses les plus commodes, à la vérité, qu’il leur est possible, mais souvent très-éloignées de ce qui est réellement dans la Nature. On a voulu réduire en calcul jusqu’à l’art de guérir ; & le corps humain, cette machine si compliquée, a été traité par nos Médecins algébristes comme le seroit la machine la plus simple ou la plus facile à décomposer. C’est une chose singulière de voir ces Auteurs résoudre d’un trait de plume des problèmes d’Hydraulique & de Statique capables d’arrêter toute leur vie les plus grands Géomètres. Pour nous, plus sages ou plus timides, contentons-nous d’envisager la plupart de ces calculs & de ces suppositions vagues comme des jeux d’esprit auxquels la Nature n’est pas obligée de se soumettre ; & concluons, que la seule vraie manière de philosopher en Physique, consiste, ou dans l’application de l’analyse mathématique aux expériences, ou dans l’observation seule, éclairée par l’esprit de méthode, aidée quelquefois par des conjectures lorsqu’elles peuvent fournir des vues, mais sévèrement dégagée de toute hypothèse arbitraire.
Arrêtons-nous un moment ici, & jettons les yeux sur l’espace que nous venons de parcourir.Nous y remarquerons deux limites où se trouvent, pour ainsi dire, concentrées presque toutes les connoissances certaines accordées à nos lumières naturelles. L’une de ces limites, celle d’où nous sommes partis, est l’idée de nous-mêmes, qui conduit à celle de l’Etre tout-puissant, & de nos principaux devoirs. L’autre est cette partie des Mathématiques qui a pour objet les propriétés générales des corps, de l’étendue & de la grandeur. Entre ces deux termes est un intervalle immense, où l’Intelligence suprême semble avoir voulu se jouer de la curiosité humaine, tant par les nuages qu’elle y a répandus sans nombre, que par quelques traits de lumière qui semblent s’échapper de distance en distance pour nous attirer. On pourroit comparer l’Univers à certains ouvrages d’une obscurité sublime, dont les Auteurs en s’abaissant quelquefois à la portée de celui qui les lit, cherchent à lui persuader qu’il entend tout à-peu-près. Heureux donc, si nous nous engageons dans ce labyrinthe, de ne point quitter la véritable route ; autrement les éclairs destinés à nous y conduire, ne serviroient souvent qu’à nous en écarter davantage.
Il s’en faut bien d’ailleurs que le petit nombre de connoissances certaines sur lesquelles nous pouvons compter, & qui sont, si on peut s’exprimer de la sorte, reléguées aux deux extrémités de l’espace dont nous parlons, soit suffisant pour satisfaire à tous nos besoins. La nature de l’homme, dont l’étude est si nécessaire & si recommandée par Socrate, est un mystère impénétrable à l’homme même, quand il n’est éclairé que par la raison seule ; & les plus grands génies à force de réflexions sur une matière si importante, ne parviennent que trop souvent à en savoir un peu moins que le reste des hommes. On peut en dire autant de notre existence présente & future, de l’essence de l’Etre auquel nous la devons, & du genre de culte qu’il exige de nous.
Rien ne nous est donc plus nécessaire qu’une Religion révélée qui nous instruise sur tant de divers objets. Destinée à servir de supplément à la connoissance naturelle, elle nous montre une partie de ce qui nous étoit caché ; mais elle se borne à ce qu’il nous est absolument nécessaire de connoître ; le reste est fermé pour nous, & apparemment le sera toujours. Quelques vérités à croire, un petit nombre de préceptes à pratiquer, voilà à quoi la Religion révélée se réduit : néanmoins à la faveur des lumières qu’elle a communiquées au monde, le Peuple même est plus ferme & plus décidé sur un grand nombre de questions intéressantes, que ne l’ont été toutes les sectes des Philosophes.
À l’égard des Sciences mathématiques, qui constituent la seconde des limites dont nous avons parlé, leur nature & leur nombre ne doivent point nous en imposer. C’est à la simplicité de leur objet qu’elles sont principalement redevables de leur certitude. Il faut même avouer que comme toutes les parties des Mathématiques n’ont pas un objet également simple, aussi la certitude proprement dite, celle qui est fondée sur des principes nécessairement vrais & évidens par eux-mêmes, n’appartient ni également ni de la même manière à toutes ces parties. Plusieurs d’entr’elles, appuyées sur des principes physiques, c’est-à-dire, sur des vérités d’expérience ou sur de simples hypothèses, n’ont, pour ainsi dire, qu’une certitude d’expérience ou même de pure supposition. Il n’y a, pour parler exactement, que celles qui traitent du calcul des grandeurs & des propriétés générales de l’étendue, c’est-à-dire, l’Algebre, la Géométrie & la Méchanique, qu’on puisse regarder comme marquées au sceau de l’évidence. Encore y a-t-il dans la lumière que ces Sciences présentent à notre esprit, une espèce de gradation, & pour ainsi dire de nuance à observer. Plus l’objet qu’elles embrassent est étendu, & considéré d’une manière générale & abstraite, plus aussi leurs principes sont exempts de nuages ; c’est par cette raison que la Géométrie est plus simple que la Méchanique, & l’une & l’autre moins simples que l’Algebre. Ce paradoxe n’en sera point un pour ceux qui ont étudié ces Sciences en Philosophes ; les notions les plus abstraites, celles que le commun des hommes regarde comme les plus inaccessibles, sont souvent celles qui portent avec elles une plus grande lumière : l’obscurité s’empare de nos idées à mesure que nous examinons dans un objet plus de propriétés sensibles. L’impénétrabilité, ajoutée à l’idée de l’étendue, semble ne nous offrir qu’un mystère de plus, la nature du mouvement est une énigme pour les Philosophes, le principe métaphysique des lois de la percussion ne leur est pas moins caché ; en un mot plus ils approfondissent l’idée qu’ils se forment de la matière & des propriétés qui la représentent, plus cette idée s’obscurcit & paroît vouloir leur échapper.
On ne peut donc s’empêcher de convenir que l’esprit n’est pas satisfait au même degré par toutes les connoissances mathématiques : allons plus loin, & examinons sans prévention à quoi ces connoissances se réduisent. Envisagées d’un premier coup d’œil, elles sont sans doute en fort grand nombre, & même en quelque sorte inépuisables : mais lorsqu’après les avoir accumulées, on en fait le dénombrement philosophique, on s’apperçoit qu’on est en effet beaucoup moins riche qu’on ne croyoit l’être. Je ne parle point ici du peu d’application & d’usage qu’on peut faire de plusieurs de ces vérités ; ce seroit peut-être un argument assez foible contr’elles : je parle de ces vérités considérées en elles-mêmes. Qu’est-ce que la plûpart des ces axiomes dont la Géométrie est si orgueilleuse, si ce n’est l’expression d’une même idée simple par deux signes ou mots différens ? Celui qui dit que deux & deux font quatre, a-t-il une connoissance de plus que celui qui se contenteroit de dire que deux & deux font deux & deux ? Les idées de tout, de partie, de plus grand & de plus petit, ne sont-elles pas, à proprement parler, la même idée simple & individuelle, puisqu’on ne sauroit avoir l’une sans que les autres se présentent toutes en même tems ? Nous devons, comme l’ont observé quelques Philosophes, bien des erreurs à l’abus des mots ; c’est peut-être à ce même abus que nous devons les axiomes. Je ne prétends point cependant en condamner absolument l’usage, je veux seulement faire observer à quoi il se réduit ; c’est à nous rendre les idées simples plus familières par l’habitude, & plus propres aux différens usages auxquels nous pouvons les appliquer. J’en dis à-peu-près autant, quoiqu’avec les restrictions convenables, des théorèmes mathématiques. Considérés sans préjugé, ils se réduisent à un assez petit nombre de vérités primitives. Qu’on examine une suite de propositions de Géométrie déduites les unes des autres, en sorte que deux propositions voisines se touchent immédiatement & sans aucun intervalle, on s’appercevra qu’elles ne sont toutes que la première proposition qui se défigure, pour ainsi dire, successivement & peu à peu dans le passage d’une conséquence à la suivante, mais qui pourtant n’a point été réellement multipliée par cet enchaînement, & n’a fait que recevoir différentes formes. C’est à-peu-près comme si on vouloit exprimer cette proposition par le moyen d’une langue qui se seroit insensiblement dénaturée, & qu’on l’exprimât successivement de diverses manières, qui représentassent les différens états par lesquels la langue a passé.
Chacun de ces états se reconnoîtroit dans celui qui en seroit immédiatement voisin ; mais dans un état plus éloigné, on ne le démêleroit plus, quoiqu’il fût toûjours dépendant de ceux qui l’auroient précédé, & destiné à transmettre les mêmes idées. On peut donc regarder l’enchaînement de plusieurs vérités géométriques, comme des traductions plus ou moins différentes & plus ou moins compliquées de la même proposition, & souvent de la même hypothèse. Ces traductions sont au reste fort avantageuses par les divers usages qu’elles nous mettent à portée de faire du théorème qu’elles expriment ; usages plus ou moins estimables à proportion de leur importance & de leur étendue. Mais en convenant du mérite réel de la traduction mathématique d’une proposition, il faut reconnoître aussi que ce mérite réside originairement dans la proposition même. C’est ce qui doit nous faire sentir combien nous sommes redevables aux génies inventeurs, qui en découvrant quelqu’une de ces vérités fondamentales, source, & pour ainsi dire, original d’un grand nombre d’autres, ont réellement enrichi la Géométrie, & étendu son domaine.
Il en est de même des vérités physiques & des propriétés des corps dont nous appercevons la liaison. Toutes ces propriétés bien rapprochées ne nous offrent, à proprement parler, qu’une connoissance simple & unique. Si d’autres en plus grand nombre sont détachées pour nous, & forment des vérités différentes, c’est à la foiblesse de nos lumieres que nous devons ce triste avantage ; & l’on peut dire que notre abondance à cet égard est l’effet de notre indigence même. Les corps électriques dans lesquels on a découvert tant de propriétés singulieres, mais qui ne paroissent pas tenir l’une à l’autre, sont peut-être en un sens les corps les moins connus, parce qu’ils paroissent l’être davantage. Cette vertu qu’ils acquierent étant frottés, d’attirer de petits corpuscules, & celle de produire dans les animaux une commotion violente, sont deux choses pour nous ; c’en seroit une seule si nous pouvions remonter à la premiere cause. L’Univers, pour qui sauroit l’embrasser d’un seul point de vûe, ne seroit, s’il est permis de le dire, qu’un fait unique & une grande vérité.
Les différentes connoissances, tant utiles qu’agréables, dont nous avons parlé jusqu’ici, & dont nos besoins ont été la premiere origine, ne sont pas les seules que l’on ait dû cultiver. Il en est d’autres qui leur sont relatives, & auxquelles par cette raison les hommes se sont appliqués dans le même tems qu’ils se livroient aux premieres. Aussi nous aurions en même tems parlé de toutes, si nous n’avions crû plus à propos & plus conforme à l’ordre philosophique de ce Discours, d’envisager d’abord sans interruption l’étude générale que les hommes ont faite des corps, parce que cette étude est celle par laquelle ils ont commencé, quoique d’autres s’y soient bien-tôt jointes. Voici à-peu-près dans quel ordre ces dernieres ont dû se succéder.
L’avantage que les hommes ont trouvé à étendre la sphère de leurs idées, soit par leurs propres efforts, soit par le secours de leurs semblables, leur a fait penser qu’il seroit utile de réduire en art la maniere même d’acquérir des connoissances, & celle de se communiquer réciproquement leurs propres pensées ; cet art a donc été trouvé, & nommé Logique. Il enseigne à ranger les idées dans l’ordre le plus naturel, à en former la chaîne la plus immédiate, à décomposer celles qui en renferment un trop grand nombre de simples, à les envisager par toutes leurs faces, enfin à les présenter aux autres sous une forme qui les leur rende faciles à saisir. C’est en cela que consiste cette science du raisonnement qu’on regarde avec raison comme la clé de toutes nos connoissances. Cependant il ne faut pas croire qu’elle tienne le premier rang dans l’ordre de l’invention. L’art de raisonner est un présent que la Nature fait d’elle-même aux bons esprits ; & on peut dire que les livres qui en traitent ne sont guere utiles qu’à celui qui peut se passer d’eux. On a fait un grand nombre de raisonnemens justes, long-tems avant que la Logique réduite en principes apprît à démêler les mauvais, ou même à les pallier quelquefois par une forme subtile & trompeuse.
Cet art si précieux de mettre dans les idées l’enchaînement convenable, & de faciliter en conséquence le passage de l’une à l’autre, fournit en quelque maniere le moyen de rapprocher jusqu’à un certain point les hommes qui paroissent différer le plus. En effet, toutes nos connoissances se réduisent primitivement à des sensations, qui sont à peu-près les mêmes dans tous les hommes ; & l’art de combiner & de rapprocher des idées directes, n’ajoûte proprement à ces mêmes idées, qu’un arrangement plus ou moins exact, & une énumération qui peut être rendue plus ou moins sensible aux autres. L’homme qui combine aisément des idées ne differe guere de celui qui les combine avec peine, que comme celui qui juge tout d’un coup d’un tableau en l’envisageant, differe de celui qui a besoin pour l’apprétier qu’on lui en fasse observer successivement toutes les parties : l’un & l’autre en jettant un premier coup d’œil, ont eu les mêmes sensations, mais elles n’ont fait, pour ainsi dire, que glisser sur le second ; & il n’eût fallu que l’arrêter & le fixer plus long-tems sur chacune, pour l’amener au même point où l’autre s’est trouvé tout d’un coup. Par ce moyen les idées réfléchies du premier seroient devenues aussi à portée du second, que des idées directes. Ainsi il est peut-être vrai de dire qu’il n’y a presque point de science ou d’art dont on ne pût à la rigueur, & avec une bonne Logique, instruire l’esprit le plus borné, parce qu’il y en a peu dont les propositions ou les regles ne puissent être réduites à des notions simples, & disposées entre elles dans un ordre si immédiat que la chaîne ne se trouve nulle part interrompue. La lenteur plus ou moins grande des opérations de l’esprit exige plus ou moins cette chaîne, & l’avantage des plus grands génies se réduit à en avoir moins besoin que les autres, ou plûtôt à la former rapidement & presque sans s’en appercevoir.
La science de la communication des idées ne se borne pas à mettre de l’ordre dans les idées mêmes ; elle doit apprendre encore à exprimer chaque idée de la maniere la plus nette qu’il est possible, & par conséquent à perfectionner les signes qui sont destinés à la rendre : c’est aussi ce que les hommes ont fait peu à peu. Les langues, nées avec les sociétés, n’ont sans doute été d’abord qu’une collection assez bisarre de signes de toute espece ; & les corps naturels qui tombent sous nos sens ont été en conséquence les premiers objets que l’on ait désignés par des noms. Mais, autant qu’il est permis d’en juger, les langues dans cette premiere origine, destinée à l’usage le plus pressant, ont dû être fort imparfaites, peu abondantes, & assujetties à bien peu de principes certains ; & les Arts ou les Sciences absolument nécessaires pouvoient avoir fait beaucoup de progrès, lorsque les regles de la diction & du style étoient encore à naître. La communication des idées ne souffroit pourtant guere de ce défaut de regles, & même de la disette de mots ; ou plûtôt elle n’en souffroit qu’autant qu’il étoit nécessaire pour obliger chacun des hommes à augmenter ses propres connoissances par un travail opiniâtre, sans trop se reposer sur les autres. Une communication trop facile peut tenir quelquefois l’ame engourdie, & nuire aux efforts dont elle seroit capable. Qu’on jette les yeux sur les prodiges des aveugles nés, & des sourds & muets de naissance ; on verra ce que peuvent produire les ressorts de l’esprit, pour peu qu’ils soient vifs & mis en action par des difficultés à vaincre.
Cependant la facilité de rendre & de recevoir des idées par un commerce mutuel, ayant aussi de son côté des avantages incontestables, il n’est pas surprenant que les hommes ayent cherché de plus en plus à augmenter cette facilité. Pour cela, ils ont commencé par réduire les signes aux mots, parce qu’ils sont, pour ainsi dire, les symboles que l’on a le plus aisément sous la main. De plus, l’ordre de la génération des mots a suivi l’ordre des opérations de l’esprit : après les individus, on a nommé les qualités sensibles, qui, sans exister par elles-mêmes, existent dans ces individus, & sont communes à plusieurs : peu-à-peu l’on est enfin venu à ces termes abstraits, dont les uns servent à lier ensemble les idées, d’autres à désigner les propriétés générales des corps, d’autres à exprimer des notions purement spirituelles. Tous ces termes que les enfans sont si long-tems à apprendre, ont coûté sans doute encore plus de tems à trouver. Enfin réduisant l’usage des mots en préceptes, on a formé la Grammaire, que l’on peut regarder comme une des branches de la Logique. Eclairée par une Métaphysique fine & déliée, elle démêle les nuances des idées, apprend à distinguer ces nuances par des signes différens, donne des regles pour faire de ces signes l’usage le plus avantageux, découvre souvent par cet esprit philosophique qui remonte à la source de tout, les raisons du choix bisarre en apparence, qui fait préférer un signe à un autre, & ne laisse enfin à ce caprice national qu’on appelle usage, que ce qu’elle ne peut absolument lui ôter.
Les hommes en se communiquant leurs idées, cherchent aussi à se communiquer leurs passions. C’est par l’éloquence qu’ils y parviennent. Faite pour parler au sentiment, comme la Logique & la Grammaire parlent à l’esprit, elle impose silence à la raison même ; & les prodiges qu’elle opere souvent entre les mains d’un seul sur toute une Nation, sont peut-être le témoignage le plus éclatant de la supériorité d’un homme sur un autre. Ce qu’il y a de singulier, c’est qu’on ait cru suppléer par des regles à un talent si rare. C’est à peu-près comme si on eût voulu réduire le génie en préceptes. Celui qui a prétendu le premier qu’on devoit les Orateurs à l’art, ou n’étoit pas du nombre, ou étoit bien ingrat envers la Nature. Elle seule peut créer un homme éloquent ; les hommes sont le premier livre qu’il doive étudier pour réussir, les grands modeles sont le second ; & tout ce que ces Écrivains illustres nous ont laissé de philosophique & de réfléchi sur le talent de l’Orateur, ne prouve que la difficulté de leur ressembler. Trop éclairés pour prétendre ouvrir la carriere, ils ne vouloient sans doute qu’en marquer les écueils. A l’égard de ces puérilités pédantesques qu’on a honorées du nom de Rhétorique, ou plûtôt qui n’ont servi qu’à rendre ce nom ridicule, & qui sont à l’Art oratoire ce que la Scholastique est à la vraie Philosophie, elles ne sont propres qu’à donner de l’Éloquence l’idée la plus fausse & la plus barbare. Cependant quoiqu’on commence assez universellement à en reconnoître l’abus, la possession où elles sont depuis long-tems de former une branche distinguée de la connoissance humaine, ne permet pas encore de les en bannir : pour l’honneur de notre discernement, le tems en viendra peut-être un jour.
Ce n’est pas assez pour nous de vivre avec nos contemporains, & de les dominer. Animés par la curiosité & par l’amour-propre, & cherchant par une avidité naturelle à embrasser à la fois le passé, le présent & l’avenir, nous desirons en même tems de vivre avec ceux qui nous suivront, & d’avoir vêcu avec ceux qui nous ont précédé. De-là l’origine & l’étude de l’Histoire, qui nous unissant aux siecles passés par le spectacle de leurs vices & de leurs vertus, de leurs connoissances & de leurs erreurs, transmet les nôtres aux siecles futurs. C’est là qu’on apprend à n’estimer les hommes que par le bien qu’ils font, & non par l’appareil imposant qui les entoure : les Souverains, ces hommes assez malheureux pour que tout conspire à leur cacher la vérité, peuvent eux-mêmes se juger d’avance à ce tribunal integre & terrible ; le témoignage que rend l’Histoire à ceux de leurs prédécesseurs qui leur ressemblent, est l’image de ce que la postérité dira d’eux.
La Chronologie & la Géographie sont les deux rejettons & les deux soûtiens de la science dont nous parlons : l’une, pour ainsi dire, place les hommes dans le tems ; l’autre les distribue sur notre globe. Toutes deux tirent un grand secours de l’histoire de la Terre & de celle des Cieux, c’est-à-dire des faits historiques, & des observations célestes ; & s’il étoit permis d’emprunter ici le langage des Poëtes, on pourroit dire que la science des tems & celle des lieux sont filles de l’Astronomie & de l’Histoire.
Un des principaux fruits de l’étude des Empires & de leurs révolutions, est d’examiner comment les hommes, séparés pour ainsi dire en plusieurs grandes familles, ont formé diverses sociétés ; comment ces différentes sociétés ont donné naissance aux différentes especes de gouvernemens ; comment elles ont cherché à se distinguer les unes des autres, tant par les lois qu’elles se sont données, que par les signes particuliers que chacune a imaginées pour que ses membres communiquassent plus facilement entr’eux. Telle est la source de cette diversité de langues & de lois, qui est devenue pour notre malheur un objet considérable d’étude. Telle est encore l’origine de la politique, espece de morale d’un genre particulier & supérieur, à laquelle les principes de la morale ordinaire ne peuvent quelquefois s’accommoder qu’avec beaucoup de finesse, & qui pénétrant dans les ressorts principaux du gouvernement des États, démêle ce qui peut les conserver, les affoiblir ou les détruire. Étude peut-être la plus difficile de toutes, par les connoissances profondes des peuples & des hommes qu’elle exige, & par l’étendue & la variété des talens qu’elle suppose ; sur-tout quand le Politique ne veut point oublier que la loi naturelle, antérieure à toutes les conventions particulieres, est aussi la premiere loi des Peuples, & que pour être homme d’État, on ne doit point cesser d’être homme.
Voilà les branches principales de cette partie de la connoissance humaine, qui consiste ou dans les idées directes que nous avons reçûes par les sens, ou dans la combinaison & la comparaison de ces idées ; combinaison qu’en général on appelle Philosophie. Ces branches se subdivisent en une infinité d’autres dont l’énumération seroit immense, & appartient plus à cet ouvrage même qu’à sa Préface.
La premiere opération de la réflexion consistant à rapprocher & à unir les notions directes, nous avons dû commencer dans ce discours par envisager la réflexion de ce côté-là, & parcourir les différentes sciences qui en résultent. Mais les notions formées par la combinaison des idées primitives, ne sont pas les seules dont notre esprit soit capable. Il est une autre espece de connoissances réfléchies, dont nous devons maintenant parler. Elles consistent dans les idées que nous nous formons à nous-mêmes en imaginant & en composant des êtres semblables à ceux qui sont l’objet de nos idées directes. C’est ce qu’on appelle l’imitation de la Nature, si connue & si recommandée par les Anciens. Comme les idées directes qui nous frappent le plus vivement, sont celles dont nous conservons le plus aisément le souvenir, ce sont aussi celles que nous cherchons le plus à réveiller en nous par l’imitation de leurs objets. Si les objets agréables nous frappent plus étant réels que simplement représentés, ce déchet d’agrément est en quelque maniere compensé par celui qui résulte du plaisir de l’imitation. A l’égard des objets qui n’exciteroient étant réels que des sentimens tristes ou tumultueux, leur imitation est plus agréable que les objets même, parce qu’elle nous place à cette juste distance, où nous éprouvons le plaisir de l’émotion sans en ressentir le desordre. C’est dans cette imitation des objets capables d’exciter en nous des sentimens vifs ou agréables, de quelque nature qu’ils soient, que consiste en général l’imitation de la belle Nature, sur laquelle tant d’Auteurs ont écrit sans en donner d’idée nette ; soit parce que la belle Nature ne se démêle que par un sentiment exquis, soit aussi parce que dans cette matiere les limites qui distinguent l’arbitraire du vrai ne sont pas encore bien fixées, & laissent quelque espace libre à l’opinion.
À la tête des connoissances qui consistent dans l’imitation, doivent être placées la Peinture & la Sculpture, parce que ce sont celles de toutes où l’imitation approche le plus des objets qu’elle représente, & parle le plus directement aux sens. On peut y joindre cet art, né de la nécessité, & perfectionné par le luxe, l’Architecture, qui s’étant élevée par degrés des chaumieres aux palais, n’est aux yeux du Philosophe, si on peut parler ainsi, que le masque embelli d’un de nos plus grands besoins. L’imitation de la belle Nature y est moins frappante, & plus resserrée que dans les deux autres Arts dont nous venons de parler ; ceux-ci expriment indifféremment & sans restriction toutes les parties de la belle Nature, & la représentent telle qu’elle est, uniforme ou variée ; l’Architecture au contraire se borne à imiter par l’assemblage & l’union des différens corps qu’elle employe, l’arrangement symmétrique que la nature observe plus ou moins sensiblement dans chaque individu, & qui contraste si bien avec la belle variété du tout ensemble.
La Poësie qui vient après la Peinture & la Sculpture, & qui n’employe pour l’imitation que les mots disposés suivant une harmonie agréable à l’oreille, parle plûtot à l’imagination qu’aux sens ; elle lui représente d’une maniere vive & touchante les objets qui composent cet Univers, & semble plûtôt les créer que les peindre, par la chaleur, le mouvement, & la vie qu’elle sait leur donner. Enfin la Musique, qui parle à la fois à l’imagination & aux sens, tient le dernier rang dans l’ordre de l’imitation ; non que son imitation soit moins parfaite dans les objets qu’elle se propose de représenter, mais parce qu’elle semble bornée jusqu’ici à un plus petit nombre d’images ; ce qu’on doit moins attribuer à sa nature, qu’à trop peu d’invention & de ressource dans la plûpart de ceux qui la cultivent : il ne sera pas inutile de faire sur cela quelques réflexions. La Musique, qui dans son origine n’étoit peut-être destinée à représenter que du bruit, est devenue peu-à-peu une espece de discours ou même de langue, par laquelle on exprime les différens sentimens de l’ame, ou plûtôt ses différentes passions : mais pourquoi réduire cette expression aux passions seules, & ne pas l’étendre, autant qu’il est possible, jusqu’aux sensations même ? Quoique les perceptions que nous recevons par divers organes different entr’elles autant que leurs objets, on peut néanmoins les comparer sous un autre point de vûe qui leur est commun, c’est-à-dire, par la situation de plaisir ou de trouble où elles mettent notre ame. Un objet effrayant, un bruit terrible, produisent chacun en nous une émotion par laquelle nous pouvons jusqu’à un certain point les rapprocher, & que nous désignons souvent dans l’un & l’autre cas, ou par le même nom, ou par des noms synonymes. Je ne vois donc point pourquoi un Musicien qui auroit à peindre un objet effrayant, ne pourroit pas y réussir en cherchant dans la Nature l’espece de bruit qui peut produire en nous l’émotion la plus semblable à celle que cet objet y excite. J’en dis autant des sensations agréables. Penser autrement, ce seroit vouloir resserrer les bornes de l’art & de nos plaisirs. J’avoue que la peinture dont il s’agit, exige une étude fine & approfondie des nuances qui distinguent nos sensations ; mais aussi ne faut-il pas espérer que ces nuances soient démêlées par un talent ordinaire. Saisies par l’homme de génie, senties par l’homme de goût, apperçûes par l’homme d’esprit, elles sont perdues pour la multitude. Toute Musique qui ne peint rien n’est que du bruit ; & sans l’habitude qui dénature tout, elle ne feroit guere plus de plaisir qu’une suite de mots harmonieux & sonores dénués d’ordre & de liaison. Il est vrai qu’un Musicien attentif à tout peindre, nous présenteroit dans plusieurs circonstances des tableaux d’harmonie qui ne seroient point faits pour des sens vulgaires ; mais tout ce qu’on en doit conclurre, c’est qu’après avoir fait un art d’apprendre la Musique, on devroit bien en faire un de l’écouter.
Nous terminerons ici l’énumération de nos principales connoissances. Si on les envisage maintenant toutes ensemble, & qu’on cherche les points de vûe généraux qui peuvent servir à les discerner, on trouve que les unes purement pratiques ont pour but l’exécution de quelque chose ; que d’autres simplement spéculatives se bornent à l’examen de leur objet, & à la contemplation de ses propriétés ; qu’enfin d’autres tirent de l’étude spéculative de leur objet l’usage qu’on en peut faire dans la pratique. La spéculation & la pratique constituent la principale différence qui distingue les Sciences d’avec les Arts, & c’est à-peu-près en suivant cette notion, qu’on a donné l’un ou l’autre nom à chacune de nos connoissances. Il faut cependant avoüer que nos idées ne sont pas encore bien fixées sur ce sujet. On ne sait souvent quel nom donner à la plûpart des connoissances où la spéculation se réunit à la pratique ; & l’on dispute, par exemple, tous les jours dans les écoles, si la Logique est un art ou une science : le problème seroit bien-tôt résolu, en répondant qu’elle est à la fois l’une & l’autre. Qu’on s’épargneroit de questions & de peines si on déterminoit enfin la signification des mots d’une maniere nette & précise !
On peut en général donner le nom d’Art à tout système de connoissances qu’il est possible de réduire à des regles positives, invariables & indépendantes du caprice ou de l’opinion, & il seroit permis de dire en ce sens que plusieurs de nos sciences sont des arts, étant envisagées par leur côté pratique. Mais comme il y a des regles pour les opérations de l’esprit ou de l’ame, il y en a aussi pour celles du corps ; c’est-à-dire, pour celles qui bornées aux corps extérieurs, n’ont besoin que de la main seule pour être exécutées. De-là la distinction des Arts en libéraux & en méchaniques, & la supériorité qu’on accorde aux premiers sur les seconds. Cette supériorité est sans doute injuste à plusieurs égards. Néanmoins parmi les préjugés, tout ridicules qu’ils peuvent être, il n’en est point qui n’ait sa raison, ou pour parler plus exactement, son origine ; & la Philosophie souvent impuissante pour corriger les abus, peut au moins en démêler la source. La force du corps ayant été le premier principe qui a rendu inutile le droit que tous les hommes avoient d’être égaux, les plus foibles, dont le nombre est toûjours le plus grand, se sont joints ensemble pour la réprimer. Ils ont donc établi par le secours des lois & des différentes sortes de gouvernemens une inégalité de convention dont la force a cessé d’être le principe. Cette derniere inégalité étant bien affermie, les hommes, en se réunissant avec raison pour la conserver, n’ont pas laissé de réclamer secretement contre elle par ce desir de supériorité que rien n’a pû détruire en eux. Ils ont donc cherché une sorte de dédommagement dans une inégalité moins arbitraire ; & la force corporelle, enchaînée par les lois, ne pouvant plus offrir aucun moyen de supériorité, ils ont été réduits à chercher dans la différence des esprits un principe d’inégalité aussi naturel, plus paisible, & plus utile à la société. Ainsi la partie la plus noble de notre être s’est en quelque maniere vengée des premiers avantages que la partie la plus vile avoit usurpés ; & les talens de l’esprit ont été généralement reconnus pour supérieurs à ceux du corps. Les Arts méchaniques dépendans d’une opération manuelle, & asservis, qu’on me permette ce terme, à une espece de routine, ont été abandonnés à ceux d’entre les hommes que les préjugés ont placés dans la classe la plus inférieure. L’indigence qui a forcé ces hommes à s’appliquer à un pareil travail, plus souvent que le goût & le génie ne les y ont entraînés, est devenue ensuite une raison pour les mépriser, tant elle nuit à tout ce qui l’accompagne. A l’égard des opérations libres de l’esprit, elles ont été le partage de ceux qui se sont crus sur ce point les plus favorisés de la Nature. Cependant l’avantage que les Arts libéraux ont sur les Arts méchaniques par le travail que les premiers exigent de l’esprit, & par la difficulté d’y exceller, est suffisamment compensé par l’utilité bien supérieure que les derniers nous procurent pour la plûpart. C’est cette utilité même qui a forcé de les réduire à des opérations purement machinales, pour en faciliter la pratique à un plus grand nombre d’hommes. Mais la société, en respectant avec justice les grands génies qui l’éclairent, ne doit point avilir les mains qui la servent. La découverte de la Boussole n’est pas moins avantageuse au genre humain, que ne le seroit à la Physique l’explication des propriétés de cette aiguille. Enfin, à considérer en lui-même le principe de la distinction dont nous parlons, combien de Savans prétendus dont la science n’est proprement qu’un art méchanique ? & quelle différence réelle y a-t-il entre une tête remplie de faits sans ordre, sans usage & sans liaison, & l’instinct d’un Artisan réduit à l’exécution machinale ?
Le mépris qu’on a pour les Arts méchaniques semble avoir influé jusqu’à un certain point sur leurs inventeurs mêmes. Les noms de ces bienfaiteurs du genre humain sont presque tous inconnus, tandis que l’histoire de ses destructeurs, c’est-à-dire, des conquérans, n’est ignorée de personne. Cependant c’est peut-être chez les Artisans qu’il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la sagacité de l’esprit, de sa patience & de ses ressources. J’avoue que la plûpart des Arts n’ont été inventés que peu-à-peu ; & qu’il a fallu une assez longue suite de siecles pour porter les montres, par exemple, au point de perfection où nous les voyons. Mais n’en est-il pas de même des Sciences ? Combien de découvertes qui ont immortalisé leurs auteurs, avoient été préparées par les travaux des siecles précédens, souvent même amenées à leur maturité, au point de ne demander plus qu’un pas à faire ? Et pour ne point sortir de l’Horlogerie, pourquoi ceux à qui nous devons la fusée des montres, l’échappement & la répétition, ne sont-ils pas aussi estimés que ceux qui ont travaillé successivement à perfectionner l’Algebre ? D’ailleurs, si j’en crois quelques Philosophes que le mépris qu’on a pour les Arts n’a point empêché de les étudier, il est certaines machines si compliquées, & dont toutes les parties dépendent tellement l’une de l’autre, qu’il est difficile que l’invention en soit dûe à plus d’un seul homme. Ce génie rare dont le nom est enseveli dans l’oubli, n’eût-il pas été bien digne d’être placé à côté du petit nombre d’esprits créateurs, qui nous ont ouvert dans les Sciences des routes nouvelles ?
Parmi les Arts libéraux qu’on a réduits à des principes, ceux qui se proposent l’imitation de la Nature, ont été appellés beaux Arts, parce qu’ils ont principalement l’agrément pour objet. Mais ce n’est pas la seule chose qui les distingue des Arts libéraux plus nécessaires ou plus utiles, comme la Grammaire, la Logique & la Morale. Ces derniers ont des regles fixes & arrêtées, que tout homme peut transmettre à un autre : au lieu que la pratique des beaux Arts consiste principalement dans une invention qui ne prend guere ses lois que du génie ; les regles qu’on a écrites sur ces Arts n’en sont proprement que la partie méchanique ; elles produisent à-peu-près l’effet du Telescope, elles n’aident que ceux qui voyent.
Il résulte de tout ce que nous avons dit jusqu’ici, que les différentes manieres dont notre esprit opere, sur les objets, & les différens usages qu’il tire de ces objets même, sont le premier moyen qui se présente à nous pour discerner en général nos connoissances les unes des autres. Tout s’y rapporte à nos besoins, soit de nécessité absolue, soit de convenance & d’agrément, soit même d’usage & de caprice. Plus les besoins sont éloignés ou difficiles à satisfaire, plus les connoissances destinées à cette fin sont lentes à paroître. Quels progrès la Medecine n’auroit-elle pas fait aux dépens des Sciences de pure spéculation, si elle étoit aussi certaine que la Géométrie ? Mais il est encore d’autres caracteres très-marqués dans la maniere dont nos connoissances nous affectent, & dans les différens jugemens que notre ame porte de ses idées. Ces jugemens sont désignés par les mots d’évidence, de certitude, de probabilité, de sentiment & de goût.
L’évidence appartient proprement aux idées dont l’esprit apperçoit la liaison tout-d’un-coup ; la certitude à celles dont la liaison ne peut être connue que par le secours d’un certain nombre d’idées intermédiaires, ou, ce qui est la même chose, aux propositions dont l’identité avec un principe évident par lui-même, ne peut être découverte que par un circuit plus ou moins long ; d’où il s’ensuivroit que selon la nature des esprits, ce qui est évident pour l’un ne seroit quelquefois que certain pour un autre. On pourroit encore dire, en prenant les mots d’évidence & de certitude dans un autre sens, que la premiere est le résultat des opérations seules de l’esprit, & se rapporte aux spéculations métaphysiques & mathématiques ; & que la seconde est plus propre aux objets physiques, dont la connoissance est le fruit du rapport constant & invariable de nos sens. La probabilité a principalement lieu pour les faits historiques, & en général pour tous les évenemens passés, présens & à venir, que nous attribuons à une sorte de hasard, parce que nous n’en démêlons pas les causes. La partie de cette connoissance qui a pour objet le présent & le passé, quoiqu’elle ne soit fondée que sur le simple témoignage, produit souvent en nous une persuasion aussi forte que celle qui naît des axiomes. Le sentiment est de deux sortes, l’un destiné aux vérités de morale, s’appelle conscience ; c’est une suite de la loi naturelle & de l’idée que nous avons du bien & du mal ; & on pourroit le nommer évidence du cœur, parce que tout différent qu’il est de l’évidence de l’esprit attachée aux vérités spéculatives, il nous subjugue avec le même empire. L’autre espece de sentiment est particulierement affecté à l’imitation de la belle Nature, & à ce qu’on appelle beautés d’expression. Il saisit avec transport les beautés sublimes & frappantes, démêle avec finesse les beautés cachées, & proscrit ce qui n’en a que l’apparence. Souvent même il prononce des arrêts séveres sans se donner la peine d’en détailler les motifs, parce que ces motifs dépendent d’une foule d’idées difficiles à développer sur-le-champ, & plus encore à transmettre aux autres. C’est à cette espece de sentiment que nous devons le goût & le génie, distingués l’un de l’autre en ce que le génie est le sentiment qui crée, & le goût, le sentiment qui juge.
Après le détail où nous sommes entrés sur les différentes parties de nos connoissances, & sur les caracteres qui les distinguent, il ne nous reste plus qu’à former un Arbre généalogique ou encyclopédique qui les rassemble sous un même point de vûe, & qui serve à marquer leur origine & les liaisons qu’elles ont entr’elles. Nous expliquerons dans un moment l’usage que nous prétendons faire de cet arbre. Mais l’exécution n’en est pas sans difficulté. Quoique l’histoire philosophique que nous venons de donner de l’origine de nos idées, soit fort utile pour faciliter un pareil travail, il ne faut pas croire que l’arbre encyclopédique doive ni puisse même être servilement assujetti à cette histoire. Le système général des Sciences & des Arts est une espece de labyrinthe, de chemin tortueux où l’esprit s’engage sans trop connoître la route qu’il doit tenir. Pressé par ses besoins, & par ceux du corps auquel il est uni, il étudie d’abord les premiers objets qui se présentent à lui ; pénetre le plus avant qu’il peut dans la connoissance de ces objets ; rencontre bientôt des difficultés qui l’arrêtent, & soit par l’espérance ou même par le desespoir de les vaincre, se jette dans une nouvelle route ; revient ensuite sur ses pas ; franchit quelquefois les premieres barrieres pour en rencontrer de nouvelles ; & passant rapidement d’un objet à un autre, fait sur chacun de ces objets à différens intervalles & comme par secousses, une suite d’opérations dont la génération même de ses idées rend la discontinuité nécessaire. Mais ce desordre, tout philosophique qu’il est de la part de l’ame, défigureroit, ou plûtôt anéantiroit entierement un Arbre encyclopédique dans lequel on voudroit le représenter.
D’ailleurs, comme nous l’avons déjà fait sentir au sujet de la Logique, la plûpart des Sciences qu’on regarde comme renfermant les principes de toutes les autres, & qui doivent par cette raison occuper les premieres places dans l’ordre encyclopédique, n’observent pas le même rang dans l’ordre généalogique des idées, parce qu’elles n’ont pas été inventées les premieres. En effet, notre étude primitive a dû être celle des individus ; ce n’est qu’après avoir considéré leurs propriétés particulieres & palpables, que nous avons par abstraction de notre esprit, envisagé leurs propriétés générales & communes, & formé la Métaphysique & la Géométrie ; ce n’est qu’après un long usage des premiers signes, que nous avons perfectionné l’art de ces signes au point d’en faire une Science ; ce n’est enfin qu’après une longue suite d’opérations sur les objets de nos idées, que nous avons par la réflexion donné des regles à ces opérations même.
Enfin le système de nos connoissances est composé de différentes branches, dont plusieurs ont un même point de réunion ; & comme en partant de ce point il n’est pas possible de s’engager à la fois dans toutes les routes, c’est la nature des différens esprits qui détermine le choix. Aussi est-il assez rare qu’un même esprit en parcoure à la fois un grand nombre. Dans l’étude de la Nature les hommes se sont d’abord appliqués tous, comme de concert, à satisfaire les besoins les plus pressans ; mais quand ils en sont venus aux connoissances moins absolument nécessaires, ils ont dû se les partager, & y avancer chacun de son côté à-peu-près d’un pas égal. Ainsi plusieurs Sciences ont été, pour ainsi dire, contemporaines ; mais dans l’ordre historique des progrès de l’esprit, on ne peut les embrasser que successivement.
Il n’en est pas de même de l’ordre encyclopédique de nos connoissances. Ce dernier consiste à les rassembler dans le plus petit espace possible, & à placer, pour ainsi dire, le Philosophe au-dessus de ce vaste labyrinthe dans un point de vûe fort élevé d’où il puisse appercevoir à la fois les Sciences & les Arts principaux ; voir d’un coup d’œil les objets de ses spéculations, & les opérations qu’il peut faire sur ces objets ; distinguer les branches générales des connoissances humaines, les points qui les séparent ou qui les unissent ; & entrevoir même quelquefois les routes secretes qui les rapprochent. C’est une espece de Mappemonde qui doit montrer les principaux pays, leur position & leur dépendance mutuelle, le chemin en ligne droite qu’il y a de l’un à l’autre ; chemin souvent coupé par mille obstacles, qui ne peuvent être connus dans chaque pays que des habitans ou des voyageurs, & qui ne sauroient être montrés que dans des cartes particulieres fort détaillées. Ces cartes particulieres seront les différens articles de notre Encyclopédie, & l’arbre ou système figuré en sera la mappemonde.
Mais comme dans les cartes générales du globe que nous habitons, les objets sont plus ou moins rapprochés, & présentent un coup d’œil différent selon le point de vûe où l’œil est placé par le Géographe qui construit la carte, de même la forme de l’arbre encyclopédique dépendra du point de vûe où l’on se mettra pour envisager l’univers littéraire. On peut donc imaginer autant de systèmes différens de la connoissance humaine, que de Mappemondes de différentes projections ; & chacun de ces systèmes pourra même avoir, à l’exclusion des autres, quelque avantage particulier. Il n’est guere de Savans qui ne placent volontiers au centre de toutes les Sciences celle dont ils s’occupent, à peu-près comme les premiers hommes se plaçoient au centre du monde, persuadés que l’Univers étoit fait pour eux. La prétention de plusieurs de ces Savans, envisagée d’un œil philosophique, trouveroit peut-être, même hors de l’amour propre, d’assez bonnes raisons pour se justifier.
Quoi qu’il en soit, celui de tous les arbres encyclopédiques qui offriroit le plus grand nombre de liaisons & de rapports entre les Sciences, mériteroit sans doute d’être préféré. Mais peut-on se flatter de le saisir ? La Nature, nous ne saurions trop le répéter, n’est composée que d’individus qui sont l’objet primitif de nos sensations & de nos perceptions directes. Nous remarquons à la vérité dans ces individus, des propriétés communes par lesquelles nous les comparons, & des propriétés dissemblables par lesquelles nous les discernons ; & ces propriétés désignées par des noms abstraits, nous ont conduit à former différentes classes où ces objets ont été placés. Mais souvent tel objet qui par une ou plusieurs de ses propriétés a été placé dans une classe, tient à une autre classe par d’autres propriétés, & auroit pû tout aussi-bien y avoir sa place. Il reste donc nécessairement de l’arbitraire dans la division générale. L’arrangement le plus naturel seroit celui où les objets se succéderoient par les nuances insensibles qui servent tout à la fois à les séparer & à les unir. Mais le petit nombre d’êtres qui nous sont connus, ne nous permet pas de marquer ces nuances. L’Univers n’est qu’un vaste Océan, sur la surface duquel nous appercevons quelques îles plus ou moins grandes, dont la liaison avec le continent nous est cachée.
On pourroit former l’arbre de nos connoissances en les divisant, soit en naturelles & en révélées, soit en utiles & agréables, soit en spéculatives & pratiques, soit en évidentes ; certaines, probables & sensibles, soit en connoissances des choses & connoissances des signes, & ainsi à l’infini. Nous avons choisi une division qui nous a paru satisfaire tout à la fois le plus qu’il est possible à l’ordre encyclopédique de nos connoissances & à leur ordre généalogique. Nous devons cette division à un Auteur célebre dont nous parlerons dans la suite de cette Préface : nous avons pourtant cru y devoir faire quelques changemens, dont nous rendrons compte ; mais nous sommes trop convaincus de l’arbitraire qui regnera toûjours dans une pareille division, pour croire que notre système soit l’unique ou le meilleur ; il nous suffira que notre travail ne soit pas entierement desapprouvé par les bons esprits. Nous ne voulons point ressembler à cette foule de Naturalistes qu’un Philosophe moderne a eu tant de raison de censurer ; & qui occupés sans cesse à diviser les productions de la Nature en genres & en especes, ont consumé dans ce travail un tems qu’ils auroient beaucoup mieux employé à l’étude de ces productions même. Que diroit-on d’un Architecte qui ayant à élever un édifice immense, passeroit toute sa vie à en tracer le plan ; ou d’un Curieux qui se proposant de parcourir un vaste palais, employeroit tout son tems à en observer l’entrée ?
Les objets dont notre ame s’occupe, sont ou spirituels ou matériels, & notre ame s’occupe de ces objets ou par des idées directes ou par des idées réfléchies. Le système des connoissances directes ne peut consister que dans la collection purement passive & comme machinale de ces mêmes connoissances ; c’est ce qu’on appelle mémoire. La réflexion est de deux sortes, nous l’avons déjà observé ; ou elle raisonne sur les objets des idées directes, ou elle les imite. Ainsi la mémoire, la raison proprement dite, & l’imagination, sont les trois manieres différentes dont notre ame opere sur les objets de ses pensées. Nous ne prenons point ici l’imagination pour la faculté qu’on a de se représenter les objets ; parce que cette faculté n’est autre chose que la mémoire même des objets sensibles, mémoire qui seroit dans un continuel exercice, si elle n’étoit soulagée par l’invention des signes. Nous prenons l’imagination dans un sens plus noble & plus précis, pour le talent de créer en imitant.
Ces trois facultés forment d’abord les trois divisions générales de notre système, & les trois objets généraux des connoissances humaines ; l’Histoire, qui se rapporte à la mémoire ; la Philosophie, qui est le fruit de la raison ; & les Beaux-arts, que l’imagination fait naître. Si nous plaçons la raison avant l’imagination, cet ordre nous paroît bien fondé, & conforme au progrès naturel des opérations de l’esprit : l’imagination est une faculté créatrice, & l’esprit, avant de songer à créer, commence par raisonner sur ce qu’il voit, & ce qu’il connoît. Un autre motif qui doit déterminer à placer la raison avant l’imagination, c’est que dans cette derniere faculté de l’ame, les deux autres se trouvent réunies jusqu’à un certain point, & que la raison s’y joint à la mémoire. L’esprit ne crée & n’imagine des objets qu’en tant qu’ils sont semblables à ceux qu’il a connus par des idées directes & par des sensations ; plus il s’éloigne de ces objets, plus les êtres qu’il forme sont bisarres & peu agréables. Ainsi dans l’imitation de la Nature, l’invention même est assujettie à certaines regles ; & ce sont ces regles qui forment principalement la partie philosophique des Beaux-arts, jusqu’à présent assez imparfaite, parce qu’elle ne peut être l’ouvrage que du génie, & que le génie aime mieux créer que discuter.
Enfin, si on examine les progrès de la raison dans ses opérations successives, on se convaincra encore qu’elle doit précéder l’imagination dans l’ordre de nos facultés, puisque la raison, par les dernieres opérations qu’elle fait sur les objets, conduit en quelque sorte à l’imagination : car ces opérations ne consistent qu’à créer, pour ainsi dire, des êtres généraux, qui séparés de leur sujet par abstraction, ne sont plus du ressort immédiat de nos sens. Aussi la Métaphysique & la Géométrie sont de toutes les Sciences qui appartiennent à la raison, celles où l’imagination a le plus de part. J’en demande pardon à nos beaux esprits détracteurs de la Géométrie ; ils ne se croyoient pas sans doute si près d’elle, & il n’y a peut-être que la Métaphysique qui les en sépare. L’imagination dans un Géometre qui crée, n’agit pas moins que dans un Poëte qui invente. Il est vrai qu’ils operent différemment sur leur objet ; le premier le dépouille & l’analyse, le second le compose & l’embellit. Il est encore vrai que cette maniere différente d’opérer n’appartient qu’à différentes sortes d’esprits ; & c’est pour cela que les talens du grand Géometre & du grand Poëte ne se trouveront peut-être jamais ensemble. Mais soit qu’ils s’excluent ou ne s’excluent pas l’un l’autre, ils ne sont nullement en droit de se mépriser réciproquement. De tous les grands hommes de l’antiquité, Archimede est peut-être celui qui mérite le plus d’être placé à côté d’Homere. J’espere qu’on pardonnera cette digression à un Géometre qui aime son art, mais qu’on n’accusera point d’en être admirateur outré, & je reviens à mon sujet.
La distribution générale des êtres en spirituels & en matériels fournit la sous-division des trois branches générales. L’Histoire & la Philosophie s’occupent également de ces deux especes d’êtres, & l’imagination ne travaille que d’après les êtres purement matériels ; nouvelle raison pour la placer la derniere dans l’ordre de nos facultés. À la tête des êtres spirituels est Dieu, qui doit tenir le premier rang par sa nature, & par le besoin que nous avons de le connoître. Au-dessous de cet Être suprème sont les esprits créés, dont la révélation nous apprend l’existence. Ensuite vient l’homme, qui composé de deux principes, tient par son ame aux esprits, & par son corps au monde matériel ; & enfin ce vaste Univers que nous appellons le Monde corporel ou la Nature. Nous ignorons pourquoi l’Auteur célebre qui nous sert de guide dans cette distribution, a placé la nature avant l’homme dans son système ; il semble au contraire que tout engage à placer l’homme sur le passage qui sépare Dieu & les esprits d’avec les corps.
L’Histoire entant qu’elle se rapporte à Dieu, renferme ou la révélation ou la tradition, & se divise sous ces deux points de vûe, en histoire sacrée & en histoire ecclésiastique. L’histoire de l’homme a pour objet, ou ses actions, ou ses connoissances ; & elle est par conséquent civile ou littéraire, c’est-à-dire, se partage entre les grandes nations & les grands génies, entre les Rois & les Gens de Lettres, entre les Conquérans & les Philosophes. Enfin l’histoire de la Nature est celle des productions innombrables qu’on y observe, & forme une quantité de branches presque égale au nombre de ces diverses productions. Parmi ces différentes branches, doit être placée avec distinction l’histoire des Arts, qui n’est autre chose que l’histoire des usages que les hommes ont faits des productions de la nature, pour satisfaire à leurs besoins ou à leur curiosité.
Tels sont les objets principaux de la mémoire. Venons présentement à la faculté qui refléchit, & qui raisonne. Les êtres tant spirituels que matériels sur lesquels elle s’exerce, ayant quelques propriétés générales, comme l’existence, la possibilité, la durée ; l’examen de ces propriétés forme d’abord cette branche de la Philosophie, dont toutes les autres empruntent en partie leurs principes : on la nomme l’Ontologie ou Science de l’Etre, ou Métaphysique générale. Nous descendons de-là aux différens êtres particuliers ; & les divisions que fournit la Science de ces différens êtres, sont formées sur le même plan que celles de l’Histoire.
La Science de Dieu appellée Théologie a deux branches ; la Théologie naturelle n’a de connoissance de Dieu que celle que produit la raison seule ; connoissance qui n’est pas d’une fort grande étendue : la Théologie révélée tire de l’histoire sacrée une connoissance beaucoup plus parfaite de cet être. De cette même Théologie révélée, résulte la Science des esprits créés. Nous avons crû encore ici devoir nous écarter de notre Auteur. Il nous semble que la Science, considérée comme appartenante à la raison, ne doit point être divisée comme elle l’a été par lui en Théologie & en Philosophie ; car la Théologie révélée n’est autre chose, que la raison appliquée aux faits révélés : on peut dire qu’elle tient à l’histoire par les dogmes qu’elle enseigne, & à la Philosophie, par les conséquences qu’elle tire de ces dogmes. Ainsi séparer la Théologie de la Philosophie, ce seroit arracher du tronc un rejetton qui de lui-même y est uni. Il semble aussi que la Science des esprits appartient bien plus intimement à la Théologie révélée, qu’à la Théologie naturelle.
La premiere partie de la Science de l’homme est celle de l’ame ; & cette Science a pour but, ou la connoissance spéculative de l’ame humaine, ou celle de ses opérations. La connoissance spéculative de l’ame dérive en partie de la Théologie naturelle, & en partie de la Théologie révélée, & s’appelle Pneumatologie ou Métaphysique particuliere. La connoissance de ses opérations se subdivise en deux branches, ces opérations pouvant avoir pour objet, ou la découverte de la vérité, ou la pratique de la vertu. La découverte de la vérité, qui est le but de la Logique, produit l’art de la transmettre aux autres ; ainsi l’usage que nous faisons de la Logique est en partie pour notre propre avantage, en partie pour celui des êtres semblables à nous ; les regles de la Morale se rapportent moins à l’homme isolé, & le supposent nécessairement en société avec les autres hommes.
La Science de la nature n’est autre que celle des corps. Mais les corps ayant des propriétés générales qui leur sont communes, telles que l’impénétrabilité, la mobilité, & l’étendue, c’est encore par l’étude de ces propriétés, que la Science de la nature doit commencer : elles ont, pour ainsi dire, un côté purement intellectuel par lequel elles ouvrent un champ immense aux spéculations de l’esprit, & un côté matériel & sensible par lequel on peut les mesurer. La spéculation intellectuelle appartient à la Physique générale, qui n’est proprement que la Métaphysique des corps ; & la mesure est l’objet des Mathématiques, dont les divisions s’étendent presqu’à l’infini.
Ces deux Sciences conduisent à la Physique particuliere, qui étudie les corps en eux-mêmes, & qui n’a que les individus pour objet. Parmi les corps dont il nous importe de connoître les propriétés, le nôtre doit tenir le premier rang, & il est immédiatement suivi de ceux dont la connoissance est le plus nécessaire à notre conservation ; d’où résultent l’Anatomie, l’Agriculture, la Médecine, & leurs différentes branches. Enfin tous les corps naturels soûmis à notre examen produisent les autres parties innombrables de la Physique raisonnée.
La Peinture, la Sculpture, l’Architecture, la Poësie, la Musique, & leurs différentes divisions, composent la troisieme distribution générale, qui naît de l’imagination, & dont les parties sont comprises sous le nom de Beaux-Arts. On pourroit aussi les renfermer sous le titre général de Peinture, puisque tous les Beaux-Arts se réduisent à peindre, & ne different que par les moyens qu’ils employent ; enfin on pourroit les rapporter tous à la Poësie, en prenant ce mot dans sa signification naturelle, qui n’est autre chose qu’invention ou création.
Telles sont les principales parties de notre Arbre encyclopédique ; on les trouvera plus en détail à la fin de ce Discours préliminaire. Nous en avons formé une espece de Carte à laquelle nous avons joint une explication beaucoup plus étendue que celle qui vient d’être donnée. Cette Carte & cette explication ont été déja publiées dans le Prospectus, comme pour pressentir le goût du public ; nous y avons fait quelques changemens dont il sera facile de s’appercevoir, & qui sont le fruit ou de nos réflexions ou des conseils de quelques Philosophes, assez bons citoyens pour prendre intérêt à notre Ouvrage. Si le Public éclairé donne son approbation à ces changemens, elle sera la récompense de notre docilité ; & s’il ne les approuve pas, nous n’en serons que plus convaincus de l’impossibilité de former un Arbre encyclopédique qui soit au gré de tout le monde.
La division générale de nos connoissances, suivant nos trois facultés, a cet avantage, qu’elle pourroit fournir aussi les trois divisions du monde littéraire, en Érudits, Philosophes, & Beaux-Esprits ; ensorte qu’après avoir formé l’Arbre des Sciences, on pourroit former sur le même plan celui des Gens de Lettres. La mémoire est le talent des premiers, la sagacité appartient aux seconds, & les derniers ont l’agrément en partage. Ainsi, en regardant la mémoire comme un commencement de réflexion, & en y joignant la réflexion qui combine, & celle qui imite, on pourroit dire en général que le nombre plus ou moins grand d’idées refléchies, & la nature de ces idées, constituent la différence plus ou moins grande qu’il y a entre les hommes ; que la réflexion, prise dans le sens le plus étendu qu’on puisse lui donner, forme le caractere de l’esprit, & qu’elle en distingue les différens genres. Du reste les trois especes de républiques dans lesquelles nous venons de distribuer les Gens de Lettres, n’ont pour l’ordinaire rien de commun, que de faire assez peu de cas les unes des autres. Le Poëte & le Philosophe se traitent mutuellement d’insensés, qui se repaissent de chimeres : l’un & l’autre regardent l’Érudit comme une espece d’avare, qui ne pense qu’à amasser sans jouir, & qui entasse sans choix les métaux les plus vils avec les plus précieux ; & l’Érudit, qui ne voit que des mots par-tout où il ne lit point des faits, méprise le Poëte & le Philosophe, comme des gens qui se croyent riches, parce que leur dépense excede leurs fonds.
C’est ainsi qu’on se venge des avantages qu’on n’a pas. Les Gens de Lettres entendroient mieux leurs intérêts, si au lieu de chercher à s’isoler, ils reconnoissoient le besoin réciproque qu’ils ont de leurs travaux, & les secours qu’ils en tirent. La société doit sans doute aux Beaux-Esprits ses principaux agrémens, & ses lumieres aux Philosophes : mais ni les uns, ni les autres ne sentent combien ils sont redevables à la mémoire ; elle renferme la matiere premiere de toutes nos connoissances ; & les travaux de l’Érudit ont souvent fourni au Philosophe & au Poëte les sujets sur lesquels ils s’exercent. Lorsque les Anciens ont appellé les Muses filles de Mémoire, a dit un Auteur moderne, ils sentoient peut-être combien cette faculté de notre ame est nécessaire à toutes les autres ; & les Romains lui élevoient des temples, comme à la Fortune.
Il nous reste à montrer comment nous avons tâché de concilier dans ce Dictionnaire l’ordre encyclopédique avec l’ordre alphabétique. Nous avons employé pour cela trois moyens, le Système figuré qui est à la tête de l’Ouvrage, la Science à laquelle chaque article se rapporte, & la maniere dont l’article est traité. On a placé pour l’ordinaire après le mot qui fait le sujet de l’article, le nom de la Science dont cet article fait partie ; il ne faut plus que voir dans le Système figuré quel rang cette Science y occupe, pour connoître la place que l’article doit avoir dans l’Encyclopédie. S’il arrive que le nom de la Science soit omis dans l’article, la lecture suffira pour connoître à quelle Science il se rapporte ; & quand nous aurions, par exemple, oublié d’avertir que le mot Bombe appartient à l’art militaire, & le nom d’une ville ou d’un pays à la Géographie, nous comptons assez sur l’intelligence de nos lecteurs, pour espérer qu’ils ne seroient pas choqués d’une pareille omission. D’ailleurs par la disposition des matieres dans chaque article, sur-tout lorsqu’il est un peu étendu, on ne pourra manquer de voir que cet article tient à un autre qui dépend d’une Science différente, celui-là à un troisiéme, & ainsi de suite. On a tâché que l’exactitude & la fréquence des renvois ne laissât là-dessus rien à desirer ; car les renvois dans ce Dictionnaire ont cela de particulier, qu’ils servent principalement à indiquer la liaison des matieres ; au lieu que dans les autres ouvrages de cette espece, ils ne sont destinés qu’à expliquer un article par un autre. Souvent même nous avons omis le renvoi, parce que les termes d’Art ou de Science sur lesquels il auroit pû tomber, se trouvent expliqués à leur article, que le lecteur ira chercher de lui-même. C’est sur-tout dans les articles généraux des Sciences, qu’on a tâché d’expliquer les secours mutuels qu’elles se prêtent. Ainsi trois choses forment l’ordre encyclopédique ; le nom de la Science à laquelle l’article appartient ; le rang de cette Science dans l’Arbre ; la liaison de l’article avec d’autres dans la même Science ou dans une Science différente ; liaison indiquée par les renvois, ou facile à sentir au moyen des termes techniques expliqués suivant leur ordre alphabétique. Il ne s’agit point ici des raisons qui nous ont fait préférer dans cet Ouvrage l’ordre alphabétique à tout autre ; nous les exposerons plus bas, lorsque nous envisagerons cette collection, comme Dictionnaire des Sciences & des Arts.
Au reste, sur la partie de notre travail, qui consiste dans l’ordre encyclopédique, & qui est plus destinée aux gens éclairés qu’à la multitude, nous observerons deux choses : la premiere, c’est qu’il seroit souvent absurde de vouloir trouver une liaison immédiate entre un article de ce Dictionnaire & un autre article pris à volonté ; c’est ainsi qu’on chercheroit en vain par quels liens secrets Section conique peut être rapprochée d’Accusatif. L’ordre encyclopédique ne suppose point que toutes les Sciences tiennent directement les unes aux autres. Ce sont des branches qui partent d’un même tronc, sçavoir de l’entendement humain. Ces branches n’ont souvent entr’elles aucune liaison immédiate, & plusieurs ne sont réunies que par le tronc même. Ainsi Section conique appartient à la Géométrie, la Géométrie conduit à la Physique particuliere, celle-ci à la Physique générale, la Physique générale à la Métaphysique ; & la Métaphysique est bien près de la Grammaire à laquelle le mot Accusatif appartient. Mais quand on est arrivé à ce dernier terme par la route que nous venons d’indiquer, on se trouve si loin de celui d’où l’on est parti, qu’on l’a tout-à-fait perdu de vûe.
La seconde remarque que nous avons à faire, c’est qu’il ne faut pas attribuer à notre Arbre encyclopédique plus d’avantage que nous ne prétendons lui en donner. L’usage des divisions générales est de rassembler un fort grand nombre d’objets : mais il ne faut pas croire qu’il puisse suppléer à l’étude de ces objets mêmes. C’est une espece de dénombrement des connoissances qu’on peut acquérir ; dénombrement frivole pour qui voudroit s’en contenter, utile pour qui desire d’aller plus loin. Un seul article raisonné sur un objet particulier de Science ou d’Art, renferme plus de substance que toutes les divisions & subdivisions qu’on peut faire des termes généraux ; & pour ne point sortir de la comparaison que nous avons tirée plus haut des Cartes géographiques, celui qui s’en tiendroit à l’Arbre encyclopédique pour toute connoissance, n’en sauroit guere plus que celui qui pour avoir acquis par les Mappemondes une idée générale du globe & de ses parties principales, se flatteroit de connoître les différens Peuples qui l’habitent, & les États particuliers qui le composent. Ce qu’il ne faut point oublier sur-tout, en considérant notre Système figuré, c’est que l’ordre encyclopédique qu’il présente est très-différent de l’ordre généalogique des opérations de l’esprit ; que les Sciences qui s’occupent des êtres généraux, ne sont utiles qu’autant qu’elles menent à celles dont les êtres particuliers sont l’objet ; qu’il n’y a véritablement que ces êtres particuliers qui existent ; & que si notre esprit a créé les êtres généraux, ç’a été pour pouvoir étudier plus facilement l’une après l’autre les propriétés qui par leur nature existent à la fois dans une même substance, & qui ne peuvent physiquement être séparées. Ces réflexions doivent être le fruit & le résultat de tout ce que nous avons dit jusqu’ici ; & c’est aussi par elles que nous terminerons la premiere Partie de ce Discours.
Nous allons présentement considérer cet Ouvrage comme Dictionnaire raisonné des Sciences & des Arts. L’objet est d’autant plus important, que c’est sans doute celui qui peut intéresser davantage la plus grande partie de nos lecteurs, & qui, pour être rempli, a demandé le plus de soins & de travail. Mais avant que d’entrer sur ce sujet dans tout le détail qu’on est en droit d’exiger de nous, il ne sera pas inutile d’examiner avec quelque étendue l’état présent des Sciences & des Arts, & de montrer par quelle gradation l’on y est arrivé. L’exposition métaphysique de l’origine & de la liaison des Sciences nous a été d’une grande utilité pour en former l’Arbre encyclopédique ; l’exposition historique de l’ordre dans lequel nos connoissances se sont succédées, ne sera pas moins avantageuse pour nous éclairer nous-mêmes sur la maniere dont nous devons transmettre ces connoissances à nos lecteurs. D’ailleurs l’histoire des Sciences est naturellement liée à celle du petit nombre de grands génies, dont les Ouvrages ont contribué à répandre la lumiere parmi les hommes ; & ces Ouvrages ayant fourni pour le nôtre les secours généraux, nous devons commencer à en parler avant de rendre compte des secours particuliers que nous avons obtenus. Pour ne point remonter trop haut, fixons-nous à la renaissance des Lettres.
Quand on considere les progrès de l’esprit depuis cette époque mémorable, on trouve que ces progrès se sont faits dans l’ordre qu’ils devoient naturellement suivre. On a commencé par l’Érudition, continué par les Belles-Lettres, & fini par la Philosophie. Cet Ordre differe à la vérité de celui que doit observer l’homme abandonné à ses propres lumieres, ou borné au commerce de ses contemporains, tel que nous l’avons principalement considéré dans la premiere Partie de ce Discours : en effet, nous avons fait voir que l’esprit isolé doit rencontrer dans sa route la Philosophie avant les Belles-Lettres. Mais en sortant d’un long intervalle d’ignorance que des siecles de lumiere avoient précédé, la régénération des idées, si on peut parler ainsi, a dû nécessairement être différente de leur génération primitive. Nous allons tâcher de le faire sentir.
Les chefs-d’œuvre que les Anciens nous avoient laissés dans presque tous les genres, avoient été oubliés pendant douze siecles. Les principes des Sciences & des Arts étoient perdus, parce que le beau & le vrai qui semblent se montrer de toutes parts aux hommes, ne les frappent guere à moins qu’ils n’en soient avertis. Ce n’est pas que ces tems malheureux ayent été plus stériles que d’autres en génies rares ; la nature est toûjours la même : mais que pouvoient faire ces grands hommes, semés de loin à loin comme ils le sont toûjours, occupés d’objets différens, & abandonnés sans culture à leurs seules lumieres ? Les idées qu’on acquiert par la lecture & la société, sont le germe de presque toutes les découvertes. C’est un air que l’on respire sans y penser, & auquel on doit la vie ; & les hommes dont nous parlons étoient privés d’un tel secours. Ils ressembloient aux premiers créateurs des Sciences & des Arts, que leurs illustres successeurs ont fait oublier, & qui précédés par ceux-ci les auroient fait oublier de même. Celui qui trouva le premier les roues & les pignons, eût inventé les montres dans un autre siecle ; & Gerbert placé au tems d’Archimede l’auroit peut-être égalé.
Cependant la plûpart des beaux Esprits de ces tems ténébreux se faisoient appeller Poëtes ou Philosophes. Que leur en coûtoit-il en effet pour usurper deux titres dont on se pare à si peu de frais, & qu’on se flate toûjours de ne guere devoir à des lumieres empruntées ? Ils croyoient qu’il étoit inutile de chercher les modeles de la Poësie dans les Ouvrages des Grecs & des Romains, dont la Langue ne se parloit plus ; & ils prenoient pour la véritable Philosophie des Anciens une tradition barbare qui la défiguroit. La Poësie se réduisoit pour eux à un méchanisme puéril : l’examen approfondi de la nature, & la grande Étude de l’homme, étoient remplacés par mille questions frivoles sur des êtres abstraits & métaphysiques ; questions dont la solution, bonne ou mauvaise, demandoit souvent beaucoup de subtilité, & par conséquent un grand abus de l’esprit. Qu’on joigne à ce desordre l’état d’esclavage où presque toute l’Europe étoit plongée, les ravages de la superstition qui naît de l’ignorance, & qui la reproduit à son tour : & l’on verra que rien ne manquoit aux obstacles qui éloignoient le retour de la raison & du goût ; car il n’y a que la liberté d’agir & de penser qui soit capable de produire de grandes choses, & elle n’a besoin que de lumieres pour se préserver des excès.
Aussi fallut-il au genre humain, pour sortir de la barbarie, une de ces révolutions qui font prendre à la terre une face nouvelle : l’Empire Grec est détruit, sa ruine fait refluer en Europe le peu de connoissances qui restoient encore au monde ; l’invention de l’Imprimerie, la protection des Medicis & de François I. raniment les esprits ; & la lumiere renaît de toutes parts.
L’étude des Langues & de l’Histoire abandonnée par nécessité durant les siecles d’ignorance, fut la premiere à laquelle on se livra. L’esprit humain se trouvoit au sortir de la barbarie dans une espece d’enfance, avide d’accumuler des idées, & incapable pourtant d’en acquérir d’abord d’un certain ordre par l’espece d’engourdissement où les facultés de l’ame avoient été si long-tems. De toutes ces facultés, la mémoire fut celle que l’on cultiva d’abord, parce qu’elle est la plus facile à satisfaire, & que les connoissances qu’on obtient par son secours, sont celles qui peuvent le plus aisément être entassées. On ne commença donc point par étudier la Nature, ainsi que les premiers hommes avoient dû faire ; on joüissoit d’un secours dont ils étoient dépourvûs, celui des Ouvrages des Anciens que la générosité des Grands & l’Impression commençoient à rendre communs : on croyoit n’avoir qu’à lire pour devenir savant ; & il est bien plus aisé de lire que de voir. Ainsi, on dévora sans distinction tout ce que les Anciens nous avoient laissé dans chaque genre : on les traduisit, on les commenta ; & par une espece de reconnoissance on se mit à les adorer sans connoître à beaucoup près ce qu’ils valoient.
De-là cette foule d’Érudits, profonds dans les Langues savantes jusqu’à dédaigner la leur, qui, comme l’a dit un Auteur célebre, connoissoient tout dans les Anciens, hors la grace & la finesse, & qu’un vain étalage d’érudition rendoit si orgueilleux, parce que les avantages qui coûtent le moins sont assez souvent ceux dont on aime le plus à se parer. C’étoit une espece de grands Seigneurs, qui sans ressembler par le mérite réel à ceux dont ils tenoient la vie, tiroient beaucoup de vanité de croire leur appartenir. D’ailleurs cette vanité n’étoit point sans quelque espece de prétexte. Le pays de l’érudition & des faits est inépuisable ; on croit, pour ainsi dire, voir tous les jours augmenter sa substance par les acquisitions que l’on y fait sans peine. Au contraire le pays de la raison & des découvertes est d’une assez petite étendue ; & souvent au lieu d’y apprendre ce que l’on ignoroit, on ne parvient à force d’étude qu’à désapprendre ce qu’on croyoit savoir. C’est pourquoi, à mérite fort inégal, un Érudit doit être beaucoup plus vain qu’un Philosophe, & peut-être qu’un Poëte : car l’esprit qui invente est toûjours mécontent de ses progrès, parce qu’il voit au-delà ; & les plus grands génies trouvent souvent dans leur amour propre même un juge secret, mais sévere, que l’approbation des autres fait taire pour quelques instans, mais qu’elle ne parvient jamais à corrompre. On ne doit donc pas s’étonner que les Savans dont nous parlons missent tant de gloire à joüir d’une Science hérissée, souvent ridicule, & quelquefois barbare.
Il est vrai que notre siecle qui se croit destiné à changer les lois en tout genre, & à faire justice, ne pense pas fort avantageusement de ces hommes autrefois si célebres. C’est une espece de mérite aujourd’hui que d’en faire peu de cas ; & c’est même un mérite que bien des gens se contentent d’avoir. Il semble que par le mépris que l’on a pour ces Savans, on cherche à les punir de l’estime outrée qu’ils faisoient d’eux-mêmes, ou du suffrage peu éclairé de leurs contemporains, & qu’en foulant aux piés ces idoles, on veuille en faire oublier jusqu’aux noms. Mais tout excès est injuste. Joüissons plûtôt avec reconnoissance du travail de ces hommes laborieux. Pour nous mettre à portée d’extraire des Ouvrages des Anciens tout ce qui pouvoit nous être utile, il a fallu qu’ils en tirassent aussi ce qui ne l’étoit pas : on ne sauroit tirer l’or d’une mine sans en faire sortir en même tems beaucoup de matieres viles ou moins précieuses ; ils auroient fait comme nous la séparation, s’ils étoient venus plus tard. L’Érudition étoit donc nécessaire pour nous conduire aux Belles-Lettres.
En effet, il ne fallut pas se livrer long-tems à la lecture des Anciens, pour se convaincre que dans ces Ouvrages même où l’on ne cherchoit que des faits & des mots, il y avoit mieux à apprendre. On apperçut bientôt les beautés que leurs Auteurs y avoient répandues ; car si les hommes, comme nous l’avons dit plus haut, ont besoin d’être avertis du vrai, en récompense ils n’ont besoin que de l’être. L’admiration qu’on avoit eu jusqu’alors pour les Anciens ne pouvoit être plus vive : mais elle commença à devenir plus juste. Cependant elle étoit encore bien loin d’être raisonnable. On crut qu’on ne pouvoit les imiter, qu’en les copiant servilement, & qu’il n’étoit possible de bien dire que dans leur Langue. On ne pensoit pas que l’étude des mots est une espece d’inconvénient passager, nécessaire pour faciliter l’étude des choses, mais qu’elle devient un mal réel, quand elle la retarde ; qu’ainsi on auroit dû se borner à se rendre familiers les Auteurs Grecs & Romains, pour profiter de ce qu’ils avoient pensé de meilleur ; & que le travail auquel il falloit se livrer pour écrire dans leur Langue, étoit autant de perdu pour l’avancement de la raison. On ne voyoit pas d’ailleurs, que s’il y a dans les Anciens un grand nombre de beautés de style perdues pour nous, il doit y avoir aussi par la même raison bien des défauts qui échappent, & que l’on court risque de copier comme des beautés, qu’enfin tout ce qu’on pourroit espérer par l’usage servile de la Langue des Anciens, ce seroit de se faire un style bisarrement assorti d’une infinité de styles différens, très-correct & admirable même pour nos Modernes, mais que Cicéron ou Virgile auroient trouvé ridicule. C’est ainsi que nous ririons d’un Ouvrage écrit en notre Langue, & dans lequel l’Auteur auroit rassemblé des phrases de Bossuet, de la Fontaine, de la Bruyere, & de Racine, persuadé avec raison que chacun de ces Ecrivains en particulier est un excellent modele.
Ce préjugé des premiers Savans a produit dans le seizieme siecle une foule de Poëtes, d’Orateurs, & d’Historiens Latins, dont les Ouvrages, il faut l’avoüer, tirent trop souvent leur principal mérite d’une latinité dont nous ne pouvons guere juger. On peut en comparer quelques-uns aux harangues de la plûpart de nos Rhéteurs, qui vuides de choses, & semblables à des corps sans substance, n’auroient besoin que d’être mises en François pour n’être lûes de personne.
Les Gens de Lettres sont enfin revenus peu-à-peu de cette espece de manie. Il y a apparence qu’on doit leur changement, du moins en partie, à la protection des Grands, qui sont bien-aises d’être savans, à condition de le devenir sans peine, & qui veulent pouvoir juger sans étude d’un Ouvrage d’esprit, pour prix des bienfaits qu’ils promettent à l’Auteur, ou de l’amitié dont ils croyent l’honorer. On commença à sentir que le beau, pour être en Langue vulgaire, ne perdoit rien de ses avantages ; qu’il acquéroit même celui d’être plus facilement saisi du commun des hommes, & qu’il n’y avoit aucun mérite à dire des choses communes ou ridicules dans quelque Langue que ce fût, & à plus forte raison dans celles qu’on devoit parler le plus mal. Les Gens de Lettres penserent donc à perfectionner les Langues vulgaires ; ils chercherent d’abord à dire dans ces Langues ce que les Anciens avoient dit dans les leurs. Cependant par une suite du préjugé dont on avoit eu tant de peine à se défaire, au lieu d’enrichir la Langue Françoise, on commença par la défigurer. Ronsard en fit un jargon barbare, hérissé de Grec & de Latin : mais heureusement il la rendit assez méconnoissable, pour qu’elle en devînt ridicule. Bientôt l’on sentit qu’il falloit transporter dans notre Langue les beautés & non les mots des Langues anciennes. Réglée & perfectionnée par le goût, elle acquit assez promptement une infinité de tours & d’expressions heureuses. Enfin on ne se borna plus à copier les Romains & les Grecs, ou même à les imiter ; on tâcha de les surpasser, s’il étoit possible, & de penser d’après soi. Ainsi l’imagination des Modernes renaquit peu-à-peu de celle des Anciens ; & l’on vit éclorre presqu’en même tems tous les chefs-d’œuvre du dernier siecle, en Eloquence, en Histoire, en Poësie, & dans les différens genres de littérature.
Malherbe, nourri de la lecture des excellens Poëtes de l’antiquité, & prenant comme eux la Nature pour modele, répandit le premier dans notre Poësie une harmonie & des beautés auparavant inconnues. Balzac, aujourd’hui trop méprisé, donna à notre Prose de la noblesse & du nombre. Les Ecrivains de Port-royal continuerent ce que Balzac avoit commencé ; ils y ajoûterent cette précision, cet heureux choix de termes, & cette pureté qui ont conservé jusqu’à présent à la plûpart de leurs Ouvrages un air moderne, & qui les distinguent d’un grand nombre de Livres surannés, écrits dans le même tems. Corneille, après avoir sacrifié pendant quelques années au mauvais goût dans la carriere dramatique, s’en affranchit enfin ; découvrit par la force de son génie, bien plus que par la lecture, les lois du Théatre, & les exposa dans ses Discours admirables sur la Tragédie, dans ses réflexions sur chacune de ses pieces, mais principalement dans ses pieces mêmes. Racine s’ouvrant une autre route, fit paroître sur le Théatre une passion que les Anciens n’y avoient guere connue ; & développant les ressorts du cœur humain, joignit à une élégance & une vérité continues quelques traits de sublime. Despréaux dans son art poëtique se rendit l’égal d’Horace en l’imitant ; Moliere par la peinture fine des ridicules & des mœurs de son tems, laissa bien loin derriere lui la Comédie ancienne ; La Fontaine fit presque oublier Esope & Phedre, & Bossuet alla se placer à côté de Démosthene.
Les Beaux-Arts sont tellement unis avec les Belles-Lettres, que le même goût qui cultive les unes, porte aussi à perfectionner les autres. Dans le même tems que notre littérature s’enrichissoit par tant de beaux Ouvrages, Poussin faisoit ses tableaux, & Puget ses statues, Le Sueur peignoit le cloitre des Chartreux, & Le Brun les batailles d’Alexandre ; enfin Lulli, créateur d’un chant propre à notre Langue, rendoit par sa musique aux poëmes de Quinault l’immortalité qu’elle en recevoit.
Il faut avoüer pourtant que la renaissance de la Peinture & de la Sculpture avoit été beaucoup plus rapide que celle de la Poësie & de la Musique ; & la raison n’en est pas difficile à appercevoir. Dès qu’on commença à étudier les Ouvrages des Anciens en tout genre, les chefs-d’œuvre antiques qui avoient échappé en assez grand nombre à la superstition & à la barbarie, frapperent bientòt les yeux des Artistes éclairés ; on ne pouvoit imiter les Praxiteles & les Phidias, qu’en faisant exactement comme eux ; & le talent n’avoit besoin que de bien voir : aussi Raphael & Michel Ange ne furent pas long-tems sans porter leur art à un point de perfection, qu’on n’a point encore passé depuis. En général, l’objet de la Peinture & de la Sculpture étant plus du ressort des sens, ces Arts ne pouvoient manquer de précéder la Poësie, parce que les sens ont dû être plus promptement affectés des beautés sensibles & palpables des statues anciennes, que l’imagination n’a dû appercevoir les beautés intellectuelles & fugitives des anciens Ecrivains. D’ailleurs, quand elle a commencé à les découvrir, l’imitation de ces mêmes beautés imparfaite par sa servitude, & par la Langue étrangere dont elle se servoit, n’a pû manquer de nuire aux progrès de l’imagination même. Qu’on suppose pour un moment nos Peintres & nos Sculpteurs privés de l’avantage qu’ils avoient de mettre en œuvre la même matiere que les Anciens : s’ils eussent, comme nos Littérateurs, perdu beaucoup de tems à rechercher & à imiter mal cette matiere, au lieu de songer à en employer une autre, pour imiter les ouvrages même qui faisoient l’objet de leur admiration ; ils auroient fait sans doute un chemin beaucoup moins rapide, & en seroient encore à trouver le marbre.
À l’égard de la Musique, elle a dû arriver beaucoup plus tard à un certain degré de perfection, parce que c’est un art que les Modernes ont été obligés de créer. Le tems a détruit tous les modeles que les Anciens avoient pû nous laisser en ce genre ; & leurs Ecrivains, du moins ceux qui nous restent, ne nous ont transmis sur ce sujet que des connoissances très-obscures, ou des histoires plus propres à nous étonner qu’à nous instruire. Aussi plusieurs de nos Savans, poussés peut-être par une espece d’amour de propriété, ont prétendu que nous avons porté cet art beaucoup plus loin que les Grecs ; prétention que le défaut de monumens rend aussi difficile à appuyer qu’à détruire, & qui ne peut être qu’assez foiblement combattue par les prodiges vrais ou supposés de la Musique ancienne. Peut-être seroit-il permis de conjecturer avec quelque vraissemblance, que cette Musique étoit tout-à-fait différente de la nôtre, & que si l’ancienne étoit supérieure par la mélodie, l’harmonie donne à la moderne des avantages.
Nous serions injustes, si à l’occasion du détail où nous venons d’entrer, nous ne reconnoissions point ce que nous devons à l’Italie ; c’est d’elle que nous avons reçû les Sciences, qui depuis ont fructifié si abondamment dans toute l’Europe ; c’est à elle surtout que nous devons les Beaux-Arts & le bon goût, dont elle nous a fourni un grand nombre de modeles inimitables.
Pendant que les Arts & les Belles-Lettres étoient en honneur, il s’en falloit beaucoup que la Philosophie fît le même progrès, du moins dans chaque nation prise en corps ; elle n’a reparu que beaucoup plus tard. Ce n’est pas qu’au fond il soit plus aisé d’exceller dans les Belles-Lettres que dans la Philosophie ; la supériorité en tout genre est également difficile à atteindre. Mais la lecture des Anciens devoit contribuer plus promptement à l’avancement des Belles-Lettres & du bon goût, qu’à celui des Sciences naturelles. Les beautés littéraires n’ont pas besoin d’être vûes long-tems pour être senties ; & comme les hommes sentent avant que de penser, ils doivent par la même raison juger ce qu’ils sentent avant de juger ce qu’ils pensent. D’ailleurs, les Anciens n’étoient pas à beaucoup près si parfaits comme Philosophes que comme Écrivains. En effet, quoique dans l’ordre de nos idées les premieres opérations de la raison précedent les premiers efforts de l’imagination, celle-ci, quand elle a fait les premiers pas, va beaucoup plus vîte que l’autre : elle a l’avantage de travailler sur des objets qu’elle enfante ; au lieu que la raison forcée de se borner à ceux qu’elle a devant elle, & de s’arrêter à chaque instant, ne s’épuise que trop souvent en recherches infructueuses. L’univers & les réflexions sont le premier livre des vrais Philosophes ; & les Anciens l’avoient sans doute étudié : il étoit donc nécessaire de faire comme eux ; on ne pouvoit suppléer à cette étude par celle de leurs Ouvrages, dont la plûpart avoient été détruits, & dont un petit nombre mutilé par le tems ne pouvoit nous donner sur une matiere aussi vaste que des notions fort incertaines & fort altérées.
La Scholastique qui composoit toute la Science prétendue des siecles d’ignorance, nuisoit encore aux progrès de la vraie Philosophie dans ce premier siecle de lumiere. On étoit persuadé depuis un tems, pour ainsi dire, immémorial, qu’on possédoit dans toute sa pureté la doctrine d’Aristote, commentée par les Arabes, & altérée par mille additions absurdes ou puériles ; & on ne pensoit pas même à s’assûrer si cette Philosophie barbare étoit réellement celle de ce grand homme, tant on avoit conçû de respect pour les Anciens. C’est ainsi qu’une foule de peuples nés & affermis dans leurs erreurs par l’éducation, se croyent d’autant plus sincerement dans le chemin de la vérité, qu’il ne leur est même jamais venu en pensée de former sur cela le moindre doute. Aussi, dans le tems que plusieurs Écrivains, rivaux des Orateurs & des Poëtes Grecs, marchoient à côté de leurs modeles, ou peut-être même les surpassoient ; la Philosophie Grecque, quoique fort imparfaite, n’étoit pas même bien connue.
Tant de préjugés qu’une admiration aveugle pour l’antiquité contribuoit à entretenir, sembloient se fortifier encore par l’abus qu’osoient faire de la soûmission des peuples quelques Théologiens peu nombreux, mais puissans : je dis peu nombreux, car je suis bien éloigné d’étendre à un Corps respectable & très-éclairé une accusation qui se borne à quelques-uns de ses membres. On avoit permis aux Poëtes de chanter dans leurs Ouvrages les divinités du Paganisme, parce qu’on étoit persuadé avec raison que les noms de ces divinités ne pouvoient plus être qu’un jeu dont on n’avoit rien à craindre. Si d’un côté, la religion des Anciens, qui animoit tout, ouvroit un vaste champ à l’imagination des beaux Esprits ; de l’autre, les principes en étoient trop absurdes, pour qu’on appréhendât de voir ressusciter Jupiter & Pluton par quelque secte de Novateurs. Mais l’on craignoit, ou l’on paroissoit craindre les coups qu’une raison aveugle pouvoit porter au Christianisme : comment ne voyoit-on pas qu’il n’avoit point à redouter une attaque aussi foible ? Envoyé du ciel aux hommes, la vénération si juste & si ancienne que les peuples lui témoignoient, avoit été garantie pour toûjours par les promesses de Dieu même. D’ailleurs, quelque absurde qu’une religion puisse être (reproche que l’impiété seule peut faire à la nôtre) ce ne sont jamais les Philosophes qui la détruisent : lors même qu’ils enseignent la vérité, ils se contentent de la montrer sans forcer personne à la reconnoître ; un tel pouvoir n’appartient qu’à l’Être tout-puissant : ce sont les hommes inspirés qui éclairent le peuple, & les enthousiastes qui l’égarent. Le frein qu’on est obligé de mettre à la licence de ces derniers ne doit point nuire à cette liberté si nécessaire à la vraie Philosophie, & dont la religion peut tirer les plus grands avantages. Si le Christianisme ajoûte à la Philosophie les lumieres qui lui manquent, s’il n’appartient qu’à la Grace de soûmettre les incrédules, c’est à la Philosophie qu’il est réservé de les réduire au silence ; & pour assûrer le triomphe de la Foi, les Théologiens dont nous parlons n’avoient qu’à faire usage des armes qu’on auroit voulu employer contre elle.
Mais parmi ces mêmes hommes, quelques-uns avoient un intérêt beaucoup plus réel de s’opposer à l’avancement de la Philosophie. Faussement persuadés que la croyance des peuples est d’autant plus ferme, qu’on l’exerce sur plus d’objets différens, ils ne se contentoient pas d’exiger pour nos Mysteres la soûmission qu’ils méritent, ils cherchoient à ériger en dogmes leurs opinions particulieres ; & c’étoit ces opinions mêmes, bien plus que les dogmes, qu’ils vouloient mettre en sûreté. Par là ils auroient porté à la religion le coup le plus terrible, si elle eût été l’ouvrage des hommes ; car il étoit à craindre que leurs opinions étant une fois reconnues pour fausses, le peuple qui ne discerne rien, ne traitât de la même maniere les vérités avec lesquelles on avoit voulu les confondre.
D’autres Théologiens de meilleure foi, mais aussi dangereux, se joignoient à ces premiers par d’autres motifs. Quoique la religion soit uniquement destinée à régler nos mœurs & notre foi, ils la croyoient faite pour nous éclairer aussi sur le système du monde, c’est-à-dire, sur ces matieres que le Tout-puissant a expressément abandonnées à nos disputes. Ils ne faisoient pas réflexion que les Livres sacrès & les Ouvrages des Peres, faits pour montrer au peuple comme aux Philosophes ce qu’il faut pratiquer & croire, ne devoient point sur les questions indifférentes parler un autre langage que le peuple. Cependant le despotisme théologique ou le préjugé l’emporta. Un Tribunal devenu puissant dans le Midi de l’Europe, dans les Indes, dans le Nouveau Monde, mais que la Foi n’ordonne point de croire, ni la charité d’approuver, & dont la France n’a pû s’accoûtumer encore à prononcer le nom sans effroi, condamna un célebre Astronome pour avoir soûtenu le mouvement de la Terre, & le déclara hérétique ; à peu-près comme le Pape Zacharie avoit condamné quelques siecles auparavant un Évêque, pour n’avoir pas pensé comme saint Augustin sur les Antipodes, & pour avoir deviné leur existence six cens ans avant que Christophe Colomb les découvrît. C’est ainsi que l’abus de l’autorité spirituelle réunie à la temporelle forçoit la raison au silence ; & peu s’en fallut qu’on ne défendît au genre humain de penser.
Pendant que des adversaires peu instruits ou mal intentionnés faisoient ouvertement la guerre à la Philosophie, elle se réfugioit, pour ainsi dire, dans les Ouvrages de quelques grands hommes, qui, sans avoir l’ambition dangereuse d’arracher le bandeau des yeux de leurs contemporains, préparoient de loin dans l’ombre & le silence la lumiere dont le monde devoit être éclairé peu-à-peu & par degrés insensibles.
À la tête de ces illustres personnages doit être placé l’immortel Chancelier d’Angleterre, François Bacon, dont les Ouvrages si justement estimés, & plus estimés pourtant qu’ils ne sont connus, méritent encore plus notre lecture que nos éloges. À considérer les vûes saines & étendues de ce grand homme, la multitude d’objets sur lesquels son esprit s’est porté, la hardiesse de son style qui réunit par-tout les plus sublimes images avec la précision la plus rigoureuse, on seroit tenté de le regarder comme le plus grand, le plus universel, & le plus éloquent des Philosophes. Bacon, né dans le sein de la nuit la plus profonde, sentit que la Philosophie n’étoit pas encore, quoique bien des gens sans doute se flatassent d’y exceller ; car plus un siecle est grossier, plus il se croit instruit de tout ce qu’il peut savoir. Il commença donc par envisager d’une vûe générale les divers objets de toutes les Sciences naturelles ; il partagea ces Sciences en différentes branches, dont il fit l’énumération la plus exacte qu’il lui fut possible : il examina ce que l’on savoit déjà sur chacun de ces objets, & fit le catalogue immense de ce qui restoit à découvrir : c’est le but de son admirable Ouvrage de la dignité & de l’accroissement des connoissances humaines. Dans son nouvel organe des Sciences, il perfectionne les vûes qu’il avoit données dans le premier Ouvrage ; il les porte plus loin, & fait connoître la nécessité de la Physique expérimentale, à laquelle on ne pensoit point encore. Ennemi des systèmes, il n’envisage la Philosophie que comme cette partie de nos connoissances, qui doit contribuer à nous rendre meilleurs ou plus heureux : il semble la borner à la Science des choses utiles, & recommande par-tout l’étude de la Nature. Ses autres Écrits sont formés sur le même plan ; tout, jusqu’à leurs titres, y annonce l’homme de génie, l’esprit qui voit en grand. Il y recueille des faits, il y compare des expériences, il en indique un grand nombre à faire ; il invite les Savans à étudier & à perfectionner les Arts, qu’il regarde comme la partie la plus relevée & la plus essentielle de la Science humaine : il expose avec une simplicité noble ses conjectures & ses pensées sur les différens objets dignes d’intéresser les hommes ; & il eût pû dire, comme ce vieillard de Térence, que rien de ce qui touche l’humanité ne lui étoit étranger. Science de la Nature, Morale, Politique, Œconomique, tout semble avoir été du ressort de cet esprit lumineux & profond ; & l’on ne sait ce qu’on doit le plus admirer, ou des richesses qu’il répand sur tous les sujets qu’il traite, ou de la dignité avec laquelle il en parle. Ses Écrits ne peuvent être mieux comparés qu’à ceux d’Hippocrate sur la Medecine ; & ils ne seroient ni moins admirés, ni moins lûs, si la culture de l’esprit étoit aussi chere au genre humain que la conservation de la santé. Mais il n’y a que les Chefs de secte en tout genre dont les Ouvrages puissent avoir un certain éclat ; Bacon n’a pas été du nombre, & la forme de sa Philosophie s’y opposoit. Elle étoit trop sage pour étonner personne ; la Scholastique qui dominoit de son tems, ne pouvoit être renversée que par des opinions hardies & nouvelles ; & il n’y a pas d’apparence qu’un Philosophe, qui se contente de dire aux hommes, voilà le peu que vous avez appris, voici ce qui vous reste à chercher, soit destiné à faire beaucoup de bruit parmi ses contemporains. Nous oserions même faire quelque reproche au Chancelier Bacon d’avoir été peut-être trop timide, si nous ne savions avec quelle retenue, & pour ainsi dire, avec quelle superstition, on doit juger un génie si sublime. Quoiqu’il avoüe que les Scholastiques ont énervé les Sciences par leurs questions minutieuses, & que l’esprit doit sacrifier l’étude des êtres généraux à celle des objets particuliers, il semble pourtant par l’emploi fréquent qu’il fait des termes de l’Ecole, quelquefois même par celui des principes scholastiques, & par des divisions & subdivisions dont l’usage étoit alors fort à la mode, avoir marqué un peu trop de ménagement ou de déférence pour le goût dominant de son siecle. Ce grand homme, après avoir brisé tant de fers, étoit encore retenu par quelques chaînes qu’il ne pouvoit ou n’osoit rompre.
Nous déclarerons ici que nous devons principalement au Chancelier Bacon l’Arbre encyclopédique dont nous avons déjà parlé fort au long, & que l’on trouvera à la fin de ce Discours. Nous en avions fait l’aveu en plusieurs endroits du Prospectus, nous y revenons encore, & nous ne manquerons aucune occasion de le répéter. Cependant nous n’avons pas crû devoir suivre de point en point le grand homme que nous reconnoissons ici pour notre maître. Si nous n’avons pas placé, comme lui, la raison après l’imagination, c’est que nous avons suivi dans le Système encyclopédique l’ordre métaphysique des opérations de l’Esprit, plûtôt que l’ordre historique de ses progrès depuis la renaissance des Lettres ; ordre que l’illustre Chancelier d’Angleterre avoit peut-être en vûe jusqu’à un certain point, lorsqu’il faisoit, comme il le dit, le cens & le dénombrement des connoissances humaines. D’ailleurs, le plan de Bacon étant différent du nôtre, & les Sciences ayant fait depuis de grands progrès, on ne doit pas être surpris que nous ayons pris quelquefois une route différente.
Ainsi, outre les changemens que nous avons faits dans l’ordre de la distribution générale, & dont nous avons déjà exposé les raisons, nous avons à certains égards poussé les divisions plus loin, sur-tout dans la partie de Mathématique & de Physique particuliere ; d’un autre côté, nous nous sommes abstenus d’étendre au même point que lui, la division de certaines Sciences dont il suit jusqu’aux derniers rameaux. Ces rameaux qui doivent proprement entrer dans le corps de notre Encyclopédie, n’auroient fait, à ce que nous croyons, que charger assez inutilement le Système général. On trouvera immédiatement après notre Arbre encyclopédique celui du Philosophe Anglois ; c’est le moyen le plus court & le plus facile de faire distinguer ce qui nous appartient d’avec ce que nous avons emprunté de lui.
Au Chancelier Bacon succéda l’illustre Descartes. Cet homme rare dont la fortune a tant varié en moins d’un siecle, avoit tout ce qu’il falloit pour changer la face de la Philosophie ; une imagination forte, un esprit très-conséquent, des connoissances puisées dans lui-même plus que dans les Livres, beaucoup de courage pour combattre les préjugés les plus généralement reçus, & aucune espece de dépendance qui le forçât à les ménager. Aussi éprouva-t-il de son vivant même ce qui arrive pour l’ordinaire à tout homme qui prend un ascendant trop marqué sur les autres. Il fit quelques enthousiastes, & eut beaucoup d’ennemis. Soit qu’il connût sa nation ou qu’il s’en défiât seulement, il s’étoit refugié dans un pays entierement libre pour y méditer plus à son aise. Quoiqu’il pensât beaucoup moins à faire des disciples qu’à les mériter, la persécution alla le chercher dans sa retraite ; & la vie cachée qu’il menoit ne put l’y soustraire. Malgré toute la sagacité qu’il avoit employée pour prouver l’existence de Dieu, il fut accusé de la nier par des Ministres qui peut-être ne la croyoient pas. Tourmenté & calomnié par des étrangers, & assez mal accueilli de ses compatriotes, il alla mourir en Suede, bien éloigné sans doute de s’attendre au succès brillant que ses opinions auroient un jour.
On peut considérer Descartes comme Géometre ou comme Philosophe. Les Mathématiques, dont il semble avoir fait assez peu de cas, font néanmoins aujourd’hui la partie la plus solide & la moins contestée de sa gloire. L’Algebre créée en quelque maniere par les Italiens, & prodigieusement augmentée par notre illustre Viete, a reçû entre les mains de Descartes de nouveaux accroissemens. Un des plus considérables est sa méthode des Indéterminées, artifice très-ingénieux & très-subtil, qu’on a sû appliquer depuis à un grand nombre de recherches. Mais ce qui a sur-tout immortalisé le nom de ce grand homme, c’est l’application qu’il a sû faire de l’Algebre à la Géométrie ; idée des plus vastes & des plus heureuses que l’esprit humain ait jamais eues, & qui sera toûjours la clé des plus profondes recherches, non seulement dans la Géométrie sublime, mais dans toutes les Sciences physico-mathématiques.
Comme Philosophe, il a peut-être été aussi grand, mais il n’a pas été si heureux. La Géométrie qui par la nature de son objet doit toûjours gagner sans perdre, ne pouvoit manquer, étant maniée par un aussi grand génie, de faire des progrès très-sensibles & apparens pour tout le monde. La Philosophie se trouvoit dans un état bien différent, tout y étoit à commencer ; & que ne coûtent point les premiers pas en tout genre ? Le mérite de les faire dispense de celui d’en faire de grands. Si Descartes qui nous a ouvert la route, n’y a pas été aussi loin que ses Sectateurs le croyent, il s’en faut beaucoup que les Sciences lui doivent aussi peu que le prétendent ses adversaires. Sa Méthode seule auroit suffi pour le rendre immortel ; sa Dioptrique est la plus grande & la plus belle application qu’on eût faite encore de la Géométrie à la Physique ; on voit enfin dans ses ouvrages, même les moins lûs maintenant, briller par tout le génie inventeur. Si on juge sans partialité ces Tourbillons devenus aujourd’hui presque ridicules, on conviendra, j’ose le dire, qu’on ne pouvoit alors imaginer mieux : les observations astronomiques qui ont servi à les détruire étoient encore imparfaites, ou peu constatées ; rien n’étoit plus naturel que de supposer un fluide qui transportât les planetes ; il n’y avoit qu’une longue suite de phénomènes, de raisonnemens & de calculs, & par conséquent une longue suite d’années, qui pût faire renoncer à une théorie si séduisante. Elle avoit d’ailleurs l’avantage singulier de rendre raison de la gravitation des corps par la force centrifuge du Tourbillon même : & je ne crains point d’avancer que cette explication de la pesanteur est une des plus belles & des plus ingénieuses hypotheses que la Philosophie ait jamais imaginées. Aussi a-t-il fallu pour l’abandonner, que les Physiciens ayent été entrainés comme malgré eux par la Théorie des forces centrales, & par des expériences faites long-tems après. Reconnoissons donc que Descartes, forcé de créer une Physique toute nouvelle, n’a pû la créer meilleure ; qu’il a fallu, pour ainsi dire, passer par les tourbillons pour arriver au vrai système du monde ; & que s’il s’est trompé sur les lois du mouvement, il a du moins deviné le premier qu’il devoit y en avoir.
Sa Métaphysique, aussi ingénieuse & aussi nouvelle que sa Physique, a eu le même sort à peu-près ; & c’est aussi à peu-près par les mêmes raisons qu’on peut la justifier ; car telle est aujourd’hui la fortune de ce grand homme, qu’après avoir eu des sectateurs sans nombre, il est presque réduit à des apologistes. Il se trompa sans doute en admettant les idées innées : mais s’il eût retenu de la secte Péripatéticienne la seule vérité qu’elle enseignoit sur l’origine des idées par les sens, peut-être les erreurs qui deshonoroient cette vérité par leur alliage, auroient été plus difficiles à déraciner. Descartes a osé du moins montrer aux bons esprits à secoüer le joug de la scholastique, de l’opinion, de l’autorité, en un mot des préjugés & de la barbarie ; & par cette révolte dont nous recueillons aujourd’hui les fruits, la Philosophie a reçu de lui un service, plus difficile peut-être à rendre que tous ceux qu’elle doit à ses illustres successeurs. On peut le regarder comme un chef de conjurés, qui a eu le courage de s’élever le premier contre une puissance despotique & arbitraire, & qui en préparant une révolution éclatante, a jetté les fondemens d’un gouvernement plus juste & plus heureux qu’il n’a pû voir établi. S’il a fini par croire tout expliquer, il a du moins commencé par douter de tout ; & les armes dont nous nous servons pour le combattre ne lui en appartiennent pas moins, parce que nous les tournons contre lui. D’ailleurs, quand les opinions absurdes sont invétérées, on est quelquefois forcé, pour desabuser le genre humain, de les remplacer par d’autres erreurs, lorsqu’on ne peut mieux faire. L’incertitude & la vanité de l’esprit sont telles, qu’il a toûjours besoin d’une opinion à laquelle il se fixe : c’est un enfant à qui il faut présenter un joüet pour lui enlever une arme dangereuse ; il quittera de lui-même ce joüet quand le tems de la raison sera venu. En donnant ainsi le change aux Philosophes ou à ceux qui croyent l’être, on leur apprend du moins à se défier de leurs lumieres, & cette disposition est le premier pas vers la vérité. Aussi Descartes a-t-il été persécuté de son vivant, comme s’il fût venu l’apporter aux hommes.
Newton, à qui la route avoit été préparée par Huyghens, parut enfin, & donna à la Philosophie une forme qu’elle semble devoir conserver. Ce grand génie vit qu’il étoit tems de bannir de la Physique les conjectures & les hypothèses vagues, ou du moins de ne les donner que pour ce qu’elles valoient, & que cette Science devoit être uniquement soûmise aux expériences & à la Géométrie. C’est peut-être dans cette vûe qu’il commença par inventer le calcul de l’Infini & la méthode des Suites, dont les usages si étendus dans la Géométrie même, le sont encore davantage pour déterminer les effets compliqués que l’on observe dans la Nature, où tout semble s’exécuter par des especes de progressions infinies. Les expériences de la pesanteur, & les observations de Képler, firent découvrir au Philosophe Anglois la force qui retient les planetes dans leurs orbites. Il enseigna tout ensemble & à distinguer les causes de leurs mouvemens, & à les calculer avec une exactitude qu’on n’auroit pû exiger que du travail de plusieurs siecles. Créateur d’une Optique toute nouvelle, il fit connoître la lumiere aux hommes en la décomposant. Ce que nous pourrions ajoûter à l’éloge de ce grand Philosophe, seroit fort au-dessous du témoignage universel qu’on rend aujourd’hui à ses découvertes presque innombrables, & à son génie tout à la fois étendu, juste & profond. En enrichissant la Philosophie par une grande quantité de biens réels, il a mérité sans doute toute sa reconnoissance ; mais il a peut-être plus fait pour elle en lui apprenant à être sage, & à contenir dans de justes bornes cette espece d’audace que les circonstances avoient forcé Descartes à lui donner. Sa Théorie du monde (car je ne veux pas dire son Systême) est aujourd’hui si généralement reçue, qu’on commence à disputer à l’auteur l’honneur de l’invention, parce qu’on accuse d’abord les grands hommes de se tromper, & qu’on finit par les traiter de plagiaires. Je laisse à ceux qui trouvent tout dans les ouvrages des Anciens, le plaisir de découvrir dans ces ouvrages la gravitation des planetes, quand elle n’y seroit pas ; mais en supposant même que les Grecs en ayent eu l’idée, ce qui n’étoit chez eux qu’un systême hasardé & romanesque, est devenu une démonstration dans les mains de Newton : cette démonstration qui n’appartient qu’à lui fait le mérite réel de sa découverte ; & l’attraction sans un tel appui seroit une hypothèse comme tant d’autres. Si quelqu’Écrivain célebre s’avisoit de prédire aujourd’hui sans aucune preuve qu’on parviendra un jour à faire de l’or, nos descendans auroient-ils droit sous ce prétexte de vouloir ôter la gloire du grand œuvre à un Chimiste qui en viendroit à bout ? Et l’invention des lunettes en appartiendroit-elle moins à ses auteurs, quand même quelques anciens n’auroient pas cru impossible que nous étendissions un jour la sphere de notre vûe ?
D’autres Savans croyent faire à Newton un reproche beaucoup plus fondé, en l’accusant d’avoir ramené dans la Physique les qualités occultes des Scholastiques & des anciens Philosophes. Mais les Savans dont nous parlons sont-ils bien sûrs que ces deux mots, vuides de sens chez les Scholastiques, & destinés à marquer un Etre dont ils croyoient avoir l’idée, fussent autre chose chez les anciens Philosophes que l’expression modeste de leur ignorance ? Newton qui avoit étudié la Nature, ne se flattoit pas d’en savoir plus qu’eux sur la cause premiere qui produit les phénomènes ; mais il n’employa pas le même langage, pour ne pas révolter des contemporains qui n’auroient pas manqué d’y attacher une autre idée que lui. Il se contenta de prouver que les tourbillons de Descartes ne pouvoient rendre raison du mouvement des planetes ; que les phénomènes & les lois de la Mechanique s’unissoient pour les renverser ; qu’il y a une force par laquelle les planetes tendent les unes vers les autres, & dont le principe nous est entierement inconnu. Il ne rejetta point l’impulsion ; il se borna à demander qu’on s’en servît plus heureusement qu’on n’avoit fait jusqu’alors pour expliquer les mouvemens des planetes : ses desirs n’ont point encore été remplis, & ne le seront peut-être de long-tems. Après tout, quel mal auroit-il fait à la Philosophie, en nous donnant lieu de penser que la matiere peut avoir des propriétés que nous ne lui soupçonnions pas, & en nous desabusant de la confiance ridicule où nous sommes de les connoître toutes ?
À l’égard de la Métaphysique, il paroît que Newton ne l’avoit pas entierement négligée. Il étoit trop grand Philosophe pour ne pas sentir qu’elle est la base de nos connoissances, & qu’il faut chercher dans elle seule des notions nettes & exactes de tout : il paroît même par les ouvrages de ce profond Géometre, qu’il étoit parvenu à se faire de telles notions sur les principaux objets qui l’avoient occupé. Cependant, soit qu’il fût peu content lui-même des progrès qu’il avoit faits à d’autres égards dans la Métaphysique, soit qu’il crût difficile de donner au genre humain des lumieres bien satisfaisantes ou bien étendues sur une science trop souvent incertaine & contentieuse, soit enfin qu’il craignît qu’à l’ombre de son autorité on n’abusât de sa Métaphysique comme on avoit abusé de celle de Descartes pour soutenir des opinions dangereuses ou erronées, il s’abstint presque absolument d’en parler dans ceux de ses écrits qui sont le plus connus ; & on ne peut guere apprendre ce qu’il pensoit sur les différens objets de cette science, que dans les ouvrages de ses disciples. Ainsi comme il n’a causé sur ce point aucune révolution, nous nous abstiendrons de le considérer de ce côté-là.
Ce que Newton n’avoit osé, ou n’auroit peut-être pû faire, Locke l’entreprit & l’exécuta avec succès. On peut dire qu’il créa la Métaphysique à peu-près comme Newton avoit créé la Physique. Il conçut que les abstractions & les questions ridicules qu’on avoit jusqu’alors agitées, & qui avoient fait comme la substance de la Philosophie, étoient la partie qu’il falloit sur-tout proscrire. Il chercha dans ces abstractions & dans l’abus des signes les causes principales de nos erreurs, & les y trouva. Pour connoitre notre ame, ses idées & ses affections, il n’étudia point les livres, parce qu’ils l’auroient mal instruit ; il se contenta de descendre profondement en lui-même ; & après s’être, pour ainsi dire, contemplé long-tems, il ne fit dans son Traité de l’entendement humain que présenter aux hommes le miroir dans lequel il s’étoit vû. En un mot il réduisit la Métaphysique à ce qu’elle doit être en effet, la Physique expérimentale de l’ame ; espece de Physique très-différente de celle des corps non-seulement par son objet, mais par la maniere de l’envisager. Dans celle-ci on peut découvrir, & on découvre souvent des phénomènes inconnus ; dans l’autre les faits aussi anciens que le monde existent également dans tous les hommes : tant pis pour qui croit en voir de nouveaux. La Métaphysique raisonnable ne peut consister, comme la Physique expérimentale, qu’à rassembler avec soin tous ces faits, à les réduire en un corps, à expliquer les uns par les autres, en distinguant ceux qui doivent tenir le premier rang & servir comme de base. En un mot les principes de la Métaphysique, aussi simples que les axiomes, sont les mêmes pour les Philosophes & pour le Peuple. Mais le peu de progrès que cette Science a fait depuis si long-tems, montre combien il est rare d’appliquer heureusement ces principes, soit par la difficulté que renferme un pareil travail, soit peut-être aussi par l’impatience naturelle qui empêche de s’y borner. Cependant le titre de Métaphysicien & même de grand Métaphysicien est encore assez commun dans notre siecle ; car nous aimons à tout prodiguer : mais qu’il y a peu de personnes véritablement dignes de ce nom ! Combien y en a-t-il qui ne le méritent que par le malheureux talent d’obscurcir avec beaucoup de subtilité des idées claires, & de préférer dans les notions qu’ils se forment l’extraordinaire au vrai, qui est toujours simple ? Il ne faut pas s’étonner après cela si la plûpart de ceux qu’on appelle Métaphysiciens font si peu de cas les uns des autres. Je ne doute point que ce titre ne soit bientôt une injure pour nos bons esprits, comme le nom de Sophiste, qui pourtant signifie Sage, avili en Grece par ceux qui le portoient, fut rejetté par les vrais Philosophes.
Concluons de toute cette histoire, que l’Angleterre nous doit la naissance de cette Philosophie que nous avons reçue d’elle. Il y a peut-être plus loin des formes substantielles aux tourbillons, que des tourbillons à la gravitation universelle, comme il y a peut-être un plus grand intervalle entre l’Algebre pure & l’idée de l’appliquer à la Géométrie, qu’entre le petit triangle de Barrow & le calcul différentiel.
Tels sont les principaux génies que l’esprit humain doit regarder comme ses maîtres, & à qui la Grece eut élevé des statues, quand même elle eut été obligée pour leur faire place, d’abattre celles de quelques Conquérans.
Les bornes de ce Discours Préliminaire nous empêchent de parler de plusieurs Philosophes illustres, qui sans se proposer des vûes aussi grandes que ceux dont nous venons de faire mention, n’ont pas laissé par leurs travaux de contribuer beaucoup à l’avancement des Sciences, & ont pour ainsi dire levé un coin du voile qui nous cachoit la vérité. De ce nombre sont ; Galilée, à qui la Géographie doit tant pour ses découvertes Astronomiques, & la Méchanique pour sa Théorie de l’accélération ; Harvey, que la découverte de la circulation du sang rendra immortel ; Huyghens, que nous avons déjà nommé, & qui par des ouvrages pleins de force & de génie a si bien mérité de la Géometrie & de la Physique ; Pascal, auteur d’un traité sur la Cycloïde, qu’on doit regarder comme un prodige de sagacité & de pénétration, & d’un traité de l’équilibre des liqueurs & de la pesanteur de l’air, qui nous a ouvert une science nouvelle : génie universel & sublime, dont les talens ne pourroient être trop regrettés par la Philosophie, si la religion n’en avoit pas profité ; Malebranche, qui a si bien démêlé les erreurs des sens, & qui a connu celles de l’imagination comme s’il n’avoit pas été souvent trompé par la sienne ; Boyle, le pere de la Physique expérimentale ; plusieurs autres enfin, parmi lesquels doivent être comptés avec distinction les Vesale, les Sydenham, les Boerhaave, & une infinité d’Anatomistes & de Physiciens célebres.
Entre ces grands hommes il en est un, dont la Philosophie aujourd’hui fort accueillie & fort combattue dans le Nord de l’Europe, nous oblige à ne le point passer sous silence ; c’est l’illustre Leibnitz. Quand il n’auroit pour lui que la gloire, ou même que le soupçon d’avoir partagé avec Newton l’invention du calcul différentiel, il mériteroit à ce titre une mention honorable. Mais c’est principalement par sa Métaphysique que nous voulons l’envisager. Comme Descartes, il semble avoir reconnu l’insuffisance de toutes les solutions qui avoient été données jusqu’à lui des questions les plus élevées, sur l’union du corps & de l’ame, sur la Providence, sur la nature de la matiere ; il paroit même avoir eu l’avantage d’exposer avec plus de force que personne les difficultés qu’on peut proposer sur ces questions ; mais moins sage que Locke & Newton, il ne s’est pas contenté de former des doutes, il a cherché à les dissiper, & de ce côté-là il n’a peut-être pas été plus heureux que Descartes. Son principe de la raison suffisante, très-beau & très vrai en lui-même, ne paroît pas devoir être fort utile à des êtres aussi peu éclairés que nous le sommes sur les raisons premieres de toutes choses ; ses Monades prouvent tout au plus qu’il a vu mieux que personne qu’on ne peut se former une idée nette de la matiere, mais elles ne paroissent pas faites pour la donner ; son Harmonie préétablie, semble n’ajoûter qu’une difficulté de plus à l’opinion de Descartes sur l’union du corps & de l’ame ; enfin son système de l’Optimisme est peut-être dangereux par le prétendu avantage qu’il a d’expliquer tout.
Nous finirons par une observation qui ne paroîtra pas surprenante à des Philosophes. Ce n’est guere de leur vivant que les grands hommes dont nous venons de parler ont changé la face des Sciences. Nous avons déjà vû pourquoi Bacon n’a point été chef de secte ; deux raisons se joignent à celle que nous en avons apportée. Ce grand Philosophe a écrit plusieurs de ses Ouvrages dans une retraite à laquelle ses ennemis l’avoient forcé, & le mal qu’ils avoient fait à l’homme d’État n’a pû manquer de nuire à l’Auteur. D’ailleurs, uniquement occupé d’être utile, il a peut-être embrassé trop de matieres, pour que ses contemporains dussent se laisser éclairer à la fois sur un si grand nombre d’objets. On ne permet guere aux grands génies d’en savoir tant ; on veut bien apprendre quelque chose d’eux sur un sujet borné : mais on ne veut pas être obligé à réformer toutes ses idées sur les leurs. C’est en partie pour cette raison que les Ouvrages de Descartes ont essuyé en France après sa mort plus de persécution que leur Auteur n’en avoit souffert en Hollande pendant sa vie ; ce n’a été qu’avec beaucoup de peine que les écoles ont enfin osé admettre une Physique qu’elles s’imaginoient être contraire à celle de Moïse. Newton, il est vrai, a trouvé dans ses contemporains moins de contradiction, soit que les découvertes géométriques par lesquelles il s’annonça, & dont on ne pouvoit lui disputer ni la propriété, ni la réalité, eussent accoûtumé à l’admiration pour lui, & à lui rendre des hommages qui n’étoient ni trop subits, ni trop forcés ; soit que par sa supériorité il imposât silence à l’envie; soit enfin, ce qui paroît plus difficile à croire, qu’il eût affaire à une nation moins injuste que les autres. Il a eu l’avantage singulier de voir sa Philosophie généralement reçûe en Angleterre de son vivant, & d’avoir tous ses compatriotes pour partisans & pour admirateurs. Cependant il s’en falloit bien que le reste de l’Europe fit alors le même accueil à ses Ouvrages. Non seulement ils étoient inconnus en France, mais la Philosophie scholastique y dominoit encore, lorsque Newton avoit déjà renversé la Physique Cartésienne, & les tourbillons étoient détruits avant que nous songeassions à les adopter. Nous avons été aussi long-tems à les soûtenir qu’à les recevoir. Il ne faut qu’ouvrir nos Livres, pour voir avec surprise qu’il n’y a pas encore vingt ans qu’on a commencé en France à renoncer au Cartésianisme. Le premier qui ait osé parmi nous se déclarer ouvertement Newtonien, est l’auteur du Discours sur la figure des Astres, qui joint à des connoissances géométriques très-étendues, cet esprit philosophique avec lequel elles ne se trouvent pas toûjours, & ce talent d’écrire auquel on ne croira plus qu’elles nuisent, quand on aura lû ses Ouvrages. M. de Maupertuis a crû qu’on pouvoit être bon citoyen, sans adopter aveuglément la Physique de son pays ; & pour attaquer cette Physique, il a eu besoin d’un courage dont on doit lui savoir gré. En effet notre nation, singulierement avide de nouveautés dans les matieres de goût, est au contraire en matiere de Science très-attachée aux opinions anciennes. Deux dispositions si contraires en apparence ont leur principe dans plusieurs causes, & sur-tout dans cette ardeur de joüir, qui semble constituer notre caractere. Tout ce qui est du ressort du sentiment n’est pas fait pour être long-tems cherché, & cesse d’être agréable, dès qu’il ne se présente pas tout d’un coup : mais aussi l’ardeur avec laquelle nous nous y livrons s’épuise bientôt, & l’ame dégoûtée aussi-tôt que remplie, vole vers un nouvel objet qu’elle abandonnera de même. Au contraire, ce n’est qu’à force de méditation que l’esprit parvient à ce qu’il cherche : mais par cette raison il veut joüir aussi long-tems qu’il a cherché, sur-tout lorsqu’il ne s’agit que d’une Philosophie hypothétique & conjecturale, beaucoup moins pénible que des calculs & des combinaisons exactes. Les Physiciens attachés à leurs théories, avec le même zele & par les mêmes motifs que les artisans à leurs pratiques, ont sur ce point beaucoup plus de ressemblance avec le peuple qu’ils ne s’imaginent. Respectons toûjours Descartes ; mais abandonnons sans peine des opinions qu’il eût combattues lui-même un siecle plus tard. Sur-tout ne confondons point sa cause avec celle de ses sectateurs. Le génie qu’il a montré en cherchant dans la nuit la plus sombre une route nouvelle quoique trompeuse, n’étoit qu’à lui : ceux qui l’ont osé suivre les premiers dans les ténebres, ont au moins marqué du courage ; mais il n’y a plus de gloire à s’égarer sur ses traces depuis que la lumière est venue. Parmi le peu de Savans qui défendent encore sa doctrine, il eût desavoüé lui-même ceux qui n’y tiennent que par un attachement servile à ce qu’ils ont appris dans leur enfance, ou par je ne sais quel préjugé national, la honte de la Philosophie. Avec de tels motifs on peut être le dernier de ses partisans ; mais on n’auroit pas eu le mérite d’être son premier disciple, ou plûtôt on eût été son adversaire, lorsqu’il n’y avoit que de l’injustice à l’être. Pour avoir le droit d’admirer les erreurs d’un grand homme, il faut savoir les reconnoitre, quand le tems les a mises au grand jour. Aussi les jeunes gens qu’on regarde d’ordinaire comme d’assez mauvais juges, sont peut-être les meilleurs dans les matieres philosophiques & dans beaucoup d’autres, lorsqu’ils ne sont pas dépourvûs de lumiere ; parce que tout leur étant également nouveau, ils n’ont d’autre intérêt que celui de bien choisir.
Ce sont en effet les jeunes Géometres, tant de France que des pays étrangers, qui ont réglé le sort des deux Philosophies. L’ancienne est tellement proscrite, que ses plus zélés partisans n’osent plus même nommer ces tourbillons dont ils remplissoient autrefois leurs Ouvrages. Si le Newtonianisme venoit à être détruit de nos jours par quelque cause que ce pût être, injuste ou légitime, les sectateurs nombreux qu’il a maintenant joueroient sans doute alors le même rôle qu’ils ont fait joüer à d’autres. Telle est la nature des esprits : telles sont les suites de l’amour propre qui gouverne les Philosophes du moins autant que les autres hommes, & de la contradiction que doivent éprouver toutes les découvertes, ou même ce qui en a l’apparence.
Il en a été de Locke à peu-près comme de Bacon, de Descartes, & de Newton. Oublié long-tems pour Rohaut & pour Regis, & encore assez peu connu de la multitude, il commence enfin à avoir parmi nous des lecteurs & quelques partisans. C’est ainsi que les personnages illustres souvent trop au-dessus de leur siecle, travaillent presque toûjours en pure perte pour leur siecle même ; c’est aux âges suivans qu’il est réservé de recueillir le fruit de leurs lumieres. Aussi les restaurateurs des Sciences ne joüissent-ils presque jamais de toute la gloire qu’ils méritent ; des hommes fort inférieurs la leur arrachent, parce que les grands hommes se livrent à leur génie, & les gens médiocres à celui de leur nation. Il est vrai que le témoignage que la supériorité ne peut s’empêcher de se rendre à elle-même, suffit pour la dédommager des suffrages vulgaires : elle se nourrit de sa propre substance ; & cette réputation dont on est si avide, ne sert souvent qu’à consoler la médiocrité des avantages que le talent a sur elle. On peut dire en effet que la Renommée qui publie tout, raconte plus souvent ce qu’elle entend que ce qu’elle voit, & que les Poëtes qui lui ont donné cent bouches, devoient bien aussi lui donner un bandeau.
La Philosophie, qui forme le goût dominant de notre siecle, semble par les progrès qu’elle fait parmi nous, vouloir réparer le tems qu’elle a perdu & se venger de l’espece de mépris que lui avoient marqué nos peres. Ce mépris est aujourd’hui retombé sur l’Érudition, & n’en est pas plus juste pour avoir changé d’objet. On s’imagine que nous avons tiré des Ouvrages des Anciens tout ce qu’il nous importoit de savoir ; & sur ce fondement on dispenseroit volontiers de leur peine ceux qui vont encore les consulter. Il semble qu’on regarde l’antiquité comme un oracle qui a tout dit, & qu’il est inutile d’interroger ; & l’on ne fait guere plus de cas aujourd’hui de la restitution d’un passage, que de la découverte d’un petit rameau de veine dans le corps humain. Mais comme il seroit ridicule de croire qu’il n’y a plus rien à découvrir dans l’Anatomie, parce que les Anatomistes se livrent quelquefois à des recherches, inutiles en apparence, & souvent utiles par leurs suites ; il ne seroit pas moins absurde de vouloir interdire l’Érudition, sous prétexte des recherches peu importantes auxquelles nos Savans peuvent s’abandonner. C’est être ignorant ou présomptueux de croire que tout soit vû dans quelque matiere que ce puisse être, & que nous n’ayons plus aucun avantage à tirer de l’étude & de la lecture des Anciens.
L’usage de tout écrire aujourd’hui en Langue vulgaire, a contribué sans doute à fortifier ce préjugé, & est peut-être plus pernicieux que le préjugé même. Notre Langue s’étant répandue par toute l’Europe, nous avons crû qu’il étoit tems de la substituer à la Langue latine, qui depuis la renaissance des Lettres étoit celle de nos Savans. J’avoüe qu’un Philosophe est beaucoup plus excusable d’écrire en François, qu’un François de faire des vers Latins ; je veux bien même convenir que cet usage a contribué à rendre la lumiere plus générale, si néanmoins c’est étendre réellement l’esprit d’un Peuple, que d’en étendre la superficie. Cependant il résulte de-là un inconvénient que nous aurions bien dû prévoir. Les Savans des autres nations à qui nous avons donné l’exemple, ont crû avec raison qu’ils écriroient encore mieux dans leur Langue que dans la nôtre. L’Angleterre nous a donc imité ; l’Allemagne, où le Latin sembloit s’être réfugié, commence insensiblement à en perdre l’usage : je ne doute pas qu’elle ne soit bien-tôt suivie par les Suédois, les Danois, & les Russiens. Ainsi, avant la fin du dix-huitieme siecle, un Philosophe qui voudra s’instruire à fond des découvertes de ses prédécesseurs, sera contraint de charger sa mémoire de sept à huit Langues différentes ; & après avoir consumé à les apprendre le tems le plus précieux de sa vie, il mourra avant de commencer à s’instruire. L’usage de la Langue Latine, dont nous avons fait voir le ridicule dans les matieres de goût, ne pourroit être que très-utile dans les Ouvrages de Philosophie, dont la clarté & la précision doivent faire tout le mérite, & qui n’ont besoin que d’une Langue universelle & de convention. Il seroit donc à souhaiter qu’on rétablit cet usage : mais il n’y a pas lieu de l’espérer. L’abus dont nous osons nous plaindre est trop favorable à la vanité & à la paresse, pour qu’on se flate de le déraciner. Les Philosophes, comme les autres Écrivains, veulent être lûs, & sur-tout de leur nation. S’ils se servoient d’une Langue moins familiere, ils auroient moins de bouches pour les célébrer, & on ne pourroit pas se vanter de les entendre. Il est vrai qu’avec moins d’admirateurs, ils auroient de meilleurs juges : mais c’est un avantage qui les touche peu, parce que la réputation tient plus au nombre qu’au mérite de ceux qui la distribuent.
En récompense, car il ne faut rien outrer, nos Livres de Science semblent avoir acquis jusqu’à l’espece d’avantage qui sembloit devoir être particulier aux Ouvrages de Belles-Lettres. Un Écrivain respectable que notre siecle a encore le bonheur de posséder, & dont je loüerois ici les différentes productions, si je ne me bornois pas à l’envisager comme Philosophe, a appris aux Savans à secoüer le joug du pédantisme. Supérieur dans l’art de mettre en leur jour les idées les plus abstraites, il a sû par beaucoup de méthode, de précision, & de clarté les abaisser à la portée des esprits qu’on auroit crû le moins faits pour les saisir. Il a même osé prêter à la Philosophie les ornemens qui sembloient lui être les plus étrangers ; & qu’elle paroissoit devoir s’interdire le plus séverement ; & cette hardiesse a été justifiée par le succès le plus général & le plus flateur. Mais semblable à tous les Écrivains originaux, il a laissé bien loin derriere lui ceux qui ont crû pouvoir l’imiter.
L’Auteur de l’Histoire Naturelle a suivi une route différente. Rival de Platon & de Lucrece, il a répandu dans son Ouvrage, dont la réputation croît de jour en jour, cette noblesse & cette élévation de style qui sont si propres aux matieres philosophiques, & qui dans les écrits du Sage doivent être la peinture de son ame.
Cependant la Philosophie, en songeant à plaire, paroît n’avoir pas oublié qu’elle est principalement faite pour instruire ; c’est par cette raison que le goût des systèmes, plus propre à flater l’imagination qu’à éclairer la raison, est aujourd’hui presqu’absolument banni des bons Ouvrages. Un de nos meilleurs Philosophes semble lui avoir porté les derniers coups[2]. L’esprit d’hypothese & de conjecture pouvoit être autrefois fort utile, & avoit même été nécessaire pour la renaissance de la Philosophie ; parce qu’alors il s’agissoit encore moins de bien penser, que d’apprendre à penser par soi-même. Mais les tems sont changés, & un Écrivain qui feroit parmi nous l’éloge des Systèmes viendroit trop tard. Les avantages que cet esprit peut procurer maintenant sont en trop petit nombre pour balancer les inconvéniens qui en résultent ; & si on prétend prouver l’utilité des Systèmes par un très-petit nombre de découvertes qu’ils ont occasionnées autrefois, on pourroit de même conseiller à nos Géometres de s’appliquer à la quadrature du cercle, parce que les efforts de plusieurs Mathématiciens pour la trouver, nous ont produit quelques théorèmes. L’esprit de Système est dans la Physique ce que la Métaphysique est dans la Géométrie. S’il est quelquefois nécessaire pour nous mettre dans le chemin de la vérité, il est presque toûjours incapable de nous y conduire par lui-même. Éclairé par l’observation de la Nature, il peut entrevoir les causes des phénomenes : mais c’est au calcul à assûrer pour ainsi dire l’existence de ces causes, en déterminant exactement les effets qu’elles peuvent produire, & en comparant ces effets avec ceux que l’expérience nous découvre. Toute hypothese dénuée d’un tel secours acquiert rarement ce degré de certitude, qu’on doit toûjours chercher dans les Sciences naturelles, & qui néanmoins se trouve si peu dans ces conjectures frivoles qu’on honore du nom de Systèmes. S’il ne pouvoit y en avoir que de cette espece, le principal mérite du Physicien seroit, à proprement parler, d’avoir l’esprit de Système, & de n’en faire jamais. À l’égard de l’usage des Systèmes dans les autres Sciences, mille expériences prouvent combien il est dangereux.
La Physique est donc uniquement bornée aux observations & aux calculs ; la Medecine à l’histoire du corps humain, de ses maladies, & de leurs remedes ; l’Histoire Naturelle à la description détaillée des végétaux, des animaux, & des minéraux ; la Chimie à la composition & à la décomposition expérimentale des corps : en un mot, toutes les Sciences renfermées dans les faits autant qu’il leur est possible, & dans les conséquences qu’on en peut déduire, n’accordent rien à l’opinion, que quand elles y sont forcées. Je ne parle point de la Géométrie, de l’Astronomie, & de la Méchanique, destinées par leur nature à aller toûjours en se perfectionnant de plus en plus.
On abuse des meilleures choses. Cet esprit philosophique, si à la mode aujourd’hui, qui veut tout voir & ne rien supposer, s’est répandu jusques dans les Belles-Lettres ; on prétend même qu’il est nuisible à leurs progrès, & il est difficile de se le dissimuler. Notre siecle porté à la combinaison & à l’analyse, semble vouloir introduire les discussions froides & didactiques dans les choses de sentiment. Ce n’est pas que les passions & le goût n’ayent une Logique qui leur appartient : mais cette Logique a des principes tout différens de ceux de la Logique ordinaire : ce sont ces principes qu’il faut démêler en nous, & c’est, il faut l’avoüer, dequoi une Philosophie commune est peu capable. Livrée toute entiere à l’examen des perceptions tranquilles de l’ame, il lui est bien plus facile d’en démêler les nuances que celles de nos passions, ou en général des sentimens vifs qui nous affectent ; & comment cette espece de sentimens ne seroit-elle pas difficile à analyser avec justesse ? Si d’un côté, il faut se livrer à eux pour les connoître, de l’autre, le tems où l’ame en est affectée est celui où elle peut les étudier le moins. Il faut pourtant convenir que cet esprit de discussion a contribué à affranchir notre littérature de l’admiration aveugle des Anciens ; il nous a appris à n’estimer en eux que les beautés que nous serions contraints d’admirer dans les Modernes. Mais c’est peut-être aussi à la même source que nous devons je ne sais quelle Métaphysique du cœur, qui s’est emparée de nos théatres ; s’il ne falloit pas l’en bannir entierement, encore moins falloit-il l’y laisser régner. Cette anatomie de l’ame s’est glissée jusque dans nos conversations ; on y disserte, on n’y parle plus ; & nos sociétés ont perdu leurs principaux agrémens, la chaleur & la gaieté.
Ne soyons donc pas étonnés que nos Ouvrages d’esprit soient en général inférieurs à ceux du siecle précédent. On peut même en trouver la raison dans les efforts que nous faisons pour surpasser nos prédécesseurs. Le goût & l’art d’écrire font en peu de tems des progrès rapides, dès qu’une fois la véritable route est ouverte ; à peine un grand génie a-t-il entrevû le beau, qu’il l’apperçoit dans toute son étendue ; & l’imitation de la belle Nature semble bornée à de certaines limites qu’une génération, ou deux tout au plus, ont bien-tôt atteintes : il ne reste à la génération suivante que d’imiter : mais elle ne se contente pas de ce partage ; les richesses qu’elle a acquises autorisent le desir de les accroître ; elle veut ajoûter à ce qu’elle a reçû, & manque le but en cherchant à le passer. On a donc tout à la fois plus de principes pour bien juger, un plus grand fonds de lumieres, plus de bons juges, & moins de bons Ouvrages ; on ne dit point d’un Livre qu’il est bon, mais que c’est le Livre d’un homme d’esprit. C’est ainsi que le siecle de Démétrius de Phalere a succédé immédiatement à celui de Démosthene, le siecle de Lucain & de Séneque à celui de Cicéron & de Virgile, & le nôtre à celui de Louis XIV.
Je ne parle ici que du siecle en général : car je suis bien éloigné de faire la satyre de quelques hommes d’un mérite rare avec qui nous vivons. La constitution physique du monde littéraire entraîne, comme celle du monde matériel, des révolutions forcées, dont il seroit aussi injuste de se plaindre que du changement des saisons. D’ailleurs comme nous devons au siecle de Pline les ouvrages admirables de Quintilien & de Tacite, que la génération précédente n’auroit peut-être pas été en état de produire, le nôtre laissera à la postérité des monumens dont il a bien droit de se glorifier. Un Poëte célebre par ses talens & par ses malheurs a effacé Malherbe dans ses Odes, & Marot dans ses Epigrammes & dans ses Epitres. Nous avons vu naître le seul Poëme épique que la France puisse opposer à ceux des Grecs, des Romains, des Italiens, des Anglois & des Espagnols. Deux hommes illustres, entre lesquels notre nation semble partagée, & que la postérité saura mettre chacun à sa place, se disputent la gloire du cothurne, & l’on voit encore avec un extrème plaisir leurs Tragédies après celles de Corneille & de Racine. L’un de ces deux hommes, le même à qui nous devons la Henriade, sûr d’obtenir parmi le très-petit nombre de grands Poëtes une place distinguée & qui n’est qu’à lui, possede en même tems au plus haut dégré un talent que n’a eu presque aucun Poëte même dans un dégré médiocre, celui d’écrire en prose. Personne n’a mieux connu l’art si rare de rendre sans effort chaque idée par le terme qui lui est propre, d’embellir tout sans se méprendre sur le coloris propre à chaque chose ; enfin, ce qui caracterise plus qu’on ne pense les grands Écrivains, de n’être jamais ni au-dessus, ni au-dessous de son sujet. Son essai sur le siecle de Louis XIV. est un morceau d’autant plus précieux que l’Auteur n’avoit en ce genre aucun modele ni parmi les Anciens, ni parmi nous. Son histoire de Charles XII, par la rapidité & la noblesse du style est digne du Héros qu’il avoit à peindre ; ses pieces fugitives supérieures à toutes celles que nous estimons le plus, suffiroient par leur nombre & par leur mérite pour immortaliser plusieurs Écrivains. Que ne puis-je en parcourant ici ses nombreux & admirables Ouvrages, payer à ce génie rare le tribut d’éloges qu’il mérite, qu’il a reçu tant de fois de ses compatriotes, des étrangers & de ses ennemis, & auquel la postérité mettra le comble quand il ne pourra plus en joüir !
Ce ne sont pas là nos seules richesses. Un Écrivain judicieux, aussi bon citoyen que grand Philosophe, nous a donné sur les principes des Lois un ouvrage décrié par quelques François, & estimé de toute l’Europe. D’excellens auteurs ont écrit l’histoire ; des esprits justes & éclairés l’ont approfondie : la Comédie a acquis un nouveau genre, qu’on auroit tort de rejetter, puisqu’il en résulte un plaisir de plus, & qui n’a pas été aussi inconnu des anciens qu’on voudroit nous le persuader ; enfin nous avons plusieurs Romans qui nous empêchent de regretter ceux du dernier siecle.
Les beaux Arts ne sont pas moins en honneur dans notre nation. Si j’en crois les Amateurs éclairés, notre école de Peinture est la premiere de l’Europe, & plusieurs ouvrages de nos Sculpteurs n’auroient pas été desavoués par les Anciens. La Musique est peut-être de tous ces Arts celui qui a fait depuis quinze ans le plus de progrès parmi nous. Graces aux travaux d’un génie mâle, hardi & fécond, les Étrangers qui ne pouvoient souffrir nos symphonies, commencent à les goûter, & les François paroissent enfin persuadés que Lulli avoit laissé dans ce genre beaucoup à faire. M. Rameau, en poussant la pratique de son Art à un si haut degré de perfection, est devenu tout ensemble le modele & l’objet de la jalousie d’un grand nombre d’Artistes, qui le décrient en s’efforçant de l’imiter. Mais ce qui le distingue plus particulierement, c’est d’avoir refléchi avec beaucoup de succès sur la théorie de ce même Art ; d’avoir sû trouver dans la Basse fondamentale le principe de l’harmonie & de la mélodie ; d’avoir réduit par ce moyen à des lois plus certaines & plus simples, une science livrée avant lui à des regles arbitraires, ou dictées par une expérience aveugle. Je saisis avec empressement l’occasion de célébrer cet Artiste philosophe, dans un discours destiné principalement à l’éloge des grands Hommes. Son mérite, dont il a forcé notre siecle à convenir, ne sera bien connu que quand le tems aura fait taire l’envie ; & son nom, cher à la partie de notre nation la plus éclairée, ne peut blesser ici personne. Mais dût-il déplaire à quelques prétendus Mécenes, un Philosophe seroit bien à plaindre, si même en matiere de sciences & de goût, il ne se permettoit pas de dire la vérité.
Voilà les biens que nous possédons. Quelle idée ne se formera-t-on pas de nos trésors littéraires, si l’on joint aux Ouvrages de tant de grands Hommes les travaux de toutes les Compagnies savantes, destinées à maintenir le goût des Sciences & des Lettres, & à qui nous devons tant d’excellens Livres ! De pareilles Sociétés ne peuvent manquer de produire dans un État de grands avantages ; pourvû qu’en les multipliant à l’excès, on n’en facilite point l’entrée à un trop grand nombre de gens médiocres ; qu’on en bannisse toute inégalité propre à éloigner ou à rebuter des hommes faits pour éclairer les autres ; qu’on n’y connoisse d’autre supériorité que celle du génie ; que la considération y soit le prix du travail ; enfin que les récompenses y viennent chercher les talens, & ne leur soient point enlevées par l’intrigue. Car il ne faut pas s’y tromper : on nuit plus aux progrès de l’esprit, en plaçant mal les récompenses qu’en les supprimant. Avoüons même à l’honneur des lettres, que les Savans n’ont pas toujours besoin d’être récompensés pour se multiplier. Témoin l’Angleterre, à qui les Sciences doivent tant, sans que le Gouvernement fasse rien pour elles. Il est vrai que la Nation les considere, qu’elle les respecte même ; & cette espece de récompense, supérieure à toutes les autres, est sans doute le moyen le plus sûr de faire fleurir les Sciences & les Arts ; parce que c’est le Gouvernement qui donne les places, & le Public qui distribue l’estime. L’amour des Lettres, qui est un mérite chez nos voisins, n’est encore à la vérité qu’une mode parmi nous, & ne sera peut-être jamais autre chose ; mais quelque dangereuse que soit cette mode, qui pour un Mécene éclairé produit cent Amateurs ignorans & orgueilleux, peut-être lui sommes-nous redevables de n’être pas encore tombés dans la barbarie où une foule de circonstances tendent à nous précipiter.
On peut regarder comme une des principales, cet amour du faux bel esprit, qui protege l’ignorance, qui s’en fait honneur, & qui la répandra universellement tôt ou tard. Elle sera le fruit & le terme du mauvais goût ; j’ajoûte qu’elle en sera le remede. Car tout a des révolutions reglées, & l’obscurité se terminera par un nouveau siecle de lumiere. Nous serons plus frappés du grand jour, après avoir été quelque tems dans les ténebres. Elles seront comme une espece d’anarchie très-funeste par elle-même, mais quelquefois utile par ses suites. Gardons-nous pourtant de souhaiter une révolution si redoutable ; la barbarie dure des siecles, il semble que ce soit notre élément ; la raison & le bon goût ne font que passer.
Ce seroit peut-être ici le lieu de repousser les traits qu’un Écrivain éloquent & philosophe[3] a lancé depuis peu contre les Sciences & les Arts, en les accusant de corrompre les mœurs. Il nous siéroit mal d’être de son sentiment à la tête d’un Ouvrage tel que celui-ci ; & l’homme de mérite dont nous parlons semble avoir donné son suffrage à notre travail par le zele & le succès avec lequel il y a concouru. Nous ne lui reprocherons point d’avoir confondu la culture de l’esprit avec l’abus qu’on en peut faire ; il nous répondroit sans doute que cet abus en est inséparable : mais nous le prierons d’examiner si la plûpart des maux qu’il attribue aux Sciences & aux Arts, ne sont point dûs à des causes toutes différentes, dont l’énumération seroit ici aussi longue que délicate. Les Lettres contribuent certainement à rendre la société plus aimable ; il seroit difficile de prouver que les hommes en sont meilleurs, & la vertu plus commune : mais c’est un privilége qu’on peut disputer à la Morale même ; & pour dire encore plus, faudra-t-il proscrire les lois, parce que leur nom sert d’abri à quelques crimes, dont les auteurs seroient punis dans une république de Sauvages ? Enfin, quand nous ferions ici au desavantage des connoissances humaines un aveu dont nous sommes bien éloignés, nous le sommes encore plus de croire qu’on gagnât à les détruire : les vices nous resteroient, & nous aurions l’ignorance de plus.
Finissons cette histoire des Sciences, en remarquant que les différentes formes de gouvernement qui influent tant sur les esprits & sur la culture des Lettres, déterminent aussi les especes de connoissances qui doivent principalement y fleurir, & dont chacune a son mérite particulier. Il doit y avoir en général dans une République plus d’Orateurs, d’Historiens, & de Philosophes ; & dans une Monarchie, plus de Poëtes, de Théologiens, & de Géometres. Cette regle n’est pourtant pas si absolue, qu’elle ne puisse être altérée & modifiée par une infinité de causes.
Aprés les réflexions & les vûes générales que nous avons crû devoir placer à la tête de cette Encyclopédie, il est tems enfin d’instruire plus particulierement le public sur l’Ouvrage que nous lui présentons. Le Prospectus qui a déjà été publié dans cette vûe, & dont M. Diderot mon collegue est l’Auteur, ayant été reçu de toute l’Europe avec les plus grands éloges, je vais en son nom le remettre ici de nouveau sous les yeux du Public, avec les changemens & les additions qui nous ont parû convenables à l’un & à l’autre.
On ne peut disconvenir que depuis le renouvellement des Lettres parmi nous, on ne doive en partie aux Dictionnaires les lumieres générales qui se sont répandues dans la société, & ce germe de Science qui dispose insensiblement les esprits à des connoissances plus profondes. L’utilité sensible de ces sortes d’ouvrages les a rendus si communs, que nous sommes plûtôt aujourd’hui dans le cas de les justifier que d’en faire l’éloge. On prétend qu’en multipliant les secours & la facilité de s’instruire, ils contribueront à éteindre le goût du travail & de l’étude. Pour nous, nous croyons être bien fondés à soûtenir que c’est à la manie du bel Esprit & à l’abus de la Philosophie, plûtôt qu’à la multitude des Dictionnaires, qu’il faut attribuer notre paresse & la décadence du bon goût. Ces sortes de collections peuvent tout au plus servir à donner quelques lumieres à ceux qui sans ce secours n’auroient pas eu le courage de s’en procurer : mais elles ne tiendront jamais lieu de Livres à ceux qui chercheront à s’instruire ; les Dictionnaires par leur forme même ne sont propres qu’à être consultés, & se refusent à toute lecture suivie. Quand nous apprendrons qu’un homme de Lettres, desirant d’étudier l’Histoire à fond, aura choisi pour cet objet le Dictionnaire de Moreri, nous conviendrons du reproche que l’on veut nous faire. Nous aurions peut-être plus de raison d’attribuer l’abus prétendu dont on se plaint, à la multiplication des méthodes, des élémens, des abregés, & des bibliotheques, si nous n’étions persuadés qu’on ne sauroit trop faciliter les moyens de s’instruire. On abrégeroit encore davantage ces moyens, en réduisant à quelques volumes tout ce que les hommes ont découvert jusqu’à nos jours dans les Sciences & dans les Arts. Ce projet, en y comprenant même les faits historiques réellement utiles, ne seroit peut-être pas impossible dans l’exécution ; il seroit du moins à souhaiter qu’on le tentât, nous ne prétendons aujourd’hui que l’ébaucher ; & il nous débarrasseroit enfin de tant de Livres, dont les Auteurs n’ont fait que se copier les uns les autres. Ce qui doit nous rassûrer contre la satyre des Dictionnaires, c’est qu’on pourroit faire le même reproche sur un fondement aussi peu solide aux Journalistes les plus estimables. Leur but n’est-il pas essentiellement d’exposer en raccourci ce que notre siecle ajoûte de lumieres à celles des siecles précédens ; d’apprendre à se passer des originaux, & d’arracher par conséquent ces épines que nos adversaires voudroient qu’on laissât ? Combien de lectures inutiles dont nous serions dispensés par de bons extraits ?
Nous avons donc crû qu’il importoit d’avoir un Dictionnaire qu’on pût consulter sur toutes les matieres des Arts & des Sciences, & qui servît autant à guider ceux qui se sentent le courage de travailler à l’instruction des autres, qu’à éclairer ceux qui ne s’instruisent que pour eux-mêmes.
Jusqu’ici personne n’avoit conçû un Ouvrage aussi grand, ou du moins personne ne l’avoit exécuté. Leibnitz, de tous les Savans le plus capable d’en sentir les difficultés, desiroit qu’on les surmontât. Cependant on avoit des Encyclopédies ; & Leibnitz ne l’ignoroit pas, lorsqu’il en demandoit une.
La plûpart de ces Ouvrages parurent avant le siecle dernier, & ne furent pas tout-à-fait méprisés. On trouva que s’ils n’annonçoient pas beaucoup de génie, ils marquoient au moins du travail & des connoissances. Mais que seroit-ce pour nous que ces Encyclopédies ? Quel progrès n’a-t-on pas fait depuis dans les Sciences & dans les Arts ? Combien de vérités découvertes aujourd’hui, qu’on n’entrevoyoit pas alors ? La vraie Philosophie étoit au berceau ; la Géométrie de l’Infini n’étoit pas encore ; la Physique expérimentale se montroit à peine ; il n’y avoit point de Dialectique ; les lois de la saine Critique étoient entierement ignorées. Les Auteurs célebres en tout genre dont nous avons parlé dans ce Discours, & leurs illustres disciples, ou n’existoient pas, ou n’avoient pas écrit. L’esprit de recherche & d’émulation n’animoit pas les Savans ; un autre esprit moins fécond peut-être, mais plus rare, celui de justesse & de méthode, ne s’étoit point soûmis les différentes parties de la Littérature ; & les Académies, dont les travaux ont porté si loin les Sciences & les Arts, n’étoient pas instituées.
Si les découvertes des grands hommes & des compagnies savantes, dont nous venons de parler, offrirent dans la suite de puissans secours pour former un Dictionnaire encyclopédique ; il faut avoüer aussi que l’augmentation prodigieuse des matieres rendit à d’autres égards un tel Ouvrage beaucoup plus difficile. Mais ce n’est point à nous à juger si les successeurs des premiers Encyclopédistes ont été hardis ou présomptueux ; & nous les laisserions tous joüir de leur réputation, sans en excepter Ephraïm Chambers le plus connu d’entre eux, si nous n’avions des raisons particulieres de peser le mérite de celui-ci.
L’Encyclopédie de Chambers dont on a publié à Londres un si grand nombre d’Éditions rapides ; cette Encyclopédie qu’on vient de traduire tout récemment en Italien, & qui de notre aveu mérite en Angleterre & chez l’étranger les honneurs qu’on lui rend, n’eût peut-être jamais été faite, si avant qu’elle parût en Anglois, nous n’avions eu dans notre Langue des Ouvrages où Chambers a puisé sans mesure & sans choix la plus grande partie des choses dont il a composé son Dictionnaire. Qu’en auroient donc pensé nos François sur une traduction pure & simple ? Il eût excité l’indignation des Savans & le cri du Public, à qui on n’eût présenté sous un titre fastueux & nouveau, que des richesses qu’il possédoit depuis long-tems.
Nous ne refusons point à cet Auteur la justice qui lui est dûe. Il a bien senti le mérite de l’ordre encyclopédique, ou de la chaîne par laquelle on peut descendre sans interruption des premiers principes d’une Science ou d’un Art jusqu’à ses conséquences les plus éloignées, & remonter de ses conséquences les plus éloignées jusqu’à ses premiers principes ; passer imperceptiblement de cette Science ou de cet Art à un autre, & s’il est permis de s’exprimer ainsi, faire sans s’égarer le tour du monde littéraire. Nous convenons avec lui que le plan & le dessein de son Dictionnaire sont excellens, & que si l’exécution en étoit portée à un certain degré de perfection, il contribueroit plus lui seul aux progrès de la vraie Science que la moitié des Livres connus. Mais, malgré toutes les obligations que nous avons à cet Auteur, & l’utilité considérable que nous avons retirée de son travail, nous n’avons pû nous empêcher de voir qu’il restoit beaucoup à y ajoûter. En effet, conçoit-on que tout ce qui concerne les Sciences & les Arts puisse être renfermé en deux Volumes in-folio ? La nomenclature d’une matiere aussi étendue en fourniroit un elle seule, si elle étoit complette. Combien donc ne doit-il pas y avoir dans son Ouvrage d’articles omis ou tronqués ?
Ce ne sont point ici des conjectures. La Traduction entiere du Chambers nous a passé sous les yeux, & nous avons trouvé une multitude prodigieuse de choses à desirer dans les Sciences ; dans les Arts libéraux, un mot où il falloit des pages ; & tout à suppléer dans les Arts méchaniques. Chambers a lû des Livres, mais il n’a guere vû d’artistes ; cependant il y a beaucoup de choses qu’on n’apprend que dans les atteliers. D’ailleurs il n’en est pas ici des omissions comme dans un autre Ouvrage. Un article omis dans un Dictionnaire commun le rend seulement imparfait. Dans une Encyclopédie, il rompt l’enchaînement, & nuit à la forme & au fond ; & il a fallu tout l’art d’Ephraim Chambers pour pallier ce défaut.
Mais, sans nous étendre davantage sur l’Encyclopédie Angloise, nous annonçons que l’Ouvrage de Chambers n’est point la base unique sur laquelle nous avons élevé ; que l’on a refait un grand nombre de ses articles ; que l’on n’a employé presqu’aucun des autres sans addition, correction, ou retranchement, & qu’il rentre simplement dans la classe des Auteurs que nous avons particulierement consultés. Les éloges qui furent donnés il y a six ans au simple projet de la Traduction de l’Encyclopédie Angloise, auroient été pour nous un motif suffisant d’avoir recours à cette Encyclopédie, autant que le bien de notre Ouvrage n’en souffriroit pas.
La Partie Mathématique est celle qui nous a parû mériter le plus d’être conservée : mais on jugera par les changemens considérables qui y ont été faits, du besoin que cette Partie & les autres avoient d’une exacte révision.
Le premier objet sur lequel nous nous sommes écartés de l’Auteur Anglois, c’est l’Arbre généalogique qu’il a dressé des Sciences & des Arts, & auquel nous avons crû devoir en substituer un autre. Cette partie de notre travail a été suffisamment développée plus haut. Elle présente à nos lecteurs le canevas d’un Ouvrage qui ne se peut exécuter qu’en plusieurs Volumes in-folio, & qui doit contenir un jour toutes les connoissances des hommes.
À l’aspect d’une matiere aussi étendue, il n’est personne qui ne fasse avec nous la réflexion suivante. L’expérience journaliere n’apprend que trop combien il est difficile à un Auteur de traiter profondément de la Science ou de l’Art dont il a fait toute sa vie une étude particuliere. Quel homme peut donc être assez hardi & assez borné pour entreprendre de traiter seul de toutes les Sciences & de tous les Arts ?
Nous avons inféré de-là que pour soûtenir un poids aussi grand que celui que nous avions à porter, il étoit nécessaire de le partager ; & sur le champ nous avons jetté les yeux sur un nombre suffisant de Savans & d’Artistes ; d’Artistes habiles & connus par leurs talens ; de Savans exercés dans les genres particuliers qu’on avoit à confier à leur travail. Nous avons distribué à chacun la partie qui lui convenoit ; quelques-uns même étoient en possession de la leur, avant que nous nous chargeassions de cet Ouvrage. Le Public verra bientôt leurs noms, & nous ne craignons point qu’il nous les reproche. Ainsi, chacun n’ayant été occupé que de ce qu’il entendoit, a été en état de juger sainement de ce qu’en ont écrit les Anciens & les Modernes, & d’ajoûter aux secours qu’il en a tirés, des connoissances puisées dans son propre fonds. Personne ne s’est avancé sur le terrein d’autrui, & ne s’est mêlé de ce qu’il n’a peut-être jamais appris ; & nous avons eu plus de méthode, de certitude, d’étendue, & de détails, qu’il ne peut y en avoir dans la plûpart des Lexicographes. Il est vrai que ce plan a réduit le mérite d’Éditeur à peu de chose ; mais il a beaucoup ajoûté à la perfection de l’Ouvrage, & nous penserons toûjours nous être acquis assez de gloire, si le Public est satisfait. En un mot, chacun de nos Collègues a fait un Dictionnaire de la Partie dont il s’est chargé, & nous avons réuni tous ces Dictionnaires ensemble.
Nous croyons avoir eu de bonnes raisons pour suivre dans cet Ouvrage l’ordre alphabétique. Il nous a paru plus commode & plus facile pour nos lecteurs, qui desirant de s’instruire sur la signification d’un mot, le trouveront plus aisément dans un Dictionnaire alphabétique que dans tout autre. Si nous eussions traité toutes les Sciences séparément, en faisant de chacune un Dictionnaire particulier, non seulement le prétendu desordre de la succession alphabétique auroit eu lieu dans ce nouvel arrangement ; mais une telle méthode auroit été sujette à des inconvéniens considérables par le grand nombre de mots communs à différentes Sciences, & qu’il auroit fallu répéter plusieurs fois, ou placer au hasard. D’un autre côté, si nous eussions traité de chaque Science séparément & dans un discours suivi, conforme à l’ordre des idées, & non à celui des mots, la forme de cet Ouvrage eût été encore moins commode pour le plus grand nombre de nos lecteurs, qui n’y auroient rien trouvé qu’avec peine ; l’ordre encyclopédique des Sciences & des Arts y eût peu gagné, & l’ordre encyclopédique des mots, ou plûtôt des objets par lesquels les Sciences se communiquent & se touchent, y auroit infiniment perdu. Au contraire, rien de plus facile dans le plan que nous avons suivi que de satisfaire à l’un & à l’autre ; c’est ce que nous avons détaillé ci-dessus. D’ailleurs, s’il eût été question de faire de chaque Science & de chaque Art un traité particulier dans la forme ordinaire, & de réunir seulement ces différens traités sous le titre d’Encyclopédie, il eût été bien plus difficile de rassembler pour cet Ouvrage un si grand nombre de personnes, & la plûpart de nos Collegues auroient sans doute mieux aimé donner séparément leur Ouvrage, que de le voir confondu avec un grand nombre d’autres. De plus, en suivant ce dernier plan, nous eussions été forcés de renoncer presque entierement à l’usage que nous voulions faire de l’Encyclopédie Angloise, entraînés tant par la réputation de cet Ouvrage, que par l’ancien Prospectus, approuvé du Public, & auquel nous desirions de nous conformer. La Traduction entiere de cette Encyclopédie nous a été remise entre les mains par les Libraires qui avoient entrepris de la publier ; nous l’avons distribuée à nos Collegues qui ont mieux aimé se charger de la revoir, de la corriger, & de l’augmenter, que de s’engager, sans avoir, pour ainsi dire, aucuns matériaux préparatoires. Il est vrai qu’une grande partie de ces matériaux leur a été inutile, mais du moins elle a servi à leur faire entreprendre plus volontiers le travail qu’on espéroit d’eux ; travail auquel plusieurs se seroient peut-être refusé, s’ils avoient prévû ce qu’il devoit leur coûter de soins. D’un autre côté, quelques-uns de ces Savans, en possession de leur Partie long-tems avant que nous fussions Éditeurs, l’avoient déja fort avancée en suivant l’ancien projet de l’ordre alphabétique ; il nous eût par conséquent été impossible de changer ce projet, quand même nous aurions été moins disposés à l’approuver. Nous savions enfin, ou du moins nous avions lieu de croire qu’on n’avoit fait à l’Auteur Anglois, notre modele, aucunes difficultés sur l’ordre alphabétique auquel il s’étoit assujetti. Tout se réunissoit donc pour nous obliger de rendre cet Ouvrage conforme à un plan que nous aurions suivi par choix, si nous en eussions été les maîtres.
La seule opération dans notre travail qui suppose quelque intelligence, consiste à remplir les vuides qui séparent deux Sciences ou deux Arts, & à renoüer la chaîne dans les occasions où nos Collegues se sont reposés les uns sur les autres de certains articles, qui paroissant appartenir également à plusieurs d’entre eux, n’ont été faits par aucun. Mais afin que la personne chargée d’une partie ne soit point comptable des fautes qui pourroient se glisser dans des morceaux surajoûtés, nous aurons l’attention de distinguer ces morceaux par une étoile. Nous tiendrons exactement la parole que nous avons donnée ; le travail d’autrui sera sacré pour nous, & nous ne manquerons pas de consulter l’Auteur, s’il arrive dans le cours de l’Édition que son ouvrage nous paroisse demander quelque changement considérable.
Les différentes mains que nous avons employées ont apposé à chaque article comme le sceau de leur style particulier, ainsi que celui du style propre à la matiere & à l’objet d’une partie. Un procédé de Chimie ne sera point du même ton que la description des bains & des théatres anciens, ni la manœuvre d’un Serrurier, exposée comme les recherches d’un Théologien, sur un point de dogme ou de discipline. Chaque chose a son coloris, & ce seroit confondre les genres que de les réduire à une certaine uniformité. La pureté du style, la clarté, & la précision, sont les seules qualités qui puissent être communes à tous les articles, & nous espérons qu’on les y remarquera. S’en permettre davantage, ce seroit s’exposer à la monotonie & au dégoût qui sont presque inséparables des Ouvrages étendus, & que l’extrême variété des matieres doit écarter de celui-ci.
Nous en avons dit assez pour instruire le Public de la nature d’une entreprise à laquelle il a paru s’intéresser ; des avantages généraux qui en résulteront, si elle est bien exécutée ; du bon ou du mauvais succès de ceux qui l’ont tentée avant nous ; de l’étendue de son objet ; de l’ordre auquel nous nous sommes assujettis ; de la distribution qu’on a faite de chaque partie, & de nos fonctions d’Éditeurs. Nous allons maintenant passer aux principaux détails de l’exécution.
Toute la matiere de l’Encyclopédie peut se réduire à trois chefs ; les Sciences, les Arts libéraux, & les Arts méchaniques. Nous commencerons par ce qui concerne les Sciences & les Arts libéraux ; & nous finirons par les Arts méchaniques.
On a beaucoup écrit sur les Sciences. Les traités sur les Arts libéraux se sont multipliés sans nombre ; la république des Lettres en est inondée. Mais combien peu donnent les vrais principes ? Combien d’autres les noyent dans une affluence de paroles, ou les perdent dans des ténebres affectées ? Combien dont l’autorité en impose, & chez qui une erreur placée à côté d’une vérité, ou décrédite celle-ci, ou s’accrédite elle-même à la faveur de ce voisinage ? On eût mieux fait sans doute d’écrire moins & d’écrire mieux.
Entre tous les Écrivains, on a donné la préférence à ceux qui sont généralement reconnus pour les meilleurs. C’est de-là que les principes ont été tirés. À leur exposition claire & précise, on a joint des exemples ou des autorités constamment reçûes. La coûtume vulgaire est de renvoyer aux sources, ou de citer d’une maniere vague, souvent infidelle, & presque toûjours confuse ; ensorte que dans les différentes parties dont un article est composé, on ne sait exactement quel Auteur on doit consulter sur tel ou tel point, ou s’il faut les consulter tous, ce qui rend la vérification longue & pénible. On s’est attaché, autant qu’il a été possible, à éviter cet inconvénient, en citant dans le corps même des articles les Auteurs sur le témoignage desquels on s’est appuyé ; rapportant leur propre texte quand il est nécessaire ; comparant par-tout les opinions ; balançant les raisons ; proposant des moyens de douter ou de sortir de doute ; décidant même quelquefois ; détruisant autant qu’il est en nous les erreurs & les préjugés ; & tâchant sur-tout de ne les pas multiplier, & de ne les point perpétuer, en protégeant sans examen des sentimens rejettés, ou en proscrivant sans raison des opinions reçûes. Nous n’avons pas craint de nous étendre quand l’intérêt de la vérité & l’importance de la matiere le demandoient, sacrifiant l’agrément toutes les fois qu’il n’a pû s’accorder avec l’instruction.
Nous ferons ici sur les définitions une remarque importante. Nous nous sommes conformés dans les articles généraux des Sciences à l’usage constamment reçû dans les Dictionnaires & dans les autres Ouvrages, qui veut qu’on commence en traitant d’une Science par en donner la définition. Nous l’avons donnée aussi, la plus simple même & la plus courte qu’il nous a été possible. Mais il ne faut pas croire que la définition d’une Science, sur-tout d’une Science abstraite, en puisse donner l’idée à ceux qui n’y sont pas du moins initiés. En effet, qu’est-ce qu’une Science ? sinon un système de regles ou de faits relatifs à un certain objet ; & comment peut-on donner l’idée de ce système à quelqu’un qui seroit absolument ignorant de ce que le système renferme ? Quand on dit de l’Arithmétique, que c’est la Science des propriétés des nombres, la fait-on mieux connoître à celui qui ne la sait pas, qu’on ne feroit connoître la pierre philosophale, en disant que c’est le secret de faire de l’or ? La définition d’une Science ne consiste proprement que dans l’exposition détaillée des choses dont cette Science s’occupe, comme la définition d’un corps est la description détaillée de ce corps même ; & il nous semble d’après ce principe, que ce qu’on appelle définition de chaque Science seroit mieux placé à la fin qu’au commencement du livre qui en traite : ce seroit alors le résultat extrèmement réduit de toutes les notions qu’on auroit acquises. D’ailleurs, que contiennent ces définitions pour la plûpart, sinon des expressions vagues & abstraites, dont la notion est souvent plus difficile à fixer que celles de la Science même ? Tels sont les mots, science, nombre, & propriété, dans la définition déjà citée de l’Arithmétique. Les termes généraux sans doute sont nécessaires, & nous avons vû dans ce Discours quelle en est l’utilité : mais on pourroit les définir, un abus forcé des signes, & la plûpart des définitions, un abus tantôt volontaire, tantôt forcé des termes généraux. Au reste nous le répétons : nous nous sommes conformés sur ce point l’usage, parce que ce n’est pas à nous à le changer, & que la forme même de ce Dictionnaire nous en empêchoit. Mais en ménageant les préjugés, nous n’avons point dû appréhender d’exposer ici des idées que nous croyons saines. Continuons à rendre compte de notre Ouvrage.
L’empire des Sciences & des Arts est un monde éloigné du vulgaire où l’on fait tous les jours des découvertes, mais dont on a bien des relations fabuleuses. Il étoit important d’assûrer les vraies, de prévenir sur les fausses, de fixer des points d’où l’on partît, & de faciliter ainsi la recherche de ce qui reste à trouver. On ne cite des faits, on ne compare des expériences, on n’imagine des méthodes, que pour exciter le génie à s’ouvrir des routes ignorées, & à s’avancer à des découvertes nouvelles, en regardant comme le premier pas celui où les grands hommes ont terminé leur course. C’est aussi le but que nous nous sommes proposé, en alliant aux principes des Sciences & des Arts libéraux l’histoire de leur origine & de leurs progrès successifs ; & si nous l’avons atteint, de bons esprits ne s’occuperont plus à chercher ce qu’on savoit avant eux. Il sera facile dans les productions à venir sur les Sciences & sur les Arts libéraux de démêler ce que les inventeurs ont tiré de leur fonds d’avec ce qu’ils ont emprunté de leurs prédécesseurs : on apprétiera les travaux ; & ces hommes avides de réputation & dépourvûs de génie, qui publient hardiment de vieux systèmes comme des idées nouvelles, seront bientôt démasqués. Mais, pour parvenir à ces avantages, il a fallu donner à chaque matiere une étendue convenable, insister sur l’essentiel, négliger les minuties, & éviter un défaut assez commun, celui de s’appesantir sur ce qui ne demande qu’un mot, de prouver ce qu’on ne conteste point, & de commenter ce qui est clair. Nous n’avons ni épargné, ni prodigué les éclaircissemens. On jugera qu’ils étoient nécessaires par-tout où nous en avons mis, & qu’ils auroient été superflus où l’on n’en trouvera pas. Nous nous sommes encore bien gardés d’accumuler les preuves où nous avons crû qu’un seul raisonnement solide suffisoit, ne les multipliant que dans les occasions où leur force dépendoit de leur nombre & de leur concert.
Les articles qui concernent les élémens des Sciences ont été travaillés avec tout le soin possible ; ils sont en effet la base & le fondement des autres. C’est par cette raison que les élémens d’une Science ne peuvent être bien faits que par ceux qui ont été fort loin au-delà ; car ils renferment le système des principes généraux qui s’étendent aux différentes parties de la Science ; & pour connoître la maniere la plus favorable de présenter ces principes, il faut en avoir fait une application très-étendue & très-variée.
Ce sont-là toutes les précautions que nous avions à prendre. Voilà les richesses sur lesquelles nous pouvions compter : mais il nous en est survenu d’autres que notre entreprise doit, pour ainsi dire, à sa bonne fortune. Ce sont des manuscrits qui nous ont été communiqués par des Amateurs, ou fournis par des Savans, entre lesquels nous nommerons ici M. Formey, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse. Cet illustre Académicien avoit médité un Dictionnaire tel à peu-près que le nôtre, & il nous a généreusement sacrifié la partie considérable qu’il en avoit exécutée, & dont nous ne manquerons pas de lui faire honneur. Ce sont encore des recherches, des observations, que chaque Artiste ou Savant, chargé d’une partie de notre Dictionnaire, renfermoit dans son cabinet, & qu’il a bien voulu publier par cette voie. De ce nombre seront presque tous les articles de Grammaire générale & particuliere. Nous croyons pouvoir assûrer qu’aucun Ouvrage connu ne sera ni aussi riche, ni aussi instructif que le nôtre sur les regles & les usages de la Langue Françoise, & même sur la nature, l’origine & le philosophique des Langues en général. Nous ferons donc part au Public, tant sur les Sciences que sur les Arts libéraux, de plusieurs fonds littéraires dont il n’auroit peut-être jamais eu connoissance.
Mais ce qui ne contribuera guere moins à la perfection de ces deux branches importantes, ce sont les secours obligeans que nous avons reçûs de tous côtés ; protection de la part des Grands, accueil & communication de la part de plusieurs Savans ; bibliotheques publiques, cabinets particuliers, recueils, portefeuilles, &c. tout nous a été ouvert, & par ceux qui cultivent les Lettres, & par ceux qui les aiment. Un peu d’adresse & beaucoup de dépense ont procuré ce qu’on n’a pû obtenir de la pure bienveillance ; & les récompenses ont presque toûjours calmé, ou les inquiétudes réelles, ou les allarmes simulées de ceux que nous avions à consulter.
Nous sommes principalement sensibles aux obligations que nous avons à M. l’Abbé Sallier, Garde de la Bibliotheque du Roi : il nous a permis, avec cette politesse qui lui est naturelle, & qu’animoit encore le plaisir de favoriser une grande entreprise, de choisir dans le riche fonds dont il est dépositaire, tout ce qui pouvoit répandre de la lumiere ou des agrémens sur notre Encyclopédie. On justifie, nous pourrions même dire qu’on honore le choix du Prince, quand on sait se prêter ainsi à ses vûes. Les Sciences & les Beaux-Arts ne peuvent donc trop concourir à illustrer par leurs productions le regne d’un Souverain qui les favorise. Pour nous, spectateurs de leurs progrès & leurs historiens, nous nous occuperons seulement à les transmettre à la postérité. Qu’elle dise à l’ouverture de notre Dictionnaire, tel étoit alors l’état des Sciences & des Beaux-Arts. Qu’elle ajoûte ses découvertes à celles que nous aurons enregistrées, & que l’histoire de l’esprit humain & de ses productions aille d’âge en âge jusqu’aux siecles les plus reculés. Que l’Encyclopédie devienne un sanctuaire où les connoissances des hommes soient à l’abri des tems & des révolutions, Ne serons-nous pas trop flatés d’en avoir posé les fondemens ? Quel avantage n’auroit-ce pas été pour nos peres & pour nous, si les travaux des Peuples anciens, des Égyptiens, des Chaldéens, des Grecs, des Romains, &c. avoient été transmis dans un Ouvrage encyclopédique, qui eût exposé en même tems les vrais principes de leurs Langues ! Faisons donc pour les siecles à venir ce que nous regrettons que les siecles passés n’ayent pas fait pour le nôtre. Nous osons dire que si les Anciens eussent exécuté une Encyclopédie, comme ils ont exécuté tant de grandes choses, & que ce manuscrit se fût échappé seul de la fameuse bibliotheque d’Alexandrie, il eût été capable de nous consoler de la perte des autres.
Voilà ce que nous avions à exposer au Public sur les Sciences & les Beaux-Arts. La partie des Arts méchaniques ne demandoit ni moins de détails, ni moins de soins. Jamais peut-être il ne s’est trouvé tant de difficultés rassemblées, & si peu de secours dans les Livres pour les vaincre. On a trop écrit sur les Sciences : on n’a pas assez bien écrit sur la plûpart des Arts libéraux ; on n’a presque rien écrit sur les Arts méchaniques ; car qu’est-ce que le peu qu’on en rencontre dans les Auteurs, en comparaison de l’étendue & de la fécondité du sujet ? Entre ceux qui en ont traité, l’un n’étoit pas assez instruit de ce qu’il avoit à dire, & a moins rempli son sujet que montré la nécessité d’un meilleur Ouvrage. Un autre n’a qu’effleuré la matiere, en la traitant plûtôt en Grammairien & en homme de Lettres, qu’en Artiste. Un troisieme est à la vérité plus riche & plus ouvrier : mais il est en même tems si court, que les opérations des Artistes & la description de leurs machines, cette matiere capable de fournir seule des Ouvrages considérables, n’occupe que la très-petite partie du sien. Chambers n’a presque rien ajoûté à ce qu’il a traduit de nos Auteurs. Tout nous déterminoit donc à recourir aux ouvriers.
On s’est adressé aux plus habiles de Paris & du Royaume ; on s’est donné la peine d’aller dans leurs atteliers, de les interroger, d’écrire sous leur dictée, de développer leurs pensées, d’en tirer les termes propres à leurs professions, d’en dresser des tables, de les définir, de converser avec ceux de qui on avoit obtenu des mémoires, & (précaution presqu’indispensable) de rectifier dans de longs & fréquens entretiens avec les uns, ce que d’autres avoient imparfaitement, obscurément, & quelquefois infidellement expliqué. Il est des Artistes qui sont en même tems gens de Lettres, & nous en pourrions citer ici : mais le nombre en seroit fort petit. La plûpart de ceux qui exercent les Arts méchaniques, ne les ont embrassés que par nécessité, & n’operent que par instinct. A peine entre mille en trouve-t-on une douzaine en état de s’exprimer avec quelque clarté sur les instrumens qu’ils employent & sur les ouvrages qu’ils fabriquent. Nous avons vû des ouvriers qui travaillent depuis quarante années, sans rien connoître à leurs machines. Il a fallu exercer avec eux la fonction dont se glorifioit Socrate, la fonction pénible & délicate de faire accoucher les esprits, obstetrix animorum.
Mais il est des métiers si singuliers & des manœuvres si déliées, qu’à moins de travailler soi-même, de mouvoir une machine de ses propres mains, & de voir l’ouvrage se former sous ses propres yeux, il est difficile d’en parler avec précision. Il a donc fallu plusieurs fois se procurer les machines, les construire, mettre la main à l’œuvre, se rendre, pour ainsi dire, apprentif, & faire soi-même de mauvais ouvrages pour apprendre aux autres comment on en fait de bons.
C’est ainsi que nous nous sommes convaincus de l’ignorance dans laquelle on est sur la plûpart des objets de la vie, & de la difficulté de sortir de cette ignorance. C’est ainsi que nous nous sommes mis en état de démontrer que l’homme de Lettres qui sait le plus sa Langue, ne connoît pas la vingtieme partie des mots ; que quoique chaque Art ait la sienne, cette langue est encore bien imparfaite ; que c’est par l’extrème habitude de converser les uns avec les autres, que les ouvriers s’entendent, & beaucoup plus par le retour des conjonctures que par l’usage des termes. Dans un attelier c’est le moment qui parle, & non l’artiste.
Voici la méthode qu’on a suivie pour chaque Art. On a traité, 1.o de la matiere, des lieux où elle se trouve, de la maniere dont on la prépare, de ses bonnes & mauvaises qualités, de ses différentes especes, des opérations par lesquelles on la fait passer, soit avant que de l’employer, soit en la mettant en œuvre.
2.o Des principaux ouvrages qu’on en fait, & de la maniere de les faire.
3.o On a donné le nom, la description, & la figure des outils & des machines, par pieces détachées & par pieces assemblées ; la coupe des moules & d’autres instrumens, dont il est à propos de connoître l’intérieur, leurs profils, &c.
4.o On a expliqué & représenté la main-d’œuvre & les principales opérations dans une ou plusieurs Planches, où l’on voit tantôt les mains seules de l’artiste, tantôt l’artiste entier en action, & travaillant à l’ouvrage le plus important de son art.
5.o On a recueilli & défini le plus exactement qu’il a été possible les termes propres de l’art.
Mais le peu d’habitude qu’on a & d’écrire, & de lire des écrits sur les Arts, rend les choses difficiles à expliquer d’une maniere intelligible. De-là naît le besoin de Figures. On pourroit démontrer par mille exemples, qu’un Dictionnaire pur & simple de définitions, quelque bien qu’il soit fait, ne peut se passer de figures, sans tomber dans des descriptions obscures ou vagues ; combien donc à plus forte raison ce secours ne nous étoit-il pas nécessaire ? Un coup d’œil sur l’objet ou sur sa représentation en dit plus qu’une page de discours.
On a envoyé des Dessinateurs dans les atteliers. On a pris l’esquisse des machines & des outils. On n’a rien omis de ce qui pouvoit les montrer distinctement aux yeux. Dans le cas où une machine mérite des détails par l’importance de son usage & par la multitude de ses parties, on a passé du simple au composé. On a commencé par assembler dans une premiere figure autant d’élémens qu’on en pouvoit appercevoir sans confusion. Dans une seconde figure, on voit les mêmes élémens avec quelques autres. C’est ainsi qu’on a formé successivement la machine la plus compliquée, sans aucun embarras ni pour l’esprit ni pour les yeux. Il faut quelquefois remonter de la connoissance de l’ouvrage à celle de la machine, & d’autres fois descendre de la connoissance de la machine à celle de l’ouvrage. On trouvera à l’article Art quelques réflexions sur les avantages de ces méthodes, & sur les occasions où il est à propos de préférer l’une à l’autre.
Il y a des notions qui sont communes à presque tous les hommes, & qu’ils ont dans l’esprit avec plus de clarté qu’elles n’en peuvent recevoir du discours. Il y a aussi des objets si familiers, qu’il seroit ridicule d’en faire des figures. Les Arts en offrent d’autres si composés, qu’on les représenteroit inutilement. Dans les deux premiers cas, nous avons supposé que le lecteur n’étoit pas entierement dénué de bon sens & d’expérience ; & dans le dernier, nous renvoyons à l’objet même. Il est en tout un juste milieu, & nous avons tâché de ne le point manquer ici. Un seul art dont on voudroit tout représenter & tout dire, fourniroit des volumes de discours & de planches. On ne finiroit jamais si l’on se proposoit de rendre en figures tous les états par lesquels passe un morceau de fer avant que d’être transformé en aiguille. Que le discours suive le procédé de l’artiste dans le dernier détail, à la bonne heure. Quant aux figures, nous les avons restraintes aux mouvemens importans de l’ouvrier & aux seuls momens de l’opération, qu’il est très-facile de peindre & très-difficile d’expliquer. Nous nous en sommes tenus aux circonstances essentielles, à celles dont la représentation, quand elle est bien faite, entraîne nécessairement la connoissance de celles qu’on ne voit pas. Nous n’avons pas voulu ressembler à un homme qui feroit planter des guides à chaque pas dans une route, de crainte que les voyageurs ne s’en écartassent. Il suffit qu’il y en ait par-tout où ils seroient exposés à s’égarer.
Au reste, c’est la main-d’œuvre qui fait l’artiste, & ce n’est point dans les Livres qu’on peut apprendre à manœuvrer. L’artiste rencontrera seulement dans notre Ouvrage des vûes qu’il n’eût peut-être jamais eues, & des observations qu’il n’eût faites qu’après plusieurs années de travail. Nous offrirons au lecteur studieux ce qu’il eût appris d’un artiste en le voyant opérer, pour satisfaire sa curiosité ; & à l’artiste, ce qu’il seroit à souhaiter qu’il apprit du Philosophe pour s’avancer à la perfection.
Nous avons distribué dans les Sciences & dans les Arts libéraux les figures & les Planches, selon le même esprit & la même œconomie que dans les Arts méchaniques ; cependant nous n’avons pû réduire le nombre des unes & des autres, à moins de six cens. Les deux volumes qu’elles formeront ne seront pas la partie la moins intéressante de l’Ouvrage, par l’attention que nous aurons de placer au verso d’une Planche l’explication de celle qui sera vis-à-vis, avec des renvois aux endroits du Dictionnaire auxquels chaque figure sera relative. Un lecteur ouvre un volume de Planches, il apperçoit une machine qui pique sa curiosité : c’est, si l’on veut, un moulin à poudre, à papier, à soie, à sucre, &c. il lira vis-à-vis, figure 50. 51. ou 60. &c. moulin à poudre, moulin à sucre, moulin à papier, moulin à soie, &c. il trouvera ensuite une explication succincte de ces machines avec les renvois aux articles Poudre, Papier, Sucre, Soie, &c.
La Gravure répondra à la perfection des desseins, & nous espérons que les Planches de notre Encyclopédie surpasseront autant en beauté celles du Dictionnaire Anglois, qu’elles les surpassent en nombre. Chambers a trente Planches ; l’ancien projet en promettoit cent vingt, & nous en donnerons six cens au moins. Il n’est pas étonnant que la carriere se soit étendue sous nos pas ; elle est immense, & nous ne nous flatons pas de l’avoir parcourue.
Malgré les secours & les travaux dont nous venons de rendre compte, nous déclarons sans peine, au nom de nos Collegues & au nôtre, qu’on nous trouvera toûjours disposés à convenir de notre insuffisance, & à profiter des lumieres qui nous seront communiquées. Nous les recevrons avec reconnoissance, & nous nous y conformerons avec docilité, tant nous sommes persuadés que la perfection derniere d’une Encyclopédie est l’ouvrage des siecles. Il a fallu des siecles pour commencer ; il en faudra pour finir : mais nous serons satisfaits d’avoir contribué à jetter les fondemens d’un Ouvrage utile.
Nous aurons toûjours la satisfaction intérieure de n’avoir rien épargné pour réussir : une des preuves que nous en apporterons, c’est qu’il y a des parties dans les Sciences & dans les Arts qu’on a refaites jusqu’à trois fois. Nous ne pouvons nous dispenser de dire à l’honneur des Libraires associés, qu’ils n’ont jamais refusé de se préter à ce qui pouvoit contribuer à les perfectionner toutes. Il faut espérer que le concours d’un aussi grand nombre de circonstances, telles que les lumieres de ceux qui ont travaillé à l’Ouvrage, les secours des personnes qui s’y sont intéressées, & l’émulation des Éditeurs & des Libraires, produira quelque bon effet.
De tout ce qui précede, il s’ensuit que dans l’Ouvrage que nous annonçons, on a traité des Sciences & des Arts, de maniere qu’on n’en suppose aucune connoissance préliminaire ; qu’on y expose ce qu’il importe de savoir sur chaque matiere ; que les articles s’expliquent les uns par les autres, & que par conséquent la difficulté de la nomenclature n’embarrasse nulle part. D’où nous inférerons que cet Ouvrage pourra, du moins un jour, tenir lieu de bibliotheque dans tous les genres à un homme du monde ; & dans tous les genres, excepté le sien, à un Savant de profession ; qu’il développera les vrais principes des choses ; qu’il en marquera les rapports ; qu’il contribuera à la certitude & au progrès des connoissances humaines ; & qu’en multipliant le nombre des vrais Savans, des Artistes distingués, & des Amateurs éclairés, il répandra dans la société de nouveaux avantages.
Il ne nous reste plus qu’à nommer les Savans à qui le Public doit cet Ouvrage autant qu’à nous. Nous suivrons autant qu’il est possible, en les nommant, l’ordre encyclopédique des matieres dont ils se sont chargés. Nous avons pris ce parti, pour qu’il ne paroisse point que nous cherchions à assigner entr’eux aucune distinction de rang & de mérite. Les articles de chacun seront désignés dans le corps de l’Ouvrage par des lettres particulieres, dont on trouvera la liste immédiatement après ce Discours.
Nous devons l’Histoire Naturelle à M. Daubenton, Docteur en Medecine, de l’Académie Royale des Sciences, Garde & Démonstrateur du Cabinet d’Histoire naturelle, recueil immense, rassemblé avec beaucoup d’intelligence & de soin, & qui dans des mains aussi habiles ne peut manquer d’être porté au plus haut degré de perfection. M. Daubenton est le digne collegue de M. de Buffon dans le grand Ouvrage sur l’Histoire Naturelle, dont les trois premiers volumes déjà publiés, ont eu successivement trois éditions rapides, & dont le Public attend la suite avec impatience. On a donné dans le Mercure de Mars 1751 l’article Abeille, que M. Daubenton a fait pour l’Encyclopédie, & le succès général de cet article nous a engagé à insérer dans le second volume du Mercure de Juin 1751 l’article Agate. On a vû par ce dernier que M. Daubenton sait enrichir l’Encyclopédie par des remarques & des vûes nouvelles & importantes sur la partie dont il s’est chargé, comme on a vû dans l’article Abeille la précision & la netteté avec lesquelles il sait présenter ce qui est connu.
La Théologie est de M. Mallet, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, de la Maison & Société de Navarre, & Professeur royal en Théologie à Paris. Son savoir & son mérite seul, sans aucune sollicitation de sa part, l’ont fait nommer à la chaire qu’il occupe, ce qui n’est pas un petit éloge dans le siecle où nous vivons. M. l’Abbé Mallet est aussi l’Auteur de tous les articles d’Histoire ancienne & moderne, matiere dans laquelle il est très-versé, comme on le verra bien-tôt par l’Ouvrage important & curieux qu’il prépare en ce genre. Au reste, on observera que les articles d’Histoire de notre Encyclopédie ne s’étendent pas aux noms de Rois, de Savans, & de Peuples, qui sont l’objet particulier du Dictionnaire de Moreri, & qui auroient presque doublé le nôtre. Enfin, nous devons encore à M. l’Abbé Mallet tous les articles qui concernent la Poësie, l’Eloquence, & en général la Littérature. Il a déjà publié en ce genre deux Ouvrages utiles & remplis de réflexions judicieuses. L’un est son Essai sur l’étude des Belles-Lettres, & l’autre ses Principes pour la lecture des Poëtes. On voit par le détail où nous venons d’entrer, combien M. l’Abbé Mallet par la variété de ses connoissances & de ses talens, a été utile à ce grand Ouvrage & combien l’Encyclopédie lui a d’obligation. Elle ne pouvoit lui en trop avoir.
La Grammaire est de M. du Marsais, qu’il suffit de nommer.
La Métaphysique, la Logique, & la Morale, de M. l’Abbé Yvon, Métaphysicien profond, & ce qui est encore plus rare, d’une extrème clarté. On peut en juger par les articles qui sont de lui dans ce premier volume, entr’autres par l’article Agir auquel nous renvoyons, non par préférence ; mais parce qu’étant court, il peut faire juger en un moment combien la Philosophie de M. l’Abbé Yvon est saine, & sa Métaphysique nette & précise. M. l’Abbé Pestré, digne par son savoir & par son mérite de seconder M. l’Abbé Yvon, l’a aidé dans plusieurs articles de Morale. Nous saisissons cette occasion d’avertir que M. l’Abbé Yvon prépare conjointement avec M. l’Abbé de Prades, un Ouvrage sur la Religion, d’autant plus intéressant, qu’il sera fait par deux hommes d’esprit & par deux Philosophes.
La Jurisprudence est de M. Toussaint, Avocat en Parlement & membre de l’Académie royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse ; titre qu’il doit à l’étendue de ses connoissances, & à son talent pour écrire, qui lui ont fait un nom dans la Littérature.
Le Blason est de M. Eidous ci-devant Ingénieur des Armées de Sa Majesté Catholique, & à qui la république des Lettres est redevable de la traduction de plusieurs bons Ouvrages de différens genres.
L’Arithmétique & la Géométrie élémentaire ont été revûes par M. l’Abbé de la Chapelle, Censeur royal & membre de la Société royale de Londres. Ses Institutions de Géométrie, & son Traité des Sections coniques, ont justifié par leur succès l’approbation que l’Académie des Sciences a donnée à ces deux Ouvrages.
Les articles de Fortification, de Tactique, & en général d’Art militaire, sont de M. Le Blond, Professeur de Mathématiques des Pages de la grande Écurie du Roi, très-connu du Public par plusieurs Ouvrages justement estimés, entr’autres par ses Élémens de Fortification réimprimés plusieurs fois ; par son Essai sur la Castramétation ; par ses Élémens de la Guerre des Siéges, & par son Arithmétique & Géométrie de l’Officier, que l’Académie des Sciences a approuvée avec éloge.
La Coupe des Pierres est de M. Goussier, très-versé & très-intelligent dans toutes les parties des Mathématiques & de la Physique, & à qui cet Ouvrage a beaucoup d’autres obligations, comme on le verra plus bas.
Le Jardinage & l’Hydraulique sont de M. d’Argenville, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes de Paris, des Sociétés royales des Sciences de Londres & de Montpellier, & de l’Académie des Arcades de Rome. Il est Auteur d’un Ouvrage intitulé, Théorie & Pratique du Jardinage, avec un Traité d’Hydraulique, dont quatre éditions faites à Paris, & deux traductions, l’une en Anglois, l’autre en Allemand, prouvent le mérite & l’utilité reconnue. Comme cet Ouvrage ne regarde que les jardins de propreté, & que l’Auteur n’y a considéré l’Hydraulique que par rapport aux jardins, il a généralisé ces deux matieres dans l’Encyclopédie, en parlant de tous les jardins fruitiers, potagers, légumiers ; on y trouvera encore une nouvelle méthode de tailler les arbres, & de nouvelles figures de son invention. Il a aussi étendu la partie de l’Hydraulique, en parlant des plus belles machines de l’Europe pour élever les eaux, ainsi que des écluses, & autres bâtimens que l’on construit dans l’eau. M. d’Argenville est encore avantageusement connu du Public par plusieurs Ouvrages dans différens genres, entr’autres par son Histoire Naturelle éclaircie dans deux de ses principales parties, la Lithologie & la Conchyliologie. Le succès de la premiere partie de cette Histoire a engagé l’Auteur à donner dans peu la seconde, qui traitera des minéraux.
La Marine est de M. Bellin, Censeur royal & Ingénieur ordinaire de la Marine, aux travaux duquel sont dûes plusieurs Cartes que les Savans & les Navigateurs ont reçûes avec empressement. On verra par nos Planches de Marine que cette partie lui est bien connue.
L’Horlogerie & la description des instrumens astronomiques sont de M. J. B. le Roy, qui est l’un des fils du célebre M. Julien le Roy, & qui joint aux instructions qu’il a reçûes en ce genre d’un pere si estimé dans toute l’Europe, beaucoup de connoissances des Mathématiques & de la Physique, & un esprit cultivé par l’étude des Belles-Lettres.
L’Anatomie & la Physiologie sont de M. Tarin, Docteur en Medecine, dont les Ouvrages sur cette matiere sont connus & approuvés des Savans.
La Medecine, la Matiere medicale, & la Pharmacie, de M. de Vandenesse, Docteur Régent de la Faculté de Medecine de Paris, très-versé dans la théorie & la pratique de son art.
La Chirurgie de M. Louis, Chirurgien gradué, Démonstrateur royal au Collége de Saint Côme, & Conseiller Commissaire pour les extraits de l’Académie royale de Chirurgie. M. Louis déjà très-estimé, quoique fort jeune, par les plus habiles de ses confreres, avoit été chargé de la partie chirurgicale de ce Dictionnaire par le choix de M. de la Peyronie, à qui la Chirurgie doit tant, & qui a bien mérité d’elle & de l’Encyclopédie, en procurant M. Louis à l’une & à l’autre.
La Chimie est de M. Malouin, Docteur Régent de la Faculté de Medecine de Paris, Censeur royal, & membre de l’Académie royale des Sciences ; Auteur d’un Traité de Chimie dont il y a eu deux éditions, & d’une Chimie medicinale que les François & les étrangers ont fort goûtée.
La Peinture, la Sculpture, la Gravûre, sont de M. Landois, qui joint beaucoup d’esprit & de talent pour écrire à la connoissance de ces beaux Arts.
L’Architecture de M. Blondel, Architecte célebre, non seulement par plusieurs Ouvrages qu’il a fait exécuter à Paris, & par d’autres dont il a donné les desseins, & qui ont été exécutés chez différens Souverains, mais encore par son Traité de la Décoration des Édifices, dont il a gravé lui-même les Planches qui sont très-estimées. On lui doit aussi la derniere édition de Daviler, & trois volumes de l’Architecture Françoise en six cens Planches : ces trois volumes seront suivis de cinq autres. L’amour du bien public & le desir de contribuer à l’accroissement des Arts en France, lui a fait établir en 1744 une école d’Architecture, qui est devenue en peu de tems très-fréquentée. M. Blondel, outre l’Architecture qu’il y enseigne à ses éleves, fait professer dans cette école par des hommes habiles les parties des Mathématiques, de la Fortification, de la Perspective, de la Coupe des Pierres, de la Peinture, de la Sculpture, &c. relatives à l’art de bâtir. On ne pouvoit donc, à toutes sortes d’égards, faire un meilleur choix pour l’Encyclopédie.
M. Rousseau de Genêve, dont nous avons déjà parlé, & qui possede en Philosophe & en homme d’esprit la théorie & la pratique de la Musique, nous a donné les articles qui concernent cette Science. Il a publié il y a quelques années un Ouvrage intitulé, Dissertation sur la Musique moderne. On y trouve une nouvelle maniere de noter la Musique, à laquelle il n’a peut-être manqué pour être reçûe, que de n’avoir point trouvé de prévention pour une plus ancienne.
Outre les Savans que nous venons de nommer, il en est d’autres qui nous ont fourni pour l’Encyclopédie des articles entiers & très-importans, dont nous ne manquerons pas de leur faire honneur.
M. Le Monnier des Académies royales des Sciences de Paris & de Berlin, & de la Société royale de Londres, & Medecin ordinaire de S. M. à Saint-Germain-en-Laye, nous a donné les articles qui concernent l’Aimant & l’Electricité, deux matieres importantes qu’il a étudiées avec beaucoup de succès, & sur lesquelles il a donné d’excellens mémoires à l’Académie des Sciences dont il est membre. Nous avons averti dans ce volume que les articles Aimant & Aiguille aimanté sont entierement de lui, & nous ferons de même pour ceux qui lui appartiendront dans les autres volumes.
M. de Cahusac de l’Académie des Belles-Lettres de Montauban, Auteur de Zeneïde que le Public revoit & applaudit si souvent sur la scene Françoise, des Fêtes de l’Amour & de l’Hymen, & de plusieurs autres Ouvrages qui ont eu beaucoup de succès sur le Théatre lyrique, nous a donné les articles Ballet, Danse, Opéra, Décoration, & plusieurs autres moins considérables qui se rapportent à ces quatre principaux ; nous aurons soin d’avertir chacun de ceux que nous lui devons. On trouvera dans le second volume l’article Ballet qu’il a rempli de recherches curieuses & d’observations importantes ; nous espérons qu’on verra dans tous l’étude approfondie & raisonnée qu’il a faite du Théatre lyrique.
J’ai fait ou revû tous les articles de Mathématique & de Physique, qui ne dépendent point des parties dont il a été parlé ci-dessus ; j’ai aussi suppléé quelques articles, mais en très-petit nombre, dans les autres parties. Je me suis attaché dans les articles de Mathématique transcendante à donner l’esprit général des méthodes, à indiquer les meilleurs Ouvrages où l’on peut trouver sur chaque objet les détails les plus importans, & qui n’étoient point de nature à entrer dans cette Encyclopédie ; à éclaircir ce qui m’a paru n’avoir pas été éclairci suffisamment, ou ne l’avoir point été du tout ; enfin à donner, autant qu’il m’a été possible, dans chaque matiere, des principes métaphysiques exacts, c’est-à-dire, simples. On peut en voir un essai dans ce volume aux articles Action, Application, Arithmétique universelle, &c.
Mais ce travail, tout considérable qu’il est, l’est beaucoup moins que celui de M. Diderot mon collegue. Il est auteur de la partie de cette Encyclopédie la plus étendue, la plus importante, la plus desirée du Public, & j’ose le dire, la plus difficile à remplir ; c’est la description des Arts. M. Diderot l’a faite sur des mémoires qui lui ont été fournis par des ouvriers ou par des amateurs, dont on lira bien-tôt les noms, ou sur les connoissances qu’il a été puiser lui-même chez les ouvriers, ou enfin sur des métiers qu’il s’est donné la peine de voir, & dont quelquefois il a fait construire des modeles pour les étudier plus à son aise. À ce détail qui est immense, & dont il s’est acquitté avec beaucoup de soin, il en a joint un autre qui ne l’est pas moins, en suppléant dans les différentes parties de l’Encyclopédie un nombre prodigieux d’articles qui manquoient. Il s’est livré à ce travail avec un desintéressement qui honore les Lettres, & avec un zele digne de la reconnoissance de tous ceux qui les aiment ou qui les cultivent, & en particulier des personnes qui ont concouru au travail de l’Encyclopédie. On verra par ce volume combien le nombre d’articles que lui doit cet Ouvrage est considérable. Parmi ces articles, il y en a de très-étendus, comme Acier, Aiguille, Ardoise, Anatomie, Animal, Agriculture, &c. Le grand succès de l’article Art qu’il a publié séparément il y a quelques mois, l’a encouragé à donner aux autres tous ses soins ; & je crois pouvoir assûrer qu’ils sont dignes d’être comparés à celui-là, quoique dans des genres différens. Il est inutile de répondre ici à la critique injuste de quelques gens du monde, qui peu accoûtumés sans doute à tout ce qui demande la plus légere attention, ont trouvé cet article Art trop raisonné & trop métaphysique, comme s’il étoit possible que cela fût autrement. Tout article qui a pour objet un terme abstrait & général ne peut être bien traité sans remonter à des principes philosophiques, toûjours un peu difficiles pour ceux qui ne sont pas dans l’usage de réfléchir. Au reste, nous devons avoüer ici que nous avons vû avec plaisir un très-grand nombre de gens du monde entendre parfaitement cet article. À l’égard de ceux qui l’ont critiqué, nous souhaitons que sur les articles qui auront un objet semblable, ils ayent le même reproche à nous faire.
Plusieurs autres personnes, sans nous avoir fourni des articles entiers, ont procuré à l’Encyclopédie des secours importans. Nous avons déjà parlé dans le Prospectus & dans ce Discours de M. l’Abbé Sallier & de M. Formey.
M. le Comte d’Herouville de Claye, Lieutenant Général des Armées du Roi, & Inspecteur Général d’Infanterie, que ses connoissances profondes dans l’Art militaire n’empêchent point de cultiver les Lettres & les Sciences avec succès, a communiqué des mémoires très-curieux sur la Minéralogie, dont il a fait exécuter en relief plusieurs travaux, comme le cuivre, l’alun, le vitriol, la couperose, &c. en quatorze usines. On lui doit aussi des mémoires sur le Colzat, la Garence, &c.
M. Falconet, Medecin Consultant du Roi & membre de l’Académie royale des Belles-Lettres, possesseur d’une Bibliotheque aussi nombreuse & aussi étendue que ses connoissances, mais dont il fait un usage encore plus estimable, celui d’obliger les Savans en la leur communiquant sans reserve, nous a donné à cet égard tous les secours que nous pouvions souhaiter. Cet homme de Lettres citoyen, qui joint à l’érudition la plus variée les qualités d’homme d’esprit & de Philosophe, a bien voulu aussi jetter les yeux sur quelques-uns de nos articles, & nous donner des conseils & des éclaircissemens utiles.
M. Dupin Fermier Général, connu par son amour pour les Lettres & pour le bien public, a procuré sur les Salines tous les éclaircissemens nécessaires.
M. Morand, qui fait tant d’honneur à la Chirurgie de Paris, & aux différentes Académies dont il est membre, a communiqué quelques observations importantes ; on en trouvera une dans ce volume à l’article Artériotomie.
MM. de Prades & Yvon dont nous avons déjà parlé avec l’éloge qu’ils méritent, ont fourni plusieurs mémoires relatifs à l’Histoire de la Philosophie & quelques-uns sur la Religion. M. l’Abbé Pestre’ nous a aussi donné quelques mémoires sur la Philosophie, que nous aurons soin de désigner dans les volumes suivans.
M. Deslandes, ci-devant Commissaire de la Marine, a fourni sur cette matiere des remarques importantes dont on a fait usage. La réputation qu’il s’est acquise par ses différens Ouvrages, doit faire rechercher tout ce qui vient de lui.
M. Le Romain, Ingénieur en chef de l’Isle de la Grenade, a donné toutes les lumieres nécessaires sur les Sucres, & sur plusieurs autres machines qu’il a eu occasion de voir & d’examiner dans ses voyages en Philosophe & en Observateur attentif.
M. Venelle, très-versé dans la Physique & dans la Chimie, sur laquelle il a présenté à l’Académie des Sciences d’excellens mémoires, a fourni des éclaircissemens utiles & importans sur la Minéralogie.
M. Goussier, déjà nommé au sujet de la Coupe des pierres, & qui joint la pratique du Dessein à beaucoup de connoissances de la Méchanique, a donné à M. Diderot la figure de plusieurs Instrumens & leur explication. Mais il s’est particulierement occupé des figures de l’Encyclopédie qu’il a toutes revûes & presque toutes dessinées ; de la Lutherie en général, & de la facture de l’Orgue, machine immense qu’il a détaillée sur les mémoires de M. Thomas son associé dans ce travail.
M. Rogeau, habile Professeur de Mathématiques, a fourni des matériaux sur le Monnoyage, & plusieurs figures qu’il a dessinées lui-même ou auxquelles il a veillé.
On juge bien que sur ce qui concerne l’Imprimerie & la Librairie, les Libraires associés nous ont donné par eux-mêmes tous les secours qu’il nous étoit possible de desirer.
M. Prevost, Inspecteur des Verreries, a donné des lumieres sur cet Art important.
La Brasserie a été faite sur un mémoire de M. Longchamp, qu’une fortune considérable & beaucoup d’aptitude pour les Lettres n’ont point détaché de l’état de ses peres.
M. Buisson, Fabriquant de Lyon, & ci-devant Inspecteur de Manufactures, a donné des mémoires sur la Teinture, sur la Draperie, sur la Fabrication des étoffes riches, sur le travail de la Soie, son tirage, moulinage, ovalage, &c. & des observations sur les Arts relatifs aux précédens, comme ceux de dorer les lingots, de battre l’or & l’argent, de les tirer, de les filer, &c.
M. La Bassée a fourni les articles de Passementerie, dont le détail n’est bien connu que de ceux qui s’en sont particulierement occupés.
M. Douet s’est prété à tout ce qui pouvoit instruire sur l’Art du Gazier qu’il exerce.
M. Barrat, ouvrier excellent dans son genre, a monté & démonté plusieurs fois en présence de M. Diderot le métier à bas, machine admirable.
M. Pichard, Marchand Fabriquant Bonnetier, a donné des lumieres sur la Bonneterie.
MM. Bonnet & Laurent ouvriers en Soie, ont monté & fait travailler sous les yeux de M. Diderot, un métier à velours, &c. & un autre en étoffe brochée : on en verra le détail à l’article Velours.
M. Papillon, célebre Graveur en bois, a fourni un mémoire sur l’histoire & la pratique de son Art.
M. Fournier, très-habile Fondeur de caracteres d’Imprimerie, en a fait autant pour la Fonderie des caracteres.
M. Favre a donné des mémoires sur la Serrurerie, Taillanderie, Fonte des canons, &c. dont il est bien instruit.
M. Mallet, Potier d’étain à Melun, n’a rien laissé à desirer sur la connoissance de son Art.
M. Hill, Anglois de nation, a communiqué une Verrerie Angloise exécutée en relief, & tous ses instrumens avec les explications nécessaires.
MM. de Puisieux, Charpentier, Mabile, & de Vienne, ont aidé M. Diderot dans la description de plusieurs Arts. M. Eidous a fait en entier les articles de Maréchallerie & de Manége, & M. Arnauld de Senlis, ceux qui concernent la Pêche & la Chasse.
Enfin un grand nombre d’autres personnes bien intentionnées ont instruit M. Diderot sur la fabrication des Ardoises, les Forges, la Fonderie, Refenderie, Trifilerie, &c. La plûpart de ces personnes étant absentes, on n’a pû disposer de leur nom sans leur consentement ; on les nommera pour peu qu’elles le desirent. Il en est de même de plusieurs autres dont les noms ont échappé. A l’égard de celles dont les secours n’ont été d’aucun usage, on se croit dispensé de les nommer.
Nous publions ce premier volume dans le tems précis pour lequel nous l’avions promis. Le second volume est déjà sous presse ; nous espérons que le Public n’attendra point les autres, ni les volumes des Figures ; notre exactitude à lui tenir parole ne dépendra que de notre vie, de notre santé, & de notre repos. Nous avertissons aussi au nom des Libraires associés qu’en cas d’une seconde édition, les additions & corrections seront données dans un volume séparé à ceux qui auront acheté la premiere. Les personnes qui nous fourniront quelques secours pour la suite de cet Ouvrage, seront nommées à la tête de chaque volume.
Voila ce que nous avions à dire sur cette collection immense. Elle se présente avec tout ce qui peut intéresser pour elle ; l’impatience que l’on a témoignée de la voir paroître ; les obstacles qui en ont retardé la publication ; les circonstances qui nous ont forcés à nous en charger ; le zele avec lequel nous nous sommes livrés à ce travail comme s’il eût été de notre choix ; les éloges que les bons citoyens ont donnés à l’entreprise ; les secours innombrables & de toute espece que nous avons reçûs ; la protection du Gouvernement ; des ennemis tant foibles que puissans, qui ont cherché, quoiqu’en vain, à étouffer l’ouvrage avant sa naissance ; enfin des Auteurs sans cabale & sans intrigue, qui n’attendent d’autre récompense de leurs soins & de leurs efforts, que la satisfaction d’avoir bien mérité de leur patrie. Nous ne chercherons point à comparer ce Dictionnaire aux autres ; nous reconnoissons avec plaisir qu’ils nous ont tous été utiles, & notre travail ne consiste point à décrier celui de personne. C’est au Public qui lit à nous juger : nous croyons devoir le distinguer de celui qui parle.
Tous ceux qui ont travaillé à cette Encyclopédie devant répondre des articles qu’ils ont revûs ou composés, on a pris le parti de distinguer les articles de chacun par une lettre mise à la Fin de l’article. Quelques circonstances, dont il est peu important d’instruire le Public, ont empêché qu’on ne suivît dans l’ordre des lettres l’ordre Encyclopédique des matieres : mais c’est un léger inconvénient. Il suffit que l’Auteur de chaque article soit désigné de maniere qu’on ne puisse pas s’y tromper.
Les Articles qui n’ont point de lettres à la fin, ou qui ont une étoile au commencement, sont de M. Diderot : les premiers sont ceux qui lui appartiennent comme étant un des Auteurs de l’Encyclopédie ; les seconds sont ceux qu’il a suppléés comme Editeur.
Voici maintenant les autres suivant l’ordre alphabétique des lettres.
| M. Goussier, | (D) |
| M. l’Abbé de la Chapelle, | (E) |
| On a oublié (E) à la fin de l’article Aigu. | |
| M. du Marsais, | (F) |
| M. l’Abbé Mallet, | (G) |
| On a oublié (G) à la fin d’Acte, & d’Alcoran. | |
| M. Toussaint, | (H) |
| M. Daubenton, | (I) |
| M. d’Argenville, | (K) |
| M. Tarin, | (L) |
| On a mis (L) pour (M) à la fin d’Antimoine, & (L) pour (I) à la fin d’Abeille. | |
| M. Malouin, | (M) |
| M. de Vandenesse, | (N) |
| M. d’Alembert, | (O) |
| M. Blondel, | (P) |
| M. le Blond, | (Q) |
| M. Landois, | (R) |
| M. Rousseau de Genêve, | (S) |
| M. le Roy, | (T) |
| M. Eidous, | (V) |
| M. l’Abbé Yvon, | (X) |
| M. Louis, | (Y) |
| On a oublié (Y) à la fin de l’article Accouchement. | |
| M. Bellin, | (Z) |
| On a mis (Z) pour (Q) à l’article Aide de Camp. | |
Nous avons eu soin d’avertir que les articles Aimant & Aiguille Aimantée étoient en entier de M. le Monnier, Medecin, & nous avertirons de même de tous ceux qu’il nous donnera. Nous ferons la même chose pour M. de Cahusac, dont il n’y a point d’articles dans ce volume.
N. B. Lorsque plusieurs articles appartenant à la même matiere, & par conséquent faits ou revûs par la même personne, sont immédiatement consécutifs, on s’est contenté quelquefois de mettre la lettre distinctive à la fin du dernier de ces articles. Ainsi l’article Action (Belles-Lettres) & l’article Action en Poësie, sont censés marqués tous deux de la lettre (G), quoiqu’elle ne soit qu’à la fin du second ; de même
la lettre (F) mise à la fin d’Adversatif appartient aux articles précédens, Adverbe, Adverbial, Adverbialement.
ES ÊTRES PHYSIQUES agissent sur les sens. Les impressions de ces Êtres en excitent les perceptions dans l’Entendement. L’Entendement ne s’occupe de ses perceptions que de trois façons, selon ses trois facultés principales, la Mémoire, la Raison, l’Imagination. Où l’Entendement fait un dénombrement pur & simple de ses perceptions par la Mémoire ; ou il les examine, les compare, & les digere par la Raison ; où il se plaît à les imiter & à les contrefaire par l’Imagination. D’où résulte une distribution générale de la Connoissance humaine qui paroît assez bien fondée ; en Histoire, qui se rapporte à la Mémoire ; en Philosophie, qui émane de la Raison ; & en Poësie, qui naît de l’Imagination.
L’HISTOIRE est des faits ; & les faits sont ou de Dieu, ou de l’homme, ou de la nature. Les faits qui sont de Dieu, appartiennent à l’Histoire Sacrée. Les faits qui sont de l’homme, appartiennent à l’Histoire Civile ; & les faits qui sont de la nature, se rapportent à l’Histoire Naturelle.
I. L’Histoire Sacrée se distribue en Histoire Sacrée ou Ecclésiastique ; l’Histoire des Prophetes, où le récit a précédé l’évenement, est une branche de l’Histoire Sacrée.
II. L’Histoire Civile, cette branche de l’Histoire Universelle, cujus fidei exempla majorum, vicissitudines rerum, fundamenta prudentiæ civilis, hominum denique nomen & fama commissa sunt, se distribue suivant ses objets en Histoire Civile proprement dite, & en Histoire Littéraire.
Les Sciences sont l’ouvrage de la réflexion & de la lumiere naturelle des hommes. Le Chancelier Bacon a donc raison de dire dans son admirable Ouvrage de dignitate & augmento Scientiarum, que l’Histoire du Monde, sans l’Histoire des Savans, c’est la statue de Polipheme à qui on a arraché l’œil.
L’Histoire Civile proprement dite, peut se sous-diviser en Mémoires, en Antiquités, & en Histoire complette. S’il est vrai que l’Histoire soit la peinture des tems passés, les Antiquités en sont des desseins presque toûjours endommagés, & l’Histoire complete, un tableau dont les Mémoires sont des études.
III. La distribution de l’Histoire naturelle est donnée par la différence des faits de la Nature, & la différence des faits de la Nature, par la différence des états de la Nature. Ou la Nature est uniforme & suit un cours réglé, tel qu’on le remarque généralement dans les corps célestes, les animaux, les végétaux, &c. ou elle semble forcée & dérangée de son cours ordinaire, comme dans les monstres ; ou elle est contrainte & pliée à différens usages, comme dans les Arts. La Nature fait tout, ou dans son cours ordinaire & réglé, ou dans ses écarts, ou dans son emploi. Uniformité de la Nature, premiere Partie d’Histoire Naturelle. Erreurs ou Ecarts de la Nature, seconde Partie d’Histoire Naturelle. Usages de la Nature, troisieme Partie d’Histoire Naturelle.
Il est inutile de s’étendre sur les avantages de l’Histoire de la Nature uniforme. Mais si l’on nous demande à quoi peut servir l’Histoire de la Nature monstrueuse, nous répondrons, à passer des prodiges de ses écarts aux merveilles de l’Art ; à l’égarer encore ou à la remettre dans son chemin ; & sur-tout à corriger la témérité des Propositions générales, ut axiomatum corrigatur iniquitas.
Quant à l’Histoire de la Nature pliée à différens usages, on en pourroit faire une branche de l’Histoire Civile ; car l’Art en général est l’industrie de l’homme appliquée par ses besoins ou par son luxe, aux productions de la Nature. Quoi qu’il en soit, cette application ne se fait qu’en deux manieres, ou en rapprochant, ou en éloignant les corps naturels. L’homme peut quelque chose ou ne peut rien, selon que le rapprochement ou l’éloignement des corps naturels est ou n’est pas possible.
L’Histoire de la Nature uniforme se distribue suivant ses principaux objets, en Histoire Céleste, ou des Astres, de leurs mouvemens, apparences sensibles, &c. sans en expliquer la cause par des systèmes, des hypotheses, &c. il ne s’agit ici que de phénomenes purs. En Histoire des Météores, comme vents, pluies, tempetes, tonnerres, aurores boréales, &c. En Histoire de la Terre & de la Mer, ou des montagnes, des fleuves, des rivieres, des courants, du flux & reflux, des sables, des terres, des forêts, des îles, des figures, des continens, &c. En Histoire des Minéraux, en Histoire des Végétaux, & en Histoire des Animaux. D’où resulte une Histoire des Élémens, de la Nature apparente, des effets sensibles, des mouvemens, &c. du Feu, de l’Air, de la Terre, & de l’Eau.
L’Histoire de la Nature monstrueuse doit suivre la même division. La Nature peut opérer des prodiges dans les Cieux, dans les régions de l’Air, sur la surface de la Terre, dans ses entrailles, au fond des Mers, &c. en tout & par-tout.
L’Histoire de la Nature employée est aussi étendue que les différens usages que les hommes font de ses productions dans les Arts, les Métiers, & les Manufactures. Il n’y a aucun effet de l’industrie de l’homme, qu’on ne puisse rappeller à quelque production de la Nature. On rappellera au travail & à l’emploi de l’Or & de l’Argent, les Arts du Monnoyeur, du Batteur-d’Or, du Fileur-d’Or, du Tireur-d’Or, du Planeur, &c. au travail & à l’emploi des Pierres précieuses, les Arts du Lapidaire, du Diamantaire, du Joaillier, du Graveur en Pierres fines, &c. au travail & à l’emploi du Fer, les Grosses-Forges, la Serrurerie, la Taillanderie, l’Armurerie, l’Arquebuserie, la Coutellerie, &c. au travail & à l’emploi du Verre, la Verrerie, les Glaces, l’Art du Miroitier, du Vitrier, &c. au travail & à l’emploi des Peaux, les Arts de Chamoiseur, Tanneur, Peaucier, &c. au travail & à l’emploi de la Laine & de la Soie, son tirage, son moulinage, les Arts de Drapiers, Passementiers, Galonniers, Boutonniers, Ouvriers en velours, Satins, Damas, Etoffes brochées, Lustrines, &c. au travail & à l’emploi de la Terre, la Poterie de terre, la Fayance, la Porcelaine, &c. au travail & à l’emploi de la Pierre, la partie méchanique de l’Architecte, du Sculpteur, du Stuccateur, &c. au travail & à l’emploi des Bois, la Menuiserie, la Charpenterie, la Marquetterie, la Tabletterie, &c. & ainsi de toutes les autres matieres, & de tous les autres Arts, qui sont au nombre de plus de deux cens cinquante. On a vû dans le Discours préliminaire comment nous nous sommes proposé de traiter de chacun.
Voilà tout l’Historique de la connoissance humaine ; ce qu’il en faut rapporter à la Mémoire ; & ce qui doit être la matiere premiere du Philosophe.
LA PHILOSOPHIE, ou la portion de la connoissance humaine qu’il faut rapporter à la Raison, est très-étendue. Il n’est presqu’aucun objet apperçu par les sens, dont la réflexion n’ait fait une Science. Mais dans la multitude de ces objets, il y en a quelques-uns qui se font remarquer par leur importance, quibus abscinditur infinitum, & auxquels on peut rapporter toutes les Sciences. Ces chefs sont Dieu, à la connoissance duquel l’homme s’est élevé par la réflexion sur l’Histoire Naturelle & sur l’Histoire Sacrée : l’Homme qui est sûr de son existence par conscience ou sens interne ; la Nature dont l’homme a appris l’histoire par l’usage de ses sens extérieurs. Dieu, l’Homme, & la Nature, nous fourniront donc une distribution générale de la Philosophie ou de la Science (car ces mots sont synonymes) ; & la Philosophie ou Science, sera Science de Dieu, Science de l’Homme, & Science de la Nature.
| PHILOSOPHIE | I. Science de Dieu. II. Science de l’Homme. III. Science de la Nature. | |
| ou SCIENCE. |
Le progrès naturel de l’esprit humain est de s’élever des individus aux especes, des especes aux genres, des genres prochains aux genres éloignés, & de former à chaque pas une Science ; ou du moins d’ajoûter une branche nouvelle à quelque Science déja formée : ainsi la notion d’une Intelligence incrée, infinie, &c. que nous rencontrons dans la Nature, & que l’Histoire sacrée nous annonce ; & celle d’une intelligence créée, finie & unie à un corps que nous appercevons dans l’homme, & que nous supposons dans la brute, nous ont conduits à la notion d’une Intelligence créée, finie, qui n’auroit point de corps ; & de-là, à la notion générale de l’Esprit. De plus les propriétés générales des Êtres, tant spirituels que corporels, étant l’existence, la possibilité, la durée, la substance, l’attribut, &c. on a examiné ces propriétés, & on en a formé l’Ontologie, ou Science de l’Être en général. Nous avons donc eu dans un ordre renversé, d’abord l’Ontologie ; ensuite la Science de l’Esprit, ou la Pneumatologie, ou ce qu’on appelle communément Métaphysique particuliere : & cette Science s’est distribuée en Science de Dieu, ou Théologie naturelle, qu’il a plû à Dieu de rectifier & de sanctifier par la Révélation, d’où Religion & Théologie proprement dite, d’où par abus, Superstition. En doctrine des Esprits bien & malfaisans, ou des Anges & des Démons ; d’où Divination, & la chimere de la Magie noire. En Science de l’Ame qu’on a sous-divisée en Science de l’Ame raisonnable qui conçoit, & en Science de l’Ame sensitive, qui se borne aux sensations.
II. Science de l’Homme. La distribution de la Science de l’Homme nous est donnée par celle de ses facultés. Les facultés principales de l’Homme, sont l’Entendement, & la Volonté ; l’Entendement, qu’il faut diriger à la Vérité ; la Volonté, qu’il faut plier à la Vertu. L’un est le but de la Logique ; l’autre est celui de la Morale.
La Logique peut se distribuer en Art de penser, en Art de retenir ses pensées, & en Art de les communiquer.
L’Art de penser a autant de branches, que l’Entendement a d’opérations principales. Mais on distingue dans l’Entendement quatre opérations principales, l’Appréhension, le Jugement, le Raisonnement, & la Méthode. On peut rapporter à l’Appréhension, la Doctrine des idées ou Perceptions ; au Jugement, celle des Propositions ; au Raisonnement & à la Méthode, celle de l’Induction & de la Démonstration. Mais dans la Démonstration, où l’on remonte de la chose à démontrer aux premiers principes ; ou l’on descend des premiers principes à la chose à démontrer : d’où naissent l’Analyse & la Synthèse.
L’Art de Retenir a deux branches, la Science de la Mémoire même, & la Science des supplémens de la Mémoire. La Mémoire que nous avons considérée d’abord comme une faculté purement passive, & que nous considérons ici comme une puissance active que la raison peut perfectionner, est ou Naturelle, ou Artificielle. La Mémoire naturelle est une affection des organes ; l’Artificielle consiste dans la Prénotion & dans l’Emblème ; la Prénotion sans laquelle rien en particulier n’est présent à l’esprit ; l’Emblème par lequel l’Imagination est appellée au secours de la Mémoire.
Les Représentations artificielles sont le Supplément de la Mémoire. L’Écriture est une de ces représentations : mais on se sert en écrivant, ou des Caracteres courans, ou de Caracteres particuliers. On appelle la collection des premiers, l’Alphabet ; les autres se nomment Chiffres : d’où naissent les Arts de lire, d’écrire, de déchiffrer, & la Science de l’Orthographe.
L’Art de Transmettre se distribue en Science de l’Instrument du Discours, & en Science des qualités du Discours. La Science de l’Instrument du Discours s’appelle Grammaire. La Science des qualités du Discours, Rhétorique.
La Grammaire se distribue en Science des Signes, de la Prononciation, de la Construction, & de la Syntaxe. Les Signes sont les sons articulés ; la Prononciation ou Prosodie, l’Art de les articuler ; la Syntaxe, l’Art de les appliquer aux différentes vûes de l’esprit, & la Construction, la connoissance de l’ordre qu’ils doivent avoir dans le Discours, fondé sur l’usage & sur la réflexion. Mais il y a d’autres Signes de la pensée que les sons articulés : savoir le Geste, & les Caracteres. Les Caracteres sont ou idéaux, ou hiéroglyphiques, ou héraldiques. Idéaux, tels que ceux des Indiens qui marquent chacun une idée & qu’il faut par conséquent multiplier autant qu’il y a d’êtres réels. Hiéroglyphiques, qui sont l’écriture du Monde dans son enfance. Héraldiques, qui forment ce que nous appellons la Science du Blason.
C’est aussi à l’Art de transmettre, qu’il faut rapporter la Critique, la Pædagogique & la Philologie. La Critique, qui restitue dans les Auteurs les endroits corrompus, donne des éditions, &c. La Pædagogique, qui traite du choix des Etudes, & de la maniere d’enseigner. La Philologie, qui s’occupe de la connoissance de la Littérature universelle.
C’est à l’Art d’embellir le Discours, qu’il faut rapporter la Versification, ou le méchanique de la Poësie. Nous omettrons la distribution de la Rhétorique dans ses différentes parties, parce qu’il n’en découle ni Science, ni Art, si ce n’est peut-être la Pantomime, du Geste ; & du Geste & de la Voix, la Déclamation.
La Morale, dont nous avons fait la seconde partie de la Science de l’Homme, est ou générale ou particuliere. Celle-ci se distribue en Jurisprudence Naturelle, Œconomique & Politique. La Jurisprudence Naturelle est la Science des devoirs de l’Homme seul ; l’Œconomique, la Science des devoirs de l’Homme en famille ; la Politique, celle des devoirs de l’Homme en société. Mais la Morale seroit incomplette, si ces Traités n’étoient précédés de celui de la réalité du bien & du mal moral ; de la nécessité de remplir ses devoirs, d’être bon, juste, vertueux, &c. c’est l’objet de la Morale générale.
Si l’on considere que les sociétés ne sont pas moins obligées d’être vertueuses que les particuliers, on verra naître les devoirs des sociétés, qu’on pourroit appeller Jurisprudence naturelle d’une société ; Œconomique d’une société ; Commerce intérieur extérieur, de terre & de mer ; & Politique d’une société.
III. Science de la Nature. Nous distribuerons la Science de la Nature en Physique & Mathématique. Nous tenons encore cette distribution de la réflexion & de notre penchant à généraliser. Nous avons pris par les sens la connoissance des individus réels ; Soleil, Lune, Sirius, &c. Astres ; Air, Feu, Terre, Eau, &c. Élémens : Pluies, Neiges, Grêles, Tonnerres, &c. Météores ; & ainsi du reste de l’Histoire Naturelle. Nous avons pris en même tems la connoissance des abstraits, couleur, son, saveur, odeur, densité, rareté, chaleur, froid, mollesse, dureté, fluidité, solidité, roideur, élasticité, pesanteur, légereté, &c. figure, distance, mouvement, repos, durée, étendue, quantité, impénétrabilité.
Nous avons vû par la réflexion que de ces abstraits, les uns convenoient à tous les individus corporels, comme étendue, mouvement, impénétrabilité, &c. Nous en avons fait l’objet de la Physique générale, ou métaphysique des corps ; & ces mêmes propriétés, considérées dans chaque individu en particulier, avec les variétés qui les distinguent, comme la dureté, le ressort, la fluidité, &c. font l’objet de la Physique particuliere.
Une autre propriété plus générale des corps, & que supposent toutes les autres, savoir, la quantité a formé l’objet des Mathématiques. On appelle quantité ou grandeur tout ce qui peut être augmenté & diminué.
La quantité, objet des Mathématiques, pouvoit être considérée, ou seule & indépendamment des indivi dus réels, & des individus abstraits dont on en tenoit la connoissance, ou dans ces individus réels & abstraits ; ou dans leurs effets recherchés d’après des causes réelles ou supposées ; & cette seconde vûe de la réflexion a distribué les Mathématiques en Mathématiques pures, Mathématiques mixtes, Physico-mathématiques.
La quantité abstraite, objet des Mathématiques pures, est ou nombrable, ou étendue. La quantité abstraite nombrable est devenue l’objet de l’Arithmétique ; & la quantité abstraite étendue, celui de la Géométrie.
L’Arithmétique se distribue en Arithmétique numérique ou par Chiffres, & en Algebre ou Arithmétique universelle par Lettres, qui n’est autre chose que le calcul des grandeurs en général, & dont les opérations ne sont proprement que des opérations arithmétiques indiquées d’une maniere abrégée : car, à parler exactement, il n’y a calcul que de nombres.
L’Algebre est élémentaire ou infinitésimale, selon la nature des quantités auxquelles on l’applique. L’infinitésimale est ou différentielle ou intégrale : différentielle, quand il s’agit de descendre de l’expression d’une quantité finie, ou considérée comme telle, à l’expression de son accroissement, ou de sa diminution instantanée ; intégrale, quand il s’agit de remonter de cette expression à la quantité finie même.
La Géométrie, ou a pour objet primitif les propriétés du cercle & de la ligne droite, ou embrasse dans ses spéculations toutes sortes de courbes : ce qui la distribue en élémentaire, & en transcendante.
Les Mathématiques mixtes ont autant de divisions & de sous-divisions, qu’il y a d’êtres réels dans lesquels la quantité peut être considérée. La quantité considérée dans les corps en tant que mobiles, ou tendans à se mouvoir, est l’objet de la Méchanique. La Méchanique a deux branches, la Statique & la Dynamique. La Statique a pour objet la quantité considérée dans les corps en équilibre, & tendans seulement à se mouvoir. La Dynamique a pour objet la quantité considérée dans les corps actuellement mus. La Statique & la Dynamique ont chacune deux parties. La Statique se distribue en Statique proprement dite, qui a pour objet la quantité considérée dans les corps solides en équilibre, & tendans seulement à se mouvoir ; & en Hydrostatique, qui a pour objet la quantité considérée dans les corps fluides en équilibre, & tendans seulement à se mouvoir. La Dynamique se distribue en Dynamique proprement dite, qui a pour objet la quantité considérée dans les corps solides actuellement mus ; & en Hydrodynamique, qui a pour objet la quantité considérée dans les corps fluides actuellement mûs. Mais si l’on considere la quantité dans les eaux actuellement mûes, l’Hydrodynamique prend alors le nom d’Hydraulique. On pourroit rapporter la Navigation à l’Hydrodynamique, & la Ballistique ou le jet des Bombes, à la Méchanique.
La quantité considérée dans les mouvemens des Corps Célestes donne l’Astronomie géométrique ; d’où la Cosmographie ou Description de l’Univers, qui se divise en Uranographie ou Description du Ciel ; en Hydrographie ou Description des Eaux ; & en Géographie ; d’où encore la Chronologie, & la Gnomonique ou l’Art de construire des Cadrans.
La quantité considérée dans la lumiere, donne l’Optique. Et la quantité considérée dans le mouvement de la lumiere, les différentes branches d’Optique. Lumiere mûe en ligne directe, Optique proprement dite ; lumiere réfléchie dans un seul & même milieu, Catoptrique ; lumiere rompue en passant d’un milieu dans un autre, Dioptrique. C’est à l’Optique qu’il faut rapporter la Perspective. La quantité considérée dans le son, dans sa véhémence, son mouvement, ses degrés, ses réflexions, sa vîtesse, &c. donne l’Acoustique.
La quantité considérée dans l’air, sa pesanteur, son mouvement, sa condensation, raréfaction, &c. donne la Pneumatique.
La quantité considérée dans la possibilité des événemens, donne l’Art de conjecturer, d’où naît l’Analyse des Jeux de hasard.
L’objet des Sciences Mathématiques étant purement intellectuel, il ne faut pas s’étonner de l’exactitude de ses divisions.
La Physique particuliere doit suivre la même distribution que l’Histoire Naturelle. De l’Histoire, prise par les sens, des Astres, de leurs mouvemens, apparences sensibles, &c. la réflexion a passé la recherche de leur origine, des causes de leurs phénomenes, &c. & a produit la Science qu’on appelle Astronomie physique, à laquelle il faut rapporter la Science de leurs influences, qu’on nomme Astrologie ; d’où l’Astrologie physique, & la chimere de l’Astrologie judiciaire. De l’Histoire prise par les sens, des vents, des pluies, grêles, tonnerres, &c. la réflexion a passé à la recherche de leurs origines, causes, effets, &c. & a produit la Science qu’on appelle Météorologie.
De l’Histoire, prise par les sens, de la Mer, de la Terre, des fleuves, des rivieres, des montagnes, des flux & reflux, &c. la réflexion a passé à la recherche de leurs causes, origines, &c. & a donné lieu à la Cosmologie ou Science de l’Univers, qui se distribue en Uranologie ou Science du Ciel, en Aerologie ou Science de l’Air, en Géologie ou Science des Continens, & en Hydrologie ou Science des Eaux. De l’Histoire des Mines, prise par les sens, la réflexion a passé à la recherche de leur formation, travail, &c. & a donné lieu à la Science qu’on nomme Minéralogie. De l’Histoire des Plantes, prise par les sens, la réflexion a passé à la recherche de leur œconomie, propagation, culture, végétation, &c. & a engendré la Botanique dont l’Agriculture & le Jardinage sont deux branches.
De l’Histoire des Animaux, prise par les sens, la réflexion a passé à la recherche de leur conservation, propagation, usage, organisation, &c. & a produit la Science qu’on nomme Zoologie ; d’où sont émanés la Médecine, la Vétérinaire, & le Manége ; la Chasse, la Pêche, & la Fauconnerie ; l’Anatomie simple & comparée. La Médecine (suivant la division de Boerhaave) ou s’occupe de l’œconomie du corps humain & raisonne son anatomie, d’où naît la Physiologie : ou s’occupe de la maniere de le garantir des maladies, & s’appelle Hygienne : ou considere le corps malade, & traite des causes, des différences, & des symptomes des maladies, & s’appelle Pathologie : ou a pour objet les signes de la vie, de la santé, & des maladies, leur diagnostic & pronostic, & prend le nom de Séméiotique : ou enseigne l’Art de guérir, & se sous-divise en Diete, Pharmacie & Chirurgie, les trois branches de la Thérapeutique.
L’Hygienne peut se considérer relativement à la santé du corps, à sa beauté, & à ses forces ; & se sous-diviser en Hygienne proprement dite, en Cosmétique, & en Athlétique. La Cosmétique donnera l’Orthopédie, ou l’Art de procurer aux membres une belle conformation ; & l’Athlétique donnera la Gymnastique ou l’Art de les exercer.
De la connoissance expérimentale, ou de l’Histoire prise par les sens, des qualités extérieures, sensibles, apparentes, &c. des corps naturels, la réflexion nous a conduit à la recherche artificielle de leurs propriétés intérieures & occultes ; & cet Art s’est appellé Chimie. La Chimie est imitatrice & rivale de la Nature : son objet est presque aussi étendu que celui de la Nature même : ou elle décompose les Êtres ; ou elle les revivifie ; ou elle les transforme, &c. La Chimie a donné naissance à l’Alchimie, & à la Magie naturelle. La Métallurgie ou l’Art de traiter les Métaux en grand, est une branche importante de la Chimie. On peut encore rapporter à cet Art la Teinture.
La Nature a ses écarts, & la Raison ses abus. Nous avons rapporté les monstres aux écarts de la Nature ; & c’est à l’abus de la Raison qu’il faut rapporter toutes les Sciences & tous les Arts, qui ne montrent que l’avidité, la méchanceté, la superstition de l’Homme, & qui le deshonorent.
Voilà tout le Philosophique de la connoissance humaine, & ce qu’il en faut rapporter à la Raison.
L’HISTOIRE a pour objet les individus réellement existans, ou qui ont existé ; & la Poësie, les individus imaginés à l’imitation des Etres historiques. Il ne seroit donc pas étonnant que la Poësie suivît une des distributions de l’Histoire. Mais les différens genres de Poësie, & la différence de ses sujets, nous en offrent deux distributions très-naturelles. Ou le sujet d’un Poëme est sacré, ou il est prophane : ou le Poëte raconte des choses passées, ou il les rend présentes, en les mettant en action ; ou il donne du corps à des Êtres abstraits & intellectuels. La premiere de ces Poësies sera Narrative : la seconde, Dramatique : la troisieme, Parabolique. Le Poëme Épique, le Madrigal, l’Épigramme, &c. sont ordinairement de Poësie narrative. La Tragédie, la Comédie, l’Opera, l’Églogue, &c. de Poësie dramatique ; & les Allégories, &c. de Poësie parabolique.
Nous n’entendons ici par Poësie que ce qui est Fiction. Comme il peut y avoir Versification sans Poësie, & Poësie sans Versification, nous avons crû devoir regarder la Versification comme une qualité du stile, & la renvoyer à l’Art Oratoire. En revanche, nous rapporterons l’Architecture, la Musique, la Peinture, la Sculpture, la Gravure, &c. à la Poësie ; car il n’est pas moins vrai de dire du Peintre qu’il est un Poëte, que du Poëte qu’il est un Peintre ; & du Sculpteur ou Graveur qu’il est un Peintre en relief ou en creux, que du Musicien qu’il est un Peintre par les sons. Le Poëte, le Musicien, le Peintre, le Sculpteur, le Graveur, &c. imitent ou contrefont la Nature : mais l’un emploie le discours ; l’autre, les couleurs ; le troisieme, le marbre, l’airain, &c. & le dernier, l’instrument ou la voix. La Musique est Théorique ou Pratique ; Instrumentale ou Vocale. À l’égard de l’Architecte, il n’imite la Nature qu’imparfaitement par la symétrie de ses Ouvrages. Voyez le Discours préliminaire.
La Poësie a ses monstres comme la Nature ; il faut mettre de ce nombre toutes les productions de l’imagination déreglée, & il peut y avoir de ces productions en tous genres.
Voilà toute la Partie Poëtique de la Connoissance humaine ; ce qu’on en peut rapporter à l’Imagination, & la fin de notre Distribution Généalogique (ou si l’on veut Mappemonde) des Sciences & des Arts, que nous craindrions peut-être d’avoir trop détaillée, s’il n’étoit de la derniere importance de bien connoître nous-mêmes, & d’exposer clairement aux autres, l’objet d’une Encyclopédie.
I. Nous avons avoüé en plusieurs endroits du Prospectus, que nous avions l’obligation principale de notre Arbre encyclopédique au Chancelier Bacon. L’éloge qu’on a lû de ce grand homme dans le Prospectus paroît même avoir contribué à faire connoître à plusieurs personnes les Ouvrages du Philosophe Anglois. Ainsi, après un aveu aussi formel, il ne doit être permis ni de nous accuser de plagiat, ni de chercher à nous en faire soupçonner.
II. Cet aveu n’empêche pas néanmoins qu’il n’y ait un très-grand nombre de choses, sur-tout dans la Branche philosophique, que nous ne devons nullement à Bacon : il est facile au lecteur d’en juger. Mais, pour appercevoir le rapport & la différence des deux Arbres, il ne faut pas seulement examiner si on y a parlé des mêmes choses, il faut voir si la disposition est la même. Tous les Arbres encyclopédiques se ressemblent nécessairement par la matiere ; l’ordre seul & l’arrangement des branches peuvent les distinguer. On trouve à peu-près les mêmes noms des Sciences dans l’Arbre de Chambers & dans le nôtre. Rien n’est cependant plus différent.
III. Il ne s’agit point ici des raisons que nous avons eues de suivre un autre ordre que Bacon. Nous en avons exposé quelques-unes ; il seroit trop long de détailler les autres, surtout dans une matiere d’où l’arbitraire ne sauroit être tout-à-fait exclu. Quoi qu’il en soit, c’est aux Philosophes, c’est-à-dire à un très-petit nombre de gens, à nous juger sur ce point.
IV. Quelques divisions comme celles des Mathématiques en pures & en mixtes, qui nous sont communes avec Bacon, se trouvent par-tout, & sont par conséquent à tout le monde. Notre division de la Medecine est de Boerhaave ; on en a averti dans le Prospectus.
V. Enfin, comme nous avons fait quelques changemens à l’Arbre du Prospectus, ceux qui voudront comparer cet Arbre du Prospectus avec celui de Bacon, doivent avoir égard à ces changemens.
VI. Voilà les principes d’où il faut partir, pour faire le parallele des deux Arbres avec un peu d’équité & de Philosophie.
Division générale de la Science humaine en Histoire, Poësie & Philosophie, selon les trois facultés de l’Entendement, Mémoire, Imagination, Raison.
Bacon observe que cette division peut aussi s’appliquer à la Théologie. On avoit suivi dans un endroit du Prospectus cette derniere idée : mais on l’a abandonnée depuis, parce qu’elle a paru plus ingénieuse que solide.
Division de l’Histoire, en naturelle & civile.
Histoire naturelle se divise en Histoire des productions de la Nature, Histoire des écarts de la Nature, Histoire des emplois de la Nature, ou des Arts.
Seconde division de l’Histoire naturelle tirée de sa fin & de son usage, en Histoire proprement dite, & Histoire raisonnée.
Division des productions de la Nature, en Histoire des choses célestes, des Météores, de l’air, de la terre & de la mer, des élémens, des especes particulieres d’individus.
Division de l’Histoire civile en ecclésiastique, en littéraire, & en civile proprement dite.
Premiere division de l’Histoire civile proprement dite, en Mémoires, Antiquités, & Histoire complette.
Division de l’Histoire complette, en Chroniques, Vies, & Relations.
Division de l’Histoire des tems en générale & en particuliere.
Autre division de l’Histoire des tems en Annales & Journaux.
Seconde division de l’Histoire civile en pure & en mixte.
Division de l’Histoire ecclésiastique en Histoire ecclésiastique particuliere, Histoire des Prophéties, qui contient la Prophétie & l’accomplissement, & Histoire de ce que Bacon appelle Nemesis, ou la Providence, c’est-à-dire, de l’accord qui se remarque quelquefois entre la volonté révelée de Dieu, & sa volonté secrette.
Division de la partie de l’Histoire qui roule sur les dits notables des hommes, en Lettres & Apophthegmes.
Division de la Poësie en narrative, dramatique, & parabolique.
Division générale de la Science en Théologie sacrée & Philosophie.
Division de la Philosophie en Science de Dieu, Science de la Nature, Science de l’Homme.
Philosophie premiere, ou Science des Axiomes, qui s’étend à toutes les branches de la Philosophie. Autre branche de cette Philosophie premiere, qui traite des qualités transcendantes des êtres, peu, beaucoup, semblable, différent, être, non être, &c.
Science des Anges & des esprits, suite de la Science de Dieu, ou Théologie naturelle.
Division de la Science de la Nature, ou Philosophie naturelle, en spéculative & pratique.
Division de la Science spéculative de la Nature en Physique particuliere & Métaphysique ; la premiere ayant pour objet la cause efficiente & la matiere ; & la Métaphysique, la cause finale & la forme.
Division de la Physique en Science des principes des choses, Science de la formation des choses, ou du monde, & Science de la variété des choses.
Division de la Science de la variété des choses en Science des concrets, & Science des abstraits.
Division de la Science des concrets dans les mêmes branches que l’Histoire naturelle.
Division de la Science des abstraits en Science des propriétés particulieres des différens corps, comme densité, légereté, pesanteur, élasticité, mollesse, &c. & Science des mouvemens dont le Chancelier Bacon fait une énumération assez longue, conformément aux idées des scholastiques.
Branches de la Philosophie spéculative, qui consistent dans les Problèmes naturels, & les sentimens des anciens Philosophes.
Division de la Métaphysique en Science des formes & Science des causes finales.
Division de la Science pratique de la Nature en Méchanique & Magie naturelle.
Branches de la Science pratique de la Nature, qui consistent dans le dénombrement des richesses humaines, naturelles ou artificielles, dont les hommes joüissent & dont ils ont joüi, & le catalogue des Polychrestes.
Branche considérable de la Philosophie naturelle, tant spéculative que pratique, appellée Mathématiques. Division des Mathématiques en pures, en mixtes. Division des Mathématiques pures en Géométrie & Arithmétique. Division des Mathématiques mixtes en Perspective, Musique, Astronomie, Cosmographie, Architecture, Science des machines, & quelques autres.
Division de la Science de l’homme, en Science de l’homme proprement dite, & Science civile.
Division de la Science de l’homme en Science du corps humain, & Science de l’ame humaine.
Division de la Science du corps humain en Medecine, Cosmétique, Athlétique, & Science des plaisirs des sens. Division de la Medecine en trois parties, Art de conserver la santé, Art de guérir les maladies, Art de prolonger la vie. Peinture, Musique, &c. Branche de la Science des plaisirs.
Division de la Science de l’ame en Science du souffle divin, d’où est sortie l’ame raisonnable, & Science de l’ame irrationnelle, qui nous est commune avec les brutes, & qui est produite du limon de la terre.
Autre division de la Science de l’ame, en Science de la substance de l’ame, Science de ses facultés, & Science de l’usage & de l’objet de ces facultés : de cette derniere résultent la Divination naturelle & artificielle, &c.
Division des facultés de l’ame sensible, en mouvement & sentiment.
Division de la Science de l’usage & de l’objet des facultés de l’ame, en Logique & Morale.
Division de la Logique en Art d’inventer, de juger, de retenir, & de communiquer.
Division de l’art d’inventer en invention des Sciences ou des Arts, & invention des Argumens.
Division de l’Art de juger, en jugement par induction, & jugement par syllogisme.
Division de l’Art du syllogisme, en Analyse, & principes pour démêler facilement le vrai du faux.
Science de l’Analogie, branche de l’Art de juger.
Division de l’Art de retenir, en Science de ce qui peut aider la mémoire, & Science de la mémoire même.
Division de la Science de la mémoire, en prénotion & emblème.
Division de la Science de communiquer, en Science de l’instrument du discours, Science de la méthode du discours, & Science des ornemens du discours, ou Rhétorique.
Division de la Science de l’instrument du discours, en Science générale des signes, & en Grammaire, qui se divise en Science du langage, & Science de l’écriture.
Division de la Science de signes, en hyéroglyphes & gestes, & en caracteres réels.
Seconde division de la Grammaire, en littéraire & philosophique.
Art de la Versification & Prosodie, branches de la Science du langage.
Art de déchiffrer branche de l’Art d’écrire.
Critique & Pédagogie, Branches de l’Art de communiquer.
Division de la Morale en Science de l’objet que l’ame doit se proposer, c’est-à-dire, du bien moral, & Science de la culture de l’ame. L’Auteur fait à ce sujet beaucoup de divisions qu’il est inutile de rapporter.
Division de la Science civile, en Science de la conversation, Science des affaires, & Science de l’État. Nous en omettons les divisions.
L’Auteur finit par quelques réflexions sur l’usage de la Théologie sacrée, qu’il ne divise en aucunes branches.
Voilà dans son ordre naturel, & sans démembrement, ni mutilation, l’Arbre du Chancelier
Bacon. On voit que l’article de la Logique est celui où nous l’avons le plus suivi, encore avons-nous crû devoir y faire plusieurs changemens. Au reste nous le répétons, c’est aux Philosophes à nous juger sur les changemens que nous avons faits : nos autres lecteurs prendront sans doute peu de part à cette question, qu’il étoit pourtant nécessaire d’éclaircir ; & ils ne se souviendront que de l’aveu formel que nous avons fait dans le Prospectus, d’avoir l’obligation principale de notre Arbre au Chancelier Bacon ; aveu qui doit nous concilier tout juge impartial & desintéressé.

On peut considérer ce caractere, ou comme lettre, ou comme mot.
I. A, en tant que lettre, est le signe du son a, qui de tous les sons de la voix est le plus facile à prononcer. Il ne faut qu’ouvrir la bouche & pousser l’air des poumons.
On dit que l’a vient de l’aleph des Hébreux : mais l’a en tant que son ne vient que de la conformation des organes de la parole ; & le caractere ou figure dont nous nous servons pour représenter ce son, nous vient de l’alpha des Grecs. Les Latins & les autres Peuples de l’Europe ont imité les Grecs dans la forme qu’ils ont donnée à cette lettre. Selon les Grammaires Hébraïques, & la Grammaire générale de P. R. p. 12. l’aleph ne sert (aujourd’hui) que pour l’écriture, & n’a aucun son que celui de la voyelle qui lui est jointe. Cela fait voir que la prononciation des lettres est sujette à variation dans les Langues mortes, comme elle l’est dans les Langues vivantes. Car il est constant, selon M. Masclef & le P. Houbigan, que l’aleph se prononçoit autrefois comme notre a ; ce qu’ils prouvent surtout par le passage d’Eusebe, Prep. Ev. L. X. c. vj. où ce P. soûtient que les Grecs ont pris leurs lettres des Hébreux. Id ex Grœcâ singulorum elementorum appellatione quivis intelligit. Quid enim aleph ab alpha magnopere differt ? Quid autem vel betha a beth ? &c.
Quelques Auteurs (Covaruvias) disent, que lorsque les enfans viennent au monde, les mâles font entendre le son de l’a, qui est la premiere voyelle de mas, & les filles le son de l’e, premiere voyelle de femina : mais c’est une imagination sans fondement. Quand les enfans viennent au monde, & que pour la premiere fois ils poussent l’air des poumons, on entend le son de différentes voyelles, selon qu’ils ouvrent plus ou moins la bouche.
On dit un grand A, un petit a : ainsi a est du genre masculin, comme les autres voyelles de notre Alphabet.
Le son de l’a, aussi bien que celui de l’e, est long en certains mots, & bref en d’autres : a est long dans grâce, & bref dans place. Il est long dans tâche quand ce mot signifie un ouvrage qu’on donne à faire ; & il est bref dans tache, macula, souillure. Il est long dans mâtin, gros chien ; & bref dans matin, première partie du jour. Voyez l’excellent Traité de la Prosodie de M. l’Abbé d’Olivet.
Les Romains, pour marquer l’a long, l’écrivirent d’abord double, Aala pour Ala ; c’est ainsi qu’on trouve dans nos anciens Auteurs François aage, &c. Ensuite ils insérèrent un h entre les deux a, Ahala. Enfin ils mettoient quelquefois le signe de la syllabe longue, āla.
On met aujourd’hui un accent circonflexe sur l’a long, au lieu de l’s qu’on écrivoit autrefois après cet a : ainsi au lieu d’écrire mastin, blasme, asne, &c. on écrit mâtin, blâme, âne. Mais il ne faut pas croire avec la plûpart des Grammairiens, que nos Peres n’écrivoient cette s après l’a, ou après toute autre voyelle, que pour marquer que cette voyelle étoit longue ; ils ecrivoient cette s, parce qu’ils la prononçoient, & cette prononciation est encore en usage dans nos Provinces méridionales, où l’on prononce mastin, testo, besti, &c.
On ne met point d’accent sur l’a bref ou commun.
L’a chez les Romains étoit appellé lettre salutaire : littera salutaris. Cic. Attic. ix. 7. parce que lorsqu’il s’agissoit d’absoudre ou de condamner un accusé, les Juges avoient deux tablettes, sur l’une desquelles ils écrivoient l’a, qui est la premiere lettre d’absolvo, & sur l’autre ils écrivoient le c, premiere lettre de condemno. Voyez A, signe d’absolution ou de condamnation. Et l’accusé étoit absous ou condamné, selon que le nombre de l’une de ces lettres l’emportoit sur le nombre de l’autre.
On a fait quelques usages de cette lettre qu’il est utile d’observer.
1. L’a chez les Grecs étoit une lettre numérale qui marquoit un. Voyez A, lettre numérale.
2. Parmi nous les Villes où l’on bat monnoie, ont chacune pour marque une lettre de l’alphabet : cette lettre se voit au revers de la pièce de monnoie au-dessous des Armes du Roi. A est la marque de la monnoie de Paris. Voyez A numismatique.
3. On dit de quelqu’un qui n’a rien fait, rien écrit, qu’il n’a pas fait une panse d’a. Panse, qui veut dire ventre, signifie ici la partie de la lettre qui avance ; il n’a pas fait la moitié d’une lettre.
A, mot, est 1. la troisieme personne du présent de l’indicatif du verbe avoir. Il a de l’argent, il a peur, il a honte, il a envie, & avec le supin des verbes, elle a aimé, elle a vu, à l’imitation des Latins, habeo persuasum. V. Supin. Nos peres écrivoient cet a avec une h ; il ha, d’habet. On ne met aucun accent sur a verbe.
Dans cette façon de parler il y a, a est verbe. Cette façon de parler est une de ces expressions figurées, qui se sont introduites par imitation, par abus, ou catachrese. On a dit au propre, Pierre a de l’argent, il a de l’esprit ; & par imitation on a dit, il y a de l’argent dans la bourse, il y a de l’esprit dans ces vers. Il, est alors un terme abstrait & général comme ce, on. Ce sont des termes métaphysiques formés à l’imitation des mots qui marquent des objets réels. L’yvient de l’ibi des Latins, & a la même signification. Ibi, y, c’est-à-dire là, ici, dans le point dont il s’agit. Il y a des hommes qui, &c. Il, c’est-à-dire, l’être métaphysique, l’être imaginé ou d’imitation, a dans le point dont il s’agit des hommes qui, &c. Dans les autres Langues on dit plus simplement, des hommes sont, qui, &c.
C’est aussi par imitation que l’on dit, la raison a des bornes. Notre Langue n’a point de cas, la Logique a quatre parties, &c.
2. A, comme mot, est aussi une préposition, & alors on doit le marquer avec un accent grave à.
A, préposition vient du latin à, à dextris, à sinistris, à droite, à gauche. Plus souvent encore notre à vient de la préposition latine ad, loqui ad, parler à. On trouve aussi dicere ad. Cic. It lucrum ad me, (Plaute) le profit en vient à moi. Sinite parvulos venire ad me, laissez venir ces enfans à moi.
Observez que a mot, n’est jamais que ou la troisieme personne du présent de l’indicatif du verbe avoir, ou une simple préposition. Ainsi à n’est jamais adverbe, comme quelques Grammairiens l’ont cru, quoiqu’il entre dans plusieurs façons de parler adverbiales. Car l’adverbe n’a pas besoin d’être suivi d’un autre mot qui le détermine, ou, comme disent communément les Grammairiens, l’adverbe n’a jamais de régime ; parce que l’adverbe renferme en soi la préposition & le nom : prudemment, avec prudence. (V. Adverbe) au lieu que la préposition a toûjours un régime, c’est-à-dire, qu’elle est toujours suivie d’un autre mot, qui détermine la relation ou l’espece de rapport que la préposition indique. Ainsi la préposition à peut bien entrer, comme toutes les autres prépositions, dans des façons de parler adverbiales : mais comme elle est toûjours suivie de son complément, ou, comme on dit, de son régime, elle ne peut jamais être adverbe.
A n’est pas non plus une simple particule qui marque le datif ; parce qu’en françois nous n’avons ni déclinaison, ni cas, ni par conséquent de datif. V. Cas. Le rapport que les Latins marquoient par la terminaison du datif, nous l’indiquons par la préposition à. C’est ainsi que les Latins mêmes se sont servis de la préposition ad, quod attinet ad me. Cic. Accedit ad, referre ad aliquem, & alicui. Ils disoient aussi également loqui ad aliquem, & loqui alicui, parler à quelqu’un, &c.
A l’égard des différens usages de la préposition à, il faut observer 1. que toute préposition est entre deux termes, qu’elle lie & qu’elle met en rapport.
2. Que ce rapport est souvent marqué par la signification propre de la préposition même, comme avec, dans, sur, &c.
3. Mais que souvent aussi les prépositions, surtout à, de ou du, outre le rapport qu’elles indiquent quand elles sont prises dans leur sens primitif & propre, ne sont ensuite par figure & par extension, que de simples prépositions unitives ou indicatives, qui ne font que mettre deux mots en rapport ; ensorte qu’alors c’est à l’esprit même à remarquer la sorte de rapport qu’il y a entre les deux termes de la relation unis entre-eux par la préposition : par exemple, approchez-vous du feu : du, lie feu avec approchez-vous, & l’esprit observe ensuite un rapport d’approximation, que du ne marque pas. Eloignez-vous du feu : du, lie feu avec éloignez-vous, & l’esprit observe-là un rapport d’éloignement. Vous voyez que la même préposition sert à marquer des rapports opposés. On dit de même donner à & ôter à. Ainsi ces sortes de rapports different autant que les mots different entre-eux.
Je crois donc que lorsque les prépositions ne sont, ou ne paroissent pas prises dans le sens propre de leur premiere destination, & que par conséquent elles n’indiquent pas par elles-mêmes la sorte de rapport particulier que celui qui parle veut faire entendre ; alors c’est à celui qui écoute ou qui lit, à reconnoître la sorte de rapport qui se trouve entre les mots liés par la préposition simplement unitive & indicative.
Cependant quelques Grammairiens ont mieux aimé épuiser la Métaphysique la plus recherchée, & si je l’ose dire, la plus inutile & la plus vaine, que d’abandonner le Lecteur au discernement que lui donne la connoissance & l’usage de sa propre Langue. Rapport de cause, rapport d’effet, d’instrument, de situation, d’époque, table à pieds de biche, c’est-là un rapport de forme, dit M. l’Abbé Girard, tom. II. p. 199. Bassin à barbe, rapport de service, (id. ib.) Pierre à feu, rapport de propriété productive, (id. ib.) &c. La préposition à n’est point destinée à marquer par elle-même un rapport de propriété productive, ou de service, ou de forme, &c. quoique ces rapports se trouvent entre les mots liés par la préposition à. D’ailleurs, les mêmes rapports sont souvent indiqués par des prépositions différentes, & souvent des rapports opposés sont indiqués par la même préposition.
Il me paroit donc que l’on doit d’abord observer la premiere & principale destination d’une préposition. Par exemple : la principale destination de la préposition à, est de marquer la relation d’une chose à une autre, comme, le terme où l’on va, ou à quoi ce qu’on fait se termine, le but, la fin, l’attribution, le pourquoi. Aller à Rome, préter de l’argent à usure, à gros intérét. Donner quelque chose à quelqu’un, &c. Les autres usages de cette préposition reviennent ensuite à ceux-là par catachrese, abus, extension, ou imitation : mais il est bon de remarquer quelques-uns de ces usages, afin d’avoir des exemples qui puissent servir de regle, & aider à décider les doutes par analogie & par imitation. On dit donc :
Air à chanter. Billet à ordre, c’est-à-dire, payable à ordre. Chaise à deux. Doute à éclaircir. Entreprise à exécuter. Femme à la hotte ? (au vocatif). Grenier à sel. Habit à la mode. Instrument à vent. Lettre de change à vûe, à dix jours de vûe. Matiere à procès. Nez à lunette. Œufs à la coque. Plaine à perte de vûe. Question à juger. Route à gauche. Vache à lait.
Agréable à la vûe. Bon à prendre & à laisser. Contraire à la santé. Délicieux à manger. Facile à faire.
La raison de cette différence est que dans le dernier exemple de n’a pas rapport à facile, mais à il ; il, hoc, cela, à savoir de faire, &c. est facile, est une chose facile. Ainsi, il, de s’assûrer un repos plein d’appas, est le sujet de la proposition, & est facile en est l’attribut.
Qu’il est doux de trouver dans un amant qu’on aime
Un époux que l’on doit aimer ! (Idem.)
Il, à savoir, de trouver un époux dans un amant, &c. est doux, est une chose douce. (V. Proposition).
Il est gauche à tout ce qu’il fait. Heureux à la guerre. Habile à dessiner, à écrire. Payable à ordre. Pareil à, &c. Propre à, &c. Semblable à, &c. Utile à la santé.
S’abandonner à ses passions. S’amuser à des bagatelles. Applaudir à quelqu’un. Aimer à boire, à faire du bien. Les hommes n’aiment point à admirer les autres ; ils cherchent eux-mêmes à être goûtés & à être applaudis. La Bruyere. Aller à cheval, à califourchon, c’est-à-dire, jambe deçà, jambe delà. S’appliquer à, &c. S’attacher à, &c. Blesser à, il a été blessé à la jambe. Crier à l’aide, au feu, au secours. Conseiller quelque chose à quelqu’un. Donner à boire à quelqu’un. Demander à boire. Etre à. Il est à écrire, à jouer. Il est à jeun. Il est à Rome. Il est à cent lieues. Il est long-tems à venir. Cela est à faire, à taire, à publier, à payer. C’est à vous à mettre le prix à votre marchandise. J’ai fait cela à votre considération, à votre intention. Il faut des livres à votre fils. Joüer à Colin Maillard, joüer à l’ombre, aux échecs. Garder à vûe. La dépense se monte à cent écus, & la recette à, &c. Monter à cheval. Payer à quelqu’un. Payer à vûe, à jour marqué. Persuader à. Préter à. Puiser à la source. Prendre garde à soi. Prendre à gauche. Ils vont un à un, deux à deux, trois à trois. Voyons à qui l’aura, c’est-à-dire, voyons à ceci, (attendamus ad hoc nempe) à savoir qui l’aura.
A se trouve quelquefois avant la préposition de comme en ces exemples.
Peut-on ne pas céder à de si puissans charmes ?
Et peut-on refuser son cœur
A de beaux yeux qui le demandent ?
Je crois qu’en ces occasions il y a une ellipse synthétique. L’esprit est occupé des charmes particuliers qui l’ont frappé ; & il met ces charmes au rang des charmes puissans, dont on ne sauroit se garantir. Peut-on ne pas céder à ces charmes qui sont du nombre des charmes si puissans, &c. Peut-on ne pas céder à l’attrait, au pouvoir de si puissans charmes ? Peut-on refuser son cœur à ces yeux, qui sont de la classe des beaux yeux. L’usage abrege ensuite l’expression, & introduit des façons de parler particulieres auxquelles on doit se conformer, & qui ne détruisent pas les regles.
Ainsi, je crois que de ou des sont toûjours des prépositions extractives, & que quand on dit des Savans soûtiennent, des hommes m’ont dit, &c. des Savans, des hommes, ne sont pas au nominatif. Et de même quand on dit, j’ai vû des hommes, j’ai vû des femmes, &c. des hommes, des femmes, ne sont pas à l’accusatif ; car, si l’on veut bien y prendre garde, on reconnoîtra que ex hominibus, ex mulieribus, &c. ne peuvent être ni le sujet de la proposition, ni le terme de l’action du verbe ; & que celui qui parle veut dire, que quelques-uns des Savans soûtiennent, &c. quelques-uns des hommes, quelques-unes des femmes, disent, &c.
On ne se sert de la préposition à après un adverbe, que lorsque l’adverbe marque relation. Alors l’adverbe exprime la sorte de relation, & la préposition indique le corrélatif. Ainsi, on dit conformément à. On a jugé conformément à l’Ordonnance de 1667. On dit aussi relativement à.
D’ailleurs l’adverbe ne marquant qu’une circonstance absolue & déterminée de l’action, n’est pas suivi de la préposition à.
A en des façons de parler adverbiales, & en celles qui sont équivalentes à des prépositions Latines, ou de quelqu’autre Langue.
A jamais, à toûjours. A l’encontre. Tour à tour. Pas à pas. Vis-à-vis. A pleines mains. A fur & à mesure. A la fin, tandem, aliquando, C’est-à-dire, nempe, scilicet. Suivre à la piste. Faire le diable à quatre. Se faire tenir à quatre. A cause, qu’on rend en latin par la proposition propter. A raison de. Jusqu’à, ou jusques à. Au-delà. Au-dessus. Au-dessous. A quoi bon, quorsùm. A la vûe, à la présence, ou en présence, coram.
Telles sont les principales occasions où l’usage a consacré la préposition à. Les exemples que nous venons de rapporter, serviront à décider par analogie les difficultés que l’on pourroit avoir sur cette préposition.
Au reste la préposition au est la même que la préposition à. La seule différence qu’il y a entre l’une & l’autre, c’est que à est un mot simple, & que au est un mot composé.
Ainsi il faut considérer la préposition à en deux états différens.
I. Dans son état simple : 1.o Rendez à César ce qui appartient à César ; 2.o se prêter à l’exemple ; 3.o se rendre à la raison. Dans le premier exemple à est devant un nom sans article. Dans le second exemple à est suivi de l’article masculin, parce que le mot commence par une voyelle : à l’exemple, à l’esprit, à l’amour. Enfin dans le dernier, la préposition à précede l’article féminin, à la raison, à l’autorité.
II. Hors de ces trois cas, la préposition à devient un mot composé par sa jonction avec l’article le ou avec l’article pluriel les. L’article le à cause du son sourd de l’e muet a amené au, de sorte qu’au lieu de dire à le nous disons au, si le nom ne commence pas par une voyelle. S’adonner au bien ; & au pluriel au lieu de dire à les, nous changeons l en u, ce qui arrive souvent dans notre Langue, & nous disons aux, soit que le nom commence par une voyelle ou par une consonne : aux hommes, aux femmes, &c. ainsi au est autant que à le, & aux que à les.
A est aussi une préposition inséparable qui entre dans la composition des mots ; donner, s’adonner, porter, apporter, mener, amener, &c. ce qui sert ou à l’énergie, ou à marquer d’autres points de vûe ajoûtés à la premiere signification du mot.
Il faut encore observer qu’en Grec à marque
1. Privation, & alors on l’appelle alpha privatif, ce que les Latins ont quelquefois imité, comme dans amens qui est composé de mens, entendement, intelligence, & de l’alpha privatif. Nous avons conservé plusieurs mots où se trouve l’alpha privatif, comme amazone, asyle, abysme, &c. l’alpha privatif vient de la préposition ἄτερ, sine, sans.
2. A en composition marque augmentation, & alors il vient de ἄγαν, beaucoup.
3. A avec un accent circonflexe & un esprit doux ἆ marque admiration, desir, surprise, comme notre ah ! ou ha ! vox quiritantis, optantis, admirantis, dit Robertson. Ces divers usages de l’a en Grec ont donné lieu à ce vers des Racines Greques
En terme de Grammaire, & sur-tout de Grammaire Greque, on appelle a pur un a qui seul fait une syllabe comme en ϕιλία, amicitia. (F)
A, étoit une lettre numérale parmi les Anciens. Baronius rapporte des vers techniques qui expriment la valeur de chaque lettre de l’alphabet. Celui-ci,
Possidet A numeros quingentos ordine recto.
marque que la lettre A signifioit cinq cens ; surmontée d’un titre ou ligne droite, de cette façon (Ā), elle signifioit cinq mille.
Les Anciens proprement dits ne firent point usage de ces lettres numérales, comme on le croit communément. Isidore de Séville qui vivoit dans le septieme siecle assûre expressément le contraire ; Latini autem numeros ad litteras non computant. Cet usage ne fut introduit que dans les tems d’ignorance. M. Ducange dans son Glossaire explique au commencement de chaque lettre quel fut cet usage, & la plûpart des Lexicographes l’ont copié sans l’entendre, puisqu’ils s’accordent tous à dire que l’explication de cet usage se trouve dans Valerius Probus, au lieu que Ducange a dit simplement qu’elle se trouvoit dans un Recueil de Grammairiens, du nombre desquels est Valerius Probus. Habetur verò illud cum Valerio Probo… & aliis qui de numeris scripserunt editum inter Grammaticos antiquos. Les Hébreux, les Arabes emploient leur aleph, & les Grecs leur alpha qui répond à notre A, pour désigner le nombre 1. & dans le langage de l’écriture alpha signifie le commencement & le principe de toutes choses. Ego sum alpha, &c. (G)
A, lettre symbolique, étoit un hiéroglyphe chez les anciens Egyptiens, qui pour premiers caracteres employoient ou des figures d’animaux ou des signes qui en marquoient quelque propriété. On croit que celle-ci représentoit l’Ibis par l’analogie de la forme triangulaire de l’A avec la marche triangulaire de cet oiseau. Ainsi quand les caracteres Phéniciens qu’on attribue à Cadmus furent adoptés en Egypte, la lettre A y fut tout à la fois un caractere de l’écriture symbolique consacrée à la Religion, & de l’écriture commune usitée dans le commerce de la vie. (G)
A, numismatique ou monétaire, sur le revers des anciennes médailles Greques, signifie qu’elles furent frappées dans la ville d’Argos, & quelquefois dans celle d’Athenes. Dans les médailles consulaires cette lettre désigne pareillement le lieu de la fabrique ; dans celles des Empereurs, il signifie communément Augustus. Dans le revers des médailles du bas Empire, qui étoient véritablement des especes de monnoies ayant cours, & dont le peuple se servoit, A est la marque ou de la Ville, comme Antioche, Arles, Aquilée, où il y avoit des Hôtels des Monnoies, ou signifie le nom du monétaire. Dans nos especes d’or & d’argent cette lettre est la marque de la monnoie de Paris ; & le double AA celle de Metz. (G)
A, lapidaire, dans les anciennes inscriptions sur des marbres, &c. signifioit Augustus, Ager, aiunt, &c. selon le sens qu’exige le reste de l’inscription. Quand cette lettre est double, elle signifie Augusti ; triple, elle veut dire auro, argento, ære. Isidore ajoûte que lorsque cette lettre se trouve après le mot miles, elle signifie que le soldat étoit un jeune homme. On trouve dans des inscriptions expliquées par d’habiles Antiquaires A rendu par ante, & selon eux, ces deux lettres A D équivalent à ces mots ante diem. (G)
A, lettre de suffrage ; les Romains se servoient de cette lettre pour donner leurs suffrages dans les assemblées du peuple. Lorsqu’on proposoit une nouvelle loi à recevoir, on divisoit en centuries ceux qui devoient donner leurs voix, & l’on distribuoit à chacun d’eux deux ballotes de bois, dont l’une étoit marquée d’un A majuscule qui signifioit antiquo ou antiquam volo ; l’autre étoit marquée de ces deux lettres U R, uti rogas. Ceux qui s’opposoient à l’établissement de la loi jettoient dans l’urne la premiere de ces ballottes, pour signifier, je rejette la loi, ou je m’en tiens à l’ancienne. (G)
A, signe d’absolution, chez les Romains dans les causes criminelles, étoit un signe pour déclarer innocente la personne accusée. C’est pourquoi Ciceron dans l’oraison pour Milon, appelle l’A une lettre favorable, littera salutaris. Quand il s’agissoit d’un jugement pour condamner ou renvoyer quelqu’un absous, on distribuoit à chaque Magistrat ou à chaque opinant trois bulletins, dont l’un portoit un A qui vouloit dire absolvo, j’absous ; l’autre un C qui marquoit condemno, je condamne ; & sur le troisieme il y avoit une N & une L, non liquet, c’est-à-dire, le fait ou le crime en question ne me paroît pas évident. Le Préteur prononçoit selon le nombre des bulletins qui se trouvoient dans l’urne. Le dernier ne servoit que quand l’accusé n’avoit pas pû entierement se justifier, & que cependant il ne paroissoit pas absolument coupable ; c’étoit ce que nous appellons un plus amplement informé. Mais si le nombre de ces trois bulletins se trouvoit parfaitement égal, les Juges inclinoient à la douceur, & l’accusé demeuroit entierement déchargé de l’accusation. Ciceron nous apprend encore que les bulletins destinés à cet usage étoient des especes de jettons d’un bois mince, poli, & frotés de cire sur laquelle étoient inscrites les lettres dont nous venons de parler, ceratam unicuique tabellam dari cerâ legitimâ. On voit la forme de ces bulletins dans quelques anciennes médailles de la famille Casia. V. Jettons. (G).
* A cognitionibus. Scorpus fameux Agitateur du cirque est représenté, dans un monument, courant à quatre chevaux, dont on lit les noms avec celui de Scorpus. Sur le bas du monument, au haut, Abascantus est couché sur son séant, un génie lui soûtient la tête ; un autre génie qui est à ses pieds tient une torche allumée qu’il approche de la tête d’Abascantus. Celui-ci a dans la main droite une couronne, & dans la gauche une espece de fruit : l’inscription est au-dessous en ces termes : Diis Manibus : Titi Flavi Augusti liberti Abascanti à cognitionibus, Flavia Hesperis conjugi suo bene merenti fecit, cujus dolore nihil habui nisi mortis. « Aux Dieux Manes : Flavia Hesperis, épouse de Titus Flavius Abascantus affranchi d’Auguste & son commis, a fait ce monument pour son mari, qui méritoit bien qu’elle lui rendît ce devoir. Après la douleur de cette perte, la mort sera ma seule consolation ». On voit qu’à cognitionibus marque certainement un office de conséquence auprès de l’Empereur. C’étoit alors Tite ou Domitien qui régnoit. Mais à cognitionibus est une expression bien générale, & il n’est gueres de Charge un peu considérable à la Cour, qui ne soit pour connoître de quelque chose. M. Fabretti prétend qu’à cognitionibus doit s’entendre de l’inspection sur le Cirque, & ce qui concernoit la course des chevaux ; il se fonde sur ce qu’on mettoit dans ces monumens les instrumens qui étoient de la charge ou du métier dont il étoit question. Par exemple, le muid avec l’Edile, les ventouses & les ligatures avec les Medecins, le faisceau avec le Licteur, &c. d’où il infere que la qualité donnée à Abascantus est désignée par le quadrige qui est au bas du monument. Mais il ne faut prendre ceci que pour une conjecture qui peut être ou vraie ou fausse. La coûtume de désigner la qualité de l’homme par les accessoires du monument, est démentie par une infinité d’exemples. On trouve (dit le P. Montfaucon) dans un monument un Lucius Trophymus affranchi d’Auguste, qualifié à veste & à lacunâ, Intendant de la garde-robe, avec deux arcs dont la corde est cassée, deux torches, & un pot ; & ce savant homme demande quel rapport il y a entre ces accessoires & la qualité d’Intendant de la garde-robe : c’est un exemple qu’il apporte contre l’opinion de Fabretti ; mais je ne le trouve pas des mieux choisis, & l’on pourroit assez aisément donner aux arcs sans cordes & au reste des accessoires un sens qui ne s’éloigneroit pas de la qualité de Trophymus. Un Intendant de la garde-robe d’un Romain n’avoit guere d’exercice qu’en tems de paix : c’est pourquoi on voit au monument de celui-ci deux arcs sans cordes, ou ce qui est mieux, avec des cordes rompues ; les autres symboles ne sont pas plus difficiles à interpréter. Mais l’exemple suivant du P. Montfaucon me semble prouver un peu mieux contre Fabretti ; c’est un Ædituus Martis ultoris représenté avec deux oiseaux qui boivent dans un pot. Cela n’a guere de rapport avec l’office de Sacristain de Mars. Mais connoissons-nous assez bien l’antiquité pour pouvoir assûrer qu’il n’y en a point ? Ne pouvoit-il pas facilement y avoir quelque singularité dans les fonctions d’un pareil Sacristain (c’est le mot du P. Montfaucon) à laquelle les oiseaux qui boivent dans un pot feroient une allusion fort juste ? & la singularité ne pourroit-elle pas nous être inconnue ? n’admirons-nous pas aujourd’hui, ou du moins ne trouvons-nous pas très-intelligibles des figures symboliques dans nos monumens, qui seront très-obscures, & qui n’auront pas même le sens commun pour nos neveux qui ne seront pas assez instruits des minuties de nos petits usages, & de nos conditions subalternes, pour en sentir l’à propos.
* A curâ amicorum. On lit dans quelques inscriptions sépulchrales le titre de a cura amicorum. Titus Cœlius Titi filius, Celer, a cura amicorum Augusti, Prœfectus legionis decimœ salutaris, Mediomatricum civitas bene merenti posuit. Dans une autre : Silvano sacrum sodalibus ejus, & Larum conum posuit Tiberius Claudius Augusti Libertus Fortunatus a cura amicorum, idemque dedicavit. Ailleurs encore : Æsculapio Deo Julius Onesimus Augusti Libertus a cura amicorum, voto suscepto dedicavit lubens merito. Je n’entends pas trop quelle étoit cette Charge chez les Grands à curâ amicorum, dit Gruter. Mais, ajoûte le P. Montfaucon, on a des inscriptions par lesquelles il paroît que c’étoit une dignité que d’être leur ami & de leur compagnie ; d’où il conclud qu’il se peut faire que ces affranchis qui étoient à curâ amicorum, prissent soin de ceux qui étoient parvenus à cette dignité. Ces usages ne sont pas fort éloignés des nôtres ; nos femmes titrées ont quelquefois des femmes de compagnie ; & il y a bien des maisons où l’on attache tel ou tel domestique à un ami qui survient ; & ce domestique s’appelleroit fort bien en latin à curâ amici.
A, dans les Ecrivains modernes, veut dire aussi l’an, comme A. D. anno Domini, l’an de Notre Seigneur : les Anglois se servent des lettres A. M. pour dire Artium magister, Maître ès Arts. Voyez Caractere. (G)
A, dans le calendrier Julien, est aussi la premiere des sept lettres dominicales. Voyez Dominical.
Les Romains s’en étoient servis bien avant le tems de Notre Seigneur : cette lettre étoit la premiere des huit lettres nundinales ; & ce fut à l’imitation de cet usage, qu’on introduisit les lettres dominicales. (G)
A. D. épistolaire ; ces deux caracteres dans les Lettres que s’écrivoient les Anciens, signifioient ante diem. Des Copistes ignorans en ont fait tout simplement la préposition ad, & ont écrit ad IV. Kalend. ad VI. Idus, ad III. Non. &c. au lieu d’ante diem IV. Kalend. ante diem VI. Idus, &c. ainsi que le remarque Paul Manuce. On trouve dans Valerius Probus A. D. P. pour ante diem pridie. (G)
* A désigne une proposition générale affirmative. Asserit A… verum generaliter… A affirme, mais généralement, disent les Logiciens. Voyez l’usage qu’ils font de cette abbréviation à l’article Syllogisme.
* A, signe des passions, selon certains Auteurs, est relatif aux passions dans les anciens Dialectes Grecs. Le Dorien, où cette lettre se répete sans cesse, a quelque chose de mâle & de nerveux, & qui convient assez à des Guerriers. Les Latins au contraire emploient dans leur Poésie des mots où cette lettre domine, pour exprimer la douceur. Mollia luteola pingit Vaccinia caltha. Virg.
Parmi les peuples de l’Europe, les Espagnols & les Italiens sont ceux qui en font le plus d’usage, avec cette différence que les premiers remplis de faste & d’ostentation, ont continuellement dans la bouche des a emphatiques ; au lieu que les a des terminaisons Italiennes étant peu ouverts dans la prononciation, ils ne respirent que douceur & que mollesse. Notre Langue emploie cette voyelle sans aucune affectation.
A, est aussi une abréviation dont on se sert en différens Arts & pour différens usages. Voyez Abréviation.
A A A, chez les Chimistes, signifie une amalgame, ou l’opération d’amalgamer. Voy. Amalgamation & Amalgame. (M)
A, ā, ou ā ā ; on se sert de cette abréviation en Medecine pour ana, c’est-à-dire, pour indiquer une égale quantité de chaque différens ingrédiens énoncés dans une formule. Ainsi ♃ thuris, myrrhe, aluminis ā ∋j, est la même chose que ♃ thuris, myrrhe, aluminis, ana ∋j. Dans l’un & l’autre exemple ā, ā ā & ana, signifient parties égales de chaque ingrédient. ♃ veut dire, prenez de l’encens, de la myrrhe, de l’alun, de chacun un scrupule.
Cette signification d’ana ne tire point son origine d’un caprice du premier Médecin qui s’en est servi, & ce n’est point l’autorité de ses successeurs qui en a prescrit la valeur & l’usage. La proposition ἀνὰ chez les Grecs se prenoit dans le même sens que dans les Auteurs de Medecine d’aujourd’hui.
Hippocrate dans son Traité des Maladies des Femmes, après avoir parlé d’un pessaire qu’il recommande comme propre à la conception, & après avoir spécifié les drogues, ajoute ἀνὰ ὄϐολον ἐκάζον, c’est-à-dire, de chacune une dragme. Voyez Ana. (N)
A. Les Marchands, Négocians, Banquiers, & Teneurs de Livres, se servent de cette lettre, ou seule, ou suivie de quelques autres lettres aussi initiales, pour abréger des façons de parler fréquentes dans le Négoce, & ne pas tant employer de tems ni de paroles à charger leurs Journaux, Livres de comptes, ou autres Registres. Ainsi l’A mis tout seul, après avoir parlé d’une Lettre de change, signifie accepté. A. S. P. accepté sous protêt. A. S. P. C. accepté sous protêt pour mettre à compte. A. P. à protester. (G)
* A, caractere alphabétique. Après avoir donné les différentes significations de la lettre A, il ne nous reste plus qu’à parler de la maniere de le tracer.
L’a dans l’écriture ronde est un composé de trois demi-cercles, ou d’un o rond & d’un demi o, observant les déliés & les pleins. Pour fixer le lieu des déliés & des pleins, imaginez un rhombe sur un de ces côtés ; la base & le côté supérieur, & le parallele à la base, marqueront le lieu des déliés ; & les deux autres côtés marqueront le lieu des pleins. V. Rhombe.
Dans la coulée, l’a est composé de trois demi-cercles, ou plutôt ovales, ou d’un o coulé, & d’un demi o coulé : quant au lieu des déliés & des pleins, ils seront déterminés de même que dans la ronde : mais il faut les rapporter à un rhomboïde. Voyez Rhomboïde.
Dans la grosse bâtarde, il est fait des trois quarts d’un e ovale, & d’un trait droit d’abord, mais terminé par une courbe, qui forme l’a en achevant l’ovale.
La premiere partie, soit ronde, soit ovale de l’a, se forme d’un mouvement composé des doigts & du poignet ; & la seconde partie, du seul mouvement des doigts, excepté sur la fin de la courbure du trait qui applatit, soit l’o, soit l’ovale, pour en former l’a, où le poignet vient un peu au secours des doigts. V. sur ces lettres nos Planches, & sur les autres sortes d’écritures, les Préceptes de MM. Rosallet & Durel.
* A, s. petite riviere de France, qui a sa source près de Fontaines en Sologne.
* AA, s. f. riviere de France, qui prend sa source dans le haut Boulonnois, sépare la Flandre de la Picardie, & se jette dans l’Océan au-dessous de Gravelines. Il y a trois rivieres de ce nom dans le Pays bas, trois en Suisse, & cinq en Westphalie.
AABAM, s. m. Quelques Alchimistes se sont servi de ce mot pour signifier le plomb. Voyez Plomb. Saturne. Accib. Alabaric. (M)
* AACH ou ACH, s. f. petite ville d’Allemagne dans le cercle de Souabe, près de la source de l’Aach. Long. 26. 57. lat. 47. 55.
* AAHUS, s. petite ville d’Allemagne dans le cercle de Westphalie, capitale de la Comté d’Aahus. Long. 24. 36. lat. 52. 10.
* AAM, s. mesure des Liquides, en usage à Amsterdam : elle contient environ soixante-trois livres, poids de marc.
* AAR, s. grande riviere qui a sa source proche de celle du Rhin, au mont de la Fourche, & qui traverse la Suisse depuis les confins du Valais jusqu’à la Souabe.
* Aar, s. riviere d’Allemagne qui a sa source dans l’Eiffel, & qui se jette dans le Rhin près de Lintz.
* AA ou AAS, s. ou Fontaine des Arquebusades. Source d’eau vive dans le Béarn, surnommée des Arquebusades, par la propriété qu’on lui attribue de soulager ceux qui ont reçu quelques coups de feu.
* AAS ou AASA, Fort de Norwege dans le Bailliage d’Aggerhus.
AB, s. m. onzieme mois de l’année civile des Hébreux, & le cinquieme de leur année ecclésiastique, qui commence au mois de Nisan. Le mois ab répond à la Lune de Juillet, c’est-à-dire à une partie de notre mois du même nom & au commencement d’Août. Il a trente jours. Les Juifs jeûnent le premier jour de ce mois, à cause de la mort d’Aaron, & le neuvieme, parce qu’à pareil jour le Temple de Salomon fut brûlé par les Chaldéens ; & qu’ensuite le second Temple bâti depuis la captivité, fut brûlé par les Romains. Les Juifs croyent que ce fut le même jour que les Envoyés qui avoient parcouru la Terre de Chanaan, étant revenus au camp, engagerent le peuple dans la révolte. Ils jeûnent aussi ce jour-là en mémoire de la défense que leur fit l’Empereur Adrien de demeurer dans la Judée, & de regarder même de loin Jérusalem, pour en déplorer la ruine. Le dix-huitieme jour du même mois, ils jeûnent à cause que la lampe qui étoit dans le Sanctuaire, se trouva éteinte cette nuit, du tems d’Achaz. Diction. de la Bibl. tom. 1. pag. 5.
Les Juifs qui étoient attentifs à conserver la mémoire de tout ce qui leur arrivoit, avoient encore un jeûne dont parle le Prophete Zacharie, institué en mémoire & en expiation du murmure des Israélites dans le désert, lorsque Moyse eut envoyé de Cadesbarné des espions dans la Terre promise. Les Juifs disent aussi que dans ce mois les deux Temples ont été ruinés, & que leur grande Synagogue d’Alexandrie fut dispersée. L’on a remarqué que dans ce même mois ils avoient autrefois été chassés de France, d’Angleterre & d’Espagne. (G)
AB, s. m. en Langue Syriaque est le nom du dernier mois de l’Eté. Le premier jour de ce mois est nommé dans leur Calendrier Saum-Miriam, le Jeûne de Notre-Dame ; parce que les Chrétiens d’Orient jeûnoient depuis ce jour jusqu’au quinze du même mois, qu’ils nommoient Fathr-Miriam, la cessation du Jeûne de Notre-Dame. D’Herbelot. Bib. Orientale. (G)
AB, s. m. en hébreu signifie pere ; d’où les Chaldéens & les Syriens ont fait abba, les Grecs abbas, conservé par les Latins, d’où nous avons formé le nom d’Abbé. Saint Marc & Saint Paul ont employé le mot syriaque ou chaldaïque abba, pour signifier Pere, parce qu’il étoit alors commun dans les Synagogues & dans les premieres assemblées des Chrétiens. C’est pourquoi abba Pater dans le 14e chap. de Saint Marc, & dans le 8e de Saint Paul aux Romains, n’est que le même mot expliqué, comme s’ils disoient : abba, c’est-à-dire, mon pere. Car comme le remarque S. Jerôme dans son Commentaire sur le iv chap. de l’Epitre aux Galates, les Apôtres & les Evangélistes ont quelquefois employé dans leurs Ecrits des mots syriaques, qu’ils interprétoient ensuite en Grec, parce qu’ils écrivoient dans cette derniere Langue. Ainsi ils ont dit Bartimée, fils de Timée ; aser, richesses ; où fils de Timée, & richesses, ne sont que la version pure des mots qui les précedent. Le nom d’abba en Syriaque qui signifioit un pere naturel, a été pris ensuite pour signifier un personnage, à qui l’on voueroit le même respect & la même affection qu’à un pere naturel. Les Docteurs Juifs prenoient ce titre par orgueil ; ce qui fait dire à J. C. dans S. Matthieu, ch. 23. N’appellez personne sur la terre votre pere, parce que vous n’avez qu’un pere qui est dans le ciel. Les Chrétiens ont donné communément le nom d’Abbé aux Supérieurs des Monasteres. Voyez Abbé (G)
*ABA, s. ville de la Phocide, bâtie par les Abantes, peuples sortis de Thrace, nommée Aba d’Abas leur Chef, & ruinée, à ce que prétendent quelques-uns, par Xercès.
* ABACA, s. Il ne paroît pas qu’on sache bien précisément ce que c’est. On lit dans le Dictionnaire du Commerce, que c’est une sorte de chanvre ou de lin qu’on tire d’un platane des Indes ; qu’il est blanc ou gris ; qu’on le fait roüir ; qu’on le bat comme notre chanvre ; qu’on ourdit avec le blanc des toiles très-fines, & qu’on n’emploie le gris qu’en cordages & cables.
* ABACH, s. petite ville d’Allemagne dans la basse Baviere, que quelques Auteurs donnent pour le château d’Abaude. Long. 29. 40. lat. 48. 52.
ABACO, s. m. Quelques anciens Auteurs se servent de ce mot, pour dire l’Arithmétique. Les Italiens s’en servent aussi dans le même sens. Voyez Abaque & Arithmétique. (O)
* ABACOA, s. Isle de l’Amérique septentrionale, l’une des Lucayes.
* ABACOT, s. m. nom de l’ancienne parure de tête des Rois d’Angleterre ; sa partie superieure formoit une double couronne. Voyez Dyche.
* ABADA, s. m. c’est, dit-on, un animal qui se trouve sur la côte méridionale de Bengale, qui a deux cornes, l’une sur le front, l’autre sur la nuque du cou ; qui est de la grosseur d’un poulain de deux ans, & qui a la queue d’un bœuf, mais un peu moins longue ; le crin & la tête d’un cheval, mais le crin plus épais & plus rude, & la tête plus plate & plus courte ; les pieds du cerf, fendus, mais plus gros. On ajoûte que de ces deux cornes, celle du front est longue de trois ou quatre piés, mince, de l’épaisseur de la jambe humaine vers la racine ; qu’elle est aiguë par la pointe, & droite dans la jeunesse de l’animal, mais qu’elle se recourbe en-devant ; & que celle de la nuque du cou est plus courte & plus plate. Les Negres le tuent pour lui enlever ses cornes, qu’ils regardent comme un spécifique, non dans plusieurs maladies, ainsi qu’on lit dans quelques auteurs, mais en général contre les venins & les poisons. Il y auroit de la témérité sur une pareille description à douter que l’abada ne soit un animal réel ; reste à savoir s’il en est fait mention dans quelque Naturaliste moderne, instruit & fidele, ou si par hasard tout ceci ne seroit appuyé que sur le témoignage de quelque voyageur. Voyez Vallisneri, tom. III. p. 367.
* ABADDON, s. m. vient d’abad, perdre. C’est le nom que S. Jean donne dans l’Apocalypse au Roi des sauterelles, à l’Ange de l’abysme, à l’Ange exterminateur.
ABADIR ou ABADDIR, s. m. mot composé de deux termes Phéniciens. Il signifie Pere magnifique, titre que les Carthaginois donnoient aux Dieux du premier ordre. En Mythologie, abadir est le nom d’une pierre que Cibele ou Ops, femme de Saturne, fit avaler dans des langes à son mari, à la place de l’enfant dont elle étoit accouchée. Ce mot se trouve corrompu dans les gloses d’Isidore, où on lit Agadir lapis. Barthius le prenant tel qu’il est dans Isidore, le rapporte ridiculement à la Langue Allemande. Bochart a cherché dans la Langue Phénicienne l’origine d’abadir, & croit avec vraissemblance qu’il signifie une pierre ronde ; ce qui quadre avec la figure décrite par Damascius. Des Anciens ont cru que cette pierre étoit le Dieu Terme : d’autres prétendent que ce mot étoit jadis synonyme à Dieu. (G)
* ABACUZ, s. m. pris adject. ce sont les biens de ceux qui meurent sans laisser d’héritiers, soit par testament, soit par droit lignager, ou autrement, & dont la succession passoit, à ce que dit Ragueau, selon l’ancienne Coûtume du Poitou, au bas Justicier de la Seigneurie dans laquelle ils étoient décédés. (H)
ABAJOUR, s. m. nom que les Architectes donnent à une espece de fenêtre ou ouverture destinée à éclairer tout étage soûterrain à l’usage des cuisines, offices, caves, &c. On les nomme communément des soupiraux : elles reçoivent le jour d’en-haut par le moyen de l’embrasement de l’appui qui est en talus ou glacis, avec plus ou moins d’inclinaison, selon que l’épaisseur du mur le peut permettre : elles sont le plus souvent tenues moins hautes que larges. Leurs formes extérieures n’ayant aucun rapport aux proportions de l’architecture, c’est dans ce seul genre de croisées qu’on peut s’en dispenser, quoique quelques Architectes ayent affecté dans l’ordre attique de faire des croisées barlongues, à l’imitation des Abajours ; comme on peut le remarquer au Château des Tuileries du côté de la grande Cour : mais cet exemple est à éviter, n’étant pas raisonnable d’affecter-là une forme de croisée, pour ainsi dire consacrée aux soûpiraux dans les étages supérieurs.
On appelle aussi fenêtres en abajour, le grand vitrail d’une Eglise, d’un grand Sallon ou Gallerie, lorsqu’on est obligé de pratiquer à cette croisée un glacis à la traverse supérieure ou inférieure de son embrasure, pour raccorder l’inégalité de hauteur qui peut se rencontrer entre la décoration intérieure ou extérieure d’un Edifice ; tel qu’on le remarque aux Invalides, au vestibule, & à la galerie du Château de Clagny. (P)
ABAISIR, s. m. Quelques Alchimistes se sont servis de ce mot pour signifier spodium. Voyez Spodium. (M)
* ABAISSE, s. f. c’est le nom que les Pâtissiers donnent à la pâte qu’ils ont étendue sous le rouleau, & dont ils font ensuite le fond d’un pâté, d’une tourte, & autres pieces semblables.
ABAISSE, adject. descendu plus bas. Ce terme, suivant Nicod, a pour étymologie βάσις, base, fondement.
Abaissé, en terme de Blason, se dit du vol ou des aîles des Aigles, lorsque le bout de leurs aîles est en embas & vers la pointe de l’écu, ou qu’elles sont pliées ; au lieu que leur situation naturelle est d’être ouvertes & déployées, de sorte que les bouts tendent vers les angles ou le chef de l’écu. Voyez Vol.
Le chevron, le pal, la bande, sont aussi dits abaissés, quand la pointe finit au cœur de l’écu ou au-dessous. Voyez Chevron, Pal, &c.
On dit aussi qu’une piece est abaissée, lorsqu’elle est au-dessous de sa situation ordinaire. Ainsi les Commandeurs de Malte qui ont des chefs dans leurs Armoiries de Famille, sont obligés de les abaisser sous celui de la Religion.
François de Boczossel Mongontier, Chevalier de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, Commandeur de Saint Paul, Maréchal de son Ordre, & depuis Bailli de Lyon. D’or au chef échiqueté d’argent & d’azur de deux tires, abaissé sous un autre chef des armoiries de la Religion de Saint Jean de Jerusalem, de gueules à la croix d’argent. (V)
ABAISSEMENT, s. m. (des équations) en Algebre, se dit de la réduction des équations au moindre degré dont elles soient susceptibles. Ainsi l’équation qui paroît du 3e degré, se réduit ou s’abaisse à une équation du 2e degré , en divisant tous les termes par x. De même l’équation , qui paroît du 4e degré, se réduit au 2d, en faisant ; car elle devient alors , ou . Voyez Degré, Equation, Réduction, &c.
Abaissement du Pole. Autant on fait de chemin en degrés de latitude, en allant du pole vers l’équateur, autant est grand le nombre de degrés dont le pole s’abaisse, parce qu’il devient continuellement plus proche de l’horison. Voyez Élévation du Pole.
Abaissement de l’Horison visible, est la quantité dont l’horison visible est abaissé au-dessous du plan horisontal qui touche la terre. Pour faire entendre en quoi consiste cet abaissement ; soit C le centre de la Terre représentée (Fig. I. Géog.) par le cercle ou globe BEM. Ayant tiré d’un point quelconque A élevé au-dessus de la surface du globe, les tangentes AB, AE, & la ligne AOC, il est évident qu’un spectateur, dont l’œil seroit placé au point A, verroit toute la portion BOE de la Terre terminée par les points touchans BE ; de sorte que le plan BE est proprement l’horison du spectateur placé en A. Voyez Horison.
Ce plan est abaissé de la distance OG, au-dessous du plan horisontal FOD qui touche la Terre en O ; & si la distance AO est assez petite par rapport au rayon de la terre, la ligne OG est presque égale à la ligne AO. Donc, si on a la distance AO, ou l’élévation de l’œil du spectateur, évaluée en piés, on trouvera facilement le sinus verse OG de l’arc OE. Par exemple, soit AO = 5 piés, le sinus verse OG de l’arc OE, sera donc de 5 piés, le sinus total ou rayon de la terre étant de 19000000 piés en nombres ronds : ainsi on trouvera que l’arc OE est d’environ deux minutes & demie ; par conséquent l’arc BOE sera de cinq minutes : & comme un degré de la terre est de 25 lieues, il s’ensuit que si la terre étoit parfaitement ronde & unie sans aucunes éminences, un homme de taille ordinaire devroit découvrir à la distance d’environ deux lieues autour de lui, ou une lieue à la ronde : à la hauteur de 20 piés, l’œil devroit découvrir à 2 lieues à la ronde ; à la hauteur de 45 piés, 3 lieues, &c.
Les montagnes font quelquefois que l’on découvre plus loin ou plus près que les distances précédentes. Par exemple, la montagne NL (Fig. 1. no 2. Géog.) placée entre A & le point E, fait que le spectateur A ne sauroit voir la partie NE ; & au contraire la montagne PQ, placée au-delà de B, fait que ce même spectateur peut voir les objets terrestres situés au-delà de B, & placés sur cette montagne au-dessus du rayon visuel AB.
L’abaissement d’une étoile sous l’horison est mesuré par l’arc de cercle vertical, qui se trouve au-dessous de l’horison, entre cette étoile & l’horison. Voyez Etoile, Vertical. (O)
ABAISSEMENT ou ABATEMENT, s. m. en terme de Blason, est quelque chose d’ajoûté à l’écu, pour en diminuer la valeur & la dignité, en conséquence d’une action deshonorante ou tache infamante dont est flétrie la personne qui le porte. Voyez Arme.
Les Auteurs ne conviennent pas tous qu’il y ait effectivement dans le blason de véritables abattemens. Cependant Leigls & Guillaume les supposant réels, en rapportent plusieurs sortes.
Les abattemens, selon le dernier de ces deux Auteurs, se font ou par reversion ou par diminution.
La reversion se fait en tournant l’écu le haut en bas, ou en enfermant dans le premier écusson un second écusson renversé.
La diminution, en dégradant une partie par l’addition d’une tache ou d’une marque de diminution, comme une barre, un point dextre, un point champagne, un point plaine, une pointe senestre, & un I gousset. Voyez chacun de ces mots à son article.
Il faut ajoûter qu’en ce cas ces marques doivent être de couleur brune ou tannée, autrement, au lieu d’être des marques de diminution, c’en seroit d’honneur. Voyez Tanné, Brun.
L’Auteur de la derniere édition de Guillin rejette tout-à-fait ces prétendus abattemens comme des chimeres : il soûtient qu’il n’y en a pas un seul exemple, & qu’une pareille supposition implique contradiction ; que les armes étant des marques de noblesse & d’honneur, insignia nobilitatis & honoris, on n’y sauroit mêler aucune marque infamante, sans qu’elles cessent d’être des armes ; que ce seroit plûtôt des témoignages toûjours subsistans du deshonneur de celui qui les porteroit ; & que par conséquent on ne demanderoit pas mieux que de supprimer. Il ajoûte que comme l’honneur qu’on tient de ses ancêtres ne peut souffrir aucune diminution, il faut dire la même chose des marques qui servent à en conserver la mémoire ; qu’il les faut laisser sans altération, ou les supprimer tout-à-fait, comme on fait dans le cas du crime de lese-Majesté, auquel cas on renverse totalement l’écu pour marque d’une entiere dégradation.
Cependant Colombines & d’autres rapportent quelques exemples contraires à ce sentiment. Mais ces exemples servent seulement de monumens du ressentiment de quelques Princes pour des offenses commises en leur présence, mais ne peuvent pas être tirées à conséquence pour établir un usage ou une pratique constante, & peuvent encore moins autoriser des officiers inférieurs, comme des Hérauts d’armes, à tenir par leurs mains des empreintes de ces armoiries infamantes.
En un mot les armes étant plûtôt les titres de ceux qui n’existent plus que de ceux qui existent, il semble qu’on ne les peut ni diminuer ni abaisser : ce seroit autant flétrir l’ancêtre que son descendant ; il ne peut donc avoir lieu que par rapport à des armes récemment accordées. S’il arrive que celui qui les a obtenues vive encore, & démente ses premieres actions par celles qui les suivent, l’abaissement se fera par la suppression de quelques caracteres honorans, mais non par l’introduction de signes diffamans. (V)
ABAISSER une équation, terme d’Algebre. Voyez Abaissement.
Abaisser est aussi un terme de Géométrie. Abaisser une perpendiculaire d’un point donné hors d’une ligne, c’est tirer de ce point une perpendiculaire sur la ligne. Voyez Ligne & Perpendiculaire. (O)
Abaisser, c’est couper, tailler une branche près de la tige d’un arbre. Si on abaissoit entierement un étage de branches, cela s’appelleroit alors ravaler. Voyez Ravaler. (K)
Abaisser, c’est, en terme de Fauconnerie, ôter quelque chose de la portion du manger de l’oiseau, pour le rendre plus léger & plus avide à la proie.
Abaisser marque parmi les Pâtissiers la façon qu’on donne à la pâte avec un rouleau de bois qui l’applatit, & la rend aussi mince que l’on veut, soit qu’on la destine à être le fond d’un pâté, ou le dessus d’une tourte grasse.
ABAISSEUR, s. m. pris adj. en Anatomie, est le nom qu’on a donné à différens muscles, dont l’action consiste à abaisser ou à porter en bas les parties auxquelles ils sont attachés. Voyez Muscle.
Abaisseur de la levre supérieure, est un muscle qu’on appelle aussi constricteur des aîles du nez ou petit incisif. Voyez Incisif.
Abaisseur propre de la levre inférieure ou le quarré, est un muscle placé entre les abaisseurs communs des levres sur la partie appellée le menton. Voyez Menton.
Abaisseur de la mâchoire inférieure. Voyez Digastrique.
Abaisseur de l’œil, est un des quatre muscles de l’œil qui le meut en bas. Voyez Œil & Droit.
Abaisseur des sourcils empêche les ordures d’entrer dans l’œil, & lui fournit une défense contre la lumiere trop vive, lorsque par la contraction de ce muscle les sourcils s’approchent de la paupiere inférieure, & en même tems l’un de l’autre.
Abaisseurs de la paupiere inférieure ; ils servent à ouvrir l’œil. (L)
ABALIENATION, s. f. dans le Droit Romain, signifie une sorte d’aliénation par laquelle les effets qu’on nommoit res mancipi, étoient transférés à des personnes en droit de les acquérir, ou par une formule qu’on appelleit traditio nexu, ou par une renonciation qu’on faisoit en présence de la Cour. Voyez Aliénation.
Ce mot est composé de ab, & alienare, aliéner. Les effets qu’on nomme ici res mancipi, & qui étoient l’objet de l’abaliénation, étoient les bestiaux, les esclaves, les terres, & autres possessions dans l’enceinte des territoires de l’Italie. Les personnes en droit de les acquérir étoient les citoyens Romains, les Latins, & quelques étrangers à qui on permettoit spécialement ce commerce. La transaction se faisoit, ou avec la cérémonie des poids, & l’argent à la main, ou bien par un désistement en présence d’un Magistrat. (H)
* ABANA, riviere de Syrie qui se jette dans la mer de ce nom, après avoir arrosé les murs de Damas du côté du Midi, ce qui l’a fait appeller dans l’Ecriture riviere de Damas.
ABANDONNÉ, adject. en Droit, se dit de biens auxquels le propriétaire a renoncé sciemment & volontairement, & qu’il ne compte plus au nombre de ses effets.
On appelle aussi abandonnées, les terres dont la mer s’est retirée, qu’elle a laissées à sec, & qu’on peut faire valoir.
Abandonné au bras séculier, c’est-à-dire livré par les Juges ecclésiastiques à la Justice séculiere, pour y être condamné à des peines afflictives que les Tribunaux ecclésiastiques ne sauroient infliger. (H)
Abandonné, adj. épithete que donnent les Chasseurs à un chien courant qui prend les devants d’une meute, & qui s’abandonne sur la bête quand il la rencontre.
ABANDONNEMENT, s. m. en Droit, est le délaissement qu’on fait de biens dont on est possesseur, ou volontairement ou forcément. Si c’est à des créanciers qu’on les abandonne, cet abandonnement se nomme cession : si on les abandonne pour se libérer des charges auxquelles on est assujetti en les possédant, il se nomme déguerpissement. Voyez Cession & Déguerpissement.
L’abandonnement qu’un homme fait de tous ses biens le rend quitte envers ses créanciers, sans qu’ils puissent rien prétendre aux biens qu’il pourroit acquérir dans la suite. (H)
ABANDONNER v. a. en fauconnerie, c’est laisser l’oiseau libre en campagne, ou pour l’égayer, ou pour le congédier lorsqu’il n’est pas bon.
Abandonner un cheval, c’est le faire courir de toute sa vîtesse sans lui tenir la bride. Abandonner les étriers, c’est ôter ses pieds de dedans. S’abandonner ou abandonner son cheval après quelqu’un, c’est le poursuivre à course de cheval.
* ABANGA, s. m. c’est le nom que les Habitans de l’Isle de Saint Thomas donnent au fruit de leur palmier. Ce fruit est de la grosseur d’un citron auquel il ressemble beaucoup d’ailleurs. C. Bauhin dit que les Insulaires en font prendre trois ou quatre pépins par jour à ceux de leurs malades qui ont besoin de pectoraux.
* ABANO, s. f. petite Ville d’Italie dans la République de Venise & le Padouan. Long. 29. 40. lat. 45. 20.
* ABANTÉENS, s. m. plur. sont les Peuples d’Argos ainsi nommés d’Abas leur Roi.
* ABANTES, s. m. pl. Peuples de Thrace qui passerent en Grece, bâtirent Abée que Xercès ruina, & se retirerent delà dans l’Isle de Negrepont, qu’ils nommerent Abantide.
* ABANTIDE, s. f. le Négrepont. V. Abantes.
ABAPTISTON, s. m. c’est le nom que les Anciens donnoient à un instrument de Chirurgie, que les Ecrivains modernes appellent communément trépan. V. Trépan. (Y)
ABAQUE, s. m. chez les anciens Mathématiciens signifioit une petite table couverte de poussiere sur laquelle ils traçoient leurs plans & leurs figures, selon le témoignage de Martius Capella, & de Perse. Sat. I. v. 131.
Nec qui abaco numeros & facto in pulvere metas
Scit risisse vafer.
Ce mot semble venir du Phénicien אבק, abak, poussiere ou poudre.
Abaque, ou Table de Pythagore, abacus Pythagoricus, étoit une table de nombres pour apprendre plus facilement les principes de l’Arithmétique ; cette table fut nommée table de Pythagore à cause que ce fut lui qui l’inventa.
Il est probable que la table de Pythagore n’étoit autre chose que ce que nous appellons table de multiplication. Voyez Table de Pythagore.
Ludolphe a donné des méthodes pour faire la multiplication sans le secours de l’abaque ou table : mais elles sont trop longues & trop difficiles pour s’en servir dans les opérations ordinaires. Voyez Multiplication. (O)
Abaque. Chez les Anciens ce mot signifioit une espece d’armoire ou de buffet destiné à différens usages. Dans un magazin de Négociant il servoit de comptoir ; & dans une sale à manger, il contenoit les amphores & les crateres ; celui-ci étoit ordinairement de marbre, comme il paroît par cet endroit d’Horace :
Et lapis albus
Pocula cum cyatho duo sustinet.
Les Italiens ont nommé ce meuble credenza. Le mot Abaque latinisé est Grec d’origine : Abaque signifie de plus panier, corbeille, chapiteau de colonne, baze d’une roche, d’une montagne, le diametre du soleil, &c. Quelques-uns prétendent qu’Abaque est composé d’à privatif & de βάσις, fondement ou base, c’est-à-dire qui est, sans pié-d’estal, attaché contre le mur. Mais Guichard remonte plus haut, il dérive le mot ἄϐαξ de l’Hebreu אכך, extolli, être élevé ; & il suppose qu’il signifioit d’abord une planche ou une tablette, ou quelqu’autre meuble semblable appliqué contre le mur. Tite-Live & Salluste parlant du luxe des Romains, après la conquête de l’Asie, leur reprochent pour ces buffets inconnus à leurs bons ayeux un goût qui alloit jusqu’à en faire fabriquer de bois le plus précieux, qu’on revêtoit de lames d’or.
* L’Abaque d’usage pour les comptes & les calculs étoit une espece de quadre long & divisé par plusieurs cordes d’airain paralleles qui enfiloient chacune une égale quantité de petites boules d’ivoire ou de bois mobiles comme des grains de chapelet, par la disposition desquelles, & suivant le rapport que les inférieures avoient avec les supérieures, on distribuoit les nombres en diverses classes, & l’on faisoit toute sorte de calculs. Cette tablette arithmétique à l’usage des Grecs ne fut pas inconnue aux Romains. On la trouve décrite d’après quelques monumens antiques par Fulvius Ursinus & Ciaconius : mais comme l’usage en étoit un peu difficile, celui de compter avec les jettons prévalut. A la Chine & dans quelques cantons de l’Asie, les Négocians comptent encore avec de petites boules d’ivoire ou d’ébene enfilées dans un fil de léton qu’ils portent accroché à leur ceinture. (G)
* Abaque. Le grand abaque est encore une espece d’auge dont on se sert dans les Mines pour laver l’or.
Abaque, c’est, dit Harris, & disent d’après Harris les Auteurs de Trevoux, la partie supérieure ou le couronnement du chapiteau de la colonne. L’abaque est quarré au Toscan, au Dorique, & à l’Ionique antique, & échancré sur ses faces aux chapiteaux Corinthien & Composite. Dans ces deux ordres, ses angles s’appellent cornes, le milieu s’appelle balai, & la courbure s’appelle arc & a communément une rose au milieu. Les Ouvriers, ajoûtent Mauclerc & Harris, appellent aussi abaque un ornement Gothique avec un filet ou un chapelet de la moitié de la largeur de l’ornement, & l’on nomme ce filet, le filet ou le chapelet de l’abaque. Dans l’ordre Corinthien, l’abaque est la septieme partie du chapiteau. Andrea Palladio nomme abaque la plinthe qui est autour du quart-de-rond appellé échime ; l’abaque se nomme encore tailloir. Scamozzi donne aussi le nom d’abaque à une moulure en creux qui forme le chapiteau du pié-d’estal de l’ordre Toscan. Voyez Harris, premiere & seconde partie.
* ABARANER, s. petite Ville dans la grande Arménie. Long. 64. lat. 39. 50.
* ABAREMO-TEMO, s. m. arbre qui croît, dit-on, dans les montagnes du Bresil. Ses racines sont d’un rouge foncé, & son écorce est cendrée, amere au goût, & donne une décoction propre à déterger les ulceres invétérés. Sa substance a la même propriété, Il ne reste plus qu’à s’assûrer de l’existence de l’arbre & de ses propriétés. Voilà toûjours son nom.
* ABARES, restes de la Nation des Huns qui se répandirent dans la Thuringe sous Sigebert. Voyez la description effrayante qu’en fait le Dictionnaire de Trevoux.
* ABARIM, montagne de l’Arabie d’où Moyse vit la terre promise ; elle étoit à l’Orient du Jourdain vis-à-vis Jéricho, dans le pays des Moabites.
* ABARIME ou ABARIMON, grande vallée de Scythie au pied du mont Imaüs qui la forme.
* ABARNAHAS, terme qu’on trouve dans quelques Alchimistes, & sur-tout dans le Theatrum chimicum de Servien Zadith. Il ne paroît pas qu’on soit encore bien assûré de l’idée qu’il y attachoit. Chambers dit qu’il entendoit par Abarnahas la même chose que par plena luna, & par plena luna la même chose que par magnesia, & par magnesia la Pierre philosophale. Voilà bien des mots pour rien.
* ABARO, Bourg ou petite Ville de Syrie dans l’Antiliban.
* ABAS, s. m. poids en usage en Perse pour peser les perles. Il est de trois grains & demi, un peu moins forts que ceux du poids de marc.
* ABASCIE, contrée de la Géorgie dans l’Asie. Long. 56. 60. lat. 43. 45.
* ABASSE ou ABASCE, Habitans de l’Abascie, Voyez Abascie.
* ABASTER, (Métamorph.) l’un des trois chevaux du char de Pluton. C’est le noir. V. Metheus & Nonius.
ABATAGE, s. m. On dit dans un chantier & sur un atelier faire un abatage d’une ou plusieurs pierres, lorsque l’on veut les coucher de leur lit sur leurs joints pour en faire les paremens, ce qui s’exécute lorsque ces pierres sont d’une moyenne grosseur, avec un boulin & des moilons : mais lorsqu’elles sont d’une certaine étendue, on se sert de leviers, de cordages, & de coins, &c. (P)
Abatage, sixieme manœuvre du Faiseur de bas au métier. Elle consiste dans un mouvement assez léger : l’Ouvrier tire à lui horisontalement la barre à poignée ; & par ce mouvement il fait avancer les ventres des platines jusqu’entre les têtes des aiguilles, & même un peu au-delà. Alors l’ouvrage paroît tomber, mais il est toûjours soûtenu par les aiguilles ; la maille est seulement achevée. Voyez la Planche seconde du Faiseur de bas au métier, fig. 2. 5, & 6. Dans la cinquieme manœuvre, la presse est sur les becs des aiguilles, & la soie est amenée sur leurs extrémités, comme on voit dans les fig. 1. 3. 4. mais dans l’abatage la presse est relevée, les ventres B des platines, (fig. 2.) ont fait tomber au-delà des têtes des aiguilles la soie qui n’étoit que sur leurs extrémités, comme on voit (fig. 2. 5. 6.) On voit (fig. 2.) les ventres B C des platines avancés entre les tétes des aiguilles. On voit (fig. 5.) l’ouvrage 3. 4. abattu ; & on voit (fig. 6.) l’ouvrage abattu & soutenu par les aiguilles, avec les mailles formées, 5, 6. Voyez l’article Bas.
Abatage, terme de Charpentier. Quand on a une piece de bois à lever, on pousse le bout d’un levier sous cette piece, on place un coin à un pié ou environ de ce bout ; on conçoit que plus le coin est voisin du bout du levier qui est sous la piece à lever, plus l’autre extrémité du levier doit être élevée, & que plus cette extrémité est élevée, plus l’effet du levier sera considérable. On attache une corde à cette extrémité élevée du levier ; les ouvriers tirent tous à cette corde : à mesure qu’ils font baisser cette extrémité du levier à laquelle leur force est appliquée, l’extrémité qui est sous la piece s’éleve, & avec elle la piece de bois. Voilà ce qu’on appelle en charpenterie, faire un abatage.
ABATANT, s. m. c’est un chassis de croisée, ou un volet ferré par le haut, qui se leve au plancher, en s’ouvrant par le moyen d’une corde passée dans une poulie. On s’en sert dans le haut des fermetures de boutiques : les Marchands d’étoffes en font toûjours usage dans leurs magasins ; ils n’ont par ce moyen de jour, que ce qu’il en faut pour faire valoir les couleurs de leurs étoffes, en n’ouvrant l’abatant qu’autant qu’il est à propos. (P)
Abatant, (Métier à faire des bas.) On donne ce nom aux deux parties (85 96) (85 96) semblables & semblablement placées du Bas au métier, planche 6. figure 2. Il faut y distinguer plusieurs parties ; on voit sur leur face antérieure une piece 94, 94 qu’on appelle garde platine ; sur leur face postérieure une piece 95 95, qu’on appelle le crochet du dedans de l’abatant : & sous leur partie inférieure une piece 96 96, qu’on appelle le crochet de dessous des abatans. Il n’y a pas une de ces pieces qui n’ait son usage, relatif à son lieu & à sa configuration. Voyez pour vous en convaincre, l’article Bas. L’extrémité supérieure des abatans 85, 85, s’assemble & s’ajuste dans la charniere des épaulieres, comme on voit aisément dans la figure premiere de la même Planche.
* ABAT CHAUVÉE, s. f. sorte de laine de qualité subalterne à laquelle on donne ce nom dans l’Angoumois, la Xaintonge, la Marche & le Limosin.
ABATÉE ou ABBATÉE, s. f. On se sert de ce terme pour exprimer le mouvement d’un vaisseau en panne, qui arrive de lui-même jusqu’à un certain point, pour revenir ensuite au vent. Voyez Panne & Arriver. (Z)
ABATELEMENT, s. m. terme de commerce usité parmi les François dans les Echelles du Levant. Il signifie une Sentence du Conseil portant interdiction de commerce contre les Marchands & Négocians de la Nation qui désavouent leurs marchés, ou qui refusent de payer leurs dettes. Cette interdiction est si rigide, qu’il n’est pas même permis à ceux contre qui elle est prononcée d’intenter aucune action pour le payement de leurs dettes, jusqu’à ce qu’ils ayent satisfait au Jugement du Conseil, & fait lever l’abatelement en payant & exécutant ce qui y est contenu. Dictionn. du Commerce, tome I. page 548. (G)
ABATEMENT, s. m. état de foiblesse dans lequel se trouvent les personnes qui ont été malades, ou celles qui sont menacées de maladie. Dans les personnes revenues de maladie, l’abatement par lui-même n’annonce aucune suite fâcheuse : mais c’est, selon Hippocrate, un mauvais symptome dans les personnes malades, quand il n’est occasionné par aucune évacuation ; & dans les personnes en santé, quand il ne provient ni d’exercice, ni de chagrin, ni d’aucune autre cause de la même évidence. (N)
ABATIS, s. m. Les Carriers appellent ainsi les pierres qu’ils ont abatues dans une carriere, soit la bonne pour bâtir, ou celle qui est propre à faire du moilon. Ce mot se dit aussi de la démolition & des décombres d’un bâtiment. (P)
Abatis, c’est dans l’Art Militaire une quantité de grands arbres que l’on abat & que l’on entasse les uns sur les autres pour empêcher l’ennemi de pénétrer dans des retranchemens ou dans quelque autre lieu. On étend ces arbres tout de leur long le pié en dedans ; on les attache ferme les uns contre les autres, & si près, que leurs branches s’entrelassent ou s’embrassent réciproquement.
On se sert de cette espece de retranchement pour boucher des défilés & pour se couvrir dans les passages des rivieres. Il est important d’avoir quelque fortification à la tête du passage, pour qu’il ne soit point insulté par l’ennemi ; il n’y a point d’obstacles plus redoutables à lui opposer que les abatis. On se trouve à couvert de ses coups derriere les branches, & il est impossible aux ennemis de les aborder & de joindre ceux qui les défendent, & qui voyent à travers les branches sans être vûs.
On se sert encore d’abatis pour mettre des postes d’infanterie dans les bois & les villages à l’abri d’être emportés par l’ennemi ; dans les circonvallations & les lignes on s’en sert pour former la partie de ces ouvrages qui occupe les bois & les autres lieux qui fournissent cette fortification. (Q)
Abatis, se dit de la coupe d’un bois ou d’une forêt, laquelle se doit faire suivant les Ordonnances. Plusieurs observent que l’abatis se fasse en décours de lune, parce que avant ce tems-là, le bois deviendroit vermoulu. C’est l’opinion la plus commune, & elle n’est peut-être pas plus certaine que celle de ne semer qu’en pleine lune & de ne greffer qu’en decours.
Abatis, se dit de l’action d’un chasseur qui tue beaucoup de gibier ; c’est aussi le nom qu’on donne aux petits chemins que les jeunes loups se font en allant & venant au lieu où ils sont nourris ; & quand les vieux loups ont tué des bêtes, on dit, les loups ont fait cette nuit un grand abatis.
Abatis. On entend par ce mot la tête, les pattes, les ailerons, le foie, & une partie des entrailles d’une oie, d’un dindon, chapon & autre volaille.
Les Cuisiniers font un grand usage des abatis, & les font servir bouillis, à l’étuvé, en ragoût, en pâté, &c.
* Abatis, lieu où les Bouchers tuent leurs bestiaux. Voyez Tuerie.
* Abatis, dans les tanneries, chamoiseries, &c. On appelle cuirs d’abatis, les cuirs encore en poil, & tels qu’ils viennent de la boucherie.
ABATON, s. m. c’est le nom que donnerent les Rhodiens à un grand édifice qu’ils construisirent pour masquer deux Statues de bronze que la Reine Artemise avoit élevées dans leur ville en mémoire de son triomphe sur eux. Vitruve, Livre II. p. 48. (P)
* ABATOS, s. isle d’Egypte dans le Palus de Memphis.
ABATTRE, v. a. Abattre une maison, un mur, un plancher. &c. Voyez Démolir. (P)
Abattre, arriver, dériver, obéir au vent, lorsqu’un vaisseau est sous voile. Ces termes se prennent en différens sens. On dit qu’un vaisseau abat, quand il est détourné de sa route par la force des courants, par les vagues & par les marées.
Faire abattre un vaisseau, c’est le faire obéir au vent lorsqu’il est sous les voiles, ou qu’il présente trop le devant au lieu d’où vient le vent ; ce qui s’exécute par le jeu du gouvernail, dont le mouvement doit être secondé par une façon de porter ou d’orienter les voiles.
On dit que le vaisseau abat, lorsque l’ancre a quitté le fond, & que le vaisseau arrive ou obéit au vent. Voyez Arriver.
Abattre un vaisseau, c’est le mettre sur le côté pour travailler à la carene, ou à quelqu’endroit qu’il faut mettre hors de l’eau, pour qu’on puisse le radouber. Voyez Carene. Radoub. (Z)
Abattre un cheval, c’est le faire tomber sur le côté par le moyen de certains cordages appellés entraves & lacs. On l’abat ordinairement pour lui faire quelque opération de Chirurgie, ou même pour le ferrer lorsqu’il est trop difficile.
Abattre l’eau : c’est essuyer le corps d’un cheval qui vient de sortir de l’eau, ou qui est en sueur ; ce qui se fait par le moyen de la main ou du couteau de chaleur.
S’abattre, se dit plus communément des chevaux de tirage qui tombent en tirant une voiture. (V)
Abattre l’oiseau, c’est le tenir & serrer entre deux mains pour lui donner quelques médicamens. On dit, il faut abattre l’oiseau.
Abattre, sixieme manœuvre du Faiseur de bas au métier. Voyez Abatage. Voyez aussi Bas au métier.
Abattre, terme de Chapelier, c’est applatir sur un bassin chaud le dessus de la forme & les bords d’un chapeau, après lui avoir donné l’apprêt & l’avoir bien fait sécher ; pour cet effet il faut que le bassin soit couvert de toile & de papiers, qu’on arrose avec un goupillon.
Abattre du bois au trictrac ; c’est étaler beaucoup de dames de dessus le premier tas, pour faire plus facilement des cases dans le courant du jeu. V. Case.
ABATTUE. s. f. On entend à Moyenvic & dans les autres Salines de Franche-Comté par une abattue, le travail continu d’une poële, depuis le moment où on la met en feu, jusqu’à celui où on la laisse reposer. A Moyenvic chaque abattue est composée de dix-huit tours, & chaque tour de vingt-quatre heures. Mais comme on laisse six jours d’intervalle entre chaque abattue, il ne se fait à Moyenvic qu’environ 20 abattues par an. La poële s’évalue à deux cens quarante muids par abattue. Son produit annuel seroit donc de 4800 muids, si quelques causes particulieres, qu’on exposera à l’article Saline, ne réduisoient l’abattue d’une poële à 220 muids, & par conséquent son produit annuel à 4400 muids : surquoi déduisant le déchet à raison de 7 à 8 pour , on peut assûrer qu’une Saline, telle que celle de Moyenvic, qui travaille à trois poëles bien soutenues, fabriquera par an douze mille trois à quatre cens muids de sel. V. Saline.
ABATTURES, s. f. pl. ce sont les traces & foulures que laisse sur l’herbe, dans les brossailles, ou dans les taillis, la bête fauve en passant : on connoît le cerf par ses abattures.
ABAVENTS, s. m. plur. ce sont de petits auvents au-dehors des tours & clochers dans les tableaux des ouvertures, faits de chassis de charpente, couverts d’ardoise ou de plomb, qui servent à empêcher que le son des cloches ne se dissipe en l’air, & à le renvoyer en bas, dit Vignole après Daviler. Ils garantissent aussi le béfroi de charpente de la pluie qui entreroit par les ouvertures. (P)
* ABARI, Abaro, Abarum, s. m. grand arbre d’Ethiopie, qui porte un fruit semblable à la citrouille. Voilà tout ce qu’on en sait, & c’est presqu’en être réduit à un mot. (I)
* ABAWIWAR, s. m. Château & contrée de la haute Hongrie.
* ABAZÉE, s. f. Voyez Sabasie.
* ABAYANCE, s. f. Attente ou espérance, fondée sur un jugement à venir.
ABBAASI, s. m. monnoie d’argent de Perse. Schah-Abas, deuxieme Roi de Perse, ordonna la fabrication de pieces d’argent, nommées abbaasi. La légende est relative à l’alcoran, & les empreintes au nom de ce Roi, & à la Ville où cette sorte d’espece a été fabriquée.
Un abbaasi vaut deux mamoudis ou quatre chayés. Le chayé vaut un peu plus de quatre sous six deniers de France. Ainsi l’abbaasi vaut, monnoie de France, dix-huit sols & quelques deniers, comme quatre à cinq deniers.
Il y a des doubles abbaasi, des triples & des quadruples : mais ces derniers sont rares.
Comme les abbaasi sont sujets à être altérés, il est bon de les peser ; & c’est pourquoi les payemens en cette espece de monnoie se font au poids, & non pas au nombre de pieces. (G)
* ABBA. V. la signification d’Ab chez les Hébreux.
ABBAYE, s. f. Monastere ou Maison Religieuse, gouvernée par un Supérieur, qui prend le titre d’Abbé ou d’Abbesse. Voyez Abbé, &c.
Les Abbayes different des Prieurés, en ce qu’elles sont sous la direction d’un Abbé ; au lien que les Prieurés sont sous la direction d’un Prieur : mais l’Abbé & le Prieur (nous entendons l’Abbé Conventuel) sont au fond la même chose, & ne different que de nom. Voyez Prieur.
Fauchet observe que dans le commencement de la Monarchie Françoise, les Ducs & les Comtes s’appelloient Abbés, & les Duchés & Comtés, Abbayes. Plusieurs personnes de la premiere distinction, sans être en aucune sorte engagées dans l’état Monastique, prenoient la même qualité. Il y a même quelques Rois de France qui sont traités d’Abbés dans l’Histoire. Philippe I. Louis VII. & ensuite les Ducs d’Orléans, prirent le titre d’Abbés du Monastere de S. Agnan. Les Ducs d’Aquitaine sont appellés Abbés du Monastere de S. Hilaire de Poitiers, & les Comtes d’Anjou, de celui de S. Aubin, &c. Mais c’est qu’ils possédoient en effet ces Abbayes, quoique laïques. Voyez Abbé.
Abbaye se prend aussi pour le bénéfice même, & le revenu dont joüit l’Abbé.
Le tiers des meilleurs Bénéfices d’Angleterre étoit anciennement, par la concession des Papes, approprié aux Abbayes & autres Maisons Religieuses : mais sous Henri VIII. ils furent abolis, & devinrent des Fiefs séculiers. 190 de ces Bénéfices abolis, rapportoient annuellement entre 200 l. & 35000 l. ce qui en prenant le milieu, se monte à 2853000 l. par an.
Les Abbayes de France sont toutes à la nomination du Roi, à l’exception d’un petit nombre ; savoir, parmi les Abbayes d’Hommes, celles qui sont Chefs d’Ordre, comme Cluny, Cîteaux avec ses quatre Filles, &c. & quelques autres de l’Ordre de Saint-Benoît, & de celui des Prémontrés : & parmi les Abbayes de Filles, celles de Sainte-Claire, où les Religieuses, en vertu de leur Regle, élisent leur Abbesse tous les trois ans. On peut joindre à ces dernieres, celles de l’Ordre de Saint Augustin, qui ont conservé l’usage d’élire leur Abbesse à vie, comme les Chanoinesses de S. Cernin à Toulouse.
C’est en vertu du Concordat entre Léon X. & François I. que les Rois de France ont la nomination aux Abbayes de leur Royaume. (H)
ABBÉ, s. m. Supérieur d’un Monastere de Religieux, érigé en Abbaye ou Prélature. Voyez Abbaye & Abbesse.
Le nom d’Abbé tire son origine du mot hébreu אב, qui signifie pere ; d’où les Chaldéens & les Syriens ont formé abba : de là les Grecs abbas, que les Latins ont retenu. D’abbas vient en françois le nom d’Abbé, &c. S. Marc & S. Paul, dans leur Texte grec, se servent du Syriaque abba, parce que c’étoit un mot communément connu dans les Synagogues & dans les premieres assemblées des Chrétiens. Ils y ajoûtent en forme d’interprétation, le nom de pere, abba, Ὁ Πατήρ, abba, pere, comme s’ils disoient, abba, c’est-à-dire, pere. Mais ce nom ab & abba, qui d’abord étoit un terme de tendresse & d’affection en Hébreu & en Chaldéen, devint ensuite un titre de dignité & d’honneur. Les Docteurs Juifs l’affectoient, & un de leurs plus anciens Livres, qui contient les Apophthegmes, ou Sentences de plusieurs d’entre eux, est intitulé Pirke abbot, ou avot ; c’est-à-dire, Chapitre des Peres. C’est par allusion à cette affectation que J. C. défendit à ses Disciples d’appeller pere aucun homme sur la terre : & S. Jerôme applique cette défense aux Supérieurs des Monasteres de son tems, qui prenoient le titre d’Abbé ou de Pere.
Le nom d’Abbé par conséquent paroît aussi ancien que l’Institution des Moines eux-mêmes. Les Directeurs des premiers Monasteres prenoient indifféremment les titres d’Abbés ou d’Archimandrites. Voyez Moine & Archimandrite.
Les anciens Abbés étoient des Moines qui avoient établi des Monasteres ou Communautés, qu’ils gouvernoient comme S. Antoine & S. Pacôme ; ou qui avoient été préposés par les Instituteurs de la vie monastique pour gouverner une Communauté nombreuse, résidante ailleurs que dans le chef-lieu de l’Ordre ; ou enfin, qui étoient choisis par les Moines mêmes d’un Monastere, qui se soûmettoient à l’autorité d’un seul. Ces Abbés & leurs Monasteres, suivant la disposition du Concile de Chalcédoine, étoient soûmis aux Evêques, tant en Orient qu’en Occident. A l’égard de l’Orient, le quatrieme Canon de ce Concile en fait une loi ; & en Occident, le 21e Canon du premier Concile d’Orléans, le 19 du Concile d’Epaune, le 22 du II. Concile d’Orléans, & les Capitulaires de Charlemagne, en avoient reglé l’usage, surtout en France. Depuis ce tems-là quelques Abbés ont obtenu des exemptions des Ordinaires pour eux & pour leurs Abbayes, comme les Monasteres de Lérins, d’Agaune, & de Luxeuil. Ce Privilége leur étoit accordé du consentement des Evêques, à la priere des Rois & des Fondateurs. Les Abbés néanmoins étoient bénis par les Evêques, & ont eu souvent séance dans les Conciles après eux : quelques-uns ont obtenu la permission de porter la Crosse & la Mitre ; d’autres de donner la Tonsure & les Ordres mineurs. Innocent VIII. a même accordé à l’Abbé de Cîteaux le pouvoir d’ordonner des Diacres & des Soûdiacres, & de faire diverses Bénédictions, comme celles des Abbesses, des Autels, & des Vases sacrés.
Mais le gouvernement des Abbés a été différent, selon les différentes especes de Religieux. Parmi les anciens Moines d’Egypte, quelque grande que fût l’autorité des Abbés, leur premiere supériorité étoit celle du bon exemple & des vertus : ni eux, ni leurs inférieurs, n’étoient Prêtres, & ils étoient parfaitement soûmis aux Evêques. En Occident, suivant la Regle de Saint Benoît, chaque Monastere étoit gouverné par un Abbé, qui étoit le Directeur de tous ses Moines pour le spirituel & pour la conduite intérieure. Il disposoit aussi de tout le temporel, mais comme un bon pere de famille ; les Moines le choisissoient d’entre eux, & l’Evêque diocésain l’ordonnoit Abbé par une Bénédiction solemnelle : cérémonie formée à l’imitation de la Consécration des Evêques. Les Abbés étoient souvent ordonnés Prêtres, mais non pas toûjours. L’Abbé assembloit les Moines pour leur demander leur avis dans toutes les rencontres importantes, mais il étoit le maître de la décision ; il pouvoit établir un Prevôt pour le soulager dans le gouvernement ; & si la Communauté étoit nombreuse, il mettoit des Doyens pour avoir soin chacun de dix Religieux, comme le marque le mot Decanus. Au reste, l’Abbé vivoit comme un autre Moine, excepté qu’il étoit chargé de tout le soin de la Maison, & qu’il avoit sa Mense, c’est-à-dire, sa table à part pour y recevoir les hôtes ; ce devoir ayant été un des principaux motifs de la fondation des Abbayes.
Ils étoient réellement distingués du Clergé, quoique souvent confondus avec les Ecclésiastiques, à cause de leur degré au-dessus des Laïques. S. Jerôme écrivant à Héliodore, dit expressément : alia Monachorum est causa, alia Clericorum. Voyez Clergé, Prêtres, &c.
Dans ces premiers tems, les Abbés étoient soûmis aux Evêques & aux Pasteurs ordinaires. Leurs Monasteres étant éloignés des Villes, & bâtis dans les solitudes les plus reculées, ils n’avoient aucune part dans les affaires ecclésiastiques. Ils alloient les Dimanches aux Eglises Paroissiales avec le reste du peuple ; ou s’ils étoient trop éloignés, on leur envoyoit un Prêtre pour leur administrer les Sacremens : enfin on leur permit d’avoir des Prêtres de leur propre Corps. L’Abbé lui-même ou l’Archimandrite, étoit ordinairement Prêtre : mais ses fonctions ne s’étendoient qu’à l’assistance spirituelle de son Monastere, & il demeuroit toujours soûmis à son Evêque.
Comme il y avoit parmi les Abbés plusieurs Personnes savantes, ils s’opposerent vigoureusement aux hérésies qui s’éleverent de leur tems ; ce qui donna occasion aux Evêques de les appeller de leurs déserts, & de les établir d’abord aux environs des Faubourgs des Villes, & ensuite dans les Villes mêmes. C’est de ce tems que l’on doit dater l’époque de leur relâchement. Ainsi les Abbés étant bientôt déchûs de leur premiere simplicité, ils commencerent à être regardés comme une espece de petits Prélats. Ensuite ils affecterent l’indépendance de leurs Evêques, & devinrent si insupportables, que l’on fit contre-eux des lois fort séveres au Concile de Chalcédoine & autres, dont on a parlé.
L’Ordre de Cluny pour établir l’uniformité, ne voulut avoir qu’un seul Abbé. Toutes les Maisons qui en dépendoient, n’eurent que des Prieurs, quelques grandes qu’elles fussent, & cette forme de gouvernement a subsisté jusqu’à présent. Les Fondateurs de Cîteaux crurent que le relâchement de Cluny venoit en partie de l’autorité absolue des Abbés : pour y remédier ils donnerent des Abbés à tous les nouveaux Monasteres qu’ils fonderent, & voulurent qu’ils s’assemblassent tous les ans en Chapitre général, pour voir s’ils étoient uniformes & fideles à observer la Regle. Ils conserverent une grande autorité à Cîteaux sur ses quatre premieres Filles, & à chacune d’elles sur les Monasteres de sa filiation ; ensorte que l’Abbé d’une Mere Eglise présidât à l’élection des Abbés des Filles, & qu’il pût avec le conseil de quelques Abbés, les destituer s’ils le méritoient.
Les Chanoines Réguliers suivirent à peu près le gouvernement des Moines, & eurent des Abbés dans leurs principales Maisons, de l’élection desquels ils demeurerent en possession jusqu’au Concordat de l’an 1516, qui transporta au Roi en France le droit des élections pour les Monasteres, aussi-bien que pour les Evêchés. On a pourtant conservé l’élection aux Monasteres qui sont Chefs-d’Ordre, comme Cluny, Cîteaux & ses quatre Filles, Prémontré, Grammont, & quelques autres ; ce qui est regardé comme un privilége, quoiqu’en effet ce soit un reste du Droit commun.
Les biens des Monasteres étant devenus considérables, exciterent la cupidité des Séculiers pour les envahir. Dès le V. siecle en Italie & en France, les Rois s’en emparerent, ou en gratifierent leurs Officiers & leurs Courtisans. En vain les Papes & les Evêques s’y opposerent-ils. Cette licence dura jusqu’au Regne de Dagobert, qui fut plus favorable à l’Eglise : mais elle recommença sous Charles Martel, pendant le Regne duquel les Laïques se mirent en possession d’une partie des biens des Monasteres, & prirent même le titre d’Abbés. Pepin & Charlemagne réformerent une partie de ces abus, mais ne les détruisirent pas entierement ; puisque les Princes leurs successeurs donnoient eux-mêmes les revenus des Monasteres à leurs Officiers, à titre de récompense pour leurs services, d’où est venu le nom de Bénéfice, & peut-être l’ancien mot, Beneficium propter officium ; quoiqu’on l’entende aujourd’hui dans un sens très-différent, & qui est le seul vrai, savoir des services rendus à l’Eglise. Charles le Chauve fit des lois pour modérer cet usage, qui ne laissa pas de subsister sous ses successeurs. Les Rois Philippe I. & Louis VI. & ensuite les Ducs d’Orléans, sont appellés Abbés du Monastere de S. Aignan d’Orléans. Les Ducs d’Aquitaine prirent le titre d’Abbés de S. Hilaire de Poitiers. Les Comtes d’Anjou, celui d’Abbés de S. Aubin ; & les Comtes de Vermandois, celui d’Abbés de S. Quentin. Cette coûtume cessa pourtant sous les premiers Rois de la troisieme race ; le Clergé s’opposant à ces innovations, & rentrant de tems en tems dans ses droits.
Mais quoiqu’on n’abandonnât plus les revenus des Abbayes aux Laïques, il s’introduisit, surtout pendant le schisme d’Occident, une autre coûtume, moins éloignée en général de l’esprit de l’Eglise, mais également contraire au droit des Réguliers. Ce fut de les donner en commende à des Clercs séculiers ; & les Papes eux-mêmes furent les premiers à en accorder, toûjours pour de bonnes intentions, mais qui manquerent souvent d’être remplies. Enfin par le Concordat entre Léon X. & François I. la nomination des Abbayes en France fut dévolue au Roi, à l’exception d’un très-petit nombre ; ensorte que maintenant presque toutes sont en commende.
Malgré les Reglemens des Conciles dont nous avons parlé, les Abbés, surtout en Occident, prirent le titre de Seigneur, & des marques de l’Episcopat, comme la Mitre. C’est ce qui donna l’origine à plusieurs nouvelles especes d’Abbés ; sçavoir aux Abbés mitrés, crossés, & non crossés ; aux Abbés œcuméniques, aux Abbés Cardinaux, &c.
Les Abbés mitrés sont ceux qui ont le privilége de porter la Mitre, & qui ont en même tems une autorité pleinement épiscopale dans leurs divers territoires. En Angleterre on les appelloit aussi Abbés souverains & Abbés généraux, & ils étoient Lords du Parlement. Selon le Sr. Edouard Coke, il y en avoit en Angleterre vingt-sept de cette sorte, sans compter deux Prieurs mitrés. Voyez Prieur. Les autres qui n’étoient point mitrés, étoient soûmis à l’Evêque diocésain.
Le Pere Hay, Moine Bénédictin, dans son Livre intitulé Astrun inextinctum, soûtient que les Abbés de son Ordre ont non-seulement une Jurisdiction [comme] épiscopale, mais même une Jurisdiction [comme] papale. Potestatem quasi episcopalem, imo quasi papalem : & qu’en cette qualité ils peuvent conférer les Ordres inférieurs de Diacres & de Soûdiacres. Voyez Ordination.
Lorsque les Abbés commencerent à porter la Mitre, les Evêques se plaignirent amerement que leurs priviléges étoient envahis par des Moines : ils étoient principalement choqués de ce que dans les Conciles & dans les Synodes, il n’y avoit aucune distinction entre-eux. C’est à cette occasion que le Pape Clément IV. ordonna que les Abbés porteroient seulement la Mitre brodée en or, & qu’ils laisseroient les pierres précieuses aux Evêques. Voyez Mitre.
Les Abbés crossés sont ceux qui portent les Crosses ou le Bâton pastoral. Voyez Crosse.
Il y en a quelques-uns qui sont crossés & non mitrés, comme l’Abbé d’une Abbaye de Bénédictins à Bourges ; & d’autres qui sont l’un & l’autre.
Parmi les Grecs il y a des Abbés qui prennent même la qualité d’Abbés œcuméniques, ou d’Abbés universels, à l’imitation des Patriarches de Constantinople. Voyez Œcuménique.
Les Latins n’ont pas été de beaucoup inférieurs aux Grecs à cet égard. L’Abbé de Cluny dans un Concile tenu à Rome, prend le titre d’Abbas Abbatum, Abbé des Abbés : & le Pape Calixte donne au même Abbé le titre d’Abbé Cardinal. Voyez Cluny. (L’Abbé de la Trinité de Vendôme se qualifie aussi Cardinal-Abbé) pour ne rien dire des autres Abbés-Cardinaux, ainsi appellés, de ce qu’ils étoient les principaux Abbés des Monasteres, qui dans la suite vinrent à être séparés.
Les Abbés-Cardinaux qui sont séculiers, ou qui ne sont point Chefs-d’Ordre, n’ont point de jurisdiction sur les Religieux, ni d’autorité dans l’intérieur des Monasteres.
Les Abbés aujourd’hui se divisent principalement en Abbés Réguliers (ou Titulaires), & en Abbés Commendataires.
Les Abbés Réguliers sont de véritables Moines ou Religieux, qui ont fait les vœux & portent l’habit de l’Ordre. Voyez Régulier, Religieux, &c.
Tous les Abbés sont présumés être tels, les Canons défendant expressément qu’aucun autre qu’un Moine ait le commandement sur des Moines : mais dans le fait il en est bien autrement.
En France les Abbés Réguliers n’ont la jurisdiction sur leurs Moines que pour la correction Monachale concernant la Regle. S’il est question d’autre excès non concernant la Regle, ce n’est point à l’Abbé, mais à l’Evêque d’en connoître ; & quand ce sont des excès privilégiés, comme s’il y a port d’armes, ce n’est ni à l’Abbé, ni à l’Evêque, mais au Juge Royal d’en connoître.
Les Abbés Commendataires, ou les Abbés en commende, sont des Séculiers qui ont été auparavant tonsurés. Ils sont obligés par leurs Bulles de prendre les Ordres quand ils seront en âge. Voyez Séculier, Tonsure, &c.
Quoique le terme de Commende insinue qu’ils ont seulement pour un tems l’administration de leurs Abbayes, ils ne laissent pas d’en joüir toute leur vie, & d’en percevoir toûjours les fruits, aussi-bien que les Abbés Réguliers.
Les Bulles leur donnent un plein pouvoir, tam in spiritualibus quam in temporalibus : mais dans la réalité les Abbés Commendataires n’exercent aucune fonction spirituelle envers leurs Moines, & n’ont sur eux aucune jurisdiction : ainsi cette expression in spiritualibus, n’est que de style dans la Cour de Rome, & n’emporte avec elle rien de réel.
Quelques Canonistes mettent les Abbayes en Commende au nombre des Bénéfices, inter titulos Beneficiorum : mais elles ne sont réellement qu’un titre canonique, ou une provision pour joüir des fruits d’un Bénéfice ; & comme de telles provisions sont contraires aux anciens Canons, il n’y a que le Pape qui puisse les accorder en dispensant du Droit ancien. Voyez Commende, Bénéfice, &c.
Comme l’Histoire d’Angleterre parle très-peu de ces Abbés Commendataires, il est probable qu’ils n’y furent jamais communs : ce qui a donné lieu à quelques Auteurs de cette Nation de se méprendre, en prenant tous les Abbés pour des Moines. Nous en avons un exemple remarquable dans la dispute touchant l’Inventeur des Lignes, pour transformer les Figures géométriques, appellées par les Francois les Lignes Robervalliennes. Le Docteur Gregory dans les Transactions philosophiques, année 1694, tourne en ridicule l’Abbé Gallois, Abbé Commendataire de l’Abbaye de S. Martin de Cores ; & le prenant pour un Moine : « Le bon Pere, dit-il, s’imagine que nous sommes revenus à ces tems fabuleux, où il étoit permis à un Moine de dire ce qu’il vouloit ».
L’Abbé releve cette méprise, & retorque avec avantage la raillerie sur le Docteur dans les Mémoires de l’Académie, année 1703.
La cérémonie par laquelle on établit un Abbé, se nomme proprement Bénédiction, & quelquefois, quoiqu’abusivement, Consécration. Voyez Bénédiction & Consécration.
Cette cérémonie consistoit anciennement à revêtir l’Abbé de l’habit appellé Cuculla, Coulle, en lui mettant le Bâton pastoral dans la main, & les souliers, appellés pedales, (sandales) à ses piés. Nous apprenons ces particularités de l’Ordre Romain de Théodore, Archevêque de Cantorbéry.
En France la nomination & la collation des Bénéfices dépendans des Abbayes en Commende, appartiennent à l’Abbé seul, à l’exclusion des Religieux. Les Abbés Commendataires doivent laisser aux Religieux le tiers du revenu de leurs Abbayes franc & exempt de toutes charges. Les biens de ces Abbayes se partagent en trois lots : le premier est pour l’Abbé ; le second pour les Religieux, & le troisieme est affecté aux réparations & charges communes de l’Abbaye ; c’est l’Abbé qui en a la disposition. Quoique le partage soit fait entre l’Abbé & les Religieux, ils ne peuvent ni les uns, ni les autres, aliéner aucune partie des fonds dont ils joüissent, que d’un commun consentement, & sans observer les solemnités de Droit.
La Profession des Religieux faite contre le consentement de l’Abbé est nulle. L’Abbé ne peut cependant recevoir aucun Religieux sans prendre l’avis de la Communauté.
Les Abbés tiennent le second rang dans le Clergé, & sont immédiatement après les Evêques : les Abbés Commendataires doivent marcher avec les Réguliers, & concurremment avec eux, selon l’ancienneté de leur réception.
Les Abbés Réguliers ont trois sortes de Puissance : l’Œconomique, celle d’Ordre, & celle de Jurisdiction. La premiere consiste dans l’administration du temporel du Monastere : la seconde, à ordonner du Service-Divin, recevoir les Religieux à Profession, leur donner la Tonsure, conférer les Bénéfices qui sont à la nomination du Monastere : la troisieme, dans le droit de corriger, d’excommunier, de suspendre. L’Abbé Commendataire n’a que les deux premieres sortes de Puissance. La troisieme est exercée en sa place par le Prieur-claustral, qui est comme son Lieutenant pour la discipline intérieure du Monastere. Voyez Prieur & Claustral.
Abbé, est aussi un titre que l’on donne à certains Evêques, parce que leurs Siéges étoient originairement des Abbayes, & qu’ils étoient même élûs par les Moines : tels sont ceux de Catane & de Montréal en Sicile. Voyez Evêque.
Abbé, est encore un nom que l’on donne quelquefois aux Supérieurs ou Généraux de quelques Congrégations de Chanoines Réguliers, comme est celui de Sainte Génevieve à Paris. Voyez Chanoine, Génevieve, &c.
Abbé, est aussi un titre qu’ont porté différens Magistrats, ou autres personnes laïques. Parmi les Génois, un de leurs premiers Magistrats étoit appellé l’Abbé du Peuple : nom glorieux, qui dans son véritable sens signifioit Pere du Peuple. (H & G)
ABBECHER ou ABBECQUER, v. a. c’est donner la becquée à un oiseau qui ne peut pas manger de lui-même.
Abbecquer ou abbécher l’oiseau, c’est lui donner seulement une partie du pât ordinaire pour le tenir en appétit ; on dit, il faut abbecquer le lanier.
ABBESSE, s. f. nom de dignité. C’est la Supérieure d’un Monastere de Religieuses, ou d’une Communauté ou Chapitre de Chanoinesses, comme l’Abbesse de Remiremont en Lorraine.
Quoique les Communautés de Vierges consacrées à Dieu soient plus anciennes dans l’Eglise que celles des Moines, néanmoins l’Institution des Abbesses est postérieure à celle des Abbés. Les premieres Vierges qui se sont consacrées à Dieu, demeuroient dans leurs maisons paternelles. Dans le IVe siecle elles s’assemblerent dans des Monasteres, mais elles n’avoient point d’Eglise particuliere ; ce ne fut que du tems de saint Grégoire qu’elles commencerent à en avoir qui fissent partie de leurs Convens. L’Abbesse étoit autrefois élûe par sa Communauté, on les choisissoit parmi les plus anciennes & les plus capables de gouverner ; elles recevoient la bénédiction de l’Evêque, & leur autorité étoit perpétuelle.
L’Abbesse a les mêmes droits & la même autorité sur ses Religieuses, que les Abbés Réguliers ont sur leurs Moines. Voyez Abbé.
Les Abbesses ne peuvent à la vérité, à cause de leur sexe, exercer les fonctions spirituelles attachées à la Prêtrise, au lieu que les Abbés en sont ordinairement revêtus. Mais il y a des exemples de quelques Abbesses qui ont le droit, ou plûtôt le privilége de commettre un Prêtre qui les exerce pour elles. Elles ont même une espece de jurisdiction épiscopale, aussi bien que quelques Abbés, qui sont exempts de la visite de leurs Evêques diocésains. V. Exemption.
L’Abbesse de Fontevraud, par exemple, a la supériorité & la direction, non-seulement sur ses Religieuses, mais aussi sur tous les Religieux qui dépendent de son Abbaye. Ces Religieux sont soumis à sa correction, & prennent leur mission d’elle.
En France la plûpart des Abbesses sont nommées par le Roi. Il y a cependant plusieurs Abbayes & Monasteres qui se conferent par élection, & sont exempts de la nomination du Roi, comme les Monasteres de Sainte Claire.
Il faut remarquer, que quoique le Roi de France ait la nomination aux Abbayes de Filles, ce n’est pas cependant en vertu du Concordat ; car les Bulles que le Pape donne pour ces Abbesses, portent que le Roi a écrit en faveur de la Religieuse nommée, & que la plus grande partie de la Communauté consent à son élection, pour conserver l’ancien droit autant qu’il se peut. Selon le Concile de Trente, celles qu’on élit Abbesses doivent avoir 40 ans d’âge, & 8 de profession, ou avoir au moins 5 ans de profession, & être âgées de 30 ans. Et suivant les Ordonnances du Royaume, toute Supérieure, & par conséquent toute Abbesse, doit avoir 10 ans de profession, ou avoir exercé pendant 6 ans un office claustral. M. Fleury, Inst. au Droit Eccles.
Le Pere Martene dans son Traité des Rits de l’Eglise, tome II. page 39. observe que quelques Abbesses confessoient anciennement leurs Religieuses. Il ajoute, que leur curiosité excessive les porta si loin, que l’on fut obligé de la réprimer.
Saint Basile dans ses Regles abregées. interrog. 110, tom. II. page 453. permet à l’Abbesse d’entendre avec le Prêtre les confessions de ses Religieuses. Voyez Confession.
Il est vrai, comme l’observe le Pere Martene dans l’endroit cité, que jusqu’au 13e siecle non-seulement les Abbesses, mais les Laïques mêmes entendoient quelquefois les confessions, principalement dans le cas de nécessité : mais ces confessions n’étoient point sacramentales, & se devoient aussi faire au Prêtre. Elles avoient été introduites par la grande dévotion des fideles, qui croyoient qu’en s’humiliant ainsi, Dieu leur tiendroit compte de leur humiliation : mais comme elles dégénérerent en abus, l’Eglise fut obligée de les supprimer. Il y a dans quelques Monasteres une pratique appellée la Coulpe, qui est un reste de cet ancien usage. (H & G)
* ABBEVILLE, ville considérable de France, sur la riviere de Somme qui la partage, dans la Basse-Picardie, capitale du Comté de Ponthieu. Long. 19 d. 19′. 40″. lat. trouvée de 50 d. 6′. 55″. par M. Cassini en 1688. Voyez Hist. Acad. page 56.
* ABCAS, peuple d’Asie qui habite l’Abascie.
* ABCÉDER, v. neut. Lorsque des parties qui sont unies à d’autres dans l’état de santé, s’en séparent dans l’état de maladie, en conséquence de la corruption, on dit que ces parties sont abcédées.
ABCÈS, s. m. est une tumeur qui contient du pus. Les Auteurs ne conviennent pas de la raison de cette dénomination. Quelques-uns croyent que l’abcès a été ainsi appellé du mot latin abcedere, se séparer, parce que les parties qui auparavant étoient contiguës se séparent l’une de l’autre : quelques autres, parce que les fibres y sont déchirées & détruites ; d’autres, parce que le pus s’y rend d’ailleurs, ou est séparé du sang : enfin d’autres tirent cette dénomination de l’écoulement du pus, & sur ce principe ils assûrent qu’il n’y a point proprement d’abcès jusqu’à ce que la tumeur creve & s’ouvre d’elle-même. Mais ce sont là des distinctions trop subtiles, pour que les Medecins s’y arrêtent beaucoup.
Tous les abcès sont des suites de l’inflammation. On aide la maturation des abcès par le moyen des cataplasmes ou emplâtres maturatifs & pourrissans. La chaleur excessive de la tumeur & la douleur pulsative qu’on y ressent sont avec la fievre les signes que l’inflammation se terminera par suppuration. Les frissons irréguliers qui surviennent à l’augmentation de ces symptomes sont un signe que la suppuration se fait. L’abcès est formé lorsque la matiere est convertie en pus : la diminution de la tension, de la fievre, de la douleur & de la chaleur, la cessation de la pulsation, en sont les signes rationels. L’amollissement de la tumeur & la fluctuation sont les signes sensuels qui annoncent cette terminaison. Voyez Fluctuation.
On ouvre les abcès par le caustique ou par l’incision. Les abcès ne peuvent se guérir que par l’évacuation du pus. On préfere le caustique dans les tumeurs critiques qui terminent quelquefois les fievres malignes. L’application d’un caustique fixe l’humeur dans la partie où la nature semble l’avoir déposé ; elle en empêche la résorption qui seroit dangereuse & souvent mortelle. Les caustiques déterminent une grande suppuration & en accélerent la formation. On les employe dans cette vûe avant la maturité parfaite. On met aussi les caustiques en usage dans les tumeurs qui se sont formées lentement & par congestion, qui suppurent dans un point dont la circonférence est dure, & où la conversion de l’humeur en pus seroit ou difficile ou impossible sans ce moyen.
Pour ouvrir une tumeur par le caustique, il faut la couvrir d’un emplâtre fenestré de la grandeur que l’on juge la plus convenable ; on met sur la peau à l’endroit de cette ouverture, une traînée de pierre à cautere. Si le caustique est solide, on a soin de l’humecter auparavant ; on couvre le tout d’un autre emplâtre, de compresses & d’un bandage contentif. Au bout de cinq ou six heures, plus ou moins, lorsqu’on juge, suivant l’activité du caustique dont on s’est servi, que l’escarre doit être faite, on leve l’appareil, & on incise l’escarre d’un bout à l’autre avec un bistouri, en pénétrant jusqu’au pus ; on panse la plaie avec des digestifs, & l’escarre tombe au bout de quelques jours par une abondante suppuration.
Dans les cas ordinaires des abcès, il est préférable de faire l’incision avec l’instrument tranchant qu’on plonge dans le foyer de l’abcès. Lorsque l’abcès est ouvert dans toute son étendue, on introduit le doigt dans sa cavité, & s’il y a des brides qui forment des cloisons, & séparent l’abcès en plusieurs cellules, il faut les couper avec la pointe des ciseaux ou avec le bistouri. Il faut que l’extrémité du doigt conduise toûjours ces instrumens, de crainte d’intéresser quelques parties qu’on pourroit prendre pour des brides sans cette précaution. Si la peau est fort amincie, il faut l’emporter avec les ciseaux & le bistouri. Ce dernier instrument est préférable, parce qu’il cause moins de douleur, & rend l’opération plus prompte. On choisit la partie la plus déclive pour faire l’incision aux abcès. Il faut, autant que faire se peut, ménager la peau ; dans ce dessein on fait souvent des contre-ouvertures, lorsque l’abcès est fort étendu. Voyez Contre-ouverture. Les abcès causés par la présence de quelques corps étrangers ne se guérissent que par l’extraction de ces corps. Voyez Tumeur.
Lorsque l’abcès est ouvert, on remplit de charpie mollette le vuide qu’occupoit la matiere, & on y applique un appareil contentif. On panse, les jours suivans, avec des digestifs jusqu’à ce que les vaisseaux qui répondent dans le foyer de l’abcès se soient dégorgés par la suppuration. Lorsqu’elle diminue, que le pus prend de la consistance, devient blanc & sans odeur, le vuide se remplit alors de jour en jour de mammelons charnus, & la cicatrice se forme à l’aide des pansemens méthodiques dont il sera parlé à la cure des ulceres. Voyez Ulcere.
M. Petit a donné à l’Académie Royale de Chirurgie un Mémoire important sur les tumeurs de la vésicule du fiel qu’on prend pour des abcès au foie. Les remarques de ce célebre Chirurgien enrichissent la Pathologie d’une maladie nouvelle. Il rapporte les signes qui distinguent les tumeurs de la vésicule du fiel distendue par la bile retenue, d’avec les abcès au foie. Il fait le parallele de cette rétention de la bile & de la pierre biliaire avec la rétention d’urine & la pierre de la vessie, & propose des opérations sur la vésicule du fiel à l’instar de celles qu’on fait sur la vessie. V. le 1er vol. des Mem. de l’Acad. de Chirurgie.
Il survient fréquemment des abcès considérables au fondement, qui occasionnent des fistules. Voyez ce qu’on en dit à l’article de la Fistule à l’anus. (Y)
* M. Littre observe, Histoire de l’Academie, an. 1701, page 29, à l’occasion d’une inflammation aux parois du ventricule gauche du cœur, que les ventricules du cœur doivent être moins sujets à des abcès qu’à des inflammations. Car l’abcès consiste dans un fluide extravasé qui se coagule, se corrompt & se change en pus, & l’inflammation dans un gonflement des vaisseaux causé par trop de fluide. Si donc on suppose que, des arteres coronaires qui nourrissent la substance du cœur, il s’extravase & s’épanche du sang qui ne rentre pas d’abord dans les veines coronaires destinées à le reprendre ; il sera difficile que le mouvement continuel de contraction & de dilatation du cœur ne le force à y rentrer, ou du moins ne le brise & ne l’atténue, de sorte qu’il s’échappe dans les ventricules au-travers des parois. Quant à l’inflammation, le cœur n’a pas plus de ressources qu’une autre partie pour la prévenir, ou pour s’en délivrer.
* On lit, Histoire de l’Acad. an. 1730, p. 40. la guérison d’un abcès au foie qui mérite bien d’être connue. M. Soullier Chirurgien de Montpellier fut appellé auprès d’un jeune homme âgé de 13 à 14 ans qui, après s’être fort échauffé, s’étoit mis les piés dans l’eau froide & avoit eu une fievre ordinaire, mais dont la suite fut très fâcheuse. Ce fut une tumeur considérable au foie, qu’il ouvrit. Il trouva ce viscere considérablement abcédé à sa partie antérieure & convexe. Il s’y étoit fait un trou qui auroit pû recevoir la moitié d’un œuf de poule, & il en sortoit dans les pansemens une matiere sanguinolente, épaisse, jaunâtre, amere & inflammable : c’étoit de la bile véritable accompagnée de floccons de la substance du foie.
Pour vuider la matiere de cet abcès, M. Soullier imagina une cannule d’argent émoussée par le bout qui entroit dans le foie, sans l’offenser, & percée de plusieurs ouvertures latérales qui recevoient la matiere nuisible & la portoient en-dehors, où elle s’épanchoit sur une plaque de plomb qu’il avoit appliquée à la plaie, de maniere que cette matiere ne pouvoit excorier la peau. L’expédient réussit, la fievre diminua, l’embonpoint revint, la plaie se cicatrisa, & le malade guérit.
* On peut voir encore dans le Recueil de 1731, page 515, une observation de M. Chicoyneau pere, sur un abcès intérieur de la poitrine accompagné des symptomes de la phthisie & d’un déplacement notable de l’épine du dos & des épaules ; le tout terminé heureusement par l’évacuation naturelle de l’abcès par le fondement.
ABDAR, s. m. nom de l’Officier du Roi de Perse qui lui sert de l’eau à boire, & qui la garde dans une cruche cachetée, de peur qu’on n’y mêle du poison, à ce que rapporte Olearius dans son voyage de Perse. (G)
* ABDARA, ville d’Espagne, bâtie par les Carthaginois dans la Bétique, sur la côte de la Méditerranée ; on soupçonne que c’est la ville qu’on nomme aujourd’hui Adra dans le Royaume de Grenade.
* ABDELARI, plante Egyptienne dont le fruit ressembleroit davantage au melon, s’il étoit un peu moins oblong & aigu par ses extrémités. Ray. H. Pl.
* ABDERE, ancienne ville de Thrace, que quelques-uns prennent pour celle qu’on appelle aujourd’hui Asperosa, ville maritime de Romanie.
* ABDERITES, habitans d’Abdere. V. Abdere.
ABDEST, s. m. mot qui dans la Langue Persane signifie proprement l’eau qui sert à laver les mains : mais il se prend par les Persans & par les Turcs pour la purification légale ; & ils en usent avant que de commencer leurs cérémonies religieuses. Ce mot est composé d’ab qui signifie de l’eau, & d’est la main. Les Persans, dit Olearius, passent la main mouillée deux fois sur leur tête depuis le col jusqu’au front, & ensuite sur les piés jusqu’aux chevilles : mais les Turcs versent de l’eau sur leur tête, & se lavent les piés trois fois. Si néanmoins ils se sont lavés les piés le matin avant que de mettre leur chaussure, ils se contentent de mouiller la main, & de la passer par-dessus cette chaussure depuis les orteils jusqu’à la cheville du pied. (G)
ABDICATION, s. f. acte par lequel un Magistrat ou une personne en charge y renonce, & s’en démet avant que le terme légal de son service soit expiré. Voyez Renonciation.
Ce mot est dérivé d’abdicare, composé de ab, & de dicere, déclarer.
On confond souvent l’abdication avec la résignation : mais à parler exactement, il y a de la différence. Car l’abdication se fait purement & simplement, au lieu que la résignation se fait en faveur de quelque personne tierce. Voyez Résignation.
En ce sens on dit que Dioclétien & Charles V. abdiquerent la Couronne, & que Philippe V. Roi d’Espagne l’a résigna. Le Parlement d’Angleterre a décidé que la violation des Lois faite par le Roi Jacques, en quittant son Royaume, sans avoir pourvû à l’administration nécessaire des affaires pendant son absence, emportoit avec elle l’abdication de la Couronne : mais cette décision du Parlement est-elle bien équitable ?
Abdication dans le Droit civil, se prend particulierement pour l’acte par lequel un pere congédie & desavoue son fils, & l’exclut de sa famille. En ce sens, ce mot est synonyme au mot Grec ἀποκήρυξις, & au mot Latin, à familiâ alienatio, ou quelquefois ablegatio & negatio, & est opposé à adoption. Il differe de l’exhérédation, en ce que l’abdication se faisoit du vivant du pere, au lieu que l’exhérédation ne se faisoit qu’à la mort. Ainsi quiconque étoit abdiqué, étoit aussi exhérédé, mais non vice versâ. V. Exhérédation.
L’abdication se faisoit pour les mêmes causes que l’exhérédation.
Abdication s’est dit encore de l’action d’un homme libre qui renonçoit à sa liberté, & se faisoit volontairement esclave ; & d’un citoyen Romain qui renonçoit à cette qualité, & aux priviléges qui y étoient attachés.
Abdication, au Palais, est aussi quelquefois synonyme à abandonnement. V. Abandonnement. (H)
ABDOMEN, s. m. signifie le bas-ventre, c’est-à-dire cette partie du corps qui est comprise entre le thorax & les hanches. Voyez Ventre.
Ce mot est purement Latin, & est dérivé d’abdere, cacher, soit parce que les principaux visceres du corps sont contenus dans cette partie, & y sont, pour ainsi dire, cachés, soit parce que cette partie du corps est toûjours couverte & cachée à la vûe ; au lieu que la partie qui est au-dessus, savoir le thorax, est souvent laissée à nud. D’autres croient que le mot abdomen est composé de abdere & d’omentum, parce que l’omentum ou l’épiploon est une des parties qui y sont contenues. D’autres regardent ce mot comme un pur paronymon ou terminaison d’abdere, principalement de la maniere dont on le lit dans quelques anciens Glossaires, où il est écrit abdumen qui pourroit avoir été formé de abdere, comme legumen de legere, l’o & l’u étant souvent mis l’un pour l’autre.
Les Anatomistes divisent ordinairement le corps en trois régions ou ventres ; la tête, le thorax ou la poitrine, & l’abdomen qui fait la partie inférieure du tronc, & qui est terminé en haut par le diaphragme, & en bas par la partie inférieure du bassin des os innominés. Voyez Corps.
L’abdomen est doublé intérieurement d’une membrane unie & mince appellée péritoine, qui enveloppe tous les visceres contenus dans l’abdomen, & qui les retient à leur place. Quand cette membrane vient à se rompre ou à se dilater, il arrive souvent que les intestins & l’épiploon s’engagent seuls ou tous deux ensemble dans les ouvertures du bas-ventre, & forment ces tumeurs qu’on appelle hernies ou descentes. Voyez Péritoine & Hernie.
Les muscles de l’abdomen sont au nombre de dix, cinq de chaque côté ; non seulement ils défendent les visceres, mais ils servent par leur contraction & dilatation alternative à la respiration, à la digestion, & à l’expulsion des excrémens. Par la contraction de ces muscles, la cavité de l’abdomen est resserrée, & la descente des matieres qui sont contenues dans l’estomac & dans les intestins, est facilitée. Ces muscles sont les antagonistes propres des sphincters de l’anus & de la vessie, & chassent par force les excrémens contenus dans ces parties, comme aussi le fœtus dans l’accouchement. Voyez Muscle, Respiration, Digestion, Accouchement, &c.
Ces muscles sont les deux obliques descendans, & les deux obliques ascendans, les deux droits, les deux transversaux, & les deux pyramidaux. Voyez les articles Oblique, Droit, Pyramidal, &c.
On divise la circonférence de l’abdomen en régions : antérieurement on en compte trois ; savoir, la région épigastrique ou supérieure, la région ombilicale ou moyenne, & la région hypogastrique ou inférieure : postérieurement on n’en compte qu’une sous le nom de région lombaire. Voyez Épigastrique, Ombilical, &c.
On subdivise chacune de ces régions en trois, sçavoir, en une moyenne & deux latérales ; l’épigastrique en épigastre & en hypocondre ; l’ombilicale en ombilicale proprement dite, & en flancs ; l’hypogastrique en pubis & en aînes ; la lombaire en lombaires proprement dites & en lombes. Voyez Épigastre, Hypocondre, &c.
Immédiatement au-dessous des muscles se présente le péritoine qui est une espece de sac qui recouvre toutes les parties renfermées dans l’abdomen.
On apperçoit sur ce sac ou dans son tissu cellulaire antérieurement les vaisseaux ombilicaux, l’ouraque, la vessie. Voyez Ombilical, Ouraque, &c.
Lorsqu’il est ouvert, on voit l’épiploon, les intestins, le mésentere, le ventricule, le foie, la vésicule du fiel, la rate, les reins, le pancréas ; les vésicules séminaires dans l’homme, la matrice, les ligamens, les ovaires, les trompes, &c. dans la femme ; la portion inférieure de l’aorte descendante, la veine cave ascendante, la veine-porte hépatique, la veine-porte ventrale, les arteres cœliaque, mésentérique, supérieure & inférieure, les émulgentes, les hépatiques, les spléniques, les spermatiques, &c. les nerfs stomachiques qui sont des productions de la huitiéme paire, & d’autres du nerf intercostal, &c. V. Épiploon, Intestin, Mesentere, &c. (L)
ABDUCTEUR, s. m. pris adject. nom que les Anatomistes donnent à différens muscles destinés à éloigner les parties auxquelles ils sont attachés, du plan que l’on imagine diviser le corps en deux parties égales & symmétriques, ou de quelqu’autre partie avec laquelle ils les comparent. Voyez Muscle.
Ce mot vient des mots Latins ab, de, & ducere, mener : les antagonistes des abducteurs sont appellés adducteurs. V. Adducteur & Antagoniste.
Les Abducteurs du bras. Voyez Sousépineux & Pié.
L’Abducteur du pouce. Voyez Thenar.
Abducteur des doigts. Voyez Interosseux.
L’Abducteur du doigt auriculaire ou l’hypothenar, ou le petit hypothenar de M. Winslow, vient de l’os pisi-forme, du gros ligament du carpe, & se termine à la partie interne de la base de la premiere phalange du petit doigt. Anat. Pl. VI. Fig. I. Ω
ABDUCTION, s. f. nom dont se servent les Anatomistes pour exprimer l’action par laquelle les muscles abducteurs éloignent une partie d’un plan qu’ils supposent diviser le corps humain dans toute sa longueur en deux parties égales & symmétriques, ou de quelqu’autre partie avec laquelle ils les comparent. (L)
Abduction s. f. en Logique est une façon d’argumenter, que les Grecs nomment apogage, où le grand terme est évidemment contenu dans le moyen terme ; mais où le moyen terme n’est pas intimement lié avec le petit terme ; desorte qu’on vous accorde la majeure d’un tel syllogisme, tandis qu’on vous oblige à prouver la mineure, afin de développer davantage la liaison du moyen terme avec le petit terme. Ainsi dans ce syllogisme,
Tout ce que Dieu a révélé est très-certain :
Or Dieu nous a révélé les Mysteres de la Trinité & de l’Incarnation ;
Donc ces Mysteres sont très-certains.
la majeure est évidente ; c’est une de ces premieres vérités que l’esprit saisit naturellement, sans avoir besoin de preuve. Mais la mineure ne l’est pas, à moins qu’on ne l’étaye, pour ainsi dire, de quelques autres propositions propres à répandre sur elle leur évidence. (X)
* ABÉATES, s. m. pl. Habitans d’Abée dans le Péloponese ; ceux d’Abée ou Aba dans la Phocide s’appelloient Abantes. Voyez Abantes.
ABÉCÉDAIRE, adjectif dérivé du nom des quatre premieres Lettres de l’Alphabeth A, B, C, D ; il se dit des ouvrages & des personnes. M. Dumas, Inventeur du Bureau typographique, a fait des Livres abécédaires fort utiles, c’est-à-dire, des Livres qui traitent des Lettres par rapport à la lecture, & qui apprennent à lire avec facilité & correctement.
Abécédaire est différent d’Alphabéthique. Abécédaire a rapport au fond de la chose, au lieu qu’Alphabétique se dit par rapport à l’ordre. Les Dictionnaires sont disposés selon l’ordre alphabétique, & ne sont pas pour cela des ouvrages abécédaires.
Il y a en Hébreu des Pseaumes, des Lamentations, & des Cantiques, dont les versets sont distribués par ordre alphabétique : mais je ne crois pas qu’on doive pour cela les appeller des ouvrages : abécédaires.
Abécédaire se dit aussi d’une personne qui n’est encore qu’à l’A, B, C, C’est un Docteur abécédaire, c’est-à-dire qui commence, qui n’est pas encore bien savant. On appelle aussi Abécédaires les personnes qui montrent à lire. Ce mot n’est pas fort usité. (F)
ABÉE, s. f. Ville du détroit Messenien que Xercès brûla, & qui avoit été bâtie par Abas fils de Lyncée.
Abée, s. f. ouverture pratiquée à la baie d’un moulin, par laquelle l’eau tombe sur la grande roue & fait moudre. Cette ouverture s’ouvre & se ferme avec des pales ou lamoirs.
ABEILLE, s. f. insecte de l’espece des mouches. Il y en a de trois sortes : la premiere & la plus nombreuse des trois est l’abeille commune : la seconde est moins abondante ; ce sont les faux bourdons ou mâles : enfin la troisieme est la plus rare, ce sont les femelles.
Les abeilles femelles que l’on appelle reines ou meres abeilles, étoient connues des Anciens sous le nom de Rois des abeilles, parce qu’autrefois on n’avoit pas distingué leur sexe : mais aujourd’hui il n’est plus équivoque. On les a vû pondre des œufs, & on en trouve aussi en grande quantité dans leur corps. Il n’y a ordinairement qu’une Reine dans une ruche ; ainsi il est très-difficile de la voir : cependant on pourroit la reconnoître assez aisément, parce qu’elle est plus grande que les autres ; sa tête est plus allongée, & ses ailes sont très-courtes par rapport à son corps ; elles n’en couvrent guere que la moitié ; au contraire celles des autres abeilles couvrent le corps en entier. La Reine est plus longue que les mâles : mais elle n’est pas aussi grosse. On a prétendu autrefois qu’elle n’avoit point d’aiguillon : cependant Aristote le connoissoit ; mais il croyoit qu’elle ne s’en servoit jamais. Il est aujourd’hui très-certain que les abeilles femelles ont un aiguillon même plus long que celui des ouvrieres ; cet aiguillon est recourbé. Il faut avoüer qu’elles s’en servent fort rarement, ce n’est qu’après avoir été irritées pendant long-tems : mais alors elles piquent avec leur aiguillon, & la piquûre est accompagnée de venin comme celle des abeilles communes. Il ne paroît pas que la mere abeille ait d’autre emploi dans la ruche que celui de multiplier l’espece, ce qu’elle fait par une ponte fort abondante ; car elle produit dix à douze mille œufs en sept semaines, & communément trente à quarante mille par an.
On appelle les abeilles mâles faux bourdons pour les distinguer de certaines mouches que l’on connoît sous le nom de bourdons. Voyez Bourdon.
On ne trouve ordinairement des mâles dans les ruches que depuis le commencement ou le milieu du mois de Mai jusques vers la fin du mois de Juillet ; leur nombre se multiplie de jour en jour pendant ce tems, à la fin duquel ils périssent subitement de mort violente, comme on le verra dans la suite.
Les mâles sont moins grands que la Reine, & plus grands que les ouvrieres ; ils ont la tête plus ronde, ils ne vivent que de miel, au lieu que les ouvrieres mangent souvent de la cire brute. Dès que l’aurore paroît, celles-ci partent pour aller travailler, les mâles sortent bien plus tard, & c’est seulement pour voltiger autour de la ruche, sans travailler. Ils rentrent avant le serein & la fraîcheur du soir ; ils n’ont ni aiguillon, ni patelles, ni dents saillantes comme les ouvrieres. Leurs dents sont petites, plates & cachées, leur trompe est aussi plus courte & plus déliée : mais leurs yeux sont plus grands & beaucoup plus gros que ceux des ouvrieres : ils couvrent tout le dessus de la partie supérieure de la tête, au lieu que les yeux des autres forment simplement une espece de bourlet de chaque côté.
On trouve dans certains tems des faux bourdons qui ont à leur extrémité postérieure deux cornes charnues aussi longues que le tiers ou la moitié de leur corps : il paroît aussi quelquefois entre ces deux cornes un corps charnu qui se recourbe en haut. Si ces parties ne sont pas apparentes au dehors, on peut les faire sortir en pressant le ventre du faux bourdon ; si on l’ouvre, on voit dans des vaisseaux & dans des réservoirs une liqueur laiteuse, qui est vraissemblablement la liqueur séminale. On croit que toutes ces parties sont celles de la génération ; car on ne les trouve pas dans les abeilles meres, ni dans les ouvrieres. L’unique emploi que l’on connoisse aux mâles, est de féconder la Reine ; aussi dès que la ponte est finie, les abeilles ouvrieres les chassent & les tuent.
Il y a des abeilles qui n’ont point de sexe. En les disséquant on n’a jamais trouvé dans leurs corps aucune partie qui eût quelque rapport avec celles qui caractérisent les abeilles mâles ou les femelles. On les appelle mulets ou abeilles communes, parce qu’elles sont en beaucoup plus grand nombre que celles qui ont un sexe. Il y en a dans une seule ruche jusqu’à quinze ou seize mille, & plus, tandis qu’on n’y trouve quelquefois que deux ou trois cens mâles, quelquefois sept ou huit cens, ou mille au plus.
On désigne aussi les abeilles communes par le nom d’ouvrieres, parce qu’elles font tout l’ouvrage qui est nécessaire pour l’entretien de la ruche, soit la récolte du miel & de la cire, soit la construction des alvéoles ; elles soignent les petites abeilles ; enfin elles tiennent la ruche propre, & elles écartent tous les animaux étrangers qui pourroient être nuisibles. La tête des abeilles communes est triangulaire ; la pointe du triangle est formée par la rencontre de deux dents posées horisontalement l’une à côté de l’autre, longues, saillantes & mobiles. Ces dents servent à la construction des alvéoles : aussi sont-elles plus fortes dans les abeilles ouvrieres que dans les autres. Si on écarte ces deux dents, on voit qu’elles sont comme des especes de cuillieres dont la concavité est en-dedans. Les abeilles ont quatre ailes, deux grandes & deux petites ; en les levant, on trouve de chaque côté auprès de l’origine de l’aile de dessous en tirant vers l’estomac, une ouverture ressemblante à une bouche ; c’est l’ouverture de l’un des poumons : il y en a une autre sous chacune des premieres jambes, desorte qu’il y a quatre ouvertures sur le corcelet (V. Corcelet) & douze autres de part & d’autre sur les six anneaux qui composent le corps : ces ouvertures sont nommées stigmates. Voyez Stigmates.
L’air entre par ces stigmates, & circule dans le corps par le moyen d’un grand nombre de petits canaux ; enfin il en sort par les pores de la peau. Si on tiraille un peu la tête de l’abeille, on voit qu’elle ne tient à la poitrine ou corcelet que par un cou très court, & le corcelet ne tient au corps que par un filet très-mince. Le corps est couvert en entier par six grandes pieces écailleuses, qui portent en recouvrement l’une sur l’autre, & forment six anneaux qui laissent au corps toute sa souplesse. On appelle antennes (Voyez Antennes) ces especes de cornes mobiles & articulées qui sont sur la tête, une de chaque côté ; les antennes des mâles n’ont que onze articulations, celles des autres en ont quinze.
L’abeille a six jambes placées deux à deux en trois rangs ; chaque jambe est garnie à l’extrémité de deux grands ongles & de deux petits, entre lesquels il y a une partie molle & charnue. La jambe est composée de cinq pieces, les deux premieres sont garnies de poils ; la quatrieme piece de la seconde & de la troisieme paire est appellée la brosse : cette partie est quarrée, sa face extérieure est rase & lisse, l’intérieure est plus chargée de poils que nos brosses ne le sont ordinairement, & ces poils sont disposés de la même façon. C’est avec ces sortes de brosses que l’abeille ramasse les poussieres des étamines qui tombent sur son corps, lorsqu’elle est sur une fleur pour faire la récolte de la cire. Voyez Cire. Elle en fait de petites pelotes qu’elle transporte à l’aide de ses jambes sur la palette qui est la troisieme partie des jambes de la troisieme paire. Les jambes de devant transportent à celles du milieu ces petites masses ; celles-ci les placent & les empilent sur la palette des jambes de derriere.
Cette manœuvre se fait avec tant d’agilité & de promptitude, qu’il est impossible d’en distinguer les mouvemens lorsque l’abeille est vigoureuse. Pour bien distinguer cette manœuvre de l’abeille, il faut l’observer lorsqu’elle est affoiblie & engourdie par la rigueur d’une mauvaise saison. Les palettes sont de figure triangulaire ; leur face extérieure est lisse & luisante, des poils s’élevent au-dessus des bords ; comme ils sont droits, roides & serrés, & qu’ils l’environnent, ils forment avec cette surface une espece de corbeille : c’est-là que l’abeille dépose, à l’aide de ses pattes, les petites pelotes qu’elle a formées avec les brosses ; plusieurs pelotes réunies sur la palette font une masse qui est quelquefois aussi grosse qu’un grain de poivre.
La trompe de l’abeille est une partie qui se développe & qui se replie. Lorsqu’elle est dépliée, on la voit descendre du dessous des deux grosses dents saillantes qui sont à l’extrémité de la tête. La trompe paroît dans cet état comme une lame assez épaisse, très-luisante & de couleur châtain. Cette lame est appliquée contre le dessous de la tête : mais on n’en voit alors qu’une moitié qui est repliée sur l’autre ; lorsque l’abeille la déplie, l’extrémité qui est du côté des dents s’éleve, & on apperçoit alors celle qui étoit dessous. On découvre aussi par ce déplacement la bouche & la langue de l’abeille qui sont au-dessus des deux dents. Lorsque la trompe est repliée, on ne voit que les étuis qui la renferment.
Pour développer & pour examiner cet organe, il faudroit entrer dans un grand détail. Il suffira de dire ici que c’est par le moyen de cet organe que les abeilles recueillent le miel ; elles plongent leur trompe dans la liqueur miellée pour la faire passer sur la surface extérieure. Cette surface de la trompe forme avec les étuis un canal par lequel le miel est conduit : mais c’est la trompe seule qui étant un corps musculeux, force par ses différentes inflexions & mouvemens vermiculaires la liqueur d’aller en avant, & qui la pousse vers le gosier.
Les abeilles ouvrieres ont deux estomacs ; l’un reçoit le miel, & l’autre la cire : celui du miel a un cou qui tient lieu d’œsophage, par lequel passe la liqueur que la trompe y conduit, & qui doit s’y changer en miel parfait : l’estomac où la cire brute se change en vraie cire, est au-dessous de celui du miel. Voyez Cire, Miel.
L’aiguillon est caché dans l’état de repos ; pour le faire sortir, il faut presser l’extrémité du corps de l’abeille. On le voit paroître accompagné de deux corps blancs qui forment ensemble une espece de boîte, dans laquelle il est logé lorsqu’il est dans le corps. Cet aiguillon est semblable à un petit dard qui, quoique très-délié, est cependant creux d’un bout à l’autre. Lorsqu’on le comprime vers la base, on fait monter à la pointe une petite goute d’une liqueur extrèmement transparente ; c’est-là ce qui envenime les plaies que fait l’aiguillon. On peut faire une équivoque par rapport à l’aiguillon comme par rapport à la trompe, ce qui paroît être l’aiguillon n’en est que l’étui ; c’est par l’extrémité de cet étui que l’aiguillon sort, & qu’il est dardé en même tems que la liqueur empoisonnée. De plus cet aiguillon est double ; il y en a deux à côté qui jouent en même tems, ou séparément au gré de l’abeille ; ils sont de matiere de corne ou d’écaille, leur extrémité est taillée en scie, les dents sont inclinées de chaque côté, de sorte que les pointes sont dirigées vers la base de l’aiguillon, ce qui fait qu’il ne peut sortir de la plaie sans la déchirer ; ainsi il faut que l’abeille le retire avec force. Si elle fait ce mouvement avec trop de promptitude, l’aiguillon casse & il reste dans la plaie ; & en se séparant du corps de l’abeille, il arrache la vessie qui contient le venin, & qui est posée au-dedans à la base de l’aiguillon. Une partie des entrailles sort en même tems, ainsi cette séparation de l’aiguillon est mortelle pour la mouche. L’aiguillon qui reste dans la plaie a encore du mouvement quoique séparé du corps de l’abeille ; il s’incline alternativement dans des sens contraires, & il s’enfonce de plus en plus.
La liqueur qui coule dans l’étui de l’aiguillon est un véritable venin, qui cause la douleur que l’on éprouve lorsqu’on a été piqué par une abeille. Si on goûte de ce venin, on le sent d’abord douçâtre : mais il devient bien-tôt acre & brûlant ; plus l’abeille est vigoureuse, plus la douleur de la piquûre est grande. On sait que dans l’hyver on en souffre moins que dans l’été, toutes choses égales de la part de l’abeille : il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à cette piquûre que d’autres. Si l’abeille pique pour la seconde fois, elle fait moins de mal qu’à la premiere fois, encore moins à une troisieme ; enfin le venin s’épuise, & alors l’abeille ne se fait presque plus sentir. On a toûjours cru qu’un certain nombre de piquûres faites à la fois sur le corps d’un animal pourroient le faire mourir ; le fait a été confirmé plusieurs fois ; on a même voulu déterminer le nombre de piquûres qui seroit nécessaire pour faire mourir un grand animal ; on a aussi cherché le remede qui détruiroit ce venin : mais on a trouvé seulement le moyen d’appaiser les douleurs en frottant l’endroit blessé avec de l’huile d’olive, ou en y appliquant du persil pilé. Quoi qu’il en soit du remede, il ne faut jamais manquer en pareil cas de retirer l’aiguillon, s’il est resté dans la plaie comme il arrive presque toûjours. Au reste la crainte des piquûres ne doit pas empêcher que l’on approche des ruches : les abeilles ne piquent point lorsqu’on ne les irrite pas ; on peut impunément les laisser promener sur sa main ou sur son visage, elles s’en vont d’elles-mêmes sans faire de mal : au contraire si on les chasse, elles piquent pour se défendre.
Pour suivre un ordre dans l’histoire succincte des abeilles que l’on va faire ici, il faut la commencer dans le tems où la mere abeille est fécondée. Elle peut l’être dès le quatrieme ou cinquieme jour après celui où elle est sortie de l’état de nymphe pour entrer dans celui de mouche, comme on le dira dans la suite. Il seroit presque impossible de voir dans la ruche l’accouplement des abeilles, parce que la reine reste presque toûjours dans le milieu où elle est cachée par les gâteaux de cire, & par les abeilles qui l’environnent. On a tiré de la ruche des abeilles meres, & on les a mises avec des mâles dans des bocaux pour voir ce qui s’y passeroit.
On est obligé pour avoir une mere abeille de plonger une ruche dans l’eau, & de noyer à demi toutes les abeilles, ou de les enfumer, afin de pouvoir les examiner chacune séparément pour reconnoître la mere. Lorsqu’elle est revenue de cet état violent, elle ne reprend pas d’abord assez de vivacité pour être bien disposée à l’accouplement. Ce n’est donc que par des hasards que l’on en peut trouver qui fassent réussir l’expérience ; il faut d’ailleurs que cette mere soit jeune ; de plus il faut éviter le tems où elle est dans le plus fort de la ponte. Dès qu’on présente un mâle à une mere abeille bien choisie, aussitôt elle s’en approche, le lêche avec sa trompe, & lui présente du miel : elle le touche avec ses pattes, tourne autour de lui, se place vis-à-vis, lui brosse la tête avec ses jambes, &c. Le mâle reste quelquefois immobile pendant un quart-d’heure ; & enfin il fait à peu près les mêmes choses que la femelle ; celle-ci s’anime alors davantage. On l’a vûe monter sur le corps du mâle ; elle recourba l’extrémité du sien, pour l’appliquer contre l’extrémité de celui du mâle, qui faisoit sortir les deux cornes charnues & la partie recourbée en arc. Supposé que cette partie soit, comme on le croit, celle qui opere l’accouplement, il faut nécessairement que l’abeille femelle soit placée sur le mâle pour la rencontrer, parce qu’elle est recourbée en haut ; c’est ce qu’on a observé pendant trois ou quatre heures. Il y eut plusieurs accouplemens, après quoi le mâle resta immobile, la femelle lui mordit le corcelet, & le soûleva en faisant passer sa tête sous le corps du mâle ; mais ce fut en vain, car il étoit mort. On présenta un autre mâle : mais la mere abeille ne s’en occupa point du tout, & continua pendant tout le reste du jour de faire différens efforts pour tâcher de ranimer le premier. Le lendemain elle monta de nouveau sur le corps du premier mâle, & se recourba de la même façon que la veille, pour appliquer l’extrémité de son corps contre celui du mâle. L’accouplement des abeilles ne consiste-t-il que dans cette jonction qui ne dure qu’un instant ? On présume que c’est la mere abeille qui attaque le mâle avec qui elle veut s’accoupler ; si c’étoit au contraire les mâles qui attaquassent cette femelle, ils seroient quelquefois mille mâles pour une femelle. Le tems de la fécondation doit être nécessairement celui où il y a des mâles dans la ruche ; il dure environ six semaines prises dans les mois de Mai & de Juin ; c’est aussi dans ce même tems que les essains quittent les ruches. Les reines qui sortent sont fécondées ; car on a observé des essains entiers dans lesquels il ne se trouvoit aucun mâle, par conséquent la reine n’auroit pû être fécondée avant la ponte qu’elle fait : aussi-tôt que l’essain est fixé quelque part, vingt-quatre heures après on trouve des œufs dans les gâteaux.
Après l’accouplement, il se forme des œufs dans la matrice de la mere abeille ; cette matrice est divisée en deux branches, dont chacune est terminée par plusieurs filets : chaque filet est creux ; c’est une sorte de vaisseau qui renferme plusieurs œufs disposés à quelque distance les uns des autres dans toute sa longueur. Ces œufs sont d’abord fort petits, ils tombent successivement dans les branches de la matrice, & passent dans le corps de ce viscere pour sortir au-dehors ; il y a un corps sphérique posé sur la matrice ; on croit qu’il en degoutte une liqueur visqueuse qui enduit les œufs, & qui les colle au fond des alvéoles, lorsqu’ils y sont déposés dans le tems de la ponte. On a estimé que chaque extrémité des branches de la matrice est composée de plus de 150 vaisseaux, & que chacun peut contenir dix-sept œufs sensibles à l’œil, par conséquent une mere abeille prête à pondre a cinq mille œufs visibles. Le nombre de ceux qui ne sont pas encore visibles, & qui doivent grossir pendant la ponte, doit être beaucoup plus grand ; ainsi il est aisé de concevoir comment une mere abeille peut pondre dix à douze mille œufs, & plus, en sept ou huit semaines.
Les abeilles ouvrieres ont un instinct singulier pour prévoir le tems auquel la mere abeille doit faire la ponte, & le nombre d’œufs qu’elle doit déposer ; lorsqu’il surpasse celui des alvéoles qui sont faits, elles en ébauchent de nouveaux pour fournir au besoin pressant ; elles semblent connoître que les œufs des abeilles ouvrieres sortiront les premiers, & qu’il y en aura plusieurs milliers ; qu’il viendra ensuite plusieurs centaines d’œufs qui produiront des mâles ; & qu’enfin la ponte finira par trois ou quatre, & quelquefois par plus de quinze ou vingt œufs d’où sortiront les femelles. Comme ces trois sortes d’abeilles sont de différentes grosseurs, elles y proportionnent la grandeur des alvéoles. Il est aisé de distinguer à l’œil ceux des reines, & que l’on a appellé pour cette raison alvéoles royaux ; ils sont les plus grands. Ceux des faux bourdons sont plus petits que ceux des reines, mais plus grands que ceux des mulets ou abeilles ouvrieres.
La mere abeille distingue parfaitement ces différens alvéoles ; lorsqu’elle fait sa ponte, elle arrive environnée de dix ou douze abeilles ouvrieres, plus ou moins, qui semblent la conduire & la soigner ; les unes lui présentent du miel avec leur trompe, les autres la lêchent & la brossent. Elle entre d’abord dans un alvéole la tête la premiere, & elle y reste pendant quelques instans ; ensuite elle en sort, & y rentre à reculons ; la ponte est faite dans un moment. Elle en fait cinq ou six de suite, après quoi elle se repose avant que de continuer. Quelquefois elle passe devant un alvéole vuide sans s’y arrêter.
Le tems de la ponte est fort long ; car c’est presque toute l’année, excepté l’hyver. Le fort de cette ponte est au printems ; on a calculé que dans les mois de Mars & de Mai, la mere abeille doit pondre environ douze mille œufs, ce qui fait environ deux cens œufs par jour : ces douze mille œufs forment en partie l’essain qui sort à la fin de Mai ou au mois de Juin, & remplacent les anciennes mouches qui font partie de l’essain ; car après sa sortie, la ruche n’est pas moins peuplée qu’au commencement de Mars.
Les œufs des abeilles ont six fois plus de longueur que de diametre ; ils sont courbes, l’une de leurs extrémités est plus petite que l’autre : elles sont arrondies toutes les deux. Ces œufs sont d’une couleur blanche tirant sur le bleu ; ils sont revêtus d’une membrane flexible, desorte qu’on peut les plier, & cela se peut faire sans nuire à l’embrion. Chaque œuf est logé séparément dans un alvéole, & placé de façon à faire connoître qu’il est sorti du corps de la mere par le petit bout ; car cette extrémité est collée au fond de l’alvéole. Lorsque la mere ne trouve pas un assez grand nombre de cellules pour tous les œufs qui sont prêts à sortir, elle en met deux ou trois, & même quatre dans un seul alvéole ; ils ne doivent pas y rester ; car un seul ver doit remplir dans la suite l’alvéole en entier. On a vû les abeilles ouvrieres retirer tous les œufs surnuméraires : mais on ne sçait pas si elles les replacent dans d’autres alvéoles ; on ne croit pas qu’il se trouve dans aucune circonstance plusieurs œufs dans les cellules royales.
La chaleur de la ruche suffit pour faire éclorre les œufs, souvent elle surpasse de deux degrés celle de nos étés les plus chauds : en deux ou trois jours l’œuf est éclos ; il en sort un ver qui tombe dans l’alvéole. Dès qu’il a pris un peu d’accroissement, il se roule en cercle ; il est blanc, charnu, & sa tête ressemble à celle des vers à soie ; le ver est posé de façon qu’en se tournant, il trouve une sorte de gelée ou de bouillie qui est au fond de l’alvéole, & qui lui sert de nourriture. On voit des abeilles ouvrieres qui visitent plusieurs fois chaque jour les alvéoles où sont les vers : elles y entrent la tête la premiere, & y restent quelque tems. On n’a jamais pû voir ce qu’elles y faisoient : mais il est à croire qu’elles renouvellent la bouillie dont le ver se nourrit. Il vient d’autres abeilles qui ne s’arrêtent qu’un instant à l’entrée de l’alvéole comme pour voir s’il ne manque rien au ver. Avant que d’entrer dans une cellule, elles passent successivement devant plusieurs ; elles ont un soin continuel de tous les vers qui viennent de la ponte de leur reine : mais si on apporte dans la ruche des gâteaux dans lesquels il y auroit des vers d’une autre ruche, elles les laissent périr, & même elles les entraînent dehors. Chacun des vers qui est né dans la ruche n’a que la quantité de nourriture qui lui est nécessaire, excepté ceux qui doivent être changés en reines ; il reste du superflu dans les alvéoles de ceux-ci. La quantité de la nourriture est proportionnée à l’âge du ver ; lorsqu’ils sont jeunes, c’est une bouillie blanchâtre, insipide comme de la colle de farine. Dans un âge plus avancé, c’est une gelée jaunâtre ou verdâtre qui a un goût de sucre ou de miel ; enfin lorsqu’ils ont pris tout leur accroissement, la nourriture a un goût de sucre mêlé d’acide. On croit que cette matiere est composée de miel & de cire que l’abeille a plus ou moins digérés, & qu’elle peut rendre par la bouche lorsqu’il lui plaît.
Il ne sort du corps des vers aucun excrément : aussi ont-ils pris tout leur accroissement en cinq ou six jours. Lorsqu’un ver est parvenu à ce point, les abeilles ouvrieres ferment son alvéole avec de la cire ; le couvercle est plat pour ceux dont il doit sortir des abeilles ouvrieres, & convexe pour ceux des faux bourdons. Lorsque l’alvéole est fermé, le ver tapisse l’intérieur de sa cellule avec une toile de soie : il tire cette soie de son corps au moyen d’une filiere pareille à celle des vers à soie, qu’il a au-dessous de la bouche. La toile de soie est tissue de fils qui sont très-proches les uns des autres, & qui se croisent ; elle est appliquée exactement contre les parois de l’alvéole. On en trouve où il y a jusqu’à vingt toiles les unes sur les autres ; c’est parce que le même alvéole a servi successivement à vingt vers, qui y ont appliqué chacun une toile ; car lorsque les abeilles ouvrieres nettoyent une cellule où un ver s’est métamorphosé, elles enlevent toutes les dépouilles de la nymphe sans toucher à la toile de soie. On a remarqué que les cellules d’où sortent les reines ne servent jamais deux fois ; les abeilles les détruisent pour en bâtir d’autres sur leurs fondemens.
Le ver après avoir tapissé de soie son alvéole, quitte sa peau de ver ; & à la place de sa premiere peau, il s’en trouve une bien plus fine : c’est ainsi qu’il se change en nymphe. Voyez Nymphe. Cette nymphe est blanche dans les premiers jours ; ensuite ses yeux deviennent rougeâtres, il paroît des poils ; enfin après environ quinze jours, c’est une mouche bien formée, & recouverte d’une peau qu’elle perce pour paroître au jour. Mais cette opération est fort laborieuse pour celles qui n’ont pas de force, comme il arrive dans les tems froids. Il y en a qui périssent après avoir passé la tête hors de l’enveloppe, sans pouvoir en sortir. Les abeilles ouvrieres qui avoient tant de soin pour nourrir le ver, ne donnent aucun secours à ces petites abeilles lorsqu’elles sont dans leurs enveloppes : mais dès qu’elles sont parvenues à en sortir, elles accourent pour leur rendre tous les services dont elles ont besoin. Elles leur donnent du miel, les lêchent avec leurs trompes & les essuient, car ces petites abeilles sont mouillées, lorsqu’elles sortent de leur enveloppe ; elles se sechent bien-tôt ; elles déploient les ailes ; elles marchent pendant quelque tems sur les gâteaux ; enfin elles sortent au-dehors, s’envolent ; & dès le premier jour elles rapportent dans la ruche du miel & de la cire.
Les abeilles se nourrissent de miel & de cire brute ; on croit que le mêlange de ces deux matieres est nécessaire pour que leurs digestions soient bonnes ; on croit aussi que ces insectes sont attaqués d’une maladie qu’on appelle le dévoiement, lorsqu’ils sont obligés de vivre de miel seulement. Dans l’état naturel, il n’arrive pas que les excrémens des abeilles qui sont toujours liquides, tombent sur d’autres abeilles, ce qui leur feroit un très-grand mal ; dans le dévoiement, ce mal arrive parce que les abeilles n’ayant pas assez de force pour se mettre dans une position convenable les unes par rapport aux autres, celles qui sont au-dessus laissent tomber sur celles qui sont au-dessous une matiere qui gâte leurs ailes, qui bouche les organes de la respiration, & qui les fait périr.
Voilà la seule maladie des abeilles qui soit bien connue ; on peut y remédier en mettant dans la ruche où sont les malades, un gâteau que l’on tire d’une autre ruche, & dont les alvéoles sont remplis de cire brute : c’est l’aliment dont la disette a causé la maladie ; on pourroit aussi y suppléer par une composition ; celle qui a paru la meilleure se fait avec une demi-livre de sucre, autant de bon miel, une chopine de vin rouge, & environ un quarteron de fine farine de féve. Les abeilles courent risque de se noyer en bûvant dans des ruisseaux ou dans des réservoirs dont les bords sont escarpés. Pour prévenir cet inconvénient, il est à propos de leur donner de l’eau dans des assiettes autour de leur ruche. On peut reconnoître les jeunes abeilles & les vieilles par leur couleur. Les premieres ont les anneaux bruns & les poils blancs ; les vieilles ont au contraire les poils roux & les anneaux d’une couleur moins brune que les jeunes. Celles-ci ont les ailes saines & entieres ; dans un âge plus avancé, les ailes se frangent & se déchiquetent à force de servir. On n’a pas encore pû savoir quelle étoit la durée de la vie des abeilles : quelques Auteurs ont prétendu qu’elles vivoient dix ans, d’autres sept ; d’autres enfin ont rapproché de beaucoup le terme de leur mort naturelle, en le fixant à la fin de la premiere année : c’est peut-être l’opinion la mieux fondée ; il seroit difficile d’en avoir la preuve ; car on ne pourroit pas garder une abeille séparément des autres : ces insectes ne peuvent vivre qu’en société.
Après avoir suivi les abeilles dans leurs différens âges, il faut rapporter les faits les plus remarquables dans l’espece de société qu’elles composent. Une ruche ne peut subsister, s’il n’y a une abeille mere ; & s’il s’en trouve plusieurs, les abeilles ouvrieres tuent les surnuméraires. Jusqu’à ce que cette exécution soit faite, elles ne travaillent point, tout est en desordre dans la ruche. On trouve communément des ruches qui ont jusqu’à seize ou dix-huit mille habitans ; ces insectes travaillent assidûment tant que la température de l’air le leur permet. Elles sortent de la ruche dès que l’aurore paroît ; au printems, dans les mois d’Avril & de Mai, il n’y a aucune interruption dans leurs courses depuis quatre heures du matin jusqu’à huit heures du soir ; on en voit à tout instant sortir de la ruche & y rentrer chargées de butin. On a compté qu’il en sortoit jusqu’à cent par minute, & qu’une seule abeille pouvoit faire cinq, & même jusqu’à sept voyages en un jour. Dans les mois de Juillet & d’Août, elles rentrent ordinairement dans la ruche pour y passer le milieu du jour ; on ne croit pas qu’elles craignent pour elles-mêmes la grande chaleur, c’est plûtôt parce que l’ardeur du Soleil ayant desséché les étamines des fleurs, il leur est plus difficile de les pelotonner ensemble pour les transporter ; aussi celles qui rencontrent des plantes aquatiques qui sont humides, travaillent à toute heure.
Il y a des tems critiques où elles tâchent de surmonter tout obstacle, c’est lorsqu’un essain s’est fixé dans un nouveau gîte ; alors il faut nécessairement construire des gâteaux ; pour cela, elles travaillent continuellement ; elles iroient jusqu’à une lieue pour avoir une seule pelotte de cire. Cependant la pluie & l’orage sont insurmontables ; dès qu’un nuage paroît l’annoncer, on voit les abeilles se rassembler de tous côtés, & rentrer avec promptitude dans la ruche. Celles qui rapportent du miel ne vont pas toûjours le déposer dans les alvéoles ; elles le distribuent souvent en chemin à d’autres abeilles qu’elles rencontrent ; elles en donnent aussi à celles qui travaillent dans la ruche, & même il s’en trouve qui le leur enlevent de force.
Les abeilles qui recueillent la cire brute, l’avalent quelquefois pour lui faire prendre dans leur estomac la qualité de vraie cire : mais le plus souvent elles la rapportent en pelotes, & la remettent à d’autres ouvrieres qui l’avalent pour la préparer ; enfin la cire brute est aussi déposée dans les alvéoles. L’abeille qui arrive chargée entre dans un alvéole, détache avec l’extrémité de ses jambes du milieu les deux pelotes qui tiennent aux jambes de derriere, & les fait tomber au fond de l’alvéole. Si cette mouche quitte alors l’alvéole, il en vient une autre qui met les deux pelottes en une seule masse qu’elle étend au fond de la cellule ; peu-à-peu elle est remplie de cire brute que les abeilles pétrissent de la même façon, & qu’elles détrempent avec du miel. Quelque laborieuses que soient les abeilles, elles ne peuvent pas être toûjours en mouvement ; il faut bien qu’elles prennent du repos pour se délasser : pendant l’hyver, ce repos est forcé ; le froid les engourdit, & les met dans l’inaction ; alors elles s’accrochent les unes aux autres par les pattes, & se suspendent en forme de guirlande.
Les abeilles ouvrieres semblent respecter la mere abeille, & les abeilles mâles seulement, parce qu’elles sont nécessaires pour la multiplication de l’espece. Elles suivent la reine, parce que c’est d’elle que sortent les œufs : mais elles n’en reconnoissent qu’une, & elles tuent les autres ; une seule produit une assez grande quantité d’œufs. Elles fournissent des alimens aux faux bourdons pendant tout le tems qu’ils sont nécessaires pour féconder la reine : mais dès qu’elle cesse de s’en approcher, ce qui arrive dans le mois de Juin, dans le mois de Juillet, ou dans le mois d’Août, les abeilles ouvrieres les tuent à coup d’aiguillon, & les entraînent hors de la ruche : elles sont quelquefois deux, trois, ou quatre ensemble pour se défaire d’un faux bourdon. En même tems elles détruisent tous les œufs & tous les vers dont il doit sortir des faux bourdons ; la mere abeille en produira dans sa ponte un assez grand nombre pour une autre génération. Les abeilles ouvrieres tournent aussi leur aiguillon contre leurs pareilles ; & toutes les fois qu’elles se battent deux ensemble, il en coûte la vie à l’une, & souvent à toutes les deux, lorsque celle qui a porté le coup mortel ne peut pas retirer son aiguillon ; il y a aussi des combats généraux dont on parlera au mot Essain.
Les abeilles ouvrieres se servent encore de leur aiguillon contre tous les animaux qui entrent dans leur ruche, comme des limaces, des limaçons, des scarabés, &c. Elles les tuent & les entraînent dehors. Si le fardeau est au-dessus de leur force, elles ont un moyen d’empêcher que la mauvaise odeur de l’animal ne les incommode ; elles l’enduisent de propolis, qui est une résine qu’elles emploient pour espalmer la ruche. Voyez Propolis. Les guêpes & les frélons tuent les abeilles, & leur ouvrent le ventre pour tirer le miel qui est dans leurs entrailles ; elles pourroient se défendre contre ces insectes, s’ils ne les attaquoient par surprise : mais il leur est impossible de résister aux moineaux qui en mangent une grande quantité, lorsqu’ils sont dans le voisinage des ruches. Voyez Mousset, Swammerdam, les Mémoires de M. Maraldi dans le Recueil de l’Académie Royale des Sciences, & le cinquieme Volume des Mémoires pour servir à l’histoire des Insectes, par M. de Reaumur, dont cet abrégé a été tiré en grande partie. Voyez Alvéole, Essain, Gateau, Propolis, Ruche, Insecte .
Il y a plusieurs especes d’abeilles différentes de celles qui produisent le miel & la cire ; l’une des principales especes, beaucoup plus grosse que les abeilles, est connue sous le nom de bourdon. Voyez Bourdon.
Les abeilles que l’on appelle perce-bois sont presque aussi grosses que les bourdons ; leur corps est applati & presque ras : elles sont d’un beau noir luisant, à l’exception des ailes dont la couleur est violette. On les voit dans les jardins dès le commencement du printems, & on entend de loin le bruit qu’elles font en volant : elles pratiquent leur nid dans des morceaux de bois sec qui commencent à se pourrir ; elles y percent des trous avec leurs dents ; d’où vient leur nom de perce-bois. Ces trous ont douze à quinze pouces de longueur, & sont assez larges pour qu’elles puissent y passer librement. Elles divisent chaque trou en plusieurs cellules de sept ou huit lignes de longueur ; elles sont séparées les unes des autres par une cloison faite avec de la sciûre de bois & une espece de colle. Avant que de fermer la premiere piece, l’abeille y dépose un œuf, & elle y met une pâtée composée d’étamines de fleurs, humectée de miel, qui sert de nourriture au ver lorsqu’il est éclos : la premiere cellule étant fermée, elle fait les mêmes choses dans la seconde, & successivement dans toutes les autres. Le ver se métamorphose dans la suite en nymphe, & il sort de cette nymphe une mouche qui va faire d’autres trous, & pondre de nouveaux œufs, si c’est une femelle.
Une autre espece d’abeille construit son nid avec une sorte de mortier. Les femelles sont aussi noires que les abeilles perce-bois & plus velues ; on voit seulement un peu de couleur jaunâtre en-dessous à leur partie postérieure : elles ont un aiguillon pareil à celui des mouches à miel ; les mâles n’en ont point, ils sont de couleur fauve ou rousse. Les femelles construisent seules les nids, sans que les mâles y travaillent : ces nids n’ont que l’apparence d’un morceau de terre gros comme la moitié d’un œuf, collé contre un mur ; ils sont à l’exposition du Midi. Si on détache ce nid, on voit dans son intérieur environ huit ou dix cavités dans lesquelles on trouve, ou des vers & de la pâtée, ou des nymphes, ou des mouches. Cette abeille transporte entre ses dents une petite pelote composée de sable, de terre, & d’une liqueur gluante qui lie le tout ensemble, & elle applique & façonne avec ses dents la charge de mortier qu’elle a apportée pour la construction du nid. Elle commence par faire une cellule à laquelle elle donne la figure d’un petit dé à coudre ; elle la remplit de pâtée, & elle y dépose un œuf & ensuite elle la ferme. Elle fait ainsi successivement, & dans différentes directions sept ou huit cellules qui doivent composer le nid en entier ; enfin elle remplit avec un mortier grossier les vuides que les cellules laissent entr’elles, & elle enduit le tout d’une couche fort épaisse.
Il y a d’autres abeilles qui font des nids sous terre ; elles sont presque aussi grosses que des mouches à miel ; leur nid est cylindrique à l’extérieur, & arrondi aux deux bouts : il est posé horisontalement & recouvert de terre de l’épaisseur de plusieurs pouces, soit dans un jardin, soit en plein champ, quelquefois dans la crête d’un sillon. La mouche commence d’abord par creuser un trou propre à recevoir ce cylindre ; ensuite elle le forme avec des feuilles découpées : cette premiere couche de feuilles n’est qu’une enveloppe qui doit être commune à cinq ou six petites cellules faites avec des feuilles comme la premiere enveloppe. Chaque cellule est aussi cylindrique & arrondie par l’un des bouts ; l’abeille découpe des feuilles en demi-ovale : chaque piece est la moitié d’un ovale coupé sur son petit diametre. Si on faisoit entrer trois pieces de cette figure dans un dé à coudre pour couvrir ses parois intérieures, de façon que chaque piece anticipât un peu sur la piece voisine, on feroit ce que fait l’abeille dont nous parlons. Pour construire une petite cellule dans l’enveloppe commune, elle double & triple les feuilles pour rendre la petite cellule plus solide, & elle les joint ensemble, de façon que la pâtée qu’elle y dépose avec l’œuf ne puisse couler au-dehors. L’ouverture de la cellule est aussi fermée par des feuilles découpées en rond qui joignent exactement les bords de la cellule. Il y a trois feuilles l’une sur l’autre pour faire ce couvercle. Cette premiere cellule étant placée à l’un des bouts de l’enveloppe cylindrique, de façon que son bout arrondi touche les parois intérieures du bout arrondi de l’enveloppe ; la mouche fait une seconde cellule située de la même façon, & ensuite d’autres jusqu’au bout de l’enveloppe. Chacune a environ six lignes de longueur sur trois lignes de diametre, & renferme de la pâtée & un ver qui, après avoir passé par l’état de nymphe, devient une abeille. Il y en a de plusieurs especes : chacune n’emploie que la feuille d’une même plante ; les unes celles de rosier, d’autres celles du maronnier, de l’orme : d’autres abeilles construisent leurs nids à peu près de la même façon, mais avec des matériaux différens ; c’est une matiere analogue à la soie, & qui sort de leur bouche.
Il y a des abeilles qui font seulement un trou en terre ; elles déposent un œuf avec la pâtée qui sert d’aliment au ver, & elles remplissent ensuite le reste du trou avec de la terre. Il y en a d’autres qui, après avoir creusé en terre des trous d’environ trois pouces de profondeur, les revêtissent avec des feuilles de coquelicot : elles les découpent & les appliquent exactement sur les parois du trou : elles mettent au moins deux feuilles l’une sur l’autre. C’est sur cette couche de fleurs que la mouche dépose un œuf & la pâtée du ver ; & comme cela ne suffit pas pour remplir toute la partie du trou qui est revêtue de fleurs, elle renverse la partie de la tenture qui déborde, & en fait une couverture pour la pâtée & pour l’œuf, ensuite elle remplit le reste du trou avec de la terre.
On trouvera l’Histoire de toutes ces mouches dans le sixieme Volume des Mémoires pour servir à l’Histoire des Insectes, par M. de Reaumur, dont cet abregé a été tiré. Voyez Mouche, Insecte. (I)
Abeilles, (Myth.) passerent pour les nourrices de Jupiter sur ce qu’on en trouva des ruches dans l’antre de Dicté, où Jupiter avoit été nourri.
* ABEL, s. petite ville des Ammonites que Joseph fait de la demi-Tribu de Manassès, au de-là du Jourdain, dans le pays qu’on appella depuis la Trachonite.
ABELIENS, ABELONIENS & ABELOITES, s. m. pl. sorte d’hérétiques en Afrique proche d’Hippone, dont l’opinion & la pratique distinctive étoit de se marier, & cependant de faire profession de s’abstenir de leurs femmes, & de n’avoir aucun commerce charnel avec elles.
Ces hérétiques peu considérables par eux-mêmes, (car ils étoient confinés dans une petite étendue de pays, & ne subsisterent pas long-tems) sont devenus fameux par les peines extraordinaires que les Savans se sont données pour découvrir le principe sur lequel ils se fondoient & la raison de leur dénomination.
Il y en a qui pensent qu’ils se fondoient sur ce texte de S. Paul, I. Cor. VII. 29. Reliquum est ut & qui habent uxores, tanquam non habentes sint.
Un Auteur qui a écrit depuis peu prétend qu’ils régloient leurs mariages sur le pié du Paradis Terrestre ; alléguant pour raison qu’il n’y avoit point eu d’autre union entre Adam & Eve dans le Paradis Terrestre que celle des cœurs. Il ajoûte qu’ils avoient encore en vûe l’exemple d’Abel, qu’ils soûtenoient avoir été marié, mais n’avoir jamais connu sa femme, & que c’est de lui qu’ils prirent leur nom.
Bochart observe qu’il couroit une tradition dans l’Orient, qu’Adam conçut de la mort d’Abel un si grand chagrin qu’il demeura cent trente ans sans avoir de commerce avec Eve. C’étoit, comme il le montre, le sentiment des Docteurs Juifs ; d’où cette fable fut transmise aux Arabes ; & c’est de-là, selon Giggeus, que חאבל Thabala en Arabe, est venu à signifier s’abstenir de sa femme. Bochart en a conclu qu’il est très-probable que cette histoire pénétra jusqu’en Afrique, & donna naissance à la secte & au nom des Abéliens.
Il est vrai que les Rabbins ont cru qu’Adam après la mort d’Abel, demeura long-tems sans user du mariage, & même jusqu’au tems qu’il engendra Seth. Mais d’assûrer que cet intervalle fut de cent trente ans, c’est une erreur manifeste & contraire à leur propre chronologie, qui place la naissance de Seth à la cent trentieme année du Monde, ou de la vie d’Adam, comme on peut le voir dans les deux ouvrages des Juifs intitulés Seder Olam.
Abarbanel dit que ce fut cent trente ans après la chûte d’Adam, ce qui est conforme à l’opinion d’autres Rabbins, que Caïn & Abel furent conçûs immédiatement après la transgression d’Adam. Mais, disent d’autres, à la bonne heure que la continence occasionnée par la chûte d’Adam ou par la mort d’Abel ait donné naissance aux Abéliens : ce fut la continence d’Adam, & non celle d’Abel, que ces hérétiques imiterent ; & sur ce pié, ils auroient dû être appellés Adamites, & non pas Abéliens. En effet il est plus que probable qu’ils prirent leur nom d’Abel sans aucune autre raison, si ce n’est que comme ce Patriarche ils ne laissoient point de postérité ; non qu’il eût vécu en continence après son mariage, mais parce qu’il fut tué avant que d’avoir été marié.
Les Abéliens croyoient apparemment, selon l’opinion commune, qu’Abel étoit mort avant que d’avoir été marié : mais cette opinion n’est ni certaine ni universelle. Il y a des Auteurs qui pensent qu’Abel étoit marié & qu’il laissa des enfans. Ce fut même, selon ces Auteurs, la cause principale de la crainte de Caïn, qui appréhendoit que les enfans d’Abel ne tirassent vengeance de sa mort.
* On croit que cette secte commença sous l’empire d’Arcadius & qu’elle finit sous celui de Théodose le jeune ; & que tous ceux qui la composoient réduits enfin à un seul village, se réunirent à l’Église. S. Aug. de hæres. c. lxxxv. Bayle, dictionn. (G)
* ABELLINAS, s. vallée de Syrie entre le Liban & l’Antiliban, dans laquelle Damas est située.
* ABELLION, ancien Dieu des Gaulois, que Boucher dit avoir pris ce nom du lieu où il étoit adoré. Cette conjecture n’est guere fondée, non plus que celle de Vossius qui croit que l’abellion des Gaulois est l’Apollon des Grecs & des Romains, ou en remontant plus haut, le Bélus des Crétois.
* ABEL-MOSC. Voyez Ambrette ou Graine de Musc.
* ABENEZER, lieu de la Terre Sainte où les Israëlites défaits abandonnerent l’Arche d’alliance aux Philistins.
* ABENSPERG, petite ville d’Allemagne dans le cercle & Duché de Baviere. Long. 29. 25. lat. 48. 45.
* ABEONE, s. f. Déesse du paganisme à laquelle les Romains se recommandoient en se mettant en voyage.
* ABER, s. m. dans l’ancien Breton, chûte d’un ruisseau dans une riviere ; telle est l’origine des noms de plusieurs confluens de cette nature, & de plusieurs villes qui y ont été bâties ; telles que Aberdéen, Aberconway, &c.
* ABERDEEN, ville maritime de l’Ecosse septentrionale. Il y a le vieux & le nouvel Aberdéen. Celui-ci est la capitale de la Province de son nom. Long. 16. lat. 57. 23.
ABERNETY, ABERBORN, ville de l’Ecosse septentrionale au fond du golphe de Firth, à l’embouchure de l’Ern. Long. 14. 40. lat. 56. 37.
ABERRATION, s. f. en Astronomie, est un mouvement apparent qu’on observe dans les étoiles fixes, & dont la cause & les circonstances ont été découvertes par M. Bradley, membre de la société royale de Londres, & aujourd’hui Astronome du roi d’Angleterre à Greenwich.
M. Picard & plusieurs autres Astronomes après lui, avoient observé dans l’Étoile polaire un mouvement apparent d’environ 40″ par an qu’il paroissoit impossible d’expliquer par la parallaxe de l’orbe annuel ; parce que ce mouvement étoit dans un sens contraire à celui suivant lequel il auroit dû être, s’il étoit venu du seul mouvement de la Terre dans son orbite. Voyez Parallaxe du grand Orbe.
Ce mouvement n’ayant pû être expliqué pendant 50 ans, M. Bradley découvrit enfin en 1727 qu’il étoit causé par le mouvement successif de la lumiere combiné avec le mouvement de la Terre. Si la France a produit dans le dernier siecle les deux plus grandes découvertes de l’Astronomie physique, sçavoir, l’accourcissement du Pendule sous l’Équateur, dont Richer s’apperçut en 1672, & la propagation ou le mouvement successif de la lumiere démontré dans l’Académie des Sciences par M. Roëmer, l’Angleterre peut bien se flatter aujourd’hui d’avoir annoncé la plus grande découverte du dix-huitieme siecle.
Voici de quelle maniere M. Bradley a expliqué la théorie de l’aberration, après avoir observé pendant deux années consécutives que l’Etoile γ de la tête du Dragon, qui passoit à son zénith, & qui est fort près du Pole de l’Ecliptique, étoit plus méridionale de 39″ au mois de Mars qu’au mois de Septembre.
Si l’on suppose (Planche Astron. Fig. 31. n. 3.) que l’œil soit emporté uniformément suivant la ligne droite AB, qu’on peut bien regarder ici comme une très-petite partie de l’orbite que la Terre décrit durant quelques minutes, & que l’œil parcourre l’intervalle compris depuis A jusqu’à B précisément dans le tems que la lumiere se meut depuis C jusqu’en B, je dis qu’au lieu d’appercevoir l’Étoile dans une direction parallele à BC, l’œil appercevra, dans le cas présent, l’Étoile selon une direction parallele à la ligne AC. Car supposons que l’œil étant entraîné depuis A jusqu’en B, regarde continuellement au-travers de l’axe d’un tube très-délié, & qui seroit toûjours parallele à lui-même suivant les directions AC, ac, &c. il est évident que si la vitesse de la lumiere a un rapport assez sensible à la vitesse de la Terre, & que ce rapport soit celui de BC à AB, alors la particule de lumiere qui s’étoit d’abord trouvée à l’extrémité C du tube coulera uniformément & sans trouver d’obstacle le long de l’axe, à mesure que le tube viendra à s’avancer, puisque selon la supposition on a toûjours AB à BC comme aB à Bc, & Aa à Cc comme AB à BC ; c’est-à-dire, que l’œil ayant parcouru l’intervalle Aa, la particule de lumiere a dû descendre uniformément jusqu’en c, & par conséquent se trouvera dans le tuyau qui est alors dans la situation ac. D’ailleurs il est aisé de voir que si on donnoit au tube toute autre inclinaison, la particule de lumiere ne pourroit plus couler le long de l’axe, mais trouveroit dès son entrée un obstacle à son passage, parce que le point c ou la particule de lumiere arriveroit ne se trouveroit pas alors dans le tuyau, qui ne seroit plus parallele à AC. Or, parmi cette multitude innombrable de rayons que lance l’Étoile & qui viennent tous parallelement à BC, il s’en trouve assez dequoi fournir continuellement de nouvelles particules qui se succédant les unes aux autres à l’extrémité du tube, coulent le long de l’axe, & forment par conséquent un rayon suivant la direction AC. Il est donc évident que ce même rayon AC sera l’unique qui viendra frapper l’œil, qui par conséquent ne sauroit appercevoir l’Étoile autrement que sous cette même direction. Maintenant si au lieu de ce tube on imagine autant de lignes droites ou de petits tubes extrèmement fins & déliés, que la prunelle de l’œil peut admettre de rayons à la fois, le même raisonnement aura lieu pour chacun de ces tubes, que pour celui dont nous venons de parler. Donc l’œil ne sauroit recevoir aucun des rayons de l’Etoile que ceux qui paroîtront venir suivant des directions paralleles à AC, & par conséquent l’Etoile paroîtra en effet dans un lieu où elle n’est pas véritablement ; c’est-à-dire, dans un lieu différent de celui où on l’auroit apperçue, si l’œil étoit resté fixe au point A.
Ce qui confirme parfaitement cette théorie si ingénieuse, & qui en porte la certitude jusqu’à la démonstration, c’est que la vitesse que doit avoir la lumiere pour que l’angle d’aberration BCA soit tel que les observations le donnent, s’accorde parfaitement avec la vitesse de la lumiere déterminée par M. Roëmer d’après les observations des Satellites de Jupiter. En effet, imaginons (Fig. 31. n°. 2.) que bc soit égal au rayon de l’orbe annuel, l’angle bca est donné par l’observation de la plus grande aberration possible des Etoiles, savoir, de 20″. On fera donc, comme le rayon est à la tangente de 20″, ainsi cb est à un quatriéme terme, qui sera la valeur de la petite portion ab de l’orbe terrestre, laquelle se trouve excéder un peu la dix-millieme partie de la moyenne distance AB ou Ab de la Terre au Soleil, puisqu’elle en est la partie. C’est pourquoi la Terre parcourant 360 degrés en 365 jours , & à proportion un arc de 57 degrés égal au rayon de l’orbite, en 58 jours ou 83709′, il s’ensuit que la 10313 partie de ce dernier nombre, c’est-à-dire, 8′ , ou 8′ 7″ sera le tems que la Terre met à parcourir le petit espace ab, & le tems que la lumiere met à parcourir l’espace bc égal au rayon de l’orbe annuel. Or M. Roëmer a trouvé par les observations des Satellites de Jupiter, que la lumiere doit mettre en effet environ 8′ 7″ à venir du Soleil jusqu’à nous. Voyez Lumiere. C’est pourquoi chacune des deux théories de M. Roëmer & de M. Bradley s’accordent à donner la même quantité pour la vitesse avec laquelle la lumiere se meut.
Au reste comme les directions que l’on regarde comme paralleles, bc, BC, ou bien ac, AC, ne le sont pas en effet, mais concourent au même point du Ciel, sçavoir à l’Etoile E, il s’ensuit qu’à mesure que la terre avancera sur la circonférence de son orbite, l’arc ou la petite tangente ab qu’elle décrit chaque jour venant à changer de direction, il en sera de même à l’égard de la ligne AC qui dans le cours d’une année entiere aura un mouvement conique autour de BC ou de AE, en sorte que prolongée dans le ciel, son extrémité doit décrire un petit cercle autour du vrai lieu qu’occupe l’Étoile ; & comme l’angle ACB ou l’angle alterne CAE qui lui est égal est de 20″, il sera vrai de dire que l’Étoile ne sçauroit jamais être apperçue dans son vrai lieu, mais qu’à chaque année elle doit recommencer à parcourir la circonférence d’un cercle autour de son véritable lieu : en sorte que si elle est au zénith, par exemple, elle pourra être vûe à son passage au méridien alternativement 20″ plus au Nord ou plus au Midi à chaque intervalle d’environ six mois. M. de Maupertuis dans son excellent ouvrage intitulé Elémens de Géographie, explique l’aberration par une comparaison ingénieuse. Il en est ainsi, dit-il, de la direction qu’il faut donner au fusil pour que le plomb frappe l’oiseau qui vole : au lieu d’ajuster directement à l’oiseau, le Chasseur tire un peu au-devant, & tire d’autant plus au-devant, que le vol de l’oiseau est plus rapide par rapport à la vitesse du plomb. Il est évident que dans cette comparaison l’oiseau représente la Terre, & le plomb représente la lumiere de l’Etoile qui la vient frapper. Cette comparaison peut servir à faire entendre le principe de l’aberration à ceux de nos Lecteurs qui n’ont aucune teinture de Géométrie. L’explication que nous venons de donner de ce même principe d’après M. Bradley peut être aussi à l’usage de ceux qui n’en ont qu’une teinture legere ; car on doit sentir que si un tuyau est mû avec une direction donnée qui ne soit pas suivant la longueur du tuyau, un corpuscule ou globule qui doit traverser ou enfiler ce tuyau en ligne droite durant son mouvement sans choquer les parois du tuyau, doit avoir pour cela une direction différente de celle du tuyau, & qui ne soit pas parallele non plus à la longueur du tuyau.
Mais voici une démonstration qui pourra être facilement entendue par tous ceux qui sont un peu au fait des principes de méchanique, & qui ne suppose ni tuyau, ni rien d’étranger. Je ne sache pas qu’elle ait encore été donnée, quoiqu’elle soit simple. Aussi ne prétens-je pas m’en faire un mérite. CB (Fig. 31. n°. 3.) étant (hyp.) la vitesse absolue de l’Étoile, on peut regarder CB comme la diagonale d’un parallélogramme dont les côtés seroient CA & AB ; ainsi on peut supposer que le globule de lumiere, au lieu du mouvement suivant CB, ait à la fois deux mouvemens, l’un suivant CA, l’autre suivant AB. Or le mouvement suivant AB est commun à ce globule & à l’œil du spectateur. Donc ce globule ne frappe réellement l’œil du spectateur que suivant CA. Donc AC est la direction dans laquelle le spectateur doit voir l’Étoile. Car la ligne dans laquelle nous voyons un objet n’est autre chose que la ligne suivant laquelle les rayons entrent dans nos yeux. C’est pour cette raison que dans les miroirs plans, par exemple, nous voyons l’objet au dedans du miroir, &c. Voyez Miroir. Voyez aussi Apparent.
M. Bradley a joint à sa théorie des formules pour calculer l’aberration des fixes en déclinaison & en ascension droite : ces formules ont été démontrées en deux différentes manieres, & réduites à un usage fort simple par M. Clairaut dans les Mémoires de l’Académie de 1737. Elles ont aussi été démontrées par M. Simpson de la Société Royale de Londres, dans un Recueil de différens Opuscules Mathématiques imprimé en Anglois à Londres 1745. Enfin M. Fontaine des Crutes a publié un traité sur le même sujet. Cet Ouvrage a été imprimé à Paris en 1744. Des Astronomes habiles nous ont paru en faire cas ; tant parce qu’il explique fort clairement la théorie & les calculs de l’aberration, que parce qu’il contient une histoire assez curieuse de l’origine & du progrès de l’Astronomie dressée sur des Mémoires de M. le Monnier. Nous avons tiré des Institutions Astronomiques de ce dernier une grande partie de cet article. (O)
* ABER-YSWITH, ville d’Angleterre dans le Casdiganshire, Province de la Principauté de Galles proche de l’embouchure de l’Yswith. Long. 13. 20. lat. 52. 30.
* ABESKOUN, isle d’Asie dans la mer Caspienne.
* ABEX, contrée maritime d’Afrique entre le pas de Suaquem & le détroit de Babel-Mandel.
* ABGARES. Les Abgares d’Edesse en Mésopotamie étoient de petits Rois qu’on voit souvent sur des Médailles avec des thiares d’une forme assez semblable à certaines des Rois Parthes. Voyez les Antiquités du Pere Montfaucon, tome III. partie I. p. 80.
* ABHAL ; c’est, à ce qu’on lit dans James, un fruit de couleur rousse, très-connu dans l’Orient, de la grosseur à peu près de celui du cyprès, & qu’on recueille sur un arbre de la même espece. On le regarde comme un puissant emmanégogue.
* ABIAD, ville d’Afrique sur la côte d’Abex.
* ABIANNEUR. Voyez Abienheur.
ABIB, s. m. nom que les Hébreux donnoient au premier mois de leur année sainte. Dans la suite il fut appellé Nisan. Voyez Nisan. Il répond à notre mois de Mars. Abib en Hébreu signifie des épis verds. S. Jerôme le traduit par des fruits nouveaux, mense novarum frugum. Exod. XIII. v. 4.. Voyez sous le mot Nisan les principales Fêtes & Cérémonies que les Juifs pratiquoient ou pratiquent encore pendant ce mois. Dictionn. de la Bible, tome I. page 14. (G)
* ABIENHEUR, s. m. terme de la Coutume de Bretagne ; c’est le Sequestre ou le Commissaire d’un fonds saisi.
* ABIENS. C’étoient entre les Scythes, d’autres disent entre les Thraces, des peuples qui faisoient profession d’un genre de vie austere, dont Tertullien fait mention, Lib. de præscript. cap. xlij. que Strabon loue d’une pureté de mœurs extraordinaire, & qu’Alexandre ab Alexandro & Scaliger ont jugé à propos d’appeller du nom de Philosophes, enviant, pour ainsi dire, aux Scythes une distinction qui leur fait plus d’honneur qu’à la Philosophie, d’être les seuls peuples de la Terre qui n’ayent presque eu ni Poëtes, ni Philosophes, ni Orateurs, & qui n’en ayent été ni moins honorés, ni moins courageux, ni moins sages. Les Grecs avoient une haute estime pour les Abiens, & ils la méritoient bien par je ne sais quelle élévation de caractere & je ne sais quel degré de justice & d’équité dont ils se piquoient singulierement entre leurs compatriotes pour qui leur personne étoit sacrée. Que ne devoient point être aux yeux des autres hommes ceux pour qui les sages & braves Scythes avoient tant de vénération ! Ce sont ces Abiens, je crois, qui se conserverent libres sous Cyrus & qui se soûmirent à Alexandre. C’est un grand honneur pour Alexandre, ou peut-être un reproche à leur faire.
ABIGEAT, s. m. terme de Droit Civil, étoit le crime d’un homme qui détournoit des bestiaux pour les voler.
* ABIMALIC, s. m. langue des Africains Beriberes, ou naturels du pays.
ABISME ou ABYSME, s. m. pris généralement, signifie quelque chose de très-profond, & qui, pour ainsi dire, n’a point de fond.
Ce mot est grec originairement ἀϐυσσὸς ; il est composé de la particule privative α & ϐυσσὸς, fond ; c’est-à-dire sans fond. Suidas & d’autres lui donnent différentes origines : ils disent qu’il vient de α & de ϐύω, couvrir, cacher, ou de α & de δύω : mais les plus judicieux Critiques rejettent cette étymologie comme ne valant gueres mieux que celle d’un vieux Glossateur, qui fait venir abyssus de ad ipsus, à cause que l’eau vient s’y rendre en abondance.
Abîme, pris dans un sens plus particulier, signifie un amas d’eau fort profond. Voyez Eau.
Les Septante se servent particulierement de ce mot en ce sens, pour désigner l’eau que Dieu créa au commencement avec la terre ; c’est dans ce sens que l’Ecriture dit que les ténebres étoient sur la surface de l’abysme.
On se sert aussi du mot abysme pour marquer le réservoir immense creusé dans la terre, où Dieu ramassa toutes ces eaux le troisieme jour : réservoir que l’on désigne dans notre Langue par le mot mer, & quelquefois dans les Livres saints par le grand abysme.
Abisme, se dit dans l’Ecriture de l’enfer, & des lieux les plus profonds de la mer, & du cahos qui étoit couvert de ténebres au commencement du monde, & sur lequel l’Esprit de Dieu étoit porté. Genese 1. 2. Les anciens Hébreux, de même que la plûpart des Orientaux, encore à présent, croient que l’abysme, la mer, les cieux, environnoient toute la terre ; que la terre étoit comme plongée & flotante sur l’abysme, à peu près, disent-ils, comme un melon d’eau nage sur l’eau & dans l’eau, qui le couvre dans toute sa moitié. Ils croient de plus, que la terre étoit fondée sur les eaux, ou du moins qu’elle avoit son fondement dans l’abysme. C’est sous ces eaux & au fond de cet abysme, que l’Ecriture nous représente les Géans qui gémissent & qui souffrent la peine de leurs crimes : c’est-là où sont relegués les Rephaïms, ces anciens Géans, qui de leur vivant faisoient trembler les peuples ; enfin c’est dans ces sombres cachots que les Prophetes nous font voir les Rois de Tyr, de Babylone, & d’Egypte, qui y sont couchés & ensevelis, mais toutefois vivant & expiant leur orgueil & leur cruauté. Psal. xxxiii. 2 xxxv. 6. Proverb. xi. 18. ix. 18. xxi. 16. Ps. lxxxvii. 2. lxx. 20 Is. xiv. 9. Ezech. xxviii. 10. xxxi. 18. xxxii. 19.
Ces abysmes sont la demeure des démons & des impies. Je vis, dit S. Jean dans l’Apocalypse, une étoile qui tomba du ciel, & à qui l’on donna la clef du puits de l’abysme : elle ouvrit le puits de l’abysme, & il en sortit une fumée comme d’une grande fournaise, qui obscurcit le soleil & l’air, & de cette fumée sortirent des sauterelles, qui se repandirent sur toute la terre : elles avoient pour Roi à leur tête l’Ange de l’abysme, qui est nommé Exterminateur. Et ailleurs, on nous représente la bête qui sort de l’abysme, & qui fait la guerre aux deux témoins de la Divinité. Enfin l’Ange du Seigneur descend du ciel, ayant en sa main la clef de l’abysme, & tenant une grande chaîne. Il saisit le dragon, l’ancien serpent, qui est le diable & satan, le lie, le jette dans l’abysme pour y demeurer pendant mille ans, ferme sur lui le puits de l’abysme & le scelle, afin qu’il n’en puisse sortir de mille ans, &c. Apoc. ix. l. 2. xi. 7. xx. l. 3.
Les fontaines & les rivieres, au sentiment des Hébreux, ont toutes leur source dans l’abysme ou dans la mer : elles en sortent par des canaux invisibles, & s’y rendent par les lits qu’elles se sont formés sur la terre. Au tems du déluge, les abysmes d’embas, ou les eaux de la mer, rompirent leur digue, les fontaines forcerent leurs sources, & se repandirent sur la terre dans le même tems que les cataractes du ciel s’ouvrirent, & inonderent tout le monde. Eccl. i. 7. Genes. viii. v. ii.
L’abysme qui couvroit la terre au commencement du monde, & qui étoit agité par l’Esprit de Dieu, ou par un vent impétueux ; cet abysme est ainsi nommé par anticipation, parce qu’il composa dans la suite la mer, & que les eaux de l’abysme en sortirent & se formerent de son écoulement : ou si l’on veut, la terre sortit du milieu de cet abysme, comme une isle qui sort du milieu de la mer, & qui paroît tout d’un coup à nos yeux, après avoir été long-tems cachée sous les eaux. Genes. 1. 2. Dictionn. de la Bibl. de Calmet, tom. I. lettre A. au mot Abysme, pag. 15.
M. Woodward nous a donné des conjectures sur la forme du grand abysme dans son Histoire naturelle de la Terre : il soûtient qu’il y a un grand amas d’eaux renfermées dans les entrailles de la terre, qui forment un vaste globe dans ses parties intérieures ou centrales, & que la surface de cette eau est couverte de couches terrestres : c’est, selon lui, ce que Moyse appelle le grand gouffre, & ce que la plûpart des Auteurs entendent par le grand abysme.
L’existence de cet amas d’eaux dans l’intérieur de la terre, est confirmée, selon lui, par un grand nombre d’observations. Voyez Terre. Déluge.
Le même Auteur prétend que l’eau de ce vaste abysme communique avec celle de l’océan, par le moyen de quelques ouvertures qui sont au fond de l’océan : il dit que cet abysme & l’océan ont un centre commun, autour duquel les eaux des deux réservoirs sont placées ; de maniere cependant que la surface de l’abysme n’est point de niveau avec celle de l’océan, ni à une aussi grande distance du centre, étant en partie resserrée & comprimée par les couches solides de la terre qui sont dessus. Mais par tout où ces couches sont crevassées, ou si poreuses que l’eau peut les pénétrer, l’eau de l’abysme y monte, elle remplit toutes les fentes & les crevasses où elle peut s’introduire, & elle imbibe tous les interstices & tous les pores de la terre, des pierres, & des autres matieres qui sont autour du globe, jusqu’à ce que cette eau soit montée au niveau de l’océan. Sur quoi tout cela est-il fondé ?
Si ce qu’on rapporte dans les Mémoires de l’Académie de 1741, de la fontaine sans fond de Sablé en Anjou, est entierement vrai, on peut mettre cette fontaine au rang des abysmes ; parce qu’en effet ceux qui l’ont sondée n’y ont point trouvé de fond ; & que selon la tradition du Pays, plusieurs bestiaux qui y sont tombés, n’ont jamais été retrouvés. C’est une espece de gouffre de 20 à 25 piés d’ouverture, situé au milieu & dans la partie la plus basse d’une lande de 8 à 9 lieues de circuit, dont les bords élevés en entonnoir, descendent par une pente insensible jusqu’à ce gouffre, qui en est comme la citerne. La terre tremble ordinairement tout autour, sous les piés des hommes & des animaux qui marchent dans ce bassin. Il y a de tems en tems des débordemens, qui n’arrivent pas toûjours après les grandes pluies, & pendant lesquels il sort de la fontaine une quantité prodigieuse de poisson, & surtout beaucoup de brochets truités, d’une espece fort singuliere, & qu’on ne connoît point dans le reste du Pays. Il n’est pas facile cependant d’y pêcher, parce que cette terre tremblante & qui s’affaisse au bord du gouffre, & quelquefois assez loin aux environs, en rend l’approche fort dangereuse ; il faut attendre pour cela des années seches, & où les pluies n’ayent pas ramolli d’avance le terrein inondé. En général, il y a lieu de croire que tout ce terrein est comme la voûte d’un lac, qui est au-dessous. L’Académie qui porte par préférence son attention sur les curiosités naturelles du Royaume, mais qui veut en même tems que ce soient de vraies curiosités, a jugé que celle-ci méritoit une plus ample instruction. Elle avoit chargé M. de Bremond de s’informer plus particulierement de certains faits, & de quelques circonstances qui pouvoient plus sûrement faire juger de la singularité de cette fontaine : mais une longue maladie, & la mort de M. de Bremond arrivée dans l’intervalle de cette recherche, ayant arrêté les vastes & utiles projets de cet Académicien, l’Académie n’a pas voulu priver le public de ce qu’elle savoit déja sur la fontaine de Sablé. (O & G) Voyez Gouffre.
Abisme, s. m. terme de Blason. C’est le centre ou le milieu de l’écu, en sorte que la piece qu’on y met ne touche & ne charge aucune autre piece. Ainsi on dit d’un petit écu qui est mis au milieu d’un grand, qu’il est en abysme ; & tout autant de fois qu’on commence par toute autre figure que par celle du milieu, on dit que celle qui est au milieu est en abysme, comme si on vouloit dire que les autres grandes pieces étant élevées en relief, celle-là paroît petite, & comme cachée & abysmée. Il porte trois besans d’or avec une fleur de lis en abysme : ainsi ce terme ne signifie pas simplement le milieu de l’écu, car il est relatif, & suppose d’autres pieces, au milieu desquelles une plus petite est abysmée.
* Abisme. C’est une espece de cuvier ou vaisseau de bois à l’usage des Chandeliers, dont l’ouverture abcd est parallelogrammatique ; les ais quarrés oblongs qui forment les grands côtés de ce cuvier sont inclinés l’un vers l’autre, font un angle aigu, & s’assemblent par cet angle dans deux patens sur une banquette à quatre piés ghie, autour de laquelle il y a un rebord pour recevoir le suif qui coule de la chandele quand elle sort de ce vaisseau. On voit par ce qui vient d’être dit, que les deux petits côtés de ce cuvier a b f, d c e, sont nécessairement taillés en triangles. C’est dans ce vaisseau rempli de suif en fusion, que l’on plonge à différentes reprises les meches qui occupent le centre de la chandele. Ces meches sont enfilées sur des baguettes. Voyez la maniere de faire la chandele à la broche ou baguette, à l’article Chandelle, & la figure de l’abysme, planche du Chandelier, fig. 7
* ABINGDON, ou ABINGTON, ou ABINDON, ville d’Angleterre en Barkshire, & sur la Tamise. Long. 16. 20. lat. 51. 40.
AB-INTESTAT. Voyez Intestat. (H)
* ABISCAS, s. m. Peuple de l’Amérique méridionale, à l’Est du Pérou.
* ABISSINIE, s. f. grand Pays & Royaume d’Afrique. Long. 48-65. lat. 6-20.
ABIT, s. m. Quelques-uns se servent de ce mot pour exprimer la céruse. Voyez Aboit, Ceruse, Blanc de Plomb. (M)
ABJURATION, s. f. en général, acte par lequel on dénie ou l’on renonce une chose d’une maniere solemnelle, & même avec serment. V. Serment.
Ce mot vient du Latin abjuratio, composé de ab, de ou contre, & de jurare, jurer.
Chez les Romains le mot d’abjuration signifioit dénégation avec faux serment d’une dette, d’un gage, d’un dépôt, ou autre chose semblable, auparavant confiée. En ce sens l’abjuration est la même chose que le parjure ; elle differe de l’éjuration qui suppose le serment juste. Voyez Parjure, &c.
L’abjuration se prend plus particulierement pour la solemnelle rénonciation ou retractation d’une doctrine ou d’une opinion regardée comme fausse & pernicieuse.
Dans les Lois d’Angleterre, abjurer une personne, c’est renoncer à l’autorité ou au domaine d’une telle personne. Par le serment d’abjuration, on s’oblige de ne reconnoître aucune autorité royale dans la personne appellée le Prétendant, & de ne lui rendre jamais l’obéissance que doit rendre un sujet à son Prince. Voyez Serment, Fidélité, &c.
Le mot d’abjuration est aussi usité dans les anciennes Coûtumes d’Angleterre, pour le serment fait par une personne coupable de félonie, qui se retirant dans un lieu d’asyle, s’obligeoit par serment d’abandonner le Royaume pour toûjours ; ce qui le mettoit à l’abri de tout autre châtiment. Nous trouvons aussi des exemples d’abjuration pour un tems, pour trois ans, pour un an & un jour, & semblables.
Les criminels étoient reçûs à faire cette abjuration en certains cas, au lieu d’être condamnés à mort. Depuis le tems d’Edouard le Confesseur, jusqu’à la réformation, les Anglois avoient tant de dévotion pour les Eglises, que si un homme coupable de félonie se réfugioit dans une Eglise ou dans un Cimetiere, c’étoit un asyle dont il ne pouvoit être tiré pour lui faire son procès ; mais en confessant son crime à la Justice ou au Coroner, & en abjurant le Royaume, il étoit mis en liberté. V. Asyle & Coroner.
Après l’abjuration on lui donnoit une croix, qu’il devoit porter à la main le long des grands chemins, jusqu’à ce qu’il fût hors des Domaines du Roi : on l’appelloit la banniere de Mere-Eglise. Mais l’abjuration déchut beaucoup dans la suite, & se réduisit à retenir pour toûjours le prisonnier dans le Sanctuaire, où il lui étoit permis de finir le reste de ses jours, après avoir abjuré sa liberté & sa libre habitation. Par le Statut 21. de Jacques Ier, tout usage d’asyle, & conséquemment d’abjuration, fut aboli. Voyez Sanctuaire. (G)
* ABLAB, s. arbrisseau de la hauteur d’un sep de vigne. On dit qu’il croît en Egypte, qu’il garde sa verdure Hyver & Été, qu’il dure un siecle, que ses feuilles & ses fleurs ressemblent à celles de la féve de Turquie, que ses féves servent d’aliment en Egypte, & de remede contre la toux & la rétention d’urine, &c. Mais il faut attendre, pour ajoûter foi à cette plante & à ses propriétés, que les Naturalistes en aient parlé clairement.
* ABLAI, s. contrée de la grande Tartarie. Long. 91-101. lat. 51-54.
ABLAIS, s. m. terme de Coûtumes ; il se dit des blés sciés encore gissants sur le champ. (H)
* ABLAQUE, s. nom que les François ont donné à la soie de perle, ou ardassine. Cette soie vient par la voie de Smyrne ; elle est fort belle : mais comme elle ne souffre pas l’eau chaude, il y a peu d’ouvrages dans lesquels elle puisse entrer.
ABLATIF, s. m. terme de Grammaire. C’est le sixieme cas des noms Latins. Ce cas est ainsi appellé du Latin ablatus, ôté, parce qu’on donne la terminaison de ce cas aux noms Latins qui sont le complément des prépositions à, absque, de, ex, sine, qui marquent extraction ou transport d’une chose à une autre : ablatus à me, ôté de moi ; ce qui ne veut pas dire qu’on ne doive mettre un nom à l’ablatif que lorsqu’il y a extraction ou transport ; car on met aussi à l’ablatif un nom qui détermine d’autres prépositions, comme clam, pro, præ, &c mais il faut observer que ces sortes de dénominations se tirent de l’usage le plus fréquent, ou même de quelqu’un des usages. C’est ainsi que Priscien, frappé de l’un des usages de ce cas, l’appelle cas comparatif ; parce qu’en effet on met à l’ablatif l’un des correlatifs de la comparaison : Paulus est doctior Petro ; Paul est plus savant que Pierre. Varron l’appelle cas latin, parce qu’il est propre à la Langue Latine. Les Grecs n’ont point de terminaison particuliere pour marquer l’ablatif : c’est le génitif qui en fait la fonction ; & c’est pour cela que l’on trouve souvent en Latin le génitif à la maniere des Grecs, au lieu de l’ablatif latin.
Il n’y a point d’ablatif en François, ni dans les autres Langues vulgaires, parce que dans ces Langues les noms n’ont point de cas. Les rapports ou vûes de l’esprit que les Latins marquoient par les différentes inflexions ou terminaisons d’un même mot, nous les marquons, ou par la place du mot, ou par le secours des prépositions. Ainsi, quand nos Grammairiens disent qu’un nom est à l’ablatif, ils ne le disent que par analogie à la Langue latine ; je veux dire, par l’habitude qu’ils ont prise dans leur jeunesse à mettre du françois en latin, & à chercher en quel cas Latin ils mettront un tel mot François : par exemple, si l’on vouloit rendre en latin ces deux phrases, la grandeur de Paris, & je viens de Paris, de Paris seroit exprimé par le génitif dans la premiere phrase ; au lieu qu’il seroit mis à l’ablatif dans la seconde. Mais comme en françois l’effet que les terminaisons latines produisent dans l’esprit y est excité d’une autre maniere que par les terminaisons, il ne faut pas donner à la maniere françoise les noms de la maniere latine. Je dirai donc qu’en Latin amplitudo, ou vastitas Lutetiæ, est au génitif ; Lutetia, Lutetiæ, c’est le même mot avec une inflexion différente : Lutetiæ est dans un cas oblique qu’on appelle génitif, dont l’usage est de déterminer le nom auquel il se rapporte d’en restraindre l’extension, d’en faire une application particuliere. Lumen solis, le génitif solis détermine lumen. Je ne parle, ni de la lumiere en général, ni de la lumiere de la lune, ni de celle des étoiles, &c. je parle de la lumiere du soleil. Dans la phrase françoise la grandeur de Paris, Paris ne change point de terminaison ; mais Paris est lié à grandeur par la préposition de, & ces deux mots ensemble déterminent grandeur ; c’est-à-dire, qu’ils font connoître de quelle grandeur particuliere on veut parler : c’est de la grandeur de Paris.
Dans la seconde phrase, je viens de Paris, de lie Paris à je viens, & sert à désigner le lieu d’où je viens.
L’Ablatif a été introduit après le datif pour plus grande netteté.
Sanctius, Vossius, la Méthode de Port-Royal, & les Grammairiens les plus habiles, soûtiennent que l’ablatif est le cas de quelqu’une des prépositions qui se construisent avec l’ablatif ; en sorte qu’il n’y a jamais d’ablatif qui ne suppose quelqu’une de ces prépositions exprimée ou sousentendue.
Ablatif absolu. Par Ablatif absolu les Grammairiens entendent un incise qui se trouve en Latin dans une période, pour y marquer quelque circonstance ou de tems ou de maniere, &c. & qui est énoncé simplement par l’ablatif : par exemple, imperante Cæsare Augusta, Christus natus est : Jesus-Christ est venu au monde sous le regne d’Auguste. Cæsar deleto hostium exercitu, &c. César après avoir défait l’armée de ses ennemis, &c. imperante Cæsare Augusto, deleto exercitu, sont des ablatifs qu’on appelle communément absolus, parce qu’ils ne paroissent pas être le régime d’aucun autre mot de la proposition. Mais on ne doit se servir du terme d’absolu, que pour marquer ce qui est indépendant, & sans relation à un autre : or dans tous les exemples que l’on donne de l’ablatif absolu, il est évident que cet ablatif a une relation de raison avec les autres mots de la phrase, & que sans cette relation il y seroit hors d’œuvre, & pourroit être supprimé.
D’ailleurs, il ne peut y avoir que la premiere dénomination du nom qui puisse être prise absolument & directement ; les autres cas reçoivent une nouvelle modification ; & c’est pour cela qu’ils sont appellés cas obliques. Or il faut qu’il y ait une raison de cette nouvelle modification ou changement de terminaison ; car tout ce qui change, change par autrui ; c’est un axiome incontestable en bonne Métaphysique : un nom ne change la terminaison de sa premiere dénomination, que parce que l’esprit y ajoûte un nouveau rapport, une nouvelle vûe. Quelle est cette vûe ou rapport qu’un tel ablatif désigne ? est-ce le tems, ou la maniere, ou le prix, ou l’instrument, ou la cause, &c. Vous trouverez toûjours que ce rapport sera quelqu’une de ces vûes de l’esprit qui sont d’abord énoncées indéfiniment par une préposition, & qui sont ensuite déterminées par le nom qui se rapporte à la préposition : ce nom en fait l’application ; il en est le complément.
Ainsi l’ablatif, comme tous les autres cas, nous donne par la nomenclature l’idée de la chose que le mot signifie ; tempore, tems ; fuste, bâton ; manu, main ; patre, pere, &c. mais de plus, nous connoissons par la terminaison de l’ablatif, que ce n’est pas là la premiere dénomination de ces mots ; qu’ainsi ils ne sont pas le sujet de la proposition, puisqu’ils sont dans un cas oblique : or la vûe de l’esprit qui a fait mettre le mot dans ce cas oblique, est ou exprimée par une préposition, ou indiquée si clairement par le sens des autres mots de la phrase, que l’esprit apperçoit aisément la préposition qu’on doit suppléer, quand on veut rendre raison de la construction. Ainsi observez :
1. Qu’il n’y a point d’ablatif qui ne suppose une préposition exprimée ou sousentendue.
2. Que dans la construction élégante on supprime souvent la préposition, lorsque les autres mots de la phrase font entendre aisément quelle est la préposition qui est sousentendue ; comme imperante Cæsare Augusto, Christus natus est : on voit aisément le rapport de tems, & l’on sousentend sub.
3. Que lorsqu’il s’agit de donner raison de la construction, comme dans les versions interlinéaires, qui ne sont faites que dans cette vûe, on doit exprimer la préposition qui est sousentendue dans le texte élégant de l’Auteur dont on fait la construction.
4. Que les meilleurs Auteurs Latins, tant Poëtes qu’Orateurs, ont souvent exprimé les prépositions que les Maîtres vulgaires ne veulent pas qu’on exprime, même lorsqu’il ne s’agit que de rendre raison de la construction : en voici quelques exemples.
Sæpe ego correxi sub te censore libellos. Ov. de Ponto, IV. Ep. xij. v. 25. J’ai souvent corrigé mes ouvrages sur votre critique. Marco sub judice palles. Perse, Sat, v. Quos decet esse hominum, tali sub Principe mores. Mart. L. I. Florent sub Cæsare leges. Ov. II. Fast. v. 141. Vacare à negotiis. Phæd. L. III. Prol. v. 2. Purgare à foliis. Cato, de Re rusticâ, 66. De injuriâ queri. Cæsar. Super re queri. Horat. Uti de aliquo. Cic. Uti de victoriâ. Servius. Nolo me in tempore hoc videat senex. Ter. And. Act. IV. v. ult. Artes, excitationesque virtutum in omni ætate cultæ, mirificos afferunt fructus. Cic. de Senect. n. 9. Doctrina nulli tanta in illo tempore. Auson. Burd. Prof. v. ℣ 15. Omni de parte timendos. Ov. de Ponto, L. IV. Ep. xij. v. 25. Frigida de tota fronte cadebat aqua. Prop. L. II. Eleg. xxij. Nec mihi solstitium quidquam de noctibus aufert. Ovid. Trist. L. V. El. x. 7. Templum de marmore. Virg. & Ovid. Vivitur ex rapto. Ovid. Metam. 1. v. 144. Facere de industria. Ter. And. act. IV. De plebe Deus ; un Dieu du commun. Ovid. Metam. I. v. 595.
La préposition à se trouve souvent exprimée dans les bons Auteurs dans le même sens que post, après : ainsi lorsqu’elle est supprimée devant les ablatifs que les Grammairiens vulgaires appellent absolus, il faut la suppléer, si l’on veut rendre raison de la construction.
Cujus à morte, hic tertius & tricesimus est annus. Cic. Il y a trente-trois ans qu’il est mort : à morte, depuis sa mort. Surgit, ab his, solio. Ovid. II. Met. où vous voyez que ab his veut dire, après ces choses, après quoi. Jam ab re divinâ, credo apparebunt domi. Plaut. Phænul. Ab re divinâ : après le service divin, après l’office, au sortir du Temple, ils viendront à la maison. C’est ainsi qu’on dit, ab urbe conditâ, depuis la fondation de Rome : à cænâ, après souper : secundus à Rege, le premier après le Roi. Ainsi quand on trouve urbe captâ triumphavit ; il faut dire, ab urbe captâ, après la ville prise. Lectis tuis litteris, venimus in Senatum ; suppléez à litteris tuis lectis ; après avoir lû votre lettre.
On trouve dans Tite-Live, L. IV. ab re malè gesta, après ce mauvais succès ; &ab re benè gesta, L. XXIII. après cet heureux succès. Et dans Lucain, L. I. positis ab armis, après avoir mis les armes bas ; & dans Ovid. II. Trist. redeat superato miles ab hoste ; que le soldat revienne après avoir vaincu l’ennemi. Ainsi dans ces occasions on donne à la préposition à, qui se construit avec l’ablatif, le même sens que l’on donne à la préposition post, qui se construit avec l’accusatif. C’est ainsi que Lucain au L. II. a dit post me ducem ; & Horace, I. L. Od. iij. post ignem ætheriâ domo subductum ; où vous voyez qu’il auroit pû dire, ab igne ætheriâ domo subducto, ou simplement, igne ætheriâ domo subducto.
La préposition sub marque aussi fort souvent le tems : elle marque ou le tems même dans lequel la chose s’est passée, ou par extension, un peu avant ou un peu après l’évenement. Dans Corn. Nepos, Att. xij. Quos sub ipsa proscriptione perillustre fuit ; c’est-à-dire, dans le tems même de la proscription. Le même Auteur à la même vie d’Atticus, c. 105. dit, sub occasu solis, vers le coucher du soleil, un peu avant le coucher du soleil. C’est dans le même sens que Suétone a dit, Ner. 5. majestatis quoque, sub excessu Tiberii, reus, où il est évident que sub excessu Tiberii, veut dire vers le tems, ou peu de tems avant la mort de Tibere. Au contraire, dans Florus, L. III. c. v. sub ipso hostis recessu, impatientes soli, in aquas suas resiluerunt : sub ipso hostis recessu veut dire, peu de tems après que l’ennemi se fût retiré ; à peine l’ennemi s’étoit-il retiré.
Servius, sur ces paroles du V. L. de l’Eneid. quo deinde sub ipso, observe que sub veut dire là post, après.
Claudien pouvoit dire par l’ablatif absolu, gratus feretur, te teste, labor ; le travail sera agréable sous vos yeux : cependant il a exprimé la préposition gratusque feretur sub te teste labor. Claud. IV. Cons. Honor.
A l’égard de ces façons de parler, Deo duce, Deo juvante, Musis faventibus, &c. que l’on prend pour des ablatifs absolus, on peut sousentendre la préposition sub, ou la préposition cum, dont on trouve plusieurs exemples : sequere hac, mea gnata, cum Diis volentibus. Plaut. Perse. Tite-Live, au L. I. Dec. iij. dit : agite cum Diis bene juvantibus. Ennius cité par Cicéron, dit : Doque volentibus cum magnis Diis : & Caton au chapitre xiv. de Re rust. dit : circumagi cum Divis.
Je pourrois rapporter plusieurs autres exemples pour faire voir que les meilleurs Auteurs ont exprimé les prépositions que nous disons qui sont sous-entendues dans le cas de l’ablatif absolu. S’agit-il de l’instrument ; c’est ordinairement cum, avec, qui est sousentendu : armis confligere ; Lucilius a dit : Acribus inter se cum armis confligere cernit. S’agit-il de la cause, de l’agent : suppléez à, ab, trajectus ense, percé d’un coup d’épée. Ovid. V. Fast. a dit : Pectora trajectus Lynceo Castor ab ense : & au second Liv. des Tristes ; Neve peregrinis tantum defendar ab armis.
Je finirai cet article par un passage de Suétone qui semble être fait exprès pour appuyer le sentiment que je viens d’exposer. Suétone dit qu’Auguste pour donner plus de clarté à ses expressions, avoit coutume d’exprimer les prépositions dont la suppression, dit-il, jette quelque sorte d’obscurité dans le discours, quoiqu’elle en augmente la grace & la vivacité. Suéton. C. Aug. n. 86. Voici le passage tout-au-long. Genus eloquendi secutus est elegans & temperatum : vitatis sententiarum ineptiis, atque inconcinnitate, & reconditorum verborum, ut ipse dicit, fœtoribus : præcipuamque curam duxit, sensum animi quam apertissimè exprimere : quod quo faciliùs efficeret, aut necubi lectorem vel auditorem obturbaret ac moraretur, neque præpositiones verbis addere, neque conjunctiones sæpius iterare dubitavit, quæ detractæ afferunt aliquid obscuritatis, etsi gratiam augent.
Aussi a-t-on dit de cet Empereur que sa maniere de parler étoit facile & simple, & qu’il évitoit tout ce qui pouvoit ne pas se présenter aisément à l’esprit de ceux à qui il parloit. Augusti promta ac profluens quæ decebat principem eloquentia fuit. Tacit.
In divi Augusti epistolis, elegantia orationis, neque morosa neque anxia : sed facilis, hercle & simplex. A. Gell.
Ainsi quand il s’agit de rendre raison de la construction Grammaticale, on ne doit pas faire difficulté d’exprimer les prépositions, puisqu’Auguste même les exprimoit souvent dans le discours ordinaire, & qu’on les trouve souvent exprimées dans les meilleurs Auteurs.
A l’égard du François, nous n’avons point d’ablatif absolu, puisque nous n’avons point de cas : mais nous avons des façons de parler absolues, c’est-à-dire, des phrases où les mots, sans avoir aucun rapport Grammatical avec les autres mots de la proposition dans laquelle ils se trouvent, y forment un sens détaché qui est un incise équivalent à une proposition incidente ou liée à une autre, & ces mots énoncent quelque circonstance ou de tems ou de maniere, &c. la valeur des termes & leur position nous font entendre ce sens détaché.
En Latin la vûe de l’esprit qui dans les phrases de la construction simple est énoncée par une préposition, est la cause de l’ablatif : re confectà ; ces deux mots ne sont à l’ablatif qu’à cause de la vûe de l’esprit qui considere la chose dont il s’agit comme faite & passée : or cette vûe se marque en Latin par la préposition à : cette préposition est donc sousentendue, & peut être exprimée en Latin.
En François, quand nous disons cela fait, ce considéré, vû par la Cour, l’Opéra fini, &c. nous avons la même vûe du passé dans l’esprit : mais quoique souvent nous puissions exprimer cette vûe par la préposition après, &c. cependant la valeur des mots isolés du reste de la phrase est équivalente au sens de la préposition Latine.
On peut encore ajoûter que la Langue Françoise s’étant formée de la Latine, & les Latins retranchant la préposition dans le discours ordinaire, ces phrases nous sont venues sans prépositions, & nous n’avons saisi que la valeur des mots qui marquent ou le passé ou le présent, & qui ne sont point sujets à la variété des terminaisons, comme les noms Latins ; & voyant que ces mots n’ont aucun rapport grammatical ou de syntaxe avec les autres mots de la phrase, avec lesquels ils n’ont qu’un rapport de sens ou de raison, nous concevons aisément ce qu’on veut nous faire entendre. (F)
ABLE, s. m. ou ABLETTE, s. s. poisson de riviere de la longueur du doigt : il a les yeux grands pour sa grosseur, & de couleur rouge, le dos verd, & le ventre blanc ; sa tête est petite ; son corps est large & plat : on y voit deux lignes de chaque côté, dont l’une est au milieu du corps, depuis les ouies jusques à la queue, & l’autre un peu plus bas ; elle commence à la nageoire qui est au-dessous des ouies, & elle disparoît avant que d’arriver jusqu’à la queue. Ce poisson n’a point de fiel ; sa chair est fort mollasse : on le prend aisément à l’hameçon, parce qu’il est fort goulu. Rondelet. L’Ablette ressemble à un Éperlan : mais ses écailles sont plus argentées & plus brillantes.
On tire de l’Able la matiere avec laquelle on colore les fausses perles. Voyez fausses Perles. C’est cette matiere préparée que l’on appelle essence d’Orient. Pour la faire, on écaille le poisson à l’ordinaire, on met les écailles dans un bassin plein d’eau claire, & on les frotte comme si on vouloit les broyer. Lorsque l’eau a pris une couleur argentée, on la transverse dans un verre, & ensuite on en verse de nouvelle sur les écailles, & on réitere la même opération tant que l’eau se colore : après dix ou douze heures, la matiere qui coloroit l’eau se dépose au fond du verre, l’eau devient claire ; alors on la verse par inclination jusqu’à ce qu’il ne reste plus dans le verre qu’une liqueur épaisse à peu près comme de l’huile, & d’une couleur approchante de celle des perles : c’est l’essence d’Orient. Les particules de matiere qui viennent des écailles sont sensibles dans cette liqueur au moyen du microscope, ou même de la loupe. On y voit des lames, dont la plûpart sont de figure rectangulaire, & ont quatre fois plus de longueur que de largeur : il y en a aussi dont les extrémités sont arrondies, & d’autres qui sont terminées en pointe ; mais toutes sont extrèmement minces ; toutes sont plates & brillantes. Cette matiere vient de la surface intérieure de l’écaille où elle est rangée régulierement & recouverte par des membranes ; de sorte que si on veut en enlever avec la pointe d’une épingle, on enleve en même temps tout ce qui vernit l’écaille, ou au moins la plus grande partie, parce qu’on arrache la membrane qui l’enveloppe. Cette matiere brillante ne se trouve pas seulement sur les écailles du poisson, il est encore brillant après avoir été écaillé, parce qu’immédiatement au-dessous de la peau que touchent les écailles, il y a aussi une membrane qui recouvre des lames argentées. La membrane qui enveloppe l’estomac & les intestins en est toute brillante. Cette matiere est molle & souple dans les intestins, & elle a toute sa consistance & sa perfection sur les écailles. Ces observations, & plusieurs autres, ont fait conjecturer que la matiere argentée se forme dans les intestins, qu’elle passe dans des vaisseaux pour arriver à la peau & aux écailles, & que les écailles sont composées de ces lames qui sont arrangées comme autant de petites briques, soit les unes contre les autres, soit les unes au-dessus des autres, ainsi qu’on peut le reconnoître à l’inspection de l’écaille. Si les écailles de l’Able se forment de cette façon, celles des autres poissons pourroient avoir aussi la même formation. M. de Réaumur, Mém. de l’Acad. Roy. des Sc. année 1716. V. Ecaille, Poisson. (I)
Ablette, poisson de riviere. Voyez Able. (I)
ABLERET, s. m. ou ABLERAT, sorte de filet quarré que l’on attache au bout d’une perche, & avec lequel on pêche de petits poissons nommés vulgairement Ables.
ABLOQUIÉ, s. m. terme de Coûtume, qui signifie la même chose que situé. C’est dans ce sens qu’il est pris dans la Coûtume d’Amiens, laquelle défend de démolir aucuns édifices abloquiés & solivés dans des héritages tenus en roture, sans le consentement du Seigneur. (H)
ABLUTION, s. f. Dans l’antiquité c’étoit une cérémonie religieuse usitée chez les Romains, comme une sorte de purification pour laver le corps avant que d’aller au sacrifice. Voyez Sacrifice.
Quelquefois ils lavoient leurs mains & leurs piés, quelquefois la tête, souvent tout le corps : c’est pourquoi à l’entrée des Temples il y avoit des vases de marbre remplis d’eau.
Il est probable qu’ils avoient pris cette coûtume des Juifs ; car nous lisons dans l’Ecriture, que Salomon plaça à l’entrée du Temple qu’il éleva au vrai Dieu, un grand vase que l’Écriture appelle la mer d’airain, où les Prêtres se lavoient avant que d’offrir le sacrifice, ayant auparavant sanctifié l’eau en y jettant les cendres de la victime immolée.
Le mot d’Ablution est particulierement usité dans l’Église Romaine pour un peu de vin & d’eau que les communians prenoient anciennement après l’hostie, pour aider à la consommer plus facilement.
Le même terme signifie aussi l’eau qui sert à laver les mains du Prêtre qui a consacré. (G)
Ablution, cérémonie qui consiste à se laver ou purifier le corps, ou quelque partie du corps, & fort usitée parmi les Mahométans, qui la regardent comme une condition essentiellement requise à la priere. Ils ont emprunté cette pratique des Juifs, & l’ont altérée comme beaucoup d’autres. Ils ont pour cet effet des fontaines dans les parvis de toutes les Mosquées.
Les Musulmans distinguent trois sortes d’Ablutions ; l’une qu’ils appellent Goul, & qui est une espece d’immersion ; l’autre, qu’ils nomment Wodou, & qui concerne particulierement les piés & les mains ; & la troisieme, appellée terreuse ou sabloneuse, parce qu’au lieu d’eau on y emploie du sable ou de la terre.
À l’égard de la premiere, trois conditions sont requises. Il faut avoir intention de se rendre agréable à Dieu, nettoyer le corps de toutes ses ordures, s’il s’y en trouve, & faire passer l’eau sur tout le poil & sur la peau. La Sonna exige encore pour cette Ablution qu’on récite d’abord la formule usitée, au nom du grand Dieu : louange à Dieu, Seigneur de la Foi Musulmane ; qu’on se lave la paume de la main avant que les cruches se vuident dans le lavoir ; qu’il se fasse une expiation avant la priere ; qu’on se frotte la peau avec la main pour en ôter toutes les saletés ; enfin que toutes ces choses soient continuées sans interruption jusqu’à la fin de la cérémonie.
Six raisons rendent cette purification nécessaire. Les premieres communes aux deux sexes, sont les embrassemens illicites & criminels par le desir seul, quoiqu’il n’ait été suivi d’aucune autre impureté : les suites involontaires d’un commerce impur, & la mort. Les trois dernieres sont particulieres aux femmes, telles que les pertes périodiques du sexe, les pertes de sang dans l’accouchement, & l’accouchement même. Les vrais Croyans font cette ablution au moins trois fois la semaine ; & à ces six cas, les Sectateurs d’Aly en ont ajoûté quarante autres ; comme lorsqu’on a tué un lésard, touché un cadavre, &c.
Dans la seconde espece d’ablution, il y a six choses à observer : qu’elle se fasse avec intention de plaire à Dieu ; qu’on s’y lave tout le visage, les mains & les bras jusqu’au coude inclusivement ; qu’on s’y frotte certaines parties de la tête ; qu’on s’y nettoye les pieds jusqu’aux talons, inclusivement ; qu’on y observe exactement l’ordre prescrit.
La Sonna contient dix préceptes sur le Wodou. Il faut qu’il soit précédé de la formule au nom du grand Dieu, &c. qu’on se lave la paume de la main avant que les cruches soient vuidées, qu’on se nettoye le visage, qu’on attire l’eau par les narines, qu’on se frotte toute la tête & les oreilles, qu’on sépare ou qu’on écarte la barbe pour la mieux nettoyer quand elle est épaisse & longue, ainsi que les doigts des piés, qu’on nettoye les oreilles l’une après l’autre, qu’on se lave la main droite avant la gauche ; qu’on observe le même ordre à l’égard des piés, qu’on répete ces actes de purification jusqu’à trois fois, & qu’on les continue sans interruption jusqu’à la fin.
Cinq choses rendent le Wodou nécessaire : 1°. l’issue de quelqu’excrément que ce soit (excepto semine) par les voies naturelles : 2°. lorsqu’on a dormi profondément, parce qu’il est à supposer que dans un profond sommeil on a contracté quelqu’impureté dont on ne se souvient pas : 3°. quand on a perdu la raison par quelqu’excès de vin, ou qu’on l’a eu véritablement aliénée par maladie ou quelqu’autre cause : 4°. lorsqu’on a touché une femme impure, sans qu’il y eût un voile ou quelqu’autre vêtement entre deux : 5°. lorsqu’on a porté la main sur les parties que la bienséance ne permet pas de nommer.
Quant à l’ablution terreuse ou sabloneuse, elle n’a lieu que quand on n’a point d’eau, ou qu’un malade ne peut souffrir l’eau sans tomber en danger de mort. Par le mot de sable, on entend toute sorte de terre, même les minéraux ; comme par l’eau, dans les deux autres ablutions, on entend celle de riviere, de mer, de fontaine, de neige, de grêle, &c. en un mot toute eau naturelle. Guer, Mœurs des Turcs, tom. I. Liv. II.
Au reste ces ablutions sont extrèmement fréquentes parmi les Mahométans : 1°. pour les raisons ci-dessus mentionnées ; & en second lieu, parce que la moindre chose, comme le cri d’un cochon, l’approche ou l’urine d’un chien, suffisent pour rendre l’ablution inutile, & mettre dans la nécessité de la réitérer : au moins est-ce ainsi qu’en usent les Musulmans scrupuleux. (G)
Ablution, Lotion. On appelle de ce nom plusieurs opérations qui se font chez les Apothicaires. La premiere est celle par laquelle on sépare d’un médicament en le lavant avec de l’eau, les matieres qui lui sont étrangeres : la seconde, est celle par laquelle on enleve à un corps les sels surabondans, en répandant de l’eau dessus à différentes reprises ; elle se nomme encore édulcoration : la troisieme est celle dont on se sert, quand pour augmenter les vertus & les propriétés d’un médicament, on verse dessus, ou du vin, ou quelque liqueur distillée qui lui communique sa vertu ou son odeur, par exemple, lorsqu’on lave les vers de terre avec le vin, &c.
Le mot d’Ablution ne convient qu’à la premiere de ces opérations, & ne peut servir tout au plus qu’à exprimer l’action de laver des plantes dans l’eau avant que de les employer : la seconde, est proprement l’édulcoration : la troisieme peut se rapporter à l’infusion. Voyez Édulcoration. Infusion. (N)
* ABNAKIS, s. m. Peuple de l’Amérique septentrionale, dans le Canada. Il occupe le 309. de long. & le 46. de lat.
* ABO, grande ville maritime de Suede, capitale des Duché & Province de Finlande méridionale. Lon. 41. lat. 61.
* ABOERA, s. ville d’Afrique, sur la côte d’or de Guinée.
ABOILAGE, s. m. vieux terme de Pratique, qui signifie un droit qu’a le Seigneur sur les abeilles qui se trouvent dans l’étendue de sa Seigneurie. Ce terme est dérivé du mot aboille, qu’on disoit anciennement pour abeille. (H).
ABOIS, s. m. pl. terme de chasse. Il marque l’extrémité où le cerf est réduit, lorsqu’excédé par une longue course il manque de force, & regarde derriere lui si les chiens sont toûjours à ses trousses, pour prendre du relâche ; on dit alors que le cerf tient les abois.
Derniers abois. Quand la bête tombe morte, ou outrée, on dit la bête tient les derniers abois.
ABOIT, s. Quelques-uns se servent de ce mot pour signifier la céruse. V. Abit, Céruse, Blanc de Plomb. (M.).
ABOKELLE. Voyez Abukelb. (G.).
ABOLITION, s. f. en général, est l’action par laquelle on détruit ou on anéantit une chose.
Ce mot est latin, & quelques-uns le font venir du Grec, ἀπολλύω ou ἀπόλλυμι, détruire ; mais d’autres le dérivent de ab & olere, comme qui diroit anéantir tellement une chose qu’elle ne laisse pas même d’odeur.
Ainsi abolir une loi, un réglement, une coûtume, c’est l’abroger, la révoquer, l’éteindre, de façon qu’elle n’ait plus lieu à l’avenir. V. Abrogation, Révocation, Extinction, &c.
Abolition, en terme de Chancellerie, est l’indulgence du Prince par laquelle il éteint entierement un crime, qui selon les regles ordinaires de la Justice, & suivant la rigueur des Ordonnances. étoit irrémissible ; en quoi abolition differe de grace ; cette derniere étant au contraire le pardon d’un crime qui de sa nature & par ses circonstances est digne de remission : aussi les Lettres d’abolition laissent-elles quelque note infamante ; ce que ne font point les Lettres de grace.
Les Lettres d’abolition s’obtiennent à la grande Chancellerie, & sont adressées, si elles sont obtenues par un Gentilhomme, à une Cour souveraine, sinon, à un Bailli ou Sénéchal. (H)
* ABOLLA, s. habit que les Philosophes affectoient de porter, que quelques-uns confondent avec l’exomide : cela supposé, c’étoit une tunique sans manches, qui laissoit voir le bras & les épaules ; c’est delà qu’elle prenoit son nom. C’étoit encore un habit de valets & de gens de service.
ABOMASUS, ABOMASUM, ou ABOMASIUM, s. m. dans l’Anatomie comparée, c’est un des estomacs ou ventricules des animaux qui ruminent. Voyez Ruminant. Voyez aussi Anatomie comparée.
On trouve quatre estomacs dans les animaux qui ruminent ; savoir, le rumen ou estomac proprement dit, le reticulum, l’omasus & l’abomasus. Voyez Rumination.
L’Abomasus, appellé vulgairement la caillette, est le dernier de ces quatre estomacs : c’est l’endroit où se forme le chyle, & d’où la nourriture descend immédiatement dans les intestins.
Il est garni de feuillets comme l’omasus : mais ses feuillets ont cela de particulier, qu’outre les tuniques dont ils sont composés, ils contiennent encore un grand nombre de glandes qui ne se trouvent dans aucun des feuillets de l’omasus. Voyez Omasus, &c.
C’est dans l’Abomasus des veaux & des agneaux que se trouve la presure dont on se sert pour faire cailler le lait. Voyez Presure. (L)
* ABOMINABLE, DÉTESTABLE, EXÉCRABLE, synonymes. L’idée primitive & positive de ces mots est une qualification de mauvais au suprème degré : aussi ne sont-ils susceptibles, ni d’augmentation, ni de comparaison, si ce n’est dans le seul cas où l’on veut donner au sujet qualifié le premier rang entre ceux à qui ce même genre de qualification pourroit convenir : ainsi l’on dit la plus abominable de toutes les débauches, mais on ne diroit gueres une débauche très-abominable, ni plus abominable qu’une autre : exprimant par eux-mêmes ce qu’il y a de plus fort, ils excluent toutes les modifications dont on peut accompagner la plûpart des autres épithetes. Voilà en quoi ils sont synonymes.
Leur différence consiste en ce qu’abominable paroît avoir un rapport plus particulier aux mœurs, détestable au goût, & exécrable à la conformation. Le premier marque une sale corruption ; le second, de la dépravation ; & le dernier, une extrème difformité.
Ceux qui passent d’une dévotion superstitieuse au libertinage, s’y plongent ordinairement dans ce qu’il y a de plus abominable. Tels mets sont aujourd’hui traités de détestables, qui faisoient chez nos peres l’honneur des meilleurs repas. Les richesses embellissent aux yeux d’un homme intéressé la plus exécrable de toutes les créatures.
ABOMINATION, s. f. Les Pasteurs de brebis étoient en abomination aux Égyptiens. Les Hébreux devoient immoler au Seigneur dans le desert les abominations des Egyptiens, c’est-à-dire, leurs animaux sacrés, les bœufs, les boucs, les agneaux & les beliers, dont les Egyptiens regardoient les sacrifices comme des abominations & des choses illicites. L’Ecriture donne d’ordinaire le nom d’abomination à l’Idolatrie& aux Idoles, tant à cause que le culte des Idoles en lui-même est une chose abominable, que parce que les cérémonies des idolatres étoient presque toûjours accompagnées de dissolutions & d’actions honteuses & abominables. Moyse donne aussi le nom d’abominable aux animaux dont il interdit l’usage aux Hébreux. Genes. xli. 34. Exod. viii. 26.
L’Abomination de désolation prédite par Daniel, c. ix. v. 27. marque, selon quelques Interpretes, l’Idole de Jupiter Olympien qu’Antiochus Epiphane fit placer dans le Temple de Jérusalem. La même abomination de désolation dont il est parlé en S. Marc, c. vi. v. 7. & en S. Math. c. xxiv. v. 15. qu’on vit à Jérusalem pendant le dernier siége de cette ville par les Romains, sous Tite, ce sont les Enseignes de l’armée Romaine, chargées de figures de leurs Dieux & de leurs Empereurs, qui furent placées dans le Temple après la prise de la Ville & du Temple. Calmet, Dictionn. de la Bible, tom. I. lett. A. pag. 21. (G)
ABONDANCE, s. f. Divinité des Payens que les anciens monumens nous représentent sous la figure d’une femme de bonne mine, couronnée de guirlandes de fleurs, versant d’une corne qu’elle tient de la main droite toutes sortes de fruits ; & répandant à terre de la main gauche des grains qui se détachent pêle-mêle d’un faisceau d’épis. On la voit avec deux cornes, au lieu d’une, dans une médaille de Trajan.
Abondance, Plénitude, Voyez Fécondité, Fertilité, &c. Les Étymologistes dérivent ce mot d’ab & unda, eau ou vague, parce que dans l’abondance les biens viennent en affluence, & pour ainsi dire comme des flots.
L’abondance portée à l’excès dégénere en un défaut qu’on nomme regorgement ou redondance. Voyez Redondance, Surabondance.
L’Auteur du Dictionnaire Œconomique donne différens secrets ou moyens pour produire l’abondance : par exemple, une abondante récolte de blé, de poires, de pommes, de pêches, &c. (G)
* Abondance, petite ville de Savoye, dans le Diocèse de Chablais.
ABONDANT, adj. nombre abondant, en Arithmétique, est un nombre dont les parties aliquotes prises ensemble forment un tout plus grand que le nombre ; ainsi 12 a pour parties aliquotes 1, 2, 3, 4, 6, dont la somme 16 est plus grande que 12. Le nombre abondant est opposé au nombre défectif qui est plus grand que la somme de ses parties aliquotes, comme 14, dont les parties aliquotes sont 1, 2, 7, & au nombre parfait qui est égal à la somme de ses parties aliquotes, comme 6, dont les parties aliquotes sont 1, 2, 3. Voyez Nombre & Aliquote. (O)
Abondant (d’) terme de Palais, qui signifie par surérogation ou par surabondance de droit ou de procédure. (H)
ABONNEMENT, s. m. est une convention faite à l’amiable, par laquelle un Seigneur à qui sont dûs des droits, ou un créancier de sommes non liquides, ou non encore actuellement dûes, se contente par indulgence, ou pour la sûreté de ses droits, d’une somme claire & liquide une fois payée, ou se relâche de façon quelconque de ses droits.
Ce terme a succédé à celui d’abournement, dérivé du mot borne, parce que l’abonnement est la facilité qu’a quelqu’un de borner, limiter ou restraindre ses prétentions. (H)
ABONNIR, v. a. terme de Potier de Terre. On dit abonnir le carreau, pour dire le sécher à demi, le mettre en état de rebattre. Voyez Rebattre.
ABORDAGE, s. m. On se sert de ce terme pour exprimer l’approche & le choc de vaisseaux ennemis qui se joignent & s’accrochent par des grapins & par des amares, pour s’enlever l’un l’autre. Voyez Grapin, Amares.
Aller à l’abordage, sauter à l’abordage, se dit de l’action ou de la manœuvre d’un vaisseau qui en joint un autre pour l’enlever, aussi bien que de celle des équipages qui sautent de leur bord à celui de l’ennemi.
Abordage se dit encore du choc de plusieurs vaisseaux que la force du vent ou l’ignorance du Timonier fait devirer les uns sur les autres, soit lorsqu’ils vont en compagnie, ou lorsqu’ils se trouvent au même mouillage.
On se sert aussi de ce terme pour le choc contre des rochers. Nous nous étions pourvûs de boute-hors pour nous défendre de l’abordage des rochers où nous appréhendions d’être emportés par l’impétuosité du courant. (Z)
ABORDER un vaisseau. Les gens de mer ne donnent point à ce terme la même signification que lui donnent les gens de riviere. Les premiers le tirent du mot bord, par lequel ils désignent une partie du navire ; & non de celui de bord, qui se prend pour le rivage. Ainsi aborder en Marine, c’est ou tomber sur un vaisseau, ou désigner l’action d’un bord qui tombe sur l’autre. De-là viennent les mots deborder, reborder, pour dire tomber une seconde fois, & se détacher des amares. Lorsque les Marins veulent marquer l’action de gagner le rivage, ils disent toucher mouches, rendre le bord, débarquer, prendre terre, relâcher.
On tâche d’aborder les vaisseaux ennemis par leur arriere vers les hanches pour jetter les grapins aux aubans, ou bien par l’avant & par le beaupré.
Il y eût un brulot qui nous aborda à la faveur du canon de l’Amiral. Voyez Brulot.
Aborder de bout au corps ou en belle, c’est mettre l’éperon dans le flanc d’un vaisseau. On dit aussi de deux vaisseaux qui s’approchent en droiture, qu’ils s’abordent de franc étable. Voyez étable.
Aborder en travers en dérivant. Couler un vaisseau à fond en l’abordant. Vaisseaux qui s’abordent, soit en chassant sur leurs ancres, soit à la voile.
« Si un vaisseau qui est à l’ancre dans un Port ou ailleurs, vient à chasser & en aborder un autre, & qu’en l’abordant il lui cause quelque dommage, les Intéressés le supporteront par moitié ».
« Si deux vaisseaux sans voiles viennent à s’aborder par hasard, le dommage qu’ils se causeront se payera par moitié : mais s’il y a de la faute d’un des Pilotes, ou qu’il ait abordé exprès, il payera seul le dommage ». Ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681. art. 10. & 11. tit. vij. L. 3. (Z)
Aborder, v. act. terme de Fauconnerie. Lorsque la perdrix poussée par l’oiseau gagne quelque buisson, on dit il faut aborder la remise sous le vent, afin que les chiens sentent mieux la perdrix dans le buisson.
ABORIGENES, nom que l’on donne quelquefois aux habitans primitifs d’un pays, ou à ceux qui en ont tiré leur origine, par opposition aux colonies ou nouveaux habitans qui y sont venus d’ailleurs. Voyez Colonie.
Le mot d’Aborigenes est fameux dans l’antiquité. Quoiqu’on le prenne à présent pour un nom appellatif, ç’a été cependant autrefois le nom propre d’un certain Peuple d’Italie ; & l’étymologie de ce nom est extrèmement disputée entre les Savans.
Ces Aborigenes sont la Nation la plus ancienne que l’on sache qui ait habité le Latium, ou ce qu’on appelle à présent la Campagne de Rome, Campagna di Roma.
En ce sens on distingué les Aborigenes des Janigenes, qui selon le faux Berose étoient établis dans le pays avant eux ; des Sicules que ces Aborigenes chasserent ; des Grecs, de qui ils tiroient leur origine ; des Latins, dont ils prirent le nom après leur union avec Enée & les Troyens ; & enfin des Ausoniens, des Volsques, des Ænotriens, & autres qui habitoient d’autres cantons du même pays.
On dispute fort pour savoir d’où vient le mot Aborigenes : s’il faut le prendre dans le sens que nous l’avons expliqué au commencement de cet article, ou s’il faut le faire venir par corruption d’aberrigenes, errans ; ou de ce qu’ils habitoient les montagnes, ou de quelqu’autre etymologie.
S. Jérôme dit qu’on les appella ainsi de ce qu’ils étoient absque origine, les premiers habitans du pays après le déluge. Denys d’Halicarnasse dit que ce nom signifie les fondateurs & les premiers peres de tous les habitans du pays.
D’autres croyent que la raison pour laquelle ils furent ainsi appellés, est qu’ils étoient Arcadiens d’origine, lesquels se disoient enfans de la Terre, & non issus d’aucun autre Peuple.
Aurelius Victor, & après lui Festus, font venir Aborigenes par corruption d’aberrigenes, comme qui diroit errans, vagabonds, & prétendent que le nom de Pelasgiens qu’on leur a aussi donné a la même origine, ce mot signifiant aussi errant.
Pausanias veut qu’ils ayent été ainsi appellés ἀπὸ ὄρεσι des montagnes qu’ils habitoient. Ce qui semble être confirmé par le sentiment de Virgile, qui parlant de Saturne, le Législateur de ce Peuple, s’exprime ainsi :
Is genus indocile, ac dispersum montibus altis
Composuit, legesque dedit.
Les Aborigenes étoient ou les anciens habitans du Pays qui y avoient été établis par Janus, à ce que quelques-uns prétendent, ou par Saturne, ou par Cham, ou quelqu’autre chef, peu de tems après la dispersion, ou même auparavant, selon le sentiment de quelques Auteurs ; ou bien c’étoit une colonie que quelqu’autre Nation y avoit envoyée, & qui ayant chassé les anciens Sicules s’établit en leur place. Or il y a beaucoup de partage entre les Auteurs touchant le nom de cette Nation primordiale : quelques-uns veulent que ç’ait été des Arcadiens qui vinrent en Italie en différens tems ; les premiers sous la conduite d’Ænotrus, fils de Lycaon, 450 ans avant la guerre de Troye, & d’autres sous là conduite d’Hercule. Quelques-autres font venir cette colonie de Lacédémoniens qui quitterent leur pays, rebutés par la sévérité du gouvernement de Lycurgue ; & ils prétendent que les uns & les autres unis ensemble avoient formé la Nation des Aborigenes. D’autres les font venir des Contrées barbares plûtôt que de la Grece, & les prétendent originaires de Scythie, d’autres des Gaules ; d’autres enfin disent que c’étoit les Cananéens que Josué avoit chassés de leur Pays. (G)
ABORTIF, adj. avorté, qui est venu avant terme, ou qui n’a point acquis la perfection, la maturité. Fruit abortif. Voyez Avortement ou Accouchement. (L)
Abortif, adject. pris subst. est un enfant né avant terme. Dans le Droit civil un abortif, aussi bien qu’un posthume venu à terme, rompt le testament par sa naissance. L. Uxoris, cap. de post hæred. Instit. (H)
* ABOUCOUCHOU, s. m. sorte de drap de laine qui se fabrique en Languedoc, en Provence, en Dauphiné, & qui s’envoie au Levant par Marseille.
ABOUEMENT, s. m. synonyme à arasement ; ils se disent l’un & l’autre des joints des traverses avec les montants, & même des joints de tout autre assemblage ; lorsque ces joints sont affleurés ou affleurent (car affleurer chez les Artistes est actif, passif & neutre) & qu’une des pieces n’excede point l’autre ; ensorte que si l’on passoit l’ongle sur leur union, il ne seroit point arrêté. L’abouement de ces joints est imperceptible. Voilà un abouement bien grossierement fait.
* ABOUGRI, adj. bois de mauvaise venue dont le tronc est tortueux, court & noueux. Voyez Rabougri.
ABOUQUEMENT, s. m. dans les Ordonnances en matiere de salines, signifie l’entassement de nouveau sel sur un meulon ou monceau de vieux sel, qu’elles défendent expressément, si ce n’est en présence des Officiers Royaux. (H)
ABOUT, s. m. se dit d’un bout de planche qu’on joint au bout d’un bordage, ou à l’extrémité d’une autre planche qui se trouve courte. Cet ébranlement fit larguer à notre bâtiment un about de dessous la premiere ceinte. Voyez Ceinte. (Z)
About, c’est en général l’extrémité de toute sorte de pieces de charpente, coupée à l’équerre, façonnée en talud, & en un mot, mise en œuvre de quelque maniere que ce soit. On dit l’about des liens, l’about des tournices, l’about des guettes, des éperons, des tenons.
ABOUTÉ, adj. terme de Blason, se dit de quatre hermines, dont les bouts se répondent & se joignent en croix.
Hurleston en Angleterre, d’argent à quatre queües d’hermines en croix, & aboutées en cœur.
ABOUTIGE, ABUTICH, ABOUHEBE, lieu de la haute Égypte proche le Nil. Long. 26. lat. 50.
ABOUTIR, v. a. V. Suppurer, Suppuration.
Aboutir, en Hydraulique, c’est raccorder un gros tuyau sur un petit : s’il est de fer, de grès, ou de bois, ce sera par le moyen d’un colet de plomb qui viendra en diminuant du gros au petit. Quand le tuyau est de plomb, l’opération est encore plus aisée : mais quand il s’agit de raccorder une conduite de six pouces sur une de trois, il faut un tambour de plomb fait en cone, en prenant une table de plomb dont on forme un tuyau que l’on soûde par-dessus. (K)
Aboutir, se dit des arbres fruitiers lorsqu’ils sont boutonnés. L’on entend alors que la seve s’est portée jusqu’au bout des branches. (K)
Aboutir, c’est revêtir des tables minces de plomb ; ce qui se pratique aux corniches, quelquefois aux cimaises, & autres saillies, soit d’Architecture, soit de Sculpture.
ABOUTISSANT, adj. qui touche, qui confine par un bout ; ainsi l’on dit : telle terre est aboutissante d’un bout au grand chemin, de l’autre au pré appellé N.
Aboutissans, s. m. pl. ne se dit jamais seul, mais se joint toûjours avec le mot tenant, de cette maniere tenans & aboutissans. Voyez Tenans.
Une déclaration d’héritage par tenans & aboutissans, est celle qui en désigne les bornes & les limites de tous les côtés ; telle doit être la description portée en une saisie-réelle de biens roturiers.
Les tenans & aboutissans sont autrement appellés bouts & joûtes. Voyez Bouts & Joûtes. (H)
* ABOY, s. petite Ville d’Irlande dans la Province de Linster.
* ABOYEURS, s. m. pl. c’est ainsi qu’on nomme des chiens qui annoncent la présence & le départ du sanglier, ou d’une autre bête chassée, qui ne manquent jamais de donner à sa vûë, & d’avertir le Chasseur.
ABRA, s. m. ce terme est générique, pour signifier une fille d’honneur, une demoiselle suivante, la servante d’une femme de condition. L’Ecriture donne ce nom aux filles de la suite de Rebecca, à celles de la fille de Pharaon, Roi d’Egypte ; à celles de la Reine Esther, & enfin à la servante de Judith. On dit qu’abra signifie proprement une coëffeuse, une fille d’atours. Gen. XXIV. 16. Ex. II. 5. Esther IV. 15. Judith VIII. 32. Eutych. Alex. Arab. Lat. p. 304. (G)
Abra, s. m. monnoie d’argent de Pologne, qui vaut trois sols six deniers de France.
Cette monnoie a cours en quelques Provinces d’Allemagne, à Constantinople où elle est reçûe pour le quart d’un asselain ; à Astracan, à Smyrne, au Caire ; elle est évaluée sur le pied du Daller d’Hollande. Voyez Daller. (G)
* ABRACADABRA, parole magique qui étant répétée dans une certaine forme, & un certain nombre de fois, est supposée avoir la vertu d’un charme pour guérir les fievres, & pour prevenir d’autres maladies. Voyez Charme & Amulete.
D’autres écrivent ce mot abrasadabra ; car on le trouve ainsi figuré en caracteres grecs ΑΒΡΑϹΑΔΑΒΡΑ où le Ϲ est l’ancien Σ qui vaut S. Voici la maniere dont doit être écrit ce mot mystérieux pour produire la prétendue vertu qu’on lui attribue.
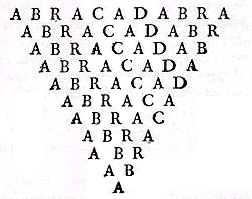
Serenus Simonicus, ancien Medecin, Sectateur de l’hérétique Basilide qui vivoit dans le deuxieme siecle, a composé un Livre des Préceptes de la Medecine en vers hexametres, sous le titre De Medicinâ parvo pretio parabili, où il marque ainsi la disposition & l’usage de ces caracteres :
Inscribes chartæ quod dicitur abracadabra
Sæpius & subter repetes, sed detrahe summam,
Et magis atque magis desint elementa figuris,
Singulæ quæ semper rapies & cætera figes,
Donec in augustum redigatur littera conum ;
His lino nexis collum redimire memento :
Talia languentis conducent vincula collo,
Lethalesque abigent (miranda potentia) morbos.
Wendelin, Scaliger, Saumaise, & le P. Kircher, se sont donné beaucoup de peine pour découvrir le sens de ce mot, Delris en parle, mais en passant, comme d’une formule connue en magie, & qu’au reste il n’entreprend point d’expliquer. Ce que l’on peut dire de plus vraissemblable, c’est que Serenus qui suivoit les superstitions magiques de Basilide, forma le mot d’abracadabra sur celui d’abrasac ou abrasax, & s’en servit comme d’un préservatif ou d’un remede infaillible contre les fievres. Voyez Abrasax.
Quant aux vertus attribuées à cet amulete, le siecle où nous vivons est trop éclairé pour qu’il soit nécessaire d’avertir que tout cela est une chimere. (G)
* ABRACALAN, terme cabalistique auquel les Juifs attribuent les mêmes propriétés qu’à l’abracadabra. Ces deux mots sont, outre des amuletes, des noms que les Syriens donnoient à une de leurs Idoles.
ABRAHAMIEN ou ABRAHAMITE, s. m. (Théol.) Voyez Paulianistes. (G)
ABRAHAMITES, s. m. Moines Catholiques qui souffrirent le Martyre pour le culte des Images sous Théophile, au neuvieme siecle.
* ABRAMBOÉ, ABRAMBAN, Ville & Pays sur la côte d’Or d’Afrique & la riviere de Volte. Long. 18. lat. 7.
ABRASION, s. f. signifie en Medecine l’irritation que produisent sur la membrane interne de l’estomac & des intestins les médicamens violens, comme les purgatifs auxquels on a donné le nom de drastique. Voyez Drastique.
La violence avec laquelle ces remedes agissent sur le veloûté de l’estomac & du canal intestinal, produit des effets si fâcheux, que la vie des malades est en danger, lorsque l’on n’y remédie pas promptement par des remedes adoucissans & capables d’émousser ou embarrasser les pointes de ces especes de médicamens. (N)
ABRAXAS ou ABRASAX, terme mystique de l’ancienne Philosophie & de la Théologie de quelques hérétiques, en particulier des Basilidiens. Quelques Modernes ont cru sur la foi de Tertullien & de Saint Jérôme, que Basilide appelloit le Dieu Suprème ou le Dieu Tout-puissant du nom d’abraxas, marquant, ajoûtent-ils, par ce mot les trois cens soixante & cinq Processions divines qu’il inventoit ; car selon la valeur numérale des lettres de ce nom, Α vaut 1. ϐ 2. ρ 100. α 1. σ 200. α 1. ξ 60. ce qui fait en tout 365. Mais outre que Saint Jérôme dit ailleurs qu’abraxas étoit peut-être le nom de Mithra ou du Soleil, qui étoit le Dieu des Perses, & qui dans sa révolution annuelle fournit le nombre de 365 jours, le sentiment de ces Peres est détruit par celui de Saint Irénée, qui assûre, 1°. que les Basilidiens ne donnoient point de nom au Dieu Suprème. Le Pere de toutes choses, disoient-ils, est ineffable & sans nom : ils ne l’appelloient donc pas abraxas ; 2°. que ce nom faisant le nombre de 365, les Basilidiens appelloient de la sorte le premier de leurs ccclxv. Cieux, ou le Prince & le premier des ccclxv. Anges qui y résidoient. Tertull. de Præscript. hæret. cap. 46. Saint Jérôme in amor. Tom. VI. pag. 100. Beausobr. Hist. du Manich. Tom. II. pag. 52.
Ce mot énigmatique a fort exercé les Savans : mais comme les Anciens n’en ont donné aucune explication satisfaisante, nous en rapporterons différentes imaginées par les Modernes ; le Lecteur jugera de leur solidité.
Godfrid Wendelin, homme fort versé dans l’Antiquité ecclésiastique, a proposé son opinion sur cette matiere dans une Lettre écrite à Jean Chiflet au mois de Septembre 1615. Il y prétend qu’abrasax est composé des lettres initiales de plusieurs mots ; que chaque lettre exprime un mot ; les quatre premieres, quatre mots Hébreux ; les trois dernieres, trois mots Grecs, de la maniere suivante :
| A | signifie | ab, le pere. |
| B | Ben, le fils. | |
| R | Rouach, l’esprit. | |
| A | Acadosch, le Saint. | |
| S | Soteria, le salut. | |
| A | Apo, par. | |
| X | Xulou, le bois. |
Voilà abrasax bien orthodoxe & bien honoré, puisqu’on y trouve distinctement exprimées les trois Personnes divines, & le salut acquis par la croix du Rédempteur. Il est aisé de réfuter cette idée de Wendelin par deux raisons : la premiere, qu’il n’est pas naturel de former un même mot de quatre mots Hébreux & de trois mots grecs. Cette objection n’est pas à la vérité suffisante. Il y a d’autres exemples de ces mots bâtards ; d’ailleurs les Basilidiens auroient pû désigner par-là l’union des deux Peuples des Hébreux & des Grecs dans la même Eglise & dans la même Foi. La seconde raison paroît plus forte. On dit que ces Hérétiques croyant que Simon le Cyrénéen fut crucifié à la place de Jesus-Christ, & sur cette rêverie, refusant de croire en celui qui a été crucifié, ils ne pouvoient dire que le salut a été acquis par la croix. Le rafinement & la subtilité qui regnent dans cette opinion de Wendelin, contribuent à la détruire.
Le P. Hardouin a profité de la conjecture précédente. Il veut que les trois premieres lettres du mot abrasax désignent le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit ; mais il croit que ces quatre dernieres A. S. A. X. signifient ἄνθροπους σόζων ἀγιῶ ξυλῶ, mots Grecs qui veulent dire sauvant les hommes par le saint bois. En suivant la même méthode, on a donné un sens fort pieux au mot abracadabra, dont on a fait un remede contre la fievre. On y a trouvé, le Pere, le Fils, le Saint-Esprit, sauvant les hommes par le saint arbre. Le Pere, le Fils, le Saint-Esprit, le Seigneur est unique. Voyez Abracadabra.
M. Basnage dans son Histoire des Juifs, tome III. part. 2. pag. 700. a proposé une autre hypothèse ; « Abraxas, dit-il, tire son origine des Égyptiens, puisque l’on voit un grand nombre d’amuletes sur lesquels est un Harpocrate assis sur son lotus, & le fouet à la main avec le mot d’abrasax ». Jusques-là cette conjecture de M. Basnage est non-seulement vraissemblable ; elle est vraie & évidemment prouvée par le mot abracadabra, qui est formé sur celui d’abrasax, & qui répeté plusieurs fois, & écrit sur du parchemin en forme de Pyramide renversée, passoit pour un remede contre la fievre. La preuve que cette superstition venoit des Payens, c’est que le Poëte Serenus qui fut Précepteur du jeune Gordien, & qui est le plus ancien Auteur qui nous ait parlé de ce prétendu remede, ne peut avoir fait profession du Christianisme : mais ce qui confirme encore plus solidement le sentiment de M. Basnage, c’est le mot ΑΒΡΑСΑΣ en grec qu’on lit fort distinctement sur l’un des deux Talismans qui ont été trouvés dans le xvii. siecle, & dont le Cardinal Baronius nous a donné la figure dans le II. tome de ses Annales, sous l’année de Jesus-Christ 120. l’autre est dans le Cabinet de Sainte Génevieve, en voici l’Inscription : ΑΒΡΑϹΑΞ. ΑΔΩΝΑΙ. ΔΑΙΜΟΝΩΝ. ΔΕΞΙΑΙ. ΔΥΝΑΜΕΙϹ. ΦΥΛΑΞΑΤΕ. ΟΥΛΒΙΑΝ. ΠΑΥΛΕΙΝΑΝ. ΑΠΟ. ΠΑΝΤΟϹ. ΚΑΚΟΙ. ΔΑΙΜΟΝΟϹ ; c’est-à-dire Abraxas Adonar, ou Seigneur des démons, bonnes Puissances, préservez Ulpie Pauline de tout méchant démon ; formule qui ressent fort le Paganisme. Mais ce qu’ajoûte M. Basnage n’est pas aussi juste : « Abraxas, continue-t-il, est un mot barbare qui ne signifie rien, & dans lequel il ne faut chercher que des nombres. Les Basilidiens s’en servoient pour exprimer le Dieu Souverain qui a créé trois cens soixante-cinq Cieux, & partagé le cours du Soleil en trois cens soixante-cinq jours ». On a vû ci-dessus qu’abraxas n’est point le nom que les Basilidiens donnoient au Dieu Suprème ; & nous allons montrer que ce terme n’est pas un mot barbare, & qui ne signifie rien.
Les recherches de M. de Beausobre nous en fourniront la preuve. « Je crois, dit ce Savant, qu’abraxas ou abrasax est composé de deux mots Grecs. Le premier est ἀϐρὸς qui a diverses significations ; mais entr’autres celle de beau, de magnifique. C’est une épithete ou un attribut du Dieu appellé Jao, comme on le voit dans cet Oracle d’Apollon de Claros rapporté par Macrobe. Saturnal, lib. 1. 17.
Ἠέλιος δὲ ἴερειν, μεταπῶρα δ’ἄϐρον Ἰαό.
« C’est-à-dire, Pluton préside sur l’hyver, Jupiter sur le printems, le Soleil sur l’été, & le beau Jao sur l’automne. On traduit ordinairement mollis Iao, ce qui ne veut pas dire une Divinité molle & foible, mais une Divinité qui fournit aux hommes toutes les délices de la vie, & qui préside sur l’automne, saison des vins & des fruits… Ἀϐρὸς signifie aussi beau, majestueux, superbe, de là vient l’ἀϐραϐαινεῖν d’Euripide, pour dire une démarche superbe, majestueuse.... Dans les vers que je viens d’alléguer Iao est Bacchus : mais Bacchus est le Soleil, comme Macrobe l’a fait voir.... Quoi qu’il en soit, ἀϐρὸς est une épithete du Soleil. Le second mot Grec dont abrasax est composé, est ou celui de Sao, ΣΑΩ, qui est souvent employé dans Homere, & qui veut dire sauver ou guérir, ou celui de Sa, ΣΑ, qui signifie salut, santé. Ainsi abrasax voudroit dire à la lettre le beau, le magnifique Sauveur, celui qui guérit les maux, & qui en préserve ». Hist. du Manichéis. tome II. pag. 55.
M. de Beausobre détaille ensuite fort au long les preuves qui établissent qu’abrasax ou ce magnifique Sauveur n’est autre que le Soleil. C’est pourquoi nous renvoyons les Lecteurs à l’ouvrage de cet Auteur. Cet article est en grande partie tiré des Mémoires de M. Formey, Historiographe de l’Académie royale de Prusse. (G)
ABREGÉ, s. m. épitome, sommaire, précis, raccourci. Un abregé est un discours dans lequel on réduit en moins de paroles, la substance de ce qui est dit ailleurs plus au long & plus en détail.
« Les Critiques, dit M. Baillet, & généralement tous les Studieux qui sont ordinairement les plus grands ennemis des abregés, prétendent que la coûtume de les faire ne s’est introduite que long-tems après ces siecles heureux où fleurissoient les Belles-Lettres & les Sciences parmi les Grecs & les Romains. C’est à leur avis un des premiers fruits de l’ignorance & de la fainéantise, où la barbarie a fait tomber les siecles qui ont suivi la décadence de l’Empire. Les Gens de Lettres & les Savans de ces siecles, disent-ils, ne cherchoient plus qu’à abreger leurs peines & leurs études, sur-tout dans la lecture des Historiens, des Philosophes, & des Jurisconsultes, soit que ce fût le loisir, soit que ce fût le courage qui leur manquât ».
Les abregés peuvent, selon le même Auteur, se réduire à six especes differentes ; 1°, les épitomes où l’on a réduit les Auteurs en gardant régulierement leurs propres termes & les expressions de leurs originaux, mais en tâchant de renfermer tout leur sens en peu de mots ; 2°. les abrégés proprement dits, que les Abréviateurs ont faits à leur mode, & dans le style qui leur étoit particulier ; 3°. les centons ou rhapsodies, qui sont des compilations de divers morceaux ; 4°. les lieux communs ou classes sous lesquelles on a rangé les matieres relatives à un même titre ; 5°. les Recueils faits par certains Lecteurs pour leur utilité particuliere, & accompagnés de remarques ; 6°. les extraits qui ne contiennent que des lambeaux transcrits tout entiers dans les Auteurs originaux, la plûpart du tems sans suite & sans liaison les uns avec les autres.
« Toutes ces manieres d’abreger les Auteurs, continue-t-il, pouvoient avoir quelque utilité pour ceux qui avoient pris la peine de les faire, & peut-être n’étoient-elles point entierement inutiles à ceux qui avoient lû les originaux. Mais ce petit avantage n’a rien de comparable à la perte que la plûpart de ces abregés ont causée à leurs Auteurs, & n’a point dédommagé la République des Lettres ».
En effet, en quel genre ces abregés n’ont-ils pas fait disparoître une infinité d’originaux ? Des Auteurs ont crû que quelques-uns des Livres saints de l’ancien Testament n’étoient que des abregés des Livres de Gad, d’Iddo, de Nathan, des Mémoires de Salomon, de la Chronique des Rois de Juda, &c. Les Jurisconsultes se plaignent qu’on a perdu par cet artifice plus de deux mille volumes des premiers Ecrivains dans leur genre, tels que Papinien, les trois Scevoles, Labéon, Ulpien, Modestin, & plusieurs autres dont les noms sont connus. On a laissé périr de même un grand nombre des ouvrages des Peres Grecs depuis Origene ou S. Irenée, même jusqu’au schisme, tems auquel on a vû toutes ces chaînes d’Auteurs anonymes sur divers Livres de l’Ecriture. Les extraits que Constantin Porphyrogenete fit faire des excellens Historiens Grecs & Latins sur l’histoire, la Politique, la Morale, quoique d’ailleurs très-loüables, ont occasionné la perte de l’Histoire Universelle de Nicolas de Damas, d’une bonne partie des Livres de Polybe, de Diodore de Sicile, de Denys d’Halicarnasse, &c. On ne doute plus que Justin ne nous ait fait perdre le Trogue Pompée entier par l’abrege qu’il en a fait, & ainsi dans presque tous les autres genres de littérature.
Il faut pourtant dire en faveur des abregés, qu’ils sont commodes pour certaines personnes qui n’ont ni le loisir de consulter les originaux, ni les facilités de se les procurer, ni le talent de les approfondir, ou d’y démêler ce qu’un compilateur habile & exact leur présente tout digéré. D’ailleurs, comme l’a remarqué Saumaise, les plus excellens ouvrages des Grecs & des Romains auroient infailliblement & entierement péri dans les siecles de barbarie, sans l’industrie de ces Faiseurs d’abregés qui nous ont au moins sauvé quelques planches du naufrage : ils n’empêchent point qu’on ne consulte les originaux quand ils existent. Baillet, Jugem. des Sçavans, tom. I. pag. 240. &. suiv. (G)
Ils sont utiles : 1°. à ceux qui ont déjà vû les choses au long.
2°. Quand ils sont faits de façon qu’ils donnent la connoissance entiere de la chose dont ils parlent, & qu’ils sont ce qu’est un portrait en mignature par rapport à un portrait en grand. On peut donner une idée générale d’une grande Histoire, ou de quelqu’autre matiere ; mais on ne doit point entamer un détail qu’on ne peut pas éclaircir, & dont on ne donne qu’une idée confuse qui n’apprend rien, & qui ne réveille aucune idée déja acquise. Je vais éclaircir ma pensée par ces exemples : Si je dis que Rome fut d’abord gouvernée par des Rois, dont l’autorité duroit autant que leur vie, ensuite par deux Consuls annuels ; que cet usage fut interrompu pendant quelques années ; que l’on élut des Décemvirs qui avoient la suprème autorité, mais qu’on reprit bien-tôt l’ancien usage d’élire des Consuls : qu’enfin Jules César, & après lui, Auguste, s’emparerent de la souveraine autorité ; qu’eux & leurs successeurs furent nommés Empereurs : il me semble que cette idée générale s’entend en ce qu’elle est en elle-même : mais nous avons des abregés qui ne nous donnent qu’une idée confuse qui ne laisse rien de précis. Un célebre Abréviateur s’est contenté de dire que Joseph fut vendu par ses freres, calomnié par la femme de Putiphar, & devint le Surintendant de l’Égypte. En parlant des Décemvirs, il dit qu’ils furent chassés à cause de la lubricité d’Appius ; ce qui ne laisse dans l’esprit rien qui le fixe & qui l’éclaire. On n’entend ce que l’Abréviateur a voulu dire, que lorsque l’on sait en détail l’Histoire de Joseph & celle d’Appius. Je ne fais cette remarque que parce qu’on met ordinairement entre les mains des jeunes gens des abregés dont ils ne tirent aucun fruit, & qui ne servent qu’à leur inspirer du dégoût. Leur curiosité n’est excitée que d’une maniere qui ne leur fait pas venir le desir de la satisfaire. Les jeunes gens n’ayant point encore assez d’idées acquises, ont besoin de détail ; & tout ce qui suppose des idées acquises, ne sert qu’à les étonner, à les décourager, & à les rebuter.
En abregé, façon de parler adverbiale, summatim. Les jeunes gens devroient recueillir en abregé ce qu’ils observent dans les Livres, & ce que leurs Maîtres leur apprennent de plus utile & de plus intéressant. (F)
Abregé ou Abréviation, lorsqu’on veut écrire avec diligence, ou pour diminuer le volume, ou en certains mots faciles à deviner, on n’écrit pas tout au long. Ainsi au lieu d’écrire Monsieur & Madame, on écrit Mr ou Me par abréviation ou par abrégé. Ainsi les abréviations sont des lettres, notes, caracteres, qui indiquent les autres lettres qu’il faut suppléer. D. O. M. c’est-à-dire, Deo optimo, maximo. A. R. S. H. Anno reparatæ salutis humanæ. Au commencement des Epîtres latines, on trouve souvent S. P. D. c’est-à-dire, Salutem plurimam dicit. Aux Inscriptions, D. V. C. c’est-à-dire, Dicat, vovet, consecrat. Sertorius Ursatus a fait une collection des explications De Notis Romanorum. (F)
ABREGÉ, s. m. partie de l’Orgue. C’est un assemblage de plusieurs rouleaux par le moyen desquels on répand & l’on transmet l’action des touches du clavier dans une plus grande étendue. Voyez la Figure 20. Planches d’Orgue.
Si les sommiers n’avoient pas plus d’étendue que le clavier, il suffiroit alors de mettre des targettes qui seroient attachées par leur extrémité inférieure aux demoiselles du clavier, & par leur extrémité supérieure aux anneaux des boursettes. Il est sensible qu’en baissant une touche du clavier, on tireroit sa targette qui feroit suivre la boursette, l’esse & la soupape correspondante. Mais comme les soupapes ne peuvent pas être aussi près les unes des autres que les touches du clavier dont 13, nombre de touches d’une octave y compris les feintes, ne font qu’un demi-pié, puisqu’il y a tel tuyau dans l’Orgue, qui porte le double ; il a donc fallu nécessairement les écarter les unes des autres : mais en les éloignant les unes des autres, elles ne se trouvent plus vis-à-vis des touches correspondantes du clavier, d’où cependant il faut leur transmettre l’action. Il faut remarquer que l’action des touches du clavier se transmet par le moyen des targettes posées verticalement, & ainsi que cette action est dans une ligne verticale. Pour remplir cette indication, on fait des rouleaux B C, Fig. 21. qui sont de bois & à huit pans d’un pouce ou environ de diametre : aux deux extrémités de ces rouleaux que l’on fait d’une longueur convenable, ainsi qu’il va être expliqué on met deux pointes de fil de fer d’une ligne ou une demi-ligne de diametre pour servir de pivots. Ces pointes entrent dans les trous des billots. AA. Voyez Billots. Soit maintenant la ligne ED, la targette qui monte d’une touche de clavier au rouleau, & la ligne GF celle qui descend de la soupape au même rouleau. La distance FD entre les perpendiculaires qui passent par une soupape, & la touche qui doit la faire mouvoir s’appellera l’expansion du clavier. Les rouleaux doivent être de trois ou quatre pouces plus longs que cette étendue. Ces trois ou quatre pouces doivent être repartis également aux deux côtés de l’espace IK qui est l’espace égal & correspondant du rouleau. A l’espace FD, aux points I & K, on perce des trous qui doivent traverser les mêmes faces. Ces trous servent à mettre des pattes IF, KD de gros fil de fer. Ces pattes sont appointées par l’extrémité qui entre dans le rouleau, & rivées après l’avoir traversé ; l’autre extrémité de la pate est applatie dans le sens vertical, & percée d’un trou qui sert à recevoir le leton des targettes. Les pattes ont trois ou quatre pouces de longueur hors du rouleau, & sont dans le même plan horisontal. On conçoit maintenant que si l’on tire la targette ED attachée à une touche, en appuyant le doigt sur cette touche, l’extrémité D de la patte DK doit baisser. Mais comme la patte est fixée dans le rouleau au point K, elle ne sauroit baisser par son extrémité D sans faire tourner le rouleau sur lui-même d’une égale quantité. Le rouleau en tournant fait suivre la patte IF dont l’extrémité F décrit un arc de cercle égal à celui que décrit l’extrémité D de l’autre patte, & tire la targette FG à laquelle le mouvement de la targette E a ainsi été transmis. Cette targette FG est attachée à la boursette par le moyen du leton H. Voyez Boursette, Sommier.
Un abregé est un composé d’autant de rouleaux semblables à celui que l’on vient de décrire, qu’il y a de touches au clavier ou de soupapes dans les sommiers. Tous les rouleaux qui composent un abregé sont rangés sur une table ou planche EFGH, Fig. 20, dans laquelle les queues des billots entrent & sont collées. Une de leurs pattes répond directement au-dessus d’une touche du clavier LM, à laquelle elle communique par le moyen de la targette ab. L’autre patte communique par le moyen d’une targette cd à une soupape des sommiers SS, TT qui s’ouvre, lorsque l’on tire la targette du clavier en appuyant le doigt sur la touche à laquelle elle est attachée, ce qui fait tourner le rouleau & tirer la targette du sommier. On appelle targette du clavier celle qui va du clavier à l’abregé, & targette du sommier celle qui va de l’abregé au sommier. Les unes & les autres doivent se trouver dans un même plan vertical dans lequel se doivent aussi trouver les demoiselles du clavier & les boursettes des sommiers. Par cette ingénieuse construction, l’étendue des sommiers qui est quelquefois de 15 ou 20 piés, se trouve rapprochée ou réduite à l’étendue du clavier qui n’est que de deux piés pour quatre octaves. C’est ce qui lui a fait donner le nom d’abregé, comme étant les sommiers réduits ou abregés.
Dans les grandes Orgues qui ont deux sommiers placés à côté l’un de l’autre en cette sorte A▭C▭B, les tuyaux des basses & des dessus sont repartis sur tous les deux ; ensorte que les plus grands soient vers les extrémités extérieures A-B, & les plus petits vers C ; les tuyaux sur chaque sommier se suivent par tons, en cette sorte :

La disposition des rouleaux pour faire cette repartition est représentée dans la Figure.
ABREGER un Fief, terme de Jurisprudence féodale, synonyme à démembrer ; mais qui se dit singulierement, lorsque le Seigneur permet à des Gens de main-morte de posséder des héritages qui en relevent. (H)
ABRÉVIATEUR, adjectif pris substantivement. C’est l’auteur d’un abregé. Justin abréviateur de Trogue Pompée nous a fait perdre l’Ouvrage de ce dernier. On reproche aux abréviateurs des Transactions Philosophiques, d’avoir fait un choix plûtôt qu’un abregé, parce qu’ils ont passé plusieurs mémoires, par la seule raison que ces mémoires n’étoient pas de leur goût. (F)
Abréviateur, s. m. terme de Chancellerie Romaine. C’est le nom d’un Officier dont la fonction est de rédiger la minute des Bulles & des signatures. On l’appelle Abréviateur, parce que ces minutes sont farcies d’abréviations.
Il y en a de deux classes : les uns qu’on appelle de parco majori (du grand banc), à qui le Régent de la Chancellerie distribue les suppliques, & qui font dresser la minute des Bulles par des Substituts qu’ils ont sous eux ; & ceux qu’on appelle de parco minori (du second banc), dont la fonction est de dresser les dispenses de mariage. (G)
ABRÉVIATION, s. f. contraction d’un mot ou d’un passage qui se fait en retranchant quelques lettres ou en substituant à leur place des marques ou des caracteres. Voyez Symbole & Apocope.
Ce mot est dérivé du latin brevis qui vient du grec βραχὺς, bref.
Les Jurisconsultes, les Medecins &c. se servent fréquemment d’abréviations, tant pour écrire avec plus de diligence, que pour donner à leurs écrits un air mystérieux.
Les Rabbins sont ceux qui emploient le plus d’abréviations. On ne sauroit lire leurs écrits qu’on n’ait une explication des abréviations Hébraïques. Les Écrivains Juifs & les Copistes ne se contentent pas de faire des abréviations comme les Grecs & les Latins, en retranchant quelques lettres ou syllabes dans un mot ; souvent ils n’en mettent que la premiere lettre. Ainsi ר signifie Rabbi, & א signifie אכ, אדרבי, ou אמד, &c. selon l’endroit où il se trouve.
Ils prennent souvent les premieres lettres de plusieurs mots de suite, & en y ajoutant des voyelles, ils font un mot barbare qui représente tous les mots dont il est l’abregé. Ainsi Rabbi Schelemoh Jarchi en jargon d’abréviations Hébraïques s’appelle Rasi : & Rabbi Moses ben Maïemon Rambam. De même, מכיא est mis pour מתך כסתר יכפה אך, donum in abdito evertit iram. Mercerus, David de Pomis, Schindler, Buxtorf & d’autres ont donné des explications de ces sortes d’abréviations. La plus ample collection des abréviations Romaines est celle de Sertorius Ursatus, qui est à la fin des Marbres d’Oxford. Sertorii Ursati, Equitis, de notis Romanorum, commentarius.
Dans l’antiquité on appelloit les abréviations notes. On les nomme encore de même dans les anciennes inscriptions latines. (G)
Abréviations. Ce sont des lettres initiales ou des caracteres dont se servent les Marchands, Négocians, Banquiers & Teneurs de Livres pour abréger certains termes de négoce & rendre les écritures plus courtes. Voici les principales avec leur explication.
Les Négocians & Banquiers Hollandois ont aussi leur abréviations particulieres. Comme toutes les Marchandises qui se vendent en Hollande, & particulierement à Amsterdam, s’y vendent par livres de gros, par rixdale, par florins d’or, par florins, par sous de gros, par sous communs & par deniers de gros, pour abreger toutes ces monnoies de compte, on se sert des caracteres suivans.
ABREUVER un vaisseau, c’est y jetter de l’eau, après qu’il est achevé de construire, & l’en remplir entre le francbord & le serrage pour éprouver s’il est bien étanché, & s’il n’y a pas de voie d’eau. (Z)
Abreuver, est aussi le même qu’arroser ; on le dit particulierement des prés où l’on fait d’abord venir l’eau d’une riviere, d’une source, ou d’un ruisseau dans une grande rigole ou canal situé à la partie supérieure des terres, & divisé ensuite par les ramifications de petits canaux dans toute l’étendue d’un pré. Cette maniere d’abreuver les prairies établie en Provence & en Languedoc les rend extrémement fertiles lorsqu’elle est faite à propos. La trop grande quantité d’eau, si elle y séjournoit, rendroit les prés marécageux. (K)
Abreuver un cheval, c’est-à-dire le faire boire ; ce qu’il faut avoir soin de faire deux fois par jour. (V)
* Abreuver. Les Vernisseurs disent de la premiere couche de vernis qu’ils mettent sur le bois, qu’elle l’abreuve.
* ABREUVOIR ou GOUTTIERE, défaut des arbres qui vient d’une altération des fibres ligneuses qui s’est produite intérieurement, & n’a occasionné aucune cicatrice qui ait changé la forme extérieure de l’arbre. L’abreuvoir a la même cause que la gélivure. Voyez l’article Gélivure.
Abreuvoir, s. m. On appelle ainsi un lieu choisi & formé en pente douce au bord de l’eau, pour y mener boire ou baigner les chevaux. Les abreuvoirs sont ordinairement pavés & bordés en barriere. On dit : menez ce cheval à l’abreuvoir ou à l’eau. (V)
Abreuvoir, lieu où les oiseaux vont boire : on dit prendre les oiseaux à l’abreuvoir. Pour réussir à cette chasse, il faut choisir un endroit fréquenté par les petits oiseaux, & où il y ait quelque ruisseau le long duquel on cherche l’endroit le plus commode pour y faire un petit abreuvoir de la longueur d’un filet, & large environ d’un pié ou d’un pié & demi : on couvre l’eau des deux côtés de l’abreuvoir, de joncs, de chaume ou d’herbes, afin que les oiseaux soient obligés de boire à l’endroit que l’on a destiné pour l’abreuvoir : on attend qu’ils soient descendus pour boire ; & quand on en voit une quantité, on les enveloppe du filet en tirant une ficelle qui répond à ce filet, & que tient le chasseur qui est caché ; ou bien l’on couvre l’abreuvoir de petits brins de bois enduits de glu, & les oiseaux venant se poser sur ces baguettes pour boire plus commodément, se trouvent pris.
L’heure la plus convenable pour tendre à l’abreuvoir, est depuis dix heures du matin jusqu’à onze, & depuis deux heures jusqu’à trois après midi, & enfin une heure & demie avant le coucher du soleil : alors les oiseaux y viennent en foule, parce que l’heure les presse de se retirer.
Remarquez que plus la chaleur est grande, meilleure est cette chasse.
Abreuvoirs, (terme de Maçonnerie ou d’Archit.) sont de petites tranchées faites avec le marteau de Tailleur de Pierres, ou avec la hachete de Maçon, dans les joints & lits des pierres, afin que le mortier ou coulis qu’on met dans ces joints, s’accroche avec les pierres & les lie. Vignole de Daviler, p. 353. (P)
ABREX, mot qui se trouve dans une inscription Latine découverte à Langres en 1673, & qui a fait penser à M. Mahudel que Bellorix, dont il est parlé dans cette inscription, étoit un homme d’autorité chez les Langrois, & même qu’il avoit été un de leurs Rois ; car il prétend que le mot abrex marque qu’il avoit abdiqué la royauté, soit qu’elle fût annuelle & élective chez ces peuples comme parmi quelques autres des Gaules, soit qu’elle fût perpétuelle dans la personne de celui qu’on avoit élû ; car si ce n’eût pas été de son propre mouvement qu’il eût renoncé à cette dignité, mais qu’il l’eût quittée après l’expiration du terme, on auroit dit exrex, & non pas abrex. Nous ne donnons ceci d’après les Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres, que comme une conjecture ingénieuse qui n’est pas dénuée de vraissemblance. (G)
ABRI, s. m. C’est ainsi qu’on appelle un endroit où l’on peut mouiller à couvert du vent. Ce port est à l’abri des vents de ouest & de nord-ouest. L’anse où nous mouillâmes est sans aucun abri. Le vent renforçant, nous fûmes nous mettre à l’abri de l’isle. Mouiller à l’abri d’une terre.
Abri se dit aussi du côté du pont où l’on est moins exposé au vent. (Z)
ABRICOTIER, s. m. arbre à fleur en rose, dont le pistil devient un fruit à noyau. La fleur est composée de plusieurs feuilles disposées en rose : le pistil sort du calyce, & devient un fruit charnu presque rond, applati sur les côtés & sillonné dans sa longueur ; ce fruit renferme un noyau osseux & applati, dans lequel il y a une semence. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Abricots. On en fait des compotes & des confitures seches & liquides : son amande sert à faire de la pâte & du ratafiat. Il se multiplie par son noyau, & se greffe sur prunier & sur amandier. On distingue l’abricotier en précoce ou abricotin, en abricot en espalier, à plein vent. Les abricots violets sont les plus beaux & les meilleurs.
La place la plus convenable aux abricotiers est le plein vent : mais toutes les expositions en espaliers leur sont bonnes, & ils aiment mieux une terre légere & sablonneuse, qu’une terre plus grasse. (K)
* Compote d’abricots verds. Prenez des abricots verds ; remplissez un chaudron d’eau à demi ; jettez-y des cendres de bois neuf ou gravelées ; faites faire à cette lessive sept ou huit bouillons ; mettez-y vos abricots ; remuez-les avec l’écumoire. Quand vous vous appercevrez qu’ils quitteront le noyau, mettez-les dans de l’eau froide, maniez-les, nettoyez & passez dans d’autre eau claire. Faites bouillir de l’eau dans une poële ; jettez-y vos abricots que vous tirerez de l’eau claire. Quand ils seront cuits, vous ferez fondre dans une poële une quantité de sucre clarifié, proportionnée à celle des abricots : cependant vous laisserez égoûter vos abricots entre des serviettes ; vous les tirerez de là pour les jetter dans le sucre ; vous les y laisserez bouillir doucement ; bientôt ils verdiront : alors poussez le bouillon ; remuez, écumez, laissez refroidir, & serrez.
Compote d’abricots mûrs. Ouvrez vos abricots par la moitié, faites-les cuire en sirop ; cassez les noyaux ; pelez les amandes ; mettez une demi-livre de sucre pour une douzaine d’abricots dans une poële. Faites fondre ; arrangez vos moitiés d’abricots dans ce sucre fondu ; continuez de faire bouillir ; jettez ensuite sur les abricots vos amandes ; ôtez votre compote de dessus le feu ; remuez-la, afin d’assembler l’écume ; enlevez l’écume avec un papier. Remettez sur le feu : s’il se reforme de l’écume, enlevez-la, laissez refroidir, & serrez. On peut peler ses abricots. S’ils sont durs, on les passera à l’eau avant que de les mettre au sucre.
* Abricots confits. Prenez des abricots verds ; piquez-les par-tout avec une épingle ; jettez-les dans l’eau ; faites-les bouillir dans une seconde eau, après les avoir lavés dans la premiere ; ôtez-les de dessus le feu quand ils monteront, & les laissez refroidir. Mettez-les ensuite sur un petit feu ; tenez-les couverts, si vous voulez qu’ils verdissent, & ne les faites pas bouillir. Quand ils seront verds, mettez-les rafraîchir dans l’eau. Quand ils seront rafraîchis, vous mettrez sur cette eau deux parties de sucre contre une d’eau, ensorte que la quantité du mélange surnage les abricots. Laissez-les reposer environ vingt-quatre heures dans cet état ; jettez-les ensuite dans un poëlon ; faites-les chauffer légérement sur le feu sans ébullition ; remuez-les souvent. Le jour suivant vous les ferez égoutter en les tirant du sirop. Vous ferez cuire le sirop seul sur le feu, jusqu’à ce qu’il vous paroisse avoir de la consistance ; vous y arrangerez vos abricots égouttés ; vous les ferez chauffer jusqu’au frémissement du sirop, puis les retirerez de dessus le feu, & les laisserez reposer jusqu’au lendemain. Le lendemain augmentant le sirop de sucre, vous les remettrez sur le feu & les ferez bouillir, puis vous les laisserez encore reposer un jour. Le quatrieme jour vous retirerez vos abricots, & vous ferez cuire le sirop seul jusqu’à ce qu’il soit lisse, c’est-à-dire, que le fil qu’il forme en le laissant distiller par inclination, se casse net. Laissez encore reposer un jour vos abricots dans ce sirop. Le cinquieme, remettez votre sirop seul sur le feu ; donnez-lui une plus forte cuisson, & plus de consistance ; jettez-y pour la derniere fois vos abricots ; faites-les frémir ; retirez-les ; achevez de faire cuire le sirop seul, & glissez-y vos abricots ; couvrez-les, & faites-leur jetter avec le sirop quelques bouillons encore ; écumez de tems en tems, & dressez.
* Abricots en marmelade. Prenez des abricots mûrs ; ouvrez-les ; cassez les noyaux ; jettez les amandes dans l’eau bouillante pour les dérober, ou ôter la peau. Prenez trois quarterons de sucre pour une livre de fruit ; mettez sur quatre livres un quart de sucre, un demi-septier d’eau ; faites cuire ce mêlange d’eau & de sucre ; écumez à mesure qu’il cuit. Quand il sera cuit à la demi-plume, ce dont vous vous appercevrez, si en soufflant sur votre écumoire il s’en éleve des pellicules blanchâtres & minces, jettez-y vos abricots & vos amandes ; faites cuire, remuez ; continuez de faire cuire & de remuer jusqu’à ce que votre abricot soit presque entierement fondu, & que votre sirop soit clair, transparent & consistant : ôtez alors votre marmelade de dessus le feu, elle est faite ; enfermez-la dans des pots que vous boucherez bien.
* Pâte d’abricots. Ayez des abricots bien mûrs ; pelez-les, ôtez le noyau, desséchez-les à petit feu, ils se mettront en pâte. Jettez cette pâte dans du sucre que vous aurez tout prêt cuit à la plume ; mêlez bien ; faites frémir le mêlange sur le feu, puis jettez dans des moules, ou entre des ardoises, & faites bien sécher dans l’étuve à bon feu.
Abricots à mi-sucre ; ce sont des abricots confits dans une quantité modérée de sucre cuit à la plume, & glissés dans du sirop cuit à perlé. Voyez A la plume & A perlé.
Abricots à oreille ; ce sont des abricots confits que les Confiseurs appellent ainsi, parce qu’ils ont entordu & contourné une des moitiés sans cependant la détacher tout-à-fait de l’autre, ou qu’ils ont enjoint ensemble deux moitiés séparées ; ensorte qu’elles se débordent mutuellement par les deux bouts, l’une d’un côté, & l’autre de l’autre.
ABRITER, v. a. c’est porter à l’ombre une plante mise dans un pot, dans une caisse, pour lui ôter le trop de soleil. On peut encore abriter une planche entiere, en la couvrant d’une toile ou d’un paillasson, ce qui s’appelle proprement couvrir. Voyez Couvrir. (K)
ABRIVER, mot ancien, encore en usage parmi les gens de riviere ; c’est aborder & se joindre au rivage. (Z)
* ABROBANIA ou ABRUCHBANIA, s. ville du Comté du même nom dans la Transylvanie.
ABROHANI. (Commerce) Voyez Malle-molle.
ABROGATION, s. f. action par laquelle on révoque ou annulle une loi. Il n’appartient qu’à celui qui a le pouvoir d’en faire, d’en abroger. V. Abolition, Révocation.
Abrogation differe de dérogation, en ce que la loi dérogeante ne donne atteinte qu’indirectement à la loi antérieure, & dans les points seulement où l’une & l’autre seroient incompatibles ; au lieu que l’abrogation est une loi faite expressément pour en abolir une précédente. Voyez Derogation. (H)
* ABROLHOS ou aperi oculos, s. m. pl. écueils terribles proche l’isle Sainte-Barbe, à 20 lieues de la côte du Brésil.
* ABROTANOIDES, s. m. espece de corail ressemblant à l’aurone femelle, d’où il tire son nom. On le trouve, selon Clusius qui en a donné le nom, sur les rochers au fond de la mer.
ABROTONE femelle, s. f. plante plus connue sous le nom de santoline. Voyez Santoline. (I)
Abrotone mâle, s. m. plante plus connue sous le nom d’aurone. Voyez Aurone. (I)
ABRUS, espece de féve rouge qui croît en Egypte & aux Indes. Hist. Plant. Ray.
On apporte l’abrus des deux Indes ; on se sert de sa semence. Il y en a de deux sortes ; l’une grosse comme un gros pois, cendrée, noirâtre ; l’autre un peu plus grosse que l’ivraie ordinaire : toutes les deux d’un rouge foncé. On les recommande pour les inflammations des yeux, dans les rhumes, &c. Voyez Dale. (I)
* ABRUZZE, s. f. Province du Royaume de Naples en Italie. Long. 30. 40. 32. 45. lat. 41. 45. 42. 52.
ABSCISSE, s. f. est une partie quelconque du diametre ou de l’axe d’une courbe, comprise entre le sommet de la courbe ou un autre point fixe, & la rencontre de l’ordonnée. Voyez Axe, ordonnée.
Telle est la ligne AE, (Planch. sect. coniq. fig. 26.) comprise entre le sommet A de la courbe MAm, & l’ordonnée EM, &c. On appelle les lignes AF abscisses du latin abscindere, couper ; parce qu’elles sont des parties coupées de l’axe ou sur l’axe ; d’autres les appellent sagittæ ; c’est-à-dire fleches. Voyez. Fleche.
Dans la parabole l’abscisse est troisieme proportionnelle au parametre & à l’ordonnée, & le parametre est troisieme proportionnel à l’abscisse & à l’ordonnée. Voyez Parabole, &c.
Dans l’ellipse le quarré de l’ordonnée est égal au rectangle du parametre par l’abscisse, dont on a ôté un autre rectangle de la même abscisse par une quatrieme proportionnelle à l’axe, au parametre, & à l’abscisse. Voyez Ellipse.
Dans l’hyperbole les quarrés des ordonnées sont entr’eux comme les rectangles de l’abscisse par une autre ligne, composée de l’abscisse & de l’axe transverse. Voyez Hyperbole.
Dans ces deux dernieres propositions sur l’ellipse & l’hyperbole, on suppose que l’origine des abscisses, c’est-à-dire le point A, duquel on commence à les compter, soit le sommet de la courbe, ou ce qui revient au même, le point où elle est rencontrée par son axe. Car si on prenoit l’origine des abscisses au centre, comme cela se fait souvent, alors les deux théorèmes précédens n’auroient plus lieu. (O)
ABSENCE, s. f. en Droit, est l’éloignement de quelqu’un, du lieu de son domicile. Voyez Absent & Présent.
L’absence est présumée en matiere de prescription ; & c’est à celui qui l’allegue pour exception, à prouver la présence.
Celui qui est absent du Royaume avec l’intention de n’y plus retourner, est réputé étranger : mais il n’est pas réputé mort. Cependant ses héritiers ne laissent pas par provision de partager ses biens. Or on lui présume l’intention de ne plus revenir, s’il s’est fait naturaliser en pays étranger, & y a pris un établissement stable. (H)
ABSENT adj. en Droit, signifie en général, quiconque est éloigné de son domicile.
Absent, en matiere de prescription, se dit de celui qui est dans une autre Province que celle où est le possesseur de son héritage. Voyez Prescription & Présent.
Les absens qui le sont pour l’intérêt de l’Etat, sont réputés présens, quoties de commodis eorum agitur.
Lorsqu’il s’agit de faire le partage d’une succession où un absent a intérêt, il faut distinguer s’il y a une certitude probable qu’il soit vivant, ou si la probabilité au contraire est qu’il soit mort. Dans le premier cas il n’y a qu’à le faire assigner à son dernier domicile, pour faire ordonner avec lui qu’il sera procédé au partage. Dans l’autre cas, ses co-héritiers partageront entre-eux la succession, mais en donnant caution pour la part de l’absent. Mais la mort ne se présume pas sans de fortes conjectures ; & s’il reste quelque probabilité qu’il puisse être vivant, on lui réserve sa part dans le partage, & on en laisse l’administration à son héritier présomptif, lequel aussi est obligé de donner caution. (H)
Lorsque M. Nicolas Bernoulli, neveu des célebres Jacques & Jean Bernoulli, soûtint à Bâle en 1709 sa these de Docteur en Droit ; comme il étoit grand Géometre, aussi-bien que Jurisconsulte, il ne put s’empêcher de choisir une matiere qui admît de la Géométrie. Il prit donc pour sujet de sa these de usu artis conjectandi in Jure, c’est-à-dire, de l’application du calcul des probabilités aux matieres de Jurisprudence, & le troisieme chapitre de cette these traite du tems où un absent doit être réputé pour mort. Selon lui il doit être censé tel, lorsqu’il y a deux fois plus à parier qu’il est mort que vivant. Supposons donc un homme parti de son pays à l’âge de vingt ans, & voyons suivant la théorie de M. Bernoulli, en quel tems il peut être censé mort.
Suivant les tables données par M. Deparcieux de l’Académie Royale des Sciences, de 814 personnes vivantes à l’âge de 20 ans, il n’en reste à l’âge de 72 ans que 271, qui sont à peu près le tiers de 814 ; donc il en est mort les deux tiers depuis 20 jusqu’à 72 ; c’est-à-dire en 52 ans ; donc au bout de 52 ans il y a deux fois plus à parier pour la mort que pour la vie d’un homme qui s’absente & qui disparoît à 20 ans. J’ai choisi ici la table de M. Deparcieux, & je l’ai préférée à celle dont M. Bernoulli paroît s’être servi, me contentant d’y appliquer son raisonnement : mais je crois notre calcul trop fort en cette occasion à un certain égard, & trop foible à un autre ; car 1°. d’un côté la table de M. Deparcieux a été faite sur des Rentiers de tontines qui, comme il le remarque lui-même, vivent ordinairement plus que les autres, parce que l’on ne met ordinairement à la tontine que quand on est assez bien constitué pour se flater d’une longue vie. Au contraire, il y a à parier qu’un homme qui est absent, & qui depuis long-tems n’a donné de ses nouvelles à sa famille, est au moins dans le malheur ou dans l’indigence, qui joints à la fatigue des voyages ne peuvent guere manquer d’abréger les jours. 2°. D’un autre côté je ne vois pas qu’il suffise pour qu’un homme soit censé mort, qu’il y ait seulement deux contre un à parier qu’il l’est, surtout dans le cas dont il s’agit. Car lorsqu’il est question de disposer des biens d’un homme, & de le dépouiller sans autre motif que sa longue absence, la loi doit toûjours supposer sa mort certaine. Ce principe me paroît si évident & si juste, que si la table de M. Deparcieux n’étoit pas faite sur des gens qui vivent ordinairement plus long-tems que les autres, je croirois que l’absent ne doit être censé mort que dans le tems où il ne reste plus aucune des 814 personnes âgées de vingt ans, c’est-à-dire à 93 ans. Mais comme la table de M. Deparcieux seroit dans ce cas trop favorable aux absens, on pourra ce me semble faire une compensation, en prenant l’année où il ne reste que le quart des 814 personnes, c’est-à-dire environ 75 ans. Cette question seroit plus facile à décider si on avoit des tables de mortalité des voyageurs : mais ces tables nous manquent encore, parce qu’elles sont très-difficiles, & peut-être impossibles dans l’exécution.
M. de Buffon a donné à la fin du troisieme volume de son Histoire Naturelle, des tables de la durée de la vie plus exactes & plus commodes que celles de M. Deparcieux, pour résoudre le problème dont il s’agit, parce qu’elles ont été faites pour tous les hommes sans distinction, & non pour les Rentiers seulement. Cependant ces tables seroient peut-être encore un peu trop favorables aux voyageurs, qui doivent généralement vivre moins que les autres hommes : c’est pourquoi au lieu d’y prendre les comme nous avons fait dans les tables de M. Deparcieux, il seroit bon de ne prendre que les , ou peut-être les . Le calcul en est aisé à faire ; il nous suffit d’avoir indiqué la méthode. (O)
* D’ailleurs la solution de ce problème suppose une autre théorie sur la probabilité morale des événemens que celle qu’on a suivie jusqu’à présent. En attendant que nous exposions à l’article Probabilité cette théorie nouvelle qui est de M. de Buffon, nous allons mettre le lecteur en état de se satisfaire lui-même sur la question présente des absens reputés pour morts, en lui indiquant les principes qu’il pourroit suivre. Il est constant que quand il s’agit de décider par une supposition du bien-être d’un homme qui n’a contre lui que son absence, il faut avoir la plus grande certitude morale possible que la supposition est vraie. Mais comment avoir cette plus grande certitude morale possible ? où prendre ce maximum ? comment le déterminer ? Voici comment M. de Buffon veut qu’on s’y prenne, & l’on ne peut douter que son idée ne soit très-ingénieuse, & ne donne la solution d’un grand nombre de questions embarrassantes, telles que celles du problème sur la somme que doit parier à croix ou pile un joüeur A contre un joüeur B qui lui donneroit un écu, si lui B amenoit pile du premier coup ; deux écus, si lui B amenoit encore pile au second coup ; quatre écus, si lui B amenoit encore pile au troisieme, & ainsi de suite : car il est évident que la mise de A doit être déterminée sur la plus grande certitude morale possible que l’on puisse avoir que B ne passera pas un certain nombre de coups ; ce qui fait rentrer la question dans le fini, & lui donne des limites. Mais on aura dans le cas de l’absent la plus grande certitude morale possible de sa mort, ou d’un évenement en général, par celui où un nombre d’hommes seroit assez grand pour qu’aucun ne craignît le plus grand malheur, qui devroit cependant arriver infailliblement à un d’entre-eux. Exemple : prenons dix mille hommes de même âge, de même santé, &c. parmi lesquels il en doit certainement mourir un aujourd’hui : si ce nombre n’est pas encore assez grand pour délivrer entierement de la crainte de la mort chacun d’eux, prenons-en vingt. Dans cette derniere supposition, le cas où l’on auroit la plus grande certitude morale possible qu’un homme seroit mort, ce seroit celui ou de ces vingt mille hommes vivans, quand il s’est absenté, il n’en resteroit plus qu’un.
Voilà la route qu’on doit suivre ici & dans toutes autres conjonctures pareilles, où l’humanité semble exiger la supposition la plus favorable.
ABSIDE, s. f. terme d’Astronomie. V. Apside.
ABSINTHE, s. f. herbe qui porte une fleur à fleurons. Cette fleur est petite, & composée de fleurons découpés, portés chacun sur un embrion de graine, & renfermés dans un calice écailleux : lorsque la fleur est passée, chaque embrion devient une semence qui n’a point d’aigrette. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Absinthe ou Aluyne. Il y a quatre sortes d’absinthe : la romaine ou grande, la petite appellée pontique, l’absinthe ou l’aluyne de mer, & celle des Alpes appellée génepi.
Cette plante se met en bordure à deux ou trois piés de distance, & se peut tondre. Elle donne de la graine difficile à vanner ; c’est pourquoi on la renouvelle tous les deux ans en sevrant les vieux piés. (K)
* La grande absinthe a donné dans l’analyse chimique, n’étant pas encore fleurie, du phlegme liquide, de l’odeur & du goût de la plante, sans aucune marque d’acide ni d’alkali : il étoit mêlé avec l’huile essentielle, ensuite une liqueur limpide, odorante, qui a donné des marques d’un acide foible & d’un alkali très-fort : enfin une liqueur purement alkaline & mêlée de sel volatil, de sel volatil urineux concret, & de l’huile, soit subtile, soit grossiere.
La masse noire restée dans la cornue calcinée au feu de reverbere, on a tiré de ses cendres par la lixiviation du sel fixe purement alkali.
Les feuilles & les sommités chargées de fleurs & de graines, ont donné un phlegme limpide de l’odeur & du goût de la plante, avec des marques d’un peu d’acidité d’abord, puis d’un acide violent, enfin d’un acide & d’un alkali urineux avec beaucoup d’huile essentielle ; une liqueur roussâtre empireumateuse, alkaline, & pleine de sel urineux ; du sel volatil concret ; de l’huile, soit essentielle & subtile, soit puante & grossiere.
De la masse noire restée dans la cornue & calcinée au feu de reverbere, on a tiré des cendres qui ont donné par la lixiviation du sel fixe purement alkali. La comparaison des élémens obtenus & de leur quantité, a démontré que les feuilles ont plus de parties subtiles & volatiles que les fleurs & les graines ; qu’elles ont beaucoup moins de sel acide & d’huile que les sommités ; d’où il s’ensuit que les feuilles contiennent un sel ammoniacal & beaucoup d’huile subtile, & que l’on rencontre dans les sommités un sel tartareux uni avec un sel ammoniacal : mais il est vraissemblable que son efficacité dépend principalement de son huile essentielle, amere & aromatique ; & que quoiqu’elle paroisse la même dans les feuilles & les sommités, cependant elle est plus subtile, plus développée & plus volatile dans les feuilles à cause de son union intime avec les sels volatils.
On l’ordonne dans la jaunisse, la cachexie & les pâles couleurs : elle tue les vers, raffermit l’estomac ; mais elle est ennemie des nerfs comme la plûpart des amers. On en tire plusieurs compositions médicinales. Voyez celles qui suivent.
Absinthe (vin d’) Prenez des sommités de deux absinthes fleuries & récentes, mondées, hachées ou rompues, de chacune quatre livres ; de la canelle concassée trois gros ; mettez le tout dans un baril de cent pintes ; remplissez le baril de moust récemment exprimé de raisins blancs : placez le baril à la cave, laissez fermenter le vin ; & la fermentation finie, remplissez le tonneau de vin blanc, bouchez-le, & gardez le vin pour votre usage.
Vin d’absinthe qui peut se préparer en tout tems. Prenez feuilles de deux absinthes séchées, de chacune six gros ; versez dessus vin blanc quatre livres ; faites-les macérer à froid dans un matras pendant vingt-quatre heures ; passez la liqueur avec expression, & filtrez ; vous aurez le vin d’absinthe que vous garderez pour votre usage. (N)
ABSOLU, adject. On appelle ainsi le Jeudi de la Semaine-sainte, ou celui qui précede immédiatement la fête de Pâque, à cause de la cérémonie de l’Absoute qui se fait ce jour-là. Voyez Absoute.
Absolu, nombre absolu en Algebre est la quantité ou le nombre connu qui fait un des termes d’une équation. Voyez Equation & Racine.
Ainsi dans l’équation xx + 16 xx = 36, le nombre absolu est 36, qui égale x multiplié par lui-même, ajouté à 16 fois x.
C’est ce que Viete appelle Homogeneum comparationis. Voyez Homogene de comparaison. (O)
Absolu. Equation absolue en Astronomie, est la somme des équations optique & excentrique : on appelle équation optique l’inégalité apparente du mouvement d’une planete, qui vient de ce qu’elle n’est pas toûjours à la même distance de la terre, & qui subsisteroit quand même le mouvement de la planete seroit uniforme ; & on appelle équation excentrique l’inégalité réelle du mouvement d’une planete qui vient de ce que son mouvement n’est pas uniforme. Pour éclaircir cela par un exemple, supposons que le soleil se meuve ou paroisse se mouvoir sur la circonférence d’un cercle dont la terre occupe le centre, il est certain que si le soleil se meut uniformément dans ce cercle, il paroît se mouvoir uniformément étant vû de la terre ; & il n’y aura en ce cas ni équation optique, ni équation excentrique : mais si la terre n’occupe pas le centre du cercle, alors quand même le mouvement du soleil seroit réellement uniforme, il ne paroît pas tel étant vû de la terre. Voyez Inégalité optique ; & en ce cas, il y auroit une équation optique sans équation excentrique. Changeons maintenant l’orbite circulaire du soleil en un orbite elliptique dont la terre occupe le foyer : on sait que le soleil ne paroît pas se mouvoir uniformément dans cette ellipse : ainsi son mouvement est pour lors sujet à deux équations, l’équation optique, & l’équation excentrique. V. Equation. (O)
ABSOLUMENT, adv. Un mot est dit absolument, lorsqu’il n’a aucun rapport grammatical avec les autres mots de la proposition dont il est un incise. Voyez Ablatif. (F)
Absolument, terme que les Théologiens scholastiques emploient par opposition à ce qui se fait par voie déclarative : ainsi les Catholiques soûtiennent que le Prêtre a le pouvoir de remettre les péchés absolument. Les Protestans au contraire prétendent qu’il ne les remet que par voie déclarative & ministérielle. Voyez Absolution.
Absolument se dit encore en Théologie par opposition à ce qui est conditionnel : ainsi les Scholastiques ont distingué en Dieu deux sortes de volontés, l’une efficace & absolue, l’autre inefficace & conditionnelle. Voyez Volonté. (G)
Absolument en Géometrie. Ce mot signifie précisément la même chose que les expressions tout-à-fait, entierement : ainsi nous disons qu’une figure est absolument ronde, par opposition à celle qui ne l’est qu’en partie, comme un sphéroïde, une cycloïde, &c. (E)
* ABSOLUTION, Pardon, rémission, synonymes. Le pardon est en conséquence de l’offense, & regarde principalement la personne qui l’a faite. Il dépend de celle qui est offensée, & il produit la réconciliation, quand il est sincerement accordé & sincerement demandé.
La remission est en conséquence du crime, & a un rapport particulier à la peine dont il mérite d’être puni. Elle est accordée par le Prince ou par le Magistrat, & elle arrête l’exécution de la justice.
L’absolution est en conséquence de la faute ou du péché, & concerne proprement l’état du coupable. Elle est prononcée par le Juge civil, ou par le Ministre ecclésiastique, & elle rétablit l’accusé ou le pénitent dans les droits de l’innocence.
Absolution, terme de Droit, est un jugement par lequel un accusé est déclaré innocent, & comme tel préservé de la peine que les lois infligent pour le crime ou délit dont il étoit accusé.
Chez les Romains la maniere ordinaire de prononcer le jugement étoit telle : la cause étant plaidée de part & d’autre, l’Huissier crioit : dixerunt, comme s’il eût dit, les Parties ont dit ce qu’elles avoient à dire : alors on donnoit à chacun des Juges trois petites bouies, dont l’une étoit marquée de la lettre A, pour l’absolution ; une autre de la lettre C, pour la condamnation ; & la troisieme, des lettres N L, non liquet, la chose n’est pas claire, pour requérir le délai de la sentence. Selon que le plus grand nombre des suffrages tomboit sur l’une ou sur l’autre de ces marques, l’accusé étoit absous ou condamné, &c. s’il étoit absous, le Préteur le renvoyoit, en disant videtur non fecisse ; & s’il n’étoit pas absous, le Préteur disoit : jure videtur fecisse.
S’il y avoit autant de voix pour l’absoudre que pour le condamner, il étoit absous. On suppose que cette procédure est fondée sur la loi naturelle. Tel est le sentiment de Faber sur la 125e loi, de div. reg. jur. de Cicéron, pro Cluentio ; de Quintilien, declam. 264. de Strabon, Lib. IX. &c.
Dans Athenes la chose se pratiquoit autrement : les causes, en matiere criminelle, étoient portées devant le tribunal des Héliastes Juges ainsi nommés d’Ἥλιος, le soleil, parce qu’ils tenoient leurs assemblées dans un lieu découvert. Ils s’assembloient sur la convocation des Thesmothetes, au nombre de 1000, & quelquefois de 1500, & donnoient leur suffrage de la maniere suivante. Il y avoit une sorte de vaisseau sur lequel étoit un tissu d’osier, & par-dessus deux urnes, l’une de cuivre & l’autre de bois au couvercle de ces urnes étoit une fente garnie d’un quarré long, qui large par le haut, se rétrécissoit par le bas : comme nous le voyons à quelques troncs anciens dans les Eglises : l’une de bois nommée κυνος, étoit celle où les Juges jettoient les suffrages de la condamnation de l’accusé ; celle de cuivre, nommée ακνες, recevoit les suffrages portés pour l’absolution. Avant le jugement on distribuoit à chacun de ces Magistrats deux pieces de cuivre, l’une pleine & l’autre percée : la premiere pour absoudre ; l’autre pour condamner ; & l’on décidoit à la pluralité des pieces qui se trouvoient dans l’une ou l’autre des urnes.
Absolution dans le Droit Canon, est un acte juridique par lequel le Prêtre, comme juge, & en vertu du pouvoir qui lui est donné par Jesus-Christ, remet les péchés à ceux qui après la confession paroissent avoir les dispositions requises.
Les Catholiques Romains regardent l’absolution comme une partie du Sacrement de Pénitence : le Concile de Trente, Sess. XIV. cap. III. & celui de Florence dans le Decret ad Armenos, fait consister la principale partie essentielle ou la forme de ce sacrement, dans ces paroles de l’absolution : je vous absous de vos péchés ; ego te absolvo à peccatis tuis.
La formule d’absolution est absolue dans l’Eglise Romaine, & déprécatoire dans l’Eglise Grecque ; & cette derniere forme a été en usage dans l’Eglise d’Occident jusqu’au XIIIe siecle. Arcudius prétend à la vérité que chez les Grecs elle est absolue, & qu’elle consiste dans ces paroles : Mea mediocritas habet te venia donatum : mais les exemples qu’il produit, ou ne sont pas des formules d’absolution, ou sont seulement des formules d’absolution de l’excommunication, & non pas de l’absolution sacramentale.
Les Protestans prétendent qu’elle est déclaratoire & qu’elle n’influe en rien dans la rémission des péchés : d’où ils concluent que le Prêtre en donnant l’absolution ne fait autre chose que déclarer au pénitent que Dieu lui a remis les péchés, & non pas les lui remettre lui-même en vertu du pouvoir qu’il a reçu de Jesus-Christ. Mais cette doctrine est contraire à celle de Jesus-Christ, qui dit en S. Jean ch. xx. ver. 23. ceux dont vous aurez remis les péchés, leurs péchés leur seront remis : aussi le Concile de Trente, Sess. XIV. canon IV. l’a-t-il condamnée comme hérétique.
Absolution signifie assez souvent une sentence qui délie & releve une personne de l’excommunication qu’elle avoit encourue. V. Excommunication.
L’absolution dans ce sens est également en usage dans l’Eglise Catholique & chez les Protestans. Dans l’Eglise Réformée d’Ecosse, si l’excommunié fait paroître des signes réels d’un pieux repentir, & si en se présentant au Presbytere (c’est-à-dire, à l’assemblée des Anciens) on lui accorde un billet d’assûrance pour son absolution, il est alors présenté à l’assemblée pour confesser son péché. Il manifeste son repentir autant de fois que le presbytere le juge convenable ; & quand l’Assemblée est satisfaite de sa pénitence, le Ministre adresse sa priere à J. C. le conjurant d’agréer cet homme, de pardonner sa désobéissance, &c. lui qui a institué la loi de l’excommunication (c’est-à-dire, de lier & de délier les péchés des hommes sur la terre) avec promesse de ratifier les sentences qui sont justes. Cela fait, il prononce son absolution, par laquelle sa premiere sentence est abolie, & le pécheur reçu de nouveau à la communion. (G)
Absolution, en Droit Canonique, se prend encore dans un sens différent, & signifie la levée des censures. L’absolution accordée à l’effet de relever quelqu’un de l’excommunication est de deux sortes ; l’une absolue & sans réserve ; l’autre restrainte & sous réserve : celle-ci est encore de deux sortes ; l’une qu’on appelle ad effectum, ou simplement absolution des censures ; l’autre appellée ad cautelam.
La premiere, c’est-à-dire, l’absolution ad effectum, est de style dans les signatures de la Cour de Rome dont elle fait la clôture, & a l’effet de rendre l’impétrant capable de joüir de la concession apostolique, l’excommunication tenant toûjours quant à ses autres effets.
L’absolution ad cautelam est une espece d’absolution provisoire qu’accorde à l’appellant d’une sentence d’excommunication le Juge devant qui l’appel est porté, à l’effet de le rendre capable d’ester en jugement pour poursuivre son appel ; ce qu’il ne pouvoit pas faire étant sous l’anathème de l’excommunication qui l’a séparé de l’Eglise : elle ne s’accorde à l’appellant qu’après qu’il a promis avec serment qu’il exécutera le jugement qui interviendra sur l’appel.
L’absolution à fævis, en terme de Chancellerie Romaine, est la levée d’une irrégularité ou suspense encourue par un Ecclésiastique, pour avoir assisté à un jugement ou une exécution de mort ou de mutilation. (H)
On donne encore le nom d’absolution à une priere qu’on fait à la fin de chaque Nocturne & des Heures Canoniales : on le donne aussi aux prieres pour les Morts. (G)
ABSOLUTOIRE, adject. terme de Droit, se dit d’un jugement qui prononce l’absolution d’un accusé. V. Absolution. (H)
* ABSORBANT, adj. Il y a des vaisseaux absorbans par-tout où il y a des arteres exhalantes. C’est par les pores absorbans de l’épiderme que passent l’eau des bains, le mercure ; & rien n’est plus certain en Anatomie que les arteres exhalantes & les veines absorbantes. Les vaisseaux lactés absorbent le chyle, &c.
Il ne seroit pas inutile de rechercher le méchanisme par lequel se fait l’absorption. Est-ce par absorption, ou par application ou adhésion des parties que se communiquent certaines maladies, comme la gale, les dartres, &c. ?
Absorbans, remedes dont la vertu principale est de se charger des humeurs surabondantes contenues dans l’estomac, ou même dans les intestins lorsqu’ils y parviennent, mêlés avec le chyle : les absorbans peuvent s’appliquer aussi extérieurement quand il est question de dessécher une plaie ou un ulcere.
On met au nombre des absorbans les coquillages pilés, les os desséchés & brûlés, les craies, les terres, & autres médicamens de cette espece.
Les absorbans sont principalement indiqués, lorsque les humeurs surabondantes sont d’une nature acide : rien en effet n’est plus capable d’émousser les pointes des acides, & d’en diminuer la mauvaise qualité, qu’un mêlange avec une matiere qui s’en charge, & qui étant pour l’ordinaire des alkalis fixes, en fait des sels neutres.
La précaution que l’on doit prendre avant & pendant l’usage des absorbans, & aprés qu’on les a cessés, est de les joindre aux délayans aqueux, & de se purger légerement ; alors on prévient tous les inconveniens dont ils pourroient être suivis. (N)
* ABSORBER, engloutir, synonymes. Absorber exprime une action générale à la vérité, mais successive, qui en ne commençant que sur une partie du sujet, continue ensuite & s’étend sur le tout. Mais engloutir marque une action dont l’effet général est rapide, & saisit le tout à la fois sans le détailler par parties.
Le premier a un rapport particulier à la consommation & à la destruction : le second, dit proprement quelque chose qui enveloppe, emporte & fait disparoître tout d’un coup : ainsi le feu absorbe, pour ainsi dire, mais l’eau engloutit.
C’est selon cette même analogie qu’on dit dans un sens figuré être absorbé en Dieu, ou dans la contemplation de quelqu’objet, lorsqu’on s’y livre dans toute l’étendue de sa pensée, sans se permettre la moindre distraction. Je ne crois pas qu’engloutir soit d’usage au figuré.
Absorber, v. act. se dit quand la branche gourmande d’un arbre fruitier emporte toute la nourriture nécessaire aux autres parties de ce végétal. (K)
ABSORPTION, s. f. dans l’œconomie animale est une action dans laquelle les orifices ouverts des vaisseaux pompent les liqueurs qui se trouvent dans les cavités du corps. Ess. de la Société d’Edimbourg.
Les extrémités de la veine ombilicale pompent les liqueurs par voie d’absorption, de même que les vaisseaux lactés pompent le chyle des intestins.
Ce mot vient du latin absorbere, absorber. (L)
ABSOUTE, s. f. Cérémonie qui se pratique dans l’Eglise Romaine le Jeudi de la semaine sainte, pour représenter l’absolution qu’on donnoit vers le même tems aux Pénitens dans la primitive Eglise.
L’usage de l’Eglise de Rome, & de la plûpart des Eglises d’Occident, étoit de donner l’absolution aux Pénitens le jour du Jeudi saint, nommé pour cette raison le Jeudi absolu. Voyez Absolu.
Dans l’Eglise d’Espagne & dans celle de Milan, cette absolution publique se donnoit le jour du Vendredi saint ; & dans l’Orient, c’étoit le même jour ou le Samedi suivant, veille de Pâques. Dans les premiers tems, l’Evêque faisoit l’absoute, & alors elle étoit une partie essentielle du Sacrement de Pénitence, parce qu’elle suivoit la confession des fautes, la réparation de leurs desordres passés, & l’examen de la vie présente : « Le Jeudi saint, dit M. l’Abbé Fleury, les Pénitens se présentoient à la porte de l’Eglise ; l’Evêque après avoir fait pour eux plusieurs prieres, les faisoit rentrer à la sollicitation de l’Archidiacre, qui lui représentoit que c’étoit un tems propre à la clémence… Il leur faisoit une exhortation sur la miséricorde de Dieu, & le changement qu’ils devoient faire paroître dans leur vie, les obligeant à lever la main pour signe de cette promesse ; enfin se laissant fléchir aux prieres de l’Eglise, & persuadé de leur conversion il leur donnoit l’absolution solemnelle ». Mœurs des Chrétiens, tit. XXV.
Maintenant ce n’est plus qu’une Cérémonie qui s’exerce par un simple Prêtre, & qui consiste à réciter les sept Pseaumes de la Pénitence, quelques oraisons relatives au repentir que les Fideles doivent avoir de leurs péchés, une entr’autres que le Prêtre dit debout, couvert, & la main étendue sur le peuple, après quoi il prononce les formules Misereatur & Indulgantiam. Mais tous les Théologiens conviennent qu’elles n’operent pas la rémission des péchés ; & c’est la différence de ce qu’on appelle absoute avec l’absolution proprement dite. V. Absolution. (G)
ABSPERG, s. petite ville d’Allemagne dans la Suabe.
ABSTEME du latin abstemius, adject. pris subst. terme qui s’entend à la lettre des personnes qui s’abstiennent entierement de boire du vin, principalement par la répugnance & l’aversion qu’elles ont pour cette liqueur.
Dans ce sens, abstème est synonyme au mot latin invinius, & au mot grec ἄοινος, & même à ceux-ci ὑδρόποτης & ὑδροπαράστατης, bûveur d’eau, panégyriste de l’eau, étant composé d’abs, qui marque retranchement, éloignement, privation, répugnance, & de temetum, vin.
Les Théologiens protestans emploient plus ordinairement ce terme pour signifier les personnes qui ne peuvent participer à la coupe dans la réception de l’Eucharistie, par l’aversion naturelle qu’elles ont pour le vin. Voyez Antipathie.
Leurs Sectes ont été extrémement divisées pour savoir si l’on devoit laisser communier ces Abstèmes sous l’espece du pain seulement. Les Calvinistes au Synode de Charenton déciderent qu’ils pouvoient être admis à la Cene, pourvû qu’ils touchassent seulement la coupe du bout des levres, sans avaler une seule goutte de l’espece du vin. Les Luthériens se récrierent fort contre cette tolérance, & la traiterent de mutilation sacrilége du Sacrement. Il n’y a point d’ame pieuse, disoient-ils, qui par la ferveur de ses prieres n’obtienne de Dieu le pouvoir & la force d’avaler au moins une goutte de vin. Voyez Stricker in nov. Litt. Germ. ann. 1709. pag. 304.
M. de Meaux a tiré avantage de cette variation pour justifier le retranchement de la coupe ; car il est clair, dit-il, que la Communion sous les deux especes n’est pas de précepte divin, puisqu’il y a des cas où l’on en peut dispenser. Voyez les Nouv. de la République des Lettres, tom. III. pag. 23. Mém. de Trev. 1708. pag. 33. & 1717. pag. 1415.
Dans les premiers siecles de la République Romaine, toutes les Dames devoient être abstèmes ; & pour s’assûrer si elles observoient cette coûtume, c’étoit une regle de politesse constamment observée, que toutes les fois que des parens ou des amis les venoient voir, elles les embrassassent. (G)
ABSTENSION, s. f. terme de Droit civil, est la répudiation de l’hérédité par l’héritier, au moyen de quoi la succession se trouve vacante, & le défunt intestat, s’il ne s’est pourvû d’un second héritier par la voie de la substitution. Voyez Substitution & Intestat.
L’abstension differe de la rénonciation en ce que celle-ci se fait par l’héritier à qui la nature ou la loi déferent l’hérédité, & l’abstension par celui à qui elle est déférée par la volonté du testateur. (H)
ABSTERGEANS, adj. remedes de nature savoneuse, qui peuvent dissoudre les concrétions résineuses. On a tort de les confondre, comme fait Castelli, avec les abluans : ceux-ci sont des fluides qui ne peuvent fondre & emporter que les sels que l’eau peut dissoudre. (N)
ABSTINENCE, s. f. Plusieurs croient que les premiers hommes avant le déluge s’abstenoient de vin & de viande, parce que l’Écriture marque expressément que Noé après le déluge commença à planter la vigne, & que Dieu lui permit d’user de viande, au lieu qu’il n’avoit donné à Adam pour nourriture que les fruits & les herbes de la terre : mais le sentiment contraire est soûtenu par quantité d’habiles Interpretes, qui croient que les hommes d’avant le déluge ne se refusoient ni les plaisirs de la bonne chere, ni ceux du vin ; & l’Ecriture en deux mots nous fait assez connoître à quel excès leur corruption étoit montée, lorsqu’elle dit que toute chair avoit corrompu sa voie. Quand Dieu n’auroit pas permis à Adam ni l’usage de la chair, ni celui du vin, ses descendans impies se seroient peu mis en peine de ces défenses. Gen. IX. 20. III. 17. VI. 11. 12
La Loi ordonnoit aux Prêtres de s’abstenir de vin pendant tout le tems qu’ils étoient occupés au service du Temple. La même défense étoit faite aux Nazaréens pour tout le tems de leur Nazaréat. Les Juifs s’abstiennent de plusieurs sortes d’animaux, dont on trouve le détail dans le Lévitique & le Deutéronome. Saint Paul dit que les Athletes s’abstiennent de toutes choses, pour obtenir une couronne corruptible, c’est-à-dire, qu’ils s’abstiennent de tout ce qui peut les affoiblir ; & en écrivant à Timothée, il blâme certains hérétiques qui condamnoient le mariage & l’usage des viandes que Dieu a créées. Entre les premiers Chrétiens, les uns observoient l’abstinence des viandes défendues par la Loi, & des chairs immolées aux Idoles ; d’autres méprisoient ces observances comme inutiles, & usoient de la liberté que Jesus-Christ a procurée à ses Fideles. Saint Paul a donné sur cela des regles très-sages, qui sont rapportées dans les Épîtres aux Corinthiens & aux Romains. Levit. X. 9. Num. VI. 3. 1. Cor. IX. 25. Tim. 1. c. IV. 3. 1. cor. VIII. 7. 10. Rom. XIV. 23.
Le Concile de Jérusalem tenu par les Apôtres, ordonne aux Fideles convertis du paganisme de s’abstenir du sang des viandes suffoquées, de la fornication, & de l’idolatrie. Act. XV. 20.
Saint Paul veut que les Fideles s’abstiennent de tout ce qui a même l’apparence du mal, ab omni specie malâ abstinete vos, & à plus forte raison de tout ce qui est réellement mauvais & contraire à la religion & à la piété. Thessal. v. 21. Calmet. Dictionn. de la Bibl. Lettre A. tom. I. pag. 32. (G)
Abstinence, s. f. Orphée, après avoir adouci les mœurs des hommes, établit une sorte de vie qu’on nomma depuis Orphique ; & une des pratiques des hommes qui embrassoient cet état, étoit de ne point manger de la chair des animaux. Il est plausible de dire qu’Orphée ayant rendu sensibles aux Lois de la société les premiers hommes qui étoient Antropophages :
Silvestres homines sacer Interpresque Deorum,
Cædibus & fœdo victu deterruit Orpheus. Horat.
il leur avoit imposé la loi de ne plus manger de viande du tout, & cela sans doute pour les éloigner entierement de leur premiere férocité ; que cette pratique ayant ensuite été adoptée par des personnes qui vouloient embrasser une vie plus parfaite que les autres, il y eut parmi les Payens une sorte de vie qui s’appella pour lors vie Orphique, Ὀρφικὸς βίος, dont Platon parle dans l’Épinomis, & au sixieme Livre de ses Lois. Les Phéniciens & les Assyriens voisins des Juifs avoient leurs jeûnes sacrés. Les Égyptiens, dit Hérodote, sacrifient une vache à Isis, après s’y être préparés par des jeûnes ; & ailleurs il attribue la même coûtume aux femmes de Cyrene. Chez les Athéniens, les fêtes d’Eleusine & des Tesmophores étoient accompagnées de jeûnes rigoureux, surtout entre les femmes qui passoient un jour entier assises à terre dans un équipage lugubre, & sans prendre aucune nourriture. A Rome il y avoit des jeûnes réglés en l’honneur de Jupiter, & les Historiens font mention de ceux de Jules César, d’Auguste, de Vespasien, de Marc Aurele, &c. Les Athletes en particulier en pratiquoient d’étonnans : nous en parlerons ailleurs. Voyez Athletes. (G)
* Abstinence des Pythagoriciens. Les Pythagoriciens ne mangeoient ni chair, ni poisson, du moins ceux d’entr’eux qui faisoient profession d’une grande perfection, & qui se piquoient d’avoir atteint le dernier degré de la théorie de leur Maître. Cette abstinence de tout ce qui avoit eu vie étoit une suite de la métempsycose : mais d’où venoit à Pythagore l’aversion qu’il avoit pour un grand nombre d’autres alimens, pour les féves, pour la mauve, pour le vin, &c. On peut lui passer l’abstinence des œufs ; il en devoit un jour éclorre des poulets : où avoit-il imaginé que la mauve étoit une herbe sacrée, folium sanctissimum ? Ceux à qui l’honneur de Pythagore est à cœur, expliquent toutes ces choses ; ils démontrent que Pythagore avoit grande raison de manger des choux, & de s’abstenir des féves. Mais n’en déplaise à Laerte, à Eustathe, à Ælien, à Jamblique, à Athenée, &c. on n’apperçoit dans toute cette partie de sa Philosophie que de la superstition ou de l’ignorance : de la superstition, s’il pensoit que la féve étoit protégée des Dieux ; de l’ignorance, s’il croyoit que la mauve avoit quelque qualité contraire à la santé. Il ne faut pas pour cela en faire moins de cas de Pythagore : son système de la métempsycose ne peut être méprisé qu’à tort par ceux qui n’ont pas assez de Philosophie pour connoître les raisons qui le lui avoient suggéré, ou qu’à juste titre par les Chrétiens à qui Dieu a révélé l’immortalité de l’ame, & notre existence future dans une autre vie.
Abstinence en Médecine a un sens très-étendu.
On entend par ce mot la privation des alimens trop succulens. On dit communément qu’un malade est réduit à l’abstinence, quand il ne prend que du bouillon, de la tisane, & des remedes appropriés à sa maladie. Quoique l’abstinence ne suffise pas pour guérir les maladies, elle est d’un grand secours pour aider l’action des remedes. L’abstinence est un préservatif contre beaucoup de maladies, & surtout contre celles que produit la gourmandise.
On doit régler la quantité des alimens que l’on prend sur la déperdition de substance qu’occasionne l’exercice que l’on fait, sur le tems où la transpiration est plus ou moins abondante, & s’abstenir des alimens que l’on a remarqué contraires à son tempérament.
On dit aussi que les gens foibles & délicats doivent faire abstinence de l’acte vénérien.
On apprend par les lois du régime, tant dans l’état de santé que dans l’état de maladie, à quelle sorte d’abstinence on doit s’astreindre. Voyez Régime. (N)
ABSTINENS, adject. pris subst. Secte d’hérétiques qui parurent dans les Gaules & en Espagne sur la fin du troisieme siecle. On croit qu’ils avoient emprunté une partie de leurs opinions des Gnostiques & des Manichéens, parce qu’ils décrioient le mariage, condamnoient l’usage des viandes, & mettoient le S. Esprit au rang des créatures. Baronius semble les confondre avec les Hiéracites : mais ce qu’il en dit d’après S. Philastre, convient mieux aux Encratites, dont le nom se rend exactement par ceux d’Abstinens ou Continens. Voyez Encratites & Hiéracites. (G)
ABSTRACTION, s. f. ce mot vient du latin abstrahere, arracher, tirer de, détacher.
L’abstraction est une opération de l’esprit, par laquelle, à l’occasion des impressions sensibles des objets extérieurs, ou à l’occasion de quelque affection intérieure, nous nous formons par réflexion un concept singulier, que nous détachons de tout ce qui peut nous avoir donné lieu de le former ; nous le regardons à part comme s’il y avoit quelque objet réel qui répondit à ce concept indépendemment de notre maniere de penser ; & parce que nous ne pouvons faire connoître aux autres hommes nos pensées autrement que par la parole, cette nécessité & l’usage où nous sommes de donner des noms aux objets réels, nous ont portés à en donner aussi aux concepts métaphysiques dont nous parlons ; & ces noms n’ont pas peu contribué à nous faire distinguer ces concepts : par exemple.
Le sentiment uniforme que tous les objets blancs excitent en nous, nous a fait donner le même nom qualificatif à chacun de ces objets. Nous disons de chacun d’eux en particulier qu’il est blanc ; ensuite pour marquer le point selon lequel tous ces objets se ressemblent, nous avons inventé le mot blancheur. Or il y a en effet des objets tels que nous appellons blancs ; mais il n’y a point hors de nous un être qui soit la blancheur.
Ainsi blancheur n’est qu’un terme abstrait : c’est le produit de notre réflexion à l’occasion des uniformités des impressions particulieres que divers objets blancs ont faites en nous ; c’est le point auquel nous rapportons toutes ces impressions différentes par leur cause particuliere, & uniformes par leur espece.
Il y a des objets dont l’aspect nous affecte de maniere que nous les appellons beaux ; ensuite considérant à part cette maniere d’affecter, séparée de tout objet, de toute autre maniere, nous l’appellons la beauté.
Il y a des corps particuliers ; ils sont étendus, ils sont figurés, ils sont divisibles, & ont encore bien d’autres propriétés : il est arrivé que notre esprit les a considérés, tantôt seulement en tant qu’étendus, tantôt comme figurés, ou bien comme divisibles, ne s’arrêtant à chaque fois qu’à une seule de ces considérations ; ce qui est faire abstraction de toutes les autres propriétés. Ensuite nous avons observé que tous les corps conviennent entre-eux en tant qu’ils sont étendus, ou en tant qu’ils sont figurés, ou bien en tant que divisibles. Or pour marquer ces divers points de convenance ou de réunion, nous nous sommes formés le concept d’étendue, ou celui de figure, ou celui de divisibilité : mais il n’y a point d’être physique qui soit l’étendue, ou la figure, ou la divisibilité, & qui ne soit que cela.
Vous pouvez disposer à votre gré de chaque corps particulier qui est en votre puissance : mais êtes-vous ainsi le maître de l’étendue, de la figure, ou de la divisibilité ? L’animal en général est-il de quelque pays, & peut-il se transporter d’un lieu en un autre ?
Chaque abstraction particuliere exclud la considération de toute autre propriété. Si vous considérez le corps en tant que figuré, il est évident que vous ne le regardez pas comme lumineux, ni comme vivant, vous ne lui ôtez rien : ainsi il seroit ridicule de conclurre de votre abstraction, que ce corps que votre esprit ne regarde que comme figuré, ne puisse pas être en même tems en lui-même étendu, lumineux, vivant, &c.
Les concepts abstraits sont donc comme le point auquel nous rapportons les différentes impressions ou réflexions particulieres qui sont de même espece, & duquel nous écartons tout ce qui n’est pas cela précisément.
Tel est l’homme : il est un être vivant, capable de sentir, de penser, de juger, de raisonner, de vouloir, de distinguer chaque acte singulier de chacune de ces facultés, & de faire ainsi des abstractions.
Nous dirons, en parlant de l’Article, que n’y ayant en ce monde que des êtres réels, il n’a pas été possible que chacun de ces êtres eût un nom propre. On a donné un nom commun à tous les individus qui se ressemblent. Ce nom commun est appellé nom d’espece, parce qu’il convient à chaque individu d’une espece. Pierre est homme, Paul est homme ; Alexandre & César étoient hommes. En ce sens le nom d’espece n’est qu’un nom adjectif, comme beau, bon, vrai ; & c’est pour cela qu’il n’a point d’article. Mais si l’on regarde l’homme sans en faire aucune application particuliere, alors l’homme est pris dans un sens abstrait, & devient un individu spécifique ; c’est par cette raison qu’il reçoit l’article ; c’est ainsi qu’on dit le beau, le bon, le vrai.
On ne s’en est pas tenu à ces noms simples abstraits spécifiques : d’homme on a fait humanité ; de beau, beauté ; ainsi des autres.
Les Philosophes scholastiques qui ont trouvé établis les uns & les autres de ces noms, ont appellé concrets ceux que nous nommons individus spécifiques, tels que l’homme, le beau, le bon, le vrai. Ce mot concret vient du latin concretus, & signifie qui croît avec, composé, formé de ; parce que ces concrets sont formés, disent-ils, de ceux qu’ils nomment abstraits : tels sont humanité, beauté, bonté, vérité. Ces Philosophes ont cru que comme la lumiere vient du soleil, que comme l’eau ne devient chaude que par le feu, de même l’homme n’étoit tel que par l’humanité ; que le beau n’étoit beau que par la beauté ; le bon par la bonté, & qu’il n’y avoit de vrai que par la vérité. Ils ont dit humanité, de là homme & de même beauté, ensuite beau. Mais ce n’est pas ainsi que la nature nous instruit ; elle ne nous montre d’abord que le physique. Nous avons commencé par voir des hommes avant que de comprendre & de nous former le terme abstrait humanité. Nous avons été touchés du beau & du bon avant que d’entendre & de faire les mots de beauté & de bonté ; & les hommes ont été pénétrés de la réalité des choses, & ont senti une persuasion intérieure avant que d’introduire le mot de vérité. Ils ont compris, ils ont conçu avant que de faire le mot d’entendement ; ils ont voulu avant que de dire qu’ils avoient une volonté, & ils se sont ressouvenu avant que de former le mot de mémoire.
On a commencé par faire des observations sur l’usage, le service, ou l’emploi des mots : ensuite on a inventé le mot de Grammaire.
Ainsi Grammaire est comme le centre ou point de réunion, auquel on rapporte les différentes observations que l’on a faites sur l’emploi des mots. Mais Grammaire n’est qu’un terme abstrait ; c’est un nom métaphysique & d’imitation. Il n’y a pas hors de nous un être réel qui soit la Grammaire ; il n’y a que des Grammairiens qui observent. Il en est de même de tous les noms de Sciences & d’Arts, aussi-bien que des noms des différentes parties de ces Sciences & de ces Arts. Voyez Art.
De même le point auquel nous rapportons les observations que l’on a faites touchant le bon & le mauvais usage que nous pouvons faire des facultés de notre entendement, s’appelle Logique.
Nous avons vû divers animaux cesser de vivre ; nous nous sommes arrêtés à cette considération intéressante ; nous avons remarqué l’état uniforme d’inaction où ils se trouvent tous en tant qu’ils ne vivent plus ; nous avons considéré cet état indépendemment de toute application particuliere ; & comme s’il étoit en lui-même quelque chose de réel, nous l’avons appellé mort. Mais la mort n’est point un être. C’est ainsi que les différentes privations, & l’absence des objets dont la présence faisoit sur nous des impressions agréables ou désagréables, ont excité en nous un sentiment réfléchi de ces privations & de cette absence, & nous ont donné lieu de nous faire par degrés un concept abstrait du néant même : car nous nous entendons fort bien, quand nous soûtenons que le néant n’a point de propriétés, qu’il ne peut être la cause de rien ; que nous ne connoissons le néant & les privations que par l’absence des réalités qui leur sont opposées.
La réflexion sur cette absence nous fait reconnoître que nous ne sentons point : c’est pour ainsi dire sentir que l’on ne sent point.
Nous avons donc concept du néant, & ce concept est une abstraction que nous exprimons par un nom métaphysique, & à la maniere des autres concepts. Ainsi comme nous disons tirer un homme de prison, tirer un écu de sa poche, nous disons par imitation que Dieu a tiré le monde du néant.
L’usage où nous sommes tous les jours de donner des noms aux objets des idées qui nous représentent des êtres réels, nous a porté à en donner aussi par imitation aux objets métaphysiques des idées abstraites dont nous avons connoissance : ainsi nous en parlons comme nous faisons des objets réels.
L’illusion, la figure, le mensonge, ont un langage commun avec la vérité. Les expressions dont nous nous servons pour faire connoître aux autres hommes, ou les idées qui ont hors de nous des objets réels, ou celles qui ne sont que de simples abstractions de notre esprit, ont entre elles une parfaite analogie.
Nous disons, la mort, la maladie, l’imagination, l’idée, &c. comme nous disons le soleil, la lune, &c. quoique la mort, la maladie, l’imagination, l’idée, &c. ne soient point des êtres existans ; & nous parlons du phénix, de la chimere, du sphinx, & de la pierre philosophale, comme nous parlerions du lion, de la panthere, du rhinoceros, du pactole, ou du Pérou.
La Prose même, quoiqu’avec moins d’appareil que la Poësie, réalise, personifie ces êtres abstraits, & séduit également l’imagination. Si Malherbe a dit que la mort a des rigueurs, qu’elle se bouche les oreilles, qu’elle nous laisse crier, &c. nos Prosateurs ne disent-ils pas tous les jours que la mort ne respecte personne ; attendre la mort ; les Martyrs ont bravé la mort, ont couru au-devant de la mort ; envisager la mort sans émotion ; l’image de la mort ; affronter la mort ; la mort ne surprend point un homme sage : on dit populairement que la mort n’a pas faim ; que la mort n’a jamais tort.
Les Payens réalisoient l’amour, la discorde, la peur, le silence, la santé, dea salus, &c. & en faisoient autant de divinités. Rien de plus ordinaire parmi nous que de réaliser un emploi, une charge, une dignité ; nous personifions la raison, le goût, le génie, le naturel, les passions, l’humeur, le caractere, les vertus, les vices, l’esprit, le cœur, la fortune, le malheur, la réputation, la nature.
Les êtres réels qui nous environnent sont mûs & gouvernés d’une maniere qui n’est connue que de Dieu seul, & selon les Lois qu’il lui a plû d’établir lorsqu’il a créé l’Univers. Ainsi Dieu est un terme réel ; mais nature n’est qu’un terme métaphysique.
Quoiqu’un instrument de musique dont les cordes sont touchées, ne reçoive en lui-même qu’une simple modification, lorsqu’il rend le son du ré ou celui du sol, nous parlons de ces sons comme si c’étoit autant d’êtres réels : & c’est ainsi que nous parlons de nos songes, de nos imaginations, de nos idées, de nos plaisirs, &c. ensorte que nous habitons, à la vérité, un pays réel & physique : mais nous y parlons, si j’ose le dire, le langage du pays des abstractions, & nous disons, j’ai faim, j’ai envie, j’ai pitié, j’ai peur, j’ai dessein, &c. comme nous disons j’ai une montre.
Nous sommes émus, nous sommes affectés, nous sommes agités ; ainsi nous sentons, & de plus nous nous appercevons que nous sentons ; & c’est ce qui nous fait donner des noms aux différentes especes de sensations particulieres, & ensuite aux sensations générales de plaisir & de douleur. Mais il n’y a point un être réel qui soit le plaisir, ni un autre qui soit la douleur.
Pendant que d’un côté les hommes en punition du péché sont abandonnés à l’ignorance, d’un autre côté ils veulent savoir & connoître, & se flattent d’être parvenus au but quand ils n’ont fait qu’imaginer des noms, qui à la vérité arrêtent leur curiosité, mais qui au fond ne les éclairent point. Ne vaudroit-il pas mieux demeurer en chemin que de s’égarer ? l’erreur est pire que l’ignorance : celle-ci nous laisse tels que nous sommes ; si elle ne nous donne rien, du moins elle ne nous fait rien perdre ; au lieu que l’erreur séduit l’esprit, éteint les lumieres naturelles, & influe sur la conduite.
Les Poëtes ont amusé l’imagination en réalisant des termes abstraits ; le Peuple payen a été trompé : mais Platon lui-même qui bannissoit les Poëtes de sa République, n’a-t-il pas été séduit par des idées qui n’étoient que des abstractions de son esprit ? Les Philosophes, les Métaphysiciens, & si je l’ose dire, les Géometres même ont été séduits par des abstractions ; les uns par des formes substantielles, par des vertus occultes ; les autres par des privations, ou par des attractions. Le point métaphysique, par exemple, n’est qu’une pure abstraction, aussi-bien que la longueur. Je puis considérer la distance qu’il y a d’une ville à une autre, & n’être occupé que de cette distance ; je puis considérer aussi le terme d’où je suis parti, & celui où je suis arrivé ; je puis de même par imitation & par comparaison, ne regarder une ligne droite que comme le plus court chemin entre deux points : mais ces deux points ne sont que les extrémités de la ligne même ; & par une abstraction de mon esprit, je ne regarde ces extrémités que comme termes, j’en sépare tout ce qui n’est pas cela : l’un est le terme où la ligne commence ; l’autre, celui où elle finit : ces termes je les appelle points, & je n’attache à ce concept que l’idée précise de terme ; j’en écarte toute autre idée : il n’y a ici ni solidité, ni longueur, ni profondeur ; il n’y a que l’idée abstraite de terme.
Les noms des objets réels sont les premiers noms ; ce sont, pour ainsi dire, les aînés d’entre les noms : les autres qui n’énoncent que des concepts de notre esprit, ne sont noms que par imitation, par adoption ; ce sont les noms de nos concepts métaphysiques : ainsi les noms des objets réels, comme soleil, lune, terre, pourroient être appellés noms physiques, & les autres, noms métaphysiques.
Les noms physiques servent donc à faire entendre que nous parlons d’objets réels ; au lieu qu’un nom métaphysique marque que nous ne parlons que de quelque concept particulier de notre esprit. Or comme lorsque nous disons le soleil, la terre, la mer, cet homme, ce cheval, cette pierre, &c. notre propre expérience & le concours des motifs les plus légitimes nous persuadent qu’il y a hors de nous un objet réel qui est soleil, un autre qui est terre, &c. & que si ces objets n’étoient point réels, nos peres n’auroient jamais inventé ces noms, & nous ne les aurions pas adopté : de même lorsqu’on dit la nature, la fortune, le bonheur, la vie, la santé, la maladie, la mort, &c. les hommes vulgaires croient par imitation qu’il y a aussi indépendemment de leur maniere de penser, je ne sais quel être qui est la nature ; un autre, qui est la fortune, ou le bonheur, ou la vie, ou la mort, &c. car ils n’imaginent pas que tous les hommes puissent dire la nature, la fortune, la vie, la mort, & qu’il n’y ait pas hors de leur esprit une sorte d’être réel qui soit la nature, la fortune, &c. comme si nous ne pouvions avoir des concepts, ni des imaginations, sans qu’il y eût des objets réels qui en fussent l’exemplaire.
A la vérité nous ne pouvons avoir de ces concepts à moins que quelque chose de réel ne nous donne lieu de nous les former : mais le mot qui exprime le concept, n’a pas hors de nous un exemplaire propre. Nous avons vû de l’or, & nous avons observé des montagnes ; si ces deux représentations nous donnent lieu de nous former l’idée d’une montagne d’or, il ne s’ensuit nullement de cette image qu’il y ait une pareille montagne. Un vaisseau se trouve arrêté en pleine mer par quelque banc de sable inconnu aux Matelots, ils imaginent que c’est un petit poisson qui les arrête. Cette imagination ne donne aucune réalité au prétendu petit poisson, & n’empêche pas que tout ce que les Anciens ont cru du remora ne soit une fable, comme ce qu’ils se sont imaginés du phénix, & ce qu’ils ont pensé du sphinx, de la chimere, & du cheval Pégase. Les personnes sensées ont de la peine à croire qu’il y ait eu des hommes assez déraisonnables pour réaliser leurs propres abstractions : mais entre autres exemples, on peut les renvoyer à l’histoire de Valentin hérésiarque du second siecle de l’Eglise : c’étoit un Philosophe Platonicien qui s’écarta de la simplicité de la foi, & qui imagina des æons, c’est-à-dire des êtres abstraits, qu’il réalisoit ; le silence, la vérité, l’intelligence, le propator, ou principe. Il commença à enseigner ses erreurs en Egypte, & passa ensuite à Rome où il se fit des disciples appellés Valentiniens. Tertullien écrivit contre ces hérétiques. Voyez l’Histoire de l’Eglise. Ainsi dès les premiers tems les abstractions ont donné lieu à des disputes, qui pour être frivoles n’en ont point été moins vives.
Au reste si l’on vouloit éviter les termes abstraits, on seroit obligé d’avoir recours à des circonlocutions & à des périphrases qui énerveroient le discours. D’ailleurs ces termes fixent l’esprit ; ils nous servent à mettre de l’ordre & de la précision dans nos pensées ; ils donnent plus de grace & de force au discours ; ils le rendent plus vif, plus serré, & plus énergique : mais on doit en connoître la juste valeur. Les abstractions sont dans le discours ce que certains signes sont en Arithmétique, en Algebre & en Astronomie : mais quand on n’a pas l’attention de les apprécier, de ne les donner & de ne les prendre que pour ce qu’elles valent, elles écartent l’esprit de la réalité des choses, & deviennent ainsi la source de bien des erreurs.
Je voudrois donc que dans le style didactique, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’enseigner, on usât avec beaucoup de circonspection des termes abstraits & des expressions figurées : par exemple, je ne voudrois pas que l’on dît en Logique l’idée renferme, ni lorsque l’on juge ou compare des idées, qu’on les unit, ou qu’on les sépare ; car idée n’est qu’un terme abstrait. On dit aussi que le sujet attire à soi l’attribut ; ce ne sont-là que des métaphores qui n’amusent que l’imagination. Je n’aime pas non plus que l’on dise en Grammaire que le verbe gouverne, veut, demande, régit, &c. Voyez Régime. (F)
ABSTRAIRE, v. act. c’est faire une abstraction ; c’est ne considérer qu’un attribut ou une propriété de quelque être, sans faire attention aux autres attributs ou qualités ; par exemple quand on ne considere dans le corps que l’étendue, ou qu’on ne fait attention qu’à la quantité ou au nombre.
Ce verbe n’est pas usité en tous les tems, ni même en toutes les personnes du présent ; on dit seulement j’abstrais, tu abstrais, il abstrait : mais au lieu de dire nous abstraïons, &c. on dit nous faisons abstraction.
Le parfait & le prétérit simple ne sont pas usités, mais on dit j’ai abstrait, tu as abstrait, &c. j’avois abstrait, &c. j’eus abstrait, &c.
Le présent du subjonctif n’est point en usage ; on dit j’abstrairois, &c. on dit aussi que j’aie abstrait. &c. (F)
Abstrait, abstraite, adjectif participe ; il se dit des personnes & des choses. Un esprit abstrait, c’est un esprit inattentif, occupé uniquement de ses propres pensées, qui ne pense à rien de ce qu’on lui dit. Un Auteur, un Géometre, sont souvent abstraits. Une nouvelle passion rend abstrait : ainsi nos propres idées nous rendent abstraits ; au lieu que distrait se dit de celui qui à l’occasion de quelque nouvel objet extérieur, détourne son attention de la personne à qui il l’avoit d’abord donnée, ou à qui il devoit la donner : on se sert assez indifféremment de ces deux mots en plusieurs rencontres. Abstrait marque une plus grande inattention que distrait. Il semble qu’abstrait marque une inattention habituelle, & distrait en marque une passagere à l’occasion de quelque objet extérieur.
On dit d’une pensée qu’elle est abstraite, quand elle est trop recherchée, & qu’elle demande trop d’attention pour être entendue. On dit aussi des raisonnemens abstraits, trop subtils. Les Sciences abstraites, ce sont celles qui ont pour objet des êtres abstraits ; tels sont la Métaphysique & les Mathématiques. (F)
* Abstraits en Logique. Les termes abstraits, ce sont ceux qui ne marquent aucun objet qui existe hors de notre imagination. Ainsi beauté, laideur, sont des termes abstraits. Il y a des objets qui nous plaisent ; & que nous trouvons beaux ; il y en a d’autres au contraire qui nous affectent d’une maniere désagréable, & que nous appellons laids. Mais il n’y a hors de nous aucun être qui soit la laideur ou la beauté. Voyez Abstraction.
Abstrait est aussi un mot en usage dans les Mathématiques : en ce sens l’on dit que les nombres abstraits sont des assemblages d’unités considérées en elles-mêmes, & qui ne sont point appliqués à signifier des collections de choses particulieres & déterminées. Par exemple 3 est un nombre abstrait, tant qu’il n’est pas appliqué à quelque chose : mais si on dit 3 piés par exemple, 3 devient un nombre concret. Voyez Concret. Voyez aussi Nombre.
Les Mathématiques abstraites ou pures sont celles qui traitent de la grandeur ou de la quantité considérée absolument & en général, sans se borner à aucune espece de grandeur particuliere. Voyez Mathématiques.
Telles sont la Géométrie & l’Arithmétique. Voyez Arithmétique & Géométrie.
En ce sens les Mathématiques abstraites sont opposées aux Mathématiques mixtes, dans lesquelles on applique aux objets sensibles les propriétés simples & abstraites, & les rapports des quantités dont on traite dans les Mathématiques abstraites : telles sont l’Hydrostatique, l’Optique, l’Astronomie, &c. (E)
* ABSUS : c’est, dit-on, une herbe d’Egypte dont la fleur est blanche & tire sur le jaune pâle, la hauteur environ de quatre doigts, & la feuille semblable à celle du triolet. Il ne paroît pas à la description de cette plante, qu’elle soit fort connue des Naturalistes, & nous n’en faisons mention que pour n’omettre que le moins de choses qu’il est possible.
* ABSYRTIDES, s. f. îles de la Dalmatie ou de l’ancienne Liburnie, situées à l’entrée du golfe de Venise, & qu’on prétend ainsi nommées d’Absyrte, frere de Médée, qu’elle y tua, & dont elle sema les membres sur la route pour rallentir la poursuite de son pere.
* ABUCCO ou ABOCCO ou ABOCCHI, s. m. poids dont on se sert dans le Royaume de Pegu ; il équivaut à une livre & demie & quatre onces & demie, poids leger de Venise.
ABUKESB, s. m. monnoie ; c’est le nom que les Arabes donnent au daller d’Hollande qui a cours chez eux. Le lion qu’elle porte est si mal représenté, qu’il est facile de le prendre pour un chien, & c’est ce qui l’a fait nommer par les Arabes abukesb, qui signifie chien dans leur langue. Voyez Daller. (G)
ABUS, s. m. se dit de l’usage irrégulier de quelque chose ; ou bien c’est l’introduction d’une chose contraire à l’intention que l’on avoit eue en l’admettant.
Ce mot est composé des mots ab, de, & usus, usage.
Les réformes & les visites sont faites pour corriger les abus qui se glissent insensiblement dans la discipline ou dans les mœurs. Constantin le Grand, en introduisant dans l’Eglise l’abondance des biens, y jetta les fondemens de cette multitude d’abus, sous lesquels ont gémi les siecles suivans.
Abus de soi-même. C’est une expression dont se servent quelques Auteurs modernes, pour dénoter le crime de la pollution volontaire. Voyez Pollution.
En Grammaire, appliquer un mot abusivement, ou dans un sens abusif, c’est en faire une mauvaise application, ou en pervertir le vrai sens. Voyez Catachrese. (H)
Abus, dans un sens plus particulier, signifie toute contravention commise par les Juges & Supérieurs ecclésiastiques en matiere de Droit.
Il résulte principalement de l’entreprise de la Jurisdiction ecclésiastique sur la laïque ; de la contravention à la police générale de l’Eglise ou du Royaume, réglée par les Canons, les Ordonnances ou les Arrêts.
La maniere de se pourvoir contre les jugemens & autres actes de supériorité des Ecclésiastiques, même de la Cour de Rome, où l’on prétend qu’il y a abus, est de recourir à l’autorité séculiere des Parlemens par appel, qu’on nomme pour le distinguer de l’appel simple, appel comme d’abus.
Le terme d’abus a été employé presque dans tous les tems dans le sens du présent article : mais l’appel comme d’abus n’a pas été d’usage dans tous les tems. On employa plusieurs moyens contre les entreprises des Ecclésiastiques & de la Cour de Rome avant de venir à ce dernier remede.
D’abord on imagina d’appeller du saint-Siége au saint Siége Apostolique, comme fit le Roi Philippe Auguste lors de l’interdit fulminé contre son Royaume par Innocent III.
Dans la suite on appella au futur Concile, ou au Pape mieux avisé, ad Papam melius consultum, comme fit Philippe-le-Bel qui appella ad Concilium de proximo congregandum, & ad futurum verum, & legitimum Pontificem, & ad illum seu ad illos ad quem vel ad quos de jure fuerit provocandum.
On joignit ensuite aux appels au futur Concile les protestations de poursuivre au Conseil du Roi, ou dans son Parlement, la cassation des actes prétendus abusifs, pour raison d’infraction des Canons & de la Pragmatique-Sanction. Voyez Pragmatique-Sanction.
Cette derniere voie acheminoit de bien près aux appels comme d’abus.
Enfin l’appel comme d’abus commença d’être en usage sous Philippe de Valois, & fut interjetté solemnellement par Pierre de Cugnieres, Avocat Général, & a toujours été pratiqué depuis au grand avantage de la Jurisdiction royale & des Sujets du Roi.
Le Ministere public est la véritable partie dans l’appel comme d’abus ; de sorte que les parties privées, l’appel une fois interjetté, ne peuvent plus transiger sur leurs intérêts au préjudice de l’appel, si ce n’est de l’avis & du consentement du Ministere public, lequel peut rejetter l’expédient proposé s’il y reconnoît quelque collusion préjudiciable au bien public.
Les Parlemens prononcent sur l’appel comme d’abus par ces mots il y a, ou il n’y a abus.
Quelquefois les Parlemens convertissent l’appel comme d’abus en appel simple ; c’est-à-dire, renvoient les parties pour se pourvoir par devant le Juge ecclésiastique, supérieur à celui d’où étoit émané le jugement prétendu abusif : quelquefois ils le convertissent aussi en simple opposition.
L’exception tirée du laps des tems n’est point admissible en matiere d’abus, ni celle tirée de la désertion d’appel en l’appel d’icelui.
L’appel comme d’abus est suspensif, si ce n’est en matiere de discipline ecclésiastique & de correction réguliere où il n’est que dévolutif.
Il se plaide en la Grand’Chambre, & se doit juger à l’audience, si ce n’est que le tiers des Juges soit d’avis d’appointer.
Les appels comme d’abus ne se relevent qu’au Parlement, & les lettres de relief se prennent au petit sceau, l’appellant y annexant la consultation de trois Avocats : mais ce n’est pas par forme de gradation de l’inférieur au supérieur que les appels comme d’abus sont portés aux Parlemens, mais comme aux dépositaires de la puissance & de la protection royale.
L’appellant qui succombe à l’appel comme d’abus est condamné, outre les dépens, à une amende de 75 livres. (H)
Abus. Ce mot est consacré en Médecine aux choses que les Médecins ont nommées non-naturelles, dont le bon usage conserve & fortifie la santé, pendant que l’abus ou le mauvais usage qu’on en fait, la détruit & produit des maladies. Voyez Non-naturelles. (N)
ABUSIF, adject. terme de Droit, qui se dit singulierement des entreprises, procédures & jugemens des ecclésiastiques, où il y a eu abus, c’est-à-dire infraction des Canons ou des Ordonnances. Voyez plus haut le mot Abus.
ABUSIVEMENT, adv. terme de Droit. Voyez ci-devant Abusif & Abus
La Cour en prononçant sur l’appel comme d’abus interjetté du jugement d’une Cour ecclésiastique dit, s’il y a lieu à l’infirmer, qu’il a été mal, nullement & abusivement jugé. (H)
* ABUYO ou ABUYA, s. une des isles Philippines aux Indes Orientales. Long. 138. lat. 10.
* ABUTER, v. a. Aux quilles, avant que de commencer le jeu, chaque joüeur en prend une & la jette vers la boule placée à une distance convenue entre les joüeurs ; voilà ce qu’on appelle abuter. Celui qui abute le mieux, c’est-à-dire dont la quille est la plus proche de la boule, gagne l’avantage de joüer le premier.
ABUTILON, s. m. herbe à fleur d’une seule feuille semblable en quelque maniere à une cloche fort ouverte & découpée ; il sort du fond un tuyau pyramidal chargé le plus souvent d’étamines. Le pistil tient au calice, & est fiché comme un clou dans la partie inférieure de la fleur & dans le tuyau. Ce pistil devient un fruit en forme de chapiteau ; il est composé de plusieurs petites gaînes assemblées autour d’un axe. Chaque gaîne ou capsule est reçûe dans une strie de l’axe : ces capsules s’ouvrent en deux parties, & renferment des semences qui ont ordinairement la forme d’un rein. Tournefort Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
* On se sert de ses feuilles & de ses semences. Ses feuilles appliquées sur les ulceres les nettoient. Ses semences provoquent les urines & chassent le gravier. Elle est diurétique & vulnéraire.
* ABYDE ou ABYDOS, sub. Ville maritime de Phrygie vis-à-vis de Sestos. Xercès joignit ces deux endroits éloignés l’un de l’autre de sept stades, par le pont qu’il jetta sur l’Hellespont.
* Abyde, (Géog. anc.) ville d’Egypte.
* ABYLA, s. nom de montagne & de ville dans le détroit de Gibraltar sur la côte de Mauritanie. C’étoit une des Colonnes d’Hercule, & Calpé sur la côte d’Espagne étoit l’autre. On croit que la ville d’Abyla des anciens est le Septa des modernes ; & la montagne, celle que nous appellons montagne des Singes.
* Abyla ou Abylene, s. ville de la Colæsynie au Midi de la Chalcide, entre l’Antiliban & le fleuve Abana, & capitale d’une petite contrée qui portoit son nom.
* ACACALIS, s. m. arbrisseau qui porte une fleur en papillon, & un fruit couvert d’une cosse. Voyez Ray. Hist. Plant. On lit dans Dioscoride que l’acacalis est le fruit d’un arbrisseau qui croît en Egypte ; que sa graine est semblable à celle du tamarin, & que son infusion mêlée avec le collyre ordinaire éclaircit la vûe. Ray ajoûte que c’est à Constantinople un remede populaire pour les maladies des yeux. Malgré toutes ces autorités, je ne regarde pas le sort de l’acacalis comme bien décidé ; sa description est trop vague, & il faut attendre ce que les progrès de l’Histoire Naturelle nous apprendront là-dessus.
* ACACIA, s. m. c’est une sorte de petit sac ou de rouleau long & étroit. Les Consuls & les Empereurs depuis Anastase l’ont à la main dans les médailles. Les uns veulent que ce soit un mouchoir plié qui servoit à l’Empereur pour donner le signal de faire commencer les jeux : les autres, que ce soit des mémoires qui lui ont été présentés ; c’est l’avis de M. du Cange : plusieurs, que ce soit un petit sac de terre que les Empereurs tenoient d’une main, & la croix de l’autre, ce qui les avertissoit que tout grands qu’ils étoient, ils seroient un jour réduits en poussiere. Le sac ou acacia fut substitué à la nappe, mappa, que l’Empereur, le Consul, ou tout autre Magistrat avoit à la main, & dont il se servoit pour donner le signal dans les jeux.
Acacia, s. m. en latin pseudo-acacia, arbre à fleurs légumineuses & à feuilles rangées ordinairement par paires sur une côte. Le pistil sort du calice & est enveloppé par une membrane frangée : il devient dans la suite une gousse applatie qui s’ouvre en deux parties, & qui renferme des semences en forme de rein. Les feuilles de l’acacia sont rangées par paires sur une côte qui est terminée par une seule feuille. Tournefort Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Acacia, acacia nostras, s. m. est celui que l’on appelle l’acacia commun de l’Amérique ; il ne s’éleve pas bien haut ; son bois est dur & raboteux, son feuillage long & petit donnant peu d’ombrage ; ses branches sont pleines de piquans. Il est propre à planter des berceaux, croît fort vite, & produit dans le printems d’agréables fleurs à bouquets. Cet arbre est sujet à verser ; & l’usage où l’on est de l’étêter, le difforme beaucoup : il donne de la graine. (K)
* Acacia, suc épaissi, gommeux, de couleur brune à l’extérieur, & noirâtre ou roussâtre, ou jaunâtre en-dedans ; d’une consistance ferme, dure, s’amollissant dans la bouche ; d’un goût austere astringent, non desagréable, formé en petites masses arrondies du poids de quatre, six, huit onces, & enveloppé de vessies minces. On nous l’apporte d’Egypte par Marseille ; on estime le meilleur celui qui est récent, pur, net, & qui se dissout facilement dans l’eau. On tire ce suc des gousses non mûres d’un arbre-appellé acacia folio scorpioidis leguminosæ, C. B. P. C’est un grand arbre & fort branchu, dont les racines se partagent en plusieurs rameaux, & se répandent de tous côtes, & dont le tronc a souvent un pié d’épaisseur, & égale ou même surpasse en hauteur les autres especes d’acacia. Il est ferme, garni de branches & armé d’épines ; ses feuilles sont menues, conjuguées, & rangées par paires sur une côte de deux pouces de longueur : elles sont d’un verd obscur, longues de trois lignes, & larges à peine d’une ligne. Les fleurs viennent aux aisselles des côtes qui portent les feuilles, & sont ramassées en un bouton sphérique porté sur un pédicule d’un pouce de longueur ; elles sont d’une couleur d’or & sans odeur, d’une seule piece en maniere de tuyau grêle, renflé à son extrémité supérieure, & découpé en 5 quartiers. Elles sont garnies d’une grande quantité d’étamines & d’un pistil qui devient une gousse semblable en quelque façon à celle du lupin, longue de cinq pouces plus ou moins, brune ou roussâtre, applatie, épaisse d’une ligne dans son milieu, plus mince sur les bords, large inégalement, & si fort retrécie par intervalle, qu’elle représente 4. 5. 6. 8. 10. & même un plus grand nombre de pastilles applaties liées ensemble par un fil. Elles ont un demi-pouce dans leur plus grande largeur, & la partie intermédiaire a à peine une ligne : l’intérieur de chacune est rempli par une semence ovalaire, applatie, dure, mais moins que celle du cormier ; de couleur de chataigne, marquée d’une ligne tout autour comme les graines de tamarins, & enveloppée d’un mucilage gommeux, & un peu astringent ou acide, & roussâtre. Cet arbre est commun au grand Caire ; on arrose d’eau les gousses qui ne sont pas encore mûres ; on les broie : on en exprime le suc qu’on fait bouillir pour l’épaissir, puis on le met en petites masses. Ce suc analysé donne une portion médiocre de sel acide, très-peu de sel alkali, beaucoup de terre astringente, & beaucoup d’huile ou subtile ou grossiere. On le place entre les astringens incrassans & repercussifs : il affermit l’estomac, fait cesser le vomissement, arrête les hémorrhagies & les flux de ventre : on le donne depuis 3 β. jusqu’à 3 j. sous la forme de poudre ou de bol, ou dans une liqueur convenable. Les Egyptiens en ordonnent tous les matins à ceux qui crachent le sang la quantité d’un gros dissoûte dans une liqueur, &c.
Le suc d’acacia entre dans la thériaque, le mithridat, les trochisques de Karabé, & l’onguent styptique de Charas.
Il sert aux Corroyeurs du grand Caire pour noircir leurs peaux. A cet acacia vrai on substitue souvent l’acacia nostras. Voyez Acacia nostras. Le suc de l’acacia nostras est plus acide que l’autre ; on le tire des cerises de cette plante récentes & non mûres : il a à peu près les mêmes propriétés que l’acacia vrai.
* ACACIENS, adj. pris subst. Ariens ainsi nommés d’Acace de Cæsarée leur chef.
* ACADÉMICIEN, ACADÉMISTE, sub. m. Ils sont l’un & l’autre membres d’une société qui porte le nom d’Académie, & qui a pour objet des matieres qui demandent de l’étude & de l’application. Mais les Sciences & le bel esprit font le partage de l’Académicien, & les exercices du corps occupent l’Académiste. L’un travaille & compose des ouvrages pour l’avancement & la perfection de la littérature : l’autre acquiert des talens purement personnels.
Académiciens, s. m. pl. secte de Philosophes qui suivoient la doctrine de Socrate & de Platon, quant à l’incertitude de nos connoissances & à l’incompréhensibilité du vrai. Académicien pris en ce sens revient à peu près à ce que l’on appelle Platonicien, n’y ayant d’autre différence entr’eux que le tems où ils ont commencé. Ceux des anciens qui embrassoient le système de Platon étoient appellés Academici, Académiciens ; au lieu que ceux qui ont suivi les mêmes opinions depuis le rétablissement des Lettres, ont pris le nom de Platoniciens.
On peut dire que Socrate & Platon qui ont jetté les premiers fondemens de l’Académie, n’ont pas été à beaucoup près si loin que ceux qui leur ont succédé, je veux dire Arcésilas, Carnéade, Clitomaque, & Philon. Socrate, il est vrai, fit profession de ne rien savoir : mais son doute ne tomboit que sur la Physique, qu’il avoit d’abord cultivée diligemment, & qu’il reconnut enfin surpasser la portée de l’esprit humain. Si quelquefois il parloit le langage des Sceptiques, c’étoit par ironie ou par modestie, pour rabattre la vanité des Sophistes qui se vantoient sottement de ne rien ignorer, & d’être toûjours prêts à discourir sur toutes sortes de matieres.
Platon, pere & instituteur de l’Académie, instruit par Socrate dans l’art de douter, & s’avoüant son sectateur, s’en tint à sa maniere de traiter les matieres, & entreprit de combattre tous les Philosophes qui l’avoient précédé. Mais en recommandant à ses disciples de se défier & de douter de tout, il avoit moins en vûe de les laisser flotans & suspendus entre la vérité & l’erreur, que de les mettre en garde contre ces décisions téméraires & précipitées, pour lesquelles on a tant de penchant dans la jeunesse, & de les faire parvenir à une disposition d’esprit qui leur fît prendre des mesures contre ces surprises de l’erreur, en examinant tout, libres de tout préjugé.
Arcésilas entreprit de réformer l’ancienne Académie, & de former la nouvelle. On dit qu’il imita Pyrrhon, & qu’il conversa avec Timon ; desorte que ayant enrichi l’époque, c’est-à-dire, l’art de douter de Pyrrhon, de l’élégante érudition de Platon ; & l’ayant armée de la dialectique de Diodore, Ariston le comparoit à la chimere, & lui appliquoit plaisamment les vers où Homere dit qu’elle étoit lion pardevant, dragon par-derriere, & chevre par le milieu. Ainsi Arcésilas étoit, selon lui, Platon par-devant, Pyrrhon par-derriere, & Diodore par le milieu. C’est pourquoi quelques-uns le rangent au nombre des Sceptiques, & Sextus Empiricus soûtient qu’il y a fort peu de différence entre sa secte, qui est la Sceptique, & celle d’Arcésilas, qui est celle de la nouvelle Académie. Voyez les Scepticiens.
En effet il enseignoit que nous ne savons pas même si nous ne savons rien ; que la nature ne nous a donné aucune regle de vérité ; que les sens & l’entendement humain ne peuvent rien comprendre de vrai ; que dans toutes les choses il se trouve des raisons opposées d’une force égale : en un mot que tout est enveloppé de ténebres, & que par conséquent il faut toûjours suspendre son consentement. Sa doctrine ne fut pas fort goûtée, parce qu’il sembloit vouloir éteindre toute la lumiere de la Science, jetter des ténebres dans l’esprit, & renverser les fondemens de la Philosophie. Lacyde fut le seul qui défendit la doctrine d’Arcésilas : il la transmit à Evandre, qui fut son disciple avec beaucoup d’autres. Evandre la fit passer à Hégesime, & Hégesime à Carnéade.
Carnéade ne suivoit pas pourtant en toutes choses la doctrine d’Arcésilas, quoiqu’il en retînt le gros & le sommaire. Cela le fit passer pour auteur d’une nouvelle Académie, qui fut nommée la troisieme. Sans jamais découvrir son sentiment, il combattoit avec beaucoup d’esprit & d’éloquence toutes les opinions qu’on lui proposoit ; car il avoit apporté à l’étude de la Philosophie une force d’esprit admirable, une mémoire fidele, une grande facilité de parler, & un long usage de la Dialectique. Ce fut lui qui fit le premier connoître à Rome le pouvoir de l’éloquence & le mérite de la Philosophie ; & cette florissante jeunesse qui méditoit dès lors l’Empire de l’Univers, attirée par la nouveauté & l’excellence de cette noble science, dont Carnéade faisoit profession, le suivoit avec tant d’empressement, que Caton, homme d’ailleurs d’un excellent jugement, mais rude, un peu sauvage, & manquant de cette politesse que donnent les Lettres, eut pour suspect ce nouveau genre d’érudition, avec lequel on persuadoit tout ce qu’on vouloit. Caton fut d’avis dans le Senat qu’on accordât à Carnéade, & aux Députés qui l’accompagnoient, ce qu’ils demandoient, & qu’on les renvoyât promptement & avec honneur.
Avec une éloquence aussi séduisante il renversoit tout ce qu’il avoit entrepris de combattre, confondoit la raison par la raison même, & demeuroit invincible dans les opinions qu’il soûtenoit. Les Stoïciens, gens contentieux & subtils dans la dispute, avec qui Carnéade & Arcésilas avoient de fréquentes contestations, avoient peine à se débarrasser des piéges qu’il leur tendoit. Aussi disoient-ils, pour diminuer sa réputation, qu’il n’apportoit rien contre eux dont il fût l’inventeur, & qu’il avoit pris ses objections dans les Livres du Stoïcien Chrysippe. Carnéade, cet homme à qui Ciceron accorde l’art de tout réfuter, n’en usoit point dans cette occasion qui sembloit si fort intéresser son amour propre : il convenoit modestement que, sans le secours de Chrysippe, il n’auroit rien fait, & qu’il combattoit Chrysippe par les propres armes de Chrysippe.
Les correctifs que Carnéade apporta à la doctrine d’Arcésilas sont très-légers. Il est aisé de concilier ce que disoit Arcésilas, qu’il ne se trouve aucune vérité dans les choses, avec ce que disoit Carnéade, qu’il ne nioit point qu’il n’y eût quelque vérité dans les choses, mais que nous n’avons aucune regle pour les discerner. Car il y a deux sortes de vérité ; l’une que l’on appelle vérité d’existence : l’autre que l’on appelle vérité de jugement. Or il est clair que ces deux propositions d’Arcésilas & de Carnéade regardent la vérité de jugement : mais la vérité de jugement est du nombre des choses relatives qui doivent être considérées comme ayant rapport à notre esprit ; donc quand Arcésilas a dit qu’il n’y a rien de vrai dans les choses, il a voulu dire qu’il n’y a rien dans les choses que l’esprit humain puisse connoître avec certitude ; & c’est cela même que Carnéade soûtenoit.
Arcésilas disoit que rien ne pouvoit être compris, & que toutes choses étoient obscures. Carnéade convenoit que rien ne pouvoit être compris : mais il ne convenoit pas pour cela que toutes choses fussent obscures, parce que les choses probables auxquelles il vouloit que l’homme s’attachât, n’étoient pas obscures, selon lui. Mais encore qu’il se trouve en cela quelque différence d’expression, il ne s’y trouve aucune différence en effet ; car Arcésilas ne soûtenoit que les choses sont obscures, qu’autant qu’elles ne peuvent être comprises : mais il ne les dépouilloit pas de toute vraissemblance ou de toute probabilité : c’étoit-là le sentiment de Carnéade ; car quand il disoit que les choses n’étoient pas assez obscures pour qu’on ne pût pas discerner celles qui doivent être préférées dans l’usage de la vie ; il ne prétendoit pas qu’elles fussent assez claires pour pouvoir être comprises.
Il s’ensuit de-là qu’il n’y avoit pas même de diversité de sentimens entr’eux, lorsque Carnéade permettoit à l’homme sage d’avoir des opinions, & peut-être même de donner quelquefois son consentement ; & lorsqu’Arcésilas défendoit l’un & l’autre, Carnéade prétendoit seulement que l’homme sage devoit se servir des choses probables dans le commun usage de la vie, & sans lesquelles on ne pourroit vivre, mais non pas dans la conduite de l’esprit, & dans la recherche de la vérité, d’où seulement Arcésilas bannissoit l’opinion & le consentement. Tous leurs différends ne consistoient donc que dans les expressions, mais non dans les choses mêmes.
Philon disciple de Clitomaque, qui l’avoit été de Carnéade, pour s’être éloigné sur de certains points des sentimens de ce même Carnéade, mérita d’être appellé avec Charmide, fondateur de la quatrieme Académie. Il disoit que les choses sont compréhensibles par elles-mêmes, mais que nous ne pouvons pas toutefois les comprendre.
Antiochus fut fondateur de la cinquieme Académie : il avoit été disciple de Philon pendant plusieurs années, & il avoit soûtenu la doctrine de Carnéade : mais enfin il quitta le parti de ses Maîtres sur ses vieux jours, & fit repasser dans l’Académie les dogmes des Stoïciens qu’il attribuoit à Platon, soûtenant que la doctrine des Stoïciens n’étoit point nouvelle, mais qu’elle étoit une réformation de l’ancienne Académie. Cette cinquieme Académie ne fut donc autre chose qu’une association de l’ancienne Académie & de la Philosophie des Stoïciens ; ou plûtôt c’étoit la Philosophie même des Stoïciens, avec l’habit & les livrées de l’ancienne Académie, je veux dire, de celle qui fut florissante sous Platon & sous Arcésilas.
Quelques-uns ont prétendu qu’il n’y a eu qu’une seule Académie ; car, disent-ils, comme plusieurs branches qui sortent d’un même tronc, & qui s’étendent vers différens côtés, ne sont pas des arbres différens ; de même toutes ces sectes, qui sont serties de ce tronc unique de la doctrine de Socrate, que l’homme ne sait rien, quoique partagées en diverses écoles, ne sont cependant qu’une seule Académie. Mais si nous y regardons de plus près, il se trouve une telle différence entre l’ancienne & la nouvelle Académie, qu’il faut nécessairement reconnoître deux Académies : l’ancienne, qui fut celle de Socrate & d’Antiochus ; & la nouvelle, qui fut celle d’Arcésilas, de Carnéade, & de Philon. La premiere fut dogmatique dans quelques points ; on y respecta du moins les premiers principes & quelques vérités morales, au lieu que la nouvelle se rapprocha presque entierement du Scepticisme. Voyez Scepticiens. (X)
ACADÉMIE, s. f. C’étoit dans l’antiquité un jardin ou une maison située dans le Céramique, un des fauxbourgs d’Athenes, à un mille ou environ de la ville, où Platon & ses sectateurs tenoient des assemblées pour converser sur des matieres philosophiques. Cet endroit donna le nom à la secte des Académiciens. Voyez Académicien.
Le nom d’Académie fut donné à cette maison, à cause d’un nommé Académus ou Écadémus, citoyen d’Athenes, qui en étoit possesseur & y tenoit une espece de gymnase. Il vivoit du tems de Thésée. Quelques-uns ont rapporté le nom d’Académie à Cadmus qui introduisit le premier en Grece les Lettres & les Sciences des Phéniciens : mais cette étymologie est d’autant moins fondée, que les Lettres dans cette premiere origine furent trop foiblement cultivées pour qu’il y eût de nombreuses assemblées de Savans.
Cimon embellit l’Académie & la décora de fontaines, d’arbres, & de promenades, en faveur des Philosophes & des Gens de Lettres qui s’y rassembloient pour conférer ensemble & pour y disputer sur différentes matieres, &c. C’étoit aussi l’endroit où l’on enterroit les Hommes illustres qui avoient rendu de grands services à la République. Mais dans le siége d’Athenes, Sylla ne respecta point cet asyle des beaux arts ; & des arbres qui formoient les promenades, il fit faire des machines de guerre pour battre la Place.
Cicéron eut aussi une maison de campagne ou un lieu de retraite près de Pouzole, auquel il donna le nom d’Académie, où il avoit coûtume de converser avec ses amis qui avoient du goût pour les entretiens philosophiques. Ce fut-là qu’il composa ses Questions académiques, & ses Livres sur la nature des Dieux.
Le mot Académie signifie aussi une secte de Philosophes qui soûtenoient que la vérité est inaccessible à notre intelligence, que toutes les connoissances sont incertaines, & que le sage doit toûjours douter & suspendre son jugement, sans jamais rien affirmer ou nier positivement. En ce sens l’Académie est la même chose que la secte des Académiciens. Voyez Académicien.
On compte ordinairement trois Académies ou trois sortes d’Académiciens, quoiqu’il y en ait cinq suivant quelques-uns. L’ancienne Académie est celle dont Platon étoit le chef. Voyez Platonisme.
Arcésilas, un de ses successeurs, en introduisant quelques changemens ou quelques altérations dans la Philosophie de cette secte, fonda ce que l’on appelle la seconde Académie. C’est cet Arcésilas principalement qui introduisit dans l’Académie le doute effectif & universel.
On attribue à Lacyde, ou plûtôt à Carnéade, l’établissement de la troisieme, appellée aussi la nouvelle Académie, qui reconnoissant que non seulement il y avoit beaucoup de choses probables, mais aussi qu’il y en avoit de vraies & d’autres fausses, avoüoit néanmoins que l’esprit humain ne pouvoit pas bien les discerner.
Quelques-autres en ajoûtent une quatrieme fondée par Philon, & une cinquieme par Antiochus, appellée l’Antiochéene, qui tempéra l’ancienne Académie avec les opinions du Stoïcisme. Voyez Stoicisme.
L’ancienne Académie doutoit de tout ; elle porta même si loin ce principe, qu’elle douta si elle devoit douter. Ceux qui la composoient eurent toûjours pour maxime de n’être jamais certains, ou de n’avoir jamais l’esprit satisfait sur la vérité des choses, de ne jamais rien affirmer, ou de ne jamais rien nier, soit que les choses leur parussent vraies, soit qu’elles leur parussent fausses. En effet, ils soûtenoient une acatalepsie absolue, c’est-à-dire, que quant à la nature ou à l’essence des choses, l’on devoit se retrancher sur un doute absolu. Voyez Acatalepsie.
Les sectateurs de la nouvelle Académie étoient un peu plus traitables : ils reconnoissoient plusieurs choses comme vraies, mais sans y adhérer avec une entiere assûrance. Ils avoient éprouvé que le commerce de la vie & de la société étoit incompatible avec le doute universel & absolu qu’affectoit l’ancienne Académie. Cependant il est visible que ces choses mêmes dont ils convenoient, ils les regardoient plûtôt comme probables que comme certaines & déterminément vraies : par ces correctifs, ils comptoient du moins éviter les reproches d’absurdité faits à l’ancienne Académie. Voyez Doute. Voyez aussi les Questions Académiques de Cicéron, où cet Auteur réfute avec autant de force que de netteté les sentimens des Philosophes de son tems, qui prenoient le titre de sectateurs de l’ancienne & de la nouvelle Académie. Voyez aussi l’article Académicien, où les sentimens des différentes Académies sont exposés & comparés. (G)
Académie, (Hist. Litt.) parmi les Modernes, se prend ordinairement pour une Société ou Compagnie de Gens de Lettres, établie pour la culture & l’avancement des Arts ou des Sciences.
Quelques Auteurs confondent Académie avec Université : mais quoique ce soit la même chose en Latin, c’en sont deux bien différentes en François. Une Université est proprement un Corps composé de Gens Gradués en plusieurs Facultés ; de Professeurs qui enseignent dans les écoles publiques, de Précepteurs ou Maîtres particuliers, & d’Etudians qui prennent leurs leçons & aspirent à parvenir aux mêmes degrés. Au lieu qu’une Académie n’est point destinée à enseigner ou professer aucun Art, quel qu’il soit, mais à en procurer la perfection. Elle n’est point composée d’Ecoliers que de plus habiles qu’eux instruisent, mais de personnes d’une capacité distinguée, qui se communiquent leurs lumieres & se font part de leurs découvertes pour leur avantage mutuel. Voyez Université.
La premiere Académie dont nous lisions l’institution, est celle que Charlemagne établit par le conseil d’Alcuin : elle étoit composée des plus beaux génies de la Cour, & l’Empereur lui-même en étoit un des membres. Dans les Conférences académiques chacun devoit rendre compte des anciens Auteurs qu’il avoit lûs ; & même chaque Académicien prenoit le nom de celui de ces anciens Auteurs pour lequel il avoit le plus de goût, ou de quelque personnage célebre de l’Antiquité. Alcuin entre autres, des Lettres duquel nous avons appris ces particularités, prit celui de Flaccus qui étoit le surnom d’Horace ; un jeune Seigneur, qui se nommoit Angilbert, prit celui d’Homere ; Adelard, Evêque de Corbie, se nomma Augustin ; Riculphe, Archévêque de Mayence, Dametas, & le Roi lui-même, David.
Ce fait peut servir à relever la méprise de quelques Ecrivains modernes, qui rapportent que ce fut pour se conformer au goût général des Savans de son siecle, qui étoient grands admirateurs des noms Romains, qu’Alcuin prit celui de Flaccus Albinus.
La plûpart des Nations ont à present des Académies, sans en excepter la Russie : mais l’Italie l’emporte sur toutes les autres au moins par le nombre des siennes. Il y en a peu en Angleterre ; la principale, & celle qui mérite le plus d’attention, est celle que nous connoissons sous le nom de Société Royale. Voyez ce qui la concerne à l’article Société Royale. Voyez aussi Société d’Edimbourg.
Il y a cependant encore une Académie Royale de Musique & une de Peinture, établies par Lettres Patentes, & gouvernées chacune par des Directeurs particuliers.
En France nous avons des Académies florissantes en tout genre, plusieurs à Paris, & quelques-unes dans des villes de Province ; en voici les principales.
Académie Françoise. Cette Académie a été instituée en 1635 par le Cardinal de Richelieu pour perfectionner la Langue ; & en général elle a pour objet toutes les matieres de Grammaire, de Poësie & d’Éloquence. La forme en est fort simple, & n’a jamais reçu de changement : les membres sont au nombre de quarante, tous égaux ; les grands Seigneurs & les gens titrés n’y sont admis qu’à titre d’Hommes de Lettres ; & le Cardinal de Richelieu qui connoissoit le prix des talens, a voulu que l’esprit y marchât sur la même ligne à côté du rang & de la noblesse. Cette Académie a un Directeur & un Chancelier, qui se tirent au sort tous les trois mois, & un Secrétaire qui est perpétuel. Elle a compté & compte encore aujourd’hui parmi ses membres plusieurs personnes illustres par leur esprit & par leurs ouvrages. Elle s’assemble trois fois la semaine au vieux Louvre pendant toute l’année, le Lundi, le Jeudi & le Samedi. Il n’y a point d’autres assemblées publiques que celles où l’on reçoit quelqu’Académicien nouveau, & une assemblée qui se fait tous les ans le jour de la S. Loüis, & où l’Académie distribue les prix d’Eloquence & de Poësie, qui consistent chacun en une médaille d’or. Elle a publié un Dictionnaire de la Langue françoise qui a déja eu trois éditions, & qu’elle travaille sans cesse à perfectionner. La devise de cette Académie est à l’Immortalité.
Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. A quelque degré de gloire que la France fût parvenue, sous les regnes de Henri IV. & de Louis XIII. & particulierement après la paix des Pyrenées & le mariage de Louis XIV. elle n’avoit pas encore été assez occupée du soin de laisser à la postérité une juste idée de sa grandeur. Les actions les plus brillantes, les évenemens les plus mémorables étoient oubliés, ou couroient risque de l’être, parce qu’on négligeoit d’en consacrer le souvenir sur le marbre & sur le bronze. Enfin on voyoit peu de monumens publics, & ce petit nombre même avoit été jusques-là comme abandonné à l’ignorance ou à l’indiscrétion de quelques particuliers.
Le Roi regarda donc comme un avantage pour la Nation l’établissement d’une Académie qui travailleroit aux Inscriptions, aux Devises, aux Médailles, & qui répandroit sur tous ces monumens le bon goût & la noble simplicité qui en font le véritable prix. Il forma d’abord cette Compagnie d’un petit nombre d’Hommes choisis dans l’Académie Françoise, qui commencerent à s’assembler dans la Bibliotheque de M. Colbert, par qui ils recevoient les ordres de Sa Majesté.
Le jour des assemblées n’étoit pas déterminé : mais le plus ordinaire au moins pendant l’hyver étoit le Mercredi, parce que c’étoit le plus commode pour M. Colbert, qui s’y trouvoit presque toûjours. En été ce Ministre menoit souvent les Académiciens à Sceaux, pour donner plus d’agrément à leurs conférences, & pour en joüir lui-même avec plus de tranquillité.
On compte entre les premiers travaux de l’Académie le sujet des desseins des tapisseries du Roi, tels qu’on les voit dans le Recueil d’estampes & de descriptions qui en a été publié.
M. Perrault fut ensuite chargé en particulier de la description du Carrousel ; & après qu’elle eut passé par l’examen de la Compagnie, elle fut pareillement imprimée avec les figures.
On commença à faire des devises pour les jettons du Trésor royal, des Parties casuelles, des Bâtimens & de la Marine ; & tous les ans on en donna de nouvelles.
Enfin on entreprit de faire par médailles une Histoire suivie des principaux évenemens du regne du Roi. La matiere étoit ample & magnifique, mais il étoit difficile de la bien mettre en œuvre. Les Anciens, dont il nous reste tant de médailles, n’ont laissé sur cela d’autres regles que leurs médailles mêmes, qui jusques-là n’avoient gueres été recherchées que pour la beauté du travail, & étudiées que par rapport aux connoissances de l’Histoire. Les Modernes qui en avoient frappé un grand nombre depuis deux siecles, s’étoient peu embarrassés des regles ; ils n’en avoient suivi, ils n’en avoient prescrit aucune ; & dans les recueils de ce genre, à peine trouvoit-on trois ou quatre pieces où le génie eût heureusement suppléé à la méthode.
La difficulté de pousser tout d’un coup à sa perfection un art si négligé, ne fut pas la seule raison qui empécha l’Académie de beaucoup avancer sous M. Colbert l’Histoire du Roi par médailles : il appliquoit à mille autres usages les lumieres de la Compagnie. Il y faisoit continuellement inventer ou examiner les différens desseins de Peinture & de Sculpture dont on vouloit embellir Versailles. On y régloit le choix & l’ordre des statues : on y consultoit ce que l’on proposoit pour la décoration des appartemens & pour l’embellissement des jardins.
On avoit encore chargé l’Académie de faire graver le plan & les principales vûes des Maisons royales, & d’y joindre des descriptions. Les gravures en étoient fort avancées, & les descriptions étoient presque faites quand M. Colbert mourut.
On devoit de même faire graver le plan & les vûes des Places conquises, & y joindre une histoire de chaque ville & de chaque conquête : mais ce projet n’eut pas plus de suite que le précédent.
M. Colbert mourut en 1683, & M. de Louvois lui succéda dans la Charge de Surintendant des Bâtimens. Ce Ministre ayant sû que M. l’Abbé Tallemant étoit chargé des inscriptions qu’on devoit mettre au-dessous des tableaux de la gallerie de Versailles, & qu’on vouloit faire paroître au retour du Roi, le manda aussi-tôt à Fontainebleau où la Cour étoit alors, pour être exactement informé de l’état des choses. M. l’Abbé Tallemant lui en rendit compte, & lui montra les inscriptions qui étoient toutes prêtes. M. de Louvois le présenta ensuite au Roi, qui lui donna lui-même l’ordre d’aller incessamment faire placer ces inscriptions à Versailles. Elles ont depuis éprouvé divers changemens.
M. de Louvois tint d’abord quelques assemblées de la petite Académie chez lui à Paris & à Meudon. Nous l’appellons petite Académie, parce qu’elle n’étoit composée que de quatre personnes, M. Charpentier, M. Quinault, M. l’Abbé Tallemant, & M. Felibien le pere. Il les fixa ensuite au Louvre, dans le même lieu où se tiennent celles de l’Académie Françoise ; & il régla qu’on s’assembleroit deux fois la semaine, le Lundi & le Samedi, depuis cinq heures du soir jusqu’à sept.
M. de la Chapelle, devenu Contrôleur des bâtimens après M. Perrault, fut chargé de se trouver aux assemblées pour en écrire les délibérations, & devint par-là le cinquieme Académicien. Bien-tôt M. de Louvois y en ajoûta deux autres, dont il jugea le secours très-nécessaire à l’Académie pour l’Histoire du Roi : c’étoient M. Racine & M. Despreaux. Il en vint enfin un huitieme, M. Rainssant, homme versé dans la connoissance des Médailles, & qui étoit Directeur du cabinet des Antiques de Sa Majesté.
Sous ce nouveau Ministere on reprit avec ardeur le travail des Médailles de l’Histoire du Roi, qui avoit été interrompu dans les dernieres années de M. Colbert. On en frappa plusieurs de différentes grandeurs, mais presque toutes plus grandes que celles qu’on a frappées depuis : ce qui fait qu’on les appelle encore aujourd’hui au balancier Médailles de la grande Histoire. La Compagnie commença aussi à faire des devises pour les jettons de l’Ordinaire & de l’Extraordinaire des Guerres, sur lesquelles elle n’avoit pas encore été consultée.
Le Roi donna en 1691 le département des Académies à M. de Pontchartrain, alors Contrôleur Général & Secrétaire d’Etat ayant le département de la Maison du Roi, & depuis Chancelier de France. M. de Ponchartrain né avec beaucoup d’esprit, & avec un goût pour les Lettres qu’aucun Emploi n’avoit pû rallentir, donna une attention particuliere à la petite Académie, qui devint plus connue sous le nom d’Académie Royale des Inscriptions & Médailles. Il voulut que M. le Comte de Pontchartrain, son fils, se rendît souvent aux assemblées, qu’il fixa exprès au Mardi & au Samedi. Enfin il donna l’inspection de cette Compagnie à M. l’Abbé Bignon, son neveu, dont le génie & les talens étoient déja fort célebrés.
Les places vacantes par la mort de M. Rainssant & de M. Quinault furent remplies par M. de Tourreil & par M. l’Abbé Renaudot.
Toutes les médailles dont on avoit arrêté les desseins du tems de M. de Louvois, celles mêmes qui étoient déja faites & gravées, furent revûes avec soin : on en réforma plusieurs ; on en ajoûta un grand nombre ; on les réduisit toutes à une même grandeur ; & l’Histoire du Roi fut ainsi poussée jusqu’à l’avenement de Monseigneur le Duc d’Anjou, son petit-fils, à la couronne d’Espagne.
Au mois de Septembre 1699 M. de Pontchartrain sut nommé Chancelier. M. le Comte de Pontchartrain, son fils, entra en plein exercice de sa Charge de Secrétaire d’Etat, dont il avoit depuis long-tems la survivance, & les Académiciens demeurerent dans son département. Mais M. le Chancelier qui avoit extrèmement à cœur l’Histoire du Roi par médailles, qui l’avoit conduite & avancée par ses propres lumieres, retint l’inspection de cet ouvrage ; & eut l’honneur de présenter à Sa Majesté les premieres suites que l’on en frappa, & les premiers exemplaires du Livre qui en contenoit les desseins & les explications.
L’établissement de l’Académie des Inscriptions ne pouvoit manquer de trouver place dans ce Livre fameux, où aucune des autres Académies n’a été oubliée. La médaille qu’on y trouve sur ce sujet représente Mercure assis, & écrivant avec un style à l’antique sur une table d’airain. Il s’appuie du bras gauche sur une urne pleine de médailles ; il y en a d’autres qui sont rangées dans un carton à ses pieds. La légendé Rerum gestarum sides, & l’exergue Academin Regia Inscriptionum & Numismatum, instituta M. DC. LXIII. signifient que l’Académie Royale des Inscriptions & Médailles, établie en 1663, doit rendre aux siecles à venir un témoignage fidele des grandes actions.
Presque toute l’occupation de l’Académie sembloit devoir finir avec le Livre des Médailles ; car les nouveaux évenemens & les devises des jettons de chaque année n’étoient pas un objet capable d’occuper huit ou neuf personnes qui s’assembloient deux fois la semaine. M. l’Abbé Bignon prévit les inconvéniens de cette inaction, & crut pouvoir en tirer avantage. Mais pour ne trouver aucun obstacle dans la Compagnie, il cacha une partie de ses vûes aux Académiciens, que la moindre idée de changement auroit peut-être allarmés : il se contenta de leur représenter que l’Histoire par médailles étant achevée, déja même sous la presse, & que le Roi ayant été fort content de ce qu’il en avoit vû, on ne pouvoit choisir un tems plus convenable pour demander à Sa Majesté qu’il lui plût assûrer l’état de l’Academie par quelqu’acte public émané de l’autorité royale. Il leur cita l’exemple de l’Académie des Sciences, qui fondée peu de tems après celle des Inscriptions par ordre du Roi, & n’ayant de même aucun titre authentique pour son établissement, venoit d’obtenir de Sa Majesté (comme nous allons le dire tout à l’heure) un Réglement signé de sa main, qui fixoit le tems & le lieu de ses assemblées, qui déterminoit ses occupations, qui assûroit la continuation des pensions, &c.
La proposition de M. l’Abbé Bignon fut extrèmement goûtée : on dressa aussi-tôt un Mémoire. M. le Chancelier & M. le Comte de Pontchartrain furent suppliés de l’appuyer auprès du Roi ; & ils le firent d’autant plus volontiers, que parfaitement instruits du plan de M. l’Abbé Bignon, ils n’avoient pas moins de zèle pour l’avancement des Lettres. Le Roi accorda la demande de l’Académie, & peu de jours après elle reçut un Réglement nouveau daté du 16 Juillet 1701.
En vertu de ce premier Réglement l’Académie reçoit des ordres du Roi par un des Secrétaires d’Etat, le même qui les donne à l’Académie des Sciences. L’Académie est composée de dix Honoraires, dix Pensionnaires, dix Associés, ayant tous voix délibérative, & outre cela de dix Eleves, attachés chacun à un des Académiciens pensionnaires. Elle s’assemble le Mardi & le Vendredi de chaque semaine dans une des sales du Louvre, & tient par an deux assemblées publiques, l’une après la S. Martin, l’autre après la quinzaine de Pâques. Ses vacances sont les mêmes que celles de l’Académie des Sciences. Voyez Académie des Sciences. Elle a quelques Associés correspondans, soit regnicoles, soit étrangers. Elle a aussi, comme l’Académie des Sciences, un Président, un vice-Président, pris parmi les Honoraires, un Directeur & un sous-Directeur pris parmi les Pensionnaires.
La classe des Eleves a été supprimée depuis & réunie à celle des Associés. Le Secrétaire & le Thrésorier sont perpétuels, & l’Académie depuis son renouvellement en 1701 a donné au public plusieurs volumes qui sont le fruit de ses travaux. Ces volumes contiennent, outre les Mémoires qu’on a jugé à propos d’imprimer en entier, plusieurs autres dont l’extrait est donné par le Secrétaire, & les éloges des Académiciens morts. M. le Président Durey de Noinville a fondé depuis environ 15 ans un prix littéraire que l’Académie distribue chaque année. C’est une médaille d’or de la valeur de 400 livres.
La devise de cette Académie est vetat mori. Tout cet art. est tiré de l’Hist. de l’Acad. des Belles-Lettres, T. I.
Académie Royale des Sciences. Cette Académie fut établie en 1666 par les soins de M. Colbert : Louis XIV. après la paix des Pyrenées desirant faire fleurir les Sciences, les Lettres & les Arts dans son Royaume, chargea M. Colbert de former une Société d’homme choisis & savans en différens genres de littérature & de science, qui s’assemblant sous la protection du Roi, se communiquassent réciproquement leurs lumieres & leurs progrés. M. Colbert après avoir conféré à ce sujet avec les savans les plus illustres & les plus éclairés, résolut de former une société de personnes versées dans la Physique & dans les Mathématiques, auxquels seroient jointes d’autres personnes savantes dans l’Histoire & dans les matieres d’érudition, & d’autres enfin uniquement occupées de ce qu’on appelle plus particulierement Belles-Lettres, c’est-à-dire, de la Grammaire, de l’Eloquence & de la Poësie. Il fut réglé que les Géometres & les Physiciens de cette Société s’assembleroient séparément le Mercredi, & tous ensemble le Samedi, dans une salle de la Bibliotheque du Roi, où étoient les livres de Physique & de Mathématique : que les savans dans l’Histoire s’assembleroient le Lundi & le Jeudi dans la sale des livres d’Histoire : qu’enfin la classe des Belles-Lettres s’assembleroit les Mardi & Vendredi, & que le premier Jeudi de chaque mois toutes ces différentes classes se réuniroient ensemble, & se feroient mutuellement par leurs Secrétaires un rapport de tout ce qu’elles auroient fait durant le mois précédent.
Cette Académie ne put pas subsister long-tems sur ce pié : 1°. les matieres d’Histoire profane étant liées souvent à celles d’Histoire ecclésiastique, & par-là à la Théologie & à la discipline de l’Eglise, on craignit que les Académiciens ne se hasardassent à entamer des questions délicates, & dont la décision auroit pû produire du trouble : 2°. ceux qui formoient la classe des Belles-Lettres étant presque tous de l’Académie Françoise, dont l’objet étoit le même que celui de cette classe, & conservant beaucoup d’attachement pour leur ancienne Académie, prierent M. Colbert de vouloir bien répandre sur cette Académie les mêmes bienfaits qu’il paroissoit vouloir répandre sur la nouvelle, & lui firent sentir l’inutilité de deux Académies différentes appliquées au même objet, & composées presque des mêmes personnes. M. Colbert goûta leurs raisons, & peu de tems après le Chancelier Seguier étant mort, le Roi prit sous sa protection l’Académie Françoise, à laquelle la classe de Belles-Lettres dont nous venons de parler fut censée réunie, ainsi que la petite Académie d’Histoire : de sorte qu’il ne resta plus que la seule classe des Physiciens & des Mathématiciens. Celle des Mathématiciens étoit composée de Messieurs Carcavy, Huyghens, de Roberval, Frenicle, Auzout, Picard & Buot. Les Physiciens étoient Messieurs de la Chambre, Médecin ordinaire du Roi ; Perrault, très savant dans la Physique & dans l’Histoire naturelle ; Duclos & Bourdelin, Chimistes, Pequet & Gayen, Anatomistes ; Marchand, Botaniste, & Duhamel, Secrétaire.
Ces Savans, & ceux qui après leur mort les remplacerent, publierent plusieurs excellens ouvrages pour l’avancement des Sciences ; & en 1692 & 1693, l’Académie publia, mois par mois, les pieces fugitives qui avoient été lûes dans les assemblées de ces années, & qui étant trop courtes pour être publiées à part, étoient indépendantes des ouvrages auxquels chacun des membres travailloit. Plusieurs de ces premiers Académiciens recevoient du Roi des pensions considérables, & l’égalité étoit parfaite entr’eux comme dans l’Académie Françoise.
En 1699 M. l’Abbé Bignon qui avoit long-tems présidé à l’Académie des Sciences, s’imagina la rendre plus utile en lui donnant une forme nouvelle. Il en parla à M. le Chancelier de Pontchartrain, son oncle, & au commencement de cette année l’Académie reçut un nouveau reglement qui en changea totalement la forme. Voici les articles principaux de ce réglement.
1°. L’Académie des Sciences demeure immédiatement sous la protection du Roi, & reçoit ses ordres par celui des Secrétaires d’Etat à qui il plaît à Sa Majesté de les donner.
2°. L’Académie est composée de dix Honoraires, l’un desquels sera Président, de vingt Pensionnaires, trois Géometres, trois Astronomes, trois Méchaniciens, trois Anatomistes, trois Botanistes, trois Chimistes, un Trésorier & un Secrétaire, l’un & l’autre perpétuels ; vingt Associés, savoir, douze regnicoles, dont deux Géometres, deux Astronomes, &c. & huit étrangers, & vingt Eleves, dont chacun est attaché à un des Académiciens pensionnaires.
3°. Les seuls Académiciens honoraires & pensionnaires doivent avoir voix délibérative quand il s’agira d’élections ou d’affaires concernant l’Académie : quand il s’agira de Sciences, les Associés y seront joints ; mais les Eleves ne parleront que lorsque le Président les y invitera.
4°. Les Honoraires doivent être regnicoles & recommendables par leur intelligence dans les Mathématiques & dans la Physique ; & les Réguliers ou Religieux peuvent être admis dans cette seule classe.
5°. Nul ne peut être Pensionnaire, s’il n’est connu par quelqu’ouvrage considérable, ou quelque découverte importante ou quelque cours éclatant.
6°. Chaque Académicien pensionnaire est obligé de déclarer au commencement de l’année l’ouvrage auquel il compte travailler. Indépendamment de ce travail, les Académiciens pensionnaires & associés sont obligés d’apporter à tour de rôle quelques observations ou mémoires. Les assemblées se tiennent le Mercredi & le Samedi de chaque semaine, & en cas de fête, l’assemblée se tient le jour précédent.
7°. Il y a deux de ces assemblées qui sont publiques par an ; savoir, la premiere après la S. Martin, & la seconde, après la quinzaine de Pâques.
8°. L’Académie vaque pendant la quinzaine de Pâques, la semaine de la Pentecôte, & depuis Noël jusqu’aux Rois, & outre cela depuis la Nativité jusqu’à la S. Martin.
En 1716, M. le Duc d’Orléans, Régent du Royaume, jugea à propos de faire quelques changemens à ce Reglement sous l’autorité du Roi. La classe des Éleves fut supprimée. Elle parut avoir des inconvéniens, en ce qu’elle mettoit entre les Académiciens trop d’inégalité, & qu’elle pouvoit par-là occasionner entr’eux, comme l’expérience l’avoit prouvé, quelques termes d’aigreur ou de mépris. Ce nom seul rebutoit les personnes d’un certain mérite, & leur fermoit l’entrée de l’Académie. Cependant « le nom d’Eleve, dit M. de Fontenelle, Eloge de M. Amontons, n’emporte parmi nous aucune différence de mérite ; il signifie seulement moins d’ancienneté & une espece de survivance ». D’ailleurs quelques Académiciens étoient morts à soixante & dix ans avec le titre d’Eleves, ce qui paroissoit mal sonnant. On supprima donc la classe des Eleves, à la place de laquelle on créa douze Adjoints, & on leur accorda ainsi qu’aux Associés, voix délibérative en matiere de Science. On fixa à douze le nombre des Honoraires. On créa aussi une classe d’Associés libres au nombre de six. Ces Associés ne sont attachés à aucun genre de science, ni obligés à aucun travail ; & il fut décidé que les Réguliers ne pourroient à l’avenir entrer que dans cette classe.
L’Académie a chaque année un Président & un Vice-Président, un Directeur & un Sous-Directeur nommés par le Roi. Les deux premiers sont toûjours pris parmi les Honoraires, & les deux autres parmi les Pensionnaires. Les seuls Pensionnaires ont des jettons pour leur droit de présence aux assemblées. Aucun Académicien ne peut prendre ce titre au frontispice d’un livre, si l’Ouvrage qu’il publie n’est approuvé par l’Académie.
Depuis ce renouvellement en 1699, l’Académie a été fort exacte à publier chaque année un volume contenant les travaux de ses Membres ou les Mémoires qu’ils ont composés & lûs à l’Académie durant cette année. A la tête de ce volume est l’Histoire de l’Académie ou l’extrait des Mémoires, & en général de tout ce qui a été lû & dit dans l’Académie ; & à la fin de l’Histoire sont les éloges des Académiciens morts durant l’année.
La place de Secrétaire a été remplie par M. de Fontenelle depuis 1699 jusqu’en 1740. M. de Mairan lui a succédé pendant les années 1741, 1742, 1743 ; & elle est à présent occupée par M. de Fouchy.
Feu M. Rouillé de Meslay, Conseiller au Parlement de Paris, a fondé deux prix, l’un de 2500 livres, l’autre de 2000 livres, que l’Académie distribue alternativement tous les ans. Les sujets du premier prix doivent regarder l’Astronomie physique. Les sujets du second prix doivent regarder la Navigation & le Commerce.
L’Académie a pour devise Invenit & perficit.
Les assemblées qui se tenoient autrefois dans la Bibliotheque du Roi, se tiennent depuis 1699 dans une très-belle Salle du vieux Louvre.
En 1713 le Roi confirma par des Lettres Patentes l’établissement des deux Académies des Sciences & des Belles-Lettres.
Outre ces Académies de la Capitale, il y en a dans les Provinces une grande quantité d’autres ; à Toulouse, l’Académie des Jeux Floraux, composée de quarante personnes, la plus ancienne du Royaume, & outre cela une Académie des Sciences & des Belles-Lettres ; à Montpellier, la Société Royale des Sciences, qui depuis 1706 ne fait qu’un même corps avec l’Académie des Sciences de Paris ; à Bordeaux, à Soissons, à Marseille, à Lyon, à Pau, à Montauban, à Angers, à Amiens, à Villefranche, &c. Le nombre de ces Académies augmente de jour en jour ; & sans examiner ici s’il est utile de multiplier si fort de pareils établissemens, on ne peut au moins disconvenir qu’ils ne contribuent en partie à répandre & à conserver le goût des Lettres & de l’Etude. Dans les villes mêmes où il n’y a point d’Académies, il se forme des Sociétés littéraires qui ont à peu près les mêmes exercices.
Passons maintenant aux principales Académies étrangeres.
Outre la Société Royale de Londres dont nous avons déjà dit que nous parlerions ailleurs, une des Académies les plus célebres aujourd’hui est celle de Berlin appellée l’Académie Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse. Frederic I. Roi de Prusse l’établit en 1700, & en fit M. Leibnitz Président. Les plus grands noms illustrerent sa liste dès le commencement. Elle donna en 1710 un premier volume sous le titre de Miscellanea Berolinensia ; & quoique le successeur de Frederic I. protégeât peu les Lettres, elle ne laissa pas de publier de nouveaux volumes en 1723, 1727, 1734, 1737, & 1740. Enfin Frederic II. aujourd’hui Roi de Prusse, monta sur le Thrône. Ce Prince, l’admiration de toute l’Europe par ses qualités guerrieres & pacifiques, par son goût pour les Sciences, par son esprit & par ses talens, jugea à propos de redonner à cette Académie une nouvelle vigueur. Il y appella des Etrangers très-distingués, encouragea les meilleurs Sujets par des récompenses, & en 1743 parut un nouveau volume des Miscellanea Berolinensia, où l’on s’apperçoit bien des nouvelles forces que l’Académie avoit déjà prises. Ce Prince ne jugea pas à propos de s’en tenir là. Il crut que l’Académie Royale des Sciences de Prusse qui avoit été jusqu’alors presque toûjours présidée par un Ministre ou Grand Seigneur, le seroit encore mieux par un homme de Lettres ; il fit à l’Académie des Sciences de Paris l’honneur de choisir parmi ses Membres le Président qu’il vouloit donner à la sienne. Ce fut M. de Maupertuis si avantageusement connu dans toute l’Europe, que les graces du Roi de Prusse engagerent à aller s’établir à Berlin. Le Roi donna en même temps un nouveau Reglement à l’Académie, & voulut bien prendre le titre de Protecteur. Cette Académie a publié depuis 1743 trois volumes françois dans le même goût à peu près que l’Histoire de l’Académie des Sciences de Paris, avec cette différence, que dans le second de ces volumes, les extraits des Mémoires sont supprimés, & le seront apparemment dans tous ceux qui suivront. Ces volumes seront suivis chaque année d’un autre. Elle a deux assemblées publiques ; l’une en Janvier le jour de la naissance du Roi aujourd’hui régnant ; l’autre à la fin de Mai, le jour de l’avenement du Roi au Throne. Dans cette derniere assemblée on distribue un prix consistant en une Médaille d’or de la valeur de 50 ducats, c’est-à-dire, un peu plus de 500 livres. Le sujet de ce prix est successivement de Physique, de Mathématique, de Métaphysique, & d’Erudition. Car cette Académie a cela de particulier, qu’elle embrasse jusqu’à la Métaphysique, la Logique & la Morale, qui ne font l’objet d’aucune autre Académie. Elle a une classe particuliere occupée de ces matieres, & qu’on appelle la classe de Philosophie spéculative.
Académie Impériale de Petersbourg. Le Czar Pierre I. dit le Grand, par qui la Russie a enfin secoüé se joug de la barbarie qui y régnoit depuis tant de siecles, ayant fait un voyage en France en 1717, & ayant reconnu par lui-même l’utilité des Académies, résolut d’en établir une dans sa Capitale. Il avoit déjà pris toutes les mesures nécessaires pour cela lorsque la mort l’enleva au commencement de 1725. La Czarine Catherine qui lui succéda, pleinement instruite de ses vûes, travailla sur le même plan, & forma en peu de tems une des plus célebres Académies de l’Europe composée de tout ce qu’il y avoit alors de plus illustre parmi les étrangers, dont quelques-uns même vinrent s’établir à Petersbourg. Cette Académie qui embrasse les Sciences & les Belles-Lettres, a publié déjà dix volumes de Mémoires depuis 1726. Ces Mémoires sont écrits en latin, & sont surtout très recommandables par la partie mathématique qui contient un grand nombre d’excellentes pieces. La plûpart des Etrangers qui composoient cette Académie étant morts ou s’étant retirés, elle se trouvoit au commencement du regne de la Czarine Elizabeth dans une espece de langueur, lorsque M. le Comte Rasomowski en fut nommé Président, heureusement pour elle. Il lui a fait donner un nouveau reglement, & paroît n’avoir rien négligé pour la rétablir dans son ancienne splendeur. L’Académie de Petersbourg a cette devise modeste, Paulatim.
Il y a à Bologne une Académie qu’on appelle l’Institut. Voyez Institut.
L’Académie Royale d’Espagne est établie à Madrid pour cultiver la langue Castillane : elle est formée sur le modele de l’Academie Françoise. Le plan en fut donné par le Duc d’Escalone, & approuvé en 1714. par le Roi, qui s’en déclara le protecteur. Elle consiste en 24. Académiciens, y compris un Directeur & un Secrétaire.
Elle a pour dévise un creuset sur le feu, & le mot de la dévise, est : Limpia, fija, y da esplendor.
L’Académie des Curieux de la Nature, en Allemagne, avoit été fondée d’abord en 1652. par M. Bausch, Médecin ; & l’Empereur Léopold la prit sous sa protection en 1670, je ne sai s’il fit autre chose pour elle.
L’Italie seule a plus d’Académies que tout le reste du monde ensemble. Il n’y a pas une ville considérable où il n’y ait assez de Savans pour former une Académie, & qui n’en forment une en effet. Jarckius nous en a donné une Histoire abregée, imprimée à Leipsic en 1725.
Jarckius n’a écrit l’Histoire que des Académies du Piémont, de Ferrare, & de Milan ; il en compte vingt-cinq dans cette derniere ville toute seule : il nous a seulement donné la liste des autres, qui montent à cinq cens cinquante. La plûpart ont des noms tout-à-fait singuliers & bisarres.
Les Académiciens de Bologne, par exemple, se nomment Abbandonati, Ansiosi, Ociosi, Arcadi, Confusi, Difettuosi, Dubbiosi, Impatienti, Inabili, Indifferenti, Indomiti, Inquieti, Instabili, Della notte piacere, Sitienti, Sonnolenti, Torbidi, Vespertini : ceux de Genes, Accordati, Sopiti, Resuegliati : ceux de Gubio, Addormentati : ceux de Venise, Acuti, Allettati, Discordanti, Disjiunti, Disingannati, Dodonei, Filadelfici, Incruscabili, Instaucabili : ceux de Rimini, Adagiati, Eutrapeli : ceux de Pavie, Affidati, Della chiave : ceux de Fermo, Raffrontati : ceux de Molise, Agitati : ceux de Florence, Alterati, Humidi, Fursurati, Della Crusca, Del Cimento, Insocati : ceux de Cremone, Animosi : ceux de Naples, Arditi, Infernati, Intronati, Lunatici, Secreti, Sirenes, Sicuri, Volanti : ceux d’Ancone, Argonauti, Caliginosi : ceux d’Urbin, Assorditi : ceux de Perouse, Atomi, Eccentrici, Insensati, Insipidi, Unisoni : ceux de Tarente, Audaci : ceux de Macerata, Catenati, Imperfetti ; d’autres Chimarici : ceux de Sienne, Cortesi, Gioviati, Trapassati : ceux de Rome, Delfici, Humoristi, Lincei, Fantastici, Illuminati, Incitati, Indispositi, Infecondi, Melancholici, Negletti, Notti Vaticane, Notturni, Ombrosi, Pellegrini, Sterili, Vigilanti : ceux de Padoue, Delii, Immaturi, Orditi : ceux de Drepano, Difficili : ceux de Bresse, Dispersi, Erranti : ceux de Modene, Dissonanti : ceux de Reccanati, Disuguali : ceux de Syracuse, Ebrii : ceux de Milan, Eliconii, Faticosi, Fenici, Incerti, Nascosti : ceux de Candie, Extravaganti : ceux de Pezzaro, Eterocliti : ceux de Comacchio, Fluttuanti : ceux d’Arezzo, Forzati : ceux de Turin, Fulminales : ceux de Reggio, Fumosi, Muti : ceux de Cortone, Humorosi : ceux de Bari, Incogniti : ceux de Rossano, Incuriosi : ceux de Brada, Innominati, Pigri : ceux d’Acis, Intricati : ceux de Mantoue, Invaghiti : ceux d’Agrigente, Mutabili, Offuscati : de Verone, Olympici, Unanii : de Viterbe, Ostinati : d’autres, Vagabondi.
On appelle aussi quelquefois Académie, en Angleterre, des especes d’Ecoles ou de Colléges où la jeunesse est formée aux Sciences & aux Arts libéraux par des Maîtres particuliers. La plûpart des Ministres non-conformistes ont été élevés dans ces sortes d’Académies privées, ne s’accommodant pas de l’éducation qu’on donne aux jeunes gens dans les Universités. (O)
Académie de Chirurgie. Voyez Chirurgie.
Académie de Peinture, est une Ecole publique où les Peintres vont dessiner ou peindre, & les Sculpteurs modeler d’après un homme nud, qu’on appelle modele.
L’Académie Royale de Peinture & de Sculpture de Paris doit sa naissance aux démêlés qui survinrent entre les Maîtres Peintres & Sculpteurs de Paris, & les Peintres privilégiés du Roi, que la Communauté des Peintres voulut inquiéter. Le Brun, Sarazin, Corneille, & les autres Peintres du Roi, formerent le projet d’une Académie particuliere ; & ayant présenté à ce sujet une requête au Conseil, ils obtinrent un Arrêt tel qu’ils le demandoient, daté du 20 Janvier 1648. Ils s’assemblerent dabord chez Charmois, Secrétaire du Maréchal Schomberg, qui dressa les premiers Statuts de l’Académie.
L’Académie tint ensuite ses Conférences dans la maison d’un des amis de Charmois, située proche S. Eustache. De-là elle passa dans l’Hôtel de Clisson, rue des Deux-boules, où elle continua ses exercices jusqu’en 1653, que les Académiciens se transporterent dans la rue des Déchargeurs. En 1654 & au commencement de 1655, elle obtint du Cardinal Mazarin un Brevet & des Lettres-Patentes, qui furent enregistrées au Parlement, & en reconnoissance elle choisit ce Cardinal pour son protecteur, & le Chancelier pour Vice-protecteur.
Il est à remarquer que le Chancelier, dès la premiere institution de l’Académie, en avoit été nommé protecteur : mais pour faire sa cour au Cardinal Mazarin, il se démit de cette dignité, & se contenta de celle de Vice-protecteur.
En 1656 Sarazin céda à l’Académie un logement qu’il avoit dans les Galeries du Louvre : mais en 1661 elle fut obligée d’en sortir ; & M. de Ratabon, Surintendant des Bâtimens, la transféra au Palais Royal, où elle demeura trente & un ans. Enfin le Roi lui donna un logement au vieux Louvre.
Enfin, en 1663 elle obtint, par le crédit de M. Colbert, 4000 livres de pension.
Cette Académie est composée d’un Protecteur, d’un Vice-protecteur, d’un Directeur, d’un Chancelier, de quatre Recteurs, d’Adjoints aux Recteurs, d’un Thrésorier, & de quatorze Professeurs, dont un pour l’Anatomie, & un autre pour la Géométrie ; de plusieurs Adjoints & Conseillers, d’un Secrétaire & Historiographe, & de deux Huissiers. Les premiers Membres de cette Académie furent le Brun, Errard, Bourdon, la Hire, Sarrazin, Corneille, Beaubrun, le Sueur, d’Egmont, Vanobstat, Guillin, &c.
L’Académie de Paris tient tous les jours après midi pendant deux heures école publique, où les Peintres vont dessiner ou peindre, & les Sculpteurs modeler d’après un homme nud ; il y a douze Professeurs qui tiennent l’école chacun pendant un mois, & douze Adjoints pour les suppléer en cas de besoin ; le Professeur en exercice met l’homme nud, qu’on nomme modele, dans la position qu’il juge convenable, & le pose en deux attitudes différentes par chaque semaine, c’est ce qu’on appelle poser le modele ; dans l’une des semaines il pose deux modeles ensemble, c’est ce qu’on appelle poser le groupe ; les desseins, peintures & modeles faits d’après cet homme s’appellent académies, ainsi que les copies faites d’après ces académies. On ne se sert point dans les Ecoles publiques de femme pour modele, comme plusieurs le croient. On distribue tous les trois mois aux Eleves trois prix de Dessein, & tous les ans deux prix de Peinture & deux de Sculpture ; ceux qui gagnent les prix de Peinture & de Sculpture sont envoyés à Rome aux dépens du Roi pour y étudier & s’y perfectionner.
Outre l’Académie Royale, il y a encore à Paris deux autres Ecoles ou Académies de Peinture, dont une à la Manufacture Royale des Gobelins.
Cette Ecole est dirigée par les Artistes à qui le Roi donne un logement dans l’Hôtel Royal des Gobelins, & qui sont pour l’ordinaire Membres de l’Académie Royale.
L’autre est l’Académie de S. Luc, entretenue par la Communauté des Maîtres Peintres & Sculpteurs ; elle fut établie par le Prevôt de Paris, le 12 Août 1391. Charles VII. lui accorda en 1430 plusieurs priviléges, qui furent confirmés en 1584 par Henri III. En 1613 la Communauté des Sculpteurs fut unie à celle des Peintres. Cette Communauté occupe, proche S. Denys de la Chartre, une maison, où elle tient son Bureau, & une Académie publique administrée ainsi que l’Académie Royale, & où l’on distribue tous les ans trois prix de Dessein aux Eleves. (R)
Académie d’Architecture, c’est une Compagnie de savans Architectes, établie à Paris par M. Colbert, Ministre d’Etat, en 1671, sous la direction du Surintendant des Bâtimens.
* Paracelse disoit qu’il n’avoit étudié ni à Paris, ni à Rome, ni à Toulouse, ni dans aucune Académie : qu’il n’avoit d’autre Université que la Nature, dans laquelle Dieu fait éclater sa sagesse, sa puissance & sa gloire, d’une maniere sensible pour ceux qui l’étudient. C’est à la nature, ajoûtoit-il, que je dois ce que je sai, & ce qu’il y a de vrai dans mes écrits.
Académie, se dit aussi des écoles & séminaires des Juifs, où leurs Rabins & Docteurs instruisent la jeunesse de leur nation dans la langue Hébraïque, lui expliquant le Talmud & les secrets de la cabale. Les Juifs ont toûjours eu de ces Académies depuis leur retour de Babylone. Celle de cette derniere ville, & celle de Tibériade entre autres, ont été fort célebres. (G)
Académie Royale de Musique. V. Opéra.
Académie, se dit encore dans un sens particulier des lieux où la jeunesse apprend à monter à cheval, & quelquefois à faire des armes, à danser, à voltiger, &c. Voyez Exercice.
C’est ce que Vitruve appelle Ephebeum ; quelques autres Auteurs anciens Gymnasium, & les Modernes Académie à monter à cheval, ou Académie militaire. Voyez Gymnase & Gymnastique.
Le Duc de Newcastle, Seigneur Anglois, rapporte que l’Art de monter à cheval a passé d’Italie en Angleterre ; que la premiere Académie de cette espece fut établie à Naples par Fréderic Grison, lequel, ajoûte-t-il, a écrit le premier sur ce sujet en vrai cavalier & en grand maître. Henri VIII. continue le même Auteur, fit venir en Angleterre deux Italiens, disciples de ce Grison, qui y en formerent en peu de tems beaucoup d’autres. Le plus grand maître, selon lui, que l’Italie ait produit en ce genre, a été Pignatelli de Naples. La Broue apprit sous lui pendant cinq ans, Pluvinel neuf, & Saint-Antoine un plus long tems ; & ces trois François rendirent les Ecuyers communs en France, où l’on n’en avoit jamais vû que d’Italiens.
L’emplacement dans lequel les jeunes gens montent à cheval s’appelle manége. Il y a pour l’ordinaire un pilier au milieu, autour duquel il s’en trouve plusieurs autres, rangés deux à deux sur les côtés. V. Manege, Pilier, &c. (V)
Les exercices de l’Académie dont nous parlons, ont été toûjours recommandés pour conserver la santé & donner de la force. C’est dans ce dessein que l’on envoie les jeunes gens à l’Académie, ils en deviennent plus agiles & plus forts. Les exercices que l’on fait à l’Académie sont d’un grand secours dans les maladies chroniques ; ils sont d’une grande utilité à ceux qui sont menacés d’obstructions, aux vaporeux, aux mélancholiques, &c. Voyez Exercice. (N)
ACADÉMISTE, s. m. Pensionnaire ou externe qui apprend à monter à cheval dans une Académie.
On trouve dans l’Ordonnance de Louis XIV, du 3 Mai 1654, un article relatif aux Académistes.
« Défendons aux Gentilshommes des Académies de chasser ou faire chasser avec fusils, arquebuses, alliés, filets, collets, poches, tonnelles, traineaux, ni autres engins de chasse, mener, ni faire mener chiens courans, lévriers, épagneuls, barbets & oiseaux ; enjoignant aux Ecuyers desdites Académies d’y tenir la main, à peine d’en répondre en leur propre & privé nom, sur peine de 300 livres d’amende, confiscation d’armes, chevaux, chiens, oiseaux & engins à chasser ».
* ACADIE ou ACCADIE, s. s. presqu’isle de l’Amérique septentrionale, située sur les frontieres orientales du Canada, entre Terre-Neuve & la nouvelle Angleterre. Long. 311-316. lat. 43-46.
Le commerce en est resté aux Anglois : il est commode pour la traite des pelleteries & la pêche des morues. Les terres y sont fertiles en blé, pois, fruits, légumes. On y trouve de gros & de menus bestiaux. Quelques endroits de l’Acadie donnent de très-belles mâtures. L’isle aux loups, ainsi appellée parce qu’ils y sont communs, donne beaucoup de leurs peaux & de leur huile. Cette huile, quand elle est fraîche, est douce & bonne à manger : on la brûle aussi. Les pelleteries sont le castor, la loutre, le loup-cervier, le renard, l’élan, le loup marin, & autres que fournit le Canada. Voyez Canada. Quant à la pêche de la morue, elle se fait dans les rivieres & les petits golfes-Le Cap-Breton s’est formé des débris de la Colonie Françoise qui étoit à l’Acadie.
* ACAJA, s. arbre de la hauteur du tilleul, dont l’écorce est raboteuse, & la couleur cendrée comme celle du sureau, les feuilles sont douces au toucher, opposées les unes aux autres, longues de quatre travers de doigt, larges d’un & demi ou deux, de grandeurs inégales, brillantes, & traversées dans leur longueur d’une grosse côte. Il porte des fleurs jaunâtres, auxquelles succedent des prunes semblables aux nôtres, tant par la figure que par la grosseur, jaunes, acides, à noyau ligneux, facile à casser, & contenant une amande d’un blanc jaunâtre. Son bois est rouge & leger comme le liége.
Sa feuille est astringente ; on arrose le rôti avec leur suc. On emploie ses prunes, qu’on appelle prunes de monbain, contre la fievre & la dyssenterie, & on en exprime du vin. On confit ses boutons. V. dans le Dict. de Medecine le reste des propriétés admirables de l’Acaja, rapportées sur la bonne foi de Ray.
ACAJOU, s. m. c’est un genre de plante à fleur monopétale en forme d’entonnoir & bien découpée : il sort du calice un pistil entouré de filamens & attaché à la partie postérieure de la fleur comme un clou : ce calice devient dans la suite un fruit mou, au bout duquel il se trouve une capsule en forme de rein, qui renferme aussi une semence de la même forme. Tournefort, Inst. rei herb. append. V. Plante. (I)
* L’acajou croît dans tous les endroits du Malabar, quoiqu’il soit originaire du Brésil. On en tire une boisson qui enivre comme le vin. L’amande de sa noix se mange rôtie ; quant à l’écorce elle est tellement acrimonieuse qu’elle excorie les gencives quand on met la noix entre ses dents.
Les Teinturiers emploient l’huile qu’on en tire dans la teinture du noir. Les habitans du Brésil comptent leur âge par ces noix : ils en serrent une chaque année.
* ACALIPSE. Nicander & Gellius font mention, l’un d’un poisson, l’autre d’un oiseau de ce nom. Le poisson de ce nom dont parle Athenée, a la chair tendre & facile à digérer. Voilà encore un de ces êtres dont il faut attendre la connoissance des progrès de l’Histoire naturelle, & dont on n’a que le nom ; comme si l’on n’avoit pas déja que trop de noms vuides de sens dans les Sciences, les Arts, &c.
* ACAMBOU, s. Royaume d’Afrique sur la côte de Guinée.
* ACANES, s. m. pl. Il y a le grand & le petit Acane. Ces deux villes sont situées sur la côte d’or de Guinée. Long. 17. 40. lat. 8. 30.
ACANGIS, s. m. pl. c’est-à-dire Gâteurs, Aventuriers cherchant fortune ; nom que les Turcs donnent à leurs Hussards, qui ainsi que les nôtres sont des troupes légeres, plus propres aux escarmouches & aux coups de main, qu’à combattre de pié ferme dans une action. On les emploie à aller en détachement à la découverte, harceler les ennemis, attaquer les convois, & faire le dégât dans la campagne. (G)
ACANTHA, s. Quelques Anatomistes nomment ainsi les apophyses épineuses des vertebres du dos, qui forment ce qu’on appelle l’épine du dos : ce nom est grec, & signifie épine. Voyez Vertebre & Epine. (L)
* ACANTHABOLE, s. m. instrument de Chirurgie dont on trouve la description dans Paul Eginete, & la figure dans Scultet. Il ressemble à des pincettes dont les extrémités sont taillées en dents qui s’emboîtent les unes dans les autres, & qui saisissent les corps avec force. On s’en servoit pour enlever les esquilles des os cariés, les épines, les tentes ; en un mot tous les corps étrangers qui se trouvoient profondément engagés dans les plaies, & pour arracher les poils incommodes des paupieres, des narines, & des sourcils.
* ACANTHACÉE, adj. f. On dit d’une plante qu’elle est acanthacée, lorsqu’elle tient de la nature du chardon, & qu’elle est armée de pointes.
ACANTHE, s. f. herbe à fleur d’une seule feuille irréguliere, terminée en bas par un anneau. La partie antérieure de la fleur de l’acanthe, est partagée en trois pieces ; la partie postérieure est en forme d’anneau. La place de la levre supérieure est occupée par quelques étamines qui soûtiennent des sommets assez semblables à une vergette. Il sort du calice un pistil qui est fiché comme un clou dans la partie postérieure de la fleur ; il devient dans la suite un fruit qui a la forme d’un gland, & qui est enveloppé par le calice. Ce fruit est partagé par une cloison mitoyenne en deux cellules, dans chacune desquelles il se trouve des semences qui sont ordinairement de figure irréguliere. Tournefort, Inst. rei herb. V. Plante. (I)
Les feuilles récentes de cette herbe ont donné dans l’analyse, du phlegme sans odeur ni goût, mais chargé d’un peu de sel salé qui troubloit la solution de Saturne ; une liqueur tirant d’abord à l’acide, qui le devenoit clairement ensuite, & qui étoit même un peu alkaline ; une liqueur roussâtre empyreumatique, legerement acide, mais pleine d’un sel alkali urineux, & de beaucoup de sel volatil ; de l’huile, soit fluide, soit épaisse.
La masse noire restée dans la cornue calcinée au feu de réverbere, a donné des cendres blanchâtres, dont par la lixiviation on a tiré un sel fixe purement alkali. De cette analyse, de la quantité relative des choses qu’on en a tirées, & de la viscosité de la plante, il s’ensuit qu’elle contient beaucoup de sel ammoniac, & un peu d’huile délayée dans beaucoup de phlegme. On n’emploie que ses feuilles, en lavemens, en fomentations, & en cataplasmes.
Acanthe, s. f. en Architecture, ornement semblable à deux plantes de ce nom, dont l’une est sauvage, l’autre cultivée : la 1re est appellée en Grec acantha, qui signifie épine ; & c’est elle que la plûpart des Sculpteurs gothiques ont imitée dans leurs ornemens ; la seconde est appellée en latin branca ursina, à cause que l’on prétend qu’elle ressemble au pié d’un ours : les Sculpteurs anciens & modernes ont préféré celle-ci, & s’en sont servis particulierement dans leurs chapiteaux. Vitruve & plusieurs de ses Commentateurs prétendent que cette plante donna occasion à Callimachus, Sculpteur Grec, de composer le chapiteau Corinthien ; voici à peu près comme il rapporte le fait : « Une jeune fille étant morte chez sa nourrice ; & cette femme voulant consacrer aux Manes de cette jeune personne plusieurs bijoux qu’elle avoit aimés pendant sa vie, les porta sur son tombeau ; & afin qu’ils se conservasient plus long-tems, elle couvrit cette corbeille d’une tuile : ce panier se trouvant placé par hasard sur une racine d’acanthe, le printems suivant cette racine poussa des branches qui, trouvant de la résistance par le poids de la corbeille, se diviserent en plusieurs rameaux, qui ayant atteint le sommet de la corbeille, furent contraints de se recourber sur eux-mêmes par la saillie que formoit la tuile sur ce panier ; ce qui donna idée à Callimachus, qui apperçut ce jeu de la nature, de l’imiter dans les chapiteaux de cet ordre, & de distribuer les seize feuilles comme on l’exécute encore aujourd’hui ; la tuile lui fit aussi imaginer le tailloir ». Voyez Chapiteau Corinthien, Collicolo, Tigettes, &c.
Villapande qui nous a donné la description du Temple de Salomon, traite de fable cette histoire, & prétend que ce chapiteau étoit exécuté à ce Temple. Il est vrai qu’il nous le décrit composé de feuilles de palmier, ce qui donna lieu, dit-il expressément, dans la suite, à composer les chapiteaux Corinthiens de feuilles d’olivier plûtôt que d’acanthe. Sans entrer en discussion avec ces deux Auteurs, je crois ce que l’un & l’autre en disent, c’est-à-dire, que les chapiteaux Corinthiens peuvent fort bien avoir été employés dans leur origine à la décoration du Temple de Jérusalem ; mais que Callimachus, Sculpteur habile, peut-être aussi celui à qui nous avons l’obligation de la perfection de sa forme générale, de la distribution de ses ornemens & de son élégance. Ce qu’il y a de certain, c’est que depuis plusieurs siecles ce chapiteau a passé pour un chef-d’œuvre dans son genre, & qu’il a presque été impossible à tous nos Architectes modernes qui ont voulu composer des chapiteaux d’une nouvelle invention, de l’égaler. (P)
ACAPATHI, s. m. Voyez Poivre.
* ACAPULCO, s. m. ville & Port de l’Amérique dans le Mexique sur la mer du Sud, Long. 276. lat. 17.
Le commerce se fait d’Acapulco au Pérou, aux Isles Philippines, & sur les côtes les plus proches du Mexique. Les Marchands d’Acapulco envoient leurs marchandises à Réalajo, à la Trinité, à Vatulco, & autres petits havres, pour en tirer des vivres & des rafraîchissemens. Il leur vient cependant du côté de la terre des fromages, du chocolat, de la farine, des chairs salées, & des bestiaux. Il va tous les ans d’Acapulco à Lima un vaisseau, ce qui ne suffit pas pour lui donner la réputation de commerce qu’a cette ville ; elle ne lui vient cependant que de deux seuls vaisseaux appellés hourques, qu’elle envoie aux Philippines & à l’Orient. Leur charge au départ d’Acapulco est composée, partie de marchandises d’Europe, qui viennent au Mexique par la Vera-cruz, & partie de marchandises de la nouvelle Espagne. La cargaison au retour est composée de tout ce que la Chine, les Indes & l’Orient, produisent de plus précieux, perles, pierreries, & or en poudre. Les habitans d’Acapulco font aussi quelque négoce d’oranges, de limons, & d’autres fruits que leur sol ne porte pas.
* ACARA ou ACARAI, s. Place de l’Amérique méridionale dans le Paraguai, bâtie par les Jésuites en 1624. Long. 26. 55. lat. mérid. 26.
Les Anglois, les Hollandois, & les Danois, sont établis à Acara, ce qui les rend maîtres de la traite des Negres & de l’or. Celle de l’or y étoit jadis considérable ; celle des Negres y étoit encore bonne ; les Marchands Maures du petit Acara sont entendus : ils achetent en gros, & détaillent ensuite. La traite de Lampy & de Juda est considérable pour l’achat des Negres. En 1706 & 1707, les vaisseaux de l’Assiente en eurent plus de deux cens cinquante pour six fusils, cinq pieces de perpétuanes, un baril de poudre de cent livres, six pieces d’Indienne, & cinq de tapsels ; ce qui, valeur d’Europe, ne faisoit pas quarante-cinq à cinquante livres pour chaque Negre. Les Negres à Juda étoient plus chers. On voit par une comparaison des marchandises avec une certaine quantité de Negres obtenue en échange, qu’on portoit là des fusils, des pieces de perpetuanes, de tapsels, des bassins de cuivre, des bougis, des chapeaux, du crystal de roche, de l’eau-de-vie, du fer, de la poudre, des couteaux, des pierres-à-fusil, du tabac, & que le Negre revenoit à quatre-vingts-huit ou quatre-vingts-dix livres, valeur réelle de cette marchandise.
* ACARICABA, s. plante du Bresil dont les racines aromatiques peuvent être comptées entre les meilleurs apéritifs. On s’en sert dans les obstructions de la rate & des reins. Les Medecins regardent le suc de ses feuilles comme un antidote & comme un vomitif. Cet article de l’acaricaba pourroit bien avoir deux défauts, celui d’en dire trop des propriétés de la plante, & de n’en pas dire assez de ses caracteres.
* ACARNAN, s. ἄκαρναν, poisson de mer dont il est parlé dans Athenée, Rondelet, & Aldrovande. On prétend qu’il est diurétique, de facile digestion, & très nourrissant. Mais il y a mille poissons dont on en peut dire autant, & qui peut-être ne sont pas mentionnés dans Athenée, & ne s’appellent pas acarnan. C’est peut-être le même qu’Acarne. Voyez ce mot.
ACARNAR, s. nom d’une étoile. Voyez Acharnar. (O)
ACARNE, s. m. ἁκαρναν, poisson de mer semblable au pagre & au pagel, avec lesquels on le vend à Rome sous le nom de phragolino, que l’on donne à ces trois especes de poisson. L’acarne est blanc, ses écailles sont argentées, le dessus de sa tête est arqué en descendant jusqu’à la bouche, qui est petite. Ses dents sont menues, ses yeux grands & de couleur d’or ; l’espace qui se trouve entre les deux yeux est applati, les nageoires sont blanches ; il y a à la racine des premieres une marque mêlée de rouge & de noir. La queue est rouge ; on voit sur le corps un trait qui va en ligne droite depuis les ouies jusqu’à la queue. On pêche ce poisson en été & en hyver ; sa chair a un goût doux, quoiqu’un peu astringent à la langue ; elle est nourrissante, & se digere facilement. Les parties intérieures de l’acarne sont à peu près semblables à celles du pagre & du pagel. Rondelet, Aldrovande. Voyez Pagre & Pagel. Voyez aussi Poisson. (I)
* ACARNANIE, s. f. Province de l’Epire qui avoit à l’Orient l’Ætolie, à l’Occident le golphe d’Ambracie, & au Midi la mer Ionienne. C’est aujourd’hui Despotat, ou la petite Grece, ou la Carnie.
* Acarnanie, s. f. ville de Sicile où Jupiter avoit un Temple renommé.
* ACARO, s. contrée & village du Royaume d’Acambou, sur la côte de Guinée en Afrique. Long. 18. lat. 5. 40.
* ACATALECTIQUE, adj. pris subst. dans la Poétique des Anciens, signifie des vers complets, qui ont tous leurs piés, leurs syllabes, & auxquels il ne manque rien à la fin. Voyez Pié & Vers.
Ce mot est composé du Grec κατὰ & de λήγω, finir, cesser, d’où se forme καταληκτικὸς qui signifie, manquant de quelque chose à la fin ou incomplet, & d’ἀ privatif qui, précédant καταληκτικὸς, lui donne une signification toute opposée ; conséquemment on appelloit catalectique tout vers qui manquoit d’une syllabe à la fin, & dont la mesure n’étoit pas complete.
Horace fournit un exemple de l’un & de l’autre dans ces deux vers de la quatrieme ode de son premier livre : ainsi scandez
Solvitur | acris hy | ems gra | tâ vice | veris | & fa | voni
Trahunt | que fic | cas ma | chinæ | cari | nas.
dans le premier desquels les piés sont complets, au lieu que dans le second il manque une syllabe pour faire un vers ïambique de six piés. (G)
ACATALEPSIE, s. f. terme qui signifie l’impossibilité qu’il y a qu’une chose soit conçûe ou comprise. Voyez Conception.
Ce mot est formé de ἀ privatif, & καταλάμϐανω, découvrir, saisir, lequel est composé lui-même de κατὰ & λάμϐανω, prendre. Voyez Catalepsie.
Acatalepsie est synonyme à incompréhensibilité. Voyez Compréhension.
Les Pyrrhoniens ou Sceptiques tenoient pour l’acatalepsie absolue : toutes les sciences ou les connoissances humaines n’alloient, selon eux, tout au plus qu’à l’apparence & à la vraissemblance. Ils déclamoient beaucoup contre les sens, & les regardoient comme la source principale de nos erreurs & de notre séduction. Voyez Sceptique, Pyrrhonien, Académique, Sens, Erreur, Probabilité, Doute, Suspension, &c. (X)
* Arcésilas fut le premier défenseur de l’acatalepsie. Voici comment il en raisonnoit. On ne peut rien savoir, disoit-il, pas même ce que Socrate croyoit ne pas ignorer, qu’on ne sait rien.
Cette impossibilité vient, & de la nature des choses, & de la nature de nos facultés, mais plus encore de la nature de nos facultés que des choses.
Il ne faut donc ni nier, ni assûrer quoi que ce soit ; car il est indigne du Philosophe d’approuver, ou une chose fausse, ou une chose incertaine, & de prononcer avant que d’être instruit.
Mais tout ayant à peu près les mêmes degrés de probabilité pour & contre, un Philosophe peut donc se déclarer contre celui qui nie ou qui assûre quoi que ce soit ; sûr, ou de trouver enfin la vérité qu’il cherche, ou de nouvelles raisons de croire qu’elle n’est pas faite pour nous. C’est ainsi qu’Arcésilas la chercha toute sa vie, perpétuellement aux prises avec tous les Philosophes de son tems.
Mais si ni les sens ni la raison ne sont pas des garans assez surs pour être écoutés dans les écoles de Philosophie, ajoûtoit-il, ils suffisent au moins dans la conduite de la vie, où l’on ne risque rien à suivre des probabilités, puisqu’on est avec des gens qui n’ont pas de meilleurs moyens de se déterminer.
ACARIATION, s. f. Voyez Accariation. (H)
* ACAZER, v. act. donner en fief ou à rente. Delà vient acazement. Voyez Fief, Rente.
ACCAPAREMENT, s. m. c’est un achat de marchandises défendues par les Ordonnances.
On le prend aussi pour une espece de monopole consistante à faire des levées considérables de marchandises, pour s’en approprier la vente à soi seul, à l’effet de les vendre à si haut prix qu’on voudra.
ACCAPARER par conséquent signifie acheter des marchandises défendues, ou faire des levées des marchandises permises, qui les rendent rares. (H)
On dit accaparer des blés, des laines, des cires, des suifs, &c. En bonne police cette manœuvre est défendue sous peine de confiscation des marchandises accaparées, d’amende pécuniaire, & même de punition corporelle en cas de récidive.
Quelques-uns confondent le terme d’accaparer avec celui d’enharrer : mais ils sont différens, & n’ont rien de commun que les mêmes défenses & les mêmes peines. Voyez Enharrer. (G)
ACCARIATION, s. f. terme de Palais usité dans quelques Provinces de France, sur-tout dans les méridionales les plus voisines d’Espagne : il est synonyme à confrontation. Voyez Confrontation.
On dit aussi dans le même sens accarement ou acarement. Accarer les témoins, c’est les confronter. (H)
* ACCARON, s. m. ville de la Palestine, celui des cinq gouvernemens des Philistins où l’arche fut gardée après avoir été prise. Beelzébuth étoit le dieu d’Accaron.
ACCASTELLAGE. C’est le château sur l’avant & sur l’arriere d’un vaisseau. Pour s’en former une idée exacte, on n’aura qu’à consulter la Planche premiere de la Marine, & les explications qui y seront jointes.
Le Roi par une Ordonnance de l’année 1675, défend aux Officiers de ses vaisseaux de faire aucun changement aux accastellages & aux soutes par des séparations nouvelles, à peine de cassation,
On fait un accastellage à l’avant & à l’arriere des vaisseaux, en les elevant & bordant au-dessus de la lisse de vibord, & cet exhaussement commence aux herpes de l’embelle. On met pour cet effet deux, trois ou quatre herpes derriere le mât, à proportion de la hauteur qu’on veut donner à l’accastellage : on le borde ensuite de planches qu’on nomme qlin, ou esquain, ou quein, auxquelles on donne l’épaisseur convenable.
Ces bordages qu’on appelle l’esquain, doivent être tenus plus larges à l’arriere, où ils joignent les montans du revers, qu’en dedans ou vers le milieu du vaisseau, afin que l’accastellage aille toûjours en s’élevant, car s’il paroissoit baisser, ou être de niveau, il formeroit un coup d’œil désagréable : lorsque ces bordages sont cousus & élevés autant qu’il faut, on laisse une ouverture au-dessus, telle qu’on juge à propos, & l’on coud ensuite les dernieres planches de l’esquain. A chaque herpe, on éleve l’accastellage d’un pié, ou à peu près, selon la grandeur du vaisseau : mais à l’arriere, on met les herpes entre les dernieres planches de l’esquain, pour que la dunette soit plus saine : on laisse aussi fort souvent du jour ou un vuide entre les plus hautes planches & celles qui sont au-dessous.
ACCASTELLÉ, adj. Un vaisseau accastellé est celui qui a un château sur son avant & sur son arriere. Voyez Accastellage & Chateau. (Z)
ACCÉDER à un contrat ou à un traité, c’est joindre son consentement à un contrat ou traité déja conclu & arrêté entre deux autres personnes ou un plus grand nombre.
En ce sens on dit : les Etats Généraux ont accédé au traité d’Hanovre ; la Czarine a accédé au traité de Vienne. Voyez Traité. (H)
ACCELERATEUR, s. m. pris adj. ou le bulbo-caverneux, terme d’Anatomie, est un muscle de la verge qui sert à accélérer l’écoulement de l’urine & de la semence.
Il est nommé plus particulierement accélérateur de l’urine, en latin accelerator urinæ. Quelques-uns en font deux muscles, qu’ils nomment muscles accélérateurs.
Il vient par une origine tendineuse de la partie supérieure & antérieure de l’urethre : mais devenant bien-tôt charnu, il passe sous l’os pubis, & embrasse la bulbe de l’urethre. Les deux côtés de ce muscle se joignent par une ligne mitoyenne qui répond au ruphée que l’on voit sur la peau qui le couvre ; & ainsi unis, ils continuent leur chemin l’espace d’environ deux travers de doigt, après quoi ce muscle se divise en deux productions charnues, qui ont leurs insertions au corps caverneux de la verge, & deviennent des tendons minces. (L)
ACCELERATION, s. f. C’est l’accroissement de vîtesse dans le mouvement d’un corps. V. Vitesse & Mouvement.
Accélération est opposé à retardation, terme par lequel on entend la diminution de vîtesse. Voyez Retardation.
Le terme d’accélération s’emploie particulierement en Physique, lorsqu’il est question de la chûte des corps pesans qui tendent au centre de la terre par la force de leur gravité. Voyez Gravité & Centre.
Que les corps en tombant soient accélérés, c’est une vérité démontrée par quantité de preuves, du moins à posteriori : ainsi nous éprouvons que plus un corps tombe de haut, plus il fait une forte impression, plus il heurte violemment la surface plane, ou autre obstacle qui l’arrête dans sa chûte.
Il y a eu bien des systèmes imaginés par les Philosophes pour expliquer cette accélération. Quelques-uns l’ont attribuée à la pression de l’air : plus, disent-ils, un corps descend, plus le poids de l’atmosphere qui pese dessus est considérable, & la pression d’un fluide est en raison de la hauteur perpendiculaire de ses colonnes : ajoutez, disent-ils, que toute la masse du fluide pressant par une infinité de lignes droites qui se rencontrent toutes en un point, savoir, au centre de la terre, ce point où aboutissent toutes ces lignes soûtient pour ainsi dire la pression de toute la masse : conséquemment plus un corps en approche de près, plus il doit sentir l’effet de la pression qui agit suivant des lignes prêtes à se réunir. Voyez Air & Atmosphere.
Mais ce qui renverse toute cette explication, c’est que plus la pression de l’air augmente, plus augmente aussi la résistance ou la force avec laquelle ce même fluide tend à repousser en enhaut le corps tombant. Voyez Fluide.
On essaye pourtant encore de répondre que l’air à mesure qu’il est plus proche de la terre, est plus grossier & plus rempli de vapeurs & de particules hétérogenes qui ne sont point un véritable air élastique ; & l’on ajoûte que le corps, à mesure qu’il descend, trouvant toûjours moins de résistance de la part de l’élasticité de l’air, & cependant étant toûjours déprimé par la même force de gravité qui continue d’agir sur lui, il ne peut pas manquer d’être accéléré. Mais on sent assez tout le vague & le peu de précision de cette réponse : d’ailleurs, les corps tombent plus vîte dans le vuide que dans l’air. Voyez Pneumatique. Voyez aussi Elasticité.
Hobbes, Philosop. Probl. c. I. p. 3. attribue l’accélération à une nouvelle impression de la cause qui produit la chûte des corps, laquelle selon son principe est aussi l’air : en même tems, dit-il, qu’une partie de l’atmosphere monte, l’autre descend : car en conséquence du mouvement de la terre, lequel est composé de deux mouvemens, l’un circulaire, l’autre progressif, il faut aussi que l’air monte & circule tout à la fois. De-là il s’ensuit que le corps qui tombe dans ce milieu, recevant à chaque instant de sa chûte une nouvelle pression, il faut bien que son mouvement soit accéléré.
Mais pour renverser toutes les raisons qu’on tire de l’air par rapport à l’accélération, il suffit de dire qu’elle se fait aussi dans le vuide comme nous venons de l’observer.
Voici l’explication que les Péripatéticiens donnent du même phénomene. Le mouvement des corps pesans en enbas, disent-ils, vient d’un principe intrinseque qui les fait tendre au centre, comme à leur place propre & à leur élément, où étant arrivés ils seroient dans un repos parfait : c’est pourquoi, ajoûtent-ils, plus les corps en approchent, plus leur mouvement s’accroît : sentiment qui ne mérite pas de réfutation.
Les Gassendistes donnent une autre raison de l’accélération : ils prétendent qu’il sort de la terre des especes de corpuscules attractifs, dirigés suivant une infinité de filets directs qui montent & descendent ; que ces filets partant comme des rayons d’un centre commun, deviennent de plus en plus divergens à mesure qu’ils s’en éloignent ; en sorte que plus un corps est proche du centre, plus il supporte de ces filets attractifs, plus par conséquent son mouvement est accéléré. Voyez Corpuscules & Aimant.
Les Cartésiens expliquent l’accélération par des impulsions réitérées de la matiere subtile éthérée, qui agit continuellement sur les corps tombans, & les pousse en enbas. V. Cartésianisme, Ether, Matiere subtile, Pesanteur, &c.
La cause de l’accélération ne paroîtra pas quelque chose de si mystérieux, si on veut faire abstraction pour un moment de la cause qui produit la pesanteur, & supposer seulement avec Galilée que cette cause ou force agit continuellement sur les corps pesans ; on verra facilement que le principe de la gravitation qui détermine le corps à descendre, doit accélérer ces corps dans leur chûte par une conséquence nécessaire. Voyez Gravitation.
Car le corps étant une fois supposé déterminé à descendre, c’est sans doute sa gravité qui est la premiere cause de son commencement de descente : or quand une fois sa descente est commencée, cet état est devenu en quelque sorte naturel au corps ; de sorte que laissé à lui-même il continueroit toûjours de descendre, quand même la premiere cause cesseroit ; comme nous voyons dans une pierre jettée avec la main, qui ne laisse pas de continuer de se mouvoir après que la cause qui lui a imprimé le mouvement a cessé d’agir. Voyez Loi de la Nature & Projectile
Mais outre cette détermination à descendre, imprimée par la premiere cause, laquelle suffiroit pour continuer à l’infini le même degré de mouvement une fois commencé, il s’y joint perpétuellement de nouveaux efforts de la même cause, savoir de la gravité, qui continue d’agir sur le corps déja en mouvement, de même que s’il étoit en repos.
Ainsi, y ayant deux causes de mouvement qui agissent l’une & l’autre en même direction, c’est-à-dire vers le centre de la terre, il faut nécessairement que le mouvement qu’elles produisent ensemble soit plus considérable que celui que produiroit l’une des deux. Et tandis que la vîtesse est ainsi augmentée, la même cause subsistant toûjours pour l’augmenter encore davantage, il faut nécessairement que la descente soit continuellement accélérée.
Supposons donc que la gravité, de quelque principe qu’elle procede, agisse uniformément sur tous les corps à égale distance du centre de la terre : divisant le tems que le corps pesant met à tomber sur la terre, en parties égales infiniment petites, cette gravité poussera le corps vers le centre de la terre dans le premier instant infiniment court de la descente : si après cela on suppose que l’action de la gravité cesse, le corps continueroit toûjours de s’approcher uniformément du centre de la terre avec une vîtesse infiniment petite égale à celle qui résulte de la premiere impression.
Mais ensuite si l’on suppose que l’action de la gravité continue, dans le second instant le corps recevra une nouvelle impulsion vers la terre, égale à celle qu’il a reçûe dans le premier ; par conséquent sa vîtesse sera double de ce qu’elle étoit dans le premier instant : dans le troisieme instant elle sera triple ; dans le quatrieme quadruple ; & ainsi de suite : car l’impression faite dans un instant précédent n’est point du tout altérée par celle qui se fait dans l’instant suivant ; mais elles sont, pour ainsi dire, entassées & accumulées l’une sur l’autre.
C’est pourquoi comme les instans de tems sont supposés infiniment petits, & tous égaux les uns aux autres, la vîtesse acquise par le corps tombant sera dans chaque instant comme les tems depuis le commencement de la descente, & par conséquent la vîtesse sera proportionnelle au tems dans lequel elle est acquise.
De plus l’espace parcouru par le corps en mouvement pendant un tems donné, & avec une vîtesse donnée, peut être considéré comme un rectangle composé du tems & de la vîtesse. Je suppose donc A (Pl. de Mechan. fig. 64.) le corps pesant qui descend, AB le tems de la descente ; je partage cette ligne en un certain nombre de parties égales qui marqueront les intervalles ou portions du tems donné, savoir AC, CE, EG, &c. je suppose que le corps descend durant le tems exprimé par la premiere des divisions AC, avec une certaine vîtesse uniforme provenant du degré de gravité qu’on lui suppose ; cette vîtesse sera representée par AD, & l’espace parcouru, par le rectangle CAD.
Or l’action de la gravité ayant produit dans le premier moment la vîtesse AD dans le corps précédemment en repos ; dans le second moment elle produira la vîtesse CF, double de la précédente ; dans le troisieme moment à la vîtesse CF sera ajoûté un degré de plus, au moyen duquel sera produite la vîtesse EH triple de la premiere, & ainsi du reste ; de sorte que dans tout le tems AB, le corps aura acquis la vîtesse BK : après cela prenant les divisions de la ligne qu’on voudra, par exemple les divisions AC, CE, &c. pour les tems, les espaces parcourus pendant ces tems seront comme les aires ou rectangles CD, EF, &c. en sorte que l’espace décrit par le corps en mouvement, pendant tout le tems AB, sera égal à tous les rectangles, c’est-à-dire, à la figure dentelée ABK.
Voilà ce qui arriveroit si les accroissemens de vîtesse se faisoient, pour ainsi dire, tout-à-coup, au bout de certaines portions finies de tems ; par exemple, en C, en E, &c. en sorte que le degré de mouvement continuât d’être le même jusqu’au tems suivant où se feroit une nouvelle accélération.
Si l’on suppose les divisions ou intervalles de tems plus courts, par exemple, de moitié ; alors les dentelures de la figure seront à proportion plus serrées, & la figure approchera plus du triangle.
S’ils sont infiniment petits, c’est-à-dire, que les accroissemens de vîtesse soient supposés être faits continuellement & à chaque particule de tems indivisible, comme il arrive en effet ; les rectangles ainsi successivement produits formeront un véritable triangle, par exemple, ABE, Fig. 65, tout le tems AB consistant en petites portions de tems A1, A2, &c. & l’aire du triangle ABE en la somme de toutes les petites surfaces ou petits trapezes qui répondent aux divisions du tems ; l’aire ou le triangle total exprime l’espace parcouru dans tout le tems AB.
Or les triangles ABE, A1f, étant semblables, leurs aires sont l’une à l’autre comme les quarrés de leurs côtés homologues AB, A1, &c. & par conséquent les espaces parcourus sont l’un à l’autre, comme les quarrés des tems.
De-là nous pouvons aussi déduire cette grande loi de l’accélération : « qu’un corps descendant avec un mouvement uniformément accéléré, décrit dans tout le tems de sa descente un espace qui est précisément la moitié de celui qu’il auroit décrit uniformément dans le même tems avec la vîtesse qu’il auroit acquise à la fin de sa chûte ». Car, comme nous l’avons déjà fait voir, tout l’espace que le corps tombant a parcouru dans le tems AB, sera représenté par le triangle ABE ; & l’espace que ce corps parcourroit uniformément en même tems avec la vitesse BE, sera représenté par le rectangle ABEF : or on sait que le triangle est égal précisément à la moitié du rectangle. Ainsi l’espace parcouru sera la moitié de celui que le corps auroit parcouru uniformément dans le même tems avec la vîtesse acquise à la fin de sa chûte.
Nous pouvons donc conclurre, 1°. que l’espace qui seroit uniformément parcouru dans la moitié du tems AB avec la derniere vîtesse acquise BE, est égal à celui qui a été réellement parcouru par le corps tombant pendant tout le tems AB.
2°. Si le corps tombant décrit quelque espace ou quelque longueur donnée dans un tems donné ; dans le double du tems, il la décrira quatre fois ; dans le triple, neuf fois, &c. En un mot, si les tems sont dans la proportion arithmétique, 1, 2, 3, 4, &c. les espaces parcourus seront dans la proportion 1, 4, 9, 16, &c. c’est-à-dire, que si un corps décrit, par exemple, 15 piés dans la premiere seconde de sa chûte, dans les deux premieres secondes prises ensemble, il décrira quatre fois 15 piés ; neuf fois 15 dans les trois premieres secondes prises ensemble, & ainsi de suite.
3°. Les espaces décrits par le corps tombant dans une suite d’instans ou intervalles de tems égaux, seront comme les nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, &c. c’est-à-dire, que le corps qui a parcouru 15 piés dans la premiere seconde, parcourra dans la seconde trois fois 15 piés, dans la troisieme cinq fois 15 piés, &c. Et puisque les vîtesses acquises en tombant sont comme les tems, les espaces seront aussi comme les quarrés des vîtesses ; & les tems & les vîtesses en raison soûdoublées des espaces.
Le mouvement d’un corps montant ou poussé en en-haut est diminué ou retardé par le même principe de gravité agissant en direction contraire, de la même maniere qu’un corps tombant est accéléré. Voyez Retardation.
Un corps lancé en haut s’éleve jusqu’à ce qu’il ait perdu tout son mouvement ; ce qui se fait dans le même espace de tems que le corps tombant auroit mis à acquérir une vitesse égale à celle avec laquelle le corps lancé a été poussé en en-haut.
Et par conséquent les hauteurs auxquelles s’élevent des corps lancés en en-haut avec différentes vîtesses, sont entr’elles comme les quarrés de ces vîtesses.
Accélération des corps sur des plans inclinés. La même loi générale qui vient d’être établie pour la chûte des corps qui tombent perpendiculairement, a aussi lieu dans ce cas-ci. L’effet du plan est seulement de rendre le mouvement plus lent. L’inclinaison étant par-tout égale ; l’accélération, quoiqu’à la vérité moindre que dans les chûtes verticales, sera égale aussi dans tous les instans depuis le commencement jusqu’à la fin de la chûte. Pour les lois particulieres à ce cas, Voyez l’article Plan incliné.
Galilée découvrit le premier ces lois par des expériences, & imagina ensuite l’explication que nous venons de donner de l’accélération.
Sur l’accélération du mouvement des pendules, Voyez Pendule.
Sur l’accélération du mouvement des projectiles. Voyez Projectile.
Sur l’accélération du mouvement des corps comprimés, lorsqu’ils se retablissent dans leur premier état & reprennent leur volume ordinaire, Voyez Compression, Dilatation, Cordes, Tension, &c.
Le mouvement de l’air comprimé est accéléré, lorsque par la force de son élasticité il reprend son volume & sa dimension naturelle ; c’est une vérité qu’il est facile de démontrer de bien des manieres. Voyez Air, Elasticité.
Accélération est aussi un terme qu’on appliquoit dans l’Astronomie ancienne aux étoiles fixes. Accélération en ce sens étoit la différence entre la révolution du premier mobile & la révolution solaire ; différence qu’on évaluoit à 3 minutes 56 secondes. Voyez Etoile, Premier mobile, &c. (O)
ACCÉLÉRATRICE (Force). On appelle ainsi la force ou cause qui accélere le mouvement d’un corps. Lorsqu’on examine les effets produits par de telles causes, & qu’on ne connoît point les causes en elles-mêmes, les effets doivent toûjours être donnés indépendamment de la connoissance de la cause, puisqu’ils ne peuvent en être déduits : c’est ainsi que sans connoître la cause de la pesanteur, nous apprenons par l’expérience que les espaces décrits par un corps qui tombe sont entr’eux comme les quarrés des tems. En général dans les mouvemens variés dont les causes sont inconnues, il est évident que l’effet produit par la cause, soit dans un tems fini, soit dans un instant, doit toûjours être donné par l’équation entre les tems & les espaces : cet effet une fois connu, & le principe de la force d’inertie supposé, on n’a plus besoin que de la Géométrie seule & du calcul pour découvrir les propriétés de ces sortes de mouvemens. Il est donc inutile d’avoir recours à ce principe dont tout le monde fait usage aujourd’hui, que la force accélératrice ou retardatrice est proportionnelle à l’élément de la vîtesse ; principe appuyé sur cet unique axiome vague & obscur, que l’effet est proportionnel à sa cause. Nous n’examinerons point si ce principe est de vérité nécessaire ; nous avouerons seulement que les preuves qu’on en a données jusqu’ici ne nous paroissent pas fort convaincantes : nous ne l’adopterons pas non plus avec quelques Géometres, comme de vérité purement contingente, ce qui ruineroit là certitude de la Méchanique, & la réduiroit à n’être plus qu’une science expérimentale. Nous nous contenterons d’observer que, vrai ou douteux, clair ou obscur, il est inutile à la Méchanique, & que par conséquent il doit en être banni. (O)
ACCÉLÉRÉ (Mouvement) en Physique, est un mouvement qui reçoit continuellement de nouveaux accroissemens de vîtesse. Voyez Mouvement.
Le mot accéléré vient du latin ad & celer, prompt, vîte.
Si les accroissemens de vîtesse sont égaux dans des tems égaux, le mouvement est dit être accéléré uniformément. Voyez Accélération.
Le mouvement des corps tombans est un mouvement accéléré ; & en supposant que le milieu par lequel ils tombent, c’est-à-dire l’air, soit sans résistance, le même mouvement peut aussi être considéré comme accéléré uniformément. Voyez Descente, &c.
Pour ce qui concerne les lois du mouvement accéléré, Voyez Mouvement & Accélération. (O)
Accéléré dans son mouvement. En Astronomie, on dit qu’une Planete est accélérée dans son mouvement, lorsque son mouvement diurne réel excede son moyen mouvement diurne. On dit qu’elle est retardée dans son mouvement, lorsqu’il arrive que son mouvement réel est moindre que son mouvement moyen. Quand la Terre est le plus éloignée du Soleil, elle est alors le moins accélérée dans son mouvement qu’il est possible, & c’est le contraire lorsqu’elle est le plus proche du Soleil. Les Astronomes s’apperçoivent de ces inégalités dans leurs observations, & on en tient compte dans les tables du mouvement apparent du Soleil. Voyez Equation. (O)
ACCENSES, adject. pris subst. du latin accensi sorenses. C’étoient des Officiers attachés aux Magistrats Romains, & dont la fonction étoit de convoquer le peuple aux assemblées, ainsi que le porte leur nom, accensi ab acciendo. Ils étoient encore chargés d’assister le Préteur lorsqu’il tenoit le Siége, & de l’avertir tout haut de trois heures en trois heures quelle heure il étoit dans les Armées Romaines.
Les Accenses, selon Festus, étoient aussi des surnuméraires qui servoient à remplacer les Soldats tués dans une bataille ou mis hors de combat par leurs blessures. Cet Auteur ne leur donne aucun rang dans la Milice : mais Asconius Pedianus leur en assigne un semblable à celui de nos Caporaux & de nos Trompettes. Tite Live en fait quelque mention, mais comme de troupes irrégulieres, & dont on faisoit peu d’estime. (G)
ACCENT, s. m. Ce mot vient d’accentum, supin du verbe accinere qui vient de ad & canere : les Grecs l’appellent προσωδία, modulatio quæ syllabis adhibetur, venant de πρὸς, préposition greque qui entre dans la composition des mots, & qui a divers usages, & ωδὴ, cantus, chant. On l’appelle aussi τόνος, ton.
Il faut ici distinguer la chose, & le signe de la chose.
La chose, c’est la voix ; la parole, c’est le mot, en tant que prononcé avec toutes les modifications établies par l’usage de la Langue que l’on parle.
Chaque nation, chaque peuple, chaque province, chaque ville même, differe d’un autre dans le langage, non-seulement parce qu’on se sert de mots différens, mais encore par la maniere d’articuler & de prononcer les mots.
Cette maniere différente, dans l’articulation des mots, est appellée accent. En ce sens les mots écrits n’ont point d’accens ; car l’accent, ou l’articulation modifiée, ne peut affecter que l’oreille ; or l’écriture n’est apperçue que par les yeux.
C’est encore en ce sens que les Poëtes disent : prêtez l’oreille à mes tristes accens. Et que M. Pelisson disoit aux Réfugiés : vous tâcherez de vous former aux accens d’une langue étrangere.
Cette espece de modulation dans les discours, particuliere à chaque pays, est ce que M. l’Abbé d’Olivet, dans son excellent Traité de la Prosodie, appelle accent national.
Pour bien parler une langue vivante, il faudroit avoir le même accent, la même inflexion de voix qu’ont les honnêtes gens de la capitale ; ainsi quand on dit, que pour bien parler françois il ne faut point avoir d’accent, on veut dire, qu’il ne faut avoir ni l’accent Italien, ni l’accent Gascon, ni l’accent Picard, ni aucun autre accent qui n’est pas celui des honnêtes gens de la capitale.
Accent, ou modulation de la voix dans le discours, est le genre dont chaque accent national est une espece particuliere ; c’est ainsi qu’on dit, l’accent Gascon, l’accent Flamand, &c. L’accent. Gascon éleve la voix où, selon le bon usage, on la baisse : il abrege des syllabes que le bon usage allonge ; par exemple un gascon dit par consquent, au lieu de dire par conséquent ; il prononce séchement toutes les voyelles nazales an, en, in, on, un, &c.
Selon le méchanisme des organes de la parole, il y a plusieurs sortes de modifications particulieres à observer dans l’accent en général, & toutes ces modifications se trouvent aussi dans chaque accent national, quoiqu’elles soient appliquées différemment ; car, si l’on veut bien y prendre garde, on trouve partout uniformité & variété. Partout les hommes ont un visage, & pas un ne ressemble parfaitement à un autre ; partout les hommes parlent, & chaque pays a sa maniere particuliere de parler, & de modifier la voix. Voyons donc quelles sont ces différentes modifications de voix qui sont comprises sous le mot général accent.
Premierement, il faut observer que les syllabes en toute langue, ne sont pas prononcées du même ton. Il y a diverses inflexions de voix dont les unes élevent le ton, les autres le baissent, & d’autres enfin l’élevent d’abord, & le rabaissent ensuite sur la même syllabe. Le ton élevé est ce qu’on appelle accent aigu ; le ton bas ou baissé est ce qu’on nomme accent grave ; enfin, le ton élevé & baissé successivement & presque en même tems sur la même syllabe, est l’accent circonflexe.
« La nature de la voix est admirable, dit Ciceron, toute sorte de chant est agréablement varié par le ton circonflexe, par l’aigu & par le grave : or le discours ordinaire, poursuit-il, est aussi une espece de chant ». Mira est natura vocis, cujus quidem, è tribus omninò sonis inflexo, acuto, gravi, tanta sit, & tam suavis varietas perfecta in cantibus. Est autem in dicendo etiam quidam cantus. Cic. Orator. n. XVII. & XVIII. Cette différente modification du ton, tantôt aigu, tantôt grave, & tantôt circonflexe, est encore sensible dans le cri des animaux, & dans les instrumens de musique.
2. Outre cette variété dans le ton, qui est ou grave, ou aigu, ou circonflexe, il y a encore à observer le tems que l’on met à prononcer chaque syllabe. Les unes sont prononcées en moins de tems que les autres, & l’on dit de celles-ci qu’elles sont longues, & de celles-là qu’elles sont breves. Les breves sont prononcées dans le moins de tems qu’il est possible ; aussi dit-on qu’elles n’ont qu’un tems, c’est-à-dire, une mesure, un battement ; au lieu que les longues en ont deux ; & voilà pourquoi les Anciens doubloient souvent dans l’écriture les voyelles longues, ce que nos Peres ont imité en écrivant aage, &c.
3. On observe encore l’aspiration qui se fait devant les voyelles en certains mots, & qui ne se pratique pas en d’autres, quoiqu’avec la même voyelle & dans une syllabe pareille : c’est ainsi que nous prononçons le héros avec aspiration, & que nous disons l’héroïne, l’héroïsme & les vertus héroïques, sans aspiration.
4. A ces trois différences, que nous venons d’observer dans la prononciation, il faut encore ajoûter la variété du ton pathétique, comme dans l’interrogation, l’admiration, l’ironie, la colere & les autres passions c’est ce que M. l’Abbé d’Olivet appelle l’accent oratoire.
5. Enfin, il y a à observer les intervalles que l’on met dans la prononciation depuis la fin d’une période jusqu’au commencement de la période qui suit, & entre une proposition & une autre proposition ; entre un incise, une parenthese, une proposition incidente, & les mots de la proposition principale dans lesquels cet incise, cette parenthese ou cette proposition incidente sont enfermés.
Toutes ces modifications de la voix, qui sont très sensibles dans l’élocution, sont, ou peuvent être, marquées dans l’écriture par des signes particuliers que les anciens Grammairiens ont aussi appellés accens ; ainsi ils ont donné le même nom à la chose, & au signe de la chose.
Quoique l’on dise communément que ces signes, ou accens, sont une invention qui n’est pas trop ancienne, & quoiqu’on montre des manuscrits de mille ans, dans lesquels on ne voit aucun de ces signes, & où les mots sont écrits de suite sans être séparés les uns des autres, j’ai bien de la peine à croire que lorsqu’une langue a eu acquis un certain degré de perfection, lorsqu’elle a eu des Orateurs & des Poëtes, & que les Muses ont joüi de la tranquillité qui leur est nécessaire pour faire usage de leurs talens ; j’ai, dis-je, bien de la peine à me persuader qu’alors les copistes habiles n’aient pas fait tout ce qu’il falloit pour peindre la parole avec toute l’exactitude dont ils étoient capables ; qu’ils n’aient pas séparé les mots par de petits intervalles, comme nous les séparons aujourd’hui, & qu’ils ne se soient pas servis de quelques signes pour indiquer la bonne prononciation.
Voici un passage de Ciceron qui me paroît prouver bien clairement qu’il y avoit de son tems des notes ou signes dont les copistes faisoient usage. Hanc diligentiam subsequitur modus etiam & forma verborum. Versus enim veteres illi, in hâc solutâ oratione propemodum, hoc est, numeros quosdam nobis esse adhibendos putaverunt. Interspirationis enim, non defatigationis nostræ, neque Librariorum notis, sed verborum & sententiarum modò, interpunctas clausulas in orationibus esse voluerunt : idque, princeps Isocrates instituisse fertur. Cic. Orat. liv. III. n. XLIV. « Les Anciens, dit-il, ont voulu qu’il y eût dans la prose même des intervalles, des séparations du nombre & de la mesure comme dans les vers ; & par ces intervalles, cette mesure, ce nombre, ils ne veulent pas parler ici de ce qui est déjà établi pour la facilité de la respiration & pour soulager la poitrine de l’Orateur, ni des notes ou signes des copistes : mais ils veulent parler de cette maniere de prononcer qui donne de l’ame & du sentiment aux mots & aux phrases, par une sorte de modulation pathétique ». Il me semble, que l’on peut conclurre de ce passage, que les signes, les notes, les accens étoient connus & pratiqués dès avant Ciceron, au moins par les copistes habiles.
Isidore, qui vivoit il y a environ douze cens ans, après avoir parlé des accens, parle encore de certaines notes qui étoient en usage, dit-il, chez les Auteurs célebres, & que les Anciens avoient inventées, poursuit-il, pour la distinction de l’écriture, & pour montrer la raison, c’est-à-dire, le mode, la maniere de chaque mot & de chaque phrase. Prætereà quædam sententiarum notæ apud celeberrimos auctores fuerunt, quasque antiqui ad distinctionem scripturarum, carminibus & historiis apposuerunt, ad demonstrandam unamquanque verbi sententiarumque, ac versuum rationem. Isid. Orig. liv. I. c. xx.
Quoi qu’il en soit, il est certain que la maniere d’écrire a été sujette a bien des variations, comme tous les autres Arts. L’Architecture est-elle aujourd’hui en Orient dans le même état où elle étoit quand on bâtit Babylone ou les pyramides d’Egypte ? Ainsi tout ce que l’on peut conclurre de ces manuscrits, où l’on ne voit ni distance entre les mots, ni accens, ni points, ni virgules, c’est qu’ils ont été écrits, ou dans des tems d’ignorance, ou par des copistes peu instruits.
Les Grecs paroissent être les premiers qui ont introduit l’usage des accens dans l’écriture. L’Auteur de la Méthode Greque de P. R. (pag. 546.) observe que la bonne prononciation de la langue Greque étant naturelle aux Grecs, il leur étoit inutile de la marquer par des accens dans leurs écrits ; qu’ainsi il y a bien de l’apparence qu’ils ne commencerent à en faire usage que lorsque les Romains, curieux de s’instruire de la langue Greque, envoyerent leurs enfans étudier à Athenes. On songea alors à fixer la prononciation, & à la faciliter aux étrangers ; ce qui arriva, poursuit cet Auteur, un peu avant le tems de Ciceron.
Au reste, ces accens des Grecs n’ont eu pour objet que les inflexions de la voix, en tant qu’elle peut être ou élevée ou rabaissée.
L’accent aigu que l’on écrivoit de droit à gauche ’, marquoit qu’il falloit élever la voix en prononçant la voyelle sur laquelle il étoit écrit.
L’accent grave, ainsi écrit `, marquoit au contraire qu’il falloit rabaisser la voix.
L’accent circonflexe est composé de l’aigu & du grave, dans la suite les copistes l’arrondirent de cette maniere ~, ce qui n’est en usage que dans le grec. Cet accent étoit destiné à faire entendre qu’après avoir d’abord élevé la voix, il falloit la rabaisser sur la même syllabe.
Les Latins ont fait le même usage de ces trois accens. Cette élevation & cette dépression de la voix étoient plus sensibles chez les Anciens, qu’elles ne le sont parmi nous ; parce que leur prononciation étoit plus soûtenue & plus chantante. Nous avons pourtant aussi élevement & abaissement de la voix dans notre maniere de parler, & cela indépendamment des autres mots de la phrase ; ensorte que les syllabes de nos mots sont élevées & baissées selon l’accent prosodique ou tonique, indépendamment de l’accent pathétique, c’est-à-dire, du ton que la passion & le sentiment font donner à toute la phrase : car il est de la nature de chaque voix, dit l’Auteur de la Méthode Greque de P. R. (pag. 551.) d’avoir quelque élevement qui soûtienne la prononciation, & cet élevement est ensuite modéré & diminué, & ne porte pas sur les syllabes suivantes.
Cet accent prosodique, qui ne consiste que dans l’élevement ou l’abaissement de la voix en certaines syllabes, doit être bien distingué du ton pathétique ou ton de sentiment.
Qu’un Gascon, soit en interrogeant, soit dans quelqu’autre situation d’esprit ou de cœur, prononce le mot d’examen, il élevera la voix sur la premiere syllabe, la soûtiendra sur la seconde, & la laissera tomber sur la derniere, à peu près comme nous laissons tomber nos e muets ; au lieu que les personnes qui parlent bien françois prononcent ce mot, en toute occasion, à peu près comme le dactyle des Latins, en élevant la premiere, passant vîte sur la seconde, & soûtenant la derniere. Un gascon, en prononçant cadis, éleve la premiere syllabe ca, & laisse tomber dis comme si dis étoit un e muet : au contraire, à Paris, on éleve la derniere dis.
Au reste, nous ne sommes pas dans l’usage de marquer dans l’écriture, par des signes ou accens, cet élevement & cet abaissement de la voix : notre prononciation, encore un coup, est moins soûtenue & moins chantante que la prononciation des Anciens ; par conséquent la modification ou ton de voix dont il s’agit nous est moins sensible ; l’habitude augmente encore la difficulté de démêler ces différences délicates. Les Anciens prononçoient, au moins leurs vers, de façon qu’ils pouvoient mesurer par des battemens la durée des syllabes. Adsuetam moram pollicis sonore vel plausu pedis, discriminare, qui docent artem, solent. (Terentianus Maurus de Metris sub med.) ce que nous ne pouvons faire qu’en chantant. Enfin, en toutes sortes d’accens oratoires, soit en interrogeant, en admirant, en nous fâchant, &c. les syllabes qui précedent nos e muets ne sont-elles pas soûtenues & élevées comme elles le sont dans le discours ordinaire ?
Cette différence entre la prononciation des Anciens & la nôtre, me paroît être la véritable raison pour laquelle, quoique nous ayons une quantité comme ils en avoient une ; cependant la différence de nos longues & de nos breves n’étant pas également sensible en tous nos mots, nos vers ne sont formés que par l’harmonie qui résulte du nombre des syllabes, au lieu que les vers grecs & les vers latins tirent leur harmonie du nombre des piés assortis par certaines combinaisons de longues & de breves.
« Le dactyle, l’ïambe & les autres piés entrent dans le discours ordinaire, dit Ciceron, & l’auditeur les reconnoît facilement », eosfacile agnoscit auditor. (Cic. Orator. n. LVI.) « Si dans nos Théatres, ajoûte-t-il, un Acteur prononce une syllabe breve ou longue autrement qu’elle ne doit être prononcée, selon l’usage, ou d’un ton grave ou aigu, tout le peuple se récrie. Cependant, poursuit-il, le peuple n’a point étudié la regle de notre Prosodie ; seulement il sent qu’il est blessé par la prononciation de l’Acteur : mais il ne pourroit pas démêler en quoi ni comment ; il n’a sur ce point d’autre regle que le discernement de l’oreille ; & avec ce seul secours que la nature & l’habitude lui donnent, il connoît les longues & les breves, & distingue le grave de l’aigu ». Theatra tota exclamant, si fuit una syllaba brevior aut longior. Nec verò multitudo pedes novi, nec ullos numeros tenet : nec illud quod offendit aut cur, aut in quo offendat intelligit, & tamen omnium longitudinum & brevitatum in sonis, sicut acutarum graviumque vocum, judicium ipsa natura in auribus nostris collocavit. (Cic. Orat. n. LI. fin.)
Notre Parterre démêle, avec la même finesse, ce qui est contraire à l’usage de la bonne prononciation ; & quoique la multitude ne sache pas que nous avons un e ouvert, un e fermé & un e muet, l’Acteur qui prononceroit l’un au lieu de l’autre seroit siflé.
Le célebre Lully a eu presque toûjours une extrème attention à ajuster son chant à la bonne prononciation ; par exemple il ne fait point de tenue sur les syllabes breves, ainsi dans l’opera d’Atis,
Vous vous éveillez si matin,
l’a de matin est chanté bref tel qu’il est dans le discours ordinaire ; & un Acteur qui le feroit long comme il l’est dans mâtin, gros chien, seroit également siflé parmi nous, comme il l’auroit été chez les Anciens en pareil cas.
Dans la Grammaire greque, on ne donne le nom d’accent qu’à ces trois signes, l’aigu ’, le grave ‘ & le circonflexe ~, qui servoient à marquer le ton, c’est-à-dire l’élevement & l’abaissement de la voix ; les autres signes, qui ont d’autres usages, ont d’autres noms, comme l’esprit rude, l’esprit doux, &c.
C’est une question s’il faut marquer aujourd’hui ces accens & ces esprits sur les mots grecs : le P. Sanadon, dans sa préface sur Horace, dit qu’il écrit le grec sans accens.
En effet, il est certain qu’on ne prononce les mots des langues mortes que selon les inflexions de la langue vivante ; nous ne faisons sentir la quantité du grec & du latin que sur la pénultieme syllabe, encore faut-il que le mot ait plus de deux syllabes : mais à l’égard du ton ou accent, nous avons perdu sur ce point l’ancienne prononciation ; cependant, pour ne pas tout perdre, & parce qu’il arrive souvent que deux mots ne different entr’eux que par l’accent, je crois avec l’Auteur de la Méthode greque de P. R. que nous devons conserver les accens en écrivant le grec : mais j’ajoûte que nous ne devons les regarder que comme les signes d’une prononciation qui n’est plus ; & je suis persuadé que les Savans qui veulent aujourd’hui régler leur prononciation sur ces accens, seroient siflés par les Grecs mêmes s’il étoit possible qu’ils en fussent entendus.
A l’égard des Latins, on croit communément que les accens ne furent mis en usage dans l’écriture que pour fixer la prononciation, & la faciliter aux étrangers.
Aujourd’hui, dans la Grammaire latine, on ne donne le nom d’accent qu’aux trois signes dont nous avons parlé, le grave, l’aigu & le circonflexe, & ce dernier n’est jamais marqué qu’ainsi ^, & non ~ comme en grec.
Les anciens Grammairiens latins n’avoient pas restraint le nom d’accent à ces trois signes. Priscien, qui vivoit dans le sixieme siecle, & Isidore, qui vivoit peu de tems après, disent également que les Latins ont dix accens. Ces dix accens, selon ces Auteurs, sont ;
1. L’accent aigu ’.
2. Le grave ‘.
3. Le circonflexe ~.
4. La longue barre, pour marquer une voyelle longue — , longa linea, dit Priscien ; longa virgula, dit Isidore.
5. La marque de la brieveté d’une syllabe, brevis virgula ˘.
6. L’hyphen qui servoit à unir deux mots, comme ante-tulit ; ils le marquoient ainsi, selon Priscien ‿, & ainsi selon Isidore Ω. Nous nous servons du tiret ou trait d’union pour cet usage, portemanteau, arc-en-ciel ; ce mot hyphen est purement grec, ὑπὸ, sub, & ἕν, unum.
7. La diastole au contraire étoit une marque de séparation ; on la marquoit ainsi ˀ sous le mot, supposita versui. (Isid. de fig. accentuum).
8. L’apostrophe dont nous nous servons encore ; les Anciens la mettoient aussi au haut du mot pour marquer la suppression d’une lettre, l’ame pour la ame.
9. La Δασεῖα ; c’étoit le signe de l’aspiration d’une voyelle. RAC. δασὺς, hirsutus, hérissé, rude. On le marquoit ainsi sur la lettre, c’est l’esprit rude des Grecs, dont les copistes ont fait l’h pour avoir la facilité d’écrire de suite sans avoir la peine de lever la plume pour marquer l’esprit sur la lettre aspirée.
10. Enfin, le ψιλὴ, qui marquoit que la voyelle ne devoit point être aspirée ; c’est l’esprit doux des Grecs, qui étoit écrit en sens contraire de l’esprit rude.
Ils avoient encore, comme nous, l’astérique & plusieurs autres notes dont Isidore fait mention, Orig. liv. I. & qu’il dit être très-anciennes.
Pour ce qui est des Hébreux, vers le cinquieme siecle, les Docteurs de la fameuse Ecole de Tibériade travaillerent à la critique des Livres de l’Ecriture-sainte, c’est-à-dire, à distinguer les livres apocryphes d’avec les canoniques : ensuite ils les diviserent par sections & par versets ; ils en fixerent la lecture & la prononciation par des points, & par d’autres signes que les Hébraïsans appellent accens ; desorte qu’ils donnent ce nom, non-seulement aux signes qui marquent l’élevation & l’abaissement de la voix, mais encore aux signes de la ponctuation.
Aliorum exemplo excitati vetustiores Massoretæ huic malo obviam ierunt, vocesque à vocibus distinxerunt interjecto vacuo aliquo spatiolo ; versus verò ac periodas notulis quibusdam, seu ut vocant accentibus, quos eam ob causam accentus pausantes & distinguentes, dixerunt. Masclef, Gram. Hebrai. 1731. tom. I. pag. 34.
Ces Docteurs furent appellés Massoretes, du mot massore, qui veut dire tradition ; parce que ces Docteurs s’attacherent dans leur opération à conserver, autant qu’il leur fut possible, la tradition de leurs Peres dans la maniere de lire & de prononcer.
A notre égard, nous donnons le nom d’accent premierement aux inflexions de voix, & à la maniere de prononcer des pays particuliers ; ainsi, comme nous l’avons déjà remarqué, nous disons l’accent Gascon, &c. Cet homme a l’accent étranger, c’est-à-dire, qu’il a des inflexions de voix & une maniere de parler, qui n’est pas celle des personnes nées dans la capitale. En ce sens, accent comprend l’élevation de la voix, la quantité & la prononciation particuliere de chaque mot & de chaque syllabe.
En second lieu, nous avons conservé le nom d’accent à chacun des trois signes du ton qui est ou aigu, ou grave, ou circonflexe : mais ces trois signes ont perdu parmi nous leur ancienne destination ; ils ne sont plus, à cet égard, que des accens imprimés : voici l’usage que nous en faisons en Grec, en Latin, & en François.
A l’égard du Grec, nous le prononçons à notre maniere, & nous plaçons les accens selon les regles que les Grammairiens nous en donnent, sans que ces accens nous servent de guide pour élever, ou pour abaisser le ton.
Pour ce qui est du Latin, nous ne faisons sentir aujourd’hui la quantité des mots que par rapport à la penultieme syllabe ; encore faut-il que le mot ait plus de deux syllabes ; car les mots qui n’ont que deux syllabes sont prononcés également, soit que la premiere soit longue ou qu’elle soit breve : par exemple, en vers, l’a est bref dans pater & long dans mater, cependant nous prononçons l’un & l’autre comme s’ils avoient la même quantité.
Or, dans les Livres qui servent à des lectures publiques, on se sert de l’accent aigu, que l’on place différemment, selon que la pénultieme est breve ou longue : par exemple, dans matutinus, nous ne faisons sentir la quantité que sur la pénultieme ti ; & parce que cette pénultieme est longue, nous y mettons l’accent aigu, matutínus.
Au contraire, cette pénultieme ti est breve dans serótinus ; alors nous mettons l’accent aigu sur l’antepenultieme ro, soit que dans les vers cette pénultieme soit breve ou qu’elle soit longue. Cet accent aigu sert alors à nous marquer qu’il faut s’arrêter comme sur un point d’appui sur cette antépénultieme accentuée, afin d’avoir plus de facilité pour passer légerement sur la pénultieme, & la prononcer breve.
Au reste, cette pratique ne s’observe que dans les Livres d’Eglise destinés à des lectures publiques. Il seroit à souhaiter qu’elle fût également pratiquée à l’égard des Livres Classiques, pour accoûtumer les jeunes gens à prononcer régulierement le Latin.
Nos Imprimeurs ont conservé l’usage de mettre un accent circonflexe sur l’â de l’ablatif de la premiere déclinaison. Les Anciens relevoient la voix sur l’a du nominatif, & le marquoient par un accent aigu, musá, au lieu qu’à l’ablatif ils l’élevoient d’abord, & la rabaissoient ensuite comme s’il y avoit eu musáà ; & voilà l’accent circonflexe que nous avons conservé dans l’écriture, quoique nous en ayons perdu la prononciation.
On se sert encore de l’accent circonflexe en Latin quand il y a syncope, comme virûm pour virorum ; sestertiûm pour sestertiorum.
On emploie l’accent grave sur la derniere syllabe des adverbes, malè, benè, diù, &c. Quelques-uns même veulent qu’on s’en serve sur tous les mots indéclinables, mais cette pratique n’est pas exactement suivie.
Nous avons conservé la pratique des Anciens à l’égard de l’accent aigu qu’ils marquoient sur la syllabe qui est suivie d’un enclitique, arma virúmque cano. Dans virúmque on éleve la voix sur l’u de virum, & on la laisse tomber en prononçant que, qui est un enclitique. Ne, ve sont aussi deux autres enclitiques ; desorte qu’on éleve le ton sur la syllabe qui précede l’un de ces trois mots, à peu près comme nous élevons en François la syllabe qui précede un e muet : ainsi, quoique dans mener l’e de la premiere syllabe me soit muet, cet e devient ouvert, & doit être soûtenu dans je mene, parce qu’alors il est suivi d’un e muet qui finit le mot ; cet e final devient plus aisément muet quand la syllabe qui le précede est soûtenue. C’est le méchanisme de la parole qui produit toutes ces variétés, qui paroissent des bisarreries ou des caprices de l’usage à ceux qui ignorent les véritables causes des choses.
Au reste, ce mot enclitique est purement Grec, & vient d’ἐγκλίνω, inclino, parce que ces mots sont comme inclinés & appuyés sur la derniere syllabe du mot qui les précede.
Observez que lorsque ces syllabes, que, ne, ve, font partie essentielle du mot, desorte que si vous les retranchiez, le mot n’auroit plus la valeur qui lui est propre ; alors ces syllabes n’ayant point la signification qu’elles ont quand elles sont enclitiques, on met l’accent, comme il convient, selon que la pénultieme du mot est longue ou breve ; ainsi dans ubíque on met l’accent sur la pénultieme, parce que l’i est long, au lieu qu’on le met sur l’antépénultieme dans dénique, úndique, útique.
On ne marque pas non plus l’accent sur la pénultieme avant le ne interrogatif, lorsqu’on éleve la voix sur ce ne, ego-ne ? sicci-ne ? parce qu’alors ce ne est aigu.
Il seroit à souhaiter que l’on accoûtumât les jeunes gens à marquer les accens dans leurs compositions. Il faudroit aussi que lorsque le mot écrit peut avoir deux acceptions différentes, chacune de ces acceptions fût distinguée par l’accent ; ainsi quand occido vient de cado, l’i est bref & l’accent doit être sur l’antépénultieme, au lieu qu’on doit le marquer sur la pénultieme quand il signifie tuer ; car alors l’i est long, occído, & cet occído vient de cædo.
Cette distinction devroit être marquée même dans les mots qui n’ont que deux syllabes, ainsi il faudroit écrire légit, il lit, avec l’accent aigu, & lêgit, il a lû, avec le circonflexe ; vénit, il vient, & vênit, il est venu.
A l’égard des autres observations que les Grammairiens ont faites sur la pratique des accens, par exemple quand la Méthode de P. R. dit qu’au mot muliéris, il faut mettre l’accent sur l’e, quoique bref, qu’il faut écrire flôs avec un circonflexe, spés avec un aigu, &c. Cette pratique n’étant fondée que sur la prononciation des Anciens, il me semble que non seulement elle nous seroit inutile, mais qu’elle pourroit même induire les jeunes gens en erreur en leur faisant prononcer muliéris long pendant qu’il est bref, ainsi des autres que l’on pourra voir dans la Méthode de P. R. pag. 733. 735, &c.
Finissons cet article par exposer l’usage que nous faisons aujourd’hui, en François, des accens que nous avons reçûs des Anciens.
Par un effet de ce concours de circonstances, qui forment insensiblement une langue nouvelle, nos Peres nous ont transmis trois sons différens qu’ils écrivoient par la même lettre e. Ces trois sons, qui n’ont qu’un même signe ou caractere, sont,
1°. L’e ouvert, comme dans fèr, Jupitèr, la mèr, l’enfèr, &c.
2°. L’e fermé, comme dans bonté, charité, &c.
3°. Enfin l’e muet, comme dans les monosyllabes me, ne, de, te, se, le, & dans la derniere de donne, ame, vie, &c.
Ces trois sons différens se trouvent dans ce seul mot, fermeté ; l’e est ouvert dans la premiere syllabe ser, il est muet dans la seconde me, & il est fermé dans la troisieme té. Ces trois sortes d’e se trouvent encore en d’autres mots, comme nètteté, évêque, sévère, repêché, &c.
Les Grecs avoient un caractere particulier pour l’e bref ε, qu’ils appelloient épsilon, ἐψιλον, c’est-à-dire e petit, & ils avoient une autre figure pour l’e long, qu’ils appelloient Eta, ἦτα ; ils avoient aussi un o bref, omicron, ὀμικρὸν, & un o long, omega, ὠμέγα.
Il y a bien de l’apparence que l’autorité publique, ou quelque corps respectable, & le concert des copistes avoient concouru à ces établissemens.
Nous n’avons pas été si heureux : ces finesses & cette exactitude grammaticale ont passé pour des minuties indignes de l’attention des personnes élevées. Elles ont pourtant occupé les plus grands des Romains, parce qu’elles sont le fondement de l’art oratoire, qui conduisoit aux grandes places de la République. Ciceron, qui d’Orateur devint Consul, compare ces minuties aux racines des arbres. « Elles ne nous offrent, dit-il, rien d’agréable : mais c’est de-là, ajoûte-t-il, que viennent ces hautes branches & ce verd feuillage, qui font l’ornement de nos campagnes ; & pourquoi mépriser les racines, puisque sans le suc qu’elles préparent, & qu’elles distribuent, vous ne sauriez avoir ni les branches ni le feuillage ». De syllabis propemodum denumerandis & dimetiendis loquemur ; quæ etiamsi sunt, sicut mihi videntur, necessaria, tamen fiunt magnificentiùs, quam docentur. Est enim hoc omninò verum, sed propriè in hoc dicitur. Nam omnium magnarum artium, sicut arborum, latitudo nos delectat ; radices stirpesque non item : sed, esse illa sine his, non potest. Cic. Orat. n. XLIII.
Il y a bien de l’apparence que ce n’est qu’insensiblement que l’e a eu les trois sons différens dont nous venons de parler. D’abord nos Peres conserverent le caractere qu’ils trouverent établi, & dont la valeur ne s’éloignoit jamais que fort peu de la premiere institution.
Mais lorsque chacun des trois sons de l’e est devenu un son particulier de la langue, on auroit dû donner à chacun un signe propre dans l’écriture.
Pour suppléer à ce défaut, on s’est avisé, depuis environ cent ans, de se servir des accens, & l’on a cru que ce secours étoit suffisant pour distinguer dans l’écriture ces trois sortes d’e, qui sont si bien distingués dans la prononciation.
Cette pratique ne s’est introduite qu’insensiblement, & n’a pas été d’abord suivie avec bien de l’exactitude : mais aujourd’hui que l’usage du Bureau typographique, & la nouvelle dénomination des lettres ont instruit les maîtres & les éleves ; nous voyons que les Imprimeurs & les Ecrivains sont bien plus exacts sur ce point, qu’on ne l’étoit il y a même peu d’années : & comme le point que les Grecs ne mettoient pas sur leur iota, qui est notre i, est devenu essentiel à l’i, il semble que l’accent devienne, à plus juste titre, une partie essentielle à l’e fermé, & à l’e ouvert, puisqu’il les caractérise.
1o. On se sert de l’accent aigu pour marquer le son de l’e fermé, bonté, charité, aimé.
2o. On emploie l’accent grave sur l’e ouvert, procès, accès, succès.
Lorsqu’un e muet est précedé d’un autre e, celui-ci est plus ou moins ouvert ; s’il est simplement ouvert, on le marque d’un accent grave, il mène, il pèse ; s’il est très-ouvert, on le marque d’un accent circonflexe, & s’il ne l’est presque point & qu’il soit seulement ouvert bref, on se contente de l’accent aigu, mon pére, une régle : quelques-uns pourtant y mettent le grave.
Il seroit à souhaiter que l’on introduisît un accent perpendiculaire qui tomberoit sur l’e mitoyen, & qui ne seroit ni grave ni aigu.
Quand l’e est fort ouvert, on se sert de l’accent circonflexe, tête, tempête, même, &c.
Ces mots, qui sont aujourd’hui ainsi accentués, furent d’abord écrits avec une s, beste ; on prononçoit alors cette s comme on le fait encore dans nos Provinces méridionales, beste, teste, &c. dans la suite on retrancha l’s dans la prononciation, & on la laissa dans l’écriture ; parce que les yeux y étoient accoûtumés, & au lieu de cette s, on fit la syllabe longue, & dans la suite on a marqué cette longueur par l’accent circonflexe. Cet accent ne marque donc que la longueur de la voyelle, & nullement la suppression de l’s.
On met aussi cet accent sur le vôtre, le nôtre, apôtre, bientôt, maître, afin qu’il donnât, &c. où la voyelle est longue : votre & notre, suivis d’un substantif, n’ont point d’accent.
On met l’accent grave sur l’a, préposition ; rendez à Cesar ce qui appartient à Cesar. On ne met point d’accent sur a, verbe ; il a, habet.
On met ce même accent sur là, adverbe ; il est là. On n’en met point sur la, article ; la raison. On écrit holà avec l’accent grave. On met encore l’accent grave sur où, adverbe ; où est-il ? cet où vient de l’ubi des Latins, que l’on prononçoit oubi, & l’on ne met point d’accent sur ou, conjonction alternative, vous ou moi ; Pierre ou Paul : cet ou vient de aut.
J’ajoûterai, en finissant, que l’usage n’a point encore établi de mettre un accent sur l’e ouvert quand cet e est suivi d’une consone avec laquelle il ne fait qu’une syllabe ; ainsi on écrit sans accent, la mer, le fer, les hommes, des hommes. On ne met pas non plus d’accent sur l’e qui précede l’r de l’infinitif des verbes, aimer, donner.
Mais comme les Maîtres qui montrent à lire, selon la nouvelle dénomination des lettres, en faisant épeler, font prononcer l’e ou ouvert ou fermé, selon la valeur qu’il a dans la syllabe, avant que de faire épeler la consone qui suit cet é, ces Maîtres, aussi-bien que les Etrangers, voudroient que, comme on met toûjours le point sur l’i, on donnât toûjours à l’e, dans l’écriture, l’accent propre à en marquer la prononciation ; ce qui seroit, disent-ils, & plus uniforme, & plus utile. (F)
Accent, quant à la formation, c’est, disent les Ecrivains, une vraie virgule pour l’aigu, un plain oblique incliné de gauche à droite pour le grave, & un angle aigu, dont la pointe est en haut, pour le circonflexe. Cet angle se forme d’un mouvement mixte des doigts & du poignet. Pour l’accent aigu & l’accent grave, ils se forment d’un seul mouvement des doigts.
ACCEPTABLE, adject. se dit au Palais des offres, des propositions, des voies d’accommodement qui sont raisonnables, & concilient autant qu’il est possible les droits & prétentions respectives des parties litigeantes. (H).
ACCEPTATION, s. f. dans un sens général, l’action de recevoir & d’agréer quelque chose qu’on nous offre, consentement sans lequel l’offre qu’on nous fait ne sauroit être effectuée.
Ce mot vient du latin acceptatio, qui signifie la même chose.
l’Acceptation d’une donation est nécessaire pour sa validité : c’est une solemnité qui y est essentielle. Or l’acceptation, disent les Jurisconsultes, est le concours de la volonté, ou l’agrément du donataire, qui donne la perfection à l’acte, & sans lequel le donateur peut révoquer sa donation quand il lui plaira. Voyez Donation, &c.
En matiere bénéficiale, les Canonistes, tiennent que l’acceptation doit être signifiée dans le tems même de la résignation, & non ex intervallo.
En matiere ecclésiastique, elle se prend pour une adhésion aux constitutions des Papes ou autres actes, par laquelle ils ont été reçus & déclarés obligatoires. Voyez Constitution, Bulle, &c.
Il y a deux sortes d’acceptation ; l’une solemnelle, & l’autre tacite.
L’acceptation solemnelle est un acte formel, par lequel l’acceptant condamne expressément quelque erreur ou quelque scandale que le Pape a condamné.
Quand une constitution a été acceptée par tous ceux qu’elle regarde plus particulierement, elle est supposée acceptée par tous les Prélats du monde chrétien qui en ont eu connoissance : & c’est cet acquiescement qu’on appelle acceptation tacite.
En ce sens la France, la Pologne & autres Etats, ont accepté tacitement la constitution contre la doctrine de Molinos & des Quiétistes. De même l’Allemagne, la Pologne & autres Etats catholiques, ont accepté tacitement la constitution contre Jansénius. Voyez Moliniste, Janséniste, &c.
Acceptation, en style de Commerce, se dit des lettres de change & billets à ordre. Or accepter une lettre de change, c’est reconnoître qu’on est débiteur de la somme y portée, & s’engager à la payer à son échéance ; ce qui se fait en apposant simplement par l’accepteur sa signature au bas. Voyez Lettre de change.
L’acceptation se fait ordinairement par celui sur qui la lettre est tirée lorsqu’elle lui est présentée par celui en faveur de qui elle est faite, ou à l’ordre de qui elle est passée. Tant que l’accepteur est maître de sa signature, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il ait remis la lettre acceptée au porteur, il peut rayer son acceptation : mais il ne le peut plus quand il l’a une fois délivrée. Voyez Accepteur.
Les lettres payables à vûe n’ont pas besoin d’acceptation, parce qu’elles doivent être payées dès qu’on les présente, ou à défaut de payement, protestées. Dans les lettres tirées pour un certain nombre de jours après la vûe, l’acceptation doit être datée ; parce que c’est du jour d’icelle que le tems court. La maniere d’accepter dans ce cas, est de mettre au bas, J’accepte pour tel jour, & de signer.
Les lettres de change payables à jour nommé, ou à usance, ou à double usance, n’ont pas besoin d’être datées ; l’usance servant assez pour faire connoître la date du billet. Voyez Usance. Pour accepter celles-ci, il n’est question que d’écrire au bas, Accepté, & de signer.
Si le porteur d’une lettre de change n’en fait point faire l’acceptation à tems, il n’a plus de garantie sur le tireur. Voyez Porteur. S’il se contente d’une acceptation à payer dans vingt jours après vûe, tandis que la lettre n’en portoit que huit, les douze jours de surplus sont à ses risques ; ensorte que si pendant ces douze jours l’accepteur venoit à faillir, il n’auroit pas de recours contre le tireur. Et si le porteur se contente d’une moindre somme que celle qui est portée par la lettre, le restant est pareillement à ses risques. Voyez Protêt, Endossement. (H)
* Il y a des acceptations sous condition en certain cas, comme sont celles de payer à soi-même, celles qui se font sous protêt simple, & celles sous protêt pour mettre à compte.
ACCEPTER une lettre de change, c’est la souscrire, s’engager au payement de la somme qui y est portée dans le tems marqué ; ce qui s’appelle accepter pour éviter à protêt. Voyez Lettre de change & Protêt.
Il faut prendre garde à ne point accepter des lettres que l’on n’ait provision en main, ou qu’on ne soit certain qu’elle sera remise dans le tems ; car quand une fois on a accepté une lettre, on en devient le principal débiteur : il la faut absolument acquiter à son échéance, autrement on seroit poursuivi à la requête de celui qui en est le porteur, après le protêt qu’il en auroit fait faire faute de payement.
Il est d’usage de laisser les lettres de change chez ceux sur qui elles sont tirées pour les accepter : mais les Auteurs qui ont écrit du Commerce, remarquent que cet usage est dangereux, & que surtout quand une lettre de change est signée au dos pour acquit, & qu’elle n’est pas encore acceptée, comme il peut arriver quelquefois, alors il ne faut jamais la laisser, pour quelque raison que ce soit, chez celui qui doit l’accepter, parce que s’il étoit de mauvaise foi il pourroit en mésuser. Si cependant celui chez qui une lettre de change a été laissée pour accepter, la vouloit retenir sous quelque prétexte que ce fût, la difficulté qu’il feroit de la rendre vaudroit acceptation, & il seroit obligé d’en payer le contenu.
Nous observerons pour ceux qui veulent se mêler du commerce des lettres de change, que celles qui sont tirées des places où le vieux style est en usage, comme à Londres, sur d’autres places où l’on suit le nouveau style, comme à Paris, la date differe ordinairement de dix jours ; c’est-à-dire, que si la lettre est datée à Londres le 11 Mars, ce sera le 21 Mars à Paris ; & ainsi des autres dates. Cette observation n’est pas également sûre pour tous les lieux où l’ancien style est en usage. En Suede, par exemple, la différence est toûjours de dix jours ; ce qui a changé en Angleterre depuis 1700, où elle a commencé d’être d’onze jours, à cause que cette année n’a pas été bissextile. V. Nouveau style & Vieux style. (G)
ACCEPTEUR, s. m. terme de Commerce, est celui qui accepte une lettre de change. Voyez Acceptation.
L’accepteur, qui ordinairement est celui sur qui la lettre de change est tirée, devient débiteur personnel par son acceptation, & est obligé à payer quand même le tirour viendroit à faillir avant l’échéance. Voyez Change. (G)
* Parmi les Négocians on se sert quelque fois du terme d’acceptator, qui signifie la même chose. Voyez Acceptation.
ACCEPTILATION, s. f. terme de Jurisprudence Romaine, remise qu’on fait de sa créance à son débiteur par un acte exprès ou quittance, par laquelle on le décharge de sa dette sans en recevoir le payement. (H)
ACCEPTION, s. f. terme de Grammaire, c’est le sens que l’on donne à un mot. Par exemple, ce mot esprit, dans sa premiere acception, signifie vent, souffle : mais en Métaphysique il est pris dans une autre acception. On ne doit pas dans la suite du même raisonnement le prendre dans une acception différente.
Acceptio vocis est interpretatio vocis ex mente ejus qui excipit, Sicul. p. 18. L’acception d’un mot que prononce quelqu’un qui vous parle, consiste à entendre ce mot dans le sens de celui qui l’emploie : si vous l’entendez autrement, c’est une acception différente. La plûpart des disputes ne viennent que de ce qu’on ne prend pas le même mot dans la même acception. On dit qu’un mot à plusieurs acceptions quand il peut être pris en plusieurs sens différens : par exemple, coin se prend pour un angle solide, le coin de la chambre, de la cheminée ; coin signifie une piece de bois ou de fer qui sert à fendre d’autres corps ; coin, en terme de monnoie, est un instrument de fer qui sert à marquer les monnoies, les médailles & les jettons ; coin ou coing est le fruit du coignassier. Outre le sens propre qui est la premiere acception d’un mot, on donne encore souvent au même mot un sens figuré : par exemple, on dit d’un bon livre qu’il est marqué au bon coin : coin est pris alors dans une acception figurée ; on dit plus ordinairement dans un sens figuré. (F)
Acception, en Medecine, se dit de tout ce qui est reçû dans le corps, soit par la peau, soit par le canal alimentaire. (N)
ACCÈS ; ce mot vient du latin accessus, qui signifie approcher, l’action par laquelle un corps s’approche de l’autre : mais il n’est pas usité en François dans ce sens littéral. Il signifie dans l’usage ordinaire abord, entrée, facilité d’aborder quelqu’un, d’en approcher. V. Entrée, Admission. Ainsi l’on dit : cet homme a accès auprès du Prince. Cette côte est de difficile accès, à cause des rochers qui la bordent. (F)
* Accès, avoir accès, aborder, approcher. On a accès où l’on entre ; on aborde les personnes à qui l’on veut parler ; on approche celles avec qui l’on est souvent. Les Princes donnent accès, se laissent aborder, permettent qu’on les approche ; l’accès en est facile ou difficile ; l’abord rude ou gracieux ; l’approche utile ou dangereuse. Qui a des connoissances peut avoir accès ; qui a de la hardiesse aborde ; qui joint à la hardiesse un esprit souple & flateur, peut approcher les Grands. Voyez les Synonymes de M. l’Abbé Girard.
Accès, en Medecine, se dit du retour périodique de certaines maladies qui laissent de tems en tems des intervalles de relâche au malade. Voyez Périodique.
Ainsi l’on dit un accès de goute, mais plus spécialement un accès de fievre, d’épilepsie, de folie : on dit aussi un accès prophétique.
On confond bien souvent accès avec paroxysme, cependant ce sont deux choses différentes ; l’accès n’étant proprement que le commencement ou la premiere attaque de la maladie, au lieu que le paroxysme en est le plus fort & le plus haut degré. Voyez Paroxysme. (N)
Accès, terme usité à la Cour de Rome, lorsqu’à l’élection des Papes les voix se trouvant partagées, quelques Cardinaux se désistent de leur premier suffrage, & donnent leur voix à un Sujet qui en a déjà d’autres, pour en augmenter le nombre. Ce mot vient du latin accessus, dérivé d’accedo, accéder, se joindre.
Accès, en Droit canonique, signifioit la faculté qu’on accordoit à quelqu’un pour posséder un Bénéfice après la mort du Titulaire, ou parce que celui à qui on accordoit cette faculté, n’avoit pas encore l’âge compétent, auquel cas on donnoit en attendant le Bénéfice à un autre, & lorsqu’il avoit atteint l’âge requis, il entroit dans son Bénéfice sans nouvelle provision.
Le Concile de Trente, Session XXV. chap. VII. a abrogé les accès. Il réserve seulement au Pape la faculté de nommer des Coadjuteurs aux Archevêques & Evêques, pourvû qu’il y ait nécessité pressante, & que ce soit en connoissance de cause.
La différence que les Canonistes mettent entre l’accès & le regrès, c’est que le regrès habet causam de præterito, parce qu’il faut pour l’exercer avoir eu droit au Bénéfice, au lieu que l’accès habet causam de futuro. Voyez Regrès. (H)
ACCESSIBLE, adj. ce dont on peut aborder, qui peut être approché.
On dit : cette place ou cette forteresse est accessible du côté de la mer, c’est-à-dire, qu’on peut y entrer par ce côté-là.
Une hauteur ou distance accessible, en Géométrie, est celle qu’on peut mesurer méchaniquement en y appliquant la mesure ; ou bien c’est une hauteur, du pié de laquelle on peut approcher, & d’où l’on peut mesurer quelque distance sur le terrein. Voyez Distance, &c.
Avec le quart de cercle on peut prendre les hauteurs tant accessibles qu’inaccessibles. Voyez Hauteur, Quart de cercle, &c.
Un des objets de l’arpentage est de mesurer non seulement les distances accessibles, mais aussi les inaccessibles. Voyez Arpentage. (E)
ACCESSION, s. f. terme de Pratique, est l’action d’aller dans un lieu. Ainsi l’on dit en ce sens ; le Juge a ordonné une accession en tel endroit, pour y dresser un procès-verbal de l’état des choses.
Accession, en Droit, est l’union, l’adjection d’une chose à une autre, au moyen de laquelle celle qui a été ajoûtée, commence dès-lors à appartenir au propriétaire de la premiere. Voyez Accessoire & Accroissement.
Accession est encore synonyme à accès, terme usité à la Cour de Rome. Voyez ci-dessus Accès. (H).
* ACCESSIT, terme Latin usité dans les Colléges, se dit dans les distributions des prix, des Ecoliers qui ont le mieux réussi après ceux qui ont obtenu les prix, & qui par conséquent en ont le plus approché. Il y a presque toûjours plusieurs accessit. Les Académies qui distribuent des prix, donnent souvent aussi des accessit.
ACCESSOIRE, terme de Droit Civil, est une chose ajoûtée ou survenue à une autre plus essentielle ou d’un plus grand prix. Voyez Accession.
En ce sens accessoire est opposé à principal.
Ainsi l’on dit en Droit, que la pourpre en laquelle on a teint un drap, n’étant que l’accessoire du drap, appartient à celui qui est le maître du drap. (H)
Accessoires, adj. pris subst. accessoires de Willis ou par accessorium, en Anatomie, sont une paire de nerfs, qui viennent de la moelle épiniere, entre la partie antérieure & postérieure de la quatrieme paire des nerfs cervicaux ; ensuite ils montent vers le crane, & y étant entrés, ils en sortent avec la paire vague ou huitieme paire, enveloppés avec elle dans une membrane commune ; après quoi ils abandonnent la huitieme paire, & vont se distribuer aux muscles du cou & de l’omoplate.
Ces nerfs-ci, en montant vers le crane, reçoivent des branches de chacune des cinq premieres paires cervicales près de leur origine de la moëlle de l’épine, & fournissent des rameaux aux muscles du larynx, du pharynx, &c. s’unissant avec une branche du nerf intercostal, ils forment le plexus ganglio-forme. Voyez Plexus. (N)
Accessoires, s. m. pl. en Peinture, sont des choses qu’on fait entrer dans la composition d’un tableau, comme vases, armures, animaux, qui sans y être absolument nécessaires, servent beaucoup à l’embellir, lorsque le Peintre sait les y placer sans choquer les convenances. (R)
* ACCHO, ville de Phénicie, qui fut donnée à la tribu d’Azer ; il y en a qui prétendent que c’est la même ville que Acé ou Ptolémaïs ; d’autres que c’est Accon.
ACCIB, s. m. Chimie : il y en a qui se sont servis de ce mot pour signifier le Plomb. Voyez Plomb, Saturne, Alabari, Aabam (M)
ACCIDENT, s. m. terme de Grammaire ; il est surtout en usage dans les anciens Grammairiens ; ils ont d’abord regardé le mot comme ayant la propriété de signifier. Telle est, pour ainsi dire, la substance du mot, c’est ce qu’ils appellent nominis positio : ensuite ils ont fait des observations particulieres sur cette position ou substance Métaphysique, & ce sont ces observations qui ont donné lieu à ce qu’ils ont appellé accidens des dictions, dictionum accidentia.
Ainsi par accident les Grammairiens entendent une propriété, qui, à la vérité, est attachée au mot, mais qui n’entre point dans la définition essentielle du mot ; car de ce qu’un mot sera primitif ou qu’il sera dérivé, simple ou composé, il n’en sera pas moins un terme ayant une signification. Voici quels sont ces accidens.
1. Toute dicion ou mot peut avoir un sens propre ou un sens figuré. Un mot est au propre, quand il signifie ce pourquoi il a été premierement établi : le mot Lion a été d’abord destiné à signifier cet animal qu’on appelle Lion : je viens de la foire, j’y ai vû un beau Lion ; Lion est pris là dans le sens propre : mais si en parlant d’un homme emporté je dis que c’est un lion, lion est alors dans un sens figuré. Quand par comparaison ou analogie un mot se prend en quelque sens autre que celui de sa premiere destination, cet accident peut être appellé l’acception du mot.
2. En second lieu, on peut observer si un mot est primitif, ou s’il est dérivé.
Un mot est primitif, lorsqu’il n’est tiré d’aucun autre mot de la Langue dans laquelle il est en usage. Ainsi en François Ciel, Roi, bon, sont des mots primitifs.
Un mot est dérivé lorsqu’il est tiré de quelqu’autre mot comme de sa source : ainsi céleste, royal, royaume, royauté, royalement, bonté, bonnement, sont autant de dérivés. Cet accident est appellé par les Grammairiens l’espece du mot ; ils disent qu’un mot est de l’espece primitive ou de l’espece dérivée.
3. On peut observer si un mot est simple ou s’il est composé ; juste, justice, sont des mots simples : injuste, injustice, sont composés. En Latin res est un mot simple, publica est encore simple, mais respublica est un mot composé.
Cet accident d’être simple ou d’être composé a été appellé par les anciens Grammairiens la figure. Ils disent qu’un mot est de la figure simple ou qu’il est de la figure composée ; en sorte que figure vient ici de fingere, & se prend pour la forme ou constitution d’un mot qui peut être ou simple ou composé. C’est ainsi que les Anciens ont appellé vasa fictilia, ces vases qui se font en ajoûtant matiere à matiere, & figulus l’ouvrier qui les fait, à fingendo.
4. Un autre accident des mots regarde la prononciation ; sur quoi il faut distinguer l’accent, qui est une élévation ou un abaissement de la voix toûjours invariable dans le même mot ; & le ton & l’emphase qui sont des infléxions de voix qui varient selon les diverses passions & les différentes circonstances, un ton fier, un ton soûmis, un ton insolent, un ton piteux. Voyez Accent.
Voilà quatre Accidens qui se trouvent en toutes sortes des mots. Mais de plus chaque sorte particuliere de mots a ses accidens qui lui sont propres ; ainsi le nom substantif a encore pour accidens le genre. Voyez Genre ; le cas, la déclinaison, le nombre, qui est ou singulier ou pluriel, sans parler du duel des Grecs.
Le nom adjectif a un accident de plus, qui est la comparaison ; doctus, doctior, doctissimus ; savant, plus savant, très-savant.
Les pronoms ont les mêmes accidens que les noms.
A l’égard des verbes, ils ont aussi par accident l’acception, qui est ou propre ou figurée : ce vieillard marche d’un pas ferme, marcher est là au propre : celui qui me suit ne marche point dans les ténebres, dit Jesus-Christ ; suit & marche sont pris dans un sens figuré, c’est-à-dire, que celui qui pratique les maximes de l’Evangile, a une bonne conduite & n’a pas besoin de se cacher ; il ne fuit point la lumiere, il vit sans crainte & sans remords.
2. L’espece est aussi un accident des verbes ; ils sont ou primitifs, comme parler, boire, sauter, trembler ; ou dérivés, comme parlementer, buvoter, sautiller, trembloter. Cette espece de verbes dérivés en renferme plusieurs autres ; tels sont les inchoatifs, les fréquentatifs, les augmentatifs, les diminutifs, les imitatifs, & les désidératifs.
3. Les verbes ont aussi la figure, c’est-à-dire qu’ils sont simples, comme venir, tenir, faire ; ou composés, comme prevenir, convenir, refaire, &c.
4. La voix ou forme du verbe : elle est de trois sortes, la voix ou forme active, la voix passive & la forme neutre.
Les verbes de la voix active sont ceux dont les terminaisons expriment une action qui passe de l’agent au patient, c’est-à-dire, de celui qui fait l’action sur celui qui la reçoit : Pierre bat Paul ; bat est un verbe de la forme active, Pierre est l’agent, Paul est le patient ou le terme de l’action de Pierre. Dieu conserve ses créatures ; conserve est un verbe de la forme active.
Le verbe est à la voix passive, lorsqu’il signifie que le sujet de la proposition est le patient, c’est-à-dire, qu’il est le terme de l’action ou du sentiment d’un autre : les méchans sont punis, vous serez pris par les ennemis ; sont punis, serez pris, sont de la forme passive.
Le verbe est à la forme neutre, lorsqu’il signifie une action ou un état qui ne passe point du sujet de la proposition sur aucun autre objet extérieur ; comme il pâlit, il engraisse, il maigrit, nous courons, il badine toûjours, il rit, vous rajeunissez, &c.
5. Le mode, c’est-à-dire les différentes manieres d’exprimer ce que le verbe signifie, ou par l’indicatif qui est le mode direct & absolu ; ou par l’impératif, ou par le subjonctif, ou enfin par l’infinitif.
6. Le sixieme accident des verbes, c’est de marquer le tems par des terminaisons particulieres : j’aime, j’aimois, j’ai aimé, j’avois aimé, j’aimerai.
7. Le septieme accident est de marquer les personnes grammaticales, c’est-à-dire, les personnes relativement à l’ordre qu’elles tiennent dans la formation du discours, & en ce sens il est évident qu’il n’y a que trois personnes.
La premiere est celle qui fait le discours, c’est-à-dire, celle qui parle, je chante ; je est la premiere personne, & chante est le verbe à la premiere personne, parce qu’il est dit de cette premiere personne.
La seconde personne est celle à qui le discours s’adresse ; tu chantes, vous chantez, c’est la personne à qui l’on parle.
Enfin, lorsque la personne ou la chose dont on parle n’est ni à la premiere ni à la seconde personne, alors le verbe est dit être à la troisieme personne ; Pierre écrit, écrit est à la troisieme personne : le soleil luit, luit est à la troisieme personne du présent de l’indicatif du verbe luire.
En Latin & en Grec les personnes grammaticales sont marquées, aussi-bien que les tems, d’une maniere plus distincte, par des terminaisons particulieres, τύπτω, τύπτεις, τύπτει, τύπτομεν, τύπτετε, τύπτουσι, canto, cantas, cantat, cantavi, cantavisti, cantavit ; cantaveram, cantabo, &c. au lieu qu’en François la différence des terminaisons n’est pas souvent bien sensible ; & c’est pour cela que nous joignons aux verbes les pronoms qui marquent les personnes, je chante, tu chantes, il chante.
8. Le huitieme accident du verbe est la conjugaison. La conjugaison est une distribution ou liste de toutes les parties & de toutes les infléxions du verbe, selon une certaine analogie. Il y a quatre sortes d’analogies en Latin par rapport à la conjugaison ; ainsi il y a quatre conjugaisons : chacune a son paradigme, c’est-à-dire un modele sur lequel chaque verbe régulier doit être conjugué ; ainsi amare, selon d’autres cantare, est le paradigme des verbes de la premiere conjugaison, & ces verbes, selon leur analogie, gardent l’a long de l’infinitif dans presque tous leurs tems & dans presque toutes les personnes. Amare, amabam, amavi, amaveram, amabo, amandum, amatum, &c.
Les autres conjugaisons ont aussi leur analogie & leur paradigme.
Je crois qu’à ces quatre conjugaisons on doit en ajoûter une cinquieme, qui est une conjugaison mixte, en ce qu’elle a des personnes qui suivent l’analogie de la troisieme conjugaison, & d’autres celle de la quatrieme ; tels sont les verbes en ere, io, comme capere, capio ; on dit à la premiere personne du passif capior, je suis pris, comme audior ; cependant on dit caperis à la seconde personne, & non capiris, quoiqu’on dise audior, audiris. Comme il y a plusieurs verbes en ere, io, suscipere suscipio, interficere interficio, elicere, io, excutere, io, fugere fugio, &c. & que les commençans sont embarrassés à les conjuguer, je crois que ces verbes valent bien la peine qu’on leur donne un paradigme ou modele.
Nos Grammairiens content aussi quatre conjugaisons de nos verbes François.
1. Les verbes de la premiere conjugaison ont l’infinitif en er, donner.
2. Ceux de la seconde ont l’infinitif en ir, punir.
3. Ceux de la troisieme ont l’infinitif en oir, devoir.
4. Ceux de la quatrieme ont l’infinitif en re, dre, tre, faire, rendre, mettre.
La Grammaire de la Touche voudroit une cinquieme conjugaison des verbes en aindre, eindre, oindre, tels que craindre, feindre, joindre, parce que ces verbes ont une singularité qui est de prendre le g pour donner un son mouillé à l’n en certains tems, nous craignons, je craignis, je craignisse, craignant.
Mais le P. Buffier observe qu’il y a tant de différentes infléxions entre les verbes d’une même conjugaison, qu’il faut, ou ne reconnoître qu’une seule conjugaison, ou en reconnoître autant que nous avons de terminaisons différentes dans les infinitifs. Or M. l’Abbé Regnier observe que la Langue Françoise a jusqu’à vingt-quatre terminaisons différentes à l’infinitif.
9. Enfin le dernier accident des verbes est l’analogie ou l’anomalie, c’est-à-dire d’être réguliers & de suivre l’analogie de leur paradigme, ou bien de s’en écarter ; & alors on dit qu’ils sont irréguliers ou anomaux.
Que s’il arrive qu’ils manquent de quelque mode, de quelque tems, ou de quelque personne, on les appelle défectifs.
A l’égard des prépositions, elles sont toutes primitives & simples, à, de, dans, avec, &c. sur quoi il faut observer qu’il y a des Langues qui énoncent en un seul mot ces vûes de l’esprit, ces rapports, ces manieres d’être, au lieu qu’en d’autres Langues ces mêmes rapports sont divisés par l’élocution & exprimés par plusieurs mots, par exemple, coram patre, en présence de son pere ; ce mot coram, en Latin, est un mot primitif & simple qui n’exprime qu’une maniere d’être considérée par une vûe simple de l’esprit.
L’élocution n’a point en François de terme pour l’exprimer ; on la divise en trois mots, en présence de. Il en est de même de propter, pour l’amour de, ainsi de quelques autres expressions que nos Grammairiens François ne mettent au nombre des prépositions, que parce qu’elles répondent à des prépositions Latines.
La préposition ne fait qu’ajoûter une circonstance ou maniere au mot qui précede, & elle est toûjours considérée sous le même point de vûe, c’est toûjours la même maniere ou circonstance qu’elle exprime ; il est dans ; que ce soit dans la ville, ou dans la maison, ou dans le coffre, ce sera toûjours être dans. Voilà pourquoi les propositions ne se déclinent point.
Mais il faut observer qu’il y a des prépositions séparables, telles que dans, sur, avec, &c. & d’autres qui sont appellées inséparables, parce qu’elles entrent dans la composition des mots, de façon qu’elles n’en peuvent être séparées sans changer la signification particuliere du mot ; par exemple, refaire, surfaire, défaire, contrefaire, ces mots, re, sur, dé, contre, &c. sont alors des prépositions inséparables, tirées du Latin. Nous en parlerons plus en détail au mot Préposition.
A l’égard de l’adverbe, c’est un mot qui, dans sa valeur, vaut autant qu’une préposition & son complément. Ainsi prudemment, c’est avec prudence, sagement, avec sagesse, &c. Voyez Adverbe.
Il y a trois accidens à remarquer dans l’adverbe outre la signification, comme dans tous les autres mots. Ces trois accidens sont,
1. L’espece, qui est ou primitive ou dérivative : ici, là, ailleurs, quand, lors, hier, où, &c. sont des adverbes de l’espece primitive, parce qu’ils ne viennent d’aucun autre mot de la Langue.
Au lieu que justement, sensément, poliment, absolument, tellement, &c. sont de l’espece dérivative ; ils viennent des noms adjectifs juste, sensé, poli, absolu, tel, &c.
2. La figure, c’est d’être simple ou composé. Les adverbes sont de la figure simple, quand aucun autre mot ni aucune préposition inséparable n’entre dans leur composition ; ainsi justement, lors, jamais, sont des adverbes de la figure simple.
Mais injustement, alors, aujourd’hui, & en Latin hodie, sont de la figure composée.
3. La comparaison est le troisieme accident des adverbes. Les adverbes qui viennent des noms de qualité se comparent, justement, plus justement, très ou fort justement, le plus justement, bien, mieux, le mieux, mal, pis, le pis, plus mal, très mal, fort mal, &c.
A l’égard de la conjonction, c’est-à-dire, de ces petits mots qui servent à exprimer la liaison que l’esprit met entre des mots & des mots, ou entre des phrases & des phrases ; outre leur signification particuliere, il y a encore leur figure & leur position.
1. Quant à la figure, il y en a de simples, comme &, ou, mais, si, car, ni, &c.
Il y en a beaucoup de composées, & si, mais si, & même il y en a qui sont composées de noms ou de verbes, par exemple, à moins que, desorte que, bien entendu que, pourvû que.
2. Pour ce qui est de leur position, c’est-à-dire, de l’ordre ou rang que les conjonctions doivent tenir dans le discours, il faut observer qu’il n’y en a point qui ne suppose au-moins un sens précedent ; car ce qui joint doit être entre deux termes. Mais ce sens peut quelquefois être transposé, ce qui arrive avec la conditionnelle si, qui peut fort bien commencer un discours ; si vous êtes utile à la société, elle pourvoira à vos besoins. Ces deux phrases sont liées par la conjonction si ; c’est comme s’il y avoit, la société pourvoira à vos besoins, si vous y êtes utile.
Mais vous ne sauriez commencer un discours par mais, &, or, donc, &c. c’est le plus ou moins de liaison qu’il y a entre la phrase qui suit une conjonction & celle qui la précede, qui doit servir de regle pour la ponctuation.
* Ou s’il arrive qu’un discours commence par un or ou un donc, ce discours est censé la suite d’un autre qui s’est tenu intérieurement, & que l’Orateur ou l’écrivain a sous-entendu, pour donner plus de véhémence à son début. C’est ainsi qu’Horace a dit au commencement d’une Ode :
Ergo Quintilium perpetuus sopor
Urget. . . . .
Et Malherbe dans son Ode à Louis XIII. partant pour la Rochelle :
Donc un nouveau labeur à tes armes s’apprête ;
Prens ta foudre, Loüis. . . . .
A l’égard des interjections, elles ne servent qu’à marquer des mouvemens subits de l’ame. Il y a autant de sortes d’interjections, qu’il y a de passions différentes. Ainsi il y en a pour la tristesse & la compassion, hélas ! ha ! pour la douleur, ai ai, ha ! pour l’aversion & le dégoût, fi. Les interjections ne servant qu’à ce seul usage, & n’étant jamais considérées que sous la même face, ne sont sujettes à aucun autre accident. On peut seulement observer qu’il y a des noms, des verbes, & des adverbes, qui étant prononcés dans certains mouvemens de passions ont la force de l’interjection, courage, allons, bon-Dieu, voyez, marche, tout beau, paix, &c. c’est le ton plûtôt que le mot qui fait alors l’interjection. (F)
Accident, s. m. en Logique, quand on joint une idée confuse & indéterminée de substance avec une idée distincte de quelque mode : cette idée est capable de représenter toutes les choses où sera ce mode ; comme l’idée de prudent, tous les hommes prudens, l’idée de rond, tous les corps ronds. Cette idée exprimée par un terme adjectif, prudent, rond, donne le cinquieme universel qu’on appelle accident, parce qu’il n’est pas essentiel à la chose à laquelle on l’attribue ; car s’il l’étoit, il seroit différence ou propre.
Mais il faut remarquer ici, que quand on considere deux substances ensemble, on peut en considérer une comme mode de l’autre. Ainsi un homme habillé peut être considéré comme un tout composé de cet homme & de ses habits : mais être habillé à l’égard de cet homme, est seulement un mode ou une façon d’être, sous laquelle on le considere, quoique ses habits soient des substances. V. Universaux. (X)
* Les Aristotéliciens, après avoir distribué les êtres en dix classes, réduisoient ces dix classes à deux générales ; à la classe de la substance, ou de l’être qui existe par lui-même, & à la classe de l’accident, ou de l’être qui est dans un autre, comme dans un sujet.
De la classe de l’accident, ils en faisoient neuf autres, la quantité, la relation, la qualité, l’action, la passion, le tems, le lieu, la situation, & l’habitude.
Accident, en Medecine, signifie une révolution qui occasionne une maladie, ou quelqu’autre chose de nouveau qui donne de la force à une maladie déjà existante. La suppression subite des crachats dans la péripneumonie est un accident fâcheux. Les plus fameux Praticiens en Medecine recommandent d’avoir communément plûtôt égard à la violence des accidens qu’à la cause de la maladie ; parce que leur durée pourroit tellement augmenter la maladie, qu’elle deviendroit incurable. V. Symptome. (N)
Accident, en Peinture. On dit des accidens de lumiere, lorsque les nuages interposés entre le soleil & la terre produisent sur la terre des ombres qui l’obscurcissent par espace ; l’effet que produit le soleil sur ces espaces qui en restent éclairés, s’appelle accident de lumiere. Ces accidens produisent des effets merveilleux dans un tableau.
On appelle encore accident de lumiere, les rayons qui viennent par une porte, par une lucarne, ou d’un flambeau, lorsque cependant ils ne font pas la lumiere principale d’un tableau. (R)
Accident se dit aussi en Fauconnerie. Les oiseaux de proie sont sujets à plusieurs accidens ; il arrive quelquefois que les faucons sont blessés en attaquant le milan ou le héron : si la blessure est légere, vous la guérirez avec le remede suivant : mettez dans un pot verni une pinte de bon verjus ; faites-y infuser pendant douze heures pimprenelle & consoude de chacune une poignée, avec deux onces d’aloès & autant d’encens, une quantité suffisante d’origan, & un peu de mastic ; l’infusion étant faite, passez le tout par un linge avec expression, & gardez ce remede pour le besoin. On se sert de cette colature pour étuver doucement la blessure qui se guérit par ce moyen aisément.
Si la blessure est considérable, il faut d’abord couper la plume pour empêcher qu’elle ne s’y attache, & y mettre une tente imbibée de baume ou d’huile de millepertuis.
Si la blessure est interne, ayant été causée par l’effort qu’a fait le faucon en fondant sur sa proie, il faut prendre un boyau de poule ou de pigeon, vuider & laver bien ce boyau, puis mettre dedans de la momie, & faire avaler le tout à l’oiseau ; il vomira sur le champ le sang qui sera caillé dans son corps, & peu de tems après il sera guéri.
Si la blessure de l’oiseau est considérable, mais extérieure, & que les nerfs soient offensés, il faudra premierement la bien étuver avec un liniment fait avec du vin blanc, dans lequel on aura fait infuser des roses seches, de l’écorce de grenade, un peu d’absinthe & d’alun, ensuite on y appliquera de la térebenthine.
ACCIDENTEL, adj. en Physique, se dit d’un effet qui arrive, ou d’une chose qui agit par accident, pour ainsi dire, sans être ou du moins sans paroître sujette à des lois, ni à des retours réglés. En ce sens accidentel est opposé à constant & principal. Ainsi la situation du soleil à l’égard de la terre, est la cause constante & principale du chaud de l’été, & du froid de l’hyver : mais les vents, les pluies, &c. en sont les causes accidentelles, qui alterent & modifient souvent l’action de la cause principale.
Point accidentel, en perspective, est un point de la ligne horisontale où se rencontrent les projections de deux lignes qui sont paralleles l’une à l’autre, dans l’objet qu’on veut mettre en perspective, & qui ne sont pas perpendiculaires au tableau. On appelle ce point accidentel, pour le distinguer du point principal, qui est le point où tombe la perpendiculaire menée de l’œil au tableau, & où se rencontrent les projections de toutes les lignes perpendiculaires au tableau. Voyez Ligne horisontale. (O)
ACCISE, s. f. terme de Commerce, droit qui se paye à Amsterdam, & dans tous les Etats des Provinces-Unies sur diverses sortes de marchandises & de denrées, comme sont le froment, & d’autres grains, la bierre, les tourbes, le charbon de terre.
Les droits d’accise du froment se payent à Amsterdam à raison de trente sols le last, soit que les grains soient chers, soit qu’ils soient à bon marché, outre les droits d’entrée qui sont de dix florins, non compris ce que les Boulangers & les Bourgeois payent pour le mesurage, le courtage, & le port à leurs maisons. (G)
ACCLAMATION, s. f. marque de joie ou d’applaudissement par lequel le public témoigne son estime ou son approbation. L’antiquité nous a transmis plusieurs sortes d’acclamations. Les Hébreux avoient coûtume de crier hosanna ; les Grecs ἄγαθη τυχὴ, bonne fortune. Il est parlé dans les Historiens de quelques Magistrats d’Athenes qui étoient élûs par acclamation. Cette acclamation ne se manifestoit point par des cris, mais en élevant les mains. Les Barbares témoignoient leur approbation par un bruit confus de leurs armes. Nous connoissons plus en détail sur ce point les usages des Romains, dont on peut réduire les acclamations à trois especes différentes ; celles du peuple, celles du Sénat, & celles des assemblées des gens de Lettres.
Les acclamations du peuple avoient lieu aux entrées des Généraux & des Empereurs, aux spectacles donnés par les Princes ou les Magistrats, & aux triomphes des vainqueurs. D’abord ce n’étoit que les cris confus d’une multitude transportée de joie, & l’expression simple & sans fard de l’admiration publique, plausus tunc arte carebat, dit Ovide. Mais sous les Empereurs, & même dès Auguste, ce mouvement impétueux auquel le peuple s’abandonnoit comme par enthousiasme, devint un art, un concert apprêté. Un Musicien donnoit le ton, & le peuple faisant deux chœurs répétoit alternativement la formule d’acclamation. La fausse nouvelle de la convalescence de Germanicus s’étant répandue à Rome, le peuple courut en foule au Capitole avec des flambeaux & des victimes en chantant, salva Roma, salva patria, salvus est Germanicus. Néron passionné pour la musique, lorsqu’il joüoit de la lyre sur le théatre, avoit pour premiers acclamateurs Seneque & Burrhus, puis cinq mille soldats nommés Augustales, qui entonnoient ses louanges, que le reste des spectateurs étoit obligé de répéter. Ces acclamations en musique durerent jusqu’à Théodoric. Aux acclamations se joignoient les applaudissemens aussi en cadence. Les formules les plus ordinaires étoient feliciter, longiorem vitam, annos felices ; celles des triomphes étoient des vers à la loüange du Général, & les soldats & le peuple crioient par intervalles ïo triumphe : mais à ces loüanges le soldat mêloit quelquefois des traits piquans & satyriques contre le vainqueur.
Les acclamations du Sénat, quoique plus sérieuses, avoient le même but d’honorer le Prince, & souvent de le flatter. Les Sénateurs marquoient leur consentement à ses propositions par ces formules, omnes, omnes, æquum est, justum est. On a vû des élections d’Empereurs se faire par acclamation, sans aucune délibération précédente.
Les gens de Lettres récitoient ou déclamoient leurs pieces dans le Capitole ou dans les Temples, & en présence d’une nombreuse assemblée. Les acclamations s’y passoient à peu près comme celles des spectacles, tant pour la musique que pour les accompagnemens. Elles devoient convenir au sujet & aux personnes ; il y en avoit de propres pour les Philosophes, pour les Orateurs, pour les Historiens, pour les Poëtes. Une des formules les plus ordinaires étoit le sophos qu’on répétoit trois fois. Les comparaisons & les hyperboles n’étoient point épargnées, surtout par les admirateurs à gages payés pour applaudir ; car il y en avoit de ce genre, au rapport de Philostrate. (G)
ACCLAMPER, acclampe, mât acclampé, mât jumellé. C’est un mât fortifié par les pieces de bois attachées à ses côtés. Voyez Clamp & Jumelle. (Z)
ACCLIVITAS, s. f. pente d’une ligne ou d’un plan incliné à l’horison, prise en montant. Voyez Plan incliné.
Ce mot est tout latin : il vient de la proposition ad, & de clivus, pente, penchant.
La raison pour laquelle nous insérons ici ce mot, c’est qu’il se trouve dans quelques ouvrages de Physique & de Méchanique, & qu’il n’y a point de mot françois qui lui réponde.
La pente, prise en descendant, se nomme declivitas.
Quelques auteurs de fortifications ont employé acclivitas pour synonyme à talud.
Cependant le mot talud est d’ordinaire employé indifféremment pour désigner la pente, soit en montant, soit en descendant. (O)
ACCOINTANCE, s. f. vieux mot qui s’emploie encore quelquefois au Palais, pour signifier un commerce illicite avec une femme ou une fille. (H)
ACCOISEMENT, s. m. terme de Medecine. Il n’est d’usage que dans cette phrase, l’accoisement des humeurs ; & il désigne alors la cessation d’un mouvement excessif excité en elles par quelque cause que ce soit. Voyez Calme. (N)
ACCOISER, v. act. en Medecine, calmer, appaiser, rendre coi. Accoiser les humeurs, les humeurs sont accoisées. (N)
ACCOLADE, s. f cérémonie qui se pratiquoit en conférant un Ordre de Chevalerie, dans le tems où les Chevaliers étoient reçûs en cette qualité par les Princes chrétiens. Elle consistoit en ce que le Prince armoit le nouveau Chevalier, l’embrassoit ensuite en signe d’amitié, & lui donnoit sur l’épaule un petit coup du plat d’une épée. Cette marque de faveur & de bienveillance est si ancienne, que Grégoire de Tours écrit que les Rois de France de la premiere race, donnant le baudrier & la ceinture dorée, baisoient les Chevaliers à la joue gauche, en proférant ces paroles, au nom du Pere & du Fils & du Saint-Esprit, & comme nous venons de dire, les frappoient de l’épée légerement sur l’épaule. Ce fut de la sorte que Guillaume le conquérant, Roi d’Angleterre, conféra la Chevalerie à Henri son fils âgé de dix-neuf ans, en lui donnant encore des armes ; & c’est pour cette raison que le Chevalier qui recevoit l’accolade étoit nommé Chevalier d’armes, & en latin Miles ; parce qu’on le mettoit en possession de faire la guerre, dont l’épée, le haubert, & le heaume, étoient les symboles. On y ajoûtoit le collier comme la marque la plus brillante de la Chevalerie. Il n’étoit permis qu’à ceux qui avoient ainsi reçû l’accolade de porter l’épée, & de chausser des éperons dorés ; d’où ils étoient nommés Equites aurati, différant par-là des Ecuyers qui ne portoient que des éperons argentés. En Angleterre, les simples Chevaliers ne pouvoient porter que des cornettes chargées de leurs armes : mais le Roi les faisoit souvent Chevaliers Bannerets en tems de guerre, leur permettant de porter la banniere comme les Barons. Voyez Banneret. (G)
Accolade, en Musique, est un trait tiré à la marge de haut en bas, par lequel on joint ensemble dans une partition les portées de toutes les différentes parties. Comme toutes ces parties doivent s’exécuter en même tems, on compte les lignes d’une partition, non par le nombre des portées, mais par celui des accolades ; car tout ce qui est sous une accolade ne forme qu’une seule ligne. V. Partition. (S)
* ACCOLAGE, s. m. se dit de la vigne : c’est un travail qui consiste à attacher les sarmens aux échalas. Il y a des pays où on les lie ou accole, car ces termes sont synonymes, aussitôt qu’ils sont taillés. Il y en a d’autres où on n’accole que ceux qui sont crus depuis la taille.
Il faut commencer l’accolage de bonne heure. On dit que pour qu’il fût aussi utile qu’il doit l’être, il faudroit s’y prendre à deux fois : la premiere, on accoleroit les bourgeons des jeunes vignes au bas seulement, afin qu’ils ne se mêlassent point les uns avec les autres, ni par le milieu, ni par le haut ; cette précaution empêcheroit qu’on ne les cassât, quand il s’agiroit de les séparer pour les accoler entierement. La seconde fois, on les accoleroit tous généralement. Quoiqu’entre les bourgeons il y en eût de plus grands les uns que les autres, il seroit nécessaire de les accoler tous la premiere fois & par le haut & par le bas : si on attendoit qu’ils fussent tous à peu près de la même hauteur pour leur donner la même façon, un vent qui surviendroit pourroit les casser : mais les vignerons n’ont garde d’avoir toutes ces attentions, à moins que la vigne ne leur appartienne.
ACCOLER, v. a. c’est attacher une branche d’arbre ou un sep de vigne à un échalas ou sur un treillage d’espalier, afin qu’en donnant plus d’air aux fruits & aux raisins, leur maturité soit plus parfaite, & leur goût plus exquis. (K)
On dit accoler la vigne à l’échalas ; c’est l’attacher à l’échalas avec les branches les plus petites du saule qu’on reserve pour cet usage.
Accoler, terme de Commerce, signifie faire un certain trait de plume en marge d’un livre, d’un compte, d’un mémoire, d’un inventaire, qui marque que plusieurs articles sont compris dans une même supputation, ou dans une seule somme, laquelle est tirée à la marge du côté où sont posés les chiffres dont on doit faire l’addition à la fin de la page.
| Bonnes. | ||||||||
| Par Jacques, | 300 l. |
|
500 | l. | ||||
| Par Pierre, | 200 | |||||||
| Douteuses. | ||||||||
| Par Jean, | 400 |
|
900 | |||||
| Par Nicolas | 500 | |||||||
| Total, | 1400 | l. | ||||||
Accolé, adj. se prend dans le Blason en quatre sens différens : 1°. pour deux choses attenantes & jointes ensemble, comme les écus de France & de Navarre qui sont accolés sous une même couronne, pour les armoiries de nos Rois. Les femmes accolent leurs écus à ceux de leurs maris. Les fusées, les lozanges & les macles, sont aussi censées être accolées quand elles se touchent de leurs flancs ou de leurs pointes, sans remplir tout l’écu : 2°. Accolé se dit des chiens, des vaches, ou autres animaux qui ont des colliers ou des couronnes passées dans le col, comme les cignes, les aigles : 3°. des choses qui sont entortillées à d’autres, comme une vigne à l’échalas, un serpent à une colonne ou à un arbre, &c. 4°. On se sert enfin de ce terme pour les chefs, bâtons, masses, épées, bannieres & autres choses semblables qu’on passe en sautoir derriere l’écu. Voyez Ecu, Fusée, Lozange, Macle, Chef, Baston, &c.
Rohan en Bretagne, de gueules à neuf macles d’or, accolées & aboutées trois trois en trois fasces. (V)
Accoler, c’est unir deux ou plusieurs pieces de bois ensemble sans aucun assemblage, simplement pour les fortifier les unes par les autres, & leur donner la force nécessaire pour le service qu’on en veut tirer.
ACCOLURE, s. f. piece de bois servant dans la composition d’un train. Voyez Train.
ACCOMMODAGE, s. m. qui signifie l’action d’arranger les boucles d’une tête ou d’une perruque : ainsi accommoder une tête, c’est en peigner la frisure, arranger les boucles, y mettre de la pommade & de la poudre ; pour cet effet après que les cheveux ont été mis en papillotes & passés au fer, on les laisse refroidir, & quand ils sont refroidis, on ôte les papillotes, on peigne la frisure, & on arrange les boucles avec le peigne, de façon à pouvoir les étaler & en former plusieurs rangs, après quoi on y met un peu de pommade qu’on a fait fondre dans la main. Cette pommade nourrit les cheveux, y entretient l’humidité nécessaire, & sert outre cela à leur faire tenir la poudre.
ACCOMMODATION, s. f. terme de Palais qui est vieilli. Voyez Accommodement, qui signifie la même chose. (H)
ACCOMMODEMENT, s. m. en terme de Pratique, est un traité fait à l’amiable, par lequel on termine un différend, une contestation ou un procès. On dit qu’un mauvais accommodement vaut mieux que le meilleur procès.
Il se peut faire par le seul concours des parties, ou par l’entremise d’un tiers arbitre, ou de plusieurs à qui ils s’en sont rapportés. C’est à peu près la même chose que transaction. Voyez Transaction, Arbitrage. (H)
ACCOMMODER, v. a. c’est apprêter des mets ou les préparer par le moyen du feu ou autrement, pour servir de nourriture ou d’aliment. Voyez Nourriture ou Aliment.
Le dessein de l’accommodage des mets devroit être de détacher la tissure trop compacte de la chair ou des viandes, pour les préparer à la dissolution & à la digestion dans l’estomac, la viande n’étant pas un aliment propre à l’homme lorsqu’elle n’est pas préparée. Il y en a qui pensent que la nature n’a pas eu en vûe d’en faire un animal carnacier. Voyez Carnacier.
Les opérations les plus ordinaires sont le rôti, le bouilli, l’étuvée. Il faut observer que dans le rôti, les mets supporteront une chaleur plus grande & plus longue que dans le bouilli ou l’étuvée, & dans le bouilli, plus grande & plus longue que dans l’étuvée. La raison en est que le rôti se faisant en plein air, comme les parties commencent à s’échauffer extérieurement, elles s’étendent, elles se dilatent, & ainsi elles donnent par degrés un passage aux parties raréfiées de l’air qu’elles renferment ; moyennant quoi les secousses intérieures qui operent la dissolution, en deviennent plus foibles & plus ralenties. Le bouilli se faisant dans l’eau, sa compression en est plus considérable, & par une suite nécessaire, les secousses qui doivent soulever le poids sont à proportion plus fortes ; ainsi la coction des mets s’en fait beaucoup plus vîte : & même dans cette maniere de les préparer, il y a de grandes différences ; car l’opération est plûtôt faite, à mesure que le poids d’eau est plus grand.
Dans l’étuvée, quoique la chaleur dure infiniment moins que dans les autres manieres d’accommoder, l’opération est beaucoup plus vive, à cause qu’elle se fait dans un vaisseau plein & bien clos ; ce qui cause des secousses beaucoup plus souvent réitérées & reverberées avec beaucoup plus de vigueur : c’est de là que procede la force extrème du digesteur ; ou de la machine de Papin, & que l’on peut concevoir plus clairement l’opération de la digestion. Voyez Digesteur & Digestion.
M. Cheyne observe que le bouilli sépare ou détache une plus grande partie des jus succulens que contiennent les mets, qu’ils en deviennent moins nourrissans, plus détrempés, plus légers, & d’une digestion plus aisée : que le rôti, d’un autre côté, laisse les mets trop pleins de sucs nourrissans, trop durs de digestion, & qui ont besoin d’être plus détrempés ou délayés. C’est pourquoi on doit faire bouillir les animaux robustes, grands & adultes, dont on veut faire sa nourriture : mais on doit faire rôtir les plus jeunes & les plus tendres.
ACCOMPAGNAGE, s. f. terme de Soierie, trame fine de même couleur que la dorure dont l’étoffe est brochée, servant à garnir le fond sous lequel elle passe, pour empêcher qu’il ne transpire au-travers de cette même dorure, ce qui en diminueroit l’éclat & le brillant.
Toutes les étoffes riches dont les chaînes sont de couleur différente de la dorure, doivent être accompagnées. Voyez Fond or, Brocards, Tissus &c. & Lisses de poil.
ACCOMPAGNATEUR, s. m. en Musique. On appelle ainsi celui qui dans un concert accompagne ou de l’orgue ou du clavecin.
Il faut qu’un bon accompagnateur soit excellent Musicien, qu’il sache bien l’harmonie, qu’il connoisse à fond son clavier, qu’il ait l’oreille excellente, les doigts souples, & le goût bon.
Nous aurons occasion de parler au mot accompagnement de quelques-unes des qualités nécessaires à l’accompagnateur. (S)
ACCOMPAGNÉ, adj. terme de Blason. Il se dit de quelques pieces honorables qui en ont d’autres en séantes partitions. Ainsi on dit que la croix est accompagnée de quatre étoiles, de quatre coquilles, & seize alérions, de vingt billettes, lorsque ces choses sont également disposées dans les quatre cantons qu’elle laisse vuides dans l’écu. Voyez Croix, Alérion, Billettes, &c. Le chevron peut être accompagné de trois croissans, deux en chef & un en pointe, de trois roses ; de trois besans, &c. La fasce peut être accompagnée de deux lozanges, deux molettes, deux croisettes, &c. l’une en chef, l’autre en pointe, ou de quatre tourteaux, quatre aiglettes, &c. deux en chef & deux en pointe. Le pairle de trois pieces semblables, une en chef & deux aux flancs, & le sautoir de quatre ; la premiere en chef, la seconde en pointe, & les deux autres aux flancs. On dit la même chose des pieces mises dans le sens de celles-là, comme deux clefs en sautoir, trois poissons mis en pairle, &c. Voyez Sautoir, Pairle, &c.
Esparbez en Guienne, d’argent à la fasce de gueules, accompagné de trois merlettes de sable. (V)
ACCOMPAGNEMENT, s. m. c’est l’exécution d’une harmonie complette & réguliere sur quelque instrument, tel que l’orgue, le clavecin, le théorbe, la guitarre, &c. Nous prendrons ici le clavecin pour exemple.
On y a pour guide une des parties de la Musique, qui est ordinairement la basse. On touche cette basse de la main gauche, & de la droite, l’harmonie indiquée par la marche de la basse, par le chant des autres parties qu’on entend en même tems, par la partition qu’on a devant les yeux, ou par des chiffres qu’on trouve communément ajoûtés à la basse. Les Italiens méprisent les chiffres ; la partition même leur est peu nécessaire ; la promptitude & la finesse de leur oreille y supplée, & ils accompagnent fort bien sans tout cet appareil : mais ce n’est qu’à leur disposition naturelle qu’ils sont redevables de cette facilité : & les autres Peuples qui ne sont pas nés comme eux pour la Musique, trouvent à la pratique de l’accompagnement des difficultés infinies ; il faut des dix à douze années pour y réussir passablement. Quelles sont donc les causes qui retardent l’avancement des éleves, & embarrassent si long-tems les maîtres ? La seule difficulté de l’Art ne fait point cela.
Il y en a deux principales : l’une dans la maniere de chiffrer les basses ; l’autre dans les méthodes d’accompagnement.
Les signes dont on se sert pour chiffrer les basses sont en trop grand nombre. Il y a si peu d’accords fondamentaux ! pourquoi faut-il une multitude de chiffres pour les exprimer ? les même signes sont équivoques, obscurs, insuffisans. Par exemple, ils ne déterminent presque jamais la nature des intervalles qu’ils expriment, ou, ce qui pis est, ils en indiquent d’opposés : on barre les uns pour tenir lieu de dièse, on en barre d’autres pour tenir lieu de bémol : les intervalles majeurs & les superflus, même les diminués, s’expriment souvent de la même maniere. Quand les chiffres sont doubles, ils sont trop confus ; quand ils sont simples, ils n’offrent presque jamais que l’idée d’un seul intervalle ; de sorte qu’on en a toûjours plusieurs autres à sous-entendre & à exprimer.
Comment remédier à ces inconvéniens ? faudra-t-il multiplier les signes pour tout exprimer ? mais on se plaint qu’il y en a déjà trop. Faudra-t-il les réduire ? on laissera plus de choses à deviner à l’accompagnateur, qui n’est déja que trop occupé. Que faire donc ? Il faudroit inventer de nouveaux signes, perfectionner le doigter, & faire des signes & du doigter deux moyens combinés qui concourent en même tems à soulager l’accompagnateur. C’est ce que M. Rameau a tenté avec beaucoup de sagacité dans sa Dissertation sur les différentes méthodes d’accompagnement. Nous exposerons aux mots Chiffrer & Doigter, les moyens qu’il propose. Passons aux méthodes.
Comme l’ancienne Musique n’étoit pas si composée que la nôtre, ni pour le chant, ni pour l’harmonie, & qu’il n’y avoit guere d’autre basse que la fondamentale, tout l’accompagnement ne consistoit que dans une suite d’accords parfaits, dans lesquels l’accompagnateur substituoit de tems en tems quelque sixte à la quinte, selon que l’oreille le conduisoit. Ils n’en savoient pas davantage. Aujourd’hui qu’on a varié les modulations, surchargé, & peut-être gâté l’harmonie par une foule de dissonnances, on est contraint de suivre d’autres regles. M. Campion imagina celle qu’on appelle regle de l’octave ; & c’est par cette méthode que la plûpart des maîtres montrent aujourd’hui l’accompagnement.
Les accords sont déterminés par la regle de l’octave, relativement au rang qu’occupent les notes de la basse dans un ton donné. Ainsi le ton connu, la note de la basse continue, le rang de cette note dans le ton, le rang de la note qui la précede immédiatement, le rang de celle qui la suit, on ne se trompera pas beaucoup en accompagnant par la regle de l’octave, si le compositeur a suivi l’harmonie la plus simple & la plus naturelle : mais c’est ce qu’on ne doit guere attendre de la Musique d’aujourd’hui. D’ailleurs, le moyen d’avoir toutes ces choses présentes ? & tandis que l’accompagnateur s’en instruit, que deviennent les doigts ? A peine est-on arrivé à un accord qu’un autre se présente ; le moment de la réflexion est précisément celui de l’exécution : il n’y a qu’une habitude consommée de Musique, une expérience refléchie, la facilité de lire une ligne de musique d’un coup d’œil, qui puissent secourir ; encore les plus habiles se trompent-ils avec ces secours.
Attendra-t-on pour accompagner que l’oreille soit formée, qu’on sache lire rapidement la musique, qu’on puisse débrouiller à livre ouvert une partition ? mais en fût-on là, on auroit encore besoin d’une habitude du doigter, fondée sur d’autres principes d’accompagnement que ceux qu’on a donnés jusqu’à M. Rameau.
Les maîtres zélés ont bien senti l’insuffisance de leurs principes. Pour y remédier ils ont eu recours à l’énumération & à la connoissance des consonances, dont les dissonnances se préparent & se sauvent. Détail prodigieux, dont la multitude des dissonnances fait suffisamment appercevoir.
Il y en a qui conseillent d’apprendre la composition avant que de passer à l’accompagnement ; comme si l’accompagnement n’étoit pas la composition même, aux talens près, qu’il faut joindre à l’un pour faire usage de l’autre. Combien de gens au contraire veulent qu’on commence par l’accompagnement à apprendre la composition ?
La marche de la basse, la regle de l’octave, la maniere de préparer & de sauver les dissonnances, la composition en général, ne concourent qu’à indiquer la succession d’un seul accord à un autre ; de sorte qu’à chaque accord, nouvel objet, nouveau sujet de réflexion. Quel travail pour l’esprit ! Quand l’esprit sera-t-il assez instruit, & l’oreille assez exercée, pour que les doigts ne soient plus arrêtés ?
C’est à M. Rameau qui, par l’invention de nouveaux signes & la perfection du doigter, nous a aussi indiqué les moyens de faciliter l’accompagnement, c’est à lui, dis-je, que nous sommes redevables d’une méthode nouvelle, qui garantit des inconvéniens de toutes celles qu’on avoit suivies jusqu’à présent. C’est lui qui le premier a fait connoître la basse fondamentale, & qui par là nous a découvert les véritables fondemens d’un Art où tout paroissoit arbitraire.
Voici en peu de mots les principes sur lesquels sa méthode est fondée.
Il n’y a dans l’harmonie que des consonances & des dissonances. Il n’y a donc que des accords consonans & dissonans.
Chacun de ces accords est fondamentalement divisé par tierces. (C’est le système de M. Rameau) Le consonant est composé de 3 notes, comme ut, mi, sol ; & le dissonant de quatre, comme sol, si, re, fa.
Quelque distinction ou distribution que l’on fasse de l’accord consonant, on y aura toûjours trois notes, comme ut, mi, sol. Quelque distribution qu’on fasse de l’accord dissonant, on y trouvera toûjours quatre notes, comme sol, si, ré, fa, laissant à part la supposition & la suspension qui en introduisent d’autres dans l’harmonie comme par licence. Ou des accords consonans se succedent, ou des accords dissonans sont suivis d’autres dissonans, ou les consonans & les dissonans sont entrelacés.
L’accord consonant parfait ne convenant qu’à la tonique, la succession des accords consonans fournit autant de toniques, & par conséquent de changemens de ton.
Les accords dissonans se succedent ordinairement dans un même ton. La dissonance lie le sens harmonique. Un accord y fait souhaiter l’autre, & fait sentir en même tems que la phrase n’est pas finie. Si le ton change dans cette succession, ce changement est toûjours annoncé par un dièse ou par un bémol. Quant à la troisieme succession, savoir l’entrelacement des accords consonans & dissonans, M. Rameau réduit à deux cas cette succession, & il prononce en général, qu’un accord consonant ne peut être précédé d’un autre dissonant que de celui de septieme de la dominante, ou de celui de sixte-quinte de la soûdominante, excepté dans la cadence rompue & dans les suspensions ; encore prétend-il qu’il n’y a pas d’exception quant au fond. Il nous paroît que l’accord parfait peut encore être précédé de l’accord de septieme diminuée, & même de celui de sixte superflue ; deux accords originaux, dont le dernier ne se renverse point.
Voilà donc trois textures différentes de phrases harmoniques : des toniques qui se succedent & qui font changer de ton : des consonances qui se succedent ordinairement dans le même ton ; & des consonances & des dissonnances qui s’entrelacent, & où la consonance est, selon M. Rameau, nécessairement précédée de la septieme de la dominante, ou de la sixte-quinte de la soûdominante. Que reste-t-il donc à faire pour la facilité de l’accompagnement, sinon d’indiquer à l’accompagnateur quelle est celle de ces textures qui regne dans ce qu’il accompagne ? Or c’est ce que M. Rameau veut qu’on exécute avec des caracteres.
Un seul signe peut aisément indiquer le ton, la tonique & son accord.
On tire de là la connoissance des dièses & des bémols qui doivent entrer dans le courant des accords d’une tonique à une autre.
La succession fondamentale par quintes ou par tierces, tant en montant qu’en descendant, donne la premiere texture de phrases harmoniques toute composée d’accords consonans.
La succession fondamentale par tierces ou par quintes en descendant, donne la seconde texture, composée d’accords dissonans, savoir des accords de septieme, & cette succession donne l’harmonie descendante.
L’harmonie ascendante est fournie par une succession de quintes en montant, ou de quartes en descendant, accompagnées de la dissonance propre à cette succession, qui est la sixte ajoûtée ; & c’est la troisieme texture des phrases harmoniques, qui n’a jusqu’ici été observée de personne, quoique M. Rameau en ait trouvé le principe & l’origine dans la cadence irréguliere. Ainsi par les regles ordinaires, l’harmonie qui naît d’une succession de dissonances descend toûjours, quoique selon ses vrais principes & selon la raison, elle doive avoir en montant une progression tout aussi réguliere qu’en descendant. Voyez Cadence.
Les cadences fondamentales donnent la quatrieme texture de phrases harmoniques, où les consonances & les dissonances s’entrelacent.
Toutes ces textures peuvent être désignées par des caracteres simples, clairs & peu nombreux, qui indiqueront en même tems, quand il le faut, la dissonance en général ; car l’espece en est toûjours déterminée par la texture même. Voyez Chiffrer. On commence par s’exercer sur ces textures prises séparément, puis on les fait se succéder les unes aux autres sur chaque ton & sur chaque mode successivement.
Avec ces précautions, M. Rameau prétend qu’on sait plus d’accompagnement en six mois, qu’on n’en savoit auparavant en six ans, & il a l’expérience pour lui. Voyez Musique, Harmonie, Basse fondamentale, Basse continue, Partition, Chiffrer, Doigter, Consonance, Dissonance, Regle de l’octave, Composition, Supposition, Suspension, Ton, Cadence, Modulation, &c.
A l’égard de la maniere d’accompagner avec intelligence, elle dépend plus de l’habitude & du goût que des regles qu’on en peut donner. Voici pourtant quelques observations générales qu’on doit toûjours faire en accompagnant.
1°. Quoi que suivant les principes de M. Rameau il faille toucher tous les sons de chaque accord, il ne faut pas toûjours prendre cette regle à la lettre. Il y a des accords qui seroient insupportables avec tout ce remplissage. Dans la plûpart des accords dissonans, surtout dans les accords par supposition, il y a quelque son à retrancher pour en diminuer la dureté ; ce son est souvent la septieme, quelquefois la quinte, quelquefois l’une & l’autre. On retranche encore assez souvent la quinte ou l’octave de la basse dans les accords dissonans, pour éviter des octaves ou des quintes de suite, qui font souvent un fort mauvais effet, surtout dans le haut ; & par la même raison, quand la note sensible est dans la basse, on ne la met pas dans l’accompagnement ; au lieu de cela, on double la tierce ou la sixte de la main droite. En général on doit penser en accompagnant, que quand M. Rameau veut qu’on remplisse tous les accords, il a bien plus d’égard à la facilité du doigter & à son système particulier d’accompagnement, qu’à la pureté de l’harmonie.
2°. Il faut toûjours proportionner le bruit au caractere de la Musique, & à celui des instrumens ou des voix qu’on a à accompagner : ainsi dans un chœur on frappe les accords pleins de la main droite, & l’on redouble l’octave ou la quinte de la main gauche, & quelquefois tout l’accord. Au contraire dans un récit lent & doux, quand on n’a qu’une flûte ou une voix foible à accompagner, on retranche des sons, on les arpege doucement, on prend le petit clavier : en un mot, on a toûjours attention que l’accompagnement, qui n’est fait que pour soûtenir & embellir le chant, ne le gâte & ne le couvre pas.
3°. Quand on a à refrapper les mêmes touches dans une note longue ou une tenue, que ce soit plûtôt au commencement de la mesure ou du tems fort, que dans un autre moment : en un mot, il faut ne rebattre qu’en bien marquant la mesure.
4°. Rien n’est si désagréable que ces traits de chant, ces roulades, ces broderies, que plusieurs accompagnateurs substituent à l’accompagnement. Ils couvrent la voix, gâtent l’harmonie, embrouillent le sujet, & souvent ce n’est que par ignorance qu’ils font les habiles mal-à-propos, pour ne savoir pas trouver l’harmonie propre à un passage. Le véritable accompagnateur va toûjours au bien de la chose, & accompagne simplement. Ce n’est pas que dans de certains vuides on ne puisse au défaut des instrumens placer quelque joli trait de chant : mais il faut que ce soit bien à propos, & toûjours dans le caractere du sujet. Les Italiens jouent quelquefois tout le chant au lieu d’accompagnement ; & cela fait assez bien dans leur genre de musique. Mais quoi qu’ils en puissent dire, il y a souvent plus d’ignorance que de goût dans cette maniere d’accompagner.
5°. On ne doit pas accompagner la Musique Italienne comme la Françoise. Dans celle-ci il faut soûtenir les sons, les arpéger gracieusement du bas en haut ; s’attacher à remplir l’harmonie, à joüer proprement la basse : car les Compositeurs François lui donnent aujourd’hui tous les petits ornemens & les tours de chant des dessus. Au contraire, en accompagnant de l’Italien, il faut frapper simplement les notes de la basse, n’y faire ni cadences, ni broderie, lui conserver la marche grave & posée qui lui convient : l’accompagnement doit être sec & sans arpéger. On y peut retrancher des sons sans scrupule ; mais il faut bien choisir ceux qu’on fait entendre. Les Italiens font peu de cas du bruit ; une tierce, une sixte bien adaptée, même un simple unisson, quand le bon goût le demande, leur plaisent plus que tout notre fracas de parties & d’accompagnement : en un mot, ils ne veulent pas qu’on entende rien dans l’accompagnement, ni dans la basse, qui puisse distraire l’oreille du sujet principal, & ils sont dans l’opinion que l’attention s’évanoüit en se partageant.
6°. Quoique l’accompagnement de l’orgue soit le même que celui du clavecin, le goût en est différent. Comme les sons y sont soûtenus, leur marche doit être plus douce & moins sautillante. Il faut lever la main entiere le moins qu’on peut, faire glisser les doigts d’une touche à l’autre sans lever ceux qui, dans la place où ils sont, peuvent servir à l’accord où l’on passe ; rien n’est si désagréable que d’entendre sur l’orgue cette espece d’accompagnement sec & détaché, qu’on est forcé de pratiquer sur le clavecin. Voyez le mot Doigter.
On appelle encore accompagnement toute partie de basse ou autre instrument, qui est composée sur un chant principal pour y faire harmonie. Ainsi un solo de violon s’accompagne du violoncelle ou du clavecin, & un accompagnement de flûte se marie fort bien à la voix ; cette harmonie ajoûte à l’agrément du chant : il y a même par rapport aux voix une raison particuliere pour les faire toûjours accompagner de quelques instrumens : car quoique plusieurs prétendent qu’en chantant on modifie naturellement sa voix selon les lois du tempérament, cependant l’expérience nous montre que les voix les plus justes & les mieux exercées, ont bien de la peine à se maintenir long tems dans le même ton quand rien ne les y soûtient. A force de chanter on monte ou l’on descend insensiblement, & en finissant, rarement se trouve-t-on bien juste dans le même ton d’où l’on étoit parti. C’est en vûe d’empêcher ces variations que l’harmonie d’un instrument est employée pour maintenir toûjours la voix dans le même diapason, ou pour l’y rappeller promptement lorsqu’elle s’en égare. V. Basse continue. (S)
Accompagnement se dit, en Peinture, des objets qui sont ajoûtés, ou pour l’ornement, ou pour la vraissemblance. Il est naturel que dans un tableau représentant des chasseurs, on voie des fusils, des chiens, du gibier, & autres équipages de chasse : mais il n’est pas nécessaire pour le vraissemblable qu’on y en mette de toutes les especes ; lorsqu’on les y introduit, ce sont des accompagnemens qui ornent toûjours beaucoup un tableau. On dit d’un tableau représentant des chasseurs : il faudroit à ce tableau quelque accompagnement, comme de fusils, gibier, &c. On dit de beaux accompagnemens. Cette chose accompagne bien cette partie, ce groupe, &c. (R)
ACCOMPAGNER, terme de Soierie, c’est l’action de passer l’accompagnage. Voyez Accompagnage.
ACCOMPLISSEMENT, s. m. signifie l’exécution, l’achevement, le succès d’une chose qu’on se proposoit de faire ou qu’on a entreprise.
Ce mot vient du latin ad & complere, remplir.
L’accomplissement des Prophéties de l’ancien Testament dans la personne du Sauveur, démontre assez clairement qu’il étoit le Messie. V. Prophétie.
L’accomplissement d’une Prophétie peut se faire, ou directement, ou par accommodation.
Car une même Prophétie peut avoir plusieurs accomplissemens en différens tems : telle est, par exemple, celle que Jesus-Christ fait touchant la ruine de Jérusalem, laquelle doit avoir un second accomplissement dans le tems qui précédera immédiatement le jugement dernier.
Ce principe n’est pas universel, & pourroit même être dangereux à bien des égards, en retombant dans le système de Grotius sur l’accomplissement des Prophéties. Il faut donc dire que l’accomplissement du sens littéral d’une Prophétie est son accomplissement direct, & que l’accomplissement du sens figuré d’une Prophétie est son accomplissement par accommodation. Ce n’est qu’entant que les Prophéties ont été accomplies à la lettre dans la personne de Jesus-Christ, qu’elles prouvent qu’il est le Messie. Quant à l’accomplissement d’accommodation, il ne fait preuve qu’autant qu’il est contenu ou clairement indiqué dans les Ecritures, ou constamment enseigné par la tradition ; car on n’ignore pas jusqu’où peut aller sur cette matiere le fanatisme & le déreglement d’imagination, quand on veut interpréter le sens des Prophéties, & en fixer l’accomplissement à sa fantaisie. Les systèmes extravagans de Joseph Mede & du Ministre Jurieu sur celles de l’Apocalypse, & le succès ridicule qu’ont eu leurs visions, devroient bien guérir les Théologiens de cette manie. Ceux qui sont persuadés que l’esprit humain n’est pas plus capable par lui-même de fixer l’accomplissement d’une Prophétie, que de prédire l’avenir d’une maniere sûre & circonstanciée, s’en tiendront toûjours à cette regle : Omnis Prophetia scripturæ propriâ interpretations non fit. Voyez Sens littéral, Sens figuré, Prophétie, Semaines, &c.
Nous ajoûtons cependant qu’il y a des Prophéties qui s’accomplissent en partie dans un premier sens, & par rapport à un certain objet, & qui n’ont leur parfait accomplissement que dans un autre. Telles sont les prédictions de la ruine de Jérusalem, & quelques-unes de celles de l’Apocalypse. (G)
ACCON, s. m. petit bateau à fond plat dont on se sert dans le pays d’Aunix pour aller sur la vase, après que la mer s’est retirée. (Z)
ACCORD, s. m. en Droit, soit en matiere civile, soit en matiere criminelle, signifie un accommodement entre les parties contestantes, au moyen de ce que l’une des deux parties fait des offres que l’autre accepte. Ainsi l’on dit, les parties sont d’accord, pour dire qu’elles sont accommodées. V. Transaction.
Accords au plur. est synonyme à accordailles. Voyez ce dernier. (H)
Accord, en Peinture, se dit de l’harmonie qui regne dans la lumiere & les couleurs d’un tableau. On dit un tableau d’un bel accord. Il faudroit un peu diminuer cette lumiere pour l’accorder avec cette autre ; éteindre la vivacité de la couleur de cette draperie, de ce ciel, qui ne se distingue pas de telle ou telle partie, &c. (R)
Accord, en Musique, est l’union de deux ou plusieurs sons entendus à la fois, formant ensemble une harmonie réguliere.
L’harmonie naturelle produite par la résonance d’un corps sonore, est composée de trois sons différens, sans compter leurs octaves, lesquels forment entr’eux l’accord le plus agréable & le plus parfait que l’on puisse entendre, d’où on l’appelle par excellence accord parfait. Ainsi, pour rendre l’harmonie complete, il faut que l’accord soit composé de trois sons ; aussi les Musiciens trouvent-ils dans le trio la perfection harmonique, soit parce qu’ils y employent les accords en entier ; soit parce que dans les occasions où ils ne les employent pas en entier, ils ont du moins l’art de faire croire le contraire à l’oreille, en lui présentant les sons principaux des accords : comme dans les consonans, la tierce avec l’octave sous-entendant la quinte, la sixte avec l’octave sous-entendant la tierce, &c & dans les dissonans, la septieme avec la tierce sous-entendant la quinte, de même la neuvieme, &c… dans la grande sixte, la sixte avec la quinte sous-entendant la tierce, la quarte avec la seconde sous-entendant la sixte, &c. Cependant l’octave du son principal produisant de nouveaux rapports & de nouvelles consonances par les complémens des intervalles, (V. Complément.) on ajoûte ordinairement cette octave pour avoir l’ensemble de toutes les consonances dans un même accord. De plus, l’addition de la dissonance (Voyez Dissonance) produisant un quatrieme son ajoûté à l’accord parfait, c’est une nécessité, si l’on veut remplir l’accord, d’avoir une quatrieme partie pour exprimer cette dissonance. Ainsi quand on veut faire entendre l’harmonie complete, ce ne peut être que par le moyen de quatre parties réunies ensemble.
On divise les accords en parfaits & imparfaits. L’accord parfait est celui dont nous venons de parler, qui est composé du son fondamental au grave, de sa tierce, de sa quinte, & de son octave ; & en général on appelle quelquefois parfait tout accord, même dissonant, dont le fondamental est au grave. Les accords imparfaits sont ceux où regne la sixte au lieu de la quinte, & en général tous ceux où le son grave n’est pas le fondamental. Ces dénominations qui ont été données avant qu’on connût la basse fondamentale, sont fort mal appliquées. Celles d’accords directs, ou renversés, sont beaucoup plus convenables dans le même sens. V. Renversement.
Les accords se distinguent encore en consonans & dissonans. Les accords consonans sont l’accord parfait & ses dérivés ; tout autre accord est dissonant.

Cet accord constitue le ton, & ne se fait que sur la tonique. Sa tierce peut être majeure ou mineure, & c’est ce qui constitue le mode.

Aucun des sons de cet accord ne peut s’altérer.

La tierce, la quinte & la septieme de cet accord peuvent s’altérer.

Aucun des sons de cet accord ne peut s’altérer.

Je joins ici partout le mot ajoûté, pour distinguer cet accord & ses renversés des productions semblables de l’accord de septieme.

Cet accord ne se renverse point, & aucun de ses sons ne peut s’altérer. Ce n’est proprement qu’un accord de petite sixte majeure, diésée par accident.

C’est un accord de septieme, auquel on ajoûte un cinquieme son d’une tierce au-dessous du fondamental.
On en retranche ordinairement la septieme, c’est-à-dire la quinte du son fondamental, qui est ici la note mi ; & dans cet état l’accord de neuvieme peut se renverser, en retranchant encore de l’accompagnement
l’octave de la note qu’on porte à la basse.
C’est l’accord dominant d’un ton mineur, au-dessous duquel on fait entendre la médiante ; ainsi c’est un véritable accord de neuvieme : mais il ne se renverse point, à cause de la quarte diminuée que donneroit avec la note sensible le son supposé porté à l’aigu, laquelle quarte est un intervalle banni de l’harmonie.

C’est un accord de septieme, au-dessous duquel on ajoûte un cinquieme son à la quinte du fondamental. On ne frappe gueres cet accord plein à cause de sa dureté, & pour le renverser on en retranche la neuvieme & la septieme.

C’est l’accord dominant sous lequel la basse fait la tonique.

C’est l’accord de septieme diminuée, sous lequel la basse fait la tonique.
Ces deux derniers accords ne se renversent point, parce que la note sensible & la tonique s’entendroient ensemble dans les parties supérieures, ce qui ne peut se tolérer.
Nous parlerons aux mots Harmonie, Basse fondamentale, Modulation, Composition, Dissonance, de la maniere d’employer tous ces accords pour en former une harmonie réguliere. Nous ajoûterons seulement ici les observations suivantes.
1. C’est une grande erreur de penser que le choix des divers renversemens d’un même accord soit indifférent pour l’harmonie ou pour l’expression ; il n’y a pas un de ces renversemens qui n’ait son caractere propre. Tout le monde sent l’opposition qui se trouve entre la douceur de la fausse quinte & l’aigreur du triton ; & cependant l’un de ces intervalles est renversé de l’autre : il en est de même de la septieme diminuée & de la seconde superflue, de la seconde ordinaire, & de la septieme. Qui ne sait combien la quinte est plus sonore que la quarte ? L’accord de grande sixte & celui de sixte mineure sont deux faces du même accord : mais de combien l’une n’est-elle pas plus harmonieuse que l’autre ? L’accord de petite sixte majeure au contraire n’est-il pas plus brillant que celui de fausse quinte ? & pour ne parler que du plus simple de tous les accords, considérez la majesté de l’accord parfait, la douceur de la sixte, & la fadeur de la sixte quarte, tous accords composés des mêmes sons. En général les intervalles superflus, les dièses dans le haut, sont propres par leur dureté à exprimer l’emportement & la colere ; au contraire les bémols, les intervalles diminués, forment une harmonie plaintive qui attendrit le cœur. C’est une multitude d’observations semblables, lorsqu’on sait s’en prévaloir, qui rend un Musicien intelligent, maître des dispositions de ceux qui l’écoutent.
2. Le choix des intervalles n’est gueres moins important que celui des accords, pour la place où l’on veut les employer. C’est par exemple, dans le bas qu’il faut placer les quintes & les octaves ; dans le haut, les tierces & les sixtes : transposez cet ordre, vous gâterez l’harmonie en laissant les mêmes accords.
3. Enfin on rend encore les accords plus harmonieux, en les rapprochant dans de petits intervalles plus convenables à la capacité de l’oreille ; c’est ce qu’on appelle resserrer l’harmonie, & ce que si peu de Musiciens savent pratiquer dans la composition de leurs chœurs, où souvent l’on entend des parties si éloignées les unes des autres, qu’elles semblent n’avoir plus de rapport entr’elles. (S)
Accord de l’orgue. Ce mot a deux significations ; premierement, il signifie la même chose que partition. Voyez Partition. Secondement, il signifie l’accord respectif de tous les jeux. C’est dans ce sens qu’il est pris dans cet article.
La partition est le fondement de l’accord : elle se fait sur le prestant qui tient le milieu entre tous les jeux de l’orgue. Quant au grave & à l’aigu, pour bien accorder, il est nécessaire d’être doüé d’une oreille extrèmement fine, ce qui s’appelle parmi les facteurs & les gens de l’art, avoir de l’oreille ; c’est un don de la nature qu’un Maître ne sauroit communiquer.
Après que la partition est faite sur le prestant (ou sur la flûte, s’il n’y a point de prestant à l’orgue) on accorde à l’octave en-dessous le bourdon de quatre piés bouché. Ensuite on accorde le huitieme pié ouvert à l’unisson du bourdon de quatre piés bouché, & à l’octave au-dessous du prestant ; on accorde ensuite la montre de seize piés à l’octave en-dessous du huitieme pié ouvert, du quatrieme pié bouché, & à la double octave en-dessous du prestant : on accorde ensuite le bourdon de seize piés à l’unisson de la montre de 16 piés, & à l’octave en-dessous du huitieme pié ouvert, du quatrieme pié bouché, & à la double octave en-dessous du prestant. Voyez la table du rapport des jeux, fig. 67, Planche d’orgue.
On accorde ensuite le grand cornet composé de cinq tuyaux sur le prestant seul. Il faut remarquer que le grand cornet n’a que deux octaves, & que des cinq tuyaux qui le composent, il n’y a que le dessus de flûte qui s’accorde à l’unisson des tailles & des dessus du prestant ; que les autres tuyaux, le dessus de bourdon, le dessus de nazard, le dessus de quarte nazard, & le dessus de tierce, s’accordent à l’unisson des jeux dont ils portent le nom. On accorde ensuite le cornet de récit & le cornet d’écho sur le prestant, comme on a accordé le grand cornet. On accorde ensuite la flûte sur le prestant seul, à l’unisson de laquelle elle doit être. Ensuite on accorde la double tierce à la tierce au-dessus du prestant, & sur tous les fonds de l’orgue. Ce qu’on appelle les fonds de l’orgue, sont tous les jeux de mutation plus graves que le prestant ; comme qui diroit les basses de l’orgue, dont le prestant tient le milieu, y ayant autant d’octaves dans l’étendue de l’orgue au-dessus & au-dessous des quatre dont le prestant est composé. On accorde ensuite le nazard sur les fonds & à la quinte au-dessus du prestant. Le gros nazard s’accorde aussi sur les fonds à l’octave au-dessous du nazard & à la quarte au-dessous du prestant. On accorde ensuite ensuite la quarte de nazard sur les fonds & avec la double tierce, & le nazard : ce jeu doit sonner l’octave du prestant. On accorde ensuite la tierce sur les fonds & la double tierce, dont elle doit sonner l’octave, & sur le nazard & la quarte nazard. Ensuite on accorde le larigot sur les fonds accompagnés de la double tierce du nazard, dont il doit sonner l’octave de la quarte nazard, de la tierce. On accorde ensuite la doublette sur tous les fonds : elle doit sonner l’octave au-dessus du prestant. Sur la doublette & les fonds on accorde les deux parties du plein jeu, la fourniture & la cimbale, dont on bouche les tuyaux des rangs que l’on n’accorde pas avec des plumes d’oie ou de pigeon, afin de les empêcher de parler, & de mieux entendre l’accord de ceux qu’on laisse libres. Ensuite quand un rang est accordé, on accorde le rang suivant, dont on ôte les plumes que l’on remet dans le rang accordé, s’il est nécessaire. Voyez Fourniture & Cimbale.
La pédale de quarte s’accorde sur les fonds & à l’unisson des basses du prestant.
La pédale de huit ou flûte s’accorde aussi sur les fonds & à l’unisson du huitieme pié ouvert, ou à l’octave au-dessous du prestant.
Lorsque tous les jeux de mutation sont accordés, on accorde les jeux d’anches, à commencer par la trompette que l’on accorde à l’octave au-dessous du prestant seul. Sur la trompette on accorde la cromorne à l’unisson, à l’octave au-dessous de la trompette. On accorde la bombarde à l’octave au-dessus de la même trompette ; on accorde le clairon qui sonne l’unisson du prestant. La voix humaine qui sonne l’unisson de la trompette s’accorde à l’octave au-dessous du prestant seul, & la voix angélique à l’unisson du même prestant. La trompette de récit qui n’a que deux octaves, sonne l’unisson des dessus de la trompette, dont elle ne differe qu’en ce qu’elle a le son plus net.
Les pédales des jeux d’anches s’accordent, savoir, celle de clairon à l’unisson des basses du clairon ; s’il y a ravalement au clavier de pédale, le ravalement descend dans le huitieme pié à l’unisson de la trompette.
La pédale de trompette sonne l’unisson des basses de la trompette ; le ravalement descend dans le seizieme pié à l’unisson de la bombarde.
La pédale de bombarde s’accorde à l’octave au-dessous des basses de la trompette, par conséquent elle sonne le seizieme pié ; s’il y a ravalement, il descend dans le trente-deuxieme pié. Voyez la table du rapport des jeux, Fig. 67. & pour le mélange des jeux, l’article Jeux, & pour leur construction, leurs articles particuliers.
On accorde tous les jeux de mutation avec les accordoirs représentés, Fig. 49. Planche d’orgue. dont on coëffe les tuyaux ouverts ou à cheminée, pour diminuer l’orifice du tuyau & le faire baisser de ton ; on enfonce au contraire les accordoirs dans les tuyaux, ce qui élargit leur ouverture quand on veut les faire hausser de ton. Dans un orgue bien accordé, la partition de chaque jeu doit être semblable à celle du prestant.
ACCORDAILLES, s. f. pl. terme de Palais, consentement à un mariage donné solemnellement par les parens des deux futurs époux assemblés à cet effet. Hors des matieres de Palais, on dit plus ordinairement accords. Accordailles est antique. (H)
ACCORDE, s’accorder, terme de commandement qu’on fait à l’équipage d’une chaloupe pour le faire nager ensemble, afin que le mouvement des avirons soit uniforme. Voyez Chaloupe, Aviron. (Z)
ACCORDER des instrumens, c’est tendre ou lâcher les cordes, allonger ou raccourcir les tuyaux jusqu’à ce que toutes les parties de l’instrument soient au ton qu’elles doivent avoir.
Pour accorder un instrument, il faut d’abord déterminer un son qui doit servir aux autres de terme de comparaison ; c’est ce qu’on appelle prendre ou donner le ton : ce son est ordinairement l’ut pour l’orgue & le clavecin, & le la pour le violon & la basse, qui ont ce la sur une corde à vuide, & dans un medium propre à être aisément saisi par l’oreille : telle est la chanterelle du violoncelle & la seconde du violon.
A l’égard des flûtes, hautbois, & autres instrumens semblables, ils ont leur ton à peu près fixe, qu’on ne sauroit gueres changer qu’en changeant quelque piece de l’instrument. On peut encore les allonger un peu à l’emboîture des pieces, ce qui baisse le ton de quelque chose : mais il doit nécessairement résulter des tons faux de toutes ces variations, parce que la juste proportion est rompue entre la longueur totale de l’instrument, & les intervalles d’un trou à l’autre.
Quand le ton est déterminé, on y fait rapporter tous les autres sons de l’instrument, qui doivent être fixés par l’accord selon les intervalles qui leur sont assignés. L’orgue & le clavecin s’accordent par quintes & par octaves ; la basse & le violon par quintes ; la viole par quartes & par tierces. En général on choisit toûjours des intervalles consonans & harmonieux, afin que l’oreille soit mieux en état de juger de leur justesse.
On remarque que les instrumens dont on tire le son par inspiration, comme la flûte & le hautbois, montent sensiblement quand on en a joüé quelque tems, ce qui vient, selon quelques-uns, de l’humidité qui, sortant de la bouche avec l’air, les renfle & les raccourcit ; ou plûtôt c’est que la chaleur & la raréfaction que l’air reçoit pendant l’inspiration rendent ses vibrations plus fréquentes, diminuent son poids ; & augmentant ainsi le poids relatif de l’atmosphere, rendent le son un peu plus aigu, suivant la doctrine de M. Euler.
Quoi qu’il en soit de la cause, il faut, au moment de l’accord, avoir égard à l’effet, & forcer modérément le vent quand on donne le ton avec ces instrumens ; car pour qu’ils restent d’accord durant le concert, il faut qu’ils soient un peu trop bas en commençant. (S)
ACCORDOIR, s. m. c’est un outil ou instrument dont les Luthiers & Facteurs se servent pour mettre d’accord les instrumens de Musique. Cet outil est différent suivant les différens instrumens qu’on veut accorder. L’accordoir du clavecin est de fer ; il a la forme d’un petit marteau, dont le manche est creusé de façon à pouvoir y faire entrer la tête des fiches, afin de tendre ou lâcher les cordes de l’instrument, & par ce moyen en hausser ou baisser les tons. Voyez Accord, Accordoir d’orgue, & les Figures, Planches d’orgues.
Accordoirs, s. m. pl. ces instrumens qui servent aux Facteurs d’orgues pour accorder les tuyaux d’étain & de plomb de l’espece des tuyaux de mutation, sont des cones de cuivre creux représentés, Fig. 49. Planches d’orgue, & Fig. 49. n°. 2.
Les premiers ABC servent pour les plus gros tuyaux, & les seconds abc qui ont une poignée, servent pour les moindres. On élargit l’ouverture des tuyaux en faisant entrer la pointe du cone dedans jusqu’à ce que le tuyau soit baissé au ton convenable ; lorsqu’au contraire le tuyau se trouve trop bas, on le fait monter en le coëffant du cone concave pour resserrer l’ouverture.
Accords ou Acores, s. m. terme de Marine. C’est ainsi que les Constructeurs nomment deux grandes pieces de bois qui servent à soûtenir un navire tant qu’il demeure sur le chantier.
Accords de l’étrave. Voyez Étrave.
ACCORNÉ, adj. terme de Blason. Il se dit de tout animal qui est marqué dans l’écu, lorsque ses cornes font d’autres couleurs que l’animal.
Masterton, en Angleterre, de gueules à une licorne passante d’argent, accornée & onglée d’or. (V)
ACCORRE de triangle. Voyez Triangle.
Accorre droite, terme de Marine ; c’est celle qui appuie sur terre, au lieu que les autres vont appuyer de travers sur les préceintes du vaisseau.
ACCORRER ou ACCOSTER, c’est approcher une chose d’une autre. On dit accoster une manœuvre.
ACCOSTÉ, adj, terme de Blason dont on se sert en parlant de toutes les pieces de longueur mises en pal, c’est-à-dire, occupant le tiers de l’écu de haut en bas par le milieu, ou mises en bande ; ce qui veut dire occupant diagonalement le tiers de l’écu de droite à gauche, quand elles ont d’autres pieces à leurs côtés. Le pal est dit accosté de six annelets quand il y en a trois d’un côté & autant de l’autre ; & la bande est dite accostée quand les pieces qui sont à ses côtés sont couchées du même sens, & qu’il y en a le même nombre de chaque côté. Lorsqu’on emploie des besans, des tourteaux, des roses, des annelets, qui sont des pieces rondes, on peut dire accompagné au lieu d’accosté. Voyez Accompagné.
Villeprouvée, en Anjou & en Champagne, de gueule à la bande d’argent accostée de deux cottices d’or. (V)
ACCOSTE-ABORD, c’est ce qu’on dit pour obliger un petit vaisseau, ou une chaloupe, à s’approcher d’un plus grand navire. (Z)
ACCOSTER les huniers, accoster les perroquets ; c’est faire toucher les coins ou les points des huniers ou des perroquets, à la poulie qu’on place pour cet effet au bout des vergues. Voyez Hunier, Perroquet, Vergue
ACCOTAR, ACCOTARD, s. m. terme de Marine ; piece d’abordage que l’on endente entre les membres, & que l’on place sur le haut d’un vaisseau pour empêcher que l’eau ne tombe sur les membres. Les accotars d’un vaisseau de cent trente-quatre piés de long doivent avoir un pouce & demi d’épaisseur. Voyez Fig. de Marine, Planche V. Fig. 1. comment l’accotar est posé sur le bout des allonges. (Z)
ACCOUCHÉ, ÉE, part. Voyez Accouchement.
Accouchée, sub. f. femme qui est en couche. Voyez Accouchement.
ACCOUCHEMENT, s. m. dans l’œconomie animale, action par laquelle la matrice se décharge au bout d’un certain tems du fruit de la conception. Voyez Matrice & Conception.
Il s’agit de trouver une cause qui, au bout de neuf mois, nous délivre de la prison où la nature nous a fait naître : mais malheureusement en Physiologie, comme dans toute autre science, lorsqu’il s’agit des causes premieres, l’imagination a toûjours beaucoup plus de part dans leur recherche que la vérité ; de-là cette diversité si grande dans l’explication de toutes les actions principales des corps animés. C’est ainsi que les uns ont prétendu que c’étoit le défaut d’aliment qui faisoit que le fœtus cherchoit à sortir : d’autres, que l’enfant se détachoit de la matrice par la même raison que le fruit se détache de l’arbre ; ceux-ci ont avancé que l’acreté des eaux renfermées dans l’amnios obligeoit l’enfant à se mouvoir & à chercher la sortie ; & ceux-là ont pensé que l’urine & les excrémens formoient une certaine masse, que leur acreté qui incommodoit le fœtus, de concert avec cette pesanteur, le contraignoit à se mouvoir ; que par ses mouvemens la tête se tournoit du côté de la matrice, & que le visage regardoit ordinairement le coccyx ; que dans cette situation les intestins & la vessie picotés par l’urine & par les excrémens, causoient encore plus d’inquiétude au fœtus dans le bassin ; que cette action de la mere augmentoit le tenesme, & par conséquent les efforts ; & que le concours de ces causes ouvroit la matrice, &c.
Pechelin & Bohn n’ont pas été satisfaits de cette opinion : ils ont crû mieux expliquer le phénomene dont il s’agit, en disant qu’il résultoit d’un effort du fœtus pour respirer, qui le faisoit tourner vers l’orifice de la matrice. Bergerus est plus porté à croire que la situation gênante où se trouve le fœtus, est la cause par laquelle il se tourne, & qu’il change de place. Marinus attribue, contre toute vérité anatomique, l’accouchement au changement de l’uterus, qui perd de son diametre & devient un sphéroide plus allongé & moins étendu.
Toutes ces idées ne sont que des dépenses d’esprit qu’ont fait divers Philosophes, pour éclairer le premier passage qui nous a conduit à la lumiere. La premiere cause irritante est sans doute, comme l’observe le Docteur Haller (Comment. Boerhaav) dans le fœtus. En effet, dans les animaux, il rompt l’œuf par son propre effort, & il éclot : cela se voit quelquefois dans les quadrupedes, toûjours dans les oiseaux, dans les viperes & dans les insectes. Ce fœtus se trouve de plus en plus incommodé, tant par son méchonium, que par l’angustie même du lieu & par la diminution des eaux, ce qui produit de plus fréquens froissemens contre la matrice, qui naissent du mal-aise que le fœtus sent, d’autant plus que le cerveau s’accroît davantage, & que ses organes se perfectionnent : de-là tous ces fœtus venus vivans après la mort de la mere ou sortis par une chûte de la matrice, qui étoit sans action. Ensuite, il est indubitable que l’irritation se communique à la matrice proportionnellement aux plus grandes inquiétudes du fœtus, à sa pesanteur, à sa force, à la petite quantité d’eaux qui l’enveloppent ; d’ailleurs il paroit que la matrice ne peut s’étendre que jusqu’à un certain point fixe, & il est raisonnable de penser que la mere ne peut manquer de beaucoup souffrir d’une dilatation forcée par le fœtus ; cette irritation engage d’abord la matrice à se resserrer : mais la cause prochaine efficiente, est l’inspiration de la mere qui est énormément augmentée, & qui la délivre d’un fardeau qu’elle ne peut plus supporter : c’est cette inspiration qui a ici le plus d’efficacité, puisque nous voyons tous les jours des accouchemens de fœtus morts, & qu’il est à croire que le fœtus vivant a encore trop peu d’instinct pour pouvoir s’aider, & que l’accouchement naturel ne se fait jamais sans des efforts violens : ces trois causes sont jointes par Verheyen. Harvey montre de la sagacité lorsqu’il dit, que si la couche est attendue de l’action du fœtus, il le faut tirer par la tête ; & par les piés, quand on l’attend de l’uterus.
Ces enfans remuent les piés, & en donnent des coups assez forts. Depuis trois ou quatre mois jusqu’à neuf, les mouvemens augmentent sans cesse, desorte qu’enfin ils excitent efficacement la mere à faire ses efforts pour accoucher, parce qu’alors ces mouvemens & le poids du fœtus ne peuvent plus être enduies par la matrice : c’est une rêverie d’imaginer que dans un tems plûtôt que dans un autre, le fœtus ne puisse plus supporter le défaut d’air qui manque à son sang, & qu’il veuille qu’on le rende à la lumiere qu’il ignore, & que par conséquent il ne peut desirer.
Les sentimens qui précedent ne sont pas les seuls qu’on ait eus sur les causes de l’accouchement, & l’opinion d’Haller n’est pas la seule vraissemblable. Nous exposerons plus bas celles de M. de Buffon.
La matrice s’eloigne dans la grossesse, de l’orifice externe de la vulve, & sans cesse elle monte dans le bas-ventre, qui lui oppose moins de résistance, & se dilate surtout entre les trompes, où il y a plus de sinus. Une matrice pleine d’un fœtus formé, occupe presque tout le bas-ventre, & fait remonter quelquefois le diaphragme dans le thorax. Quelquefois la femme ne paroît gueres grosse, quoique prête d’accoucher, & elle accouche d’un gros enfant ; la raison en est que l’uterus est plus dilaté postérieurement qu’antérieurement : mais il est facile, comme on voit, de s’assûrer, en touchant une femme, si elle est grosse, cet éloignement de l’uterus étant le premier signe de grossesse. (L)
Il s’ensuit de tout ce qui précede, qu’on peut considérer la matrice comme un muscle creux dont la dilatation est passive pendant tout le tems de la grossesse, & qui enfin se met en contraction & procure la sortie du fœtus. On a vû au commencement de cet article ce qu’il faut penser de divers raisonnemens sur ce qui sert d’aiguillon à cette contraction de la matrice : quoi qu’il en soit de la cause, il est constant que cette contraction est accompagnée de douleurs fort vives, qu’on nomme douleurs de l’enfantement. Elles se distinguent des douleurs de colique, en ce que celles-ci se dissipent, ou du moins reçoivent quelque soulagement par l’application des linges chauds sur le bas-ventre, l’usage intérieur de l’huile d’amandes douces, la saignée, les lavemens adoucissans, &c. au lieu que tous ces moyens semblent exciter plus fortement les douleurs de l’enfantement. Un autre signe plus distinctif est le siége de la douleur : dans les coliques venteuses, elle est vague ; dans l’inflammation, elle est fixe, & a pour siége les parties enflammées : mais les douleurs de l’enfantement sont alternatives, répondent au bas, & sont toutes déterminées vers la matrice. Ces signes pourroient néanmoins induire en erreur (car ils sont équivoques) & être produits par un flux de ventre, un tenesme, &c. Il faut donc, comme on l’a dit plus haut, toucher l’orifice de la matrice, & son état fournira des notions plus certaines sur la nature des douleurs, & les signes caractéristiques du futur accouchement. Lorsque le corps de la matrice agit sur l’enfant qu’elle renferme, elle tend à surmonter la résistance de l’orifice qui s’amincit peu à peu & se dilate. Si l’on touche cet orifice dans le tems des douleurs, on sent qu’il se resserre ; & lorsque la douleur est dissipée, l’orifice se dilate de nouveau. On juge du tems que l’accouchement mettra à se terminer par l’augmentation des douleurs, & par le progrès de la dilatation de l’orifice lorsqu’elles sont cessées.
Il est donc naturel de présumer, dit M. de Buffon, que ces douleurs qu’on désigne par le nom d’heures du travail, ne proviennent que de la dilatation de l’orifice de la matrice, puisque cette dilatation est le plus sûr moyen pour reconnoître si les douleurs que ressent une femme grosse sont en effet les douleurs de l’enfantement : la seule chose qui soit embarrassante, continue l’Auteur que nous venons de citer, est cette alternative de repos & de souffrance qu’éprouve la mere : lorsque la premiere douleur est passée, il s’écoule un tems considérable avant que la seconde se fasse sentir ; & de même il y a des intervalles souvent très-longs entre la seconde & la troisieme, entre la troisieme & la quatrieme douleur, &c. Cette circonstance de l’effet ne s’accorde pas parfaitement avec la cause que nous venons d’indiquer ; car la dilatation d’une ouverture qui se fait peu à peu, & d’une maniere continue, devroit produire une douleur constante & continue, & non pas des douleurs par accès. Je ne sai donc si on ne pourroit pas les attribuer à une autre cause qui me paroît plus convenable à l’effet : cette cause seroit la séparation du placenta : on sait qu’il tient à la matrice par un certain nombre de mammelons qui pénetrent dans les petites lacunes ou cavités de ce viscere ; dès-lors ne peut-on pas supposer que ces mammelons ne sortent pas de leurs cavités tous en même tems ? Le premier mammelon qui se séparera de la matrice, produira la premiere douleur ; un autre mammelon qui se séparera quelque tems après, produira une autre douleur, &c. L’effet répond ici parfaitement à la cause, & on peut appuyer cette conjecture par une autre observation ; c’est qu’immédiatement avant l’accouchement il sort une liqueur blanchatre & visqueuse, semblable à celle que rendent les mammelons du placenta lorsqu’on les tire hors des lacunes où ils ont leur insertion ; ce qui doit faire penser que cette liqueur qui sort alors de la matrice, est en effet produite par la séparation de quelques mammelons du placenta. M. de Buffon, Hist. nat. (I)
Lorsque le Chirurgien aura reconnu que la femme est dans un véritable travail, il lui fera donner quelques lavemens pour vuider le rectum avant que l’enfant se trouve au passage : il est aussi fort à propos de faire uriner la femme ou la sonder, si le col de la vessie étoit déja comprimé par la tête de l’enfant. Lorsque la femme est assez forte, on gagne beaucoup à lui faire une saignée dans le travail ; la déplétion qu’on occasionne par ce moyen, relâche toutes les parties & les dispose très-avantageusement. On prépare ensuite un lit autour duquel on puisse tourner commodément. Le Chirurgien touchera la femme de tems en tems, pour voir si les membranes qui enveloppent l’enfant sont prêtes à se rompre. Lorsque les eaux ont percé, on porte le doigt dans l’orifice de la matrice pour reconnoître quelle partie l’enfant présente ; c’est la tête dans l’accouchement naturel : on sent qu’elle est dure, grosse, ronde & égale ; les autres parties ont des qualités tactiles différentes dont il est assez facile de s’appercevoir, même à travers les membranes. Les choses étant dans cet état, (les eaux étant percées) il faut faire coucher promptement la femme sur le lit préparé particulierement pour l’accouchement. Ce lit doit être fait d’un ou de plusieurs matelas garnis de draps pliés en plusieurs doubles, pour recevoir le sang & les eaux qui viendront en abondance. Il ne faut pas que la femme soit tout-à-fait couchée, ni assise tout-à-fait : on lui éleve la poitrine & la tête par des oreillers : on lui met un traversin sous l’os sacrum pour lui élever le bassin : les cuisses & les jambes seront fléchies, & il est bon que les piés puissent être appuyés contre quelque chose qui résiste. Chez les personnes mal à leur aise, où l’on n’a pas la commodité de disposer un lit extraordinaire, on met les femmes au pié de leur lit, qu’on traverse d’une planche appuyée contre les quenouilles. La femme en travail tiendra quelqu’un par les mains pour mieux se roidir & s’en servir de point d’appui dans le tems des douleurs. Il ne faut point presser le ventre comme le font quelques Sages-femmes. Le Chirurgien oindra ses mains avec quelques graisses, comme sain-doux, beurre frais, ou avec quelques huiles, afin de lubrifier tout le passage. Il mettra ensuite le bout de ses doigts dans le vagin, en les tenant, autant qu’il le pourra, écartés les uns des autres dans le tems des douleurs.
Quand la tête de l’enfant commencera à avancer, le Chirurgien se disposera à recevoir l’enfant. Lorsqu’elle sera avancée jusqu’aux oreilles, on tachera de glisser quelques doigts sur la machoire inférieure, & à la premiere douleur un peu forte on tirera l’enfant. Il ne faut pas tirer l’enfant tout droit, mais en vacillant un peu de côté & d’autre, afin de faire passer les épaules. Ces mouvemens se doivent faire sans perdre de tems, de crainte que l’enfant ne soit suffoqué par l’action de l’orifice sur le cou, si cette partie restoit arrêtée trop long-tems au passage. Aussitôt que les épaules seront dehors, on coule les doigts sous les aisselles pour tirer le reste du corps.
Dès que l’enfant sera tiré, le Chirurgien le rangera de côté, lui tournant la face de façon qu’il ne puisse être incommodé, ou même étouffé par le sang & les eaux qui sortent immédiatement après, & qui tomberoient dans la bouche & dans le nez du nouveau né s’il étoit couché sur le dos.
Après avoir mis l’enfant dans une position où l’on ne puisse pas craindre ces inconvéniens, on fait deux ligatures au cordon ombilical avec un fil ciré en plusieurs doubles : ces ligatures se font à quatre travers de doigt de distance, & le plus proche de l’enfant, à peu près à cet intervalle de son nombril. On coupe le cordon avec des ciseaux ou avec un bistouri entre les deux ligatures, dont l’effet est d’empêcher que la mere ne perde du sang par la veine ombilicale qui le porte à l’enfant, & que l’enfant ne souffre point de l’hémorrhagie des arteres ombilicales qui reportent le sang de l’enfant au placenta.
On entortille alors l’extrémité du cordon qui sort de la matrice autour de deux doigts, & on le tire doucement après avoir donné de légeres secousses en tous sens pour décoller le placenta, dont la sortie est l’effet de la contraction de la matrice déterminée encore par quelques douleurs. Ce viscere tend à se débarrasser de l’arriere-faix qui deviendroit corps étranger. On doit considérer la sortie du placenta comme un second accouchement. Lorsque le cordon ombilical est rompu, ou lorsque le placenta résiste un peu trop à sa séparation de l’intérieur de la matrice, il faut que le Chirurgien y porte la main promptement tandis que l’orifice est encore béant : le délai deviendroit par le resserrement de l’orifice un grand obstacle à l’introduction de la main. Si dans le second cas que nous venons d’exposer on ne portoit pas la main dans la matrice pour en détacher le placenta, & qu’on s’obstinât à vouloir tirer par le cordon, on pourroit occasionner le renversement de la matrice dont nous parlerons en son lieu. Il faut de même porter la main dans la matrice, lorsqu’après avoir tiré le placenta on s’apperçoit qu’il n’est pas dans son entier. On débarrasse en même tems dans toutes ces occasions la cavité de cet organe des caillots de sang qui pourroient s’y trouver.
Si après avoir tiré l’enfant on reconnoissoit que le ventre ne se fût point affaissé, comme il le fait ordinairement, & que les douleurs continuassent assez vivement, il faudroit avant que de faire des tentatives pour avoir le placenta, reporter la main dans la matrice. Il y a presque toûjours dans cette circonstance un second enfant dont il faudroit accoucher de nouveau la femme, après avoir rompu les membranes qui enveloppent le second enfant ; & il ne faudroit délivrer la mere du placenta du premier enfant qu’après le second accouchement, parce que les arrierefaix pouvant être collés l’un à l’autre, on ne pourroit en arracher un sans décoller l’autre, ce qui donneroit lieu à une perte de sang qui pourroit causer la mort à l’enfant qui resteroit, & même être préjudiciable à la mere.
Si un enfant avoit beaucoup souffert au passage, s’il étoit froissé & contus, comme cela arrive dans les accouchemens laborieux, on pourroit couper le cordon ombilical après avoir fait une seule ligature, & tiré quelques cuillerées de sang par le bout du cordon qui tient à l’enfant avant que de le lier : cette saignée rempliroit l’indication que demande un pareil état.
L’accouchement où l’enfant présente les piés pourroit à la rigueur passer pour naturel, puisqu’il sort facilement de cette façon par l’aide d’un Accoucheur, & que c’est ainsi qu’il faut terminer les accouchemens laborieux dans lesquels les enfans présentent quelques autres parties, à moins que ce ne soient les fesses, l’enfant pouvant alors être tiré en double.
Lorsqu’on a été obligé d’aller chercher les piés de l’enfant, on les amene à l’orifice de la matrice : si l’on n’en a pû saisir qu’un, l’autre ne fait point d’obstacle ; il faut tirer celui qu’on tient jusqu’à ce qu’on puisse dégager l’autre cuisse. Lorsque l’enfant a la poitrine dans l’orifice de la matrice, il faut ; sans cesser de tirer, donner un demi tour si les doigts des piés regardoient l’os pubis, afin de retourner l’enfant dont le menton pourroit s’accrocher à ces os si l’on continuoit de le tirer dans cette premiere situation.
Un accouchement naturel par rapport à la bonne situation de l’enfant, peut être difficile lorsque la femme n’aura point été aidée à propos, qu’il y aura long-tems que les eaux se seront écoulées, & que les douleurs deviendront languissantes, ou même cesseront tout-à-fait. On peut bien remédier en quelque sorte à la secheresse de l’accouchement, en exposant la femme à la vapeur de l’eau tiede qui relâche les parties : mais rien ne supplée au défaut des douleurs : les lavemens acres que quelques Auteurs conseillent peuvent irriter le rectum & la matrice par communication ; mais cela peut être infructueux & nuisible : le plus court dans ces conjonctures est de se servir du tire-tête, dont nous parlerons au mot Forceps.
Lorsque le fœtus est mort, & qu’on ne peut pas l’avoir par l’instrument dont nous venons de parler, on est contraint de se servir des moyens extrèmes, & de dépecer l’enfant avec les crochets, pour délivrer la mere de ce fruit infortuné. Voyez Crochet.
Si toutes choses bien disposées d’ailleurs, il y a une impossibilité physique de tirer l’enfant en vie par les voies ordinaires, en consequence de la mauvaise conformation des os du bassin de la mere, &c. il faut faire l’opération césarienne. V. Césarienne.
Mais la nature tend trop efficacement à la conservation des especes pour avoir rendu les accouchemens laborieux les plus fréquens. Au contraire, il arrive quelquefois que le fœtus sort de la matrice sans déchirer les membranes qui l’enveloppent, & par conséquent sans que la liqueur qu’elles contiennent se soit écoulée : cet accouchement paroit être le plus naturel, & ressemble à celui de presque tous les animaux : cependant le fœtus humain perce ordinairement ses membranes à l’endroit qui se trouve sur l’orifice de la matrice, par l’effort qu’il fait contre cette ouverture ; & il arrive assez souvent que l’amnios, qui est fort mince, ou même le chorion, se déchirent sur les bords de l’orifice de la matrice, & qu’il en reste une partie sur la tête de l’enfant en forme de calote ; c’est ce qu’on appelle naitre coeffé. Dès que cette membrane est percée ou déchirée, la liqueur qu’elle contient s’écoule : on appelle cet écoulement le bain ou les eaux de la mere : les bords de l’orifice de la matrice & les parois du vagin en étant humectés, se prêtent plus facilement au passage de l’enfant. Après l’écoulement de cette liqueur, il reste dans la capacité de la matrice un vuide dont les Accoucheurs intelligens savent profiter pour retourner le fœtus, s’il est dans une position desavantageuse pour l’accouchement, ou pour le débarrasser des entraves du cordon ombilical qui l’empêchent quelquefois d’avancer. M. de Buffon, Hist. nat.
Pour que l’Accouchement soit naturel, il faut, selon les Medecins, trois conditions : la premiere, que la mere & l’enfant fassent réciproquement leurs efforts, la mere pour mettre au monde l’enfant, & l’enfant pour sortir du ventre de sa mere. La seconde, que l’enfant vienne au monde la tête la premiere, cela étant sa situation naturelle. Et la troisieme, que l’accouchement soit prompt & facile, sans aucun mauvais accident.
Lorsque l’enfant présente les piés, ou qu’il vient de travers ou double, l’accouchement n’est point naturel. Les Latins appelloient les enfans ainsi nés agrippæ, comme qui diroit ægrè parti. Voyez Agrippa.
L’Accouchement naturel est celui qui se fait au terme juste, c’est-à-dire, dans le dixieme mois lunaire : l’accouchement n’est point naturel, lorsque l’enfant vient au monde ou plûtôt ou plûtard, comme dans le huitieme mois.
Les femmes accouchent au bout de sept, huit, neuf, dix & onze mois : mais elles ne portent pas plus long-tems, nonobstant que quelques Medecins prétendent qu’un accouchement peut être naturel dans le quatorzieme mois.
On a remarqué que les Accouchemens sont plus heureux dans le septieme mois que dans le huitieme, c’est-à-dire, qu’il est plus aisé de sauver l’enfant quand il vient dans le septieme mois que quand il vient dans le huitieme, & que ces premiers vivent plus souvent que les derniers.
Peysonnel, Medecin à Lyon, a écrit un Traité Latin du terme de l’Accouchement des femmes, où il entreprend de concilier toutes les contradictions apparentes d’Hippocrate sur ce sujet. Il prétend que le terme le plus court de l’Accouchement naturel, suivant Hippocrate, est de cent quatre-vingts-deux jours, ou de six mois entiers & complets ; & le plus long, de deux cens quatre-vingts jours, ou de neuf mois complets & dix jours ; & que les enfans qui viennent devant ou après ce terme ne vivent point, ou ne sont pas légitimes.
Bartholin a écrit un Livre de insolitis partûs viis, des conduits extraordinaires par où sort le fœtus : il rapporte différens exemples d’accouchemens fort extraordinaires. Dans les uns le fœtus est sorti par la bouche ; dans d’autres par l’anus. Voyez Salmuthus, Obs. 94. Cent. III. Transact. Philosoph. n°. 416. p. 435.
* Il est fait mention dans les Mémoires de l’Académie des Sciences, année 1702, page 235, d’un fœtus humain tiré du ventre de sa mere par le fondement. Cette espece d’accouchement est assez extraordinaire pour trouver place ici. Au mois de Mars 1702, M. Cassini ayant donné avis à l’Académie des Sciences qu’une femme, sans avoir eu aucun signe de grossesse, avoit rendu par le siége plusieurs os qui sembloient être les os d’un fœtus, la chose parut singuliere, d’autant plus que quelques-uns se souvinrent qu’on avoit autrefois proposé des faits semblables, qui s’étoient trouvé faux par l’examen qu’on en avoit fait ; & M. Littre s’offrit à vérifier celui-ci.
Il trouva dans le lit une femme de 31 ans, autrefois fort grasse, alors horriblement décharnée & très foible. Il y avoit douze ans qu’elle étoit mariée : elle avoit eu trois enfans pendant les six premieres années de son mariage ; elle avoit fait quatre fausses couches dans les trois années suivantes ; & le 15 du mois d’Août de l’année précédente elle avoit senti une douleur aiguë à la hanche droite ; & cette douleur qui étoit diminuée quelque tems après, avoit entierement cessé au bout de cinq semaines. Au commencement du mois de Novembre de la même année, elle avoit senti sous le foie une autre douleur, accompagnée d’un grand étouffement ; & en appuyant sur la région douloureuse, on y avoit remarqué une tumeur ronde & grosse qui ne paroissoit pas au dehors, & qu’on sentoit au toucher. Environ deux mois après, ce qui faisoit cette tumeur étoit tombé dans le côté droit du bassin de l’hypogastre, & la douleur & l’étouffement avoient cessé sur le champ. Voyez la suite effrayante des symptomes de cet accident dans le Mémoire de M. Littre ; la fievre continue pendant quatre mois sans relâche, avec redoublemens par jour, & frissons ; l’aversion pour les alimens, les défaillances, les hoquets, le vomissement de sang, un cours de ventre purulent & sanglant, qui entraînoit des os, des chairs, des cheveux, &c. les épreintes, les coliques, la toux, le crachement de sang, les insomnies, les délires, &c.
À l’inspection des os rendus, M. Littre s’apperçut qu’ils appartenoient à un fœtus d’environ six mois. Cependant cette femme n’avoit jamais eu aucun soupçon de grossesse ; son ventre n’avoit jamais sensiblement grossi, & elle n’y avoit point senti remuer d’enfant : mais d’un autre côté elle avoit eu quelques autres signes de grossesse que M. Littre rapporte. M. Littre examina ensuite la matrice & le gros boyau de la malade : la matrice étoit dans son état naturel, & il n’en étoit rien sorti que dans le tems réglé pour les femmes saines qui ne sont pas grosses. Mais le fondement étant bordé d’hémorrhoïdes, son orifice étoit serré & rétréci par une dureté considérable qui en occupoit toute la circonférence ; & en introduisant avec beaucoup de peine de sa part, & de douleur de la part de la malade, le doigt & les instrumens, le rectum lui parut ulceré & percé en dedans d’un trou large d’environ un pouce & demi. Ce trou situé à la partie postérieure de l’intestin du côté droit, deux pouces & demi au-dessus du fondement, ne laissoit plus de doute sur le chemin que les os & les autres matieres étrangeres avoient tenu.
En examinant avec le doigt cette plaie, M. Littre sentit la tête d’un fœtus qui étoit si fortement appliquée, qu’il ne put la déranger, & que depuis trois jours la malade ne rendoit plus de matieres extraordinaires.
L’état de la malade étant constaté, il s’agissoit de la guérir : pour cet effet, M. Littre commença par lui donner des forces, en lui prescrivant les meilleurs alimens & les remedes les plus capables d’affoiblir les symptomes du mal : ensuite il travailla à tirer le reste du fœtus ; ce qu’il ne put exécuter qu’avec des précautions infinies, & dans un tems très-considérable. Il tira avec ses doigts tous les petits os & les chairs, il inventa des instrumens à l’aide desquels il coupa les gros os, sans aucun danger pour la femme ; & ce traitement commencé au mois de Mars dura cinq mois, au bout desquels la malade se trouva en état de vaquer à ses affaires. Ceux qui le suivront dans tout son détail, douteront si l’art a moins de ressources que la nature, & s’il n’y a pas des cas où le Chirurgien & le Medecin ne font pas plus qu’elle pour notre conservation : cependant on sait qu’elle conserve tout ce qu’elle peut empêcher de périr, & que de tous les moyens qui lui sont possibles, il n’y en a presqu’aucun qu’elle n’emploie.
M. Littre cherche, après avoir fait l’histoire de la guérison, dans quel endroit ou dans quelle partie du ventre de la malade le fœtus étoit contenu pendant qu’il vivoit. On peut d’abord soupçonner quatre endroits différens ; la simple capacité du ventre, la matrice, les trompes & les ovaires.
Il n’étoit pas dans la simple capacité du ventre, parce qu’en pressant la partie inférieure du ventre de haut en bas, on touchoit une espece de poche d’une grandeur à contenir un petit fœtus d’environ six mois, ronde, peu stable dans son assiette, & percée d’un trou. Cette poche n’étoit pas les membranes du fœtus, mais une partie de la mere, car les membranes du fœtus avoient été extraites par l’ouverture du gros boyau.
Il n’étoit pas non plus dans la cavité de la matrice ; 1°. parce que la malade a eu réglément ses ordinaires pendant cette grossesse : 2°. que le trou de la poche étoit situé à sa partie latérale gauche : 3°. que trois mois après la sortie du fœtus cette poche étoit encore grosse : 4°. que pendant le traitement il n’étoit survenu aucune altération aux parties naturelles, aucun écoulement, &c. 5°. que la matrice pleine d’un fœtus de six mois ne s’étend point jusqu’aux fausses côtes : 6°. que s’il eût été dans la matrice, il en eût rongé les parois pour en sortir.
D’où M. Littre conclut que c’est donc ou la trompe ou l’ovaire qui avoit servi de matrice au fœtus : mais il ne se décide point pour l’une de ces parties plûtôt que pour l’autre ; il conjecture seulement que la poche formée par l’une ou l’autre s’est ouverte, & que le fœtus est tombé dans la capacité de l’hypogastre où il est mort.
On a vû par le commencement de cet article, ce qu’il produisit là, & quelles furent les suites de cet accident.
Vers la fin de Septembre la malade fut aussi forte & dans le même embonpoint qu’auparavant. Elle joüissoit d’une parfaite santé lorsque M. Littre faisoit l’histoire de sa maladie.
Le fait précedent est remarquable par la maniere dont une femme s’est débarrassée d’un enfant mort : en voici un autre qui ne l’est gueres moins par le nombre des enfans qu’une femme a mis au monde tous vivans. On lit, Hist. de l’Acad. 1709, pag. 22, que dans la même année la femme d’un Boucher d’Aix étoit accouchée de quatre filles, qui paroissoient de différens termes, ensuite d’une masse informe, puis de deux jours en deux jours de nouveaux enfans bien formés, tant garçons que filles, jusqu’au nombre de cinq ; de sorte qu’en tout il y en avoit neuf, sans compter la masse : ils étoient tous vivans, & furent tous baptisés ou ondoyés. On n’avoit point encore ouvert la masse informe, qui apparemment contenoit un autre enfant. Le nombre des enfans, & quelques soupçons de superfétation, sont ici des choses très-dignes d’observation.
Il est vrai que l’histoire de la fameuse Comtesse de Hollande seroit bien plus merveilleuse : mais aussi n’a-t-elle pas l’air d’une histoire.
En 1685, à Leckerkerch, qui est à huit ou dix lieues de la Haye, la femme d’un nommé Chrétien Claes accoucha de cinq enfans. Le premier fut un garçon qui vécut deux mois. Dix-sept heures après la naissance de celui-là, vint un second fils, mais mort. Vingt-quatre heures après cette femme mit au monde un troisieme garçon, qui vécut environ deux heures. Autres vingt-quatre heures après elle eut un quatrieme mort-né. Elle mourut elle-même en mettant au monde un cinquieme garçon, qui périt dans le travail.
Je terminerai cet article par une question physiologique relative à la méchanique des accouchemens. On demande s’il se fait un écartement des os pubis dans cette opération de la nature. Quelques Auteurs pensent que ceux qui tiennent l’affirmative le font avec trop de crédulité, & peu d’exactitude : mais il y a des faits très-circonstanciés qui détruisent ces imputations. M. Verdier, célebre Anatomiste, de l’Académie Royale de Chirurgie, & Démonstrateur royal des Ecoles, a traité amplement cette matiere dans son Traité d’Ostéologie, à l’article des os du bassin. M. Loüis a fait des observations sur un grand nombre de cadavres, à la sollicitation de M. Levret, membre de la même Académie ; & tous deux ont vû par le parallele de la jonction des os du bassin des femmes & des hommes, que dans celles-là il y avoit des dispositions très-naturelles à l’écartement non-seulement des os pubis, mais encore des iléons avec l’os sacrum ; & l’examen des cadavres des femmes mortes en couche à l’Hôtel-Dieu, que M. Levret a fait avec M. Moreau, Chirurgien Major de cette Maison en survivance de M. Boudou, confirme que toute la charpente osseuse du bassin prête plus ou moins dans les accouchemens les plus naturels.
Les Chirurgiens François ont beaucoup travaillé sur la matiere des accouchemens : tels sont Portail, Peu, Viardel, Amand, Mauriceau, Lamotte, Levret, &c. M. Puzos a donné à l’Académie de Chirurgie plusieurs Mémoires sur cette matiere : il y en a un inséré dans le premier volume sur les pertes de sang des femmes grosses, digne de la réputation de l’Auteur.
ACCOUCHER, v. n. enfanter. Accoucher heureusement. Elle a accouché en tel endroit. Elle est accouchée. Accoucher à terme. Accoucher d’un enfant mort. (L)
Accoucher, v. adj. aider à une femme à accoucher. C’est cette Sage-femme qui a accouché une telle dame. Elle accouche bien. Un Chirurgien accouche mieux qu’une Sage-Femme. (L)
ACCOUCHEUR, s. m. Chirurgien dont le talent principal est d’accoucher les femmes. Ce Chirurgien est un bon Accoucheur. (L)
ACCOUCHEUSE s. f. femme qui fait profession d’accoucher. Habile Accoucheuse. On dit plûtôt Sage-Femme. (L)
* Il y a des maladies, dit Boerhaave, qui viennent de causes toutes particulieres & qu’il faut bien remarquer, parce qu’elles donnent lieu à une mauvaise conformation. Les principales sont l’imagination de la mere, l’imprudence de l’Accoucheuse, &c. Il arrive fort souvent, ajoûte son Commentateur, M. de la Metrie, « que ces femmes rendent les corps mous des enfans tout difformes, & qu’elles gâtent la figure de la tête en la maniant trop rudement. Delà tant de sots dont la tête est mal faite, oblongue ou angulaire, ou de toute autre forme différente de la naturelle. Il vaudroit mieux pour les femmes, ajoûte M. de la Metrie, qu’il n’y eût point d’Accoucheuses. L’art des accouchemens ne convient que lorsqu’il y a quelque obstacle : mais ces femmes n’attendent pas le tems de la nature ; elles déchirent l’oeuf, & elles arrachent l’enfant avant que la femme ait de vraies douleurs. J’ai vû des enfans dont les membres ont été luxés dans cette opération ; d’autres qui en ont eu un bras cassé. Lorsqu’un membre a été luxé, l’accident restant inconnu, l’enfant en a pour le reste de la vie. Lorsqu’il y a fracture, le raccourcissement du membre l’indique. Je vous conseille donc, lorsque vous pratiquerez, de réprimer ces téméraires Accoucheuses ». Voyez Inst. de Boerhaave.
Je me crois obligé par l’intérêt que tout honnête homme doit prendre à la naissance des citoyens, de déclarer que poussé par une curiosité qui est naturelle à celui qui pense un peu, la curiosité de voir naître l’homme après l’avoir vû mourir tant de fois, je me fis conduire chez une de ces Sages-femmes qui font des éleves & qui reçoivent des jeunes gens qui cherchent à s’instruire de la matiere des accouchemens, & que je vis là des exemples d’inhumanité qui seroient presque incroyables chez des barbares. Ces Sages-femmes, dans l’espérance d’attirer chez elles un plus grand nombre de spectateurs, & par conséquent de payans, faisoient annoncer par leurs émissaires qu’elles avoient une femme en travail dont l’enfant viendroit certainement contre nature. On accouroit ; & pour ne pas tromper l’attente, elles retournoient l’enfant dans la matrice, & le faisoient venir par les piés. Je n’oserois pas avancer ce fait si je n’en avois pas été témoin plusieurs fois, & si la Sage-femme elle-même n’avoit eu l’imprudence d’en convenir devant moi, lorsque tous les assistans s’étoient retirés. J’invite donc ceux qui sont chargés de veiller aux désordres qui se passent dans la société, d’avoir les yeux sur celui-là.
ACCOUER, v. adj. Quand le Veneur court un cerf qui est sur ses fins, & le joint pour lui donner le coup d’épée au défaut de l’épaule, ou lui couper le jarret ; on dit, le Veneur vient d’accouer le cerf, ou le cerf est accoué.
* ACCOUPLE, s. f. lien dont on attache les chiens de chasse, ou deux à deux, ou quelquefois trois à trois.
ACCOUPLEMENT, s. m. jonction du mâle & de la femelle pour la génération. Les animaux s’accouplent de différentes façons, & il y en a plusieurs qui ne s’accouplent point du tout. M. de Buffon nous donne une idée générale de cette variété de la nature dans le 2e vol. de l’Hist. nat. gén. & part. avec la description du Cabinet du Roi, page 311. & suivantes. Voici ses propres termes.
« La plus grande partie des animaux se perpétuent par la copulation ; cependant parmi les animaux qui ont des sexes, il y en a beaucoup qui ne se joignent pas par une vraie copulation ; il semble que la plûpart des oiseaux ne fassent que comprimer fortement la femelle, comme le coq, dont la verge quoique double est fort courte, les moineaux, les pigeons, &c. D’autres, à la vérité, comme l’autruche, le canard, l’oie, &c. ont un membre d’une grosseur considérable, & l’intromission n’est pas équivoque dans ces especes : les poissons mâles s’approchent de la femelle dans le tems du frai ; il semble même qu’ils se frottent ventre contre ventre, car le mâle se retourne quelquefois sur le dos pour rencontrer le ventre de la femelle, mais avec cela il n’y a aucune copulation ; le membre nécessaire à cet acte n’existe pas ; & lorsque les poissons mâles s’approchent de si près de la femelle, ce n’est que pour répandre la liqueur contenue dans leurs laites sur les œufs que la femelle laisse couler alors ; il semble que ce soient les œufs qui les attirent plûtôt que la femelle ; car si elle cesse de jetter des œufs, le mâle l’abandonne & suit avec ardeur les œufs que le courant emporte, ou que le vent disperse : on le voit passer & repasser cent fois dans tous les endroits où il y a des œufs : ce n’est sûrement pas pour l’amour de la mere qu’il se donne tous ces mouvemens ; il n’est pas à présumer qu’il la connoisse toûjours ; car on le voit répandre sa liqueur sur tous les œufs qu’il rencontre, & souvent avant que d’avoir rencontré la femelle.
« Il y a donc des animaux qui ont des sexes & des parties propres à la copulation, d’autres qui ont aussi des sexes & qui manquent de parties nécessaires à la copulation ; d’autres, comme les limaçons, ont des parties propres à la copulation & ont en même tems les deux sexes ; d’autres, comme les pucerons, n’ont point de sexe, sont également peres ou meres & engendrent d’eux-mêmes & sans copulation, quoiqu’ils s’accouplent aussi quand il leur plaît, sans qu’on puisse savoir trop pourquoi, ou pour mieux dire, sans qu’on puisse savoir si cet accouplement est une conjonction de sexes, puisqu’ils en paroissent tous également privés ou également pourvûs ; à moins qu’on ne veuille supposer que la nature a voulu renfermer dans l’individu de cette petite bête plus de faculté pour la génération que dans aucune autre espece d’animal, & qu’elle lui aura accordé non-seulement la puissance de se reproduire tout seul, mais encore le moyen de pouvoir aussi se multiplier par la communication d’un autre individu. »
Et à la page 313. « Presque tous les animaux, à l’exception de l’homme, ont chaque année des tems marqués pour la génération ; le printems est pour les oiseaux la saison de leurs amours ; celle du frai des carpes & de plusieurs autres especes de poissons est le tems de la plus grande chaleur de l’année, comme aux mois de Juin & d’Août ; celle du frai des brochets, des barbeaux & d’autres especes de poissons, est au printems ; les chats se cherchent au mois de Janvier, au mois de Mai, & au mois de Septembre ; les chevreuils au mois de Décembre ; les loups & les renards en Janvier ; les chevaux en été ; les cerfs au mois de Septembre & d’Octobre ; presque tous les insectes ne se joignent qu’en Automne, &c. Les uns, comme ces derniers, semblent s’épuiser totalement par l’acte de la génération, & en effet ils meurent peu de tems après, comme l’on voit mourir au bout de quelques jours les papillons qui produisent les vers à soie ; d’autres ne s’épuisent pas jusqu’à l’extinction de la vie, mais ils deviennent, comme les cerfs, d’une maigreur extrème & d’une grande foiblesse, & il leur faut un tems considérable pour réparer la perte qu’ils ont faite de leur substance organique ; d’autres s’épuisent encore moins & sont en état d’engendrer plus souvent ; d’autres enfin, comme l’homme, ne s’épuisent point du tout, ou du moins sont en état de réparer promptement la perte qu’ils ont faite, & ils sont aussi en tout tems en état d’engendrer, cela dépend uniquement de la constitution particuliere des organes de ces animaux : les grandes limites que la nature a mises dans la maniere d’exister se trouvent toutes aussi étendues dans la maniere de prendre & de digérer la nourriture, dans les moyens de la rendre ou de la garder, dans ceux de la séparer & d’en tirer les molécules organiques nécessaires à la reproduction ; & par-tout nous trouverons toûjours que tout ce qui peut être est ». (I)
ACCOUPLEMENT, s’entend en Architecture de la maniere d’espacer les colonnes le plus près les unes des autres, qu’il est possible, en évitant néanmoins la pénétration des bases & des chapiteaux, comme au portail des Minimes par François Mansard. De tous les ordres, le Dorique est le plus difficile à accoupler, à cause de la distribution des métopes, de la frise, de son entablement ; lesquels, selon le système des anciens, doivent être quarrés, quoique plusieurs Architectes modernes ayent négligé ce précepte, tels que de Brosse à S. Gervais & au Luxembourg, & le Mercier au Palais Royal. (P)
ACCOUPLER, v. a. apparier ensemble le mâle & la femelle. Voyez Accouplement. (L)
Accoupler, terme de riviere, c’est lier plusieurs batteaux ensemble.
Accoupler, terme d’Agriculture, c’est appareiller deux chevaux, deux bœufs, pour les employer au labour des terres & à d’autres ouvrages de la campagne.
Accoupler. On dit au trictrac accoupler ses dames, c’est proprement les disposer deux à deux sur une fleche. Voyez Dames.
ACCOURCIR la bride dans sa main, c’est une action par laquelle le cavalier, après avoir tiré vers lui les rênes de la bride, en les prenant par le bout où est le bouton avec la main droite, les reprend ensuite avec la gauche qu’il avoit ouverte tant soit peu, pour laisser couler les rênes pendant qu’il les tiroit à lui. (V)
Accourcir le trait, terme de Chasse, c’est le ployer à demi ou tout-à-fait pour tenir le limier.
ACCOURSE, s. f. terme de Marine, c’est le passage qu’on laisse au fond de calle dans le milieu & des deux côtés du vaisseau, pour aller de la poupe à la proue le long du vaisseau. (Z)
ACCOUTREMENT, s. m. vieux mot qui signifie parure, ajustement. Il signifioit aussi l’habillement & l’équipage militaire d’un Soldat, d’un Chevalier, d’un Gentilhomme.
Quelques Auteurs font venir ce mot de l’Allemand custer, d’où l’on a fait coûtre, qui est encore en usage dans quelques Cathédrales de France, & entre autres dans celle de Bayeux, pour signifier un Sacristain ou Officier qui a soin de parer l’autel ou l’Eglise. D’autres le font venir du mot acculturare, qui dans la basse Latinité équivaut à culturam dare ou ornare. Quoi qu’il en soit, ce terme est suranné, & n’est plus d’usage que dans la conversation ou dans le style familier. (G)
ACCOUTUMER un cheval, c’est le styler, le faire à quelque exercice ou à quelque bruit que ce soit, pour qu’il n’en ait point peur. (V)
ACCRETION, s. f. en Medecine. Voyez Accroissement.
ACCROCHEMENT, s. m. parmi les Horlogers, signifie un vice de l’échappement qui fait arrêter l’horloge. Il vient de ce qu’une dent de la roue de rencontre s’appuie sur une palette avant que son opposée ait échappé de dessus l’autre palette. Cet accident arrive aux montres dont l’échappement est trop juste ou mal fait, & à celles dont les trous des pivots du balancier, ceux de la roue de rencontre, & les pointes des dents de cette roue,ont souffert beaucoup d’usure.
On dit qu’une montre a une feinte d’accrochement, lorsque les dents opposées de sa roue de rencontre touchent en échappant les deux palettes en même tems, mais si légerement qu’elles ne font pour ainsi dire que frotter sur la palette qui échappe, & que cela n’est pas assez considérable pour la faire arrêter. Voyez Echappement. (T)
ACCROCHER, v. act. (Marine) c’est aborder un vaisseau en y jettant des grapins. V. Abordage. (Z)
ACCROISSANCE, s. f. V. Accroissement.
ACCROISSEMENT, s. m. en Droit, est l’adjection & la réunion d’une portion devenue vacante à celle qui est déja possédée par quelqu’un. Voyez Accession.
Dans le Droit civil un legs fait à deux personnes conjointes tam re quam verbis, tombe tout entier par droit d’accroissement à celui des deux légataires qui survit au testateur, si l’un des deux est mort auparavant. L’alluvion est une autre espece d’accroissement. Voyez Alluvion. (H)
Accroissement, en Physique, se dit de l’augmentation d’un corps organisé qui croît par de nouvelles parties qui s’y ajoûtent.
L’accroissement est de deux sortes : l’un consiste dans une simple apposition extérieure de nouvelle matiere ; c’est ce qu’on nomme autrement juxta-position, & c’est ainsi, selon plusieurs Physiciens, que croissent les pierres, les coquilles, &c. V. Pierre & Coquille.
L’autre se fait par un fluide qui est reçû dans des vaisseaux, & qui y étant porté peu à peu, s’attache à leurs parois, c’est ce qu’on appelle intus-susception, & c’est ainsi, selon les mêmes Auteurs, que croissent les animaux & les plantes. V. Plante, Animal ; voyez aussi Végétation & Nutrition. (O)
Accroissement, action par laquelle les pertes du corps sont plus que compensées par la nutrition. Voyez Nutrition.
Il y a quelque chose d’assez remarquable dans l’accroissement du corps humain : le fœtus dans le sein de la mere croît toûjours de plus en plus jusqu’au moment de la naissance ; l’enfant au contraire croît toûjours de moins en moins jusqu’à l’âge du puberté, auquel il croît pour ainsi dire tout à coup, & arrive en fort peu de tems à la hauteur qu’il doit avoir pour toûjours. Il ne s’agit pas ici du premier tems après la conception, ni de l’accroissement qui succede immédiatement à la formation du fœtus ; on prend le fœtus à un mois, lorsque toutes ses parties sont développées ; il a un pouce de hauteur alors ; à deux mois deux pouces un quart, à trois mois trois pouces & demi, à quatre mois cinq pouces & plus, à cinq mois six pouces & demi ou sept pouces, à six mois huit pouces & demi ou neuf pouces, à sept mois onze pouces & plus, à huit mois quatorze pouces, à neuf mois dix-huit pouces. Toutes ces mesures varient beaucoup dans les différens sujets, & ce n’est qu’en prenant les termes moyens qu’on les a déterminées. Par exemple, il naît des enfans de vingt-deux pouces & de quatorze ; on a pris dix-huit pouces pour le terme moyen, il en est de même des autres mesures : mais quand il y auroit des variétés dans chaque mesure particuliere, cela seroit indifférent à ce que M. de Buffon, d’où ces observations sont tirées, en veut conclurre. Le résultat sera toûjours que le fœtus croît de plus en plus en longueur tant qu’il est dans le sein de la mere : mais s’il a dix-huit pouces en naissant, il ne grandira pendant les douze mois suivans que de six ou sept pouces au plus ; c’est-à-dire, qu’à la fin de la premiere année il aura vingt-quatre ou vingt-cinq pouces ; à deux ans, il n’en aura que vingt-huit ou vingt-neuf ; à trois ans, trente ou trente-deux au plus, & ensuite il ne grandira guere que d’un pouce & demi ou deux pouces par an jusqu’à l’âge de puberté : ainsi le fœtus croît plus en un mois sur la fin de son séjour dans la matrice, que l’enfant ne croît en un an jusqu’à cet âge de puberté, où la nature semble faire un effort pour achever de développer & de perfectionner son ouvrage en le portant, pour ainsi dire, tout à coup au dernier degré de son accroissement.
Le fœtus n’est dans son principe qu’une goutte de liqueur limpide, comme on le verra ailleurs ; un mois après toutes les parties qui dans la suite doivent devenir osseuses, ne sont encore que des cellules remplies d’une espece de colle très-déliée. Le fœtus passe promptement du néant, ou d’un état si petit que la vûe la plus fine ne peut rien appercevoir, à un état d’accroissement si considérable au moyen de la nourriture qu’il reçoit du suc laiteux ; qu’il acquiert dans l’espace de neuf mois la pesanteur de douze livres environ, poids dont le rapport est certainement infini avec celui de son premier état. Au bout de ce terme, exposé à l’air, il croît plus lentement, & il devient dans l’espace de vingt ans environ douze fois plus pesant qu’il n’étoit, & trois ou quatre fois plus grand. Examinons la cause & la vîtesse de cet accroissement dans les premiers tems, & pourquoi il n’est pas aussi considérable dans la suite. La facilité surprenante qu’a le fœtus pour être étendu, se concevra si on fait attention à la nature visqueuse & muqueuse des parties qui le composent, au peu de terre qu’elles contiennent, à l’abondance de l’eau dont elles sont chargées, enfin au nombre infini de leurs vaisseaux, que les yeux & l’injection découvrent dans les os, dans les membranes, dans les cartilages, dans les tuniques des vaisseaux, dans la peau, dans les tendons, &c. Au lieu de ces vaisseaux, on n’observe dans l’adulte qu’un tissu cellulaire épais, ou un suc épanché : plus il y a de vaisseaux, plus l’accroissement est facile. En effet le cœur alors porte avec une vîtesse beaucoup plus grande les liquides ; ceux qui sont épanchés dans le tissu cellulaire s’y meuvent lentement, & ils ont moins de force pour étendre les parties. Il doit cependant y avoir une autre cause ; savoir, la plus grande force & le plus grand mouvement du cœur qui soit dans le rapport des fluides & des premiers vaisseaux : ce point saillant déjà vivifié dans le tems que tous les autres visceres dans le fœtus, & tous les autres solides, ne sont pas encore sensibles, la fréquence du pouls dans les jeunes animaux, & la nécessité nous le font voir. Effectivement l’animal pourroit-il croître si le rapport du cœur du tendre fœtus à ses autres parties, étoit le même que celui du cœur de l’adulte à toutes les siennes. La force inconnue, quelle qu’elle puisse être, qui met les parties des corps animés en mouvement, paroît produire un plus grand effet dans le fœtus que dans l’adulte, dans lequel tous les organes des sensations s’endurcissent, tandis qu’ils sont extrèmement tendres & sensibles dans le fœtus. Telles sont l’œil, l’oreille, la peau, le cerveau même. Ceci ne peut-il pas encore s’expliquer, en ce que le fœtus a la tête plus grosse, par le rapport plus grand des nerfs des jeunes animaux au reste de leurs parties ?
Ne doit-il donc pas arriver que le cœur faisant effort contre les vaisseaux muqueux il les étende aisément, de même que le tissu cellulaire qui les environne, & les fibres musculaires arrosées par des vaisseaux ? Or toutes ces parties cedent facilement,parce qu’elles renferment peu de terre, & qu’au contraire elles sont chargées de beaucoup de gluten qui s’unit & qui se prête aisément. L’ossification doit donc se faire lorsque le suc gelatineux renfermé entre deux vaisseaux paralleles, devient osseux à la suite du battement réiteré de ces vaisseaux. Les os s’accroissent lorsque les vaisseaux placés le long de leurs fibres viennent à être étendus par le cœur ; ces vaisseaux en effet entraînent alors avec eux les fibres osseuses, ils les allongent, & elles repoussent les cartilages qui limitent les os & toutes les autres parties qui, quoique cellulaires, sont cependant élastiques. Ces fibres s’étendent entre leurs épiphyses, de sorte qu’elles les rendent plus courtes, mais plus solides. Tel est le méchanisme par lequel les parties du corps s’allongent, & par lequel il se forme des intervalles entre les fibres osseuses, cellulaires & terreuses qui se sont allongées. Ces intervalles sont remplis par les liquides, qui sont plus visqueux & plus gelatineux dans les jeunes animaux que les adultes. Ces liquides contractent donc plus facilement des adhérences, & se moulent sur les petites cavités dans lesquelles ils entrent. La souplesse des os dans le fœtus, la facilité avec laquelle ils se consolident, la plus grande abondance du suc glutineux & de l’humeur gelatineuse dans les membres des jeunes animaux, & le rapport des cartilages aux grands os, font voir que les os dans les jeunes sujets sont d’une nature plus visqueuse que dans les vieillards : mais plus l’animal approche de l’adolescence, & plus l’accroissement se fait lentement. La roideur des parties qui étoient souples & flexibles dans le fœtus ; la plus grande partie des os qui auparavant n’étoient que des cartilages, en sont des preuves. En effet, plusieurs vaisseaux s’affaissant à la suite du battement des gros troncs qui leur sont voisins, ou dans les membranes desquels ils se distribuent, ces vaisseaux sont remplacés par des parties solides qui ont beaucoup plus de consistance. Effectivement le suc osseux s’écoule entre les fibres osseuses ; toutes les membranes & les tuniques des vaisseaux sont formées d’un tissu cellulaire plus épais : d’ailleurs, une grande quantité d’eau s’évaporant de toutes les parties, les filets cellulaires se rapprochent, ils s’attirent avec plus de force, ils s’unissent plus étroitement, ils résistent davantage à leur séparation ; l’humeur glaireuse, qui est adhérente aux os & aux parties solides, se seche ; la compression des arteres & des muscles dissipe le principe aqueux : les parties terreuses sont en conséquence dans un plus grand rapport avec les autres.
Toutes ces choses se passent ainsi jusqu’à ce que les forces du cœur ne soient plus suffisantes pour étendre les solides au-delà. Ceci a lieu lorsque les épiphyses cartilagineuses dans les os longs, se sont insensiblement diminuées au point qu’elles ne peuvent l’être davantage, & que devenues extrèmement minces & très-dures, elles se résistent à elles-mêmes, & au cœur en même tems. Or comme la même cause agit de même sur toutes les parties du corps, si on en excepte un petit nombre, tout le tissu cellulaire, toutes les membranes des arteres, les fibres musculaires, les nerfs, doivent acquérir insensiblement la consistance qu’ils ont par la suite, & devenir tels que la force du cœur ne soit plus capable de les étendre.
Cependant le tissu cellulaire lâche & entrecoupé de plusieurs cavités, se prête dans différens endroits à la graisse qui s’y insinue, & quelquefois au sang : ce tissu se gonfle dans différentes parties ; ainsi quoiqu’on ne croisse plus, on ne laisse pas de grossir. Il paroît que cela arrive, parce que l’accroissement n’ayant plus lieu, il se sépare du sang une plus petite quantité de sucs nourriciers, il reste plus de matiere pour les secrétions ; la résistance que trouve le sang dans les plus petits vaisseaux, devient plus grande par leur endurcissement : les secrétions lentes doivent alors être plus abondantes, le rapport de la force du cœur étant moindre, puisque la roideur des parties augmente la résistance, & que d’ailleurs la force du cœur ne paroît pas devenir plus grande. En effet, le cœur est un muscle qui tire principalement sa force de sa souplesse, de la grande quantité du suc nerveux qui s’y distribue, eu égard à la solidité de la partie rouge du sang, (comme nous le dirons ailleurs). Or bien loin que la vieillesse augmente toutes ces choses, elle les diminue certainement : ainsi le corps humain n’a point d’état fixe, comme on le pourroit penser. Quelques vaisseaux sont continuellement détruits & se changent en fibres d’autant plus solides, que la pression du poids des muscles & du cœur a plus de force dans différentes parties : c’est pour cela que les parties dont les ouvriers se servent plus fréquemment se roidissent ; le tissu cellulaire devient aussi continuellement plus épais, plus dur ; l’humeur glutineuse plus seche & plus terreuse ; les os des vieillards deviennent en conséquence roides ; les cartilages s’ossifient. Lorsque le gluten, dont toutes les parties tiennent leur souplesse, vient à être détruit, elles deviennent dures, le tissu cellulaire même du cerveau, du cœur, des arteres, sont dans ce cas ; la pesanteur spécifique des différentes parties du corps devient plus grande, & même celle du crystallin : enfin la force attractive des particules glutineuses des liqueurs du corps humain diminue par les alimens salés dont on a fait usage, par les boissons inflammables, par les excès de tout genre. Le sang dégénere donc en une masse friable,acre, & qui n’est point gelatineuse : c’est ce que font voir la lenteur des cicatrices des plaies & des fractures, la mauvaise odeur de l’haleine, de l’urine, la plus grande quantité des sels du sang, la diminution de sa partie aqueuse, & l’opacité des humeurs qui étoient autrefois transparentes.
C’est pourquoi les ligamens intervertébraux venant à se sécher, à se durcir, & à s’ossifier, ils rapprochent insensiblement en devant les vertebres les unes des autres ; on devient plus petit & tout courbé. Les tendons deviennent très-transparens, très durs & cartilagineux, lorsque le gluten qui étoit dans l’interstice de leurs fibres est presque détruit. Les fibres musculaires, les vaisseaux, & surtout les arteres, deviennent plus dures, l’eau qui les rendoit molles étant dissipée : elles s’ossifient même quelquefois. Le tissu cellulaire lâche se contracte, forme des membranes d’une tissure plus serrée : les vaisseaux excréteurs sont en conséquence comprimés de part & d’autre, & leurs petits orifices se ferment : la sécheresse des parties diminue donc les secrétions nécessaires du sang, les parties se roidissent, la température du sang devient plus seche & plus terreuse ; de maniere qu’au lieu de l’humeur que le sang déposoit auparavant dans toutes les parties du corps, il n’y porte plus qu’une vraie terre, comme on le sait par les endurcissemens qui arrivent, par les croûtes osseuses répandues dans les arteres, dans les membranes, dans la superficie de la plûpart des os, surtout des vertebres, & quelquefois dans les parties les plus molles, comme on l’a observé dans toutes les parties du corps.
C’est la voie naturelle qui conduit à la mort, & cela doit arriver lorsque le cœur devient plus compact ; que sa force n’augmente pas à proportion des résistances qu’il rencontre ; & que par conséquent il succombe sous la charge. Lorsque le poumon, qui est moins susceptible de dilatation, résiste au ventricule droit du cœur, de même que tout le système des arteres capillaires, qui d’ailleurs font beaucoup de résistance au cœur, le mouvement du sang se ralentit insensiblement, il s’arrête, & le sang s’accumule surtout dans le ventricule droit, parce qu’il ne trouve plus de passage libre par le poumon, jusqu’à ce qu’enfin le cœur palpitant pendant quelque tems, le sang s’arrête, se coagule, & le mouvement du cœur cesse.
La nature a presque marqué le terme auquel tous les animaux doivent arriver : on n’en sait pas bien les raisons. L’homme qui vit long-tems vit naturellement deux fois plus que le bœuf & que le cheval, & il s’en est trouvé assez fréquemment qui ont vécû cent ans, & d’autres qui sont parvenus à 150. Les oiseaux vivent plus long-tems que les hommes ; les poissons vivent plus que les oiseaux, parce qu’au lieu d’os ils n’ont que des cartilages, & ils croissent continuellement.
La durée totale de la vie peut se mesurer en quelque façon par celle du tems de l’accroissement. Un arbre ou un animal qui prend en peu de tems son accroissement, périt beaucoup plûtôt qu’un autre auquel il faut plus de tems pour croître. Dans les animaux comme dans les végétaux, l’accroissement en hauteur est celui qui est achevé le premier. Un chêne cesse de grandir long-tems avant qu’il cesse de grossir. L’homme croît en hauteur jusqu’à seize ou dix-huit ans, & cependant le développement entier de toutes les parties de son corps en grosseur, n’est achevé qu’à trente ans. Les chiens prennent en moins d’un an leur accroissement en longueur ; & ce n’est que dans la seconde année qu’ils achevent de prendre leur grosseur. L’homme qui est trente ans à croitre, vit quatre-vingts-dix ans ou cent ans ; le chien qui ne croît que pendant deux ou trois ans, ne vit aussi que dix ou douze ans : il en est de même de la plûpart des autres animaux. Les poissons qui ne cessent de croître qu’au bout d’un très-grand nombre d’années, vivent des siecles, &c. comme nous l’avons déjà insinué. Cette longue durée de leur vie doit dépendre de la constitution particuliere de leurs arrêtes, qui ne prennent jamais autant de solidité que les os des animaux terrestres.
Les animaux qui ne produisent qu’un petit nombre de fœtus, prennent la plus grande partie de leur accroissement, & même leur accroissement tout entier, avant que d’être en état d’engendrer ; au lieu que les animaux qui multiplient beaucoup, engendrent avant même que leur corps ait pris la moitié, ou même le quart de son accroissement. L’homme, le cheval, le bœuf, l’âne, le bouc, le belier, ne sont capables d’engendrer que quand ils ont pris la plus grande partie de leur accroissement, il en est de même des pigeons & des autres oiseaux qui ne produisent qu’un petit nombre d’œufs : mais ceux qui en produisent un grand nombre, comme les coqs, les poules, les poissons, &c. engendrent bien plûtôt. Un coq est capable d’engendrer à l’âge de trois mois, & il n’a pas alors pris plus d’un tiers de son accroissement ; un poisson qui doit au bout de vingt ans peser trente livres, engendre dès la premiere ou la seconde année, & cependant il ne pese peut-être pas alors une demi-livre. Mais il y auroit des observations particulieres à faire sur l’accroissement & la durée de la vie des poissons : on peut reconnoître à peu près leur âge en examinant avec une loupe ou un microscope les couches annuelles dont sont composées leurs écailles : mais on ignore jusqu’où il peut s’étendre. On voit des carpes chez M. le Comte de Maurepas, dans les fossés de son château de Pontchartrain, qui ont au moins cent cinquante ans bien avérés, & elles paroissent aussi agiles & aussi vives que des carpes ordinaires. Il ne faut pas dire avec Leuwenhoek, que les poissons sont immortels, ou du moins qu’ils ne peuvent mourir de vieillesse. Tout doit périr avec le tems ; tout ce qui a eu une origine, une naissance, un commencement, doit arriver à un but, à une mort, à une fin : mais il est vrai que les poissons vivant dans un élément uniforme, & qu’étant à l’abri des grandes vicissitudes & de toutes les injures de l’air, ils doivent se conserver plus long-tems dans le même état que les autres animaux : & si ces vicissitudes de l’air sont, comme le prétend un grand Philosophe (le Chancelier Bacon) (Voyez son traité de la vie & de la mort) les principales causes de la destruction des êtres vivans, il est certain que les poissons étant de tous les animaux ceux qui y sont les moins exposés, ils doivent durer beaucoup plus long-tems que les autres. Mais ce qui doit contribuer encore plus à la longue durée de leur vie, c’est que leurs os sont d’une substance plus molle que ceux des autres animaux, & qu’ils ne se durcissent pas, & ne changent presque point du tout avec l’âge. Les arrêtes des poissons s’allongent, grossissent, & prennent de l’accroissement sans prendre plus de solidité, du moins sensiblement ; au lieu que les os des autres animaux, aussi bien que toutes les autres parties solides de leurs corps, prennent toujours plus de dureté & de solidité : & enfin lorsqu’elles sont absolument remplies & obstruées, le mouvement cesse, & la mort suit. Dans les arrêtes au contraire cette augmentation de solidité, cette replétion, cette obstruction qui est la cause de la mort naturelle, ne se trouve pas, ou du moins ne se fait que par degrés beaucoup plus lents & plus insensibles, & il faut peut-être beaucoup de tems pour que les poissons arrivent à la vieillesse.
La mort est donc d’une nécessité indispensable suivant les lois des corps qui nous sont connues, quoique la differente proportion de la force du cœur aux parties solides, la coction des alimens, le caractere du sang, la chaleur de l’air extérieur, puissent plus ou moins en éloigner le terme. En conséquence de ces lois, les vaisseaux les plus petits devoient être comprimés par les plus gros, le gluten devoit s’épaissir insensiblement, les parties aqueuses s’evaporer, & par conséquent les filets du tissu cellulaire s’approcher de plus en plus. Au reste, un régime de vie tranquille, qui n’est point troublé par les passions de l’ame & par les mouvemens violens du corps ; une nourriture tirée de végétaux ; la tempérance & la fraîcheur extérieure, peuvent empêcher les solides de devenir sitôt roides, suspendre la secheresse & l’acreté du sang.
Est-il croyable qu’il naisse ou renaisse de nouvelles parties dans le corps humain ? La maniere dont les polypes, & presque toute la famille des testacées se reproduisent ; la régénération des vers, des chenilles, des serres des écrevisses ; tous les différens changemens qui arrivent à l’estomac, la reproduction des queues des lésards, & des os qui occupent la place de ceux que l’on a perdus, prouvent-ils qu’ils se fait une pareille régénération dans toutes les parties des corps animés ? doit-on lui attribuer la réparation naturelle des cheveux (qui sont des parties organiques) des ongles, des plumes, la production des nouvelles chairs dans les plaies, celle de la peau, la réduction du scrotum, le cal des os ? La question est difficile à décider. Ceci a néanmoins lieu dans les insectes, dont la structure est simple & gelatineuse, & dont les humeurs lentes ne s’écoulent point, mais restent adhérentes aux autres parties du corps. Les membranes dans lesquelles se forment les hydatides dans l’homme, la génération des chairs dans les blessures, le cal qui fortifie non-seulement les os fracturés, mais qui encore tient lieu des os entiers, se forment d’une liqueur gelatineuse rendue compacte par la pulsation des arteres voisines prolongées : on n’a cependant jamais observé que de grandes parties organiques se soient régénérées. La force du cœur dans l’homme, & la tendance que les humeurs qui y séjournent ont à la pourriture, la structure composée du corps, qui est fort différente de celle des insectes, s’opposent à de pareilles régénérations.
Il y a une autre espece d’accroissement qui a paru merveilleux quand le hasard l’a découvert : on remarqua en Angleterre que nos corps étoient constamment plus grands le matin que le soir, & que cet accroissement montoit à six & sept lignes ; on examina ce nouveau phénomene, & on en donna l’explication dans les Transactions Philosophiques. Un esprit qui n’auroit pû étendre ses vûes que sur des objets déjà découverts, auroit vérifié grossierement ce phénomene, l’auroit étalé aux yeux du public sous une autre forme, l’auroit paré de quelque explication physique mal ajustée, auroit promis de dévoiler de nouvelles merveilles : mais M. l’Abbé de Fontenu s’est rendu maître de cette nouvelle découverte ; il a laissé si loin ceux qui l’avoient donnée au public, qu’ils n’ont osé publier leurs idées ; il est fâcheux que l’ouvrage où il a rassemblé ses observations n’ait pas été imprimé. Nous ne donnerons pas ici le détail de toutes les découvertes qu’il a faites sur cette matiere : mais nous allons donner des principes dont on pourra les déduire. 1°. L’épine est une colonne composée de parties osseuses séparées par des cartilages épais, compressibles & élastiques ; les autres cartilages qui se trouvent à la tête des os, & dans les jointures, ne paroissent pas avoir la même élasticité. 2°. Tout le poids du tronc, c’est-à-dire, le poids de cent livres au moins, porte sur l’épine ; les cartilages qui sont entre les vertebres sont donc comprimés quand le corps est debout : mais quand il est couché, ils ne portent plus le même poids ; ils doivent se dilater, & par conséquent éloigner les vertebres ; ainsi le tronc doit devenir plus long, mais ce sera là précisément une force élastique qui augmentera le volume des cartilages. Les fluides sont poussés continuellement par le cœur, & ils trouvent moins de résistance dans les cartilages lorsqu’ils ne sont pas comprimés par le poids du tronc, ils doivent donc y entrer en plus grande quantité & dilater les vaisseaux : mais ces vaisseaux ne peuvent se dilater sans augmenter le volume des cartilages, & sans écarter les vertebres : d’abord les cartilages extrèmement comprimés se rétablissent avec plus de force ; ensuite cette force diminuera par degrés, comme dans les bâtons fléchis, qui se restituent ; il est donc évident que l’accroissement qui se fait quand on est couché demande un certain espace de tems, parce que les cartilages, toûjours pressés, ne peuvent se rétablir dans un instant. De plus, supposons que l’accroissement soit de six lignes, chaque ligne d’augmentation ne se fait pas dans le même espace de tems ; les dernieres lignes demanderont un tems beaucoup plus long, parce que les cartilages ont moins de force dans le dernier tems de la restitution ; de même qu’un ressort qui se débande a moins de force sur la fin de sa détente. 3°. L’accroissement dans les cartilages, doit produire une augmentation dans le diametre de la poitrine ; car les côtes en général sont plus éloignées sur l’épine que sur le sternum, ou dans leur marche. Suivant cette idée, prenons-en deux du même côté, regardons-les comme formant un angle dont une vertebre & un cartilage sont la base. Il est certain que de deux triangles qui ont les côtés égaux & les bases inégales, celui qui a la base plus petite a plus de hauteur perpendiculaire : or la base de l’angle que forment ces deux côtés le soir, est plus petite que la base de l’angle qu’ils forment le matin ; il faut donc que le soir il y ait plus de distance de l’épine au sternum, ou bien il faut que les côtés se soient voutés, & par conséquent la poitrine aura plus de distance le soir que le matin. 4°. Après le repas les vaisseaux sont plus pleins, le cœur pousse le sang & les autres fluides avec plus de force, les vaisseaux agissent donc plus fortement sur les cartilages ; ils doivent donc porter dans leur intérieur plus de fluide, & par conséquent les dilater ; les vertebres doivent donc s’éloigner, & par conséquent il y aura un accroissement après le repas, & il se fera en plus ou moins de tems, selon la force des vaisseaux, ou selon la situation du corps ; car si le corps est appuyé sur le dossier d’une chaise, le poids du tronc portera moins sur les cartilages, ils seront donc moins pressés ; l’action des vaisseaux qui arrivent dans les cartilages trouvera donc moins de résistance, elle pourra donc mieux les dilater : mais quand l’action des vaisseaux commencera à diminuer, le décroissement arrivera, parce que la pesanteur du corps l’emportera alors sur l’action des vaisseaux, laquelle ne sera plus aussi vigoureuse quand la digestion sera faite, & quand la transpiration, qui est très-abondante trois heures après le repas, aura diminué le volume, & par conséquent l’action des vaisseaux, & la chaleur qui porte partout la raréfaction. 5°. Il y a un accroissement & un décroissement auquel toutes ces causes n’ont pas la même part ; quand on est couché on devient plus long d’un demi pouce, même davantage : mais cette augmentation disparoît dès qu’on est levé. Deux faits expliqueront ce phénomene. 1°. L’épine est plus droite quand on est couché, que lorsque le corps est sur ses piés. 2°. Le talon se gonfle, & ce gonflement disparoît par le poids du corps ; au reste cet accroissement & ce décroissement sont plus considérables dans la jeunesse, que dans l’âge avancé. M. Senac, Essais de Physique. (L)
Accroissement, se dit, en Medecine, de l’augmentation d’une maladie. Le tems de l’accroissement est un tems fâcheux ; c’est celui où les accidens augmentent en nombre, en durée & en violence ; si l’on saisit la maladie dès son commencement, on pourra prévenir la force de l’accroissement. Voyez Maladie. (N)
Accroissement, en Jardinage, se dit des plantes lorsqu’elles ont fait un grand progrès, & de belles pousses. Voyez Végétation. (K)
ACCROIST. Voyez Accroissement.
ACCROISTRE (Commerce) en un sens neutre, se dit d’une chose qui passe à un associé ou co-propriétaire, par droit d’accroissement, en conséquence de ce que celui qui possédoit cette portion est mort ou l’a abandonnée. (G)
ACCROUPI, adject. en terme de Blason, se dit du Lion quand il est assis, comme celui de la ville d’Arles, & celui de Venise. On dit la même chose de tous les animaux sauvages qui sont dans cette posture, & des lievres, lapins & conils qui sont ramassés, ce qui est leur posture ordinaire, lorsqu’ils ne courent pas.
Paschal Colombier, en Dauphiné, d’argent à un singe accroupi de gueules : quelques-uns de la même famille l’ont porté rampant. (V)
ACCRUES, terme de Marchands de filets ; faire des boucles au lieu de mailles pour accrocher les filets ; c’est ce qu’ils appellent jetter des accrues.
ACCUBITEUR, s. m. (Hist. anc.) Officier du Palais des Empereurs de Constantinople. C’étoit un Chambellan qui couchoit auprès du Prince, pour la sûreté de sa personne. (G)
ACCUL, s. m. terme de Marine : les Navigateurs de l’Amérique se servent de ce mot pour désigner l’enfoncement d’une baie. Le mot de cul-de-sac a parmi eux la même signification. Ils disent l’accul du petit Goave, & le cul-de-sac de la Martinique. (Z)
ACCULÉ, terme de Blason ; il se dit d’un cheval cabré quand il est sur le cul en arriere, & de deux canons opposés sur leurs affuts, comme les deux que le Grand-Maître de l’Artillerie met au bas de ses armoiries pour marque de sa dignité.
Harling en Angleterre, d’argent à la licorne acculée de sable accornée & onglée d’or. (V)
ACCULEMENT ou ACULEMENT, s. m. terme de Marine : c’est la proportion suivant laquelle chaque gabarit s’éleve sur la quille plus que la maîtresse côte, ou premier gabarit, ou l’évidure des membres qu’on place à l’avant & à l’arriere du vaisseau. Voy. Varangue acculé. (Z)
ACCULER (Manége.) se dit lorsque le cheval qui manie sur les voltes ne va pas assez en avant à chacun de ses tems & de ses mouvemens ; ce qui fait que ses épaules n’embrassent pas assez de terrein, & que sa croupe s’approche trop près du centre de la volte. Cheval acculé, votre cheval s’accule & s’entable tout à la fois. Les chevaux ont naturellement de l’inclination à s’acculer en faisant les demi-voltes. Quand les Italiens travaillent les chevaux au répolon, ils affectent de les acculer. Acculer a un autre sens parmi le vulgaire, & se dit d’un cheval qui se jette & s’abandonne sur la croupe en desordre lorsqu’on l’arrête, ou qu’on le tire en arriere. Voyez Volte, Répolon. &c. (V)
ACCUMULATION, subst. f. entassement, amas de plusieurs choses ensemble. Ce mot est fait du Latin ad, & cumulus, monceau.
Accumulation ou Cumulation, en Droit, est la jonction de plusieurs titres avec lesquels un prétendant se présente pour obtenir un héritage ou un bénéfice, qu’un seul de ces titres pourroit lui acquérir. Voyez Cumulation. (H)
ACCUSATEUR, s. m. en Droit, est celui qui poursuit quelqu’un en Justice pour la réparation d’un crime qu’il lui impute. Chez les Romains l’accusation étoit publique ; & tout citoyen se pouvoit porter accusateur. En France un particulier ne se peut porter accusateur qu’entant que le crime lui a apporté personnellement du dommage, & il ne peut conclurre qu’à des réparations civiles : mais il n’appartient qu’au Ministere public, c’est-à-dire, au Procureur Général ou son Substitut, de conclurre à des réparations pénales : c’est lui seul qui est chargé de la vindicte publique. Et le particulier qui révele en Justice un crime où il n’est point intéressé, n’est point accusateur, mais simple dénonciateur, attendu qu’il n’entre pour rien dans la procédure, & n’est point poursuivant concurremment avec le Procureur Général, comme l’est l’accusateur intéressé.
Dans le cas où l’accusé se trouveroit innocent par l’évenement du Procès, l’accusateur privé doit être condamné à des dommages & intérêts, à l’exception d’un petit nombre de cas ; au contraire du Procureur Général, contre lequel l’accusé absous ne peut prétendre de recours pour raison de dommages & intérêts ; parce que l’usage de ce recours nuiroit à la recherche des crimes, attendu que les Procureurs du Roi ne l’entreprendroient qu’en tremblant, s’ils étoient responsables en leur nom de l’évenement du Procès. Seulement, si au défaut de partie civile il y a un dénonciateur, l’accusé absous pourra s’en prendre à lui pour ses dommages & intérêts.
Accusateur differe de dénonciateur, en ce qu’on suppose que le premier est intéressé à la recherche du crime qu’il révele, au contraire du dénonciateur.
ACCUSATIF, s. m. terme de Grammaire ; c’est ainsi qu’on appelle le 4e cas des noms dans les Langues qui ont des déclinaisons, c’est-à-dire, dans les Langues dont les noms ont des terminaisons particulieres destinées à marquer différens rapports, ou vûes particulieres sous lesquelles l’esprit considere le même objet. « Les cas ont été inventés, dit Varron, afin que celui qui parle puisse faire connoître, ou qu’il appelle, ou qu’il donne, ou qu’il accuse. Sunt destinati casus ut qui de altero diceret, distinguere posset, quùm vocaret, quùm daret, quùm accusaret ; sic alia quædam discrimina quæ nos & Groecos ad declinandum duxerunt. Varro, lib. I. de Anal.
Au reste les noms que l’on a donnés aux différens cas ne sont tirés que de quelqu’un de leurs usages, & sur-tout de l’usage le plus fréquent, ce qui n’empêche pas qu’ils n’en aient encore plusieurs autres, & même de tout contraires ; car on dit également donner à quelqu’un, & ôter à quelqu’un, défendre & accuser quelqu’un ; ce qui a porté quelques Grammairiens (tel est Scaliger) à rejetter ces dénominations, & à ne donner à chaque cas d’autre nom que celui de premier, second, & ainsi de suite jusqu’à l’ablatif, qu’ils appellent le sixieme cas.
Mais il suffit d’observer que l’usage des cas n’est pas restraint à celui que leur dénomination énonce. Tel est un Seigneur qu’on appelle Duc ou Marquis d’un tel endroit ; il n’en est pas moins Comte ou Baron d’un autre. Ainsi nous croyons que l’on doit conserver ces anciennes dénominations, pourvû que l’on explique les différens usages particuliers de chaque cas.
L’accusatif fut donc ainsi appellé, parce qu’il servoit à accuser, accusare aliquem : mais donnons à accuser la signification de déclarer, signification qu’il a même souvent en François, comme quand les Négocians disent accuser la réception d’une Lettre ; & les joüeurs de Piquet, accuser le point. En déterminant ensuite les divers usages de ces cas, j’en trouve trois qu’il faut bien remarquer.
1. La terminaison de l’accusatif sert à faire connoître le mot qui marque le terme ou l’objet de l’action que le verbe signifie. Augustus vicit Antonium, Auguste vainquit Antoine. Antonium est le terme de l’action de vaincre ; ainsi Antonium est à l’accusatif, & détermine l’action de vaincre. Vocem proecludit metus, dit Phedre en parlant des grenouilles épouvantées du bruit que fit le soliveau que Jupiter jetta dans leur marais ; la peur leur étouffa la voix, vocem est donc l’action de proecludit. Ovide parlant du palais du Soleil, dit que materiem superabat opus ; materiem ayant la terminaison de l’accusatif, me fait entendre que le travail surpassoit la matiere. Il en est de même de tous les verbes actifs transitifs, sans qu’il puisse y avoir d’exception, tant que ces verbes sont présentés sous la forme d’actifs transitifs.
Le second service de l’accusatif c’est de terminer une de ces prépositions qu’un usage arbitraire de la Langue Latine détermine par l’accusatif. Une préposition n’a par elle-même qu’un sens appellatif ; elle ne marque qu’une sorte, une espece de rapport particulier : mais ce rapport est ensuite appliqué, & pour ainsi dire individualisé par le nom qui est le complément de la préposition : par exemple, il s’est levé avant, cette préposition avant marque une priorité. Voilà l’espece de rapport : mais ce rapport doit être déterminé. Mon esprit est en suspens jusqu’à ce que vous me disiez avant qui ou avant quoi. Il s’est levé avant le jour, ante diem ; cet accusatif diem détermine,
- ↑ Ce Prospectus a été publié au mois de Novembre 1750.
- ↑ M. l’Abbé de Condillac, de l’Académie royale des Sciences de Prusse, dans son Traité des Systémes.
- ↑ M. Rousseau de Genêve, Auteur de la Partie de l’Encyclopédie qui concerne la Musique, & dont nous espérons que le Public sera très satisfait, a composé un Discours fort éloquent, pour prouver que le rétablissement des Sciences & des Arts a corrompu les mœurs. Ce Discours a été couronné en 1750 par l’Académie de Dijon, avec les plus grands éloges ; il a été imprimé à Paris au commencement de cette année 1751, & a fait beaucoup d’honneur à son Auteur.
- ↑ Voir errata.



















